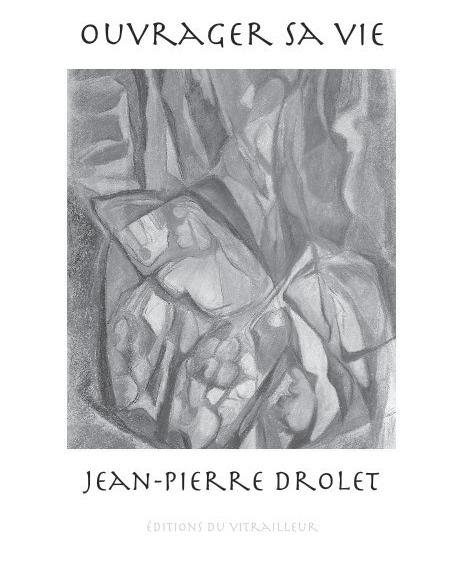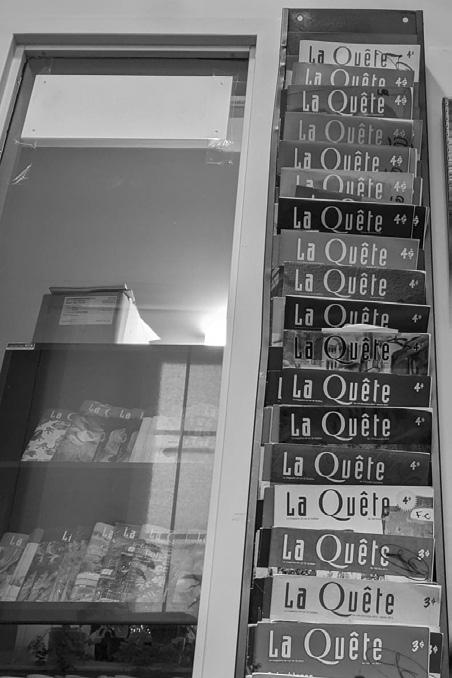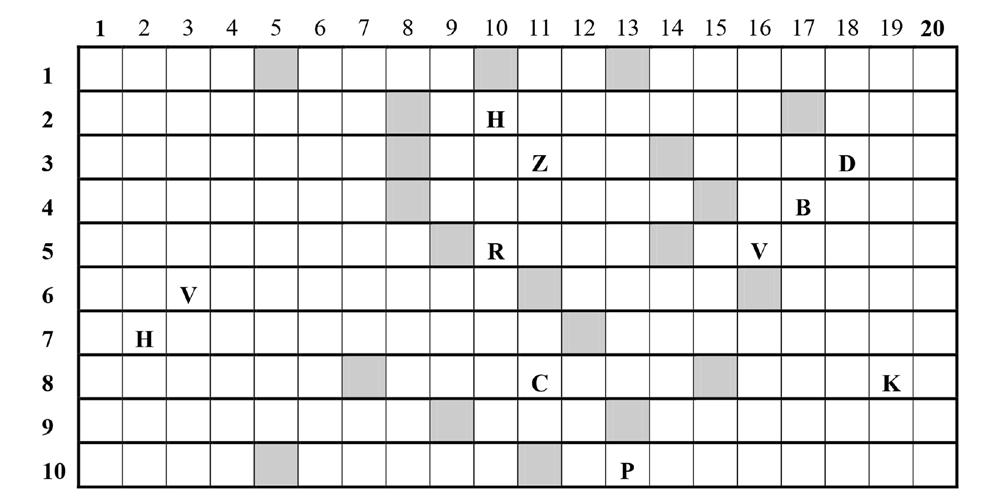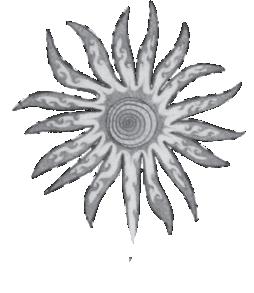3 minute read
Une chambre en ville
C o u r t o i s i e : M a r t i n e C o r r i v a u l t
En 2020, les personnages de roman — ou de téléroman — vivent rarement dans une « maison de chambres » : ce n’est ni glamour ni sexy comme milieu de vie, « la dernière porte avant la rue », comme disent les gens du CMCQ. Les temps ont bien changé depuis la Pension Velder et la télésérie Chambres en ville.
Advertisement
Au siècle dernier (!), la radio et la télévision situaient les intrigues d’au moins deux séries dramatiques autour des locataires d’un toit qui leur offrait un certain esprit de famille. Le premier auteur à s’y intéresser a été Robert Choquette, poète et romancier, qui était aussi scripteur à Radio-Canada au début des années 1930. (Né à Manchester dans une famille québécoise partie gagner sa vie là-bas, il était revenu terminer ses études à Montréal et « finira » ambassadeur du Canada.)
Profitant de sa propre expérience, il imagina, dans un cours d’écriture pour le nouveau médium qu’était alors la radio, une histoire dont l’action se déroulerait dans une maison de chambres. L’idée développée se retrouva sur les ondes de la radio de Radio-Canada de 1938 à 1942 sous forme d’un radio-feuilleton. On y racontait la vie des habitants à la Pension Velder, une pension de famille comme on disait alors, tenue par une veuve belge et ses deux enfants, ce qui lui permettait de garder sa grande maison bourgeoise.
Dans l’esprit de l’époque, les personnages sont un étudiant, sa fiancée, un professeur de musique, une commère amoureuse du confident de la veuve, des gens « bien » du moins en façade qui trouvent gîte et couvert chez Mme Velder. Après la guerre, le sujet sera repris à la télévision, de 1959 à 1961, sous le titre Les Velder que l’auteur tentera de ramener, en 1977 en retrouvant lieux et hôtesse avec Quinze ans plus tard. Mais la société a changé et les bobos des pensionnaires de Mme Velder n’intéressent plus le public friand de plus d’action.
Pourtant, à la fin des années 1980, Lise Payette écrit, avec sa fille Sylvie, une nouvelle version de la « pension » avec Chambres en ville (1989-1996). Cette fois, ce sont des adolescents qui cohabitent, sous l’aile d’une adulte compréhensive jouée par Louise Deschâtelets. Le public de l’époque n’a pas oublié les frasques de Lola et Pete (Anne Dorval et Francis Reddy) dans cette pépinière de nouveaux acteurs où grandiront les Patricia Paquin, Marie-Soleil Tougas, Gregory Charles, Marie-Josée Croze et bien d’autres. Leurs personnages apprivoisaient alors liberté et vie réelle dans une atmosphère quasi familiale.
Un demi-siècle plus tard, la société québécoise a bien changé et d’une décennie à l’autre, les portraits qu’en brosse la télévision n’ont pas cessé de se transformer au gré de l’évolution. Quel que soit le cadre des histoires, on y parle de nous et des multiples visages de notre petit monde. Renée Legris¹, historienne du téléroman québécois, a analysé les contenus et observe les mutations dans la manière de représenter les situations. Même des classiques comme Les belles histoires ou Les Plouffe en sont transformées.
Les moyens de diffusion se multiplient même si pour remplir leurs grilles de programmation, les entreprises ne sont pas prêtes à investir dans la nouveauté. Les auteurs s’intéressent aux problèmes des groupes, des familles, des individus et le public exige d’être ému et surpris. Mme Legris observe que les images ne sont pas toujours innocentes. La culture de la violence et de la mort, l’hédonisme et la sexualité omniprésente sont bien installés à l’écran, qu’il soit grand ou petit, fixe ou mobile.
Dans les pensions de famille d’hier comme dans les maisons de chambres qui subsistent aujourd’hui librement ou au sein de structures organisées, des générations de Québécois de tous les âges défilent et ultimement se ressemblent à travers leurs rêves, leurs besoins, leurs maux, leurs bonheurs ou leurs souffrances.
C’est ce qu’ont voulu raconter des auteurs comme Marcel Dubé, Pierre Dufresne, Roger Lemelin, Mia Riddez après les Grignon, Guèvremont et Gélinas, qu’ont suivis Janette Bertrand, Arlette Cousture, Guy Fournier puis Fabienne Larouche, Sylvie Lussier, Anne Boyer, Michel D’Astous, Chantale Cadieux, Michelle Allen, Luc Dionne, Josée Fréchette, Florence Longpré et toute une nouvelle génération de témoins de nos histoires.
(1) Renée Legris a publié en 2011 chez Septentrion Une histoire des genres dramatiques à la radio québécoise et en 2013, Le téléroman québécois, 1953-2008.