

Khovantchina
Opéra de Modeste Moussorgski
Passion et partage
La Fondation du Groupe Pictet est fière de soutenir le volet pédagogique du « GTJ - Grand Théâtre Jeunesse ».
En participant à ce programme de formation, nous nous engageons en faveur de la génération à venir.
Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir offrir aux talents de demain l’opportunité de découvrir les joies de l’opéra et du ballet, et peut-être même de susciter des vocations.
Les associés du groupe Pictet vous souhaitent une très belle saison 2024-2025.
Le Grand Théâtre de Genève remercie ses mécènes et partenaires de la saison 2024-2025 pour leur engagement généreux et passionné.
SUBVENTIONNÉ PAR
BRIGITTE LESCURE
AVEC LE GÉNÉREUX SOUTIEN DE
RÉMY ET VERENA BEST
GRANDS MÉCÈNES
POUR LE PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
CAROLINE ET ÉRIC FREYMOND

MÉCÈNES
BLOOMBERG BOGHOSSIAN
FONDATION VRM
HYPOSWISS PRIVATE BANK GENÈVE SA
ANGELA ET LUIS FREITAS DE OLIVEIRA
MONA LUNDIN-HAMILTON FRANCE MAJOIE LE LOUS
CARGILL INTERNATIONAL SA FONDATION COROMANDEL VERA MICHALSKI-HOFFMANN
DANCE REFLECTIONS BY VAN CLEEF & ARPELS DENISE ELFEN-LANIADO FONDATION LÉONARD GIANADDA MÉCÉNAT
MKS PAMP SA FAMILLE ROLLAND
ADAM ET CHLOÉ SAID
PARTENAIRES MÉDIA
FAMILLE SCHOENLAUB FONDATION DU DOMAINE DE VILLETTE
RTS TV & ESPACE 2 LE TEMPS
LÉMAN BLEU LE PROGRAMME.CH
PARTENAIRES D'ÉCHANGE
DEUTZ FLEURIOT FLEURS TPG
L'USINE SPORTS CLUB MANOTEL
PARTENAIRE MÉDICAL OFFICIEL
CENTRE DE MÉDECINE DU SPORT ET DE L'EXERCICE HIRSLANDEN CLINIQUE LA COLLINE
GUY DEMOLE
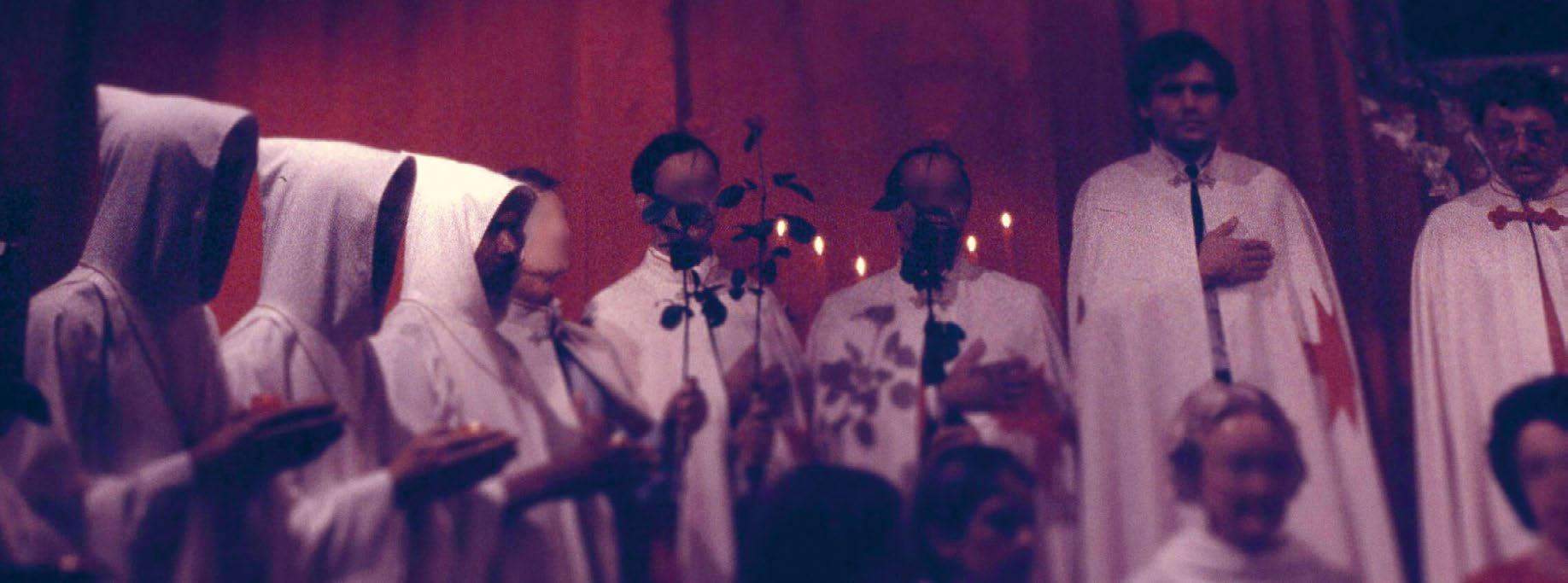













1 Image vidéo d'une cérémonie de l'OTS, archives de la Justice fribourgeoise. À droite, Luc Jouret et Joseph Di Mambro, fondateurs de l'ordre du Temple solaire qui provoquera la mort de 74 personnes dans plusieurs suicides collectifs © Point Prod
2 Wagon soviétique à Yerevan en Arménie © Aram Vardanyan
3 Gravure de la vue du mur du Kremlin et des murs de la ville de Moscou au XVIIe siècle © BLM Collection / Alamy Banque d'images
4 « Partout la vie » (1888), peinture de Nikolaï Aleksandrovich Iarochenko
5 Maurice Ravel et Igor Stravinsky en 1910
6 Portrait anonyme de la régente Sophia Alekseyevna de Russie, peint entre 1801 et 1850, exposé au Musée de l'Hermitage © wikicommons
7 © Alexander Kadnikov
8 Lénine embaumé et exposé (1924) © Universal History Archive/UIG / Bridgeman Images
9 Image du film « Troupe d'élite 2 » (« Tropa de Elite 2 : O Inimigo Agora É Outro ») de José Padilha © 2010 Globo Filmes / Feijao Filmes / Riofilme Zazen Producoes / DR Collection Christophel / Alamy Banque d'images
10 Sans titre, 1997-1998, Case History © 2011 Boris Mikhaïlov
11 L'exécution des streltsy dans « Histoire de Russie » de Blin de Sainmore. © collection privée / Alamy Banque d'images
12 « Te Deum » à l'église orthodoxe russe des vieux-croyants de Lyakhovo, district d'Orekhovo-Zuyevsky, oblast de Moscou (Guslitsa), 2008 © Wiki Commons
13 Portrait anonyme du Patriarche Nikon Musée de la nouvelle Jérusalem © Wiki commons
14 Photographie imaginée par l'intelligence artificielle de l'intérieur d'un train de transit vers un goulag

LA PEAU EST UN PARFUM




Khovantchina
Хованщина
Opéra de Modeste Moussorgski
Livret du compositeur
Version orchestrée de Dmitri Chostakovitch, finale d'Igor Stravinsky
Créé le 21 février 1886 (version Nikolaï Rimski-Korsakov) à Saint-Pétersbourg
Dernière fois au Grand Théâtre de Genève en 1981-1982
Nouvelle production
25, 28 mars, 1er et 3 avril 2025 — 19h
30 mars 2025 — 15h
Chanté en russe avec surtitres en français et anglais
Le spectacle durera environ quatre heures quinze avec un entracte inclus
Avec le soutien de
ANGELA ET LUIS
FREITAS DE OLIVEIRA
Roméo et Juliette

Beaucoup de bruit pour rien

Direction musicale
Alejo Pérez
Mise en scène
Calixto Bieito
Scénographie
Rebecca Ringst
Costumes
Ingo Krügler
Lumières
Michael Bauer
Vidéos
Sarah Derendinger
Dramaturgie
Beate Breidenbach
Direction des chœurs
Mark Biggins
Le prince
Ivan Khovanski
Dmitry Ulyanov
Le prince
Andreï Khovanski
Arnold Rutkowski
Le prince
Vassili Galitsine
Dmitry Golovnin
Dossifeï
Taras Shtonda
Marfa
Raehann Bryce-Davis
Le boyard Chaklovity
Vladislav Sulimsky
Emma
Ekaterina Bakanova
Scribe
Michael J. Scott
Susanna
Liene Kinča
Envoyé de Galitsine
Streshnev, un jeune héraut
Rémi Garin
Kouzka
Emanuel Tomljenović
Premier strelets
Vladimir Kazakov
Deuxième strelets
Mark Kurmanbayev
Varsonofiev
Igor Gnidii
Chœur du Grand Théâtre de Genève
Maîtrise du Conservatoire populaire de Genève
Orchestre de la Suisse
Romande
Prise de rôle
Membre du Jeune Ensemble
Votre entreprise, notre métier
Un accompagnement sur mesure
Financements et leasing
Solutions digitales
Gestion et investissement
Transmission d'entreprise

Intro | 0
Trois tendances politico-sociales s'affrontent dans Khovantchina : le courant tourné vers l'ouest, intéressé par une ouverture vers l'Europe, inspiré par Pierre le Grand et incarné dans l'opéra par le prince Golyzin, éclairé et cultivé ; le conservatisme des boyards, qui tiennent aux traditions ancestrales et veulent assurer leur pouvoir, représenté par Ivan Khovanski et ses redoutables régiments de streltsy ; et, enfin, les vieux-croyants, un groupe religieux sectaire et conservateur, prônant une Russie repliée sur elle-même et protégée de la décadence européenne, une force sociale tout à fait influente, menée par le prêtre Dossifeï. « Khovantchina » désigne d'ailleurs ici un complot fomenté par le boyard Khovanski et réprimé dans le sang par l'homme qui déterminera l'avenir de la Russie après la fin de l'opéra : Pierre le Grand.
La dernière œuvre de Moussorgski est un grand opéra choral, à la fois profondément enraciné dans la tradition musicale russe et largement tourné vers l'avenir. Le compositeur a dû laisser son héritage inachevé. En 1881, il meurt à l'âge de 42 ans seulement, anéanti par l'alcool. Plusieurs compositeurs se sont attelés à compléter cette œuvre dont le plus populaire est sans nul doute Rimski-Korsakov. Le Grand Théâtre de Genève présente l'œuvre dans l'instrumentation de Dmitri Chostakovitch, plus proche du langage musical âpre de Moussorgski avec toutefois le finale d'Igor Stravinsky qui emporte l'œuvre dans les strates de la transcendance spirituelle (et d'un pessimisme certain).
Intro | 1
Alimenté par le corpus de l'histoire russe, Khovantchina est l'occasion pour le metteur en scène d'origine espagnole de mettre en perspective la manipulation dont l'histoire fait l'objet, c'est-à-diresa sempiternelle réécriture et son utilisation par les autocrates d'hier et d'aujourd'hui. Tout en gardant une distance shakespearienne (ou moussorgskienne) face aux événements relatés — quelquefois fidèlement, quelquefois gorgés de fiction–, Calixto Bieito laisse rouler le train de l'histoire, avec un regard à la fois triste et sardonique, sans jamais perdre son humanité, et nous montre bien que ce que l'on raconte n'est jamais que ce que l'on veut raconter et que l'on ne voit que ce que l'on veut voir.
Avec cette production, il vient compléter son cycle d'opéras russes sur la scène genevoise, toujours accompagné du chef d'orchestre Alejo Pérez avec lequel la collaboration entamée dans Guerre et Paix de Prokofiev se poursuit après Lady Macbeth de Mtsensk de Chostakovitch. Au centre de la mise en scène de Bieito, toujours très imagée, se trouve, outre le chœur, le personnage féminin le plus important de l'opéra, Marfa, incarné ici par la fulgurante et époustouflante mezzo-soprano américaine Raehann Bryce-Davis. De retour au Grand Théâtre de Genève, la basse russe Dmitri Ulyanov incarne le prince Ivan Khovanski, à mille lieues de son géneral Koutouzov dans Guerre et Paix, de son Philippe II dans Don Carlos, ou encore de son Boris dans Lady Macbeth de Mtsensk. Le baryton Vladislav Sulimsky, impressionnant Macbeth au Festival de Salzbourg 2023 et dans le rôle titre de L'Idiot dans l’édition 2024, vient s'ajouter aux autres grands interprètes slaves de cette distribution dans le rôle du boyard Chaklovity.


Intro | 0
Three socio-political trends collide in Khovantchina: the West- facing current, interested in opening up towards Europe, inspired by Peter the Great and embodied in the opera by the enlightened and cultured Prince Golyzin; the conservatism of the boyars, who hold to ancestral traditions and want to ensure their power, represented by Ivan Khovanski and his formidable Streltsy regiments; and finally the Old Believers, a sectarian and conservative religious group advocating a Russia closed in on itself and protected from European decadence, and a very influential social force, led by the priest Dossifej. 'Khovanshchina' moreover refers here to a conspiracy hatched by the boyar Khovanski and bloodily repressed by the man who will determine the future of Russia after the opera: Peter the Great.
Mussorgsky's final work is a grand choral opera both deeply rooted in Russian musical tradition, and pointing very much towards the future. The composer had to leave his legacy unfinished, dying in 1881 at the age of just 42, destroyed by alcohol. Several composers stepped in to complete the work, among whom RimskiKorsakov is undoubtedly the most popular. The Grand Théâtre de Genève presents the work in Dmitri Shostakovich's orchestration, which is closer to Mussorgsky's harsh musical language, but with the finale by Igor Stravinsky which carries the work into the realms of spiritual transcendence (and of real pessimism).
Intro | 1
Fuelled by the corpus of Russian history, Khovantchina is an opportunity for the Spanishborn director to put the manipulation of history into perspective, in other words the endless rewriting of history and its use by autocrats past and present. While maintaining a Shakespearean (or Mussorgskian) distance from the events recounted — sometimes faithfully, sometimes crammed with fiction — Calixto Bieito lets the train of history roll along, with a look that is both sad and sardonic, without ever losing his humanity, and shows us that what we tell is only what we want to tell, and that we only see what we want to see.
This production sees the director complete his cycle of Russian operas for the Geneva stage, supported as ever by conductor Alejo Perez, with whom the collaboration began with Prokofiev's War and Peace and continues on from Shostakovich's Lady Macbeth of Mzensk. At the centre of Bieito's always-vivid staging, beyond the chorus, is the opera's most important female character, Marfa, played here by the dazzling and breathtaking American mezzo-soprano Raehann Bryce-Davis. Returning to the Grand Théâtre de Genève, russian bass Dmitri Ulyanov plays Prince Ivan Khovanski — worlds away from his General Kuzoumov in War and Peace, his Philip II in Don Carlos, or even his Boris in Lady Macbeth of Mtsensk. Baritone Vladislav Sulimsky, who impressed as Macbeth at the Salzburg Festival 2023 and in Der Idiot in the last edition, joins the cast's other great Slavic performers in the role of the boyar Chaklovity.




Vibrons pour la culture romande










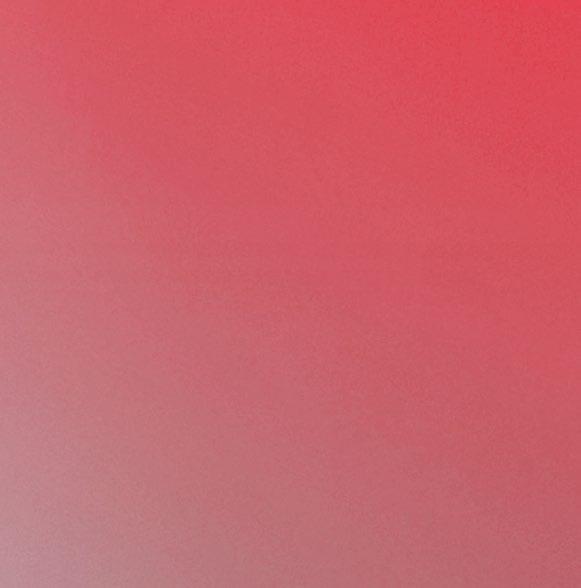



La RTS contribue au renforcement culturel romand, à la radio, à la télévision et sur le digital, grâce à près de 50 émissions culturelles hebdomadaires.


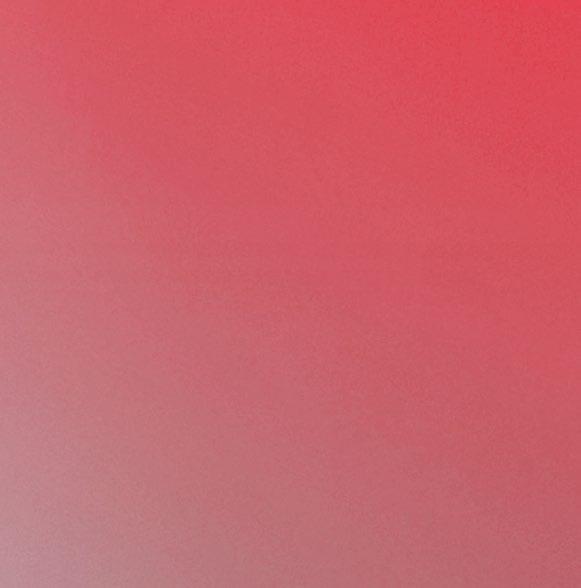



Contexte
À la fin du XVIIe siècle, la Russie est en proie à une crise d'État ainsi qu'à une crise religieuse.
À la mort du tsar Fiodor III, il n'y a pas d'héritier majeur pour monter sur le trône. C'est ainsi qu'on intronisa les deux demi-frères Ivan et Pierre, tous deux encore mineurs et, surtout, issus de familles ennemies... Sophie, demi-sœur et adversaire de Pierre, prit alors en charge les affaires gouvernementales. C'est elle qui provoqua une révolte au cours de laquelle les streltsy, la garde du palais de Sofia, qui était devenu une sorte d'État dans l'État, massacra une grande partie de la famille et des partisans de Pierre. Dès 1650, l'Église orthodoxe russe avait mis en place des réformes de certains dogmes et liturgies. Cependant, une grande partie des croyants s'est opposée à ces réformes et s'est séparée de l'Église principale. Ces raskolniki ou « vieuxcroyants » furent persécutés et chassés.
Acte I
Les streltsy sont comme enivrés par le bain de sang de la nuit précédente. Pendant ce temps, Chaklovity dicte à l'écrivain une dénonciation contre Ivan Khovanski, le chef des streltsy, qui a lui-même des ambitions de pouvoir et est en train de préparer un complot. La foule acclame Khovanski.
Andreï Khovanski a laissé tomber sa maîtresse, la vieille-croyante Marfa, et fait maintenant la cour à la jeune Emma. Mais son père Ivan Khovanski s'intéresse, lui aussi, à Emma et une violente dispute éclate. Dossifeï, le chef spirituel des vieux-croyants, s'interpose comme médiateur.
Acte II
Galitsine, un membre important du gouvernement et amant de Sofia, a demandé à Marfa de venir chez lui. Elle doit lui prédire son avenir. Marfa lui prédit sa chute prochaine ; Galitsine ordonne alors qu'on l'assassine.
Ivan Khovanski se présente chez Galitsine. Il lui reproche d'avoir réduit le pouvoir des boyards. Galitsine veut moderniser l'État russe et l'ouvrir vers l'Europe occidentale, tandis que Khovanski veut maintenir l'ordre ancien, le pouvoir des boyards et l'armée des streltsy. Les deux hommes se disputent violemment. Dossifeï arrive et tente à son tour de servir de médiateur ; pour lui, le salut de la Russie réside uniquement dans la foi telle qu'elle est pratiquée par les vieux-croyants.
C'est alors qu'à la grande consternation de Galitsine, Marfa revient. Elle a survécu à la tentative de meurtre : Pierre a pris le pouvoir de manière inattendue et ses troupes ont sauvé Marfa.
Chaklovity rapporte que Sofia a reçu une dénonciation anonyme accusant Ivan Khovanski de conspiration contre le tsar. Le tsar Pierre a ordonné une enquête sur cette Khovanshchina.


Acte III
Les vieux-croyants défilent imperturbablement dans la ville en entonnant des chants guerriers. Marfa est accusée de péché par la vieillecroyante fanatique Susanna en raison de son amour pour Andreï. Dossifeï prend le parti de Marfa et réprimande vertement Susanna.
Marfa avoue à Dossifeï à quel point sa passion la tourmente : commettre un suicide avec Andreï lui semble être la seule issue. Dossifeï l'exhorte à la patience et se présente lui-même comme le plus grand des pécheurs. Chaklovity déplore le sort de la Russie et appelle un élu de tous ses vœux.
Des streltsy ivres se livrent à des actes de vandalisme. Leurs femmes les maudissent, eux et leur éternel alcoolisme. Le scribe arrive en courant, paniqué, il a de mauvaises nouvelles : les troupes du tsar Pierre sont en marche. De nombreux streltsy ont déjà été massacrés. Les streltsy et leurs femmes se tournent alors vers Ivan Khovanski pour obtenir de l'aide. Mais celui-ci comprend qu'il n'a plus aucun pouvoir.
Acte IV
Première image
Ivan Khovanski tente d'étouffer sa peur en organisant une fête bruyante. Un proche de Galitsine l'avertit qu'il doit se méfier, qu'un grand danger le menace. Khovanski ignore tous les avertissements. Chaklovity lui transmet une invitation de Sofia : Khovanski doit aller consulter chez elle. Cela s'avère une ruse : Chaklovity assassine Khovanski.
Deuxième image
Les nouveaux dirigeants envoient Galitsine en exil. Le peuple assiste à son départ. Marfa annonce à Dossifeï que les vieux-croyants ne seront pas épargnés non plus : le gouvernement a ordonné leur assassinat. Dossifeï décide alors d'un suicide collectif. Andreï Khovanski, à moitié fou, est toujours à la recherche d'Emma. Marfa essaie de lui ouvrir les yeux sur la réalité et lui apprend la mort de son père. Il serait, lui aussi, en danger. Andreï ne la croit pas et appelle les streltsy.
Ceux-ci apparaissent, mais ils sont déjà désarmés. Les coups de cloches annoncent leur exécution, ordonnée par le tsar Pierre. Andreï est maintenant prêt à suivre Marfa. Au dernier moment, Streshnev annonce que les streltsy ont été graciés...
Acte V
Dossifeï et Marfa ne voient plus d'autre issue et se préparent au suicide collectif. Marfa rappelle son amour à Andreï. Tous se dirigent ensemble vers la mort.
Background
At the end of the 17th century, Russia was in the grip of a state crisis as well as a religious crisis. On the death of Tsar Fyodor III, there was no major heir to ascend the throne. The two halfbrothers Ivan and Peter, both still minors and, from enemy families, were enthroned. Sophie, half-sister and Peter's opponent took charge of government affairs. It was she who provoked a revolt during which the Streltsy, the palace guard, which had become a state within a state, massacred a large part of Peter's family and supporters. From 1650, the Russian Orthodox Church had introduced reforms to certain dogmas and liturgies. However, a large proportion of the faithful opposed these reforms and broke away from the main Church. These raskolniki or 'Old Believers' were persecuted and driven out.
Act I
The Streltsy are as if intoxicated by the bloodshed of the previous night. Meanwhile, Chaklovity dictates to the writer a denunciation against Ivan Khovansky, the leader of the Streltsy, who has ambitions of power himself and is plotting a conspiracy. The crowd cheers Khovansky.
Andrei Khovansky has left his mistress, the Old Believer Marfa, and is now courting the young Emma. But her father Ivan Khovansky is also interested in Emma and a violent argument breaks out. Dossifei, the spiritual leader of the Old Believers, intervenes as a mediator.
Act II
Golitsin, an important member of the government and Sofia's lover, has asked Marfa to come to his house. She is to tell him his fortune. Marfa foretells his imminent downfall; Golitsin then orders that he be assassinated.
Ivan Khovansky goes to Golitsin's house. He criticises him for having reduced the power of the boyars. Golitsin wants to modernise the Russian state and open it up to Western Europe, while Khovansky wants to maintain the old order, the power of the boyars and the Streltsy army. The two men argue violently. Dossifei arrives and in turn tries to mediate; for him, the salvation of Russia lies solely in the faith as practised by the Old Believers.
Then, to Golitsin's great dismay, Marfa returns. She had survived the assassination attempt: Peter had unexpectedly seized power and his troops had saved Marfa.
Chaklovity reports that Sofia had received an anonymous denunciation accusing Ivan Khovansky of plotting against the Tsar. Tsar Peter ordered an investigation into this 'Khovanshchina'.
Act III
The Old Believers parade imperturbably through the city, singing war songs. Marfa is accused of sin by the fanatical Old Believer Susanna because of her love for Andrei. Dosifei takes Marfa's side and sharply reprimands Susanna.
Marfa confesses to Dosifei how much her passion torments her: committing suicide with Andrei seems to her to be the only way out. Dosifei urges her to be patient and presents himself as the greatest of sinners. Chaklovity laments the fate of Russia and calls for an elected official of his choice.
Drunken Streltsy indulge in acts of vandalism. Their wives curse them and their eternal alcoholism. The scribe arrives running, panicked, with bad news: the troops of Tsar Peter are on the march. Many Streltsy have already been massacred. The Streltsy and their wives turn to Ivan Khovansky for help. But he realises that he no longer has any power.
Act IV
First image
Ivan Khovansky tries to stifle his fear by organising a noisy party. A close friend of Golitsin's warns him that he must beware, that he is in great danger. Khovansky ignores all the warnings. Chaklovity sends him an invitation from Sofia: Khovansky must go and visit her at her home. This turns out to be a trick: Chaklovity murders Khovansky.
Second image
The new rulers send Golitsin into exile. The people witness his departure. Marfa tells Dosifei that the Old Believers will not be spared either: the government has ordered their assassination. Dosifei then decides on a collective suicide. Andrei Khovansky, half mad, is still searching for Emma. Marfa tries to open his eyes to reality and tells him of his father's death. He too is in danger. Andrei does not believe her and calls out to the Streltsy.
They appear, but they are already unarmed and, heralded by the tolling of the bells, on their way to their execution, ordered by Tsar Peter. Andrei is now ready to follow Marfa. At the last moment, Streshnev announces that the Streltsy have been pardoned...
Act V
Dossifei and Marfa see no other way out and prepare for collective suicide. Marfa reminds Andrei of her love. They all head to their deaths together.
Le Briefing
Chaque matin à 6h, la newsletter du Temps fait le tour de l’actualité pour démarrer la journée bien informé
Tous les matins, le Briefing vous livre un résumé des informations qui comptent, un agenda des événements à ne pas manquer ainsi qu’une sélection d’articles exclusifs, de l'analyse au reportage.
Inscrivez-vous gratuitement en scannant le code QR ou sur letemps.ch
1839

Modeste Petrovitch Moussorgski naît à Karevo, dans le nord de la Russie. Il est le plus jeune fils d'une famille de riches propriétaires terriens.
1845
Reçoit ses premières leçons de piano de sa mère à l'âge de 6 ans.
1849
La famille s'installe à SaintPétersbourg.
1856
Moussorgski s'engage comme officier dans le régiment de garde Preobrajensky, l'unité créée par le tsar Pierre le Grand.
1857
Moussorgski fait la connaissance de Mili Balakirev, qui devient son professeur de piano et de théorie musicale.
Le cercle Balakirev voit le jour. Plus tard, il sera appelé le « Puissant petit groupe ».
1861
L'abolition du servage par le tsar Alexandre II entraîne des pertes financières pour la famille de Moussorgski. Ce soudain dénuement fait naître en lui le besoin de thématiser la misère et l'injustice sociale dans ses compositions.
1863
Pour des raisons financières, s'installe dans un appartement partagé avec cinq autres jeunes hommes. Début d'une activité de fonctionnaire dans le Département d'ingénierie.
1865
Décès de sa mère. En automne, Moussorgski est atteint de delirium tremens.
1867
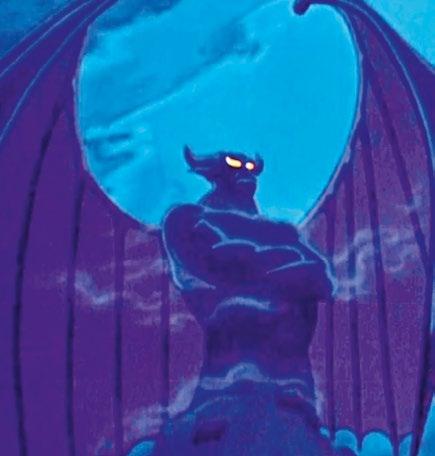
Première grande œuvre orchestrale, le poème symphonique Une Nuit sur le mont Chauve.
1868
Entre à nouveau dans la fonction publique en tant que fonctionnaire. L'insatisfaction professionnelle que ressent Moussorgski renforce sa tendance à l'alcoolisme.
1869

Première version de l'opéra Boris Godounov en sept scènes. Deuxième version en quatre actes avec prologue en 1872.
1872
Moussorgski commence à travailler sur Khovantchina.
1874
Tableaux d'une exposition, musique pour piano d'après des tableaux de feu son ami Viktor Hartmann. Œuvre publiée par Nikolaï Rimski-Korsakov et orchestrée par Maurice Ravel.
1880
Le 1er janvier, Moussorgski est suspendu de la fonction publique en raison de son alcoolisme.
1881
Après plusieurs crises d'épilepsie, il est hospitalisé le 26 février, où Ilya Répine fait son portrait peu avant sa mort.
Khovantchina de Modeste Moussorgski (1839-1881)
Livret de Modeste Moussorgski
Version de Dmitri Chostakovitch avec le finale d'Igor Stravinsky*
Premier Acte Moscou.
La place Rouge
Оркестровая интродукция
Prélude
1. Подойду, подойду… в Ивангород Me rendrai… en la ville d'Ivangorod
(streltsy, Kouzka, Clerc)
2. Эй, эй ты, строчило! Hé ! Hé, là-bas, greffier !
(streltsy, Kouzka, Clerc, Chaklovity)
3. Ай, да, весело!
Ohé ! Joie !
(streltsy, Kouzka, Clerc, Ivan Khovanski, Mocovites, Le Peuple)
4. Пустите, пустите! Laissez-moi !
(Emma, Andreï Khovanski, Marfa)
5. Что такое?
Que se passe-t-il ?
(Ivan Khovanski, Emma, Andreï Khovanski, Marfa, streltsy, Kouzka, Le Peuple)
6. Стой! Arrête !
(Dossifeï, Ivan Khovanski, Emma, Andreï Khovanski, Marfa, streltsy, Kouzka, Le Peuple, Les vieux-croyants)
Deuxième acte
Chez le prince
Vassili Galitsine
1. Свет мой, братец Васенька
Mon très cher frère, Vassenka
(Vassili Galitsine, Varsonofiev)
2. К вам, княже Entrez chez vous, Prince
(Marfa, Vassili Galitsine, Varsonofiev)
3. А мы без докладу Nous entrons
(Ivan Khovanski, Vassili Galitsine)
4. Знаешь ли ты Sais-tu quel est mon sang ?
(Dossifeï, Ivan Khovanski, Vassili Galitsine)
5. Княже, княже! Prince, Prince !
(Marfa, Dossifeï, Ivan Khovanski, Vassili Galitsine)
6. Князя! Princes!
(Chaklovity, Marfa, Dossifeï, Ivan Khovanski, Vassili Galitsine)
Troisième acte Zamoskvoretche. Le faubourg des streltsy
1. Посрамихом, пререкором Nous avons anéanti, nous avons révoqué (Les vieux-croyants)
2. Исходила младешенка À travers prairies et marais (Marfa)
3. Грех!
Quel péché!
(Marfa, Susanna)
4. По что мятешися?
Pourquoi t'agiter ainsi ?
(Dossifeï, Marfa, Susanna)
5. Спит стрелецкое гнездо Il dort, le nid des streltsy (Chaklovity)
6. Поднимайтесь, молодцы!
Debouts, les braves!
(streltsy, Les femmes des streltsy, Chaklovity, Kouska)
7. Беда, беда…
Malheur, malheur…
(Le clerc, streltsy, Les femmes des streltsy, Kouska)
8. Здорово, детки
Le bonjour, mes enfants
(Ivan Khovanski, streltsy, Les femmes des streltsy, Kouska)
Quatrième acte
Premier tableau :
La salle à manger du prince
Ivan Khovanski
1. Возле речки на лужочке Près du ruisseau (Ivan Khovanski, Les jeunes Paysannes)
2. Игры и пляски персидок Danses persanes
3. Ты зачем? Que veux-tu ?
(Ivan Khovanski, Chaklovity, Les jeunes Paysannes)
Deuxième tableau : Moscou
4. Глянь-ко! Везут как есть! Regarde voir ! (Le Peuple)
5. Свершилося решение судьбы La destinée s'est accomplie (Dossifeï, Marfa)
6. А ты здесь, злодейка! Ah, te voilà, scélérate ! (Andreï Khovanski, Marfa)
7. Не дай пощады Pas de pitié
(Andreï Khovanski, Marfa, streltsy, Les Femmes des streltsy, Strechnev)
Cinquième acte
Une forêt de pins. Un ermitage. Nuit de la lune
1. Здесь, на этом месте святе
Ici, en ce lieu sacré (Dossifeï, Les vieux-croyants)
2. Боже, грех мой Mon amour est mon péché (Marfa, Andreï Khovanski)
3. Труба предвечного Les trompettes de la Nuit des temps (Marfa, Andreï Khovanski, Dossifeï, Les vieux-croyants)
4. Господь спасет меня* Dieu, sauve moi ! Les vieux-croyants
Khovantchina défend des thèmes universels
Rencontre entre Calixto Bieito, metteur en scène, et Beate Breidenbach, dramaturge.
Calixto Bieito, vous avez déjà mis en scène deux opéras de compositeurs russes, ici, au Grand Théâtre de Genève, d'abord Guerre et Paix de Sergueï Prokofiev, puis Lady Macbeth de Mtsensk de Dmitri Chostakovitch. Voilà maintenant la troisième œuvre russe, Khovantchina de Moussorgski. Qu'est-ce qui, selon vous, relie ces trois pièces ?
Il y a des thèmes similaires qui sont abordés dans les trois opéras : la brutalité humaine, par exemple, ainsi que la haine. Musicalement aussi, ces trois opéras se rejoignents ; on sent que les trois compositeurs viennent du même pays et obéissent à la même tradition musicale. Par ailleurs, la répression politique, à laquelle les compositeurs sont confrontés, relie également les œuvres. Je le perçois de façon très claire. Même dans Khovantchina, j'ai le sentiment que Moussorgski a été entravé dans son désir de liberté. Il me semble qu'il ne l'a pas composée de manière aussi indépendante et libre qu'il l'aurait probablement souhaité. Cette impression est peut-être aussi procurée par le fait qu'il n'a pas pu achever ni orchestrer l'opéra, étant mort à seulement 42 ans.
Selon vous, quel est le thème central de Khovantchina ?
Je pense qu'il s'agit surtout de la façon dont l'histoire peut être manipulée. L'opéra parle également de la manipulation et de l'attisement des émotions telles que la haine, le fanatisme et le radicalisme. La capacité de ne pas penser, de désactiver la pensée, crée l'histoire. L'histoire devient une machine qui efface les hommes.
L'œuvre se situe dans un contexte historique concret : elle raconte la période chaotique d'un grand bouleversement en Russie autour de 1700, juste avant l'arrivée au pouvoir de Pierre le Grand, des révoltes sanglantes des streltsy, des conspirations et des jeux de pouvoir qui se terminent de manière fatale. En quoi ce qui est raconté ici est-il typique de la Russie ?
Khovantchina contient de nombreuses références historiques, et elles concernent bien sûr la Russie. Le compositeur était Russe et l'opéra est chanté en russe. Pourtant, je pense que cette œuvre aborde des thèmes universels, des thèmes qui nous concernent tous et qui ne

Entretien avec Calixto Bieito
Calixto Bieito © Carole Parodi
se limitent pas à l'histoire de la Russie. En fin de compte, il s'agit de la question de savoir à quel point il est difficile d'être vraiment libre. Mais il s'agit aussi de la signification du mot liberté et des moyens qui sont mis en place pour l'obtenir et échapper à la manipulation. Ici, il est question d'autocratie et de peur. Des thèmes qui ne pourraient être plus actuels et universels. Le travail de Moussorgski a, pour moi, une dimension aussi universelle que les tragédies de William Shakespeare. J'espère que notre mise en scène de Khovantchina amènera à réfléchir sur la valeur réelle de nos sociétés libérales ainsi que sur la façon dont nous pourrions les préserver et les développer. Je ressens en ce moment une grande incertitude, une grande fragilité et beaucoup de peur. Je n'ai malheureusement pas beaucoup d'espoir pour nous. Comment Erda dit-elle dans L'Or du Rhin, déjà ? « Tout ce qui est, finit. »
Actuellement, les événements se bousculent dans le monde et ne donnent en effet pas beaucoup de raisons d'espérer… Comment faites-vous face au fait que cette pièce soit devenue si actuelle ces dernières années ?
J'essaie d'éviter les actualisations trop faciles. Ce ne pourrait d'ailleurs pas être autrement, car il semble que nous vivions actuellement dans un grand accelerando ; toute forme d'actualisation de la politique actuelle serait déjà dépassée demain. Comme vous l'avez mentionné, la période à laquelle se déroule l'opéra de Moussorgski connaissait de grands bouleversements. De la même façon, nous traversons une période de grands changements. Avec l'essor de l'intelligence artificielle, une nouvelle ère technologique a commencé, dont nous ne savons pas encore où elle nous mènera. Cette évolution est incroyablement rapide. Et ce n'est que le début. Cela ne me semble pas être une évolution
très positive pour l'humanité. Je pense encore à Shakespeare qui parlait de la roue de l'histoire qui tourne éternellement ; il n'y a pas d'échappatoire.
Cela semble très fataliste…
Oui, absolument. C'est mon impression : nous ne pouvons vraiment pas changer notre destin. Nous sommes dans un train qui roule sans fin, implacable et inarrêtable. En espagnol, il y a un proverbe qui dit : « Arrêtez le monde, je veux descendre ! » Mais, malheureusement, cela n'est pas possible.
Dans Khovantchina, il y a le groupe des vieuxcroyants qui, d'une certaine façon, tente de s'opposer aux changements dans le monde : ils refusent d'accepter les réformes de la liturgie orthodoxe russe. Cependant, pour eux non plus, il n'y a pas d'avenir… ils finissent par s'immoler. Donc même dans la religion, il ne se trouverait plus d'espoir ?
Je ne pense pas. Il me semble que dans les sociétés occidentales, la majorité des gens n'a plus de lien fort avec la religion. De plus, l'Église chrétienne a accumulé bien des fautes dans le passé, pensons seulement à son rôle dans l'Allemagne nazie. L'histoire de l'Église est pleine de luttes de pouvoir et d'opportunisme. Et dans le présent, il y a tellement de fanatisme. C'est effrayant. Pour moi, Khovantchina ne se termine pas simplement sur la mort et l'immolation des vieux-croyants, mais surtout sur l'effondrement des sociétés occidentales et même de l'Europe entière, telle que nous la connaissons. Le train de l'histoire entraîne tout sur son passage. Où va-t-il exactement ? Personne ne le sait. Mais chacun aura ses propres associations avec cette image.
Vous l'avez mentionné, Moussorgski n'a pas pu terminer son opéra et il existe plusieurs versions de la fin : une version de Nikolaï Rimski-Korsakov et une deuxième de Dmitri Chostakovitch. C'est cette dernière que nous avons choisie pour notre représentation, mais avec une fin différente…
Dans cette fin — en fait, dans toute l'œuvre —, on retrouve ce que je voulais dire par manipulation de l'histoire. Lorsque Moussorgski est mort, il n'existait qu'une série d'esquisses du cinquième acte. Le premier à l'arranger était RimskiKorsakov qui voyait Pierre le Grand, lequel n'apparaît jamais dans la pièce mais dont le règne commençait historiquement au milieu de l'opéra, comme le représentant d'une Russie moderne et meilleure ; son orchestration se termine donc par des trompettes éclatantes annonçant l'arrivée de Pierre. Chostakovitch, qui proposa une deuxième version orchestrale en 1950, conclut, lui aussi, avec les trompettes de Pierre le Grand, puis inséra une reprise du début de l'opéra, ce qui reflète une vision positive de la figure très ambivalente de Pierre comme le grand modernisateur, telle qu'elle prévalait en Union soviétique. Quant à la fin proposée par Stravinsky, elle reste beaucoup plus fidèle aux esquisses existantes de Moussorgski, qui était un profond pessimiste ; tous les personnages importants meurent, à l'exception de Chaklovity qui sera d'ailleurs lui-même englouti par l'histoire. Même Galitsine, qui représentait l'ouverture de la Russie vers l'Europe, n'a plus d'avenir dans l'empire de Pierre. La version de Stravinsky se termine sur une note sombre et poétique. Cette version n'est pas seulement plus proche des intentions originales de Moussorgski, elle correspond davantage à ma vision de cette œuvre. C'est pourquoi nous l'avons choisie pour notre mise en scène.
Le drame du peuple russe
Ulrich Schmid
L'histoire russe est une manne pour les librettistes. Elle est peuplée de sinistres tsars, d'éminentes figures religieuses, d'intrigants aristocrates et de paysans désespérés. Le règne des autocrates est ponctué d'insurrections, de guerres de palais et d'assassinats politiques. Modeste Moussorgski se montra fasciné par ces bouleversements et ces changements de pouvoir, ainsi que par les vagues de souffrances et d'espoirs et s'inspira régulièrement de cette époque sanglante de l'empire des tsars. Encore jeune compositeur, Moussorgski composa des extraits du poème Les Haïdamaques de Taras Chevtchenko, dans lequel le poète ukrainien décrivait la révolte des Cosaques de Zaporogue contre la domination polono-lituanienne en 1768. Plus tard, Moussorgski composa son premier opéra sur la pièce historique d'Alexandre Pouchkine Boris Godounov. Godounov était monté sur le trône de Russie en 1598, certainement après avoir fait assassiner le tsarévitch légitime Dimitri. Cet événement marqua le début des « Temps des troubles », période qui culmina avec l'occupation polonaise de Moscou en 1612. Pour Moussorgski, ce n'est toutefois pas la lutte de pouvoir qui est au premier plan de ce sujet, mais bien plus le peuple
russe, lui-même. En 1874, il dédicace d'ailleurs la partition pour piano avec ces mots : « Je considère le peuple comme une personnalité de premier plan, animée d'une pensée unitaire. Tel était le problème que j'ai tenté de résoudre dans mon opéra. »
La version moderne de l'histoire selon Moussorgski contredisait diamétralement l'historiographie russe qui lui était contemporaine.
Sergueï Soloviov, le père du célèbre philosophe Vladimir Soloviov, publia entre 1851 et 1879 une Histoire de la Russie en 29 volumes. L'auteur se concentrait, d'une part, sur la grandeur nationale de la Russie et, d'autre part, sur la signification des différentes figures dirigeantes. L'orientation clairement patriotique de l'œuvre monumentale de Soloviov correspondait à l'image que l'élite sociale russe se faisait d'elle-même, ne se préoccupant guère des intérêts des classes inférieures. Cependant, le petit peuple gronde. En effet, bien que le tsar Alexandre II ait aboli le servage en 1861, les paysans restaient économiquement dépendants de leurs seigneurs. En 1866, l'autorité du souverain russe fut pour la première fois ouvertement remise en question.



Un terroriste tira sur le tsar, mais manqua sa cible. S'ensuivit alors une série d'attentats spectaculaires : une explosion au Palais d'Hiver ou encore une attaque du train de la cour du tsar. Finalement, en 1881, Alexandre II fut victime d'un attentat à la bombe alors qu'il était dans une calèche.
La seconde moitié du XIXe siècle fut marquée en Russie par des luttes de différentes idées politiques, sociales et philosophiques. Depuis le Congrès de Vienne en 1815, l'empire tsariste occupait une position dominante en Europe. En 1849, le tsar russe Nicolas Ier aida même le jeune empereur François-Joseph à réprimer la révolte hongroise, ce qui lui valut le surnom de « Gendarme de l'Europe ». La défaite russe lors de la guerre de Crimée (1852-1855) mit subitement fin à cette domination et les débats idéologiques qui avaient déjà débuté dans les années 1830 s'en trouvèrent renforcés. Les « occidentalistes » et les « slavophiles » se livraient une lutte pour l'avenir de la Russie. Les « occidentalistes » voulaient rejoindre le plus rapidement possible les nations leaders, à savoir la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, tandis que les « slavophiles » appelaient à un retour à leurs propres racines. Ironie de l'histoire, les deux parties étaient de façon pourtant surprenante d'accord sur le diagnostic de la misère russe. L'empire tsariste était en retard, économiquement peu performant et doté d'un système hégémonique anachronique. Une grande partie de la population vivait dans une pauvreté extrême. Toutefois, pour les « slavophiles », l'absence de progrès était justement le principal atout de la Russie. Ils pensaient, romantiquement, qu'une solidarité sociale originelle s'était maintenue en Russie. La Sobornost était devenue un concept central pour les slavophiles, à savoir l'universalité de l'Église qui comprenait la communauté ecclésiale des hommes au sein
de la Russie. En fin de compte, cette tradition slavophile fit apparaître l'image idéale d'une théocratie qui doit apporter à la Russie non seulement le bien-être social, mais aussi le salut religieux. Ainsi, la position slavophile s'opposait explicitement aux Lumières en Europe, qui substituaient une raison mécanique à l'amour mutuel.
C'est dans ce contexte dramatique que Moussorgski écrivit son opéra Khovantchina. Le critique d'art Vladimir Stassov joua un rôle décisif dans la création de l'œuvre, en aidant Moussorgski à rédiger le livret. L'influent critique et le jeune compositeur s'étaient rencontrés en 1858 alors que se formait le groupe musical Le Groupe des Cinq, aussi appelé « Puissant petit groupe », composé de Moussorgski, Mili Balakirev, Alexandre Borodine, César Cui et Nikolaï RimskiKorsakov. Dans le débat entre « occidentalistes » et « slavophiles », les compositeurs du groupe adoptèrent une attitude intermédiaire. Contrairement à Piotr Tchaïkovski par exemple, qui concevait ses œuvres dans le respect de la tradition romantique européenne, ils veillaient à respecter les codes du chant traditionnel russe. Ils voulaient en effet fonder une musique nationale propre et se considéraient ainsi comme des novateurs, qui non seulement se démarquaient de la mélodie dominante d'Europe occidentale, mais qui se soulevaient aussi courageusement contre les conventions sociales figées de leur époque.
Au sein de ce groupe, Stassov assumait aussi bien le rôle de mentor que celui de communicant. Il encouragea non seulement une musique, mais aussi un art russe. Lorsqu'en 1870, un groupe d'artistes talentueux s'insurgea contre l'esthétique néoclassique de la peinture académique et organisa des expositions itinérantes de tableaux dans tout l'empire,
Stassov n'hésita pas, par ailleurs, à soutenir ce mouvement. Les artistes, qui diffusaient leur art auprès d'un large public même en province, peignaient des scènes du quotidien à la campagne comme à la ville, dans un style réaliste. Ils espéraient ainsi rompre avec la culture dominante aristocratique et intégrer tout le peuple dans l'esthétique et la réception de l'art.
Si Stassov et Moussorgski ont tout d'abord entretenu une relation plutôt distante, ils se sont rapidement rapprochés et Stassov devint bientôt le principal conseiller artistique de Moussorgski. En 1866, Moussorgski composa une romance nommée Séminariste. Il était clair pour le compositeur que l'orientation anticléricale de cette chanson ne trouverait pas grâce aux yeux de la censure tsariste. C'est pourquoi les partitions furent imprimées à Leipzig. En tentant d'importer l'œuvre en Russie, la douane confisqua l'ensemble du tirage, tout en laissant cependant au compositeur trois exemplaires. Moussorgski en envoya un à Stassov en 1870 et l'accompagna de l'habile dédicace : « Le coupable de ce triomphe. De Moussorjanin » (un jeu de mots censé évoquer le nom de famille du compositeur, et dans lequel moussor signifie poubelle). En 1872, Moussorgski écrivit dans une lettre à son mentor : « Je vous dédie l'époque de ma vie où Khovantchina verra le jour. Je vous offre ma propre vie et ma vie pendant cette période. »
En tant que contemporains éveillés, Moussorgski et Stassov observèrent les évolutions contradictoires de l'empire tsariste : la libération des paysans face à la montée du terrorisme, le début de l'industrialisation entraînant la paupérisation de larges couches de la population, la diffusion des idées des Lumières éclipsée par l'obscurantisme de l'Église d'État très puissante. Le choix du thème de l'opéra Khovantchina n'était évidemment pas un hasard,
mais bien le reflet de l'actualité de la fin du XVIIe siècle qui se revivait dans le présent de Moussorgski. À travers cette allégorie historique, le compositeur parvient à faire un commentaire critique sur la culture et la situation de la nation russe de la fin du XIXe siècle. Dans l'histoire russe, Khovantchina est un nom d'époque péjoratif désignant une conspiration du prince Ivan Khovanski. Après la mort du tsar Fiodor Alexievitch en 1862, il n'y avait pas d'héritier majeur au trône. Deux demi-frères de la famille Romanov étaient considérés comme les successeurs légitimes : le faible d'esprit Ivan et le cadet Pierre, qui devait monter sur le trône en 1689. Durant cette vacance de pouvoir, la sœur d'Ivan, Sofia, voulait faire valoir ses droits à la régence. Finalement, c'est le prince Ivan Khovanski qui l'aide à imposer sa domination, notamment grâce à son régiment de streltsy. Cependant, peu de temps après, le chef des streltsy, Khovanski, voulut s'emparer lui-même du pouvoir. Le complot ayant été mis au grand jour, Khovanski et son fils furent exécutés.
La dimension politique et militaire de ce conflit fut occultée par une âpre querelle religieuse. En 1653, le patriarche Nikon avait prescrit aux fidèles de l'Église orthodoxe russe de se signer avec trois doigts et non plus deux comme auparavant, trois doigts symbolisant la Trinité alors que deux soulignaient la double nature divine et humaine de Jésus. Les opposants à la réforme de l'Église critiquèrent cette nouveauté, arguant que c'était le Christ-humain qui était mort sur la croix et non le dieu trinitaire. Plus tard, d'autres nouveautés, qui ne firent pas l'unanimité, apparurent. Ainsi, le culte se terminait désormais par un triple alléluia au lieu d'un double ; de plus, l'orthographe cyrillique du nom « Jésus » fut modifiée. Si d'un point de vue actuel, ce changement peut sembler anodin, il ébranla alors le cœur de la foi, à laquelle s'identifiaient
les hommes du début de l'ère moderne. Nikon ne voulait pas moderniser la pratique religieuse, mais au contraire la rapprocher à nouveau du rite grec traditionnel. Ce faisant, il déclencha toutefois un schisme au sein de l'Église. En 1666, les vieux-croyants désobéirent ainsi au patriarche. Des deux côtés, on s'accusait alors d'apostasier la véritable foi. Les vieux-croyants voyaient en Nikon un antéchrist. Le chef de groupe était le protopope (où « pope » désigne un prêtre orthodoxe) Avvakoum, qui écrivit l'une des premières autobiographies de la littérature russe. En 1682, il fut brûlé sur le bûcher comme hérétique. Ivan Khovanski sympathisait avec les vieux-croyants, qui voyaient dans le futur tsar Pierre un antéchrist. Les vieux-croyants espéraient que Khovanski reviendrait sur les réformes de l'Église. Avec l'anéantissement de la révolte des streltsy en 1689, les perspectives d'avenir des vieux-croyants s'amenuisèrent également. La gestion stricte de l'empire par Pierre ne laissait plus de possibilités d'existence au groupe dans la partie européenne de la Russie. Ils émigrèrent dans des régions reculées de Sibérie, où les structures étatiques étaient peu développées.
En travaillant sur son opéra, Moussorgski s'est intéressé de près à la Khovantchina. Il a rempli son carnet d'extraits de sources historiques et de traités scientifiques. Il existe toutefois quelques divergences significatives entre sa fiction historique et les faits réels. En effet, la trahison politique du rôle-titre Ivan Khovanski est soulignée par une infidélité religieuse et émotionnelle : il courtise la belle luthérienne Emma qui est convoitée par son fils. Dans la célèbre scène finale, les vieux-croyants montent d'eux-mêmes sur le bûcher, alors qu'ils étaient en réalité victimes de la répression de l'État. La révolte des streltsy comme montrée dans l'opéra correspond à une compilation de différents
soulèvements des années 1682, 1689 et 1698. Il est particulièrement frappant de constater que les représentants de la dynastie des Romanov, Sofia, Ivan et Pierre, qui se disputent le trône, n'apparaissent pas du tout dans l'opéra de Moussorgski. Ce n'était toutefois pas une obligation imposée par la censure, mais plutôt une volonté de Moussorgski de montrer l'histoire russe vue « d'en bas ».
Le parti pris historique de Moussorgski dans son opéra Khovantchina n'est pas évident à saisir. Il est alors difficile de savoir si l'opéra se positionne idéologiquement en faveur du futur souverain impérial Pierre et il est très probable que ce manque de clarté soit volontaire. Le public est ainsi contraint de se concentrer sur le problème central de Moussorgski : l'absence de liberté du peuple russe, qui dispose certes de plusieurs possibilités de gouvernement (le prince insurgé Khovanski, les prétendants rivaux au trône, les vieux-croyants), mais qui est privé de toutes possibilités d'actions. Moussorgski part d'une constellation similaire pour interpréter son propre présent. Le « tsar libérateur » Alexandre II avait certes tenté de réformer la société d'ordres russe, sans vraiment y parvenir complètement, puisque soit l'opposition se trouvait à l'étranger, soit elle s'était déjà radicalisée. Les activités du journaliste républicain Alexandre Herzen à Londres ne se sont pas étendues jusqu'en Russie et les actions terroristes de différents groupes révolutionnaires entraînèrent une répression de plus en plus forte de la part des autorités de l'empire tsariste. Avec Khovantchina, Moussorgski constata une désorientation de la société similaire à celle qui avait prévalu en Russie 200 ans plus tôt : l'agenda politique du tsar est particulièrement ambigu, les idées libérales peinent à s'imposer, les extrémistes violents n'apportent aucune solution et ne font qu'aggraver la situation. Ainsi, Moussorgski
se trouva au cœur des débats de son temps avec son analyse musicale de la misère russe. Charles Darwin publia en 1859 son ouvrage révolutionnaire de biologie de l'évolution
De l'origine des espèces. En 1872, Moussorgski écrivait dans une lettre à Stassov : « Alors que Darwin éclaire l'homme sur son origine, il sait exactement à quel être vivant il a affaire. Sans que l'homme le sache, il est pris dans un étau. » Il est intéressant de relever que la vision pessimiste de Moussorgski sur la Russie apparaît clairement dans le nom de genre qu'il a donné à Khovantchina. Moussorgski ne qualifiait pas son œuvre d'« opéra », mais de « drame musical populaire ». Il soulignait ainsi qu'il ne considérait pas ce qui se passait sur scène comme un spectacle en costumes éloigné de la vie, mais plutôt comme une mise en scène critique de problèmes sociaux fondamentaux, montrant ainsi dans son drame populaire russe le drame du peuple russe.
L'opéra de Moussorgski offre un regard très actuel notamment sur la représentation implacable des mécanismes de pouvoir en Russie. Malgré ses louanges au souverain, chanté par le chœur, le peuple, qui est au centre de l'attention de Moussorgski, est désespéré par sa propre impuissance. Dans Khovantchina, le pouvoir autocratique auquel aspire le prince Khovanski s'oppose à l'idéal populaire de Dossifeï, le chef des vieux-croyants. En fin de compte, dans Khovantchina, Moussorgski réfléchit musicalement à la tragédie du peuple russe, pris au piège entre deux mauvaises alternatives : l'acceptation de l'exercice du pouvoir par le tsar ou l'autodestruction, conséquence ultime de l'impossibilité d'un gouvernement populaire.
Ulrich Schmid
Ulrich Schmid est professeur d'études culturelles et sociales russes à l'Université de Saint-Gall. Ses recherches se concentrent sur la politique et les médias en Russie ainsi que sur le nationalisme en Europe de l'Est.
« Traquer le passé dans le présent »
À propos de l'inachèvement de Khovantchina
À sa mort en 1881, Moussorgski laisse deux opéras inachevés : Khovantchina, un grand drame historique en cinq actes, commencé neuf ans plus tôt, et La Foire de Sorotchintsy, un opéra plus léger dans le genre comique, inspiré d'une nouvelle ukrainienne de Gogol. Alors qu'il avance parallèlement sur ces deux partitions d'envergure, il commence déjà à rêver à un nouvel opéra historique sur la révolte de Pougatchov au temps de Catherine II. Cette œuvre aurait dû parachever son grand triptyque sur l'histoire russe, après Boris Godounov et Khovantchina.
Moussorgski a souvent procédé ainsi : son imagination bouillonne constamment de plusieurs projets simultanés, l'un pouvant provisoirement éclipser l'autre. Il suffit de rappeler que ces années voient également naître les Tableaux d'une exposition (1874) ainsi que ses deux grands cycles vocaux Sans Soleil (1874) et Chants et danses de la mort (1875-77) pour faire apparaître l'extraordinaire énergie du compositeur, qui travaille en outre comme fonctionnaire dans une administration d'État pour gagner sa vie. On comprend toutefois
l'inquiétude de ses proches à l'idée qu'il ne parvienne pas à terminer les chantiers ouverts, surtout lorsque sa santé commence à se dégrader. Deux bourses versées par des groupes d'amis fidèles lui permettent d'abandonner en 1880 son gagne-pain pour se concentrer sur la composition. Malgré ces conditions favorables, sa mort précoce, survenue juste une année plus tard, laisse ses deux derniers chefs-d'œuvre inachevés.
Genèse et travail sur les sources
Heureusement, la réduction piano de Khovantchina, de la main du compositeur, est pratiquement complète. Seuls les finales des actes II et V font exception : pour ces deux moments clefs de l'opéra ne subsistent que des fragments, ainsi que les intentions exposées par Moussorgski à ses amis. Un ensemble réunissant les cinq rôles principaux, projeté pour conclure l'acte II, ne verra jamais le jour. Quant à l'acte V, Moussorgski n'a pas eu le temps de développer son chœur de vieux-croyants pour la scène d'autodafé, qu'il a pourtant en tête depuis les toutes premières esquisses de l'œuvre.



S'il ne manque que peu de musique, la partition n'est pas orchestrée, à l'exception de la chanson de Marfa et du réveil des streltsy au 3e acte. Mais, à vrai dire, la question la plus délicate demeure l'éventuel surplus de matière, plus que l'absence d'orchestration ou l'inachèvement de deux scènes, aussi essentielles soient-elles. C'est qu'en neuf ans, le projet a pris des proportions de plus en plus vastes. Moussorgski, qui rédige lui-même son livret sur la base de sources historiques, se passionne pour son sujet et accumule un matériel d'une incroyable richesse. « Je baigne dans la documentation, mon cerveau bout comme un chaudron où je serais immergé en permanence », écrit-il à son ami le critique d'art Vladimir Stassov, le 13 juillet 1872.
Débordant d'idées, il travaille simultanément sur plusieurs tableaux, s'interrompant longuement, modifiant de façon substantielle la conception de certaines scènes. Au fil des ans, la psychologie des personnages évolue. D'autre part, la musique prend forme dans son esprit sans toujours qu'il ne la fixe : Moussorgski attend parfois des années avant l'étape de la composition. « L'élaboration marche très bien, mais je dois tourner sept fois ma plume dans la main avant d'écrire », confie-t-il à Stassov le 2 août 1873. « Parfois, je m'élance, mais non, stop ! Mon cuisinier intérieur me dit que la soupe a beau bouillir, il est encore trop tôt pour la servir à table. » Ou encore, après une description de la scène finale de son opéra : « Tout cela est déjà presque prêt, mais comme ce fut déjà le cas pour Boris, je ne le coucherai sur le papier que lorsque le fruit sera mûr » (à Paulina Stassova, le 23 juillet 1873).
La dramaturgie qui naît de cette genèse est discontinue : l'opéra est construit comme une série de tableaux, dont certains pourraient disparaître sans nuire au déroulement de l'intrigue. Les scènes « inutiles » se multiplient,
servant à brosser une somptueuse « caricature sur l'Histoire » (termes de Moussorgski).
Parallèlement à la composition, Moussorgski continue ses recherches sur les événements historiques. Stassov, qui travaillait à la Bibliothèque impériale, l'avait aidé à réunir ses sources, témoignages d'une époque sombre et violente de l'histoire russe. Aux nombreux textes d'archives consultés par le compositeur s'ajoute une abondante littérature secondaire sur les trois grandes révoltes des streltsy (1682, 1689 et 1698, condensées en un seul épisode) ainsi que sur la politique de la régente Sophie et de son favori Galitsine. Le compositeur passe des nuits entières à dévorer la monumentale Histoire de la Russie de Soloviov, comme il avait fait précédemment avec celle de Karamzine alors qu'il travaillait à son opéra Boris Godounov.
Les textes autour du schisme (raskol en russe) provoqué par les réformes religieuses du patriarche Nikon au XVIIe siècle occupent une place centrale dans le corpus de Moussorgski. Or, la perception des spécialistes sur les vieuxcroyants (raskolniki, soit les « schismatiques ») diffère selon la perspective adoptée : certains les considèrent comme les garants de l'esprit de l'ancienne Russie, admirables dans leur obstination à défendre les rituels anciens contre des réformes religieuses, sociales et politiques influencées par les modèles européens. D'autres les associent à une secte de fanatiques obscurantistes, fermée à toute idée de progrès, même nécessaire. Précisons que l'historiographie de l'époque dite « pré-pétrovskienne » (avant l'européanisation de la Russie par Pierre le Grand) en est alors à ses balbutiements. Le compositeur fait donc œuvre de pionnier en défrichant des textes que les historiens eux-mêmes découvrent depuis peu.
Conception dramatique et esthétique musicale
Le contact direct de Moussorgski avec les sources a d'importantes conséquences : les faits historiques sont incorporés aux discours, exigeant de l'auditeur une grande concentration pour saisir les allusions et détails, qui fusent de toutes parts. Nous sommes plongés dans un tableau vivant dans lequel personnages et événements sont dotés d'une réelle épaisseur historique. Cela est d'autant plus vrai que Moussorgski s'inspire également de ses lectures pour la caractérisation des rôles principaux. Les sources sont parfois exploitées littéralement : un texte d'archives peut ainsi être intégré à une scène de genre inventée de toutes pièces par Moussorgski. La dénonciation dictée par Chaklovity à l'écrivain public, dans le premier tableau de Khovantchina, est un authentique document d'époque. La lettre de la régente Sophie que le prince Galitsine lit au début du deuxième acte est, elle aussi, historique.
De cette méthode de travail découle une grande diversité stylistique, inattendue d'un livret d'opéra. Avec virtuosité, Moussorgski capte les différents idiomes et registres stylistiques qui se côtoient dans cette Russie encore médiévale : la langue de l'État, lourde et bureaucratique, la langue policée de Galitsine, plus proche du russe du XIXe, les savoureuses tournures populaires des gens de Moscou, le lexique truffé d'archaïsmes des vieux-croyants et de leur guide spirituel Dossifeï, dont le langage évoque le slavon d'Église. Dans son désir d'authenticité, le compositeur ne cherche pas à unifier. Au contraire, les discours sont rapportés de façon à souligner les contrastes entre les personnages, les rangs et les origines sociales.
On s'en doute : la musique suit un même principe, caractérisant les groupes de sorte à garantir à chacun une identité musicale propre. Ainsi Moussorgski fait-il chanter ses vieux-croyants à l'unisson, sur un thème mélismatique au contour archaïsant. En plus de créer un effet d'authenticité (et d'« étrangeté » par la même occasion), ce procédé souligne bien la détermination des vieux-croyants. Il prend tout son sens dans un réseau de contrastes : « Puisque c'est original, ça fait parfaitement mon affaire, écrit Moussorgski le 23 juillet 1873, d'autant plus que la complainte des raskolniki fera un magnifique contraste avec le thème de Pierre le Grand. » Représenté par une fanfare doublée d'un hymne d'allure occidentale, le matériau associé à Pierre s'oppose en effet radicalement à l'idiome ascétique des vieuxcroyants ; il se distingue également du style contrapuntique propre au folklore russe utilisé pour les interventions du peuple moscovite.
Ce qui est valable pour les masses chorales l'est aussi pour les rôles principaux, dont la caractérisation se distingue par un même souci de vérité musicale. Moussorgski n'hésite pas à exploiter le procédé du leitmotiv pour parfaire ses portraits. Emporté et colérique, réputé pour ses mœurs immorales et attaché à ses privilèges, le chef des streltsy est pourvu d'un motif un peu rustique, qui le suit partout en épousant ses constantes sautes d'humeur. Ivan Khovanski est, lui, doté d'un tic de langage (Spasi Bog, « Dieu me garde »), qui lui donne une dimension grotesque, malgré ses allures de dictateur. À propos de Galitsine, amant de Sophie, Moussorgski avait lu qu'il était un homme superstitieux, mais éclairé et progressiste, menant un projet de réformes audacieuses pour son époque. Habile diplomate, sachant tirer son épingle du jeu, il est caractérisé par des thèmes adoptant le langage musical de son interlocuteur.
Fermeture vs ouverture
De cette irréconciliable polyphonie de voix émerge une partition vive, colorée, mêlant étroitement le comique et le tragique, basée sur la juxtaposition — voire la superposition — de styles et de langages différents. Pour renforcer la simultanéité des points de vue qui s'opposent sur la destinée de la Russie, Moussorgski exploite des chœurs de coulisses qui se superposent en arrière-plan à l'action sur scène, provoquant un contrepoint dramatique et musical d'une redoutable efficacité. C'est que l'identité de chacun est ici associée à la volonté de défendre des positions et des visions incompatibles entre elles, malgré le jeu des alliances qui précipite la perte des uns (Khovanski et les streltsy), l'exil ou l'emprisonnement des autres (Galitsine et Sophie), la renonciation des derniers sous la forme d'un acte d'effacement volontaire (Les vieuxcroyants). Là encore, le compositeur n'a pas cherché à réconcilier, unifier ou juger : Khovantchina a beau s'achever sur la disparition de tous les personnages principaux, sa dramaturgie reste fondamentalement ouverte.
Par son travail sur les sources et sur les divergences dans leur interprétation, Moussorgski a acquis une conception différenciée de l'histoire. En réponse, la construction de son opéra fait cohabiter les points de vue, invitant à une recherche de sens toujours renouvelée. Cette situation se trouve renforcée par la mort prématurée du compositeur, laissant à jamais ouverte la question de la « dernière » version. Comment savoir si Moussorgski aurait conservé son opéra sous la forme que lui donne son manuscrit chant-piano ? La question est d'autant plus délicate qu'il a modifié son livret à maintes reprises, se gardant la possibilité d'ajouter, de renoncer, de permuter.
L'accumulation de matériel par l'auteur et les dimensions importantes qu'avait prises l'opéra ont justifié les coupures de son premier éditeur : Nikolaï Rimski-Korsakov, qui supprima quelque 800 mesures de l'original. Fidèle à lui-même, Rimski en profita pour apporter de nombreuses modifications, « corrigeant » et ajoutant des idées de son cru. Sa proposition pour les deux parties inachevées est particulièrement frappante : à la fin de l'acte II, après l'annonce de la sanction de Pierre contre la mutinerie du prince Khovanski, Rimski cite le Prélude de l'opéra, associé à un « lever de soleil » sur la rivière Moskova. À la fin de l'œuvre, c'est l'hymne du futur tsar réformateur qui retentit, tandis que se consume l'ermitage des vieux-croyants. Si le contraste entre ces matériaux était prévu par Moussorgski, l'image finale d'un régiment de soldats sur scène, accompagné du thème optimiste de Pierre et de volées de cloches, semble corroborer une vision progressiste de l'histoire et l'action du tsar est revêtue d'une indéniable aura positive.
En 1958, Chostakovitch se voit confier la mission de réorchestrer la partition. Plus fidèle à l'esprit de l'original, il travaille sur l'édition critique du musicologue soviétique Pavel Lamm, parue au début des années 1930, marquant un retour au manuscrit de Moussorgski. Mais à son tour, Chostakovitch doit opérer des choix pour les parties inachevées. Il décide alors de conserver le finale de Rimski, auquel il ajoute toutefois un postlude. Après une brève méditation du peuple moscovite sur le sort de la Russie, la musique du prélude revient, suggérant l'aube d'une nouvelle journée. L'aspect cyclique qui ressort de cette solution est séduisant, mais ne rend pas vraiment la fin apocalyptique telle qu'envisagée par Moussorgski. Seul Stravinsky, à qui Diaghilev avait demandé de composer un finale pour sa célèbre production parisienne de 1913, est resté fidèle au fragment de l'auteur, n'ajoutant rien
à la prière des vieux-croyants qui s'éteint progressivement, morendo. C'est cette version que le Grand Théâtre a choisie pour la présente production.
Post-scriptum
« Nous avons progressé ? — Mensonge. Nous en sommes au même point ! […] Tant que le peuple ne pourra pas constater de ses propres yeux à quelle sauce on le prépare et tant qu'il ne dira pas lui-même à quelle sauce il veut être préparé, nous en serons toujours au même point. » Ainsi s'exprimait Moussorgski en juin 1872, alors que Saint-Pétersbourg (la ville de Pierre) fêtait en grande pompe le bicentenaire de la naissance de son fondateur. Dubitatif quant aux réels progrès d'un régime autocratique, en 1672 comme en 1872, le compositeur vient alors d'annoncer à Stassov la mise en route de sa Khovantchina. Modestement (le compositeur aime jouer avec son prénom, Modeste), il s'est retiré neuf ans plus tard sans avoir pu mettre le point final à ce vaste tableau, mais son credo — « traquer le passé dans le présent » — reste plus que jamais d'actualité.
Les différentes versions de l'œuvre
En 1872, Moussorgski commence à travailler sur Khovantchina. À sa mort, en 1881, il laissera une réduction pour piano, pas tout à fait complète.
Nikolaï Rimski-Korsakov l'adaptera et orchestrera l'œuvre pour une première représentation en 1886, éliminant certaines scènes de la partition.
Une autre version, datant de 1913, est signée par Maurice Ravel et Igor Stravinsky.
En 1931, Boris Assafiev orchestre la réduction pour piano élaborée par Pavel Lamm d'après l'autographe de Moussorgski.
Enfin, en 1958, Dmitri Chostakovitch crée une nouvelle version orchestrale qui inclut également les scènes omises par Rimski-Korsakov. Cette version est jouée le 25 novembre 1960 au théâtre Kirov (maintenant Mariinsky).
Mathilde Reichler
Mathilde Reichler s'est formée à l'Université de Genève où elle a été assistante en musicologie. Elle enseigne actuellement l'analyse musicale à la HEMU, ainsi que la dramaturgie de l'opéra au sein du Certificat de formation continue en dramaturgie de l'UNIL/Manufacture.
Un historien mercenaire ?
Nicolas Ducimetière
Fondation Martin Bodmer
Fasciné par la figure du tsar Pierre Ier Romanov (1672-1725), Voltaire commença dès 1737 à réunir de la documentation et manifesta auprès de l'impératrice Élisabeth, huit ans plus tard, son désir d'écrire une biographie du souverain, tout en devenant membre de l'Académie de Saint-Pétersbourg. À la suggestion du comte et ministre Ivan Chouvalov, la cour impériale finit par passer une commande officielle en 1757, garantissant à l'auteur l'accès aux archives russes, ainsi que l'envoi au château de Ferney (tout juste acheté) de fourrures de luxe et d'une collection de médailles d'or représentant les grands épisodes de la vie du tsar. Avec l'aide de son ami Chouvalov, Voltaire voulut faire œuvre d'historien et tâcha de travailler sur des « preuves authentiques » afin d'être le plus rigoureux possible. Il fut toutefois critiqué de part et d'autre, en France pour ses compromissions à l'égard du pouvoir impérial (ce à quoi Voltaire répondit : « Mon ami, ils m'ont donné de bonnes pelisses et je suis frileux ! ») et en Russie pour avoir dénigré la culture ancestrale du pays. Le savant Mikhaïl Lomonossov, appelé à réviser les textes de Voltaire avec d'autres érudits, déplora que, dans bien des passages, « la Russie ne puisse pas paraître glorieuse : elle ne peut que se trouver déshonorée et outragée ». Peu enclin à accepter les corrections de ses relecteurs, Voltaire amenda finalement très peu son texte, même quand il était clairement erroné ou
approximatif (à propos de lieux géographiques, de figures historiques ou de dates). Le premier tome vit le jour en 1759 chez son éditeur genevois Cramer, suivi d'un second volume en 1763. Si les premiers chapitres admiraient les immensités géographiques de la Russie, ils se montraient aussi volontiers méprisants pour l'histoire ancienne du pays (jugée sans importance) et pour les us et coutumes de ses peuples (décrits comme frustes). « Mon dessein est de faire voir ce que le czar a créé plutôt que de débrouiller inutilement l'ancien chaos », affirma Voltaire. Car son objectif était bel et bien de dresser un monument à Pierre le Grand, nouveau Prométhée ayant apporté la civilisation et le progrès (en un mot : les Lumières) au peuple russe. Épisode crucial du début du règne, le récit de l'« Horrible sédition de la milice des Strélitz » (1682 et 1689) occupa les chapitres IV et V, pour lesquels Voltaire employa surtout des témoignages de voyageurs, comme l'État présent de la Grande Russie de Perry (1717) ou la Description historique de l'Empire russien de Strahlenberg (1757). Quand Lomonossov lui demanda de taire le détail du supplice des streltsy vaincus, Voltaire, têtu, se complut à décrire leur mort sous le knout ou la hache, comme il avait raconté sans fard les massacres perpétrés par les soldats rebelles sous les yeux du tout jeune tsar. Mais la paix revint et la régence de Sophie prit fin : « De ce moment Pierre régna », ouvrant une ère nouvelle.

Voltaire (1694-1778), Histoire de l'Empire de Russie sous Pierre le Grand. Par l'Auteur de l'histoire de Charles XII, s.l.n.n. [Genève, Cramer], 1759, tome I, chapitre IV, édition originale. Fondation Martin Bodmer

Alejo Pérez
Direction musicale
Un grand sens du style et la capacité à appréhender la complexité de chaque partition dans ses moindres détails caractérisent le chef argentin Alejo Pérez, lui assurant ainsi une place importante sur les scènes d'opéra et de concert internationales. De 2009 à 2012, il est directeur musical du Teatro Argentino de La Plata et, depuis le début de la saison 2019/20, de l'Opera Ballet Vlaanderen, avec à son actif de nouvelles productions telles que Pelléas et Mélisande dans la mise en scène de Damien Jalet et Sidi Larbi Cherkaoui. Au Grand Théâtre de Genève, il mène l'Orchestre de la Suisse romande en 2022 pour Guerre et Paix puis pour Lady Macbeth de Mtsensk la saison suivante, dans des mises en scène de Calixto Bieito, qu'il retrouve cette saison pour Khovantchina. En 2023-2024, il a également collaboré avec l'Orchestre philharmonique de Radio France et l'Orchestre symphonique métropolitain de Tokyo.

Calixto Bieito
Mise en scène
Directeur du Teatro Arriaga de Bilbao depuis 2017, Calixto Bieito privilégie une approche résolument contemporaine dans ses choix de mise en scène. Ses adaptations de Macbeth à Salzbourg, Hamlet à Édimbourg ou Die Entführung aus dem Serail au Komische Oper de Berlin, aussi célèbres que controversées, établissent sa réputation d'artiste européen de premier plan. Parallèlement à des œuvres classiques telles que L'incoronazione di Poppea (Zurich), les œuvres emblématiques du XXe siècle (Moïse et Aaron de Schönberg ou Les Soldats de Zimmermann) et les créations contemporaines (Lear de Reimann ou Les Bienveillantes de Hèctor Parra) attirent son intérêt. Récompensé par de nombreuses distinctions internationales, Calixto Bieito est considéré comme l'un des plus grands metteurs en scène d'opéra actuels. Au Grand Théâtre, il crée Guerre et Paix de Prokofiev (2021) et Lady Macbeth de Mtsensk de Chostakovitch (2023).

Ringst Scénographie
La décoratrice allemande Rebecca Ringst est diplômée de l'Académie des arts de la scène de Dresde. Elle collabore depuis 2006 avec Calixto Bieito, par exemple pour Boris Godounov (Bayerische Staatsoper), Lear (Opéra national de Paris), Les Bienveillantes (Parra, Opéra de Flandre), Les Soldats (Opéra de Zurich), Guerre et Paix et Lady Macbeth de Mtsensk (Grand Théâtre de Genève, 2021 et 2023). Elle reçoit le Premio Max (Espagne) pour Forests et le Hedda Award (Norvège) pour A Dream Play, pièces mises en scène par C. Bieito. Entre autres metteurs en scène, elle travaille avec Stefan Herheim — Le Chevalier à la rose (Opéra de Stuttgart, 2010) lui vaut le titre de Scénographe européenne de l'année décerné par Opernwelt — et Barrie Kosky, par exemple avec Agrippina (Bayerische Staatsoper) ou Les Maîtres chanteurs de Nuremberg (Festival de Bayreuth). Elle est élue Designer de l'année aux International Opera Awards 2019.

Ingo Krügler
Costumes
Le costumier Ingo Krügler étudie le costume et la mode à Berlin et à Londres. Il travaille d'abord dans la haute couture à Paris et puis c'est à Vienne qu'il commence à concevoir des costumes pour Tim Kramer au théâtre et pour des comédies musicales mises en scène par Joseph E. Köpplinger, dont Evita ou Jesus Christ Superstar. À l'opéra, il collabore avec Stefan Märki, Elisabeth Stöppler, Lydia Steyer, Tatjana Gürbaca, Tobias Kratzer et Matthew Wilde avant de rencontrer Calixto Bieito avec qui la collaboration l'amène depuis de part le monde : Turandot à Toulouse, L'incoronazione di Poppea à Zurich, Dialogues des Carmélites et Lohengrin à Berlin, Boris Godounov à Munich, la Passion selon saint Jean au Châtelet ou bien encore Les Bienveillantes à l'Opéra des Flandres et L'ange exterminateur à Paris. Au Grand Théâtre de Genève, Guerre et Paix et Lady Macbeth de Mtsensk. Ils travailleront prochainement ensemble sur un Ring pour l'opéra de Paris.
Rebecca

Michael Bauer
Lumières
Chef éclairagiste de la Bayerische Staatsoper depuis 1998, le designer lumières allemand Michael Bauer y collabore avec de multiples metteurs en scène, parmi lesquels Luc Bondy (Tosca), August Everding (La Flûte enchantée), Claus Guth (Semele), Richard Jones (Hänsel et Gretel), Yannis Kokkos (Nabucco), Peter Konwitschny (Tristan et Isolde) ou Jürgen Rose (Don Carlo). Pour Calixto Bieito, il signe notamment les lumières de Giulio Cesare (Dutch National Opera & Ballet), Elias (Opéra national de Lyon), Simon Boccanegra (Opéra national de Paris), Boris Godounov (Bayerische Staatsoper), Tosca (Opéra d'Oslo), Lohengrin (Staatsoper Unter den Linden), Orgia (Teatro Arriaga de Bilbao), Tannhäuser (Teatro La Fenice), ainsi que Guerre et Paix et Lady Macbeth de Mtsensk au Grand Théâtre de Genève (2021 et 2023), où il est aussi présent pour Così fan tutte mis en scène par David Bösch (2017) et pour Idomeneo par Sidi Larbi Cherkaoui (2024).

Sarah Derendinger Vidéo
Sarah Derendinger est réalisatrice et artiste vidéo. Elle explore depuis les années 1990 la relation entre cinéma expérimental et installations multimédias et a réalisé de nombreux films expérimentaux. Ses œuvres ont été présentées notamment aux Theatertreffen Berlin, aux opéras de Paris, Londres, Madrid, Bruxelles, Berlin et Hamburg. Depuis 2013, elle collabore régulièrement avec Calixto Bieito et a créé des vidéos pour Jossi Wieler, Heiner Goebbels, Barbora Horáková et Andrea Moses. En 2017, elle reçoit le Prix de la critique espagnole du meilleur design vidéo. Ses films expérimentaux et documentaires sont montrés dans de nombreux festivals. Familientreffen lui vaut en 2009 le Prix Ciné Swiss. Depuis 2021, elle met en scène ses propres opéras vidéo, comme Tempest (Arne Nordheim, Bergen Festival 2021) et The Rape of Lucretia (Lucerne, 2023), où elle intègre l'installation vidéo dans la mise en scène lyrique.

Beate Breidenbach
Dramaturgie
La dramaturge Beate Breidenbach étudie le violon, la musicologie et la slavistique à Novossibirsk, Berlin et Saint-Pétersbourg. D'abord assistante à la Staatsoper Stuttgart et à la Staatsoper Unter den Linden, elle devient dramaturge du Theater St. Gallen, du Theater Basel puis de l'Opernhaus Zürich. Elle collabore à Zurich avec divers metteurs en scène, tels que David Hermann (L'Enlèvement au sérail), Andreas Homoki (Die Walküre, Der Ring des Nibelungen), Calixto Bieito (Eliogabalo), Dmitri Tcherniakov (Pelléas et Mélisande) ou Kirill Serebrennikov (Così fan tutte). Elle retrouve Calixto Bieito pour Les Soldats au Teatro Real Madrid et Guerre et Paix au Grand Théâtre de Genève (2021). Également traductrice de russe, on lui doit la version allemande de Boris Godounov et du Nez. Elle a collaboré avec la télévision suisse pour La Bohème im Hochhaus réalisé par Felix Breisach (Arte-RSI-SF) et à Diskothek im Zwei, émission radiophonique de SRF 2 Kultur.

Dmitry Ulyanov
Basse
Le prince Ivan Khovanski
Diplômée du Conservatoire d'État de l'Oural, la basse russe Dmitry Ulyanov est invitée sur les plus grandes scènes, interprétant notamment le Général (Le Joueur) et le Grand Inquisiteur (Don Carlos) à la Staatsoper de Vienne, Galitski (Le Prince Igor) à l'Opéra national d'Amsterdam, le roi René (Iolanta) et le rôle-titre d'Attila à l'Opéra national de Lyon, Boris (Lady Macbeth de Mtsensk ) à l'Opéra national de Paris et au Festival de Salzbourg, Filippo II (Don Carlo) au Teatro Real Madrid, Dodon (Le Coq d'or) au Festival d'Aix-en-Provence ou Boris Godounov à la Bayerische Staatsoper. Au Grand Théâtre de Genève, il a récemment incarné Kutuzov (Guerre et Paix), le cardinal de Brogni (La Juive), Boris (Lady Macbeth de Mtsensk ) et Philippe II (Don Carlos). En 2015, il a reçu le prix Casta Diva (Russie) pour son interprétation d'Ivan Khovanski (Khovantchina). En 2019, il est nommé Artiste émérite de la Fédération de Russie.

Arnold Rutkowski
Ténor
Le prince Andreï Khovanski
Formé à l'Académie de musique de Łódz et passé par la troupe de l'Opéra de Wroćław, le ténor polonais Arnold Rutkowski reçoit en 2009 le prix CulturArte du concours Operalia et fait ses débuts internationaux au Théâtre de Modène avec Don José (Carmen). Il interprète par la suite Vaudemont (Iolanta) à l'Opéra national de Paris, à l'Opéra national de Lyon et au Festival d'Aix-enProvence, Pollione (Norma) et Stefan (Le Manoir hanté, Moniuszko) au Teatr Wielki (Varsovie), Don José au Royal Opera House Covent Garden et au Semperoper de Dresde, Pinkerton (Madame Butterfly) au Deutsche Oper am Rhein (Düsseldorf) et au Grand Théâtre de Genève (2013), où il est aussi le duc de Mantoue (Rigoletto) l'année suivante, Alfredo (La Traviata) et Rodolfo (La Bohème) aux opéras d'Helsinki et de Stockholm, le duc de Mantoue à la Staatsoper Hamburg et au Michigan State Opera, ou Lensky (Eugène Onéguine) à la Staatsoper unter den Linden (Berlin).

Dmitry Golovnin
Ténor
Le prince Vassili Galitsine
Le ténor russe Dmitry Golovnin est d'abord diplômé en trompette du Conservatoire de Saint-Pétersbourg. Après une première carrière instrumentale, il se tourne vers l'art lyrique et se forme à la Hochschule für Musik und Theater de Hambourg. Il est depuis 2007 soliste du Théâtre Mikhailovsky (Saint-Pétersbourg), où il interprète notamment
Alfredo (La Traviata), Cavaradossi (Tosca), Lensky (Eugène Onéguine) Vaudémont (Iolanta), Gustavo (Un bal masqué), Vladimir (Le Prince Igor) ou Turiddu (Cavalleria rusticana). Il chante aussi Grigori (Boris Godounov) au Concertgebouw d'Amsterdam, Šapkin (De la maison des morts) à l'Opéra national de Lyon, le roi Charles (La Pucelle d'Orléans, Tchaïkovski) au Theater an der Wien, Don José (Carmen) à l'Opéra de Riga, Agrippa von Nettesheim (L'Ange de feu) au Metropolitan Opera ou Hermann (La Dame de pique) à la Monnaie. Il a déjà chanté le rôle de Galitsine au Theater Basel.

Taras Shtonda Basse
Dossifeï
Après des études au Conservatoire Tchaïkovski de Kiev, Taras Shtonda devient soliste à l'Opéra national de Kiev et dans quantité d'opéras européens. Il a chanté de nombreux rôles du répertoire russe, notamment Dossifeï (Khovantchina) à l'Opéra national de Pologne et au Bolchoï, Pimen (Boris Godounov) au Festival de Savonlinna, Boris Ismailov (Lady Macbeth de Mtsensk ) au Bolchoï, le prince Gremin (Eugène Onéguine) au Festival de Glyndebourne, à l'Opéra de Malmö et à l'Opéra national de Norvège, Mamyrov (L'Enchanteresse) à l'Opéra de Flandre et Faust (L'Ange de feu) à l'Opéra de Lyon. Parmi ses autres apparitions : le Grand Inquisiteur (Don Carlo) à l'Opéra d'État de Bavière, Sparafucile (Rigoletto) au Festival de Savonlinna, Gurnemanz (Parsifal) à l'Opéra de Malmö, Crespel (Les Contes d'Hoffmann) à l'Opéra royal du Danemark. Au Grand Théâtre de Genève, il est Fafner (L'Anneau du Nibelung) en 2018-19.

Raehann
Bryce-Davis
Mezzo-soprano
Marfa
Saluée par le New York Observer comme « l'une des meilleures mezzo-sopranos de sa génération », Raehann Bryce-Davis s'impose sur les plus grandes scènes mondiales dont l'Opera Vlaanderen, le Teatro Massimo de Palermo, le Staatstheater Nürnberg, le LA Opera et le Metropolitan Opera de New York. Avec un répertoire aventureux qui va de Donizetti à Philip Glass, ses rôles incluent Kristina dans L'Affaire Makropoulos, Mrs Alexander dans Satyagraha, Sara dans Roberto Devereux, Eboli dans Don Carlo, Amneris dans Aida, Der Komponist dans Ariadne à Naxos et Baba la Turque dans The Rake's Progress. Récemment, elle a été Ella dans X : The Life and Times of Malcolm X au Metropolitan Opera et a fait ses débuts au Houston Grand Opera en Azucena dans Il trovatore. Son premier clip vidéo, To the Afflicted, a été largement salué par la critique et choisi comme vidéo officielle pour la Journée mondiale de l'opéra 2020.

Vladislav Sulimsky
Baryton
Le boyard Chaklovity
Né en Biélorussie, Vladislav Sulimsky obtient le premier prix du concours international RimskiKorsakov en 2002 et du concours international Giacomo Lauri-Volpi en 2010. Soliste du Théâtre Mariinsky, il y interprète notamment les rôlestitres d'Eugène Onéguine, Simon Boccanegra, Macbeth, Rigoletto ou Gianni Schicchi. Il chante aussi Miller (Luisa Miller) à l'Opéra de Malmö et au Festival de Glyndebourne, Eugène Onéguine et Renato (Un ballo in maschera) à l'Opéra de Stockholm, Rodrigo (Don Carlos) et le rôle-titre de Mazeppa au Festival de Baden-Baden, Tomsky à l'Opéra de Stuttgart et au Festival de Salzbourg où il remporte un grand succès pour son Idiot en 2024, Germont à l'Opéra de Dallas, Macbeth au Theater Basel, Alberich (L'Or du Rhin) au Festival d'Édimbourg, Rigoletto au Royal Opera House en tournée à Muscat, le comte de Luna (Le Trouvère) à la Staatsoper Berlin ou encore Iago (Otello) à la Wiener Staatsoper.

Ekaterina Bakanova
Soprano
Emma
Outre le chant, la soprano russe Ekaterina Bakanova étudie le piano et l'accordéon. Elle incarne notamment Violetta (La Traviata) et Musetta (La Bohème) au Royal Opera House, Donna Anna (Don Giovanni) aux Arènes de Vérone, Gilda (Rigoletto) et Fiordiligi (Così fan tutte) à l'Opéra de Leipzig, Micaëla (Carmen) au Teatro La Fenice, le rôle-titre de Lucia di Lammermoor au Teatro Regio de Parme, Susanna (Les Noces de Figaro) et Pamina (La Flûte enchantée) au Teatro Regio de Turin, Almirena (Rinaldo) à l'Opéra royal de Versailles, Magda (La Rondine) au Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Norina (Don Pasquale) et Liù (Turandot) au National Centre for the Performing Arts de Pékin, Leïla (Les Pêcheurs de perles) au Liceu, Antonia (Les Contes d'Hoffmann) à l'Opernhaus Zürich, Anaï (Moïse et Pharaon) à l'Opéra national de Lyon. Au Grand Théâtre de Genève, elle a été Elisabetta (Roberto Devereux) la saison passée.

Michael J. Scott
Ténor
Scribe
Diplômé de la Manhattan School of Music et du Royal College of Music, le ténor américain Michael J. Scott chante le Premier Juif (Salomé) et Chapkine (De la maison des morts) à l'Opéra de Rome, et y crée le rôle de Casca (Julius Caesar, Battistelli) en 2021. Il est le Deuxième Juif (Salome) au Royal Opera House, Loge (Der Ring des Nibelungen) au Theater an der Wien, Spoletta (Tosca) au Nederlandse Reisopera, Lippo Fiorentino (Street Scene) au Teatro Real Madrid, et crée Minos (Solar, Moody) à La Monnaie de Bruxelles (2023). À l'Opéra de Flandre, il est un marquis (Le Joueur), Malcolm (Macbeth), le commissaire Clemens (création en 2019 des Bienveillantes de Parra), Monostatos (Die Zauberflöte), un scribe (Khovantchina) ou un paysan (Lady Macbeth de Mtsensk ). Au Grand Théâtre de Genève, il chante l'hôte du bal, l'ordonnance du prince Bolkanski et Ivanov dans Guerre et Paix (2021) et le Premier Juif dans Salomé (2025).

Liene Kinča
Soprano
Susanna
La soprano lettone Liene Kinča est diplômée de l'Académie lettone de musique (Riga). Au Théâtre national de Riga, elle reçoit le prix Latvijas Gāze de la meilleure soliste en 2011 et 2013. Elle y chante notamment Abigaïlle (Nabucco), Sieglinde (La Walkyrie), Lisa (La Dame de pique), Woglinde et la Troisième Norne (Le Crépuscule des dieux), Giorgetta (Il tabarro), Amelia (Un ballo in maschera), la Princesse étrangère (Rusalka), les rôles-titres de Turandot, Tosca, Aida, Madame Butterfly et Suor Angelica ou le Requiem de Verdi. Sa carrière la mène sur les plus grandes scènes : elle interprète Elsa (Lohengrin), Senta (Der fliegende Holländer) et Chrysothémis (Elektra) à l'Opéra de Flandre, Gutrune (Le Crépuscule des dieux) au Theater an der Wien, Elisabeth (Tannhäuser) à l'Opéra de Leipzig, Isolde (Tristan et Isolde) au New National Theatre Tokyo et la princesse Maria (Guerre et Paix) au Grand Théâtre de Genève (2021).

Rémi Garin
Ténor
Envoyé de Galitsine
Streshnev, un jeune héraut
Rémi Garin a étudié au Conservatoire national régional d'Annecy avant d'intégrer l'École de l'Opéra national de Paris. Finaliste du concours international de chant de Toulouse, il exerce une activité de soliste pendant une quinzaine d'années, interprétant des rôles tels que Fenton (Falstaff) Ismaële (Nabucco) ou Cassio (Otello), le Chevalier de la Force (Dialogues des Carmélites), Tamino (Die Zauberflöte), Edgardo (Lucia di Lammermoor) ou encore Nemorino (L'elisir d'amore). Il se produit également dans de nombreux oratorios et œuvres sacrées (Mozart, Puccini, Gounod, Beethoven, Haydn, Rossini). En Australie, il a chanté la ballade d'Horatio Lélio de Berlioz pour l'ABC Radio du Festival de Melbourne. En Suisse, il interprète le Journal d'un disparu de Janáček au festival Lavaux Classic. Au Grand Théâtre de Genève, il chante régulièrement des rôles de caractère.

Emanuel Tomljenović
Ténor
Kouzka
Le ténor croate Emanuel Tomljenović étudie le chant à la Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Il interprète Don Ottavio (Don Giovanni), Belmonte (Die Entführung aus dem Serail), Tebaldo (I Capuleti e i Montecchi), l'aumônier (Dialogues des Carmélites), Raymond (La Pucelle d'Orléans de Tchaïkovski) sur différentes scènes européennes, le Temps (Il trionfo del Tempo e del Disinganno) au Festival international Haendel de Göttingen et Roméo (Romeo und Julia de Blacher) à l'Opéra de Cologne. Au concert, il se produit particulièrement dans le répertoire sacré de Bach (Passions, Magnificat, Messe en Si, Weihnachtsoratorium), Mozart (Grande messe en Ut mineur, Requiem, Messe du couronnement), Haydn (Die Schöpfung) ou romantique (Elias de Mendelssohn). Auparavant membre de l'International Opera Studio de l'Opéra de Cologne, il intègre le Jeune Ensemble du Grand Théâtre de Genève pour la saison 2024-25.

Vladimir Kazakov
Baryton
Premier strelets
Formé à l'Université des arts, à l'Académie de Théâtre et au Conservatoire RimskiKorsakov de SaintPétersbourg en direction d'orchestre, saxophone, théâtre et chant, le baryton russe Vladimir Kazakov intègre la troupe du Théâtre Mikhaylovsky et se produit à l'Opéra de chambre de Saint-Pétersbourg, notamment en Alfio (Cavalleria rusticana), Sharpless (Madame Butterfly), Fiorello (Il barbiere di Siviglia), Firman Trombest (Pietro il Grande, Donizetti), Tonio (Pagliacci), ou en diable (Cherevitchki, Tchaïkovski). En 2022, il incarne Kuligin (Kátia Kabanová) pour le Festival Janáček Brno. Son répertoire compte aussi Papageno (La Flûte enchantée), Don Giovanni, Falke (La Chauve-Souris), Valentin (Faust), Germont (La Traviata), Énée (Didon et Énée), Belcore (L'elisir d'amore), Eugène Onéguine, Robert (Iolanta), Tomsky (La Dame de pique) ou Don Carlos (Les Fiançailles au couvent).

Mark Kurmanbayev
Basse
Deuxième strelets
La basse serbe Mark Kurmanbayev étudie le chant auprès d'Elena Pankratova. Il suit également l'enseignement de Grace Bumbry, Barbara Frittoli, Freddie de Tommaso, Sergei Leiferkus et Alexei Tanovitski. En 2022, il chante Naroumov (La Dame de pique) à Baden-Baden sous la direction de Kirill Petrenko. En 2023, il participe à l'Académie du Festival d'Aix-en-Provence sous la baguette de Thomas Hengelbrock, et incarne un Homme de Mr Pilkington lors de la création d'Animal Farm (Raskatov) au Dutch National Opera, dont il intègre le Studio pour la saison 20232024. Il y interprète Joe (Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny), le Premier Prêtre et le Second Homme d'armes (Die Zauberflöte), Gualtiero Raleigh (Roberto Devereux) et Don Fernando (Fidelio). Au Festival de Verbier 2024, il est Bartolo (Le nozze di Figaro) et Pistola (Falstaff). Cette saison, il est membre du Jeune Ensemble du Grand Théâtre de Genève.

Igor Gnidii
Baryton
Varsonofiev
La formation internationale du baryton franco-ukrainien Igor Gnidii le conduit tout d'abord au Conservatoire Supérieur d'État d'Odessa en Ukraine puis à l'École supérieure de musique
Reine-Sophie à Madrid, où il travaille avec Tom Krause et Manuel Cid. Il entre ensuite à l'Atelier lyrique de l'Opéra national de Paris, puis participe à l'Académie européenne de musique à Aix-enProvence. Il remporte de nombreux prix en Espagne et donne des récitals, notamment avec l'Orchestre de la Radio et de la Télévision espagnoles. Il fait ses débuts sur la scène de l'Opéra national de Paris dans La Traviata (marquis d'Obigny). Il collabore avec des metteurs en scène comme Robert Carsen, Gilbert Deflo, Francesca Zambello, Giancarlo del Monaco, Christoph Marthaler et chante sous la direction d'Alain Altinoglu, Sylvain Cambreling, Jeffrey Tate, Marc Albrecht, Daniel Oren ou encore Pinchas Steinberg.
Débuts au GTG



Sopranos
Fosca Aquaro
Chloé Chavanon
Anne-Aurore Cochet
Nicola Hollyman
Mayako Ito
Célia Kinzer
Eline Kretchoff
Victoria Martynenko
Armine Mkrtchyan
Martina Möller-Gosoge
Daria Mykolenko
Daria Novik
Titziana Piletta
Cristiana Presutti
Elisabeth Rosenberg
Anna Samokhina
Iulia Elena Surdu
Dana Tanase
Noriko Urata
Altos
Camille-Taos Arbouz
Elise Bédènes
Audrey Burgener
Magali Duceau
Astrid Dupuis
Marie Hamard
Daryna Hryban
Vanessa Hurst
Varduhi Khachatryan
Mi-Young Kim
Céline Kot
Negar Mehravaran
Anouk Molendijk
Yuko Naka
Gabrielle Savelli
Olga Singayivska
Céline Soudain
Mariana Vassileva-Chaveeva
Ténors
Pierre Arpin
Jaime Caicompai
Lars Fischer
Rémi Garin
Maël Graa
Lyonel Grelaz
Christian Joel Sanghun Lee
Nicolas Lhoste
Juan Antonio Nogueira
José Pazos
Michele Pinto
Pablo Plaza
Aurélien Reymond
Georgi Sredkov
Bisser Terziyski
David Webb
Marin Yonchev
Louis Zaitoun
Serhii Zaritskyi
Basses
Romaric Braun
Nicolas Carré
Phillip Casperd
Alexandre Chaffanjon
Aleksandar Chaveev
Peter BaeKeun Cho
Christophe Coulier
Rodrigo Garcia
Thibault Gerentet
Igor Gnidii
Seong-Ho Han
Gautier Joubert
Woojin Kang
Vladimir Kazakov
Joshua Lane
Emerik Malandain
Sebastià Peris
Carlos Rodriguez
Alan Starovoitov
Vladimir Stojanovic
Dimitri Tikhonov
Job Tomé
Premiers violons
Bogdan Zvoristeanu
Roman Filipov
Yumiko Awano
Caroline Baeriswyl
Linda Bärlund
Elodie Berry
Stéphane Guiocheau
Aleksandar Ivanov
Guillaume Jacot
Yumi Kubo
Florin Moldoveanu
Bénédicte Moreau
Muriel Noble
Yin Shen
Cristian Zimmerman
Seconds violons
Sidonie Bougamont
François Payet-Labonne
Claire Dassesse
Rosnei Tuon
Florence Berdat
Yesong Jeong
Ines Ladewig Ott
Claire Marcuard
Merry Mechling
Eleonora Ryndina
Claire Temperville
David Vallez
Cristian Vasile
Nina Vasylieva
Yuwen Zhu
Altos
Frédéric Kirch
Elçim Özdemir
Emmanuel Morel
Jarita Ng
Luca Casciato
Fernando Domínguez Cortez
Hannah Franke
Hubert Geiser
Stéphane Gontiès
Marco Nirta
Verena Schweizer
Yan Wei Wang
Violoncelles
Lionel Cottet
Léonard Frey-Maibach
Gabriel Esteban
Hilmar Schweizer
Lucas Henry
Laurent Issartel
Yao Jin
Olivier Morel
Caroline Siméand Morel
Son Lam Trân
Contrebasses
Héctor Sapiña Lledó
Bo Yuan
Alain Ruaux
Ivy Wong
Mihai Faur
Adrien Gaubert
Gergana Kusheva
Nuno Osório
Zhelin Wen
Flûtes
Sarah Rumer
Loïc Schneider
Raphaëlle Rubellin
Jerica Pavli
Jona Venturi
Hautbois
Nora Cismondi
Simon Sommerhalder
Andrey Cholokyan
Alexandre Emard
Clarinettes
Dmitry Rasul-Kareyev
Michel Westphal
Benoît Willmann
Camillo Battistello
Guillaume Le Corre
Bassons
Céleste-Marie Roy
Afonso Venturieri
Francisco Cerpa Román
Vincent Godel
Katrin Herda
Cors
Jean-Pierre Berry
Julia Heirich
Alexis Crouzil
Pierre-Louis Dauenhauer
Pierre Briand
Clément Charpentier-Leroy
Agnès Chopin
Trompettes
Olivier Bombrun
Giuliano Sommerhalder
Antoine Pittet
Claude-Alain Barmaz
Laurent Fabre
Trombones
Matteo De Luca
Alexandre Faure
Vincent Métrailler
Andrea Bandini
Laurent Fouqueray
Tuba
Ross Knight
Timbales
Arthur Bonzon
Olivier Perrenoud
Percussions
Christophe Delannoy
Michel Maillard
Michael Tschamper
Harpe
Johanna Schellenberger
Pratique d'orchestre (DAS)
Kevin Saw, alto
André Costa, cor
Ivan Oesinger, percussions
Production
Guillaume Bachellier, délégué production
Régie du personnel
Grégory Cassar Gateau, régisseur principal
Mariana Cossermelli, régisseur adjoint
Régie technique
Marc Sapin, superviseur et coordinateur
Vincent Baltz, coordinateur adjoint
Frédéric Broisin, régisseur de scène
Guillaume Michalakakos, régisseur de scène
Équipe
artistique Équipe technique
Assistante à la direction musicale
Margaryta Grynyvetska
Assistante à la mise en scène
Olga Poliakova
Assistant à la mise en scène GTG
Leonardo Piano
Assistante décorateurs
Annett Hunger
Assistante aux costumes
Anastasia Dorotchik
Assistant vidéaste
Julien Munschy
Chef de chant
Jean-Paul Pruna
Reginald Le Reun
Coach linguistique
Maria Dribinsky
Coach linguistique du chœur
Victoria Martynenko
Régie de production
Julie Serré
Régie
Jean-Pierre Dequaire
Régie surtitres
Benjamin Delpouve
Directeur artistique adjoint
Arnaud Fétique
Chargé de production artistique et casting
Markus Hollop
Assistante de production et responsable de la figuration
Matilde Fassò
Chargée administration artistique
Élise Rabiller
Responsable des ressources musicales
Eric Haegi
Régie du Chœur
Marianne Dellacasagrande
Directeur technique
Philippe Sagnes
Adjointe administrative
Sabine Buchard
Régisseure technique de production
Catherine Mouvet
Chef de plateau
Patrick Savariau
Machinerie
Daniel Jimeno
Eclairages
Marius Echenard
Accessoires
Damien Bernard
Electromécaniciens
David Bouvrat
Son/ Vidéo
Jean-Marc Pinget
Matteo Buttice
Habillage
Joelle Muller
Perruques/Maquillage
Karine Cuendet (jusqu'à la 1e)
Christèle Paillard (jusqu'à la 1e)
Carole Schoeni (dès la 1e)
Ateliers costumes
Armindo Faustino Portas
DIRECTION GÉNÉRALE
Directeur général
Aviel Cahn
Assistante administrative
Victoire Lepercq
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Secrétaire générale
Carole Trousseau
Attaché de direction et Chargé du contrôle interne
Swan Varano
Adjointe administrative
Cynthia Haro
DIRECTION ARTISTIQUE
Directeur artistique adjoint
Arnaud Fétique
Responsable de la planification
Marianne Dellacasagrande
Assistant à la mise en scène
Leonardo Piana
ADMINISTRATION ARTISTIQUE
Chargé de production artistique et casting
Markus Hollop
Chargée d'administration
artistique
Elise Rabiller
Assistante de production et responsable de la figuration
Matilde Fassò
RÉGIE DE SCÈNE
Régisseur-e général-e
NN
Régisseur
Jean-Pierre Dequaire
MUSIQUE
Chef de chant principal
Jean-Paul Pruna
Chefs de chant/Pianistes
Xavier Dami
Réginald Le Reun
Responsable ressources
musicales
Eric Haegi
Jeune Ensemble
Mark Kurmanbayev
Emanuel Tomljenovic
Yuliia Zasimova
DRAMATURGIE ET DÉVELOPPEMENT CULTUREL
Dramaturge
Clara Pons
Rédacteur-traducteur
Christopher Park
Responsable développement culturel
Sabryna Pierre
Collaboratrice jeune public
Léa Siebenbour
CHŒUR
Chef des chœurs
Mark Biggins
Régisseure des chœurs
Marianne Dellacasagrande
Assistant régie des chœurs et logistique
Rodrigo Garcia
Sopranos
Fosca Aquaro
Chloé Chavanon
Nicola Hollyman
Mayako Ito
Victoria Martynenko
Martina Möller-Gosoge
Cristiana Presutti
Anna Samokhina
Iulia Elena Surdu
Altos
Elise Bédènes
Audrey Burgener
Magali Duceau
Varduhi Khachatryan
Mi-Young Kim
Céline Kot
Vanessa Hurst
Negar Mehravaran
Mariana Vassileva-Chaveeva
Ténors
Jaime Caicompai
Rémi Garin
Lyonel Grélaz
Sanghun Lee
José Pazos
Terige Sirolli
Georgi Sredkov
Bisser Terziyski
David Webb
Marin Yonchev
Louis Zaitoun
Basses
Romaric Braun
Nicolas Carré
Phillip Casperd
Aleksandar Chaveev
Peter Baekeun Cho
Christophe Coulier
Rodrigo Garcia
Igor Gnidii
Seong Ho Han
Vladimir Kazakov
Sebastià Peris Marco
Dimitri Tikhonov
BALLET
Directeur du Ballet
Sidi Larbi Cherkaoui
Directeur opérationnel du Ballet
Florent Mollet
Régisseuse du ballet
Valérie Girault
Coordinatrice administrative
Léa Caufin
Chargée de production du ballet
Barbara Pian
Maître de ballet principal
Manuel Renard
Danseuses
Yumi Aizawa
Céline Allain
Zoé Charpentier
Zoe Hollinshead
Emilie Meeus
Stefanie Noll
Sara Shigenari
Kim van der Put
Madeline Wong
Danseurs
Jared Brown
Quintin Cianci
Oscar Comesaña Salgueiro
Ricardo Gomes Macedo
Julio Leon Torres
Adelson Carlos Nascimento Santo Jr.
Juan Perez Cardona
Mason Kelly
Luca Scaduto
Endre Schumicky
Geoffrey Van Dyck
Nahuel Vega
TECHNIQUE DU BALLET
Directeur technique du Ballet
Rudy Parra
Régisseur plateau
Alexandre Ramos
Régisseur lumières
Dylan Larcher
Technicien son & vidéo
Jean-Pierre Barbier
Service médical
Dr Silvia Bonfanti
Dr Victoria Duthon
(Hirslanden Clinique La Colline)
MÉCÉNAT ET SPONSORING
Responsable du mécénat
Frédérique Walthert
Adjointe administrative
Natalie Ruchat
PRESSE
Responsable presse et relations publiques
Karin Kotsoglou
Assistante presse
Sophie Millar
MARKETING & VENTES
Directeur Marketing & Ventes
Alain Duchêne
MARKETING
Responsable communication
digitale
Wladislas Marian
Social media and influencer manager
Alice Menoud-Riondel
Graphiste
Sébastien Fourtouill
Vidéaste
Florent Dubois
Assistante communication
Caroline Bertrand Morier
Coordinatrice communication
Paola Ortiz
Responsable développement clientèles privées et institutionnelles
Juliette Duru
BILLETTERIE
Responsable billetterie et du développement des publics
Margaux Sulmon
Responsable adjointe développement des publics
Julie Kunz
Collaboratrices billetterie
Jessica Alves
Hawa Diallo-Singaré
Feifei Zheng
ACCUEIL DU PUBLIC
Responsable accueil du public
Pascal Berlie
Agent-e-s d'accueil
Eric Aellen
Romain Aellen
Sélim Besseling
Margot Chapatte
Michel Chappellaz
Laura Colun
Liu Cong
Raphaël Curtet
Yacine El Garah
Arian Iraj Forotan Bagha
Victoria Fragoso
David Gillieron
Youri Hanne
Youssef Mahmoud
Ilona Montessuit
Dilara Özcan
Baptiste Perron
Margot Plantevin
Luane Rasmussen
Tanih Razakamanantsoa
Julia Rieder
Laure Rutagengwa
Doris Sergy
Rui Simao
Emma Stefanski
Quentin Weber
FINANCES
Responsable Finances
Florence Mauron-Fort
Comptables
Paola Andreetta
Andreana Bolea
Laure Kabashi
RESSOURCES HUMAINES
Responsable RH
Mahé Baer Ernst
Gestionnaires RH
Laura Casimo
Marina Della Valle
Alexia Dubosson NN
INFORMATIQUE
Chef de service
Marco Reichardt
Administrateurs informatiques et télécoms
Lionel Bolou
Ludovic Jacob
Alexandre Martins
ARCHIVES
Archiviste / Gestionnaire des collections
NN
CAFÉTÉRIA DU PERSONNEL
Coordinateur
Christian Lechevrel
Collaborateur buvette
Norberto Cavaco
Cuisinier
Olivier Marguin
TECHNIQUE
Directeur technique
Philippe Sagnes
Adjointe administrative
Sabine Buchard
Collaboratrice administrative et comptable
Chantal Chappot
Régisseures techniques de production
Ana Martín del Hierro
Catherine Mouvet
BUREAU D'ÉTUDE
Responsable du bureau d'étude
Yvan Grumeau
Assistant
Christophe Poncin
Dessinateur-trice-s
Stéphane Abbet
Antonio Di Stefano
Solène Laurent
LOGISTIQUE
Responsable logistique
Thomas Clément
Chauffeurs / Collaborateurs administratifs
Dragos Mihai Cotarlici
Alain Klette
SERVICE INTÉRIEUR
Huissier responsable
Stéphane Condolo
Huissier-ère-s
Bekim Daci
Teymour Kadjar
Antonios Kardelis
Fanni Smiricky
Huissiers/Coursiers
Cédric Lullin
Timothée Weber
INFRASTRUCTURE ET BÂTIMENT
Ingénieur infrastructure
bâtiment et sécurité
Roland Fouillerat
Responsable d'entretien
Thierry Grasset
CHEFS DE PLATEAU
Stéphane Nightingale
Patrick Savariau
MACHINERIE
Chef de service
Stéphane Guillaume
Sous-chefs
Juan Calvino
Stéphane Desogus
Daniel Jimeno
Yannick Sicilia
Sous-chef cintrier
Killian Beaud
Brigadiers
Eric Clertant
Henrique Fernandes Da Silva
Sulay Jobe
Julien Pache
Damian Villalba
Machinistes cintriers
Alberto Araujo Quinteiro
David Berdat
Vincent Campoy
Nicolas Tagand
Machinistes
Chann Bastard
Philippe Calame
Vincent De Carlo
Fernando De Lima
Sedrak Gyumushyan
Benjamin Mermet
Hervé Pellaud
Julien Perillard
Geoffrey Riedo
Bastien Werlen
SON & VIDÉO
Chef de service
Jean-Marc Pinget
Sous-chef
Matteo Buttice
Techniciens
Amin Barka
Youssef Kharbouch
Christian Lang
Jérôme Ruchet
ÉCLAIRAGE
Chef de service
Simon Trottet
Sous-chefs de production
Marius Echenard
Stéphane Gomez
Sous-chef opérateur lumières et informatique de scène
David Martinez
Coordinateur de production
Blaise Schaffter
Techniciens éclairagistes
Serge Alérini
Dinko Baresic
Salim Boussalia
Stéphane Esteve
Romain Toppano
Juan Vera
Électronicien
Clément Brat
Opérateurs lumière et informatique de scène
William Desbordes
Florent Farinelli
NN
Responsable entretien
électrique
Fabian Pracchia
ÉLECTROMÉCANIQUE
Chef de service
David Bouvrat (ad interim)
Sous-chef
Fabien Berenguier (ad interim)
Electromécaniciens
Sébastien Duraffour
Stéphane Resplendino
Christophe Seydoux
Emmanuel Vernamonte
ACCESSOIRES
Chef de service
Damien Bernard
Sous-chef
Patrick Sengstag
Accessoiristes
Vincent Bezzola
Joëlle Bonzon
Stamatis Kanellopoulos
Cédric Pointurier-Solinas
Anik Polo
Silvia Werder
Pierre Wüllenweber
HABILLAGE
Cheffe de service
Joëlle Muller
Sous-cheffe
Sonia Ferreira Gomez
Responsable costumes Ballet
Caroline Bault
Habilleur-euse-s
Claire Barril
Cécile Cottet-Nègre
Angélique Ducrot
Sylvianne Guillaume
Philippe Jungo
Olga Kondrachina
Christelle Majeur
Veronica Segovia
Charlotte Simoneau
Lorena Vanzo-Pallante
Habilleuse ballet
Raphaèle Ruiz
PERRUQUES ET MAQUILLAGE
Cheffe de service
Karine Cuendet
Sous-cheffe
Christèle Paillard
Perruquières-maquilleuses
Lina Frascione Bontorno
Cécile Jouen
Alexia Sabinotto
ATELIERS DÉCORS
Chef des ateliers décors
Michel Chapatte
Assistant
Christophe Poncin
MENUISERIE
Chef de service
Stéphane Batzli
Sous-chef
Manuel Puga Becerra
Menuisiers
Giovanni Conte
Ivan Crimella
Frédéric Gisiger
Aitor Luque
Philippe Moret
German Pena
Bruno Tanner
SERRURERIE
Chef de service
Alain Ferrer
Serruriers
Romain Grasset
Samir Lahlimi
TAPISSERIE DÉCORATION
Chef de service
Dominique Baumgartner
Sous-chef
Martin Rautenstrauch
Tapissier-ère-s et décorateur-trice-s
Line Beutler
Daniela De Rocchi
Dominique Humair Rotaru
Raphaël Loviat
Fanny Silva Caldari
PEINTURE DÉCORATION
Chef de service
Fabrice Carmona
Sous-chef
Christophe Ryser
Peintres
Gemy Aïk
Ali Bachir-Chérif
Stéphane Croisier
Janel Fluri
ATELIERS COSTUMES
Cheffe des ateliers costumes
Sandra Delpierre
Assistant-e-s
Armindo Faustino-Portas
Carole Lacroix
Gestionnaire stock costumes
Philippe Joly
Coordinatrice
de productions costumes
Sylvie Barras
ATELIER COUTURE
Cheffe de l'atelier couture
Corinne Crousaud
Costumière
Jacky Blanchard
Caroline Ebrecht
Tailleur-e-s
Amar Ait-Braham
Christian Rozanski
Pauline Voegeli
Couturier-ère-s
Sophie De Blonay
Léa Cardinaux
Ivanna Denis
Marie Hirschi
Gwenaëlle Mury
Léa Perarnau
Yulendi Ramirez
Xavier Randrianarison
Ana-Maria Rivera
Soizic Rudant
Astrid Walter
Fanny Betend
DÉCO ET ACCESSOIRES
COSTUMES
Cheffe de service
Isabelle Pellissier-Duc
Décoratrices
Corinne Baudraz
Emanuela Notaro
Ella Abbonizio
CUIR
Chef de service
Arthur Veillon
Cordonnier-ère-s
Venanzio Conte
Catherine Stuppi
Eloane Berner (apprenti)
PERSONNEL SUPPLÉMENTAIRE
TEMPORAIRE
Médiamaticien
Enzo Incorvaia (apprenti)
Ressources humaines
Anita Hasani (apprentie)
Vlora Isaki
Mathilde Bettencourt
Rym Benharrats
Accueil du public
Raphaël Benador
Lorella Birchmeier
Eloïse Crétallaz
Auriana Demierre
Tana Krippner
Lucie Lerebours
Alexandre Pages
Vincent Pasche
Jane Vulloz
Billetterie
Lea Arigoni
Solana Cruz (apprentie)
Morgane Wagner
Archives
Léana Polard
Marketing
Cyril Robert
Presse
Charles Sigel
Informatique
Alexandre Da Silva Martins
Buvette
Abema Dady-Molamba
Léonie Laborderie
Régie
Valérie Tacheron
Saskia Van Beuningen
Chœur — organisation et support
Molham Al Sidawi
Senou Ronald Alohoutade
Harry Favarger
Sega Njie
Pauline Riegler
Ballet
Elena Braito Sanina
Anna Cenzuales
Antonio Costa Jover
Serafima Demianova
Dramaturgie et développement
culturel
Alexandra Guinea
Latcheen Maslamani
Mansour Walter
Accessoires de scène
Yoann Botelho
Dorota Smolana Tomic
Habillage
Sarah Bourgeade
Julie Chenevard
Delphine Corrignan-Pasquier
Céline Ducret
Aurélie Vincent
Infrastructure et bâtiment
André Barros (apprenti)
David Garcia (stagiaire)
Perruques et maquillage
Delfina Perez
Carole Schoeni
Cristina Simoes
Nathalie Tanner
Séverine Uldry
Mia Vranes
Léa Yvon
Éclairage
Tristan Freuchet
Adrien Nicolovicci
Juliette Riccaboni
Alessandra Vigna
Machinerie
Claude Attipoe
Mickael Coue
Telat Demir
Maxime Ettwiller
Marius Iacoblev
Greg Schmidt
André Tapia
Électromécanique
Alejandro Andion
Son & Vidéo
Clément Karch
Noah Nikita Kreil
Bureau d'étude
Cédric Bach
Lorenzo Del Cerro
Décors
Loris Gérard (stagiaire)
Samir Karar (stagiaire)
Cuir
Eloane Berner (apprenti)
Couture
Michèle Foucher-Michaux
Kalyani Jaccard
Giulia Muniz
Paola Mulone
Amandine Penigot
Thea Ineke Van der meer
La Fondation du Grand Théâtre de Genève
Le Grand Théâtre est régi depuis 1964 par la Fondation du Grand Théâtre de Genève sous la forme juridique d'une Fondation d'intérêt communal, dont les statuts ont été adoptés par le Conseil municipal et par le Grand Conseil. Principalement financée par la Ville de Genève avec le soutien de l'Association des communes genevoises et de mécènes, la Fondation a pour mission d'assurer l'exploitation du Grand Théâtre,
Conseil de Fondation
M. Xavier Oberson, Président*
Mme Sandrine Salerno, Vice-présidente*
M. Guy Dossan, Secrétaire*
M. Sami Kanaan*
Mme Frédérique Perler*
M. Claude Demole*
Mme Dominique Perruchoud*
M. Ronald Asmar
M. Shelby R. du Pasquier
M. Rémy Pagani
M. Charles Poncet
* Membre du Bureau
Situation au 27 août 2024
notamment en y organisant des spectacles d'art lyrique, chorégraphique et dramatique (art. 2 de ses statuts).
Le Conseil de Fondation est composé de quatorze membres, désignés par le Conseil municipal et le Conseil administratif de la Ville de Genève, et d'un membre invité représentant du personnel.
M. Thomas Putallaz
Mme Maria Vittoria Romano
Mme Françoise Vaufrey Briegel
M. Juan Calvino, Membre invité représentant du personnel
M. Guy Demole, Président d'honneur
Secrétariat Cynthia Haro fondation@gtg.ch
Devenez mécène du Grand Théâtre !
Comme mécène ou partenaire du Grand Théâtre de Genève, vous serez associé à la plus grande structure artistique de Suisse romande et renforcerez tant son ancrage à Genève que son rayonnement au-delà de ses frontières. Vous participerez au déploiement des ambitions d'excellence et d'innovation artistiques, et d'ouverture à tous les publics. Chaque saison, le Grand Théâtre présente des productions lyriques et chorégraphiques qui évoquent les grands sujets de notre époque, destinées à faire vivre l'expérience incomparable de l'art sous toutes ses formes au plus grand nombre. Avec une compagnie de ballet menée par le grand chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui, à la pointe de l'expérimentation transdisciplinaire, le Grand Théâtre développe un nouveau répertoire de danse contemporaine dont les tournées feront briller Genève et la Suisse à l'international.
Votre don permet la réalisation de projets audacieux, avec un large champ d'initiatives qui vous permettent de participer directement au financement d'une saison ou d'un spectacle ; contribuer à la création mondiale d'un ballet ; soutenir un projet qui rassemble plusieurs
disciplines artistiques ; vous engager pour la jeunesse et pour la diversification des publics ; pour l'accessibilité à toutes et tous et à petit prix ; aider les artistes du Grand Théâtre, sa troupe de jeunes chanteurs en résidence ou les jeunes danseurs de sa compagnie de ballet.
À titre individuel, dans le cadre d'une fondation ou d'une entreprise, votre mécénat se construit selon vos souhaits en relation privilégiée avec le Grand Théâtre, pour enrichir votre projet d'entreprise ou personnel. Rejoignez-nous pour bénéficier non seulement d'une visibilité unique et d'un accès exceptionnel aux productions, mais aussi pour vivre des émotions fortes et des moments inoubliables en compagnie des grands artistes de notre époque !
Rejoignez-nous, engageons-nous ensemble à pérenniser les missions du Grand Théâtre !
Informations et contact
+41 22 322 50 58
+41 22 322 50 59 mecenat@gtg.ch
Ville de Genève, Association des communes genevoises, Cercle du Grand Théâtre de Genève, Aline Foriel-Destezet, République et Canton de Genève
Ses grands mécènes : Fondation Alfred et Eugénie Baur, Généreux donateur conseillé par CARIGEST SA, Guy Demole, FCO Private Office SA, Caroline et Éric Freymond, Fondation Ernst Göhner, Indosuez Wealth Management, Fondation Inspir', JT International SA, Fondation Leenaards, Brigitte Lescure, Fondation Francis et Marie-France Minkoff, Fondation du Groupe Pictet, REYL Intesa Sanpaolo, Fondation Edmond J. Safra, Union Bancaire Privée, UBP SA, Stiftung Usine, Fondation VRM
Ses mécènes : Rémy et Verena Best, Bloomberg, Boghossian, Cargill International SA, Fondation Coromandel, Dance Reflections by Van Cleef & Arpels, Denise Elfen-Laniado, Angela et Luis Freitas de Oliveira, Fondation Léonard Gianadda Mécénat, Hirslanden Clinique La Colline — CMSE, Hyposwiss Private Bank Genève SA, Mona Lundin-Hamilton, France Majoie Le Lous, Vera Michalski-Hoffmann, MKS PAMP SA, Famille Rolland, Adam et Chloé Said, Famille Schoenlaub, Fondation du Domaine de Villette
Le Cercle du Grand Théâtre de Genève
Le Cercle du Grand Théâtre de Genève rassemble toutes les personnes et entreprises intéressées à soutenir les activités du Grand Théâtre dans le domaine des arts lyrique, chorégraphique et dramatique. Depuis sa création en 1986, le Cercle apporte chaque saison un important soutien financier au Grand Théâtre par des contributions aux spectacles.
Pour la saison 2024-2025, le Cercle soutient les productions suivantes : Ihsane, Fedora, Khovantchina et Stabat Mater.
Pourquoi rejoindre le Cercle ?
Pour partager une passion commune et s'investir dans l'art vivant avec la plus grande scène culturelle de la Suisse romande.
Certains de nos avantages exclusifs :
· Cocktails d'entracte
· Dîner de gala annuel
· Voyages lyriques sur des scènes européennes
· Conférence annuelle Les Métiers de l'Opéra
· Participation à la finale du Concours de Genève (section voix)
· Priorité pour la souscription des abonnements
· Priorité de placement et utilisation de la même place tout au long de la saison
· Service de billetterie personnalisé
· Tarifs préférentiels pour la location des espaces du Grand Théâtre
· Invitation au pot de Première
· Meet & Greet avec un·e artiste et/ou un·e membre de la production
· Accès gratuit à toutes les activités de La Plage
Bureau (novembre 2024)
M. Rémy Best, président
M. Shelby du Pasquier, vice-président
M. Luis Freitas de Oliveira, trésorier
Mme Benedetta Spinola, secrétaire
Autres membres du Comité (novembre 2024)
Mme Emily Chaligné
M. Romain Jordan
Mme Pilar de La Béraudière
Mme Marie-Christine von Pezold
Mme Adeline Quast
M. François Reyl
M. Julien Schoenlaub
M. Gerson Waechter
Membres bienfaiteurs
M. Metin Arditi
MM. Ronald Asmar et Romain Jordan
M. et Mme Rémy Best
M. Jean Bonna
Fondation du groupe Pictet
M. et Mme Luis Freitas de Oliveira
Mme Mona Hamilton
M. et Mme Pierre Keller
Banque Lombard Odier & Cie
MKS PAMP SA
M. et Mme Yves Oltramare
M. et Mme Jacques de Saussure
M. et Mme Julien Schoenlaub
M. et Mme Pierre-Alain Wavre
M. et Mme Gérard Wertheimer
Membres individuels
S.A. Prince Amyn Aga Khan
Mme Marie-France Allez de Royère
Mme Diane d'Arcis
M. Luc Argand
M. Cesar Henrique Arthou
Mme Christine Batruch-Hawrylyshyn
M. et Mme François Bellanger
Mme Maria Pilar de la Béraudière
M. Vincent Bernasconi
M. et Mme Philippe Bertherat
Mme Antoine Best
Mme Saskia van Beuningen
M. et Mme Nicolas Boissonnas
Mme Clotilde de Bourqueney Harari
Comtesse Brandolini d'Adda
Mme Emily Chaligné
M. et Mme Jacques Chammas
M. et Mme Philippe Chandon-Moët
M. et Mme Philippe Cottier
Mme Tatjana Darani
M. et Mme Claude Demole
M. et Mme Guy Demole
M. et Mme Michel Dominicé
M. Pierre Dreyfus
Me et Mme Olivier Dunant
Mme Marie-Christine Dutheillet de Lamothe
Mme Heidi Eckes-Chantré
Mme Denise Elfen-Laniado
Mme Diane Etter-Soutter
M. et Mme Patrice Feron
M. et Mme Éric Freymond
M. et Mme Olivier Fulconis
M. et Mme Nicolas Gonet
M. et Mme Yves Gouzer
Mme Claudia Groothaert
M. et Mme Philippe Gudin de La Sablonnière
Mme Bernard Haccius
Mme Beatrice Houghton
Mme Victoria Hristova
M. et Mme Éric Jacquet
M. et Mme Daniel Jaeggi
M. Guillaume Jeangros
Mme Jane Kent
M. Antoine Khairallah
M. et Mme Jean Kohler
Mme Mallu Kulvik
M. Marko Lacin
Mme Brigitte Lacroix
M. et Mme Philippe Lardy
Mme Éric Lescure
M. Pierre Lussato
Mme France Majoie Le Lous
M. et Mme Colin Maltby
M. Bertrand Maus
M. et Mme Olivier Maus
Mme Béatrice Mermod
Mme Vera Michalski-Hoffmann
Mme Jacqueline Missoffe
M. et Mme Christopher Mouravieff-Apostol
M. Fergal Mullen
M. Xavier Oberson
M. et Mme Patrick Odier
M. et Mme Alan Parker
M. et Mme Shelby du Pasquier
Mme Jean Pastré
Mme Sibylle Pastré
Baron et Baronne Louis Petiet
M. et Mme Gilles Petitpierre
Mme Marie-Christine von Pezold
M. et Mme Charles Pictet
M. Charles Pictet
M. et Mme Guillaume Pictet
M. et Mme Ivan Pictet
M. Nicolas Pictet
Mme Françoise Propper
Comte et Comtesse de Proyart
M. et Mme Christopher Quast
Mme Zeina Raad
Mme Brigitte Reverdin
M. et Mme Dominique Reyl
M. et Mme François Reyl
Mme Karin Reza
Mme Chahrazad Rizk
M. et Mme Jean-Pierre Roth
M. et Mme Andreas Rötheli
M. et Mme Jean-Rémy Roussel
M. et Mme Adam Said
Mme Maria-Claudia de Saint Perier
Marquis et Marquise de Saint Pierre
M. Vincenzo Salina Amorini
M. Alain Saman
Mme Nahid Sappino
M. Paul Saurel
Mme Isabelle de Ségur
Baronne Seillière
M. Jérémy Seydoux
Mme Nathalie Sommer
Marquis et Marquise Enrico Spinola
Mme Christiane Steck
Mme Kenza Stucki
M. Eric Syz
M. Riccardo Tattoni
Mme Suzanne Troller
M. et Mme Gérard Turpin
M. Olivier Varenne
Mme Ghislaine Vermeulen
M. et Mme Julien Vielle
M. et Mme Olivier Vodoz
Mme Bérénice Waechter
M. Gerson Waechter
M. et Mme Stanley Walter
M. Stanislas Wirth
M. et Mme Giuseppe Zocco
Membres institutionnels
1875 Finance SA
BCT Bastion Capital & Trust
FCO Private Office SA
Fondation Bru
Fondation de l'Orchestre de la Suisse Romande
International Maritime Services Co. Ltd.
Lenz & Staehelin
Moore Stephens Refidar SA
Plus d'informations et le détail complet des avantages pour les membres du Cercle sur gtg.ch/cercle
Inscriptions
Cercle du Grand Théâtre de Genève
Gwénola Trutat
Case postale 44
1211 Genève 8 +41 22 321 85 77 (8 h-12 h)
cercle@gtg.ch
Compte bancaire
No 530290
Banque Pictet & Cie SA
Organe de révision
Plafida SA
Ballet

Mirage
Chorégraphie de Damien Jalet mondiale 2025 première création
Chorégraphie de Damien Jalet
Chorégraphie de Damien Jalet
Création mondiale 6 au 11 mai 2025
2025 première création Ballet du Théâtre, Jalet poursuit son de la condition Kohei Nawa. traverse comme éveillé, fluctuant à l’instar de
Ballet du Grand Théâtre, Jalet poursuit son de la condition avec Kohei Nawa. traverse comme éveillé, fluctuant
mouvant, à l’instar de phénomène fascinant.
Dans cette première création pour le Ballet du Grand Théâtre, Damien Jalet poursuit son exploration de la condition humaine avec Kohei Nawa. Mirage se traverse comme un rêve éveillé, fluctuant et mouvant, à l’instar de ce phénomène fascinant. Moussorgski de prophétie
IMPRESSUM
Directeur de la publication
Aviel Cahn
Rédaction
Beate Breidenbach
Clara Pons
Traduction
Michaël Rolli
Relecture
Samira Payot
Opéra
Opéra Récital
Opéra Récital Ballet


Stabat Mater
Stabat Mater
Stabat Mater
Benjamin Appl
Benjamin Appl
Benjamin Appl
Onbashira
Onbashira
Oratorio de Battista Pergolesi Nouvelle 10 au mai 2025
Oratorio de Giovanni Battista Pergolesi Nouvelle production 10 au 18 mai 2025
Oratorio de Giovanni Battista Pergolesi Nouvelle production 10 au 18 mai 2025
Baryton
Baryton
Baryton
James Baillieu, piano 15 mai 2025 — 20h
James Baillieu, piano 15 2025 — 20h
Tout le génie du prodige italien Pergolèse est ici décuplé.
Tout le génie du prodige italien Pergolèse est ici décuplé.
L'interprétation angélique de Jakub Józef Orliński et de Barbara Hannigan, cheffe et soprano, étire le cri de cette sublime douleur magnifiée par Romeo Castellucci.
Tout le génie du prodige Pergolèse est décuplé. L'interprétation angélique de Jakub Józef Orliński et de Barbara Hannigan, et étire cri cette sublime magnifiée par Castellucci.
L'interprétation angélique de Jakub Józef Orliński et de Barbara Hannigan, cheffe et soprano, étire le cri de cette sublime douleur magnifiée par Romeo Castellucci.
Photo couverture
© Diana Markosian
Photos page 8, 31, 37, 50
© Sarah Derendinger pour la production
Réalisation graphique
Sébastien Fourtouill
Impression
Atar Roto Presse SA
Chorégraphie
Chorégraphie
James Baillieu, piano 15 mai 2025 — 20h
17 mai
17 mai 2025
Fidèle à sa curiosité musicale, le baryton allemand Benjamin Appl, accompagné de son complice James Baillieu, fait dialoguer le cycle Six Songs from A Shropshire Lad de George Butterworth avec l'œuvre de Gustav Mahler.
Fidèle à sa curiosité musicale, le baryton allemand Benjamin Appl, accompagné de son complice James dialoguer le cycle from Shropshire Lad de George Butterworth avec l'œuvre Mahler.
Grand Théâtre de Genève
Boulevard du Théâtre 11
Case postale 44 1211 Genève 8
Standard +41 22 322 50 00
Billetterie
+41 22 322 50 50
Contact info@gtg.ch gtg.ch
#WeArtGTG
Fasciné par festival japonais
Fasciné par festival
Damien rassembler
Damien Jalet rassembler
Skid et Thr(o)ugh d'une soirée
Fidèle à sa curiosité musicale, le baryton allemand Benjamin Appl, accompagné de son complice James Baillieu, fait dialoguer le cycle Six Songs from A Shropshire Lad de George Butterworth avec l'œuvre de Gustav Mahler.
Skid et Thr(o)ugh d'une


