
Quand l’amour égare, dans la vie comme à l’opéra
Marina Abramović, de la séparation aux retrouvailles
À travers Stockholm avec Daniel Johansson, l’interprète de Tannhäuser


Quand l’amour égare, dans la vie comme à l’opéra
Marina Abramović, de la séparation aux retrouvailles
À travers Stockholm avec Daniel Johansson, l’interprète de Tannhäuser
Suivez l’actualité culturelle, les recommandations de nos journalistes et les portraits de ceux qui façonnent la scène culturelle en Suisse romande.

Découvrez nos abonnements en scannant le code QR ou sur LeTemps.ch/abonnement
À l’opéra, l’amour n’est jamais une solution. C’est un vertige, un gouffre ouvert sous les pieds.
Depuis quatre siècles, le théâtre lyrique met en scène non pas l’amour comme refuge, mais l’amour comme trouble, comme perte – perte de soi, de l’autre, de tout repère. Le thème s’imposait donc pour le premier numéro de cette saison du Grand Théâtre placée sous le titre « Lost in translation ». Car quel trouble est-il plus actuel que celui des cœurs et des corps, à l’heure où les relations se réécrivent, où les rôles se redéfinissent ?
L’amour, quand il entre en scène, n’a donc rien d’un idéal paisible. Il est excès. Il commence là où les mots échouent. Alors on chante. Et quand le chant ne suffit plus, on se tait, ou on meurt. C’est ce basculement – du discours vers le cri, et parfois vers le silence – qui dit la perte de maîtrise, l’abandon du sens. L’amour, ici, n’est pas à construire. Il désoriente. Il désagrège. Il transforme l’élan en tragédie.
Prenez Pelléas & Mélisande. L’unique opéra de Debussy revient enfin sur la scène du Grand Théâtre, après avoir été évincé par la pandémie. Tout y est flou, tout échappe.
Golaud pose des questions ; personne ne répond. Mélisande ne sait pas – pourquoi elle pleure, pourquoi elle erre, pourquoi elle laisse tomber sa bague dans le puits. Rien ne tient debout, tout glisse. La musique elle-même est fluide, insaisissable. L’amour, ici, ne lie pas : il dissout.
Cette absence de repères, les chorégraphes Sidi Larbi Cherkaoui et Damien Jalet la traduisent en mouvement, dans un décor signé Marina Abramović. Chez la grande plasticienne, l’amour est aussi transformation – parfois douloureuse –, comme elle l’a confié à Emmanuel Grandjean dans ce numéro.
Dans Tannhäuser, Wagner projette l’expérience ailleurs. Son héros erre entre deux univers : Vénus, incarnation du désir immédiat, et Élisabeth, figure de l’amour pur. Deux visions irréconciliables.
Tannhäuser ne parvient pas à choisir. Il fuit, revient, s’égare à nouveau – jusqu’à la perte totale.
L’amour n’y éclaire rien. Il ouvre un labyrinthe moral, mystique, sans issue. Là encore, ce n’est pas la passion qui triomphe, mais l’impossibilité de la vivre lorsque la conscience est écorchée.
Les amours lyriques sont aussi souvent dysfonctionnelles, empêchées, fragmentées. Elles nous parlent parce qu’elles mettent en scène ce que la vie réelle, trop confuse, nous empêche de nommer, comme nous l’explique le psychanalyste Pascal Neveu. Car entre les couples heureux, rares à l’opéra, et les couples tragiques, plus nombreux, il y a ceux dont l’histoire ne se termine ni dans les larmes ni dans la lumière. Des amours grises, intermédiaires, où le trouble est la seule certitude, ainsi que les décrit Jules Cavalié.
L’opéra ne prétend pas soigner les errances amoureuses mais il donne forme à l’indicible. Il fait de l’échec du langage, des énigmes du désir, un art à part entière. Il met en jeu ce lieu sans mots qu’on nomme amour, et où pourtant nous perdons pied. Par ivresse ou par désillusion.
C’est peut-être pour cela qu’il nous bouleverse encore.
Bonne lecture !
Jean-Jacques Roth
Rédacteur en chef de ce magazine, Jean-Jacques Roth a travaillé dans de nombreux médias romands. Il a notamment été rédacteur en chef et directeur du Temps puis directeur de l’actualité à la RTS avant de rejoindre Le Matin Dimanche, où il a dirigé le magazine Cultura. Il a entre autres consacré deux ouvrages au Grand Théâtre.

Partenaire de l’ouverture de saison du Grand Théâtre de Genève depuis plusieurs années, l’UBP est heureuse de soutenir la représentation de Tannhäuser.


Édito 1
Par Jean-Jacques Roth
Lost in… love 4
Brigitte Rosset, « Plus le temps passe, moins j’ai peur de me perdre dans l’amour »
Ailleurs 6
Daniel Johansson à Stockholm
Portfolio 12
Iris van Herpen
Danse 14
Le Ballet du GTG chez Hugonnet
Portrait de couverture
Les couvertures du magazine, comme les photos de la brochure et des affiches du Grand Théâtre sont cette saison choisies par Paolo Woods. Lauréat de plusieurs World Press Photos, Paolo Woods parcourt le monde avec un regard nuancé sur les réalités sociales et politiques. Il a signé de nombreux ouvrages sur l’Iran, Haïti, sur les pilules du bonheur ou sur la Chinafrique. La photo de couverture de ce numéro montre Lolo Beaubrun, chanteur et fondateur du groupe Boukman Eksperyans, à Saut d’Eau, en Haïti. © Paolo Woods

Mark Elder et Wagner, les clichés à la poubelle
Premiers pas 40
Mathilde Bettencourt « Je m’attendais à être surprise, mais pas aussi positivement »
Rétroviseur 42
Mouvement culturel 44
Bakou, l’opéra du pétrole
Agenda 48
Lost in love… perdus dans l’amour. L’opéra est une scène ouverte aux couples tragiques, dysfonctionnels, errants : leur chant donne des contours à ce qui, dans la vie, est chaos. Notre dossier leur est consacré (Vénus et Adonis d’Abraham Bloemaert, 1632). © Rawpixels.com / Statens Museum for Kunst
Lost in love, à l’opéra et dans la vie 20
Aimer jusqu’à la fracture 22
Couples à l’opéra, les chants de la dérive 28
Marina Abramović, l’amour à l’œuvre 34
Stéphane Degout, « L’amour tragique, contrarié ou sacrificiel nourrit l’opéra » 38
Éditeur Grand Théâtre de Genève, Partenariat Le Temps, Collaboration éditoriale Le Temps
Directeur de la publication Aviel Cahn Rédacteur en chef Jean-Jacques Roth Édition Jean-Jacques Roth
Comité de rédaction Aviel Cahn, Karin Kotsoglou, Jean-Jacques Roth Direction artistique Jérôme Bontron, Sarah Muehlheim
Maquette et mise en page Sarah Muehlheim Images Irina Popa (Le Temps ) Relecture Patrick Vallon
Impression Moléson Impressions, imprimé sur papiers certifiés FSC issus de sources responsables avec des encres bio végétales sans cobalt Promotion GTG Diffusion 2000 exemplaires + diffusion numérique sur www.letemps.ch Parution 4 fois par saison
La comédienne romande se raconte dans des solos hilarants et poignants.
Elle est aussi vertigineuse dans les filets du désir chez Marivaux. Paroles d’une dentellière du cœur.
Par Alexandre Demidoff
Les heures exquises de Brigitte Rosset. La comédienne romande a le bagou des grandes comiques. Et l’envergure d’une dentellière du sentiment. Impossible de ne pas trembler avec elle, quand elle joue la Comtesse foudroyée par un Chevalier – une femme en vérité –, dans La Fausse suivante de Marivaux, montée par Jean Liermier au Théâtre de Carouge et reprise récmment au Théâtre national populaire de Villeurbanne. Impossible aussi de ne pas chérir ses fantômes quand elle célèbre sa famille très protestante dans son dernier solo, le si solaire Merci pour le couteau à poisson, les conversations et les délices au jambon. « Mais oui, tout est amour », s’emballe-t-elle au téléphone, voix de l’aube, impétueuse et claire comme l’eau des torrents des Diablerets où elle vit avec son compagnon une partie de l’année.
Vous est-il arrivé de ne pas vous reconnaître dans l’amour ?
Je ne me souviens pas de m’être perdue dans une passion. Je suis trop raisonnable pour cela ! Même ado, je ne me suis jamais teint les cheveux en bleu pour un garçon. En revanche, je me suis perdue dans le désamour…
C’est-à-dire… ?
Dans le tunnel d’un chagrin qui ne passe pas, j’ai eu la sensation d’être arrachée à moi. Je n’étais plus Brigitte, j’étais le néant. Je me rappelle cette amie qui m’a dit : « Ça fait six mois que tu te lamentes, je ne te reconnais plus… » Il y a tout qui s’éteint quand l’être aimé ne vous aime plus. Un peu comme si dans un de mes solos, la lumière était coupée d’un coup et que je me retrouvais bouche ouverte dans le noir…
Est-ce que ça peut pousser à une forme de folie ?
Je me suis surprise à lire et relire tous les messages de la personne aimée, ceux où l’amour paraissait sans limites, comme si la lettre était le présent, comme si elle pouvait m’abstraire du désespoir, me rendre le passé.
Quel remède alors ?
Il n’y en a pas, sauf, pardon de la banalité, le temps. La plasticienne Sophie Calle l’a très bien exprimé dans son exposition et son livre Douleur exquise. C’est une traversée du chagrin, une suite de textes où elle met en regard ce qu’elle vit avec le témoignage d’hommes et de femmes à qui elle a demandé de raconter leurs plus grandes souffrances. Au bout de trois mois, elle note : « Un homme m’a quitté. » Tout est dit, c’est fini. Elle a fait son deuil.

Alexandre Demidoff se forme à la mise en scène à l’Institut national des arts et techniques du spectacle à Bruxelles. Il enchaîne ensuite avec un master en littérature française à l’Université de Genève et à l’Université de Pennsylvanie à Philadelphie. Il collabore au Nouveau
Quotidien dès 1994 et rejoint le Journal de Genève comme critique dramatique en 1997. Depuis 1998, il est journaliste à la rubrique Culture du Temps qu’il a dirigée entre 2008 et 2015. Il passe une partie de sa vie dans les salles.

« Il y a tout qui s’éteint quand l’être aimé ne vous aime plus. Un peu comme si dans un de mes solos, la lumière était coupée d’un coup et que je me retrouvais bouche ouverte dans le noir… » © Vincent Calmel
Peut-on dissocier la personne du personnage quand on joue une scène d’amour ?
Non, pas toujours. Être couverte de mots d’amour comme je l’ai été dans le rôle de la Comtesse est troublant, d’autant que Marivaux décrit, à travers cette scène, l’éveil du sentiment et que son verbe est merveilleux. En face de Rébecca Balestra d’abord, puis de Lola Giouse qui a repris le rôle, j’ai été transpercée par l’amour, pas exactement celui de la vraie vie, mais il s’en rapproche délicieusement. Dans ces moments-là, je ne distingue plus le personnage de Brigitte. Je suis grisée par cette langue et je ne m’en lasse jamais.
Comment se traduit l’état amoureux chez vous ?
C’est une bouffée de joie et j’insiste sur le mot « bouffée ». Je suis consciente de tout, j’ai le sentiment d’appartenir pleinement au monde et tout est léger. Je me sens portée comme par une vague.
Écrivez-vous des lettres d’amour ?
Depuis toujours, bien sûr. J’aime les recevoir, j’aime les ciseler. J’écris à mon amoureux encore aujourd’hui, alors que nous vivons ensemble. Quand je suis en tournée, je noircis des cartes postales ou le papier à lettres des hôtels. Mes missives arrivent souvent après mon retour, mais qu’importe. C’est important de s’écrire. Je suis en train de transformer mon spectacle Merci pour le couteau à poisson, les conversations et les délices au jambon en livre. Je réalise que c’est une immense déclaration d’amour, à ma mère, Catherine, décédée en 2020, à mes sœurs, à mes frères…
Vos amours sont-ils un sujet de conversation avec vos proches ?
Non, jamais. Mon sentiment n’a qu’un destinataire, l’être aimé. Je ne spécule pas avec d’autres sur mes chances que le sentiment soit réciproque. Je garde mes amours secrètes. Même quand je vis cette félicité, je ne l’ébruite pas. L’intime doit rester intime.
Avec l’âge, tombe-t-on moins facilement amoureux ?
Ah non ! Je suis persuadée qu’on peut vivre l’amour avec la même intensité à 80 ans qu’à 15. Il est impossible de perdre ça, le reste, je veux bien, mais pas ça. Il est même probable qu’avec le temps, on s’abandonne davantage à l’amour : on reconnaît le sentiment et on ose se perdre – on revient à votre question initiale ! – dans sa toile, aller vers l’inconnu.
La chanson d’amour qui vous porte ?
Quand on n’a que l’amour de Jacques Brel. Jean Liermier l’a glissée dans sa Fausse suivante. À chaque fois que je l’entendais, j’étais chavirée.
Le ténor suédois s’apprête à chanter
Tannhäuser au Grand Théâtre. Avant les répétitions, il a fait visiter sa ville et raconté sa trajectoire, de Gun’s N’ Roses à Wagner. Et son amour pour les rivages, car il est vital pour lui de vivre au bord de l’eau.
Par Loretto Villalobos
Photographies : Margareta Bloom Sandebäck pour le Grand Théâtre Magazine
Loretto Villalobos est journaliste culturelle indépendante.
Elle couvre l’opéra, le théâtre, la comédie musicale, le nouveau cirque, la danse et les arts de la performance pour, entre autres, Svenska Dagbladet, Aftonbladet et la revue Opera Elle anime également Kritcirkeln, le seul podcast en Suède spécialisé dans la critique des arts de la scène.
Kvarnholmen est un quartier de la commune de Nacka, une presqu’île de l’ouest de Stockholm, à seulement dix minutes en bus du centre-ville. C’est ici que je donne rendez-vous à Daniel Johansson, qui arrive bronzé de son séjour estival aux îles Åland avec sa famille. Il parle avec enthousiasme du lieu où nous nous trouvons, un petit café au centre de Kvarnholmen, installé dans un bâtiment qui était autrefois une boulangerie industrielle.
« Ce quartier est très spécial, » raconte-t-il. « C’était une ancienne zone de chantier naval, par exemple Finnboda Varv se trouvait ici, où ils construisaient des bateaux, et ils produisaient du carburant pour le diesel dans les zones rocheuses. Ensuite, Coop avait sa fabrique de pâtes et faisait du pain ici. En gros, tous ces bâtiments, sauf les constructions neuves, sont d’anciennes maisons d’architecture fonctionnaliste ou des usines désaffectées dont ils ont vidé l’intérieur pour en faire des appartements. Et Finnberget, cette colline où j’habite, en surplomb du quartier, s’appelle ainsi parce qu’il y vivait beaucoup de Finlandais qui travaillaient dans les chantiers navals. Ce sont aussi d’anciennes habitations, des années 40-50. »

Daniel Johansson à la veille de son départ pour les répétitions de Tannhäuser à Genève. Il aime travailler ses rôles au bord de l’eau. À Genève comme à Stockholm, il fréquente assidument les rivages.
Diplômé de l’Ecole royale de musique de Stockholm, le ténor Daniel Johansson s’est illustré dans plusieurs répertoires, de Mozart (Tamino) à Puccini (Rodolfo, Calaf, Pinkerton) et Verdi (Germont, Otello) ou Johann Strauss (Alfred). Il a chanté à Genève dans Guerre et Paix de Prokoviev (Pierre Bézoukhov). Mais c’est surtout un wagnérien accompli, qui maîtrise aussi bien Lohengrin que Siegmund, ou Parsifal qu’il a chanté à Genève en 2023.

Une arche métallique a récemment été édifiée à la mémoire de deux légendes suédoises du chant, la soprano Birgit Nilsson et Jussi Björling, ce ténor auquel Daniel Johansson se réfère souvent.
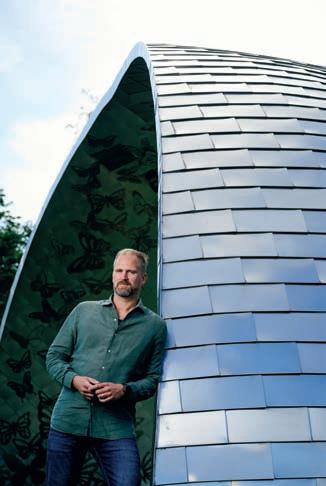

Il faut une demi-heure pour gagner le centre-ville depuis le quartier de Kvarnolmen où réside Daniel Johansson. Il en profite pour réviser ses partitions.

L’eau est partout à Stockholm. Enfant, Daniel Johansson passait ses étés sur le voilier de son beau-père, qui était capitaine de marine, ou au bord de l’eau à pêcher.



La gelateria Snö a reçu plusieurs prix pour ses glaces maison. Elle se trouve dans Kvarnen, un des anciens bâtiments industriels en briques rouges qui témoignent du passé industriel du quartier.
Daniel Johansson est originaire de Växjö, dans la région du Småland, au sud-est de la Suède, et a grandi dans une maison remplie de musique. Il raconte comment c’était un moyen naturel pour toute la famille de passer du temps ensemble – avec des disques de Shirley Bassey, Whitney Houston et Céline Dion, tandis que son père aimait écouter Johnny Cash et danser le bugg, une danse très populaire en Suède inspirée du jitterbug et du swing. En voiture comme à la maison, il y avait toujours quelqu’un qui jouait ou chantait.
« Maman avait acheté une guitare avec son premier salaire d’été, et ma sœur a appris à en jouer, puis moi. C’était très important que cette guitare soit là. » Sa mère l’a ensuite « un peu forcé » à prendre des cours de piano, même s’il n’était pas passionné. Lui, il était surtout attiré par le hard rock, Guns N’ Roses était son groupe préféré. Il jouait aussi dans un groupe influencé par Metallica et Rage Against the Machine. Il avait même acheté les partitions pour les chansons de Guns N’ Roses, ce qui allait plus tard avoir une importance décisive.
Vers ses vingt ans, sa mère a commencé à prendre des cours de chant avec Sylvia Mang-Borenberg, une cantatrice et pianiste de concert vivant dans la région. Un jour, la mère a persuadé Daniel de l’accompagner. « Sylvia était une figure importante du Småland et avait chanté dans beaucoup d’opéras mais je n’avais aucune idée de qui elle était. J’y suis quand même allé, avec mes longs cheveux et tout. Je n’avais jamais entendu de musique classique. Je me suis assis, et elle m’a demandé : “Que sais-tu faire ? Tu peux me montrer quelque chose ?” Alors je me suis installé au piano à queue et j’ai chanté des chansons de Guns N’ Roses, elle a dû presque en perdre ses oreilles ! Mais elle a entendu que j’avais des aigus – Axl Rose a une énorme tessiture ! Elle a vu qu’il pourrait y avoir quelque chose, mais il a fallu longtemps avant qu’elle m’appelle pour que je revienne essayer. J’étais un peu hésitant, mais je suis retourné là-bas et elle m’a dit : « Je veux que tu regardes ça. » Puis elle a sorti Tosca et joué « E lucevan le stelle ». Je n’avais jamais entendu ce genre de musique. J’ai été totalement “Wow, qu’est-ce que c’est que ça ?” et j’ai senti que je devais explorer ce que c’était. »
Nous commençons à marcher vers le quai où le bateau part pour le centre-ville. Le quartier est composé de hautes collines qui descendent vers l’eau.
Daniel raconte que l’école de ses enfants a la meilleure vue de la ville – un paysage fantastique qui montre clairement l’amas d’îles sur lequel Stockholm est construite.
« Être près de l’eau est vital pour moi. Ne pas être près de l’eau, c’est carrément impensable. »
Daniel a commencé à prendre des cours avec Harald Ek. Le chant a toujours été une fascination pour lui qui se décrit comme un « fanatique du chant ». Mais la voie vers une carrière n’était pas tracée, il envisageait alors des études de physique à l’université. Mais il a tout de même suivi une formation musicale à la folkhögskola (le lycée suédois) de Ljungskile, après quoi l’École d’opéra s’est présentée comme un développement organique pour son talent.
Sur notre chemin, nous croisons une installation dédiée à la soprano Birgit Nilsson (1918-2005) et au ténor Jussi Björling (1911-1960), qui a été récemment inaugurée. L’œuvre, intitulée Höga C, est une grande arche métallique en acier inoxydable acidifié, dont la surface rappelle la peau d’un gigantesque reptile. L’intérieur est décoré de papillons et porte un portrait de chaque légende du chant. Un chanteur suédois ne peut qu’avoir un lien avec ces géants.
« Birgit Nilsson est venue à moi assez tard. Mais c’est l’une des plus grandes interprètes de Wagner, avec une discipline et une précision énormes. Et Jussi Björling était techniquement tellement sûr ! Quand j’étudiais avec Erik Sædén, nous revenions toujours à “comment Jussi aurait-il fait ?” »
Nous continuons vers le quai. Être près de l’eau est important pour Daniel. Il raconte comment ses étés d’enfance étaient passés sur le voilier de son beau-père, qui était capitaine de marine, ou au bord de l’eau à pêcher. Et comment il aime maintenant souvent s’asseoir près de l’eau pour étudier ses partitions – souvent avec un café ou une glace de la petite boutique vers laquelle nous nous dirigeons. Même quand il est à Genève pour chanter, il se rend toujours au bord du lac. « Être près de l’eau est vital pour moi. Ne pas être près de l’eau, c’est carrément impensable. »
La gelateria Snö, où nous entrons, a reçu plusieurs prix pour ses glaces maison. La boutique se trouve dans Kvarnen, l’un des anciens bâtiments industriels massifs en briques rouges qui témoignent du passé industriel du quartier. Le bateau pour la ville fait partie du réseau de transports en commun de Stockholm et c’est le moyen que Daniel utilise pour se rendre au Théâtre Royal.
Il passe souvent la demi-heure de trajet à revoir ses partitions avant le spectacle. A-t-il des rituels ou superstitions avant de monter sur scène ?
« Non, j’essaie d’éviter ce genre de comportements qui pourraient devenir obsessionnels. Je sais quel type de nourriture éviter pour ne pas abîmer mes cordes vocales, et je repose ma voix la veille d’une représentation. »
Nous parlons de son attrait pour Wagner.
« J’ai toujours été fasciné par sa musique et sa capacité à raconter une histoire. Le jeu psychologique entre les personnages est central chez Wagner. Ce n’est pas aussi direct que chez Puccini – comme dans La Bohème où Rodolfo et Mimì tombent amoureux en deux minutes et l’histoire continue. Chez Wagner, les rencontres entre personnages prennent du temps. Il y a tellement de choses inscrites dans la musique – des silences et des tensions. J’aime cette dimension intellectuelle. Surtout quand on vieillit un peu, on commence à réfléchir aux grandes questions de l’existence, de l’être et du sens. Pourquoi tout existe, qu’y avait-il avant que nous existions ? Toutes ces grandes questions. Ce sont justement ces questions que Wagner aborde, dans Parsifal par exemple. La musique de Wagner est en plus tellement composée dans les moindres détails, terriblement réfléchie. Écrite par un fou peut-être. Il a vraiment osé prendre des risques musicaux. Mais ce qui me fascine le plus, c’est le chant. Il faut des chanteurs incroyablement bons pour que ce soit agréable à entendre. C’est tellement difficile, avec tellement d’aspects à prendre en compte en permanence… Ce n’est pas qu’un beau son. Souvent, ce n’est même pas le plus important, mais plutôt les forces psychologiques en jeu et la manière de transmettre le texte. »
La mer est agitée, nous nous demandons même si la tempête Floris a laissé des traces sur la côte ouest. Mais le soleil brille fort et la petite averse qui nous a surpris quand nous sommes montés à bord s’est arrêtée. C’est ça, l’été suédois : toujours changeant. La seule chose dont on peut être sûr, c’est de ne pas trop se fier à la météo. Pourtant, le petit ferry est plein de touristes. C’est une manière économique de découvrir les îles de Stockholm et d’aller à Djurgården, où se trouvent notamment le musée Abba, le parc d’attractions Gröna Lund et le musée Vasa.
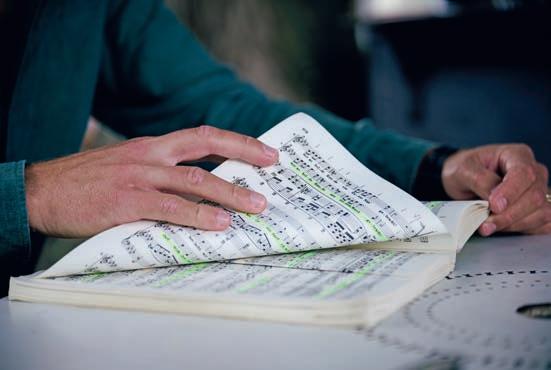

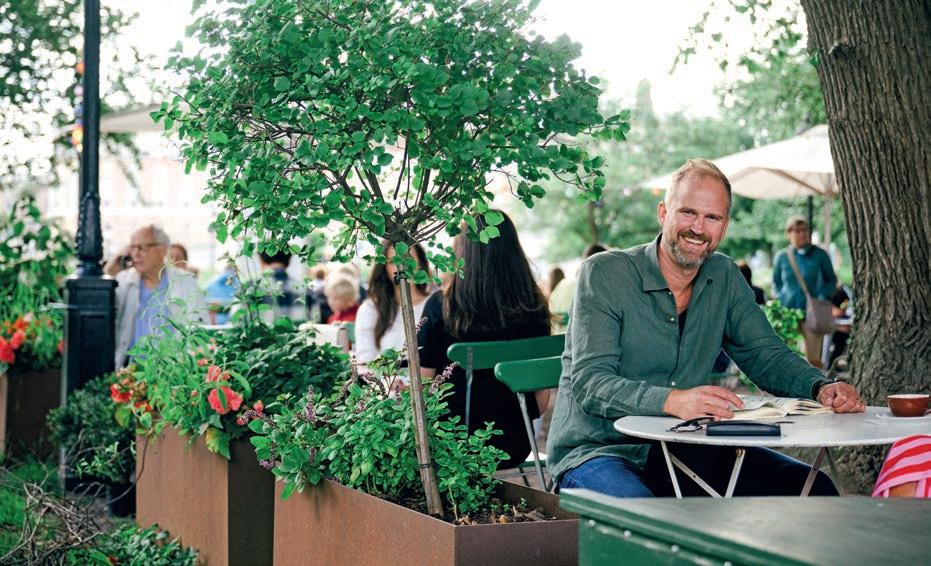
« J’ai toujours été fasciné par la musique de Wagner et sa capacité à raconter une histoire. »


Nous descendons au terminus Nybrokajen, tout près du quartier musical de la capitale avec des salles consacrées à tous les types de musique – classique, jazz, musiques du monde. De l’autre côté de la baie se trouve le Théâtre royal dramatique, qui est la Comédie-Française suédoise. Michael Thalheimer, qui met en scène Tannhäuser au Grand Théâtre de Genève, a signé plusieurs productions ici, la dernière étant La Cerisaie d’Anton Tchekhov. On se souvient qu’il a aussi conçu la production qui a marqué les débuts de Daniel Johansson dans le rôle de Parsifal au Grand Théâtre, il y a deux ans.
« Il comprend le drame, les impulsions humaines et la psychologie, et que ça ne doit pas forcément être beau. Il y a aussi une beauté là-dedans. Je ne peux pas parler à sa place, mais le fait qu’il y ait cet aspect profondément humain même dans la laideur, et que cela puisse faire partie de toute la palette d’un individu – tout doit être représenté. »
L’Opéra royal de Stockholm, inauguré en 1898, où Daniel Johansson a beaucoup chanté. Le bâtiment va connaître une importante restauration, qui a commencé par la façade. Il fermera en 2027 et les spectacles déménageront pour plusieurs années au Gasometer, un ancien réservoir à gaz transformé en salle de spectacles.
Entre le débarcadère et l’Opéra royal, Daniel Johansson fait une pause dans le parc Kungsträdgarden, où les habitants de la capitale profitent du dernier soleil d’été avant que la Suède s’enfonce dans les saisons sombres.
Nous marchons maintenant vers l’autre scène nationale, l’Opéra Royal, qui se trouve à quelques centaines de mètres du débarcadère. Nous traversons le parc Berzelius à Nybroplan où se dresse un monument à l’inventeur John Ericsson. Le verdoyant Kungsträdgården est plein de vie, de la musique forte vient des terrasses, les gens profitent du dernier soleil d’été avant que la Suède ne s’enfonce dans les saisons sombres. Un peu plus loin, en face de l’entrée de l’Opéra Royal et juste devant l’église Saint-Jacques, se trouve un buste de Jussi Björling. L’Opéra Royal, inauguré en 1898, est actuellement en rénovation. Les travaux ont commencé par la façade, mais au début de 2027, le bâtiment fermera et les activités artistiques déménageront pour cinq ans au Gasometer, un gigantesque réservoir à gaz des années 1900 situé dans un autre quartier industriel en pleine reconversion.
Mais avant tout cela, Daniel Johansson chantera à l’Opéra royal Calaf dans Turandot de Puccini.
« C’est un peu comme revenir à la maison ! Je n’ai jamais été enrôlé de manière fixe ici, mais j’ai toujours ma loge, » rit-il. Il raconte qu’il a beaucoup chanté à Stockholm au début de sa carrière, ainsi qu’au nouvel Opéra d’Oslo. Et il garde un attachement particulier pour l’Opéra Royal. « Birgitta Svendén, qui a été une sorte de mentor pour moi, était ma directrice à l’École d’opéra, et elle est devenue ensuite directrice de l’opéra ici. » Nous quittons l’opéra pour rencontrer la mezzo-soprano et collègue de Daniel Johansson, Miriam Treichl, qui arrête son vélo pour discuter un peu. Elle a chanté le rôle-titre dans la dernière production de Carmen, où Daniel était son Don José. Nous faisons un dernier arrêt à une terrasse à Kungsträdgården. C’est le dernier jour avant son départ pour Genève où Daniel va commencer les répétitions de Tannhäuser pendant quelques semaines. Internet offre des possibilités inédites de réduire la distance avec sa famille grâce à la visioconférence – et au jeu vidéo Roblox ! En même temps, on sent que son humeur change quand on lui rappelle qu’il doit quitter ses enfants. « C’est en fait ce que je déteste le plus dans tout ça, » dit-il. Nous nous quittons alors pour qu’il puisse passer quelques dernières heures en famille avant de s’envoler pour Genève et Wagner.
Au Grand Théâtre de Genève Tannhäuser du 21 septembre au 4 octobre 2025 www.gtg.ch/tannhauser
La styliste néerlandaise Iris van Herpen signe les costumes de Pelléas et Mélisande de Debussy. Chercheuse et créatrice de nouveaux matériaux, elle est connue pour ses tenues sculpturales, qu’ont porté Björk, Lady Gaga ou Beyoncé. Iris van Herpen collabore avec des créateurs de toutes disciplines.



dans les
dessinées



Deux images du film Biomimicry réalisé en 2020 avec le Dutch National Ballet, qui met en scène la danseuse JingJing Mao dans une chorégraphie fluide où la mode et la biomimétique se fondent, dans des tenues dessinées par Iris van Herpen.
Une des salles de l’exposition que le Musée des Arts décoratifs de Paris a consacrée à Iris van Herpen en 2023/24. On y découvrait une centaine de pièces de haute couture accompagnées d’œuvres d’art contemporain, de design et d’éléments issus des sciences naturelles. © Christophe Dellières / Musée des Arts Décoratifs

Au Grand Théâtre de Genève Pelléas & Mélisande du 26 octobre au 4 novembre 2025
www.gtg.ch/pelleas-melisande rdv.

Neuf danseurs de la compagnie du Grand Théâtre se sont produits pour la première fois au Pavillon de la danse de Genève. Une collaboration avec la chorégraphe romande Yasmine Hugonnet qui a ouvert le festival de La Bâtie.
Par Alexandre Demidoff
Tout le monde n’a pas le privilège de Yasmine Hugonnet : avoir un petit génie qui la guide dans ses quêtes, loquace mais en sourdine. La chorégraphe romande, qui a eu en 2019 les honneurs du Festival d’Automne à Paris, a ce privilège : elle commerce avec un démon qui personnifie la ventriloquie. L’artiste a ce don dont elle fait merveille : elle parle du ventre sans desserrer les lèvres. De cette sorcellerie, elle a fait des pièces raffinées qui respirent le mystère et fascinent comme Chro-no-lo-gi-cal au Théâtre de Vidy en 2018 et Les Porte-Voix en 2022 au même endroit ainsi qu’au Théâtre Saint-Gervais à Genève.
Les danseurs de la troupe du Grand Théâtre en répétition pour 1000&1BPM _ Odyssée, créée au Pavillon ADC © Anne-Laure Lechat / 1000&1 BPM _ Odyssée
Dans ce dernier, quatre interprètes sortaient d’une cavité blanche, oreille géante peut-être, appelés à la lumière par une légende. Dans la bouche de ces éberlués, l’histoire d’une femme qui commerce avec les morts. Dans leur bouche aussi, l’esprit d’un python qu’on appellera plus tard pythie. Des possédés au fond. À un moment, l’une posait une main sur la nuque d’une camarade et en libérait la voix. Yasmine Hugonnet, 45 ans, imprime ainsi sa signature depuis 2014 et un Récital des postures qui la révélait au Théâtre Sévelin 36 à Lausanne. Seule en scène, elle déployait une virtuosité clinique, anatomie d’un corps qui échappe aux cadres et se rit des normes. Nouvel échelon : fin août, elle ouvrait La Bâtie-Festival de Genève avec 1000&1BPM _ Odyssée, créée au Pavillon ADC avec neuf danseurs et danseuses du Ballet du Grand Théâtre, une première pour elle. Le principe de cette collaboration rare ? L’écoute de ce qui pulse chez chacun. Une manière d’inventer son chœur, pas à pas, sans renoncer à son âme. Car tel est le talent de Yasmine Hugonnet : offrir à chacun de ses interprètes un écrin où déployer son individualité. Le compositeur Michael Nick a créé la texture musicale de cette mosaïque charnelle. D’une polyphonie de gestes est née une union sacrée. Cette pièce était une matrice. Yasmine Hugonnet la prolongera au mois de janvier au Théâtre de Vidy. Avec les danseurs de sa compagnie, Arts mouvementés, elle signera Our Time. Trois interprètes tireront les fils de l’automne. Au seuil, on devrait entendre un battement – de cils, d’horloge ou de métronome. Une pulsation élémentaire comme dans 1000&1BPM _ Odyssée. Le plaisir alors sera de poursuivre cette rythmique du berceau, d’en imprimer l’écho et le sortilège cardiaque dans les corps. Yasmine Hugonnet allie ainsi un geste à la fois originel et intime. Ses histoires de cœur ne ressemblent à aucune autre.
Cult. chaque jeudi à 20h

vibrez avec l’application léman bleu !


Directeur musical du Hallé Orchestra, à Manchester, pendant 24 ans, Sir Mark Elder a quitté sa formation pour la direction musicale du Palau de la Musica de Valencia. Il a également été directeur musical de l’English National Opera de 1979 à 1993, et a mené des collaborations intensives avec le London Philharmonic Orchestra, The Orchestra of the Age of Enlightenment ainsi qu’avec le Chicago Symphony Orchestra. Il a en outre dirigé Opera Rara, label spécialisé dans l’enregistrement d’opéras oubliés. Invité régulier des plus grandes maisons d’opéra et des meilleurs orchestres du monde, Mark Elder a été nommé Commandeur de l’Ordre de l’Empire britannique en 1989 et fait Chevalier en 2008.

Avec le chef britannique Mark Elder, il faut revoir tout ce qu’on croyait savoir sur le compositeur, dont il dirigera Tannhäuser en ouverture de saison.
Pour lui, ses opéras doivent être joués comme de la musique de chambre et les chanteurs dire le texte autant qu’ils le chantent.
Par Jean-Jacques Roth

« Une seule répétition peut suffire à modifier la sonorité d’un orchestre. »
© Alex Burns / The Hallé
Énorme carrière, bien plus imposante que sa notoriété. Mark Elder fait partie de ces musiciens qui ont tracé une route « loin de sentiers obliques », comme l’aurait écrit Victor Hugo. Un pur du métier. Il a tout dirigé, tout exploré, du baroque aux opéras italiens oubliés du début du XIXe siècle ; du grand romantisme au contemporain. Il a été directeur artistique pendant 24 ans de l’Orchestre Hallé de Manchester, magnifique formation peu connue en dehors de Grande-Bretagne car l’argent manquait pour les tournées internationales. Il en reste le directeur honoraire depuis qu’il a quitté son poste l’été dernier, pour prendre la direction artistique du Palau de la Musica de Valencia. Il y dirigera chaque saison trois opéras et trois concerts. Mais en dehors de ces mandats, il a promené sa baguette à la tête de tous les orchestres et de tous les opéras qui comptent. Et c’est en homme d’une courtoisie très british, alors que tant d’honneurs auraient pu l’abîmer, qu’il nous donne sa recette pour bien diriger Wagner.
Vous êtes de retour au Grand Théâtre après 31 ans d’absence, vous aviez alors dirigé La Bohème de Puccini. Et vous voici dans Wagner, pour Tannhäuser. Vous avez dirigé tant de répertoires différents qu’on se demande quelle est votre musique préférée. J’ai un enthousiasme très large. Je suis surtout intéressé par le style. Le respect du style, c’est ce qui fait qu’un ouvrage sonne bien. Mais j’ai deux piliers dans ma vie musicale, deux compositeurs qui sont nés la même année, Wagner et Verdi. J’ai dirigé Verdi plus qu’aucun autre. Normal, il est si important. Mais l’un des accomplissements dont je suis le plus heureux, c’est d’avoir monté et dirigé L’Anneau du Nibelung de Wagner à Manchester. D’une manière générale, mon idéal c’est l’équilibre. En musique et dans ma vie.
Quelle place occupe Tannhäuser dans l’œuvre de Wagner, que dit-il de particulier du compositeur ?
C’était une légende très importante pour lui. D’ailleurs, Wagner n’a jamais renoncé à le réécrire. Il en avait le projet encore quelques mois avant sa mort – on ne sait hélas pas ce qu’il avait en tête. Je pense qu’il a senti que lors de la composition de la première version, en 1845, il n’avait pas tous les moyens de son projet. Il cherchait à écrire une musique qui surprendrait le monde, le « Gesamtkunstwerk », l’œuvre d’art totale alliant texte, musique, chant et scénographie. Ce qu’il achèvera plus tard. Avec Tannhäuser, il est encore tributaire de l’opéra romantique allemand. D’une certaine manière, Tannhäuser représente le climax d’un certain type de musique allemande.
C’est un opéra difficile à diriger ?
La plus grosse difficulté, comme toujours chez Wagner, c’est l’architecture. Les actes sont très longs, sans doute un peu trop d’ailleurs. Vous devez à tout moment savoir où vous êtes dans le voyage. Cette préoccupation est dans mon esprit en permanence et c’est une difficulté commune à tout le grand répertoire romantique, lyrique comme symphonique. Par ailleurs, Tannhäuser n’est pas facile techniquement pour les instrumentistes. Le début du deuxième acte est une des choses les plus rapides que Wagner ait écrites.
Mais ce qui est vraiment important, c’est l’équilibre sonore. L’orchestre ne doit pas jouer trop fort, sauf bien sûr lorsque Wagner l’exige expressément. Les chanteurs doivent surtout rester toujours parfaitement audibles, or le son d’un orchestre a beaucoup changé depuis le milieu du XIXe siècle. Il s’agit donc de s’ajuster en permanence. Certains instruments ont évolué plus que d’autres, un fortissimo de l’un ne correspond plus au fortissimo de l’autre tel que Wagner l’entendait. Les bons orchestres savent cela. Le test de qualité d’un orchestre, c’est sa vitesse d’adaptation à ces paramètres, qui changent d’un répertoire et d’une époque à l’autre. Et la capacité à comprendre ce que je rêve d’entendre.


Vous avez dit un jour qu’il fallait jouer l’opéra Parsifal comme de la musique de chambre…
La sonorité parfaite naît lorsque chaque membre de l’orchestre écoute les autres. Chacun doit être uni aux autres. C’est ça que je travaille durant les répétitions. En particulier dans l’opéra allemand : ce sentiment que chaque instrumentiste écoute soigneusement les chanteurs, ce que les autres instruments jouent, et sait où va le discours musical. Ces éléments sont déterminants pour imprimer une sensation de flux. Quand tout le monde s’écoute, la sonorité devient merveilleuse.
La manière de chanter Wagner a-t-elle changé depuis 40 ans ?
Oui, quelque chose s’est perdu. Trop peu de chanteurs ont un instrument assez flexible pour répondre aux exigences de Wagner. La difficulté de tenir jusqu’au bout des rôles très lourds les empêche parfois de prendre garde aux beautés du chemin. Quand j’ai fait Tannhäuser au Metropolitan Opera de New York, en 2004, c’était avec Peter Seiffert, qui est mort récemment. Il était incroyable. Il modulait sa voix comme s’il chantait du lied, avec une telle subtilité… Il disait le texte autant qu’il le chantait. C’est très important car chez Wagner, qui écrivait lui-même ses livrets, tout est conduit par le flux poétique : le timing comme le flux de la musique. Ça détermine le temps que vous devez prendre ou ne pas prendre. Quand les chanteurs maîtrisent cet art, on touche l’idéal
wagnérien, comme a pu le représenter une Waltraud Meier, qui parle à travers la musique. J’aimerais que plus de chanteurs comprennent cela. Chanter Wagner ce n’est pas seulement faire un grand beau son glorieux. Mais utiliser sa voix pour exprimer toute la variété et les contrastes du texte, ses couleurs et ses textures.
Qu’attendez-vous d’un orchestre dont vous n’êtes pas familier ? Vous tentez d’aller dans le sens de sa tradition sonore ou de l’amener à la sonorité que vous désirez ?

J’essaie de produire le son que j’ai dans ma tête, mais je suis attentif au style de l’orchestre. Lorsque j’ai été appelé à diriger Tannhäuser à l’Opéra de Paris, je n’obtenais pas le son que je voulais au début. Mais avec le travail, quelque chose s’est peu à peu produit et développé jusqu’aux représentations. C’était un bel exemple de co-direction.
Est-il est possible de changer la sonorité d’un orchestre en quelques répétitions ?
Oh oui, clairement.
Avec ce que vous dites ou avec ce que vous montrez ?
Par le geste. Une seule répétition peut suffire à modifier la sonorité d’un orchestre. Parce que les gestes et le corps du chef ont une importance décisive. Le poids qu’il y a ou non dans un geste définit le temps et l’espace que vous donnez à la musique...
Le temps et l’espace donné à la musique, c’est justement une de vos signatures. Oui. Je ne supporte pas la musique qui court, court, et pfuit c’est fini. Il faut avoir quelque chose à dire et être convaincu par ce que l’on a à dire. Être très clair dans sa tête, toujours savoir où va la musique. Une musique qui ne respire pas est une musique inerte. Faire respirer la musique, c’est essentiel.

Qu’avez-vous retenu de votre expérience avec l’Orchestra of the Age of Enlightment (on l’appelle en français l’Orchestre du Siècle des Lumières), qui joue sur instruments d’époque ?
J’ai énormément appris avec eux. Nous avons commencé lorsqu’ils démarraient, dans les années 80, et ça a été une période passionnante. Une grande source d’inspiration sur la notion d’équilibre orchestral. Nous avons joué beaucoup de Verdi et de Donizetti. C’est une tout autre expérience qu’avec un orchestre moderne. Le choix des instruments, la date de leur facture sont déterminants. Il n’y a pas qu’une manière de faire sonner la musique du XIXe siècle. Nous avons fait
Euryanthe de Weber au festival de Glyndebourne. Un opéra révéré par Wagner. C’était vivant, jamais gras. C’est ce que je cherche avec les orchestres modernes. Le tutti dans Tannhäuser doit sonner comme si c’était écrit par Weber. Si c’est trop dense et sombre, on rate quelque chose.
Comment êtes-vous resté si longtemps avec l’orchestre Hallé à Manchester ?
24 ans, c’est une longévité rare désormais.
John Barbirolli avait pour défi de construire l’orchestre après la guerre. Et il est arrivé à maturité avec l’apparition du disque 33 tours. Mais l’orchestre était en mauvaise position lorsque je l’ai repris.
Il n’y avait pas d’horizon, les musiciens étaient bons
Mark Elder a dirigé l’Orchestre Hallé de Manchester pendant 24 ans. © Alex Burns / The Hallé
« Comment rester si longtemps ? Comment n’aurais-je pas pu ?
Je ne suis pas chasseur de fauves. J’aime faire de la musique dans une bonne atmosphère et me battre pour faire la meilleure musique possible. »
mais angoissés. Ils ne savaient pas s’ils auraient du travail la semaine suivante. J’ai toujours voulu avoir mon orchestre dans mon pays pour mon public. Et j’ai été très heureux d’avoir ce privilège. On a travaillé dans une très grande proximité. C’était dur, mais nous avons partagé tant de choses ensemble… Comment rester si longtemps ?
Comment n’aurais-je pas pu ? Je ne suis pas chasseur de fauves. J’aime faire de la musique dans une bonne atmosphère et me battre pour faire la meilleure musique possible. Nous avons compté les pennies, ce qui n’est pas si mal. Comme cela, nous avons dû survivre et prendre les bonnes décisions. Avoir trop d’argent, ce n’est pas toujours bon. Et puis, nous avons eu la chance d’avoir des publics passionnés. Il faut assister à un concert au Bridgewater Hall de Manchester ou au Concert Hall de Nottingham pour mesurer la ferveur des publics de l’Angleterre du Nord-Ouest !
Au Grand Théâtre de Genève Tannhäuser du 21 septembre au 4 octobre 2025 www.gtg.ch/tannhauser rdv.

L’amour est rarement heureux à l’opéra. Les protagonistes s’y perdent, ou l’amour les perd. Mais il y a aussi les zones grises de l’amour qui erre, qui flotte, et où le sens s’égare. L’art peut alors rendre lisible ce qui, dans nos vies, est souvent chaotique et sans contour.


Comme la fiction, l’opéra rend lisible ce qui, dans la vie réelle, est souvent chaotique et sans contour. Et la psychanalyse nous aide à comprendre que les amours qui nous déchirent ne sont pas de simples erreurs de parcours. Ils disent quelque chose d’essentiel : le désir humain est complexe, souvent paradoxal, toujours révélateur.
Par Pascal Neveu
Pascal Neveu est psychanalyste, directeur de l’Institut français de psychanalyse active (IFPA), enseignant au sein de l’Enseignement militaire supérieur scientifique et technique à l’École militaire, chroniqueur médias, conférencier et auteur de plusieurs ouvrages, dont Changer ? Moi jamais ! et Mentir pour mieux vivre ensemble (l’un et l’autre aux éditions de l’Archipel).
Il y a des amours qui grandissent et d’autres qui dévorent. Des histoires qui réchauffent l’âme, et celles qui l’ébranlent sans relâche. On parle souvent d’amour « toxique », mais derrière ce mot-valise se cache une mécanique beaucoup plus subtile, complexe, douloureuse parfois. Loin d’être un simple hasard affectif ou une mauvaise rencontre, l’amour dysfonctionnel obéit souvent à une logique interne, inconsciente, dont la psychanalyse tente précisément de décrypter le mouvement… entre le réel et la fiction. Freud, dans « Au-delà du principe de plaisir », évoque la compulsion de répétition : cette tendance du sujet à revivre encore et encore des situations douloureuses, comme si la souffrance elle-même contenait une promesse de transformation. L’amour, dans sa version la plus intense, peut alors devenir un champ de bataille où se rejouent les conflits les plus archaïques. C’est dans cet espace entre désir, fantasme et réparation que l’amour dysfonctionnel trouve ses racines.
Le transfert amoureux : rejouer pour (ne pas) réparer ?
Le transfert, mécanisme central du processus analytique, consiste en une projection d’affects anciens sur une figure présente. En amour, ce mécanisme se déploie à pleine puissance : le partenaire devient le théâtre vivant de nos conflits passés, réactivant des blessures infantiles encore ouvertes.
Rêve causé par le vol d’une abeille autour d’une grenade, une seconde avant l’éveil, par Salvador Dali (1944).
© IMAGO / Museo Nacional Thyssen-Bornemisza/ 2025, ProLitteris, Zurich

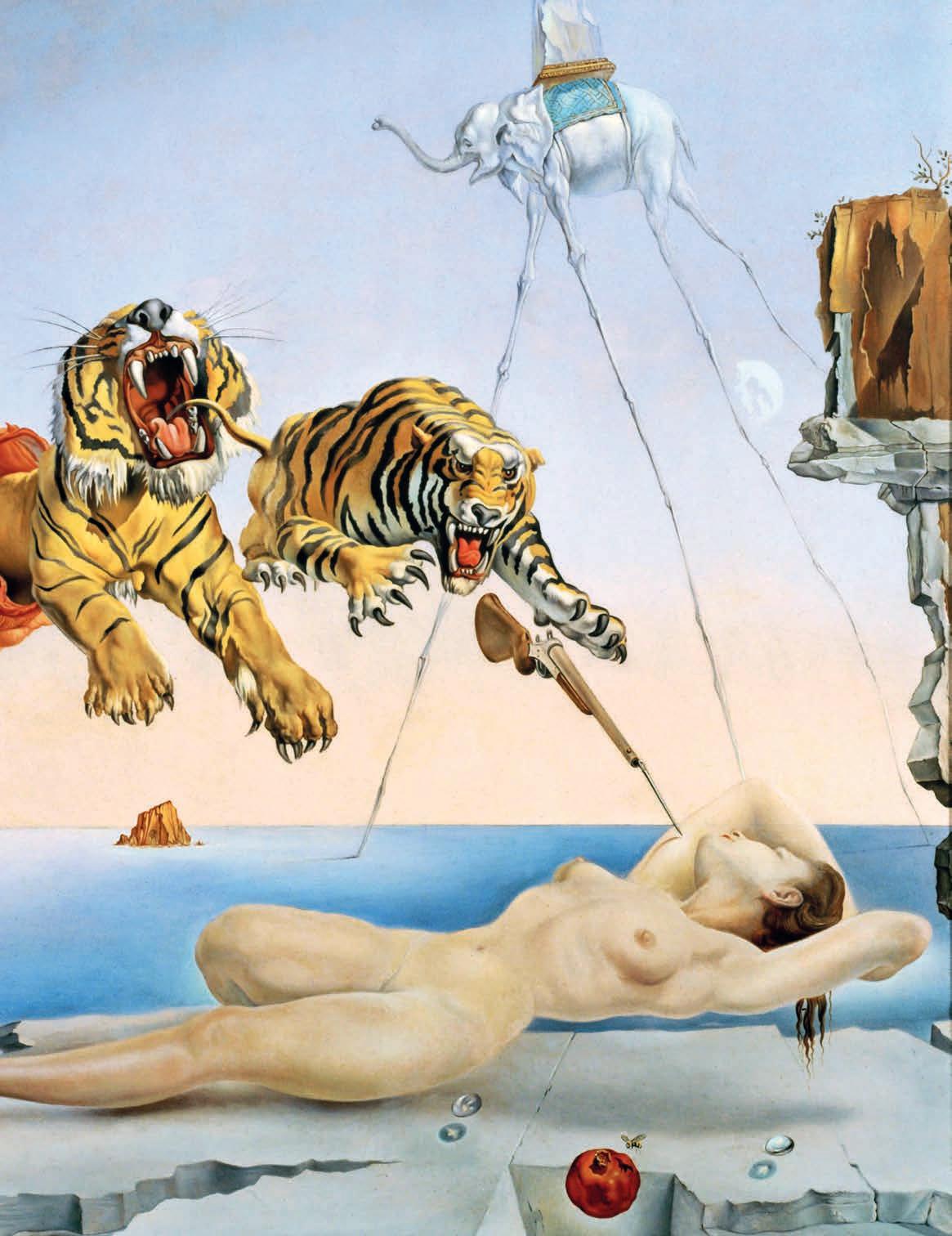
Nous pouvons choisir systématiquement un amour indisponible émotionnellement, souvent marié, souvent absent. En analyse, on découvre qu’on rejoue sans le savoir son lien au parent lointain, et toujours préoccupé. Chaque relation devient alors tentative de capter une attention refusée. Mais l’échec se répète, car la scène intérieure ne change pas.
Par exemple : Didon aime Énée, un homme qui doit partir. Elle meurt d’amour, abandonnée. Tatiana aime Onéguine, froid et distant. Il la rejette, elle évolue, et le rejette à son tour.
Tout comme dans les romans : Emma Bovary cherche l’amour parfait chez des hommes qui ne comblent jamais son vide intérieur. Marcel (chez Proust) aime Albertine, mais ce n’est pas elle qu’il aime : c’est ce qu’elle représente.
Ces « figures » rejouent un schéma inconscient. Elles cherchent l’amour… mais choisissent des êtres absents, inaccessibles ou émotionnellement indisponibles, en écho à une faille ancienne. Des personnages comme Didon ou Emma Bovary projettent sur l’autre un idéal inatteignable. Ils aiment moins la personne que ce qu’elle représente : un fantasme ou une réponse à un vide. Le désir se fixe sur des êtres absents, fuyants ou émotionnellement indisponibles. C’est souvent une répétition inconsciente liée à une blessure ancienne.

L’amour devient alors quête, mais aussi miroir d’un manque intérieur.
Le transfert amoureux rend donc visible ce qui était invisible : l’autre n’est pas simplement choisi : il est activé. Il reçoit les affects, les attentes, les colères et les espoirs que le sujet n’a jamais pu adresser à ses figures primaires.
Fantasme et objet perdu : aimer l’absent
Lacan introduit dans son enseignement le concept d’objet a, cet élément insaisissable qui cause le désir sans jamais le satisfaire. Dans l’amour dysfonctionnel, le partenaire est souvent investi comme cet objet fantasmatique : censé combler un manque, guérir une blessure, répondre à une absence fondatrice. Mais ce manque est structurel : il ne peut être comblé, seulement déplacé.
L’amour devient alors une quête impossible, un parcours sans fin vers un objet toujours fuyant. On aime ce qu’on projette, on attend ce qui ne viendra pas, on confond le réel avec le scénario intérieur.
Ce fonctionnement peut être doux, exaltant même, dans ses débuts. Mais il devient tragique lorsque la confrontation avec la réalité laisse place à l’effondrement fantasmatique.
C’est là que surgissent les passions tristes : jalousie, dépendance, désespoir. On croit aimer l’autre, mais on se bat avec une absence intérieure, déguisée en présence extérieure.
Narcissisme et fusion : la confusion des peaux
Freud, dans « Pour introduire le narcissisme », décrit deux types de choix d’objet : le choix par appui (lié à des figures parentales) et le choix narcissique (lié à l’image de soi). Dans les amours fusionnels, ces deux mécanismes s’entrelacent. Le partenaire est choisi pour combler une faille narcissique, et rapidement fusionné dans une identité confuse.
La relation devient un miroir animé, une zone floue où chacun se cherche dans le regard de l’autre. Mais la fusion empêche la différenciation : dès que le partenaire affirme son altérité, l’unité s’effondre, et avec elle le sentiment de sécurité. On tombe alors dans des dynamiques de contrôle, de jalousie, voire de panique affective. Que ce soit en opéra ou en roman, on retrouve souvent des personnages qui aiment non pas une personne en chair et en os, mais une projection, un idéal impossible (ce qu’on appelle parfois un « objet perdu » ou un « objet a »). Leur désir se fixe sur un être qui incarne finalement un manque intérieur. Car chacun peut ressentir une dépersonnalisation immédiate, comme si son identité s’effaçait dès qu’elle n’était pas là. Le lien fusionnel se révèle alors être un lien de survie narcissique, incapable d’intégrer la réalité de l’autre comme sujet autonome.

La pulsion de mort : souffrir pour exister ?
Freud introduit la pulsion de mort pour expliquer certaines conduites qui vont à l’encontre du principe de plaisir. En amour, cette pulsion se manifeste dans les scénarios autodestructeurs : partenaires violents, ruptures répétées, sacrifices extrêmes. Il ne s’agit pas de masochisme pur, mais d’une tentative de mise à l’épreuve de soi-même, comme si la souffrance était le seul moyen d’être touché.
Winnicott, dans « Jeu et réalité », évoque ces patients qui ont besoin de traverser l’épreuve pour éprouver leur propre existence. L’amour devient terrain d’intensité : on ne cherche pas forcément le bonheur, mais une forme de ressenti qui confirme qu’on est vivant.
Dans certaines cures, on observe des patients qui ne peuvent tomber amoureux que dans des contextes de danger : tromperie, transgression, violence. Ces éléments ne sont pas les causes de l’amour, mais ses garants inconscients, comme si la menace elle-même activait le lien.

Par exemple Otello aime Desdémone d’un amour absolu, mais dès qu’un doute s’installe sur sa fidélité, il sombre dans une panique destructrice. Son amour est fusionnel, possessif. Il ne tolère pas l’altérité.
La moindre autonomie de l’autre (réelle ou fantasmée) menace son identité.
Dans l’opéra de Benjamin Britten, Peter Grimes, isolé socialement, se réfugie dans une relation où l’autre est son repère. L’échec de ce lien déclenche une crise existentielle intense.
Mais quand on lit Heathcliff (dans Les Hauts de Hurlevent d’Emily Brontë) qui clame son amour pour Catherine de manière obsessionnelle : elle est pour lui une part de lui-même.
Lorsqu’elle le quitte, il vit cela comme une mutilation. Il rejette le monde, rongé par la perte de cette fusion. Werther dans Les Souffrances du jeune Werther (Goethe) tombe amoureux d’une femme fiancée à un autre. Ne pouvant posséder son objet d’amour, il se dissout dans le chagrin, jusqu’au suicide. Il ne voit pas l’autre comme une personne autonome, mais comme le centre de sa propre existence.
Otello et Werther vivent une relation où l’autre est vital, non pas comme être libre, mais comme garant de son unité psychique. Dès que l’autre s’éloigne, sa structure intérieure vacille. Ce sont des amours fusionnels qui ne supportent pas la séparation, car l’autre incarne plus qu’un partenaire : il est le pilier du moi.
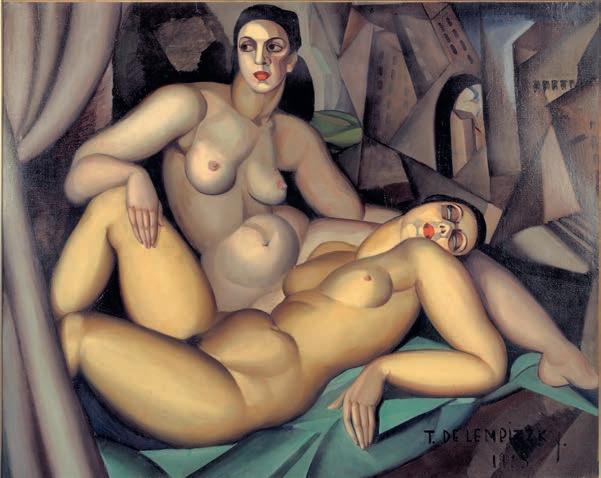
Le couple comme espace groupal
Le couple, loin d’être une addition d’individus, est aussi un champ de transfert croisé. Deux inconscients s’y rencontrent, parfois s’affrontent, souvent s’interpellent sans le savoir. Annie de Butler décrit le couple comme un espace groupal : un lieu où les scénarios internes de chacun se rejouent, s’entrelacent, se perturbent.
Dans les relations dysfonctionnelles, le lien est souvent pris dans une scène de théâtre inconsciente, où les rôles sont distribués sans discussion. L’un devient le bourreau, l’autre la victime ; l’un la mère réparatrice, l’autre l’enfant insatiable. Il n’y a pas de méchanceté… juste des places occupées sans conscience. Lacan dira : « Il n’y a pas de rapport sexuel », au sens où le lien entre les sujets n’est jamais naturel, mais toujours construit, symbolisé, imaginé. Le couple devient alors une tentative de créer un pont entre des mondes intérieurs, souvent incompatibles.
Dans la fiction, les amours dysfonctionnelles sont souvent hyperboliques, presque mythologiques (Tristan et Iseut, Don Giovanni, Tosca…).
Elles répondent à une logique dramaturgique : amour impossible, transgression, perte, sublimation. Mais elles ont cette cohérence symbolique que la réalité n’offre pas. Elles sont compréhensibles, esthétiques, parfois même cathartiques. Dans la réalité, les dynamiques dysfonctionnelles sont souvent silencieuses, banales, insidieuses. Elles ne suivent pas toujours une logique narrative : elles s’étirent, se fragmentent, se répètent sans fin. Et surtout, elles sont vécues, avec tout ce que cela suppose de confusion, de douleur, d’impasses concrètes.
Perspective ou Les deux amies, par Tamara de Lempicka (1925).
© IMAGO / Collection privée / 2025, ProLitteris, Zurich
L’opéra comme miroir de l’inconscient amoureux ?
Certaines œuvres lyriques donnent corps à ces conflits avec une acuité saisissante. Tannhäuser, de Wagner, en est l’une des plus emblématiques. Le héros est pris entre Vénus (pulsion charnelle, plaisir illimité) et Elisabeth (idéal du moi, amour rédempteur). Incapable de choisir, il oscille sans fin, pris dans une compulsion tragique. Le Venusberg incarne l’excès, l’ivresse, la perte de soi dans la jouissance. Rome, à l’opposé, symbolise le repentir, la sublimation, la souffrance purificatrice. Mais aucun des deux mondes ne le sauve vraiment. Ce tiraillement entre Éros et Thanatos est la traduction musicale de la fracture interne du désir. Wagner y expose la tension entre le besoin de transgresser et celui de se racheter, ce qui crée une tension constitutive de nombreux amours dysfonctionnels.
Dans Pelléas et Mélisande, Debussy peint un théâtre du flou affectif. Mélisande est une énigme : douce, fuyante, opaque. Elle incarne l’objet a dans sa forme la plus silencieuse. Golaud veut comprendre, posséder, nommer… mais échoue, se perd, s’effondre. Pelléas hésite, approche, s’éloigne. Rien ne se dit clairement, tout se ressent dans les silences, les regards.
Yniold, l’enfant, témoin de ces tensions, voit, sans comprendre. Il est le regard traumatisé sur le désir adulte : un regard qui capture l’indicible, mais ne peut le traduire.
Les lithographies de Khnopff ou Schwabe illustrent parfaitement cette esthétique du désir empêché : voiles, brumes, gestes suspendus, lumière trouble. L’amour y est une scène d’inconscient : floue, tragique, magnifiquement humaine.
Les amours dysfonctionnelles ne sont pas de simples accidents de parcours. Ce sont des tentatives (parfois maladroites, parfois violentes) d’accéder à une part de soi que le sujet ne parvient pas à nommer autrement. Elles révèlent, exposent, rejouent des scènes anciennes enfouies dans la mémoire affective et corporelle. Ce sont des appels, parfois désespérés, à une reconnaissance impossible, à une réparation imaginaire.
L’Étreinte amoureuse (Liebesakt), dessin d’Egon Schiele (1915).
© IMAGO/ 2025, ProLitteris, Zurich


Ces amours qui nous épuisent, qui nous hantent, qui nous déchirent, ne sont pas de simples erreurs de parcours. Elles disent quelque chose d’essentiel : le désir humain est complexe, souvent paradoxal, toujours révélateur.
La psychanalyse ne prétend pas guérir l’amour. Elle l’écoute. Elle en déchiffre les mécanismes, les replis, les impasses. Elle montre que derrière chaque souffrance relationnelle peut se cacher une logique : celle du désir, celle du manque, celle du fantasme. Et elle ouvre une voie : celle d’une compréhension qui permet, un jour peut-être, un lien plus libre, plus habité, plus vrai.
Je dirais que les amours de fiction (et notamment lyriques) rendent lisible ce qui, dans la vie réelle, est souvent chaotique et sans contours. Dans l’opéra ou le roman, les passions sont stylisées, dramatisées, rendues audibles : les conflits internes deviennent extérieurs, les pulsions prennent corps, les silences sont traduits en musique ou en métaphores.
Ces amours qui nous épuisent, qui nous hantent, qui nous déchirent, ne sont pas de simples erreurs de parcours. Elles disent quelque chose d’essentiel : le désir humain est complexe, souvent paradoxal, toujours révélateur. La psychanalyse permet d’en lire les méandres, non pour les condamner, mais pour leur offrir un sens, parfois douloureux, toujours éclairant.
Comprendre, c’est déjà choisir. Et choisir, c’est peut-être commencer à aimer autrement.
Au Grand Théâtre de Genève Tannhäuser du 21 septembre au 4 octobre 2025 www.gtg.ch/tannhauser
Au Grand Théâtre de Genève Pelléas & Mélisande du 26 octobre au 4 novembre 2025 www.gtg.ch/pelleas-melisande rdv.
Entre les couples heureux et les couples tragiques, il y a à l’opéra les couples errants, dysfonctionnels : sans tragédie du sentiment ni authentique bonheur. Mais qui révèlent les zones grises de l’amour, et nous touchent pour cela.
Par Jules Cavalié
Un amour heureux, accepté d’avance, admis par tous et sans obstacles, ne fait pas un bon livret d’opéra : les couples y sont donc mis à l’épreuve. Sur le versant comique, les amoureux déploient des trésors d’invention pour triompher des mesquineries et conclure un mariage d’amour a priori contraire aux intérêts matériels de leurs parents récalcitrants, ultime difficulté souvent aplanie par un héritage opportun – réminiscence ironique du deus ex machina. Sur le versant tragique, ils s’aiment aussi mais ne pourront pas faire couple : obstacle politique, religieux, ou ancestrale rivalité... se résolvent dans la mort, car tout est bon pour séparer les amoureux de manière définitive. Entre ces deux paradigmes on peut aussi suivre le destin de couples errants, sans tragédie du sentiment ni authentique bonheur, couples à la dérive, qui s’éteignent en dépit d’eux-mêmes et dont l’amour ne prend pas corps.
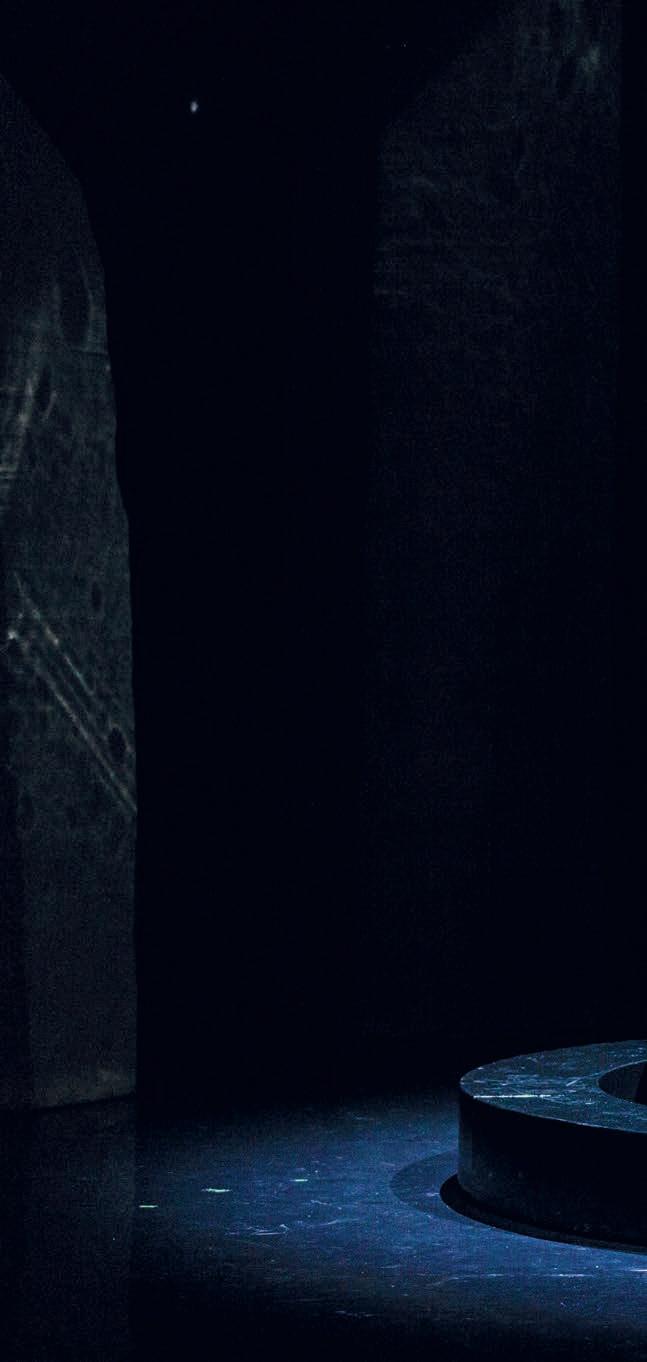
L’amoureux aveugle à l’autre
Repartons de L’Orfeo de Monteverdi (1607) où le couple Orphée-Eurydice apparaît à peine en scène. Très rapidement, le spectateur peut distinguer les failles béantes de ce couple pourtant promis au bonheur à l’acte I. Il apprend d’abord l’opinion de la communauté pastorale sur leur couple, dont le récit fait disparaître Eurydice, engloutie sous les larmes, la douleur et la patience d’Orphée alors qu’il la courtisait. Le nom de la jeune femme n’est mentionné que pour dire qu’elle fut hautaine. Puis Orphée chante son amour en mentant sciemment au public tout juste informé des précédents de cette histoire : dans un accès de fatuité il raconte un bonheur réciproque et immédiat « puisque ton doux émoi a répondu au mien ». Le futur marié nie la personnalité d’Eurydice et ses premiers sentiments. Enfin, elle prend la parole pour faire une déclaration troublante : « Je ne puis exprimer combien ma joie est grande, Orphée, de contempler ton bonheur, car mon cœur ne m’appartient plus mais est venu te rejoindre sous les auspices d’Amour. C’est donc lui que tu dois interroger si tu désires savoir combien je suis heureuse et combien je t’aime. »
À travers ce refus de déclarer simplement son amour, Eurydice saisit le mince espace de liberté pour exprimer implicitement l’impossibilité du couple. Elle ne prendra ensuite la parole que pour formuler d’ultimes adieux, et le spectateur n’en saura pas plus sur elle. À cet égard, Eurydice fait songer à Mélisande, dont la présence centrale au sein du drame lyrique Pelléas et Mélisande de Debussy (1902) se dérobe en permanence à ceux qui l’approchent. Même Pelléas ne sait pas répondre aux jeux de cette dernière – lorsqu’elle s’amuse avec l’anneau donné par Golaud –
Rédacteur en chef de la revue Avant-Scène Opéra, Jules Cavalié a étudié la musique et la musicologie à Londres (University of London) et Paris (CNSMDP, CRR 93). Ses recherches portent sur les circulations d’artistes à la Belle Époque, notamment les présences italiennes à Paris dans le cadre des créations parisiennes des opéras de Puccini.

Pelléas & Mélisande de Debussy, ici dans la mise en scène de Sidi Larbi
et Damien Jalet, telle qu’elle sera donnée au Grand Théâtre. Un opéra où le désir de la femme n’est jamais reconnu dans sa spécificité et toujours rapporté à celui de l’homme. © Magali Dougados

À côté des amours confus, il existe des amours inintelligibles à eux-mêmes.
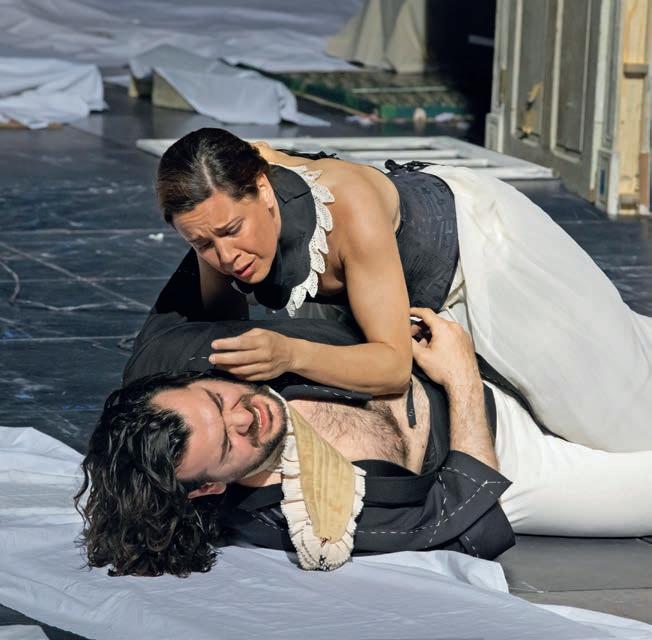
ni percevoir son inquiétude lorsqu’il cède à la sensualité de sa chevelure. Pelléas est certes plus attentif que son frère aîné, mais il peine aussi à reconnaître Mélisande comme sujet, tout comme Orphée ne laisse qu’une place infime à Eurydice. Pour autant, les deux femmes ne sont pas sans désir ; simplement celui-ci n’est jamais reconnu dans sa spécificité et toujours rapporté à celui de l’homme. Or il ne saurait y avoir de couple là où les aspirations individuelles sont niées. Quand l’amour inopérant entre Orphée et Eurydice est interrompu une première fois par la mort d’Eurydice, la quête d’Orphée peut reprendre. Cette fois-ci, il s’agit de l’arracher des bras de la mort et non plus à son indifférence. Paradoxalement, cette quête est moins difficile à accomplir car l’époux dispose désormais de droits sur son épouse, jusqu’au moment où, inquiet de ne pouvoir tout à fait saisir l’objet de sa quête, il tente d’attraper Eurydice du regard. Lors de cette deuxième perte, outre les ressorts déjà à l’œuvre dans la relation entre les deux personnages, c’est bien l’attitude d’Orphée comme héros en quête qui précipite la tragédie. Or, à sa suite, bien des amoureux seront entravés par une quête transitionnelle qui empêche la relation de se nouer en toute confiance. Dans La Dame de pique de Tchaïkosvki (1890), Hermann confond son amour du jeu et son amour pour Lisa. Obsédé par la perspective de faire fortune, on ne sait plus s’il a souhaité la richesse pour pouvoir aimer Lisa, ou s’il a aimé Lisa pour accéder à la Comtesse détentrice du secret des trois cartes toujours gagnantes. Une même confusion est à l’œuvre dans le cœur de Fritz, le personnage principal de l’opéra de Franz Schreker, Der ferne Klang (1912). Ce n’est qu’en expirant qu’il comprend que le son lointain qui l’attirait sans cesse vers de nouveaux horizons – à la manière du chant des sirènes – ne pouvait être entendu qu’auprès de son amoureuse Grete qu’il a délaissée dès la fin du premier acte au nom de cette quête. Là encore l’incompréhension règne : en refusant de voir que l’amour de Grete serait la source d’inspiration tant attendue, Fritz nie la possibilité même du couple et le rapport de réciprocité qui le fonde.

Dans Les Noces de Figaro de Mozart, la Comtesse oppose au désir de toute-puissance de son mari des contrepouvoirs plus puissants et plus intimes. Ici Lenneke Ruiten et Kartal Karagedik dans la mise en scène de Tom Goosens à l’Opéra de Flandres (2023). © Annemie Augustijns
Certaines quêtes transitionnelles se font au nom de pulsions bien moins idéalistes que celles de Fritz. Ainsi l’infidélité du Comte Almaviva, dans Les Noces de Figaro de Mozart (1788), manifeste un désir de toute-puissance, auquel son couple – qui exige respect et compromis – ne lui donne pas accès. En convoitant Susanne, il veut rétablir le droit de cuissage. D’ailleurs, pour récupérer son mari, la Comtesse ne cherche pas à la séduire, mais à neutraliser ce désir de toute-puissance en y opposant sans cesse des contrepouvoirs plus puissants et plus intimes, de l’organisation de la liesse populaire à l’acte I lors de la remise du vêtement blanc la mariée – symbole virginal –jusqu’à organiser le simulacre de sa propre infidélité.
Le monde ou le couple
À côté de ces amours confus, il existe des amours inintelligibles à eux-mêmes. Dans Wozzeck d’Alban Berg (1925), Wozzeck et Marie forment un étrange duo dysfonctionnel à la mesure du monde heurté qui les entoure. Ce couple réunit deux personnages qui ne savent pas exister individuellement : l’infidélité de Marie n’est pas un désir de toute-puissance, et Wozzeck est un homme sans quête. Par conséquent, ils sont indisponibles pour faire couple. Balloté entre les invectives du capitaine et les expérimentations du docteur, victime d’hallucinations, Wozzeck est incapable de se saisir et de manifester un libre arbitre réfléchi. De son côté Marie cède au Tambour-Major, mais tombe dans le remords ; depuis son intérieur elle regarde vers la rue ou dans un miroir pour s’éblouir des uniformes militaires et des bijoux offerts par son amant, dans une fuite vers un ailleurs dérisoire. L’un et l’autre sont incapables de se regarder en face, tout comme ils sont incapables d’accorder une attention tangible à leur fils, qui ne sera pas vraiment ému de la mort de sa mère. Personnalités absentes d’elles-mêmes, elles désertent le couple qui, laissé à l’abandon, devient une friche cabossée par la vie hagarde que mènent les personnages.

Au cœur des couples dysfonctionnels se noue une tragédie qui éloigne l’un de l’autre, sans pour autant défaire leurs liens.
La réciproque de ce couple maudit est peut-être à chercher chez Wagner, du côté de Tristan et Iseut. Ces deux-là formaient un couple finalement plus opérationnel avant de boire le philtre, en conflit certes, mais existant dans le monde, se reconnaissant l’un l’autre, même si Tristan évitait Isolde. En effet, le philtre ne les décille pas quant à leur amour non dit, il les rend aveugles au monde extérieur. Il s’agit d’ailleurs d’un amour de la nuit qui s’épanouit dans l’obscurité du navire, dans l’ombre de la chambre, ou dans les ténèbres de Karéol. Autant dans Wozzeck le couple se dissout dans le monde, autant chez Wagner il acte son impossibilité d’être au monde, le philtre sectionne les liens hiérarchiques, familiaux, amicaux qui les retiennent au monde.
L’infidélité a déjà introduit la possibilité d’un terzo incomodo qui fait obstacle au couple. Il en est un plus pernicieux : l’absent. Dans La Ville morte d’Erich Korngold (1920), Paul forme un couple toxique avec Marietta – belle actrice qui possède les mêmes traits que sa défunte épouse Marie. Il tente de faire revivre l’absente à travers elle, poursuivant une chimère qui le conduit – en songe seulement – au crime.
L’absence est comblée par le souvenir qui nourrit le fantasme morbide de résurrection. Ici impossible de faire couple puisque l’autre est un écran de projection, nécessairement déceptif. Dans ce cas
l’absence est un peuplement : c’est encore un couple à trois, la troisième personne n’étant pas Marie l’absente, mais bien Marietta qui n’occupe qu’une fonction secondaire de support.
Dans d’autres opéras, c’est une réelle absence qui entraîne le dysfonctionnement du couple, comme par exemple dans La Femme sans ombre de Richard Strauss (1919). Deux couples pour deux types d’absence : l’absence d’ombre de l’Impératrice, qui signale sa nature démonique, et l’absence d’enfant dans le couple de Barak avec la Teinturière. L’ombre cherchée par l’Impératrice conditionne son avenir avec l’Empereur, qui pourrait se muer en statue de pierre, mais s’il faut à l’Impératrice une ombre pour devenir humaine, l’Empereur est un autre absent, parti chaque jour à la chasse et revenu à la nuit seulement auprès de son épouse, comme si la nature démonique de celle-ci n’était qu’un trophée de chasse supplémentaire. Or la sanction divine si l’Impératrice ne projette pas d’ombre doit frapper l’Empereur, signalant que la résolution de ce « problème de couple » lui incombe aussi. Mais l’Empereur semble se désintéresser de cette quête dont il serait pourtant le premier bénéficiaire.
Ici les absences signalent l’ambiguïté des désirs, l’égoïsme de l’Empereur et la naïveté de l’Impératrice. La résolution de ce désaccord passe par une mise à l’épreuve qui les oblige à contempler l’altérité, car l’Empereur est – momentanément – puni et changé en pierre, gardant toutefois les yeux alertes pour contempler son épouse accomplir un choix juste mais difficile qui s’avérera ensuite libérateur. Pour l’autre couple, la dysfonction vient de l’absence, voire – plus simplement – de l’absence de réciprocité à l’amour de Barak pour la Teinturière. Car à l’opéra comme dans le réel nombreux sont les couples forcés : ceux-ci finissent par reconnaître la puissance du lien qui les unit et admettre qu’ils peuvent former un couple heureux.

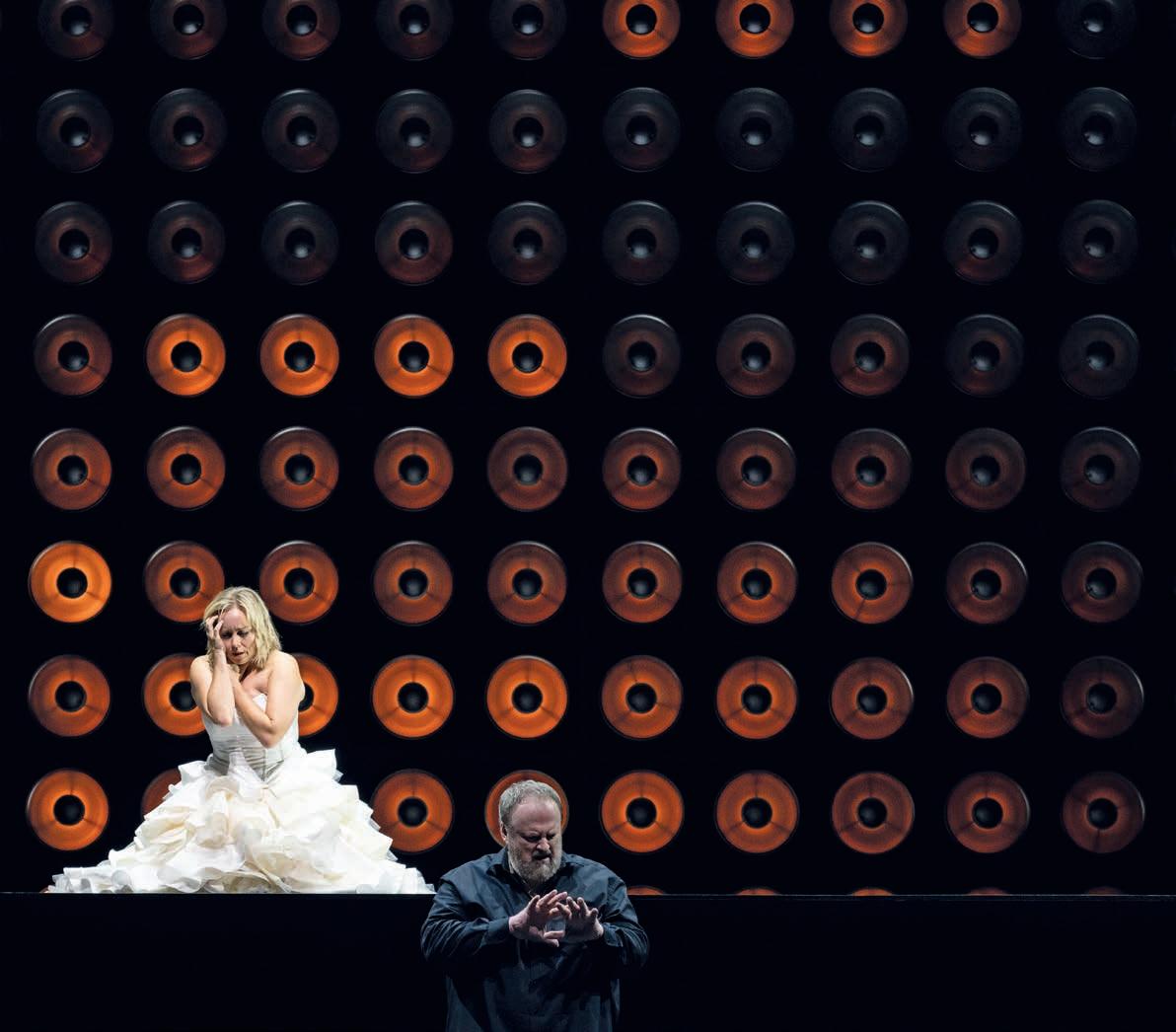
Au cœur de ces couples dysfonctionnels se noue une tragédie qui éloigne l’un de l’autre. Le couple, comme entité collective et néanmoins une, se fragmente sans pour autant défaire les liens qui unissent les personnages. Ainsi, c’est dans cet espace interstitiel et mouvant que naissent des affects singuliers qui ne sont réductibles ni à la haine ni à la passion. S’y déploie une subtile gamme de gris pour dépeindre des sentiments justes et touchants, et parfois révéler une certaine sagesse comme à la fin de Così fan tutte de Mozart où les deux couples doivent se résoudre au pardon et à l’humilité.
Dans Tristan et Iseut de Wagner, le philtre rend les amants aveugles au monde extérieur, actant son impossibilité d’être au monde. Ici Elisabet Strid et Gwyn Hugues Jones dans la mise en scène de Michael Thalheimer au Grand Théâtre (2024). © Carole Parodi / Grand Théâtre de Genève
Au Grand Théâtre de Genève Tannhäuser du 21 septembre au 4 octobre 2025 www.gtg.ch/tannhauser
Au Grand Théâtre de Genève Pelléas & Mélisande du 26 octobre au 4 novembre 2025 www.gtg.ch/pelleas-melisande
Emmanuel Grandjean est critique d’art et de design. Il a dirigé les rubriques Culture de la Tribune de Genève et du Temps Correspondant en Suisse pour The Artnewspaper, il estresponsable des publications du groupe SPG à Genève.
Par Emmanuel Grandjean


Marina Abramović et Ulay dans l’une de leurs premières performances, Rest Energy, en 1980, dans les premières années de leur relation artistique et amoureuse qui durera jusqu’en 1988.
© IMAGO / Collection : Collection M HKA, Antwerp / Collection Flemish Community / © Marina Abramović et Ulay / Avec l’aimable autorisation des Archives Marina Abramović / 2025, ProLitteris, Zurich
Après le Boléro de Ravel, Marina Abramović signe la scénographie de Pelléas et Mélisande. Une histoire d’amour impossible et tragique qui résonne avec celui qu’a vécu l’artiste et dont elle fit le cœur de son travail.
C’est l’histoire d’un triangle amoureux entre une jeune fille mystérieuse, retrouvée perdue dans la forêt, un châtelain pressé de l’épouser et son jeune demi-frère qui s’entiche follement de cette inconnue. La passade restera platonique. Elle n’en finira pas moins dans le sang. Pelléas et Mélisande, c’est Tristan et Iseut, mais en version fin de siècle. Un désastre des cœurs écrit par Maurice Maeterlinck, chantre du symbolisme, courant hybride animé par la mélancolie, le rêve et où la femme tient souvent le rôle fatal, mis en musique par Claude Debussy en 1902.
L’opéra avait été joué en 2020 au Grand Théâtre, accompagné, et c’était la première fois dans l’œuvre, d’une mise en scène réglée par les chorégraphes Sidi Larbi Cherkaoui, directeur du ballet de la maison de Neuve, et Damien Jalet. La représentation ayant été bousculée par la pandémie de Covid-19, elle avait été donnée, à distance, en visio. Cinq ans plus tard, la revoici qui va enfin pouvoir rencontrer son public et ainsi le projeter dans l’épatante scénographie cosmique imaginée par l’artiste Marina Abramović. « Pelléas et Mélisande m’a particulièrement intéressée en raison de ses multiples dimensions d’un amour impossible qui se termine tragiquement, explique l’artiste. Sur le plateau, de grands cristaux qui symbolisent une énergie en transformation, sous différentes formes. Ils suggèrent aussi que les événements de l’opéra pourraient se dérouler sur peut-être une autre planète avec des projections qui viennent évoquer notre univers et des variétés de décors intergalactiques. »
L’amour justement, parlons-en avec celle devenue la figure emblématique d’un art performatif radical et extrême. « Je pense qu’il est l’émotion humaine la plus importante. La toute première expérience de vie, c’est l’amour pour la mère, les parents, les amis, l’amant, le mari, la femme. Au début de ma carrière, je repoussais mes limites mentales et physiques pour comprendre où il se situait. » Au point d’occuper une place centrale dans son travail pendant les douze années que l’artiste va partager avec Ulay, son partenaire en performance avec qui elle forme un tandem amoureux hautement intense et fusionnel. Ensemble, ils conçoivent une série de happenings qui interrogent la possibilité d’une véritable union entre deux êtres, non pas symboliquement, mais dans la réalité concrète des corps. Dans Relation in Space de 1976, l’année de leur rencontre, ils se filment en vidéo, se percutant à pleine vitesse dans un espace vide. Une manière d’envisager l’amour comme une tentative de coïncidence absolue entre deux subjectivités. Laquelle se solde par la douleur, l’épuisement, et la blessure. Un an plus tard, les deux artistes se filment encore, échangeant leur souffle jusqu’à l’asphyxie (Breathing In/Breathing Out) ou montrant Ulay tendant la corde d’un arc armée d’une flèche dirigée vers Marina qui, de son côté, tient le corps de l’arme de jet. Une situation en équilibre précaire qu’aucun des deux n’a intérêt à rompre,
au risque de voir le projectile se ficher dans le cœur de la performeuse. Lorsqu’il frappe, Cupidon peut donc aussi signifier la mort. « J’ai rencontré Ulay d’une manière étrange, comme si le destin l’avait voulu ainsi, se souvient Marina Abramović. C’était le jour de mon anniversaire, à Amsterdam, et j’ai découvert que c’était aussi le sien. Nous sommes tombés amoureux cette nuit-là, et notre histoire d’amour, tout comme notre collaboration artistique, a duré jusqu’à notre séparation sur la Grande Muraille de Chine. »
Le couple qui a fait de son histoire une œuvre, voulait en fait mettre en scène l’idée de l’amour réconcilié. Mais le temps d’obtenir les autorisations et de mettre au point cette performance hors normes, le climat s’envenime entre les deux artistes. The Lovers : The Great Wall Walk sera le dernier acte de leur relation impossible. La performance se déroule en 1988. Chacun à un bout de la Grande Muraille part, à pied, rejoindre l’autre au milieu du monument. Marina Abramović depuis la mer Jaune, Ulay depuis le désert de Gobi. 5000 kilomètres en tout, qu’ils parcourront en 90 jours pour finalement se dire adieu. L’espace topographique de la muraille devient dès lors la métaphore de la distance affective ; la marche, celle du calvaire vers le deuil. La rencontre finale n’est pas une réconciliation, mais un point d’effacement. « Dans notre travail, nous parlions de l’énergie masculine et féminine qui se rejoignent pour créer une troisième forme d’énergie : le soi. Le mélange des opposés permet de se libérer de l’ego et donne à l’œuvre une autonomie propre, une vie indépendante. L’amour, la haine et le pardon : notre relation exprimait toutes ces facettes. » Ils ne se reverront plus pendant 22 ans.
« J’ai
rencontré Ulay d’une manière étrange, comme si le destin l’avait voulu ainsi. C’était le jour de mon anniversaire, à Amsterdam, et j’ai découvert que c’était aussi le sien. Nous sommes tombés amoureux cette nuit-là, et notre histoire d’amour, tout comme notre collaboration artistique, a duré jusqu’à notre séparation sur la Grande Muraille de Chine. »
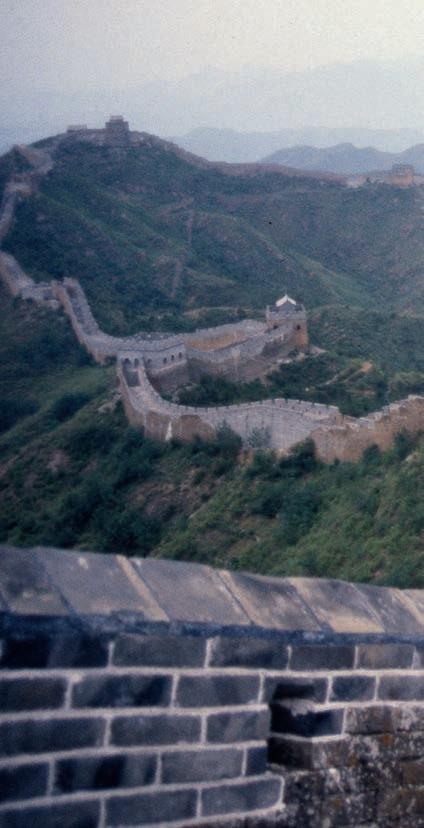
Jusqu’à ce jour de 2010, où Ulay débarque au MoMA. Marina Abramović performe. Cela s’intitule The Artist is Present. Elle s’est installée dans le musée d’art moderne de New York avec une table et deux chaises. Depuis trois mois, six jours sur sept et pendant huit heures, habillée d’une longue robe rouge qui la recouvre intégralement, elle reçoit de parfaits inconnus qui s’assoient en face d’elle et plongent leurs yeux dans les siens. Aucun contact n’est permis. Juste le regard profond qui déclenche, chez certains, des torrents de larmes. Et puis Ulay arrive, sans prévenir. Ce sera la seule fois où la performeuse va transgresser son protocole en prenant les mains de son ex-compagnon. Le public applaudit tandis que les deux artistes, sous le choc, s’effondrent sans dire un mot. Marina Abramović parlait du pardon dans l’amour, c’est lui qui s’invite dans ce petit geste de paix, séquence bouleversante qui dure tout juste une minute. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, disait Antoine Lavoisier avant de finir, coupé en deux, sous l’échafaud. L’amour aussi, qui ne disparaît jamais, mais se métamorphose avec le temps.

Ulay et Marina Abramović dans le cadre de la rétrospective de Marina Abramović, The Cleaner (au sens de la purge), qui a parcouru plusieurs villes d’Europe de 2017 à 2020. La relation entre les deux artistes était au centre de l’exposition. © IMAGO / epd-bild / Meike Boeschemeyer

« À la suite de The Artist is Present, ma relation à l’amour a profondément changé, reprend l’artiste. Après plus de huit heures à rester immobile en regardant des gens dans les yeux, j’ai découvert en moi une explosion d’amour inconditionnel pour chaque personne assise en face de moi. Hommes, femmes, enfants, des personnes que je n’avais jamais vues auparavant. Le sentiment d’amour inconditionnel que je ressentais dans ma poitrine était indescriptible. C’était immense, douloureux, et me faisait pleurer. Le public ressentait cette énergie et pleurait avec moi. Quand je me suis levée de cette chaise, après avoir regardé dans les yeux 1500 personnes, j’étais transformée. J’avais changé ma manière de concevoir l’amour. » Ulay décèdera dix ans plus tard, sans jamais avoir véritablement retrouvé sa place dans le milieu de l’art depuis sa rupture. Dès lors, chez Marina Abramović, l’amour ne sera plus une question de relation intime, mais de force impersonnelle, de principe vital et spirituel.
Lorsqu’ils décidèrent de se séparer, Marina Abramović et Ulay le firent par une performance fimée : chacun est parti d’une extrémité de la Grande Muraille de Chine et lorsqu’ils se sont rejoints, ils se sont dit adieu.
Marina Abramović / Ulay, The Lovers, performance, 90 jours, Grande Muraille de Chine, mars–juin 1988 © Marina Abramović et Ulay / Avec l’aimable autorisation des Archives Marina Abramović / 2025, ProLitteris, Zurich

Désormais absent physiquement, l’amour devient une présence spectrale que l’artiste convoque dans la mémoire et dans les traces laissées par les disparus. En 2020, elle monte Seven Deaths of Maria Callas qui rejoue les différentes morts tragiques de la grande diva lyrique, figure mythique d’un amour absolu et inaccessible dont l’intensité consume tout sur son passage. « L’amour inconditionnel, pas seulement pour les êtres humains, mais aussi pour les animaux, les plantes, et notre planète, est devenu le cœur de mon travail, et la forme d’amour la plus essentielle à mes yeux », explique-t-elle. Comme dans la scénographie astrale de Pelléas et Mélisande, où il prend une dimension universelle capable d’embrasser l’infini du cosmos. Parce que l’amour n’est jamais trop grand.
rdv.
Au Grand Théâtre de Genève Pelléas & Mélisande du 26 octobre au 4 novembre 2025 www.gtg.ch/pelleas-melisande
Le baryton français incarnera Wolfram dans Tannhaüser, avant de revenir chanter en récital. Il explique pourquoi n’y a pas de meilleur ressort lyrique que le sentiment amoureux empêché.

« On a tous en nous un écho des personnages que nous incarnons sur scène dans nos expériences personnelles, de l’effondrement à la résilience. » © Cédric Roulliat
Par Sylvie Bonier
Papageno l’a révélé. C’était à Aix-en-Provence en 1998. Le jeune Stéphane Degout avait alors 23 ans et abordait le rôle de l’oiseleur de La Flûte enchantée de Mozart dans l’Académie européenne du festival. Il y avait fait sensation.
L’intelligence de son chant, la clarté de sa diction, son timbre dense et brun ainsi que son jeu naturel avaient enthousiasmé le public, la presse et les professionnels.
Plus d’un quart de siècle plus tard, après une carrière qui l’a porté sur les plus grandes scènes et amené à endosser les personnages les plus complexes, le baryton français est récemment repassé par la ville du Roi René, où il se produit régulièrement. Il y a donné un concert avec l’ensemble Diotima. Mais il tenait aussi à participer à l’hommage au directeur Pierre Audi, disparu subitement en mai. Stéphane Degout est un homme de fidélités.
L’artiste s’attache aux scènes, aux artistes et aux personnages qui l’inspirent. Pelléas, Albert de Werther ou Hamlet ont marqué son chemin professionnel, et l’intimité du récital lui tient aussi beaucoup à cœur.
À Genève, où il incarna Rodrigue de Don Carlos de Verdi en 2023, il avait encore fait deux apparitions rapprochées en récital. Revoilà le chanteur à deux reprises sur la scène du Grand Théâtre : en septembre dans Tannhaüser de Wagner où il incarnera Wolfram, autre rôle important dans sa vie. Puis il reviendra en décembre avec le pianiste Cédric Tiberghien avec des œuvres de Schumann, Ropartz, Ravel, Debussy et Rita Strohl.
Ses choix musicaux s’inscrivent parfaitement dans la thématique de saison, « Lost in translation », où la perte de soi se révèle particulièrement sensible dans le domaine amoureux. « Lost in love » en est l’écho sentimental car, que ce soit à deux sur le plateau ou dans une grande production lyrique, l’amour malheureux occupe le cœur de tous les programmes.
À l’Opéra, le sentiment amoureux est contrarié, malmené, tragique, voire mortel. Destin lyrique funeste ou nécessité ?
L’amour dysfonctionnel n’est pas réservé qu’à l’opéra. Il est évident que sans drame, il n’y a pas de grands enjeux émotionnels. Le déraillement et la résistance sont intéressants à creuser car ils génèrent la souffrance, qui elle-même engendre des émotions puissantes. Quand l’amour est cabossé, cela oblige à aller chercher loin des solutions, soit de réparation, soit radicales. C’est valable en littérature et au théâtre. Mais il est vrai qu’à l’opéra, le traitement musical ajoute une forte résonance au texte, qui de son côté stimule beaucoup la création des effets musicaux. Tout ce qui engendre une douleur intime crée une grande tension entre les mots et les notes. Cela agit comme une caisse de résonance, aiguise la créativité et élargit l’expressivité. Il n’y a pas de meilleur ressort lyrique que le sentiment amoureux empêché.
Est-ce que dans votre vie, la tension amoureuse se joue comme en scène ?
On a tous en nous un écho des personnages dans nos expériences personnelles, de l’effondrement à la résilience. Tout dépend du genre de la relation, passionnelle et brève, ou engagée sur le long terme. Les moments de doute, d’incompréhension, de rivalité, de jalousie, d’éloignement ou de rupture sont sources de conflit et de mal-être. Mais l’amour a toujours à faire avec le dépassement de soi, qui nécessite une adaptation à l’autre, une réflexion et une transformation personnelle indispensables pour avancer.
Êtes-vous un amoureux plutôt perdu ou éperdu ?
Un peu des deux. Mais à la fin, j’arrive à prendre de la distance. Puis la mélancolie s’installe, impossible à mettre de côté. Mais cet effleurement a parfois du bon et peut tenir chaud…
Quel rapport entre le contrôle et le lâcher-prise faut-il instaurer sur scène ?
On ne peut pas se permettre de se laisser déborder par ses émotions sans risque de se perdre ou de faillir techniquement. Mais à la fois, il faut savoir laisser affleurer ses sentiments pour offrir plus de vie et de crédibilité aux personnages. C’est une question délicate d’équilibre et de sensibilité.
Dans quelle catégorie amoureuse situez-vous le chevalier Wolfram, que vous avez régulièrement chanté ?
Le sacrifice de soi. Le don total, qu’il soit amical ou amoureux. La noblesse de Wolfram dépasse les limites purement humaines. Si Tannhaüser avait eu un quatrième acte, on peut se demander ce que serait
devenu Wolfram. Serait-il entré dans les ordres ? Jusqu’où son sacrifice aurait-il transformé sa vie ? Il y a quelque chose de bouleversant dans son amour de l’autre. Il aurait pu tuer ou se venger. Mais il va au-delà, pour atteindre la rédemption en faisant le deuil d’Elisabeth, et de lui-même.
C’est un personnage amoureux contrarié rare dans le répertoire… Oui, je n’en vois pas d’autre mais je ne connais pas tout. Il est l’amour supérieur. Pelléas est un genre d’amour contrarié « parfait », jusqu’à la mort. Sa résignation est très belle. Hamlet, lui, est incapable d’anticiper son destin amoureux qu’il subit jusqu’au bord de la folie. Onéguine est écorché, et va au bout de ses sentiments alors que Rodrigue, dans Don Carlos, représente une autre forme sacrificielle, entre l’amitié et le pouvoir.
Sa déclaration d’amitié est d’une puissance incroyable.
Est-ce que la voix de baryton incarne mieux l’amour tragique que celle de ténor, qui incarne souvent l’amour transi ?
Oui, la tessiture plus grave est mieux adaptée pour exprimer la complexité et la douleur affective. La palette de couleurs vocales et d’expressivité est plus variée pour atteindre la profondeur des sentiments. Le ténor est plus brillant, plus vaillant et conquérant. Le registre plus bas du baryton offre plus d’ombres et des teintes plus riches.
Grâce à la clarté de votre diction, vous embrassez avec le même bonheur les rôles en français, italien ou allemand. Quelle langue vous semble le mieux convenir à l’amour, contrarié, ou non ?
Je dirais que c’est une langue qui n’existe pas, qu’il faut inventer ou apprendre à chaque instant, avec chaque personne.
Au Grand Théâtre de Genève Tannhäuser du 21 septembre au 4 octobre 2025
www.gtg.ch/tannhauser
Au Grand Théâtre de Genève Récital 7 décembre 2025
www.gtg.ch/stephane-degout rdv.
Mélanie Chappuis est journaliste, chroniqueuse, romancière et dramaturge. Elle a publié à ce jour une quinzaine d’ouvrages, dont huit romans, parmi lesquels La Pythie (éditions Slatkine) et Suzanne, désespérément (éditions BSN Press), trois pièces de théâtre, parmi lesquelles L’autre et Après la vague. Collaboratrice régulière à la RTS, elle a notamment produit, réalisé et animé l’émission littéraire Mon Truc en Plumes, en été 2023.
Mathilde Bettencourt au Grand Théâtre :
« Ici, on fait les salaires en entendant le chœur répéter, c’est un environnement incroyable… »
© Carole Parodi / Grand Théâtre de Genève

« Je m’attendais à être surprise, mais pas aussi positivement »
Cette saison, le Magazine du GTG nous fait découvrir des collaborateurs.trices engagés récemment et leur regard sur leur métier, sur le monde de l’opéra et de la danse. Première invitée, Mathilde Bettencourt, du service des ressources humaines.
Par Mélanie Chappuis

Nous avons rendez-vous dans les bureaux du Grand Théâtre un jour de grosse chaleur, début juillet. Dans un labyrinthe de murs de pierre et de béton décorés d’affiches et ornés de plantes vertes, nous cherchons un endroit calme et frais pour discuter. Nous choisissons de nous installer dans un local vitré aux confortables canapés, à quelques mètres et parois de l’open space dans lequel travaillent Mathilde Bettencourt et ses collègues. Elle m’accueille avec un petit trac, il s’agit de sa première interview, mais surtout avec l’envie de me communiquer sa joie d’évoluer dans son nouvel environnement. La jeune RH de 27 ans a commencé à travailler au Grand Théâtre de Genève en décembre 2024, en tant que spécialiste salaires et administration. Quelques mois plus tard, son enthousiasme est intact.
Avant d’arriver dans ces locaux, vous avez passé 6 ans dans une agence de recrutement, qu’est-ce qui vous a donné envie de postuler au Grand Théâtre ?
Quand j’ai vu que le Grand Théâtre recherchait une spécialiste salaires et administration, j’ai tout de suite tenté ma chance. Mon père est un grand amateur d’opéra, c’est un monde dans lequel je baigne depuis mon enfance, on écoutait de l’opéra partout, dans la voiture, à la maison. Enfant, j’avoue que ça m’intéressait moyennement.
Est-ce que vos parents vous auraient préféré artiste que RH ?
Ils essayaient de jouer sur mes inclinations en me faisant prendre des cours de musique, mais sans grand succès. J’aime plus le côté « admin » des choses. Chez moi tout est rangé, classé, carré, mes amis trouvent que j’en fais trop mais c’est important la rigueur, surtout ici au Grand Théâtre.
Pour compenser le côté éventuellement brouillon ou désorganisé des artistes ?
Alors certains artistes, il faut certes leur courir un peu après, mais ils viennent de mondes si variés et ils sont si passionnés... Imaginez si j’oublie de faire la demande pour le permis de travail d’un danseur japonais ! Il faut agir en amont pour ne pas avoir de mauvaise surprise, on doit avoir les autorisations nécessaires quand l’artiste arrive. Il faut présenter de belles demandes, réunir les bons documents, les artistes qui viennent de l’étranger doivent aussi se préparer de leur côté, dans leurs pays, obtenir les visas nécessaires, etc. Ça prend du temps. Nous nous y prenons à l’avance.
Quelle a été votre première impression en arrivant ici ?
Je m’attendais à être surprise, mais aussi positivement, peut-être pas. Mon premier jour de travail a coïncidé avec la première de Fedora, on m’a directement amenée à la régie lumières, j’en avais plein les yeux, et des frissons. Ici, on fait les salaires en entendant le chœur répéter, c’est un environnement incroyable. Quand je suis arrivée, les gens étaient fiers de m’expliquer leur métier, de me faire visiter les coulisses, on comprend mieux ce qu’on fait et pourquoi on le fait quand on va rendre visite aux corps de métiers présents ici. Maquillage, coiffure, perruques, décors, cintres, régies… Il y a tellement de monde. Alors je vais voir les gens et je me présente. D’abord, nous ne sommes que des noms sur des emails, ensuite, on est heureux de mettre des visages sur nos échanges virtuels, et de voir à quoi correspond la fonction des uns et des autres. J’en apprends tous les jours. En arrivant ici, j’ignorais ce qu’était un contrat d’artiste.
Racontez-nous…
Quand on voit « chef d’orchestre » sur un contrat, ou « soprano », « pianiste », « assistant chorégraphe », ça change de « carreleur », « maçon » ou « secrétaire », plus fréquents dans mon précédent emploi. Les contrats ont des durées spécifiques, celle du temps de la production par exemple.
Êtes-vous encouragés par la direction à aller voir les spectacles ?
Oui, on a des billets pour chaque générale, que ce soit pour le ballet ou l’opéra. Et nous avons des écrans dans les bureaux, sur lesquels sont retransmises les répétitions, on sait toujours ce qui se passe, côté artistique. Pendant mes pauses, je descends, je prends un petit quart d’heure pour aller voir les activités qui se déroulent à La Plage, qui concernent souvent les partenariats avec les écoles ou les seniors. C’est touchant de voir la joie des personnes âgées lorsqu’elles chantent.
Je n’ai jamais été aussi épanouie dans ma carrière professionnelle, c’est un monde où tout le monde est fier d’être là, où on se soutient. En même temps, je n’ai que 27 ans.
La saison dernière du Grand Théâtre s’est terminée en italien, avec le Stabat Mater de Pergolese donné à la Cathédrale Saint-Pierre dans une mise en scène de Romeo Castellucci, et La Traviata de Verdi revue par l’œil radical de Karin Henkel. Mais on n’oubliera pas le fascinant spectacle de Damien Jalet, Mirage, miroitant de corps énigmatiques errants dans un désert métaphorique.
Ruzan Mantashian, l’une des deux sopranos qui ont chanté La Traviata, contemple le portrait de son bonheur enfui dans la mise en scène sans concessions de Karin Henkel.
© Carole Parodi
C’est sur la jetée des Bains des Pâquis, qu’au petit matin du 17 août le Grand Théâtre a poursuivi sa programmation La Plage durant l’été avec des pièces d’Arnold Schönberg et de Viktor Ullmann. © AR
Des corps noirs et scintillants, un décor noir, des sculptures animées aux mouvements organiques : avec Mirage, le chorégraphe Damien Jalet a hypnotisé des salles combles et enthousiastes.
© Rahi Rezvani




Pour la dernière Late Night de sa saison 24/25, le Grand Théâtre s’est associé à la Fête de la Musique et à Electron pour offrir non pas une mais deux soirées, avec DJs installés sur les balcons du GTG et une place de Neuve transformée en piste de danse ouverte. © AR

Comme de coutume, le dernier spectacle de la saison a été diffusé gratuitement sur grand écran dans le parc des Eaux-Vives. La Traviata, ce soir-là, a fait pleurer les étoiles.
© AR

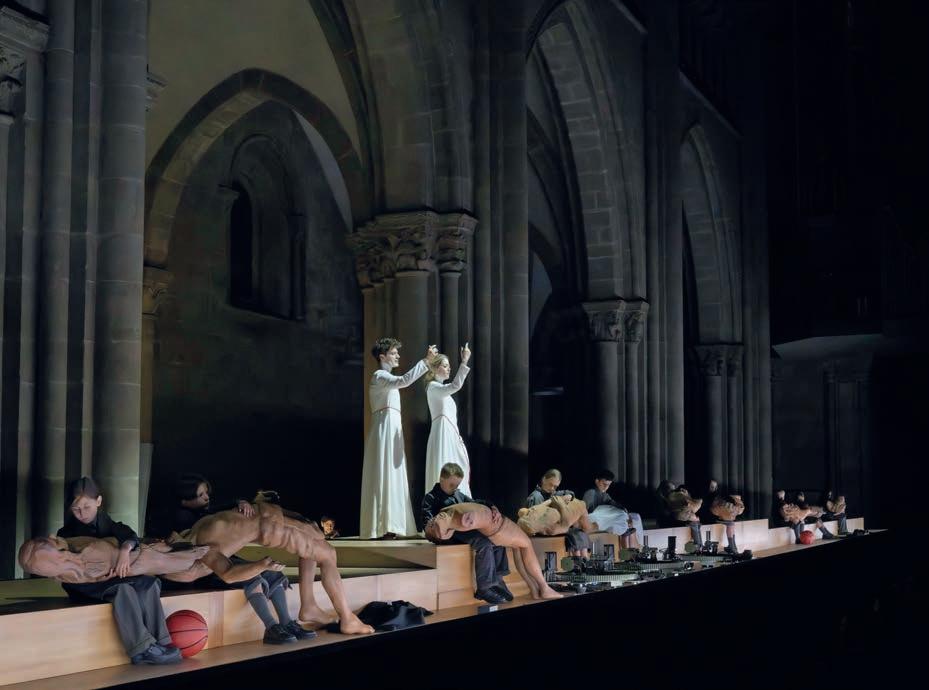
Sur le praticable longeant les piliers de la Cathédrale Saint-Pierre, Barbara Hannigan et Jakub Jozef Orlinski ont sublimé le Stabat Mater de Pergolese dans la mise en scène de Romeo Castellucci, un des spectacles les plus attendus de l’année. © Monika Ritterhaus
ans


L’Opéra de Bakou est considéré comme le joyau de la capitale azerbaïdjanaise, qui multiplie les projets culturels. Financé par un pétromilliardaire par esprit de revanche et par admiration pour une soprano russe, il fut achevé en dix mois et inauguré en 1911.
Par Mélissa Cornet
C’est sa vie culturelle, dont son opéra, qui valent à Bakou le nom de Paris du Caucase. Aujourd’hui, elle évoque néanmoins davantage le mariage d’Istanbul et de Dubaï, avec ses superpositions d’architectures traditionnelle, soviétique, et européenne agressivement rénovées sur fond de grattes-ciels aux lumières néons. La capitale mérite néanmoins son surnom de ville des vents — Bakou vient du persan bad kubeh, « coup de vent »: certains jours, il est si fort qu’il faut lutter pour avancer. Depuis son indépendance, l’Azerbaïdjan se réinvente à coup de campagnes de relations publiques financées par les pétrodollars, comme par exemple avec l’organisation de la première édition des Jeux européens, ou les posters Visit Baku dans plusieurs grands aéroports dont celui, gargantuesque, d’Istanbul. Une tentative de faire oublier le caractère autocratique du régime et ses pratiques répressives, notamment face aux médias.
Construit en 1911, l’opéra a été ravagé par un incendie en 1985 peu après avoir été rénové. Il a rouvert en 1988.
© IMAGO / Posztos Janos

C’est par admiration pour la soprano russe Antonina Nejdánova que le riche magnat du pétrole Daniel Mailov fit construire l’Opéra de Bakou. Et c’est bien sûr elle qui l’inaugura.
© IMAGO / United Archives International
L’OPÉRA
Le Théâtre national académique azerbaïdjanais d’opéra et de ballet, premier et unique opéra du pays, fut construit en 1911 par l’architecte arménien Nikolaï Bayev, dans un style inspiré de l’architecture de la Renaissance.
Tout commence par un affront mondain. Le millionnaire Daniel Mailov et son frère, deux notables de Bakou, ne sont pas invités au bal d’inauguration de la demeure d’un célèbre chanteur d’opéra local. Ce bâtiment était alors considéré comme l’un des joyaux architecturaux de la ville. Blessés dans leur orgueil, les frères Mailov décident de faire construire un édifice encore plus impressionnant : un opéra.
La même année, une cantatrice italienne visite Bakou. Choquée de constater qu’aucun opéra digne de ce nom n’existe dans cette ville pourtant riche, elle refuse de se produire. L’année suivante, en 1910, c’est Antonina Nejdánova, célèbre soprano russe, qui se rend à Bakou et donne plusieurs concerts dans des clubs et salles de spectacle. Lors d’un bal organisé pour son départ, on lui demande si elle reviendra un jour à Bakou. Elle répond par la négative, regrettant qu’aucun mécène n’ait financé un véritable opéra alors que la ville regorge de fortunes pétrolières. Daniel Mailov, admiratif de la voix et de la personnalité de Nejdánova, saisit l’opportunité : il lui propose de revenir dans un an, pour inaugurer un opéra construit en son honneur.

La construction d’un tel édifice en une seule année semble impossible. Le célèbre philanthrope Zeynalabdin Taghiyev, qui avait déjà financé un autre théâtre à Bakou (le Théâtre Taghiyev), exprime son scepticisme. Daniel Mailov lui propose alors un pari : si l’opéra est achevé dans les temps, Taghiyev en paiera les frais ; sinon, Mailov s’en chargera seul. Selon une autre version de l’histoire, s’ils échouent, les frères Mailov offriraient le théâtre à Taghiyev.
Les travaux sont menés tambour battant : 200 ouvriers travaillent en trois équipes, jour et nuit. La construction avance rapidement, malgré les objections du Conseil municipal, qui ordonne un arrêt pour non-respect des règles de sécurité. L’architecte Bayev réussit à convaincre les autorités et obtient les autorisations nécessaires. En moins de dix mois, le théâtre est terminé. Le maire de la ville, Piotr Martynov, accompagné d’architectes et d’ingénieurs, inspecte l’édifice et valide sa sécurité. Le coût total dépasse 250 000 roubles (environ 30 000 dollars de l’époque), une somme alors colossale. Fidèle à sa parole, Taghiyev règle la facture. Le 28 février 1911, le Théâtre des Mailov est inauguré en grande pompe. Daniel Mailov avait prévenu Antonina Nejdánova par télégramme, et c’est elle qui donne le premier récital. Toute l’élite de
Le Baku Boulevard est l’endroit idéal pour flâner entre palmiers, sculptures post-sovétiques et vue sur les Flame Towers. © Melissa Cornet
Bakou est présente, sauf le chanteur d’opéra qui n’avait pas invité les Mailov à son bal.
En 1985, le théâtre, récemment rénové, est ravagé par un incendie mystérieux. Les causes du sinistre restent inconnues. Néanmoins, compte tenu de son importance culturelle, les autorités décident de le reconstruire rapidement. Les travaux de restauration sont achevés et, le 3 janvier 1988, le théâtre rouvre ses portes au public. Aujourd’hui encore, il est considéré comme l’un des symboles les plus majestueux et emblématiques de la vie culturelle azerbaïdjanaise.
Depuis 2023, l’opéra a à sa tête le ténor azerbaïdjanais Yusif Eyvazov, jusqu’à récemment époux d’Anna Netrebko.
Nizami küçəsi 95
Pour les billets : www.iticket.az/en/venues/ azerbaijan-state-academic-opera-andballet-theatre
Partant de l’opéra construit par les frères Mailov se déroule l’artère principale de la ville, la longue rue Nizami, vibrant du dynamisme de ses boutiques, restaurants, cafés. À deux pas de l’opéra, le Café Gazelli offre un intérieur et une terrasse élégants, des plats locaux et internationaux servis par des serveurs particulièrement agréables. Le matin, goûtez le chikhirtma, simple
petit déjeuner d’œufs cuisinés avec des tomates, qui rappelle le menemen turc.
La place des fontaines, à l’opposé de l’opéra, marque la transition entre l’artère commerçante et la vieille ville historique de Bakou. Tout est piéton, et agréable à parcourir.
ICHERI SHEHER,
LA VIEILLE VILLE
Au milieu des murs de pierre polis, dans un dédale de rues étroites bordées de restaurants, boutiques et cafés, trône la Tour de la Vierge, qui offre une vue panoramique sur le centre-ville de Bakou. Personne ne connaît vraiment l’origine de cette tour cylindrique, ni sa date de construction, ni sa fonction initiale, mais la légende veut qu’une jeune femme se serait jetée du haut de la tour pour échapper à un prétendant non désiré, une histoire que l’on retrouve maintenant dans les contes et poèmes azerbaïdjanais. Elle est inscrite au patrimoine de l’humanité de l’UNESCO.
Côté historique, on y trouve également le Palais des Chirvanchahs, château d’architecture islamique datant du XVe siècle, aujourd’hui transformé en musée. Pour un regard plus contemporain sur l’Azerbaïdjan, visitez la Maison de la Photographie de Bakou, qui présente le travail de photographes azerbaïdjanais contemporains. www.icherisheher.gov.az
LA QUZU
Pour un déjeuner ou un dîner, La Quzu offre une cour intérieure ombragée ou vous pourrez gouter la gastronomie azerbaïdjanaise, très proche de son voisin turc: kebabs arrosés d’ayran (boisson à base de yaourt), thé noir à volonté, kayam (crème épaisse) et miel, gâteaux de riz à la persane, et dumplings à la peau épaisse. Marqué par des influences turques, persanes et russes, le Caucase du Sud partage des langues et cultures proches. L’Azerbaïdjan, encore
empreint de soviétisme, tente d’en tourner la page par d’ambitieux projets de rénovation. www.cafecity.az/ru/restaurant/laquzu
PROMENADE AU BORD DE LA MER CASPIENNE
Le long de la mer Caspienne, la promenade piétonne de Bakou — ou Baku Boulevard — est l’endroit idéal pour flâner entre palmiers, sculptures post-soviétiques et vues sur les Flame Towers qui s’illuminent à la tombée du jour. C’est ici que les familles viennent marcher en soirée, que les amoureux s’installent sur les bancs, et que les enfants grignotent du maïs grillé. Le Café Mirvari, vestige élégant du modernisme soviétique, offre une pause face aux eaux grises, où respirer l’histoire de la ville autant que son désir de se réinventer.
Baku Boulevard
+994 50 315 45 78 @mirvari.cafe
COUCHER DE SOLEIL
SUR BAKOU
Du haut de la corniche de Bakou, le parc Highland offre une vue imprenable sur la ville, ses gratte-ciels et maisons beiges à perte de vue, et sur la gauche, les célèbres Flame Towers, symboles de Bakou et de son motto: “Terre de Feu”, en référence à l’abondance de gaz naturel de la région et des feux ainsi créés. En témoignent les feux éternels de Yanar Dag, proches de Bakou, ou du temple du feu zorostraien Ateshgah, petits frères de la célèbre Porte de l’Enfer du Turkménistan, où une échappée de gaz naturel brûle depuis des décennies. La vue de Bakou rend apparente les différentes époques et architectures de la capitale, des bâtiments moyenâgeux de la vieille ville, aux blocs soviétiques, et enfin aux gratte-ciels argentés.
MARI VANNA
Pour un changement après les kebabs et autres spécialités azerbaïdjanaises, Mari Vanna offre un détour via la Russie chic dans un décor éclectique,
avec ses dumplings, ses blinis et autres . Un rappel, au milieu des voisins russophones, que le Caucase accueille depuis le début de l’invasion russe des milliers de jeunes Russes fuyant leur régime et sa mobilisation pour nourrir sa guerre folle contre l’Ukraine.
93 Zərifə Əliyeva küçəsi +994 12 404 95 95 @marivannabaku
HEYDAR ALIYEV
L’effondrement de l’Union soviétique en 1991 et le « contrat du siècle » signé en 1994 entre le gouvernement azerbaïdjanais et des sociétés pétrolières multinationales, accordant aux investisseurs étrangers le droit d’exploiter les ressources naturelles du pays, marquent un tournant pour l’Azerbaïdjan. Une grande partie des bénéfices générés par l’industrie pétrolière a été investie dans la modernisation de la ville, ajoutant à son horizon une série de bâtiments futuristes.
Symbole de ce nouveau Bakou, le Centre culturel Heydar Aliyev est une œuvre futuriste signée par l’architecte de renommée mondiale Zaha Hadid, et a remporté le prix du Design de l’année en 2014. Avec ses courbes fluides et son extérieur immaculé, ce bâtiment emblématique semble émerger du sol comme une vague figée. À l’intérieur, on découvre un musée consacré à l’ancien président Heydar Aliyev, des expositions temporaires d’art contemporain, et des installations immersives.
www.heydaraliyevcenter.az
1 Heydar Aliyev Avenue +994 12 505 60 01




La reprise de saison, qui propose deux grands opéras du répertoire avec Tannhäuser et Pelléas et Mélisande, ouvre aussi les portes du Grand Théâtre à toutes sortes d’activités. Soucieux d’inviter les publics les plus divers à découvrir ou profiter de l’édifice, le GTG organise des journées portes ouvertes, des apéropéras, des ateliers pour enfants, ou son traditionnel Sleepover (voir ci-contre). Et on n’oubliera pas la série des récitals de chant sur la grande scène, qui convient cette année Stéphane Degout, Peter Mattei, Elsa Dreisig et en ouverture de la série la célèbre mezzosoprano américaine Joyce DiDonato. Une soirée qui promet d’être exceptionnelle, à l’image d’une artiste souveraine.
Par Karin Kotsoglou

JOYCE DIDONATO EN RÉCITAL
En famille, en flâneurs, venez (re)découvrir le Grand Théâtre et ses coulisses. Au programme, une répétition du chœur et du ballet, des ateliers pour enfants, des visites guidées et des parcours découvertes. Grand Théâtre Genève, le 7 septembre de 11h à 18h (entrée libre).
DUMY MOYI AVEC
LE FESTIVAL DE LA BÂTIE
Dans le cadre du Festival de la Bâtie, nous accueillerons la performance de François Chaignaud Dumy Moyi Présentée dans les plus grands festivals, cette performance solo vient offrir un regard croisé sur sa nouvelle création avec Nina Laisné et Nadia Larcher. Foyer du Grand Théâtre Genève, le 8 septembre à 19h et 21h.
ABRACADABRA, ATELIER
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
Après la malicieuse Souris Traviata, le pays enchanté de Colorama, et Dachenka le bébé chien turbulent, Abracadabra est le nouvel atelier-spectacle du GTG. Il permettra aux enfants de 3 à 7 ans et à leurs accompagnants d’aller à la découverte de l’opéra grâce à des formules magiques délirantes et des interactions avec les artistes, le tout sur les plus beaux airs de Purcell, Offenbach, Mozart ou Grieg… Grand Théâtre Genève, du 24 septembre au 19 novembre.
« Lumineuse », « explosive », « généreuse », « brillante » : la vibrante et multi-talentueuse mezzo-soprano américaine Joyce DiDonato, dont le New York Times a salué la voix en la qualifiant de « rien de moins que de l’or 24 carats », est l’un des talents les plus convoités de la scène musicale internationale. Accompagnée du pianiste Craig Terry, elle sera enfin de retour au GTG avec un programme fascinant qui traverse plusieurs époques, partant de Haydn pour finir avec la musique du contemporain Jake Heggie, compositeur de l’opéra Dead Man Walking dans lequel elle incarnait au Metropolitan Opera de New York en 2023 une bouleversante Sœur Helen, sans oublier les mélodies d’Alma Mahler et de Claude Debussy dont on présentera le Pelléas & Mélisande quelques semaines plus tard.
Grand Théâtre Genève, le 11 octobre à 20h.
C’est l’un des événements les plus courus de la programmation La Plage du GTG. Et pour cause : qui n’a jamais rêvé de dormir dans les lieux magiques d’un opéra, accompagné durant la nuit par diverses prestations musicales ?
Grand Théâtre Genève, le 31 octobre à 20h.
31 OCT – 12 NOV 2025


CONCOURS DE DIRECTION 2025–2026
1er TOUR : 31 OCT –1 NOV (ORCHESTRE HEM)
2e TOUR : 2– 3 NOV (L’OCG)
Demi-Finales et Finales en 2026
CONCOURS D’ALTO 2025
DEMI-FINALES : 6–9 NOV
FINALE AVEC L’OSR : 12 NOV
Tarif préférentiel pour les membres du Cercle du Grand Théâtre de Genève et les Ami·e·s du GTG





















La RTS contribue au renforcement culturel romand, à la radio, à la télévision et sur le digital, grâce à près de 50 émissions culturelles hebdomadaires.

