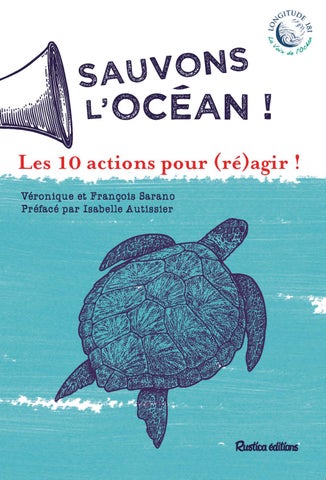1 minute read
Au large, adoptez les bons gestes
from Sauvons l'océan
chaudes et glacées, zones éclairées et abysses obscurs… On a décrit 240 000 espèces, il en existerait dix fois plus… Mais que sait-on de cet univers, inexploré parce qu’inaccessible, hormis notre connaissance de l’étroite bande côtière ? Seuls six sous-marins peuvent descendre à 6 000 mètres. Ils explorent quelques hectares, lors de rares plongées, et entrevoient quelques animaux. L’essentiel de ce que l’on connaît a été prélevé à l’aveuglette, avec des filets ou des nasses descendus depuis les bateaux… C’est un peu comme si on décrivait les Amériques en lançant, depuis une montgolfière, un petit filet afin de recueillir des animaux et des plantes !
Pire, tous ces animaux sont morts, et la description de leurs cadavres ne dit pas comment ils vivent et quelles relations ils ont avec les autres espèces. Car toutes interagissent sans cesse, entre elles et avec le milieu en un équilibre dynamique, toujours en évolution, et qui bénéficie à chacun. L’océan n’est pas une somme d’espèces, c’est un tout. Et un tout bien plus riche que la simple somme de ces éléments.
Il faut donc préserver non pas des espèces isolées, mais les espèces dans leur milieu, c’est-à-dire des écosystèmes entiers, en multipliant les réserves.
En continuité avec les terres
La surface des océans n’est pas une « barrière » qui sépare le monde terrestre et le monde marin. C’est avant tout une zone d’échanges. Échanges de gaz : l’océan rejette l’oxygène produit par les algues du plancton, premier « poumon de la planète » (et non la forêt amazonienne) et absorbe le gaz carbonique en excès dans l’atmosphère. Échanges de nourriture, car les oiseaux marins se nourrissent de poissons et de calmars, les ours des saumons qui remontent les rivières et, à l’inverse, les crabes des déchets organiques qu’ils trouvent sur le rivage.