Les outils
Usuels et Génératifs
dans la conception de

dans la conception de
PB : Comment les outils de conception usuels et les outils de conception génératifs de l’architecte influencent la conception des atmosphères domestiques ?
Mémoire de master
Damien Blachier
Promoteur : Salvator-John Liotta
2023-24
Faculté d’architecture de l’ULB : La Cambre Horta
Remerciements
Abstract
INTRODUCTION
1. Avant-Propos
2. Contextualisation
3. Problématique
4. Plan du mémoire
1. Les atmosphères architecturales
1.1 L’atmosphère
1.1.1 La notion d’atmosphère
1.1.2 Recherche contemporaine de l’atmosphère
1.1.3 Les critères de la dimension sensorielle
1.2 Définition actuelle
1.2.1 Peter Zumthor
1.2.2 Gregoire Chelkoff
1.2.3 Elisabetta Canepa
1.3 Le rôle de l’outil de conception dans la qualité de l’atmosphère
1.3.1 Critères d’appréciation des atmosphères contemporaines
1.3.2 L’enjeu de la maîtrise du processus
2. Les outils de représentation de l’architecte
2.1 Les outils manuels
2.1.1 Le dessin, la perspective, les axonométries
2.1.2 Les maquettes physiques
2.1.3 La photographie photomontage collages
2.2 Les outils digitaux
2.2.1 Les outils DAO CAO
2.2.2 Les outils matriciels
2.2.3 Les outils BIM et paramétriques
2.3 Les outils de visualisation numérique
2.3.1 Les outils de rendu intégrés
2.3.2 Les outils de rendu spécialisés
2.3.3 Les outils de visualisation en Réalité Virtuelle
2.4 Influence des images et des médias numériques
2.4.1 Impact sur la perception des espaces
2.4.2 Enrichissement du processus créatif
2.4.3 Mise en garde de Jacques Lucan
3. Outils génératifs de l’architecte
3.1 Les outils LLM
3.1.1 Définition et fonctionnement des LLM
3.1.2 Analyse fonctionnelle, interface type et prompts
3.1.3 Les outils aboutis (Présentation des outils fonctionnels)
3.1.4 Les outils IA intégrés aux outils digitaux traditionnels
3.2 Les capacités de ces outils aujourd’hui
3.2.1 Impact sur le processus de conception
3.2.2 Leur intégration dans des projets actuels
3.2.3 Limites et défis
3.3 Constats et enjeux
3.3.1 Enjeux éthiques et sociaux
3.3.2 Potentiels et opportunités
3.3.3 Risques et précautions
MÉTHODOLOGIE
1. Collecte des données
2. Recherche documentaire
3. Conférences et films d’archives
A. Les outils manuels : Frank Lloyd Wright et la Maison sur la Cascade
A.1 Contexte historique
A.1.1 Les outils de Frank Lloyd Wright
A.1.2 Les techniques de composition de Frank Lloyd Wright
A.2 Analyse de la villa sur la cascade
A.2.1 Conception
A.2.2 Rapport à l’atmosphère
A.2.3 Mise en œuvre
A.3 Résultats d’analyse
A.4 Conclusion
B. Les outils paramétriques : The mountain, BIG et Ycone, Jean Nouvel
B.1 Contexte historique
B.2 Analyse de The Mountain de Bjarke Ingels Group
B.2.1 Les techniques de composition de BIG
B.2.2 Conception
B.2.3 Rapport à l’atmosphère
B.2.4 Mise en œuvre
B.2.5 Résultats d’analyse
B.3 Analyse de Ycone de Atelier Jean Nouvel
B.3.1 Les techniques de composition de AJN
B.3.2 Conception
B.3.3 Rapport à l’atmosphère
B.3.4 Mise en œuvre
B.3.5 Résultat d’analyse
B.4 Conclusion générale Les Outils paramétriques dans le logement d’aujourd’hui
C. Les outils génératifs : La thèse de Stanislas Chaillou et Mjøstårnet Tower, Voll Arkitekter
C.1 Introduction de la recherche AI + Architecture, Towards a New Approach
C.1.1 Les outils génératifs
C.1.2 Les possibilités de conception
C.1.3 Le processus conception génératif selon Stanislas Chaillou
C.1.3.1 Les GANs
C.1.3.2 La génération de plan le «Pipeline»
C.1.3.3 L’empreinte
C.1.3.4 La disposition
C.1.3.5 L’aménagement
C.1.3.6 L’assemblage d’appartements
C.1.3.7 Les styles
C.1.3.8 Les Métriques
C.1.3.9 Les Atmosphères
C.1.3.10 Conclusion
C.2 L’état actuel de l’utilisation des Outils Génératif dans la pratique architecturale
C.3 Le processus de conception via les Outils Génératif «no-code»
C.3.1 Les outils précurseurs : génération d’images et analyse urbanistique
C.3.2 L’évolution du choix et des spécialités
C.3.3 Le nouveau processus de conception
C.3.4 Les gains : Rapidité / Précision
C.3.5 Vision
C.3.6 L’avis de Mark Burry
C.3.7 L’avis d’Antoine Picon
CONCLUSION
1. Objectifs
2. Résultats
3. Perspective
Bibliographie Glossaire
Abstract
La question de l’habitat a toujours été au cœur des débats d’architecture, au cours de mon parcours académique j’ai développé un intérêt marqué pour les atmosphères domestiques et leur méthode de représentation. Ces expériences m’ont permis de découvrir comment les outils de conception influencent l’expérience de la compréhension approfondie de l’importance cruciale des atmosphères domestiques dans la conception architecturale. Cette recherche vise à explorer l’évolution des outils de représentation architecturale et à examiner comment ces outils influencent la conception et des atmosphères domestiques. La recherche se demande comment les outils de conception usuels et les outils de conception génératifs de l’architecte influencent la conception des atmosphères domestiques ? En s’appuyant sur une méthode d’analyse chronologique, cette étude se divise en trois parties principales : les outils de représentation manuelle avant l’ère numérique, la transition vers la numérisation et l’arrivée des outils numériques, et enfin, l’impact des technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle sur la représentation et la conception des espaces domestiques.
La première partie de cette recherche se concentre sur l’ère prénumérique, analysant des œuvres de figures emblématiques comme Frank Lloyd Wright, pour comprendre comment les méthodes traditionnelles influençaient la conception des atmosphères. La deuxième partie examine la transition vers la numérisation, en mettant en lumière des pionniers tels que Bjarke Ingels et Jean Nouvel, pour évaluer comment les outils numériques ont transformé la représentation architecturale et son impact sur les espaces de vie. La troisième et dernière partie se penche sur l’avenir, explorant l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la conception architecturale et son potentiel pour redéfinir les atmosphères domestiques.
À travers cette recherche, je cherche à démontrer comment chaque évolution technologique a influencé la manière dont les architectes conçoivent et représentent les atmosphères domestiques, offrant de nouvelles perspectives sur la relation entre technologies, conception architecturale, qualité spatiale et expérience de l’espace.
Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à mes professeurs John Salvatore Liotta et David Erkan, pour leur accompagnement tout au long de mon parcours académique. Leur expertise et leurs conseils dans les domaines de l’architecture contemporaine, digitale, BIM et paramétrique ont été d’une grande aide pour mes recherches et la rédaction de ce mémoire. Leur passion pour l’enseignement et leur dévouement à l’égard de leurs étudiants se sont manifestés dans chaque interaction, enrichissant mon expérience académique et personnelle. Leur soutien a été précieux pour surmonter les défis rencontrés et pour approfondir mes connaissances dans ces domaines.
Je remercie également mes amis et ma famille pour leur soutien moral et leurs encouragements constants, qui ont été essentiels tout au long de ce processus.
Avant-Propos
Contextualisation
Problématique Plan du mémoire
INTRODUCTION
Au cours de mon parcours académique en master, j’ai eu l’opportunité de travailler dans l’atelier «Logement innovant». Cette expérience s’est révélée être une expérience fascinant à travers les complexités et les subtilités de l’habitat moderne. J’ai découvert une multitude de questions et de défi s qui se posent inévitablement lorsqu’on envisage les logements de demain.
Cette exploration m’a non seulement permis d’acquérir une compréhension de l’architecture résidentielle contemporaine, mais m’a également conduit à développer un intérêt particulier pour les aspects moins tangibles, mais tout aussi essentiels de nos espaces de vie. L’une des révélations les plus signifi catives de cette période a été la reconnaissance de l’importance cruciale des espaces intérieurs et de l’ambiance du lieu.
En travaillant en parallèle dans la Question d’Architecture « Architecture et Parametric Design », j’ai été captivé par l’impact profond de la dynamique spatiale sur l’expérience humaine. J’ai appris que la conception des espaces intérieurs ne se limite pas à l’esthétique ou à la fonctionnalité, elle englobe également la manière dont ces espaces infl uencent les sens et interagit avec les usagers.
À travers mes recherches personnelles, je me suis grandement intéressé au travail de Grégoire Chelkoff qui souligne l’importance de concevoir l’architecture comme une culture sensorielle de l’environnement habité, mettant l’accent sur une approche modale plutôt que causale des dimensions physiques et sensorielles.
Inspiré par cette vision, ce mémoire vise à encourager une approche plus intégrée de la conception architecturale, où la complexité et la beauté sont pleinement exploitées pour enrichir l’expérience spatiale à l’intérieur.
Ceci implique un examen critique des pratiques actuelles et propose une réfl exion sur la manière dont les architectes peuvent mieux utiliser les technologies et techniques paramétriques pour créer des ambiances.
Ce mémoire se veut donc être une exploration de la manière dont la dimension sensible de l’architecture peut être intégrée dans l’utilisation des technologies modernes, telle que le BIM et l’IA, pour enrichir notre compréhension, notre conception et notre expérience de l’espace architectural.


Dans le cadre de mon parcours académique en tant qu’étudiant d’architecture, l’importance de l’atmosphère émerge comme un défi majeur. Dès la seconde partie du XXe siècle, apparait une diminution de l’intérêt pour l’espace perçu dans le domaine du logement et d’autant plus au sein du le logement social, principalement pour cause de la reconstruction. Les enseignements sensibles, comme ceux de Le Corbusier qui valorisaient la qualité de l’expérience à travers la promenade architecturale, ont été remplacés par une préoccupation croissante en l’efficacité structurelle et fonctionnelle, au détriment des qualités spatiales qui apportent une valeur ajoutée à l’habitat.
Cela s’est plutôt traduit par une réduction de l’engagement de l’architecte dans la création d’espaces de qualité et de l’expérience vécue par les usagers. Dans ce contexte, l’architecte est souvent perçu comme un acteur qui, en s’alignant sur les exigences des commanditaires, privilégie la rentabilité économique au détriment de la qualité des logements. Cette orientation vers une maximisation des gains financiers conduit à une standardisation des constructions, où les considérations économiques priment sur l’innovation architecturale et le bien-être des occupants.
De plus, dans notre ère actuelle, marquée par des périodes de confinement et encore aujourd’hui de télétravail qui oblige les individus à passer la majeure partie de leur temps dans leurs espaces domestiques, nous constatons que de nombreux logements ne répondent pas aux besoins contemporains. Souvent, ces espaces sont perçus comme étant trop exigus, mal agencés, excessivement ensoleillés, ou encore trop chauds, révélant ainsi une carence dans leur conception. Parallèlement, la crise du logement, exacerbée par un déficit de solutions adéquates et des problèmes de logement de piètre qualité, coexiste avec les défis écologiques posés par le secteur de la construction. La solution envisagée à cette problématique réside dans une densification réfléchie, qui, tout en répondant au besoin pressant de logements, intègre des considérations écologiques.
En réponse à ces défis, l’architecture paramétrique émerge comme un domaine d’intérêt pour les architectes qui cherchent à concevoir rapidement et efficacement tout en respectant des critères écologiques. L’utilisation de logiciels avancés facilite la visualisation des espaces intérieurs, la prévision des atmosphères, et l’optimisation de l’ensoleillement ainsi que l’intégration de matériaux de construction et de l’efficacité des stratégies d’isolation. Ce processus permet une maîtrise accrue du design, de la construction, et de la mise en œuvre, contribuant ainsi à la création d’espaces de qualité qui répondent aux exigences actuelles.
Face à la standardisation des constructions et à la prééminence des impératifs financiers, une réaction significative se dessine dans le monde de l’architecture. L’émergence et l’adoption croissante des outils de modélisation des informations d’un bâtiment (BIM)et des logiciels paramétriques représentent une véritable lueur d’espoir. Ces technologies offrent une voie prometteuse pour réconcilier rentabilité économique et qualité architecturale, marquant ainsi le début d’une renaissance dans la conception et la réalisation de l’espace bâti.Cette vision globale permet d’anticiper et de résoudre les problématiques potentielles, réduisant ainsi les coûts inutiles tout en optimisant la qualité et la performance des bâtiments. Parallèlement, l’utilisation des logiciels paramétriques ouvre de nouvelles perspectives en termes de personnalisation et d’innovation architecturale. En permettant aux architectes de manipuler et d’ajuster les paramètres de conception en temps réel, ces outils facilitent l’exploration de formes complexes et la création d’espaces véritablement adaptés aux besoins spécifiques des utilisateurs. Loin de se limiter à une démarche purement esthétique, l’approche paramétrique encourage une réflexion approfondie sur la fonctionnalité, l’efficacité énergétique et l’intégration harmonieuse des bâtiments dans leur environnement.
Cependant l’arrivée de l’informatique autour des années 2000 à pour tant promis qu’enfin les architectes allaient pouvoir modéliser, visualiser et anticiper la conception du projet, mais cela n’a pas radicalement changé la donne au sujet des atmosphères.
Dans le contexte actuel de l’architecture, où l’efficacité économique et la standardisation des constructions prédominent souvent au détriment de la qualité et de l’individualité des espaces de vie, l’émergence et l’adoption des outils de modélisation des informations du bâtiment (BIM) et des logiciels paramétriques représentent un tournant. Ces technologies offrent une nouvelle perspective, permettant de réconcilier les contraintes économiques avec les aspirations à une architecture plus riche et personnalisée.
De plus, les outils d’intelligence artificielle ou dits génératifs, arrivés depuis peu, offrent aux architectes une grande capacité d’expérimentation. Grâce à ces technologies, il est désormais possible de générer une vue, un plan, un rendu spatial d’un logement très rapidement et d’en optimiser son ambiance et son atmosphère, répondant ainsi de manière plus précise aux besoins et désirs des usagers.
Cependant, cette évolution technologique pose une question fondamentale : Comment les outils de conception usuels et les outils de conception génératifs de l’architecte influencent la conception des atmosphères domestiques ? Comprendre cette dynamique est crucial pour évaluer l’impact réel des nouvelles technologies sur la qualité de vie des occupants et sur l’évolution de la pratique architecturale elle-même. Les outils numériques, tels que le BIM, les logiciels paramétriques, les outils de rendus et les outils IA, permettent des visualisations réalistes et amplifie encore plus la capacité d’expérimentation, mais cela soulèvent également des questions sur leur influence sur la perception sensorielle et émotionnelle des espaces.
D’après l’engouement de la presse d’architecture (Pavillon de l’Arsenal, 2020) , les outils d’IA et génératifs, tels que les logiciels basés sur l’intelligence artificielle et les algorithmes de conception, faciliteraient une approche plus intégrée et éclairée dans le choix des matériaux. En permettant aux concepteurs de simuler l’impact de différents matériaux sur l’ambiance et l’esthétique des espaces de vie, ces outils encouragent une réflexion plus profonde sur la durabilité, l’économie et l’impact écologique des constructions. Cependant, cette capacité à créer des représentations idéalisées suscite une interrogation sur la fidélité de ces simulations à la réalité construite et la capacité de ces outils à capturer les nuances et les subtilités des matériaux et de l’interaction spatiale dans un environnement réel.
Il est vrai que les avancées techniques rendues possibles par les outils d’IA et les techniques génératives ont le potentiel de permettre une exploration plus libre des potentialités architecturales. Ces outils permettent de concilier esthétique, fonctionnalité et performance environnementale de manière harmonieuse, tout en offrant la possibilité de traiter l’architecture, l’enveloppe du bâtiment et son atmosphère de façon plus indépendante. Néanmoins, cela soulève la question de la cohérence globale dans la conception finale et de la capacité des architectes à maîtriser l’harmonisation de ces aspects pour répondre aux défis écologiques et sociaux contemporains.
D’après la thèse de Stanislas Chaillou (Chailloux, 2020), l’incorporation de données qualitatives et sensorielles dans la méthode de conception assistée par IA représente une avancée majeure pour l’amélioration de l’expérience des espaces de vie. En prenant en compte des aspects tels que l’acoustique, la qualité de l’air et la luminosité naturelle dès les premières étapes de conception, ces outils permettent de concevoir des espaces qui répondent non seulement aux besoins fonctionnels, mais aussi au bien-être des occupants. Cependant, il est crucial de questionner dans quelle mesure cette approche qualitative et sensorielle peut être généralisée sans perdre de vue les spécificités et les particularités de chaque projet. Ainsi, en établissant ce cadre de recherche, l’ambition est de questionner le fonctionnement des outils d’IA et génératifs afin de préciser l’impact réel de ces outils sur les atmosphères conçues. Il est essentiel d’examiner de manière critique et analytique les avantages tangibles et les limitations inhérentes à ces technologies, tout en évaluant comment elles influencent la créativité et la capacité des architectes à répondre aux besoins humains complexes et variés. Ce regard critique vise à déterminer si l’IA et les outils génératifs représentent véritablement un progrès dans la conception architecturale ou s’ils introduisent de nouveaux défis et considérations éthiques.
Cette étude a pour objectif de répondre aux questions suivantes :
1. Comment ces outils influencent-ils la créativité et l’innovation des architectes dans le processus de conception ?
2. Dans quelle mesure les outils d’IA et génératifs améliorent-ils la conception des atmosphères architecturales, la qualité sensorielle et émotionnelle des espaces ?
3. Quels sont les défis éthiques et techniques liés à l’intégration des outils d’IA et génératifs dans la pratique architecturale ?
Malgré l’intérêt croissant pour l’utilisation des outils d’IA et génératifs en architecture, la plupart des recherches précédentes se sont concentrées sur les avantages technologiques et les potentialités créatives de ces outils. Il est donc crucial de dépasser cette perspective technocentrée pour explorer les implications plus profondes de ces technologies sur la pratique architecturale et la qualité des espaces de vie. Cette étude vise à questionner non seulement les capacités techniques des outils d’IA et génératifs, mais aussi leur impact réel sur la création d’espaces vivants, enrichissants et durables. L’ambition est de comprendre comment ces outils peuvent être utilisés pour servir une architecture centrée sur l’humain, tout en répondant aux défis contemporains de durabilités et d’efficacités.
Hypothèse 1 : Les outils d’IA et génératifs ont le potentiel de créer des atmosphères architecturales plus personnalisées et adaptées aux besoins des utilisateurs.
Hypothèse 2 : L’intégration de ces outils dans le processus de conception améliore la précision et l’efficacité, tout en stimulant l’innovation architecturale.
Hypothèse 3 : Les défis éthiques et techniques liés à l’utilisation de ces outils peuvent être surmontés par une formation adéquate des architectes et une vigilance continue dans leur application.
Les hypothèses de cette recherche se concentrent sur le potentiel des outils d’IA et génératifs à transformer la conception architecturale. Premièrement, ces outils peuvent créer des atmosphères architecturales hautement personnalisées en tenant compte des besoins spécifiques des utilisateurs grâce à l’analyse de données comportementales et environnementales. Deuxièmement, leur intégration améliore la précision et l’efficacité du processus de conception tout en stimulant l’innovation, car ils permettent une exploration rapide de multiples options et automatisent les tâches répétitives. Enfin, bien que des défis éthiques et techniques subsistent, une formation adéquate des architectes et une vigilance continue peuvent surmonter ces obstacles, garantissant une utilisation responsable et bénéfique de ces technologies dans la création de meilleurs espaces de vie.
Pendant la lecture des ouvrages et des études de cas sur les outils d’IA et génératifs, j’ai décidé de me concentrer sur leur impact spécifique sur la conception des atmosphères architecturales. Pour éviter de tomber dans une analyse technocentrée, je propose une structure de recherche plus ciblée sur les aspects sensoriels, émotionnels et pratiques de l’intégration de ces technologies. Chaque partie sera introduite par un état de l’art suivi d’une analyse de cas contemporains mettant l’accent sur les possibilités offertes par les outils d’IA et génératifs. Une dernière analyse permettra d’élaborer une conclusion sur le potentiel réel et les défis de l’intégration de ces technologies dans la pratique architecturale contemporaine.
Ce mémoire est divisé en cinq parties. La première a pour but d’introduire la phase de recherche en exposant le chemin de pensée propre qui m’a amené au choix de ce sujet lié à la conception de l’atmosphère et de la texture dans le logement. Pour donner suite à l’exposition de la problématique sur l’habitat de qualité, un état de la matière est présenté pour spécifier la mesure des termes employés et permettre au lecteur de comprendre les notions qui lui seront présentées par la suite à travers 3 grands points.
Le premier point, consacré aux outils manuels, vise à explorer l’importance historique des techniques traditionnelles de représentation architecturale. Nous y aborderons des méthodes telles que le dessin à la main, les croquis, la photographie et le collage. À travers des analyses de cas spécifiques, cette section mettra en lumière comment ces outils permettent aux architectes de matérialiser leurs visions et de créer des atmosphères distinctes. Nous examinerons également comment ces techniques ont ouvert de nouvelles perspectives créatives.
Le deuxième point se focalise sur les outils digitaux. Cette section présentera un état de l’art des technologies numériques en architecture, notamment les logiciels de modélisation 3D, le BIM et les outils paramétriques. L’analyse se portera sur leur capacité à transformer la pratique architecturale en offrant des visualisations précises, des simulations réalistes et une meilleure coordination entre les différentes disciplines de la conception et de la construction. Des études de cas contemporaines illustreront l’impact de ces outils sur la conception et la réalisation de projets, mettant en évidence leurs avantages et les défis qu’ils posent.
Le troisième point est dédié aux outils génératifs, en particulier ceux basés sur l’intelligence artificielle et les algorithmes génératifs. Il s’agira d’analyser comment ces technologies permettent d’explorer une vaste gamme de solutions de conception, de générer des formes innovantes et de simuler des conditions réelles de lumière et de matériaux. À travers un cas d’étude, la recherche questionnera l’impact de ces outils sur la création des atmosphères architecturales, leur potentiel à redéfinir les pratiques architecturales et les limites qu’ils rencontrent. Cette section visera à offrir une réflexion critique sur le rôle des outils génératifs dans l’architecture contemporaine.
Enfin, la recherche se conclura par une synthèse des principaux enseignements tirés des analyses de cas et des réflexions théoriques. L’intégration équilibrée de ces outils dans la pratique architecturale sera discutée, en abordant les enjeux et les limites associés. Les potentialités des outils génératifs et de l’intelligence artificielle pour ouvrir de nouvelles perspectives créatives et pratiques seront mises en avant. Il sera crucial de souligner la nécessité d’une maîtrise critique et éthique de ces technologies afin de garantir qu’elles sont utilisées de manière responsable et bénéfique pour la création d’espaces de vie enrichissants et durables. La conclusion visera à offrir des recommandations pratiques pour les architectes et les professionnels du bâtiment, tout en proposant des pistes de réflexion pour les recherches futures dans ce domaine en constante évolution.
Mon objectif est de comprendre comment est-il possible d’intégrer une dimension sensible et multisensorielle en utilisant les outils techniques actuels et de demain. Mon mémoire vise à encourager une approche plus sensible de la conception architecturale, où la complexité et la beauté des structures ne sont pas seulement réservées à l’aspect extérieur des bâtiments, mais sont pleinement exploitées pour enrichir l’expérience spatiale de l’habitant.
Ceci implique un examen critique des pratiques actuelles et propose une réflexion sur la manière dont les architectes peuvent mieux utiliser les technologies et techniques paramétriques pour créer des ambiances intérieures qui sont en harmonie avec les façades extérieures, offrant ainsi une expérience plus cohérente et immersive.
Mon mémoire se veut donc être une exploration de la manière dont la dimension sensible et multisensorielle de l’architecture peut être intégrée dans l’utilisation des technologies génératives.
L’atmosphère en architecture
Les outils de représentation de l’architecte
Outils génératifs de l’architecte
1.1 Les origines de la notion d’atmosphère en architecture
La notion d’atmosphère en architecture trouve ses racines dans les écrits anciens, notamment ceux de Vitruve. Dans son traité monumental «De architectura», Vitruve pose les bases de la théorie architecturale occidentale et aborde de manière indirecte ce que l’on pourrait aujourd’hui appeler l’atmosphère architecturale.
Bien qu’il ne parle pas explicitement d’atmosphère dans ses trois principes fondamentaux de l’architecture : firmitas, utilitas et venustas (solidité, utilité et beauté), ses écrits soulignent l’importance de la proportion, de la symétrie et de l’harmonie dans la création d’espaces architecturaux qui résonnent avec les sens humains.
La solidité contribue à une sensation de sécurité et de stabilité, des éléments critiques pour l’atmosphère d’un espace. L’utilité se réfère à la fonctionnalité et à l’adaptabilité des espaces pour leurs usages prévus, répondant parfaitement à ses fonctions, crée une atmosphère de confort et d’efficacité. La beauté, pour Vitruve, est liée à la proportion, la symétrie et l’esthétique. Un espace qui est visuellement harmonieux et esthétiquement plaisant peut susciter des sentiments de plaisir et de tranquillité. (Universaliste.fr . Andréa Palladio 1508-1580)
Les principes vitruviens ont profondément influencé la pensée architecturale de la Renaissance, où des architectes comme Léon Battista Alberti, Borromini, Brunelleschi et Andrea Palladio ont repris et développé ses idées. Ces architectes ont continué à explorer comment les formes, les proportions et les matériaux peuvent affecter la perception et l’expérience des espaces architecturaux.

fig 3 : Les trois principes fondamentaux de l’architecture, De Architectura Vitruve, 2023
Lors de la renaissance, une interprétation nouvelle de ces principes émerge avec le travail de Palladio. Andrea Palladio, architecte italien du XVIe siècle, est reconnu pour avoir développé l’architecture palladienne, caractérisée par l’usage harmonieux des proportions, l’influence de l’architecture classique romaine. Il est surtout célèbre pour ses villas comme la Villa Rotonda. Ses écrits, notamment «Les Quatre Livres de l’Architecture», ont eu une influence durable sur l’architecture occidentale, particulièrement en Europe et en Amérique du Nord.
L’influence de Vitruve sur Andrea Palladio est indéniable et se manifeste à travers l’adhésion aux principes classiques de proportions, de symétrie et d’utilisation des matériaux. En outre, Palladio a su développer une approche unique de la création d’atmosphères architecturales en utilisant la lumière, les proportions harmonieuses, et surtout l’interaction avec le paysage, sous forme de cadrages pour enrichir l’expérience sensorielle et émotionnelle des espaces. (Universaliste.fr. Andréa Palladio 1508-1580)
En effet, Andrea Palladio, bien que non théorisée par Palladio, émerge clairement de son œuvre à travers l’utilisation de la lumière, de l’espace, des proportions et de la relation avec le paysage. Palladio utilisait la lumière naturelle de manière stratégique pour créer des ambiances variées au sein de ses bâtiments. La disposition des fenêtres et des ouvertures était soigneusement calculée pour maximiser l’entrée de lumière tout en créant des jeux d’ombre qui ajoutaient de la profondeur et du dynamisme aux espaces intérieurs.
La Villa Rotonda est un exemple emblématique de l’utilisation de la lumière chez Palladio. Chaque façade de la villa est orientée vers un point cardinal, permettant ainsi à la lumière naturelle de pénétrer dans la villa de différentes manières au cours de la journée. L’un des aspects les plus marquants de l’architecture de Palladio est son utilisation des proportions harmoniques, inspirées des principes vitruviens. Ces proportions créent non seulement une esthétique plaisante, mais elles contribuent aussi à une sensation de bien-être et de sérénité dans les espaces qu’il conçoit. Chaque élément architectural est en harmonie avec les autres, créant une expérience visuelle cohérente et agréable.
Andrea Palladio, à travers son œuvre, démontre une compréhension profonde de l’impact sensoriel et émotionnel de l’architecture domestique. Ses bâtiments sont des exemples parfaits de la manière dont l’architecture peut créer des atmosphères spécifiques et enrichir l’expérience humaine. En intégrant les principes de Vitruve avec ses propres innovations, Palladio a établi des standards qui continuent d’inspirer et de guider les architectes contemporains dans la création des atmosphères d’aujourd’hui.
La Villa Rotonda, dans ses proportions «parfaites» illustre bien l’idée de la «beauté» Andréa Palladio, 1566, Archweb.com

Dans le discours architectural, les termes ‘matérialité’ et ‘atmosphère’ se croisent souvent, mais évoquent des dimensions distinctes de l’expérience spatiale. La matérialité se réfère aux éléments tangibles utilisés dans la construction et la finition des espaces des matériaux tels que le bois, l’acier, le verre et le béton. L’atmosphère, en revanche, englobe les qualités intangibles et subjectives perçues par les occupants, comment un espace se ressent, ce qui peut inclure les effets de la lumière, du son et des textures des matériaux sur les émotions et les comportements humains. (Canepa . 2019)
La matérialité en architecture concerne les substances physiques à partir desquelles les bâtiments sont construits. Elle implique une considération approfondie des propriétés et des potentiels des matériaux comment ils peuvent être manipulés, comment ils interagissent avec les facteurs environnementaux, et comment ils contribuent structurellement et esthétiquement aux bâtiments.
fig 5 : L’atmosphère au centre du projet architectural, projet très simple, mais qui ne se fait pas l’excuse de la qualité spatiale, PROJET : Marina Tabassum Architects, Biat ur Rouf Mosque, Dhaka, Bangladesh, 2012.

Pourtant l’atmosphère va au-delà des propriétés matérielles pour englober l’impact émotionnel et psychologique d’un espace. Il s’agit de la qualité et du caractère perçus d’un environnement, façonnés par un jeu de lumière, d’ombre, de texture et de couleur, ainsi que par la configuration spatiale elle-même. Frank Lloyd Wright a retravaillé la notion d’atmosphère en architecture au début du 20e siècle, introduisant une définition nouvelle et nuancée de cette idée. Pour Wright, l’atmosphère d’un bâtiment n’était pas seulement une question de forme ou de fonction, mais une expérience émotionnelle et sensorielle unitaire. Il croyait fermement à l’intégration harmonieuse de l’architecture dans son environnement naturel, une idée incarnée dans des œuvres emblématiques telles que Fallingwater et la Robie House. Wright utilisait des matériaux locaux, des fenêtres panoramiques, et des plans ouverts pour créer des espaces inondés de lumière naturelle et en continuité avec la nature environnante. (Pfeiffer Brooks, Peter Gössel 2002)
Ses concepts d’architecture organique cherchaient à établir une symbiose entre l’édifice et son site, favorisant une atmosphère d’harmonie et de bien-être total. Dans ses ouvrages, tels que «The Natural House» et son autobiographie, Wright développe ses idées sur la matérialité, la lumière, et l’espace, insistant sur l’importance de concevoir des bâtiments qui enrichissent l’expérience émotionnelle des occupants. Cette approche novatrice a redéfini l’architecture en mettant l’accent sur la création d’environnements vivants et harmonieux, transformant ainsi la manière dont les architectes contemporains envisagent et conçoivent les atmosphères architecturales.
Bien que la matérialité et l’atmosphère puissent être considérées séparément, elles sont profondément interconnectées dans la pratique architecturale. Le choix des matériaux influence directement l’atmosphère d’un espace. Par exemple, l’utilisation de grands panneaux de verre peut créer un sentiment d’ouverture et de connexion avec l’extérieur, influençant ainsi l’atmosphère du bâtiment en termes de transparence et de légèreté.
1.1.2 Recherche contemporaine de l’atmosphère
La notion d’atmosphère a été revue récemment par plusieurs grandes figures de l’architecture ayant essayé d’apporter leur propre définition. En 2022 Elisabetta Canepa, dans son livre «Architecture is Atmosphere», amène une analyse riche et nuancée sur le concept d’atmosphère en architecture.
Elisabetta Canepa (MS.Eng., Ph.D.) est une architecte et chercheuse originaire de Gênes, en Italie. Elle est actuellement boursière postdoctorale Marie Curie de l’Union européenne, lauréate de l’appel à candidatures 2020. Ses travaux de recherche se concentrent sur la connexion hybride entre l’architecture et les neurosciences cognitives, en analysant des sujets tels que les dynamiques atmosphériques, la nature émotionnelle de l’expérience architecturale, la théorie de l’incarnation, le phénomène empathique entre l’homme et l’espace, ainsi que l’expérimentation en réalité virtuelle. Son approche se concentre sur l’interaction complexe entre les corps, les espaces, et les émotions, offrant ainsi une vision nouvelle et holistique de l’atmosphère architecturale. (Canepa . 2019)

fig 6 : Elisabetta Canepa, Reseshgate, 2022
L’autrice considère l’atmosphère comme un phénomène multidimensionnel qui émergent de l’interaction dynamique entre les occupants d’un espace, la configuration physique de cet espace, et les émotions que cet environnement suscite. Elle met en avant l’idée que l’architecture ne se limite pas à la simple construction de structures physiques, mais qu’elle englobe également la création d’expériences sensorielles et émotionnelles.
Elle souligne l’importance des perceptions sensorielles dans la formation de l’atmosphère. Elle explique que les matériaux, la lumière, les sons et même les odeurs jouent un rôle crucial dans la manière dont un espace est perçu et vécu. Citation : «L’atmosphère d’un espace est une somme de ses qualités sensorielles, qui influencent directement notre bien-être émotionnel et physique.»
Le livre explore également comment les espaces peuvent évoquer des réponses empathiques. Par exemple, un espace bien conçu peut induire des sentiments de confort, de sécurité, ou de stimulation. Citation : «L’architecture a le pouvoir d’évoquer des émotions profondes, en créant des environnements qui résonnent avec nos états d’âme intérieurs.»
L’architecte Canepa examine comment le mouvement du corps à travers un espace contribue à l’atmosphère de ce dernier. Elle insiste sur le fait que l’architecture doit prendre en compte le flux et le rythme du déplacement humain. Citation : «Le parcours d’un individu à travers un espace architectural est une danse silencieuse qui influence et est influencée par l’atmosphère ambiante.»
1.1.3
Les critères de la dimension sensorielle en architecture se concentrent sur les éléments qui influencent directement les perceptions sensorielles des occupants dans un espace. Cette dimension prend en compte plusieurs facteurs clés :
La lumière naturelle et artificielle joue un rôle crucial dans la perception de l’espace. Les variations de lumière peuvent transformer l’ambiance d’une pièce, affectant son confort et sa fonctionnalité. Par exemple, Peter Zumthor met en avant l’importance de la lumière dans la création d’ambiances intimes et mémorables, comme observé dans ses Thermes de Vals. (Divisare.com, 2018. Peter Zumthor)
Les matériaux utilisés dans la construction d’un espace influencent fortement son atmosphère. Les textures, les couleurs, et les propriétés tactiles des matériaux contribuent à la création d’une ambiance spécifique. Zumthor et Elisabetta Canepa soulignent tous deux l’importance de la matérialité pour évoquer des sensations et des émotions particulières. L’acoustique d’un espace affecte aussi sa dimension sensorielle. Les matériaux et la configuration de l’espace peuvent amplifier ou réduire les sons, influençant ainsi l’expérience auditive des occupants. Par exemple, les projets de Grégoire Chekhov prennent souvent en compte les propriétés sonores des matériaux et leur impact sur l’ambiance générale. La perception de la température dans un espace contribue également à son atmosphère. Les choix de matériaux et les solutions de chauffage/refroidissement peuvent créer des sensations de chaleur ou de fraîcheur, influençant ainsi le confort des utilisateurs.
La manière dont les occupants interagissent avec l’espace et les usages prévus influencent également l’atmosphère. Un espace conçu pour la détente aura des critères sensoriels différents de ceux d’un espace de travail. En intégrant ces critères sensoriels dans la conception architecturale, les architectes peuvent créer des espaces qui non seulement répondent à des besoins fonctionnels, mais qui enrichissent également l’expérience sensorielle et émotionnelle des utilisateurs.


fig 8 : Faire une ambiance, creating an atmosphere : actes du colloque international Grenoble 10-12 septembre 2008, publié en 2010
1.2
Dans son livre, ses idées aux contributions de penseurs et d’architectes antérieurs comme Peter Zumthor et Juhani Pallasmaa, Canepa montre comment la compréhension de l’atmosphère a évolué. Elle souligne que, tandis que les perspectives classiques mettaient l’accent sur les proportions et la symétrie, les approches actuelles incluent des aspects plus intangibles et sensoriels.
Canepa intègre des concepts de psychologie environnementale, de phénoménologie, et de neurosciences pour enrichir sa définition de l’atmosphère architecturale. Elle démontre que la conception architecturale contemporaine doit aller au-delà des considérations purement fonctionnelles et esthétiques pour inclure des éléments qui touchent directement à l’expérience humaine et émotionnelle.
La perspective d’Elisabetta Canepa sur l’atmosphère architecturale représente une évolution significative dans la manière dont nous comprenons et concevons les espaces. En se concentrant sur l’interaction entre le corps, l’espace et l’émotion, Canepa nous invite à envisager l’architecture non seulement comme un art de la construction, mais aussi comme une science de l’expérience humaine. Son travail souligne l’importance de créer des espaces qui résonnent profondément avec leurs occupants, enrichissant ainsi notre compréhension de ce que signifie vraiment l’architecture atmosphérique. (Canepa, 2019)
1.2.1 Peter Zumthor
Peter Zumthor, architecte suisse renommé pour son approche minimaliste et sensible, lauréat du Prix Pritzker en 2009, est reconnu pour son approche unique de l’architecture, où l’atmosphère joue un rôle central. Ses écrits et ses projets révèlent une compréhension profonde de la manière dont les éléments architecturaux peuvent créer des expériences émotionnelles et sensorielles. Zumthor accorde une grande importance aux matériaux utilisés dans ses constructions. Pour lui, la matérialité ne se limite pas à une simple sélection esthétique ; elle est essentielle à la création d’une atmosphère. Les matériaux sont choisis pour leurs qualités sensorielles, leur texture, leur capacité à vieillir et à changer avec le temps. La lumière est un autre élément crucial dans l’œuvre de l’architecte. Il utilise la lumière naturelle de manière à créer des ambiances spécifiques, en jouant avec les ombres et les reflets pour enrichir l’expérience spatiale.
Pour lui, l’espace est vécu à travers le mouvement et la présence du corps. Il conçoit ses espaces pour qu’ils soient explorés, sentis, et expérimentés de manière intime et personnelle. Les Thermes de Vals, en Suisse, sont l’un des projets les plus emblématiques de Zumthor. Construites avec du quartzite local, les thermes exploitent la matérialité de la pierre pour créer une atmosphère de sérénité et de détente. La lumière naturelle pénètre dans l’espace à travers des fentes et des ouvertures stratégiquement placées, créant un jeu de lumière et d’ombre qui change au fil de la journée. (Zumthor, 2006)
Peter Zumthor sur l’atmosphère architecturale met en évidence l’importance de la matérialité, de la lumière, et de l’espace dans la création d’expériences émotionnelles et sensorielles. À travers ses projets emblématiques comme les Thermes de Vals et la chapelle de Saint-Bénédict, il démontre comment une attention méticuleuse aux détails et une compréhension profonde des matériaux et de la lumière peuvent transformer des espaces en expériences atmosphériques mémorables.

Grégoire Chelkoff, bien qu’il soit moins connu que d’autres architectes contemporains, a apporté des perspectives uniques et innovantes sur la notion d’atmosphère en architecture. Son approche se caractérise par une profonde compréhension de l’interaction entre les éléments architecturaux et les expériences humaines. (Chelkoff, 2022)

Grégoire Chelkoff est un architecte et chercheur connu pour son exploration des atmosphères architecturales, mettant en avant la temporalité, le changement et le contexte culturel. Son travail se concentre sur la manière dont les espaces influencent les perceptions sensorielles et émotionnelles des usagers, intégrant des éléments comme la lumière, les matériaux et les volumes. Il utilise également des outils de conception innovants pour développer ces concepts dans la pratique contemporaine. Ses contributions ont un impact significatif sur la manière dont les architectes créent des expériences immersives et dynamiques dans les espaces construits.
Le chercheur insiste sur l’importance de l’expérience sensorielle globale dans la conception architecturale. Pour lui, l’atmosphère ne peut être appréhendée qu’en tenant compte de l’ensemble des sensations perçues par l’utilisateur : la vue, l’ouïe, l’odorat, le toucher et même le goût. Il met également l’accent sur la dimension temporelle de l’atmosphère. Il explore comment les espaces évoluent et changent avec le temps, en réponse aux variations de la lumière, aux conditions météorologiques et aux usages humains. Pour lui, l’atmosphère est intrinsèquement liée au contexte culturel et géographique. Il croit que chaque lieu à une atmosphère unique qui doit être respectée et mise en valeur par l’architecture.
À travers ses recherches il démontre comment une architecture bien pensée peut créer des atmosphères riches et dynamiques, profondément connectées aux sensations humaines et aux cycles naturels. Ses travaux enrichissent le discours contemporain sur l’atmosphère en architecture, offrant des solutions qui sont à la fois poétiques et pragmatiques. Pour élaborer une définition nuancée et composite de l’atmosphère en architecture, il est essentiel de comparer les perspectives historiques et contemporaines.

En perspectives contemporaines, Elisabetta Canepa met l’accent sur les interactions entre corps, espace, et émotion, en soulignant l’importance des sensations multisensorielles pour créer une atmosphère immersive. En comparant ces perspectives des architectes contemporains, il est possible de proposer une définition composite de l’atmosphère en architecture comme une synthèse de l’harmonie matérielle, de l’interaction sensorielle, et de l’adaptation contextuelle et temporelle.
La notion d’atmosphère en architecture trouve ses racines dans des concepts historiques et s’est développée au fil du temps, intégrant des perspectives variées. Les architectes classiques et contemporains mettent tous l’accent sur l’importance des sensations et de la perception sensorielle dans la création d’une atmosphère. L’utilisation de la lumière et des matériaux est un thème récurrent, essentiel pour façonner l’ambiance d’un espace. Les architectes s’accordent également sur la capacité de l’architecture à provoquer des émotions.
Cependant, il existe des divergences notables entre les perspectives historiques et contemporaines. Les architectes contemporains comme Grégoire Chekhov soulignent l’importance du changement et de l’évolution temporelle, une dimension moins présente dans les écrits classiques. Ils insistent également sur l’influence du contexte culturel et géographique, adoptant une approche plus contextuelle de la conception architecturale. En outre, les architectes contemporains privilégient une approche multisensorielle, tandis que les architectes classiques se concentraient principalement sur la vue et l’esthétique. (Canepa, 2019)

fig 12 : Generators of Architectural Atmosphere, Interface 3, 2022, Reserchgate,
Ainsi, selon les définitions des architectes contemporains, on peut donc admettre que l’atmosphère en architecture peut être définie comme l’ensemble des qualités perceptuelles et émotionnelles d’un espace, résultant de l’interaction harmonieuse entre lumière, matériaux, volumes et contexte environnemental et culturel. Elle englobe à la fois les aspects physiques et immatériels de l’architecture, influençant profondément la perception sensorielle et émotionnelle des occupants. L’atmosphère est dynamique et évolutive, changeant en fonction du temps et des conditions environnantes, tout en restant ancrée dans une expérience sensorielle globale et multisensorielle. Cette définition composite intègre les perspectives historiques et contemporaines, offrant une vision holistique et nuancée de l’atmosphère architecturale. Elle met en lumière l’importance des sensations, de la temporalité et du contexte culturel, tout en soulignant l’évolution du concept au fil du temps.
Les outils manuels ont constitué les fondations de la pratique architecturale depuis l’Antiquité. Ces outils, qui incluent le dessin à la main, les esquisses, les maquettes physiques et les collages, ont permis aux architectes de matérialiser leurs visions et de communiquer leurs concepts avant l’ère numérique. Ils ont toujours été essentiels pour les architectes dans leur processus créatif. Le dessin à la main permet une exploration intuitive des formes et des volumes. Il offre une liberté artistique et une connexion directe avec le matériau de conception. Les esquisses rapides capturent les premières idées et les concepts embryonnaires, permettant de visualiser et de modifier les éléments de conception en temps réel.
Les maquettes physiques, quant à elles, jouent un rôle crucial dans la matérialisation des idées. Elles permettent d’expérimenter avec les proportions, les matériaux et la lumière, offrant ainsi une compréhension plus profonde de l’espace. Des architectes comme Frank Lloyd Wright utilisaient des maquettes pour tester les effets de la lumière naturelle et artificielle, anticipant ainsi l’atmosphère des espaces avant leur construction. (Delvalet. Thimonier, 2019)
Les outils manuels ont un impact significatif sur la création des atmosphères architecturales. Le dessin à la main et les maquettes permettent de capturer les nuances subtiles de la lumière, des ombres et des textures, qui sont essentielles pour définir l’atmosphère d’un lieu. Ces techniques offrent une approche tactile et visuelle de la conception, favorisant une meilleure anticipation des sensations et des émotions que l’espace suscitera chez ses occupants.
En utilisant ces outils, les architectes peuvent expérimenter avec différents matériaux et configurations spatiales, optimisant ainsi l’expérience sensorielle globale. Par exemple, l’utilisation de la lumière dans les dessins et les maquettes permet de visualiser comment elle interagira avec les matériaux et les volumes, influençant ainsi l’ambiance générale de l’espace.
Il ressort que les outils manuels, bien que souvent éclipsés par les technologies numériques modernes, restent fondamentaux dans la pratique architecturale. Ils permettent une exploration intuitive et tactile des concepts, capturant les nuances essentielles pour la création d’atmosphères immersives et émotionnelles. En comprenant l’histoire et la pratique de ces outils, nous pouvons mieux apprécier leur impact sur la conception architecturale et l’expérience spatiale.

fig 13 : Outils de l’architecte, Dessins d’architecture médiévaux, 2019, Strasbourg, Musée de l’Œuvre NotreDame
1.3.1 Critères d’appréciation des atmosphères contemporaines
Pour établir un cadre clair, les éléments à inclure sont ceux qui influencent directement les sens des occupants, suscitent des réactions émotionnelles mesurables ou observables, et modifient la perception de l’espace par leur matérialité et leur forme. En revanche, les éléments purement fonctionnels sans impact perceptuel ou émotionnel, les décorations temporaires non permanentes, et les facteurs externes indépendants de la conception architecturale, comme les conditions météorologiques imprévisibles, doivent être exclus du cadre de l’atmosphère en architecture.
Cette approche permet de clarifier le concept d’atmosphère en architecture, en définissant ses limites et en orientant les recherches futures vers une compréhension plus approfondie et intégrée de l’atmosphère dans les espaces construits.
Les atmosphères architecturales ne sont pas figées ; elles évoluent en fonction des mouvements artistiques, des contextes sociaux et des avancées technologiques de chaque époque. Les caractéristiques d’une époque donnée influencent directement la manière dont les architectes conçoivent et perçoivent les espaces. Par exemple, les périodes de modernisme, de postmodernisme et de durabilité ont chacune apporté des approches distinctes à la création d’atmosphères.
1.3.2 L’enjeu de la maîtrise du processus
Alors que nous progressons dans l’ère numérique, il est crucial de comprendre comment les nouveaux outils de représentation influencent la conception et la perception des atmosphères architecturales. La transition du dessin manuel aux outils numériques, tels que la CAO, la modélisation 3D, et la réalité virtuelle, a transformé la pratique architecturale de manière significative. Ces technologies offrent des moyens plus précis et immersifs pour représenter les atmosphères, permettant aux architectes de simuler des expériences sensorielles avant même la construction physique.
A l’ère actuelle, nous assistons à une transformation radicale des outils de conception architecturale. Les représentations numériques, telles que les modélisations 3D et les simulations en réalité virtuelle, permettent aux architectes d’expérimenter et de visualiser des atmosphères de manière plus réaliste et immersive avant même la construction. Ce changement a fondamentalement modifié le processus de conception : autrefois, un projet se déroulait d’abord sur un plan, puis se concrétisait en un bâtiment.
Aujourd’hui, le processus inclut des étapes intermédiaires cruciales comme la modélisation 3D, les itérations via l’intelligence artificielle, les retours du public et, enfin, la construction de l’espace réel.
L’importance croissante de la représentation numérique signifie que la création de l’atmosphère devient un projet en soi. Les architectes ne se contentent plus de dessiner ; ils doivent également créer des rendus visuels convaincants qui transmettent l’atmosphère souhaitée et permettent une évaluation avant la réalisation. Cette nouvelle dynamique pousse à une exploration approfondie des impacts des outils de représentation sur les atmosphères architecturales. C’est pourquoi il est essentiel de diriger les recherches futures vers l’analyse de ces outils numériques et leur influence sur la conception et la perception des atmosphères. (Lucan. 2021. Habiter)
En entrant dans ce nouveau contexte digital, il devient impératif de comprendre comment ces technologies transforment les espaces que nous habitons et la manière dont nous les percevons. Les recherches futures doivent se pencher sur les évolutions des atmosphères en analysant les outils de représentation, du dessin à la main aux simulations avancées, pour découvrir comment ces innovations façonnent notre expérience de l’espace architectural afin de mieux concevoir des espaces répondant aux besoins sensoriels et émotionnels des utilisateurs.
La maîtrise des outils est essentielle pour atteindre les objectifs des atmosphères souhaités en architecture. Les outils de conception et les techniques de construction ne sont pas seulement des moyens de réalisation pratique ; ils influencent directement la qualité sensorielle et émotionnelle des espaces créés. Une compréhension approfondie et une utilisation habile de ces outils permettent aux architectes de manipuler avec précision les éléments qui contribuent à l’atmosphère d’un espace, telles que la lumière, les matériaux, et les volumes.
Les outils de modélisation numérique, comme le BIM et les rendus photoréalistes, permettent aux architectes de visualiser et d’ajuster les effets atmosphériques en phase de conception. Ils facilitent la simulation des conditions réelles de lumière et de matériaux, offrant ainsi une prévision plus précise de l’ambiance finale. Cependant, la maîtrise de ces technologies nécessite des compétences spécialisées et une compréhension approfondie des interactions entre les différents éléments de conception.
L’innovation technologique en architecture présente à la fois des défis et des opportunités pour la création d’ambiances cohérentes et immersives. Les avancées en matière de réalité virtuelle (VR) et de réalité augmentée (AR) permettent aux architectes et aux clients de vivre une expérience immersive des espaces avant même leur construction. Ces technologies offrent une opportunité unique de tester et d’affiner les aspects sensoriels et émotionnels d’un projet en temps réel. Cependant, l’accès à ces technologies peut être coûteux et nécessite un investissement en temps pour acquérir les compétences nécessaires.
Pour créer des ambiances cohérentes et immersives, il est crucial que les architectes maîtrisent non seulement les outils de conception, mais aussi les techniques de construction. Une coordination étroite entre la conception et la construction assure que les intentions atmosphériques initiales sont maintenues tout au long du processus de réalisation. Cela implique une communication efficace entre les architectes, les ingénieurs, et les entrepreneurs pour garantir que chaque détail est exécuté selon la vision prévue.
Les défis incluent la gestion des contraintes techniques et budgétaires tout en préservant l’intégrité de la conception. Les opportunités résident dans l’utilisation créative des technologies et des matériaux pour surmonter ces contraintes et améliorer la qualité sensorielle et émotionnelle des espaces. En fin de compte, la maîtrise du processus et des techniques constructives est un facteur clé pour atteindre les objectifs atmosphériques souhaités, créant des espaces qui sont non seulement fonctionnels, mais aussi profondément engageants sur le plan sensoriel et émotionnel.
La maîtrise des outils de représentation pousse les architectes à une compréhension plus profonde et holistique de leurs projets. Ils ne se contentent plus de créer des formes et des structures, mais intègrent aussi les dimensions sensorielle et émotionnelle dès les premières étapes de la conception. Les simulations de lumière naturelle, les analyses acoustiques et les visualisations immersives en réalité virtuelle permettent une approche sensible et réfléchie de l’espace, où chaque élément est conçu pour améliorer le bien-être des occupants.
En outre, cette maîtrise technique ouvre la porte à une plus grande créativité. En connaissant les possibilités et les limites des outils de représentation, les architectes peuvent expérimenter avec de nouvelles formes, matériaux et configurations spatiales. Ils peuvent repousser les frontières de l’architecture traditionnelle et proposer des solutions innovantes et audacieuses, tout en gardant un contrôle rigoureux sur la réalisation pratique de leurs idées.
La justesse dans la conception, rendue possible par la maîtrise des outils de représentation, repose aussi sur la capacité des architectes à communiquer efficacement leurs visions. Les visualisations détaillées et réalistes facilitent le dialogue avec les clients, les ingénieurs et les entrepreneurs, assurant que chaque partie prenante comprend et partage la même vision du projet. Cela réduit les malentendus et les modifications coûteuses en cours de construction,
L’évolution des atmosphères architecturales ne peut être pleinement comprise sans examiner les outils de représentation qui permettent aux architectes de concevoir et de visualiser leurs projets en amont. Historiquement, les architectes ont utilisé des techniques de dessin manuel pour donner vie à leurs visions, créant ainsi des atmosphères par l’usage de la lumière, des matériaux et des formes. Avec l’arrivée des outils digitaux, cette capacité de représentation a été fondamentalement transformée, offrant des possibilités de conception, de visualisation et de simulation sans précédent.
Les outils manuels ont constitué les fondations de la pratique architecturale depuis l’Antiquité. Ces outils, qui incluent le dessin à la main, les esquisses, les maquettes physiques et les collages, ont permis aux architectes de matérialiser leurs visions et de communiquer leurs concepts avant l’ère numérique. Comprendre l’histoire et la pratique de ces outils est crucial pour saisir leur impact sur la conception architecturale et la création d’atmosphères.
L’histoire de l’architecture est profondément liée à l’utilisation des outils de représentation manuels. Dès l’Antiquité, les architectes utilisaient des techniques de dessin à main levée et de modélisation physique pour conceptualiser et communiquer leurs idées. Des figures emblématiques comme Vitruve ont posé les bases de l’utilisation de ces outils, tandis que des architectes de la Renaissance comme MichelAnge et Brunelleschi ont repoussé les limites de ce que l’on pouvait accomplir avec des dessins et des maquettes. L’utilisation de la lumière et des matériaux par ces architectes a permis de créer des atmosphères uniques qui ont marqué leur époque.
Les outils manuels ont toujours été essentiels pour les architectes dans leur processus créatif. Le dessin à la main permet une exploration intuitive des formes et des volumes. Il offre une liberté artistique et une connexion directe avec le matériau de conception. Les esquisses rapides capturent les premières idées et les concepts embryonnaires, permettant de visualiser et de modifier les éléments de conception.

fig 14 : Outils manuels de l’architecte, Dessins d’architecture médiévaux, 2019, Strasbourg, Musée de l’Œuvre Notre-Dame
Les outils manuels en architecture englobent une vaste gamme d’instruments et de techniques utilisés par les architectes pour concevoir, dessiner et modéliser leurs projets. Ces outils incluent, mais ne se limitent pas à, les compas, les règles, les équerres, les crayons, les papiers à dessin, les plumes à encre, les pinceaux et divers autres instruments de dessin. De plus, les maquettes physiques, réalisées à l’aide de matériaux comme le bois, le carton, et les métaux, sont également des outils manuels cruciaux pour la visualisation des projets architecturaux.
Les perspectives, développées pendant la Renaissance au XVe siècle, sont des techniques de dessin qui représentent des objets en trois dimensions sur une surface bidimensionnelle. Cette méthode utilise des lignes convergentes pour créer l’illusion de profondeur et de volume. En architecture, les perspectives sont cruciales pour visualiser l’effet spatial et l’ambiance d’un projet avant sa réalisation. Les lignes convergentes se dirigent vers un ou plusieurs points de fuite sur l’horizon. Ils servent à créer l’illusion de profondeur et de guide pour toutes les lignes parallèles dans la réalité. Lorsque ces lignes convergent, elles dirigent l’œil du spectateur vers un point spécifique, simulant ainsi la manière dont nous percevons la distance dans le monde réel. (Ching, 2003)
Ces lignes aident à établir les proportions relatives et les dimensions des objets à différentes distances du spectateur sur un plan. Ce plan est la «toile» sur laquelle la perspective est appliquée. C’est ici que l’illusion tridimensionnelle prend vie, permettant de visualiser des espaces complexes sur une surface plane. (Mazzola. 2006)
Les perspectives permettent aux architectes de simuler la manière dont la lumière et l’ombre joueront dans un espace, influençant ainsi l’atmosphère. Les perspectives aident également à comprendre la volumétrie et les proportions des différents éléments d’un projet. En visualisant les hauteurs, les largeurs et les profondeurs de chaque composant architectural, les concepteurs peuvent s’assurer que tous les éléments s’harmonisent bien entre eux, facilitant ainsi la création de lieux bien proportionnés et esthétiquement agréables.

L’utilisation des perspectives a révolutionné la conception architecturale en offrant une méthode visuelle claire pour représenter et ajuster les idées spatiales avant la construction. En anticipant comment les espaces seront perçus, les architectes peuvent créer des environnements qui répondent non seulement aux exigences fonctionnelles, mais aussi aux aspirations esthétiques et sensibles, assurant ainsi une expérience spatiale enrichissante et harmonieuse. (Mazzola. 2006)
L’ombrage est aussi un élément clé, il est utilisé pour donner du relief et de la texture aux dessins architecturaux. En jouant avec les nuances et les intensités de l’ombre, les architectes peuvent simuler l’impact de la lumière sur les surfaces, mettant en évidence les détails et les formes des structures. Les grilles servent de guide pour maintenir les proportions et les alignements corrects dans les dessins. Elles aident à diviser l’espace de manière cohérente, facilitant ainsi le processus de mise en page et de dimensionnement des différents éléments architecturaux. (Ching, 2010)
Les axonométries sont des techniques de représentation graphique qui permettent de dessiner des objets en trois dimensions sur un plan bidimensionnel. Les objets sont dessinés de manière à ce que les axes x, y, et z restent proportionnels et non déformés, ils restent parallèles, offrant ainsi une vue sans distorsion de l’objet, permettant de conserver les proportions relatives des différentes dimensions.
Isométrique : Les trois axes (x, y, z) sont inclinés à des angles égaux (120°) par rapport à la surface du dessin. C’est la forme la plus courante d’axonométrie, souvent utilisée pour sa simplicité et sa clarté. Dimétrique : Deux des axes sont inclinés à des angles égaux, tandis que le troisième axe est différent. Cette méthode est moins courante, mais peut être utile pour représenter des objets où deux dimensions sont plus importantes que la troisième. Trimétrique : Chacun des trois axes est incliné à un angle différent. Cette méthode est rarement utilisée en raison de sa complexité, mais elle peut offrir une représentation très précise des objets.(Ching, 2010)

Cette méthode est particulièrement utile pour représenter les interrelations entre différents niveaux d’un bâtiment, comme les étages d’un immeuble ou les différentes sections d’une maison. Les architectes peuvent explorer des configurations spatiales complexes et tester diverses options de design avant de les mettre en œuvre. Elle permet également de visualiser l’impact des matériaux et des finitions sur l’espace, aidant ainsi à prévoir comment ces éléments contribueront à l’atmosphère générale du projet. Cela permet d’assurer que chaque détail est soigneusement considéré et que l’espace final répondra aux attentes esthétiques et fonctionnelles.
La modélisation physique est une autre technique cruciale dans l’architecture, utilisée pour la visualisation et la compréhension des projets en trois dimensions. Les modèles physiques permettent aux architectes de tester des concepts, d’explorer des formes et de communiquer leurs idées. Cela leur permet de développer une compréhension approfondie de leurs projets, tout en communiquant efficacement leurs idées à travers des représentations visuelles claires et détaillées.
Les maquettes physiques ont toujours occupé une place prépondérante dans l’architecture pour leur capacité unique à transformer des concepts abstraits en représentations tangibles. Avant l’ère numérique, ces maquettes étaient souvent le principal moyen pour les architectes d’explorer et de vérifier les proportions, les volumes, et les relations spatiales des projets en cours de conception. (Ching, 2010)
Les maquettes physiques ne se limitent pas à la visualisation des structures ; elles sont également cruciales pour la création d’atmosphères architecturales. En manipulant différents matériaux et textures dans une maquette, les architectes peuvent expérimenter l’effet de la lumière, de l’ombre et des couleurs sur l’espace. Cela leur permet de prévoir comment

17: Guggenheim, F.L. Wright. Photographie personnelle tirée du livre : Pfeiffer, Bruce Brooks, and Peter Gössel. 2002. Frank Lloyd Wright Taschen
ces éléments interagiront dans le bâtiment fini, et d’ajuster les conceptions pour atteindre l’atmosphère souhaitée. Les maquettes peuvent inclure des détails précis tels que les revêtements de sol, les textures murales et les éléments de mobilier, offrant une représentation complète de l’espace. En combinant des éléments réels et imaginaires, ces représentations offraient un aperçu des possibilités infinies de l’architecture, bien avant que les outils numériques ne deviennent la norme. Les matériaux utilisés dans une maquette doivent refléter les qualités des matériaux finaux utilisés dans la construction réelle. Par exemple, une maquette en bois peut donner une idée des textures et de la chaleur que ce matériau apporte à l’espace final.
Parfois, les matériaux de construction réels peuvent être utilisés à une échelle réduite pour renforcer la fidélité de la maquette. Par exemple, utiliser du béton pour couler de petites structures permet de tester ses propriétés et son esthétique à une échelle plus petite. Par exemple le béton peut être coulé en petites quantités pour créer des maquettes détaillées de structures bétonnées. Cela permet de tester les textures, les couleurs et les finitions possibles. Cela pousse à l’innovation et à la créativité, par exemple, l’utilisation des morceaux de verre pour simuler des façades vitrées ou des résines pour représenter des éléments translucides qui permettent de tester différentes approches et différents effets visuels.
De fait la compréhension des matériaux que permettent les maquettes physiques est fondamentale pour le succès du processus de conception architecturale, car elle permet une représentation précise et fidèle des projets.
2.1.3 La photographie photomontage collages
La photographie, devenue courante en architecture au début du XXe siècle, permet de capturer des images d’espaces existants ou de maquettes. Elle joue un rôle essentiel dans l’analyse et la communication des idées architecturales. Les photographies sont prises sous différents angles pour montrer des perspectives variées d’un espace ou d’une maquette. Cela permet de documenter et d’analyser les éléments clés de la conception architecturale, tels que la lumière, les ombres, et les proportions.
La photographie permet d’étudier l’impact de la lumière naturelle et artificielle, des ombres, et des couleurs sur un espace. En capturant des moments spécifiques de la journée, les photographies révèlent comment ces éléments influencent l’atmosphère d’un lieu. La photographie aide à documenter et à analyser les qualités atmosphériques des espaces réels. Elle permet de capturer des instants précis et de comprendre comment la lumière naturelle et artificielle affecte l’ambiance d’un lieu. En visualisant ces effets, les architectes peuvent ajuster leurs conceptions pour créer des atmosphères désirées. (Scheib, 2021)
Le photomontage et les collages, utilisés depuis les années 1920, combinent des images et des éléments graphiques pour créer des représentations visuelles composites. Ils offrent une approche créative pour explorer et communiquer des concepts architecturaux. Le photomontage combine des photographies avec d’autres éléments graphiques pour créer des images nouvelles et imaginatives. Cette technique permet d’expérimenter avec des idées architecturales en superposant des éléments réels et fictifs.

18 : Chicago Auditorium Building, exterior from Michigan Avenue, 1989, Wikipédia

fig 19 : Superstudio, Vita (Supersuperficie), 19711972, Archives, Centre Pompidou
Le photomontage et les collages permettent aux architectes d’explorer des idées innovantes et de visualiser des espaces imaginaires. Ces techniques facilitent la communication des concepts aux clients et aux parties prenantes, en montrant comment différents éléments peuvent se combiner pour créer des atmosphères spécifiques. Elles offrent également la possibilité d’expérimenter avec des matériaux, des textures et des configurations spatiales avant la réalisation physique, permettant ainsi d’affiner et d’améliorer le design final.
Les collages assemblent divers matériaux graphiques, tels que des dessins, des photos et des textures, pour créer des compositions visuelles. Les architectes utilisent cette technique pour explorer et présenter des concepts de manière créative et visuellement engageante. Les collages sont une technique artistique et architecturale qui consiste à assembler divers matériaux graphiques, tels que des photographies, des dessins, et des textures, pour créer des compositions visuelles. Utilisés depuis les années 1920, les collages permettent aux architectes d’explorer des idées innovantes et de présenter des concepts de manière créative.
Aujourd’hui, les outils numériques ont évolué pour inclure des logiciels avancés de modélisation 3D et de BIM (Building Information Modeling), comme Revit et ArchiCAD. Ces technologies permettent une conception intégrée et une gestion des données tout au long du cycle de vie du bâtiment, de la conception à la construction et à la maintenance.
2.2.1
Les logiciels de dessin assisté par ordinateur (DAO) tels qu’AutoCAD, ArchiCAD, et MicroStation ont apporté une transformation majeure dans le domaine de la conception architecturale. Introduits dans les années 1980 et 1990, ces outils ont permis de passer des dessins à la main aux dessins numériques, facilitant la précision et l’efficacité. AutoCAD, l’un des logiciels les plus utilisés, est renommé pour ses capacités de dessin en deux dimensions (2D). Il permet aux architectes de créer des plans, des élévations, et des sections avec une grande précision.
Chaque détail technique peut être minutieusement ajusté, ce qui est crucial pour les aspects structurels et esthétiques des projets architecturaux. L’un des avantages majeurs des outils 2D est la facilitation de la communication et de la collaboration. Les dessins numériques peuvent être facilement partagés et modifiés par différentes parties prenantes du projet, y compris les ingénieurs, les clients et les entrepreneurs. Cette interopérabilité améliore la coordination et réduit les erreurs, assurant une mise en œuvre plus fluide du projet. Les outils DAO permettent une efficacité accrue dans la réalisation des dessins. Les modifications peuvent être faites rapidement sans avoir à redessiner entièrement les plans, comme c’était le cas avec les méthodes traditionnelles. Cela réduit le temps nécessaire pour les révisions et les ajustements, accélérant ainsi le cycle de développement du projet.

fig 20 : Ici un exemple d’une agence utilisant les outils manuels, «Taliesin West», Home and studio, F.L Wright, 1935, Taschen, Photographie personnelle tirée du livre : Pfeiffer, Bruce Brooks, and Peter Gössel. 2002. Frank Lloyd Wright. Taschen.

fig 21 : Ici un exemple d’agence utilisant les outils numériques, Inside Foster + Partners Headquarters, Office Snapshots, 2013,
Un autre avantage des logiciels DAO est leur capacité à intégrer et à gérer les normes et les régulations du bâtiment. Ils permettent d’incorporer des bibliothèques de symboles standardisés et de vérifier automatiquement la conformité des dessins avec les codes du bâtiment.
Cependant, l’utilisation des outils 2D présente certaines limitations. Bien qu’ils offrent une précision dans les détails techniques, ils peuvent limiter la vision spatiale globale du projet. Les dessins en 2D ne permettent pas toujours de visualiser l’ensemble du bâtiment dans ses trois dimensions, ce qui peut compliquer la compréhension des relations spatiales et volumétriques.
Les outils matriciels, tels que Photoshop, GIMP, et Lightroom, ont révolutionné la manière dont les architectes conçoivent et représentent les atmosphères architecturales. Ces logiciels permettent la manipulation d’images bitmap, offrant des capacités avancées pour la retouche photo, la création de montages, et l’amélioration visuelle des représentations architecturales.
Photoshop est utilisé pour ajuster la luminosité, le contraste, et la saturation des images, ainsi que pour éliminer les imperfections. Cela permet de créer des représentations visuelles nettes et esthétiquement plaisantes. Grâce aux calques et aux masques, Photoshop permet de superposer et de combiner différentes images pour créer des photomontages complexes.
Ces montages peuvent simuler des atmosphères architecturales avant même la réalisation du projet. Les outils de transformation et de distorsion de Photoshop sont particulièrement utiles pour ajuster les perspectives et les proportions des éléments graphiques, permettant une représentation plus réaliste et immersive des espaces conçus. En outre, les filtres et les effets de Photoshop peuvent être utilisés pour créer des atmosphères particulières, comme un éclairage dramatique ou une texture spécifique, améliorant ainsi la capacité des architectes à visualiser et à communiquer leurs idées.
Les outils matriciels permettent de produire des images photoréalistes des projets architecturaux, aidant ainsi à visualiser l’impact des choix de matériaux, de lumière, et d’agencement spatial sur l’atmosphère globale.

fig 22 : Interface Photoshop 3.0, la version ayant introduit les calques et les palettes, 1994, Wikipédia

fig 23 : Interface Guimp 2.8, la version ayant introduit les groupes de calques et les palettes, 2012, GIMP
En manipulant les images, les architectes peuvent simuler différentes conditions de lumière et de météo, permettant de prévoir comment un espace réagira dans divers contextes. Les outils matriciels offrent une plateforme pour l’expression artistique, permettant aux architectes de créer des compositions visuelles qui communiquent l’essence émotionnelle et sensorielle de leurs projets.
Les images produites à l’aide des outils matriciels sont essentielles pour les présentations aux clients et aux parties prenantes. Elles permettent de communiquer clairement les idées et les intentions du projet. Ces images peuvent être facilement partagées et modifiées, facilitant la collaboration entre les membres de l’équipe de conception et les autres professionnels impliqués dans le projet. Tous ces outils jouent un rôle crucial dans la conception et la représentation des atmosphères architecturales.
Les outils de modélisation 3D, les technologies BIM (Building Information Modeling) et les outils de conception paramétrique ont révolutionné la manière dont les architectes conçoivent et réalisent leurs projets. Des logiciels tels que Revit, Rhino, et Grasshopper permettent de créer des modèles tridimensionnels complexes qui intègrent non seulement la forme, mais aussi des données techniques, structurelles et environnementales.
Le BIM est particulièrement influent dans le processus de conception. En centralisant toutes les informations du projet dans un modèle unique et interactif, il permet une meilleure coordination entre les différents intervenants du projet, réduisant ainsi les erreurs et les conflits potentiels. Les informations sur les matériaux, les coûts, les performances énergétiques, et les phases de construction sont toutes intégrées dans un seul modèle BIM, facilitant une gestion plus efficace et un suivi plus précis des projets.
Ces outils utilisent des algorithmes pour produire des formes et des structures en fonction de paramètres spécifiques définis par l’architecte. Cela permet de créer des designs complexes et innovants qui seraient difficiles à réaliser avec des méthodes traditionnelles de conception.

fig 24 : ArchiCAD 5.1, Première version permettant le partage de fichier via Teamwork permet à plusieurs architectes de travailler sur un même projet, 1997, macintoshrepository 2015
Ils permettent d’explorer plus en profondeur les formes et les structures, tester différentes options de conception rapidement et efficacement, et optimiser les performances énergétiques et environnementales des bâtiments. Les modèles 3D et BIM permettent également des simulations précises de l’ensoleillement, des flux d’air et d’autres facteurs environnementaux, ce qui est essentiel pour concevoir des bâtiments durables et performants.
Cependant, la maîtrise de ces outils nécessite une formation spécialisée et une compréhension approfondie des technologies numériques. Les architectes doivent être formés à l’utilisation de logiciels comme Revit, Rhino, et Grasshopper, ainsi qu’à la compréhension des principes de conception paramétrique et de modélisation BIM. Cela représente un investissement en temps et en ressources, mais les bénéfices en termes de précision, d’efficacité et de qualité de conception sont considérables.
Revit permet de créer des modèles 3D détaillés qui intègrent toutes les informations du bâtiment. Chaque élément du modèle (murs, portes, fenêtres, etc.) contient des données spécifiques comme les matériaux, les dimensions, les propriétés thermiques, etc. Le logiciel facilite la collaboration entre les différentes parties prenantes du projet (architectes, ingénieurs, entrepreneurs) grâce à un modèle central partagé.
Les modifications apportées au modèle sont automatiquement mises à jour pour tous les utilisateurs, réduisant les risques d’erreurs et de conflits. Revit génère automatiquement les dessins techniques, les plans, les élévations et les sections à partir du modèle 3D.
Cela permet de gagner du temps et d’assurer la cohérence entre les différentes vues du projet en réalisant des simulations et des analyses, telles que l’analyse énergétique, les simulations de lumière du jour et les études de flux d’air.
Rhino est connu pour sa flexibilité dans la modélisation de formes libres et complexes. Il permet de créer des surfaces très précises et fluides, adaptées à la modélisation architecturale avancée.

fig 25 : Revit 13, Depuis Revit 2013, les différentes disciplines (Structure et MEP sont réunies en un seul produit, simplement appelé Revit, 2013, Salam Albaradie, Grabcad Comunity, 2014
Le logiciel offre des options de personnalisation grâce à des scripts et des plugins, permettant aux utilisateurs d’adapter l’interface et les fonctionnalités selon leurs besoins spécifiques.
Grasshopper, un plugin pour Rhino, utilise une interface de programmation visuelle où les utilisateurs créent des algorithmes en connectant des composants. Chaque composant représente une opération, comme la création de géométrie ou la modification de paramètres.
Les architectes peuvent générer des formes et des structures complexes en définissant des règles et des relations paramétriques. Il intègre des outils d’optimisation et de simulation qui permettent de tester différentes configurations et d’optimiser les designs en fonction de critères prédéfinis, tels que l’efficacité énergétique ou la performance structurelle.

fig 26 : Interface Grasshopper, Grasshopper est principalement utilisé pour créer des algorithmes génératifs. Ici en version 1, première version après avoir été développé sous le nom de Explicit History, 2007, Wikipédia
Ces outils ont introduit une précision et une efficacité sans précédent dans la création de dessins techniques et de plans. Les architectes peuvent désormais réaliser des modifications rapides et précises, ajustant facilement les détails techniques et les proportions des éléments architecturaux. Cette flexibilité a permis une exploration plus approfondie des concepts de design et a facilité la gestion des projets complexes.
Les outils 2D digitaux ont également permis de développer un style visuel distinctif, caractérisé par des lignes nettes, des perspectives précises et une clarté graphique. Les dessins produits avec ces logiciels possèdent une qualité esthétique qui se distingue des esquisses manuelles, offrant une représentation claire et professionnelle des idées architecturales.
Un autre aspect essentiel de ces outils est leur capacité à améliorer la collaboration entre les différentes parties prenantes du projet. Les dessins numériques peuvent être facilement partagés, modifiés et commentés par les architectes, ingénieurs, clients et autres intervenants, facilitant ainsi une coordination efficace et réduisant les risques d’erreurs.
Les outils 3D, BIM, et paramétriques ont transformé la pratique architecturale en offrant des capacités de modélisation et de simulation avancées. Ils permettent une conception plus intégrée et coordonnée, favorisant des projets de haute qualité qui répondent aux exigences techniques, esthétiques et environnementales. La maîtrise de ces outils est essentielle pour les architectes modernes afin de rester compétitifs et innovants dans un environnement de plus en plus technologique.
Aujourd’hui, les standards contemporains de conceptions des atmosphères architecturales sont largement influencés par les préoccupations environnementales, l’innovation technologique et une approche centrée sur l’utilisateur. L’accent est mis sur la durabilité, l’efficacité énergétique et l’intégration de technologies intelligentes pour créer des environnements adaptatifs et interactifs. Les outils numériques comme les logiciels de modélisation 3D et les rendus photoréalistes jouent un rôle crucial dans la prévisualisation et l’ajustement des atmosphères avant même la construction, permettant des ajustements précis et une meilleure anticipation des résultats finaux.
Les méthodes de dessin traditionnelles, telles que le dessin à la main et les croquis, ont longtemps été les principaux moyens de représentation pour les architectes. Ces techniques permettent une grande créativité et une exploration intuitive des formes et des concepts, bien qu’elles présentent des limitations en termes de précision et de temps de réalisation. Malgré ces limitations, les dessins manuels restent essentiels pour exprimer les idées et les concepts initiaux des projets.
La transition initiale des outils manuels aux outils de dessin numériques a commencé dans les années 1980 et s’est démocratisée dans les années 2000. À cette époque, les logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO) ont commencé à devenir courants dans le domaine de l’architecture. Des programmes comme AutoCAD ont révolutionné la manière dont les architectes dessinaient et modélisaient leurs projets. Ces outils numériques permettaient une précision accrue, une manipulation facile des formes et des volumes, ainsi qu’une modification rapide des plans et des dessins.
L’introduction des outils CAO a permis de réduire considérablement le temps nécessaire à la production de dessins techniques et a amélioré la capacité des architectes à visualiser des projets complexes. Par exemple, des études montrent que l’utilisation d’AutoCAD dans les années 1980 a facilité la création de dessins techniques précis, tout en permettant des itérations rapides et efficaces des conceptions.
Les moteurs de rendu spécialisés, tels que Twinmotion et Enscape, ont révolutionné la visualisation des projets architecturaux en permettant de produire des images et des animations photoréalistes. Ces outils sont essentiels pour donner vie aux conceptions architecturales, en offrant une représentation visuelle très détaillée et réaliste des projets avant même leur construction.
Twinmotion est un moteur de rendu en temps réel développé par Epic Games. Il permet aux architectes de créer des visualisations interactives et immersives de leurs projets. Twinmotion se distingue par son interface utilisateur intuitive et sa capacité à produire des rendus de haute qualité rapidement. Il utilise le moteur Unreal Engine, connu pour ses capacités graphiques avancées, permettant ainsi de simuler de manière réaliste la lumière naturelle, les matériaux, et les conditions météorologiques. Twinmotion permet également l’intégration de modèles BIM (Building Information Modeling) et de CAD (Computer-Aided Design), ce qui facilite la transition entre la conception technique et la visualisation artistique.
Enscape, quant à lui, est un plugin de rendu en temps réel qui s’intègre directement dans des logiciels de modélisation tels que Revit, SketchUp, Rhino, et ArchiCAD. Enscape offre une visualisation instantanée, permettant aux utilisateurs de voir les modifications de leur modèle en temps réel. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les architectes et les designers, car elle permet d’expérimenter rapidement avec différentes options de conception et de voir immédiatement l’impact de ces modifications. Enscape produit des rendus photoréalistes en utilisant des technologies avancées de ray tracing et d’éclairage global, ce qui donne aux utilisateurs une expérience visuelle immersive et précise.
L’impact de ces moteurs de rendu spécialisés sur la conception architecturale est considérable. Ils permettent aux architectes et aux clients de visualiser avec précision comment un projet apparaîtra une fois terminé, facilitant ainsi la prise de décisions éclairées. La capacité à explorer un modèle en temps réel aide à identifier et à résoudre les problèmes de conception à un stade précoce, réduisant ainsi les coûts et les délais de construction. En outre, les rendus photoréalistes sont des outils puissants pour les présentations marketing et les ventes, aidant à communiquer la vision architecturale de manière convaincante.

fig 27 : Twinmotion, création 2005, en octobre 2015 récompense lors du Concours de l’innovation des «Mondial du Bâtiment Awards» Twinmotion

fig 28 : Enscape, Image d’un concour de création de rendu 3d gagné par enscape, création 2017, Enscape
Blender et 3ds Max sont deux logiciels de modélisation 3D et de rendu très populaires dans le domaine de l’architecture, chacun offrant des capacités avancées pour produire des visualisations photoréalistes et des animations complexes
Blender est un logiciel open-source de modélisation 3D, de rendu, d’animation et de composition. Il est particulièrement apprécié pour sa flexibilité et sa puissance, malgré le fait qu’il soit gratuit. Blender utilise le moteur de rendu Cycles, qui est capable de produire des images photoréalistes en utilisant des techniques avancées telles que le ray tracing. Cycles permet de simuler des matériaux réalistes, des effets de lumière et des ombres précises, offrant ainsi aux architectes un outil puissant pour visualiser leurs projets de manière détaillée.
3ds Max, développé par Autodesk, est un logiciel de modélisation, d’animation et de rendu 3D largement utilisé dans l’industrie de l’architecture, du jeu vidéo et des effets visuels. 3ds Max utilise plusieurs moteurs de rendus. V-Ray est connu pour sa vitesse et son efficacité dans le rendu de scènes complexes, en utilisant des techniques avancées telles que l’illumination globale et le rendu basé sur les photons.
Ces outils facilitent également la communication avec les clients et les parties prenantes, en offrant des visualisations claires et convaincantes qui illustrent l’ambiance et le caractère d’un espace avant même sa construction. L’utilisation de ces logiciels améliore le processus de conception en permettant une exploration plus créative et une optimisation des éléments atmosphériques, conduisant à des projets architecturaux mieux informés et plus immersifs.

fig 29 : Blender, création 1994, Blender a sorti une version stable de Blender 2.5x en avril 2011 : Blender 2.57. En octobre 2011 sort la version 2.60, qui marque l’aboutissement et la fin de développement de la série 2.5x, Blender 3D Architect, Avril 2024,
Les visualisations en Réalité Virtuelle (VR) représentent une avancée majeure dans le domaine de l’architecture, offrant aux architectes et aux clients une immersion complète dans les projets avant même leur construction. Le VR permet de créer des expériences interactives et immersives, où les utilisateurs peuvent explorer des modèles 3D à l’échelle réelle, ressentir les proportions des espaces et interagir avec l’environnement de manière réaliste. Les outils de VR, tels que Oculus Rift, HTC Vive et Microsoft HoloLens, utilisent des casques de réalité virtuelle pour immerger les utilisateurs dans un environnement 3D. Les logiciels spécialisés comme Enscape, Twinmotion, et Unreal Engine sont utilisés pour créer ces environnements virtuels. Ces logiciels convertissent les modèles architecturaux en scènes interactives en temps réel, permettant aux utilisateurs de se déplacer librement et d’interagir avec l’espace.
Les architectes utilisent des logiciels de modélisation 3D comme Revit, SketchUpou 3ds Max pour créer des modèles détaillés des projets. Ces modèles sont ensuite importés dans les logiciels de VR pour être convertis en environnements virtuels.
Les utilisateurs peuvent explorer les modèles en VR, se déplaçant librement dans les espaces, ouvrant des portes, allumant des lumières et même modifiant les matériaux et les meubles en temps réel. Cette interaction en temps réel offre une compréhension plus approfondie de l’espace et de son ambiance. Le VR offre une immersion totale, permettant aux architectes et aux clients de ressentir les proportions, les volumes et les ambiances des espaces de manière réaliste. Cette immersion aide à prendre des décisions éclairées sur la conception et les matériaux utilisés.
Le VR facilite la communication entre les architectes, les clients et les autres parties prenantes en offrant une représentation claire et convaincante du projet. Les clients peuvent explorer le projet comme s’il était déjà construit, ce qui réduit les malentendus et les attentes irréalistes.
Les visualisations en VR permettent de tester différentes options de conception et d’évaluer leur impact sur l’atmosphère. Les architectes peuvent expérimenter avec la lumière, les matériaux et les aménagements pour créer des ambiances spécifiques et optimisées.

Les avancées technologiques, notamment en visualisation 3D, réalité virtuelle (VR), et réalité augmentée (AR), ont profondément modifié les conventions esthétiques et la perception des espaces architecturaux. Ces transformations ont des implications à la fois sur le processus de conception et sur l’expérience sensorielle des utilisateurs.
2.4.1
Les technologies de rendu photoréaliste telles que Twinmotion et Enscape permettent de créer des visualisations d’une précision et d’un réalisme sans précédent. Cette capacité à produire des images extrêmement détaillées et réalistes influence les architectes à envisager chaque élément de design avec une attention méticuleuse aux détails. La création de rendus photoréalistes incite les concepteurs à intégrer dès le début des éléments qui étaient auparavant considérés tardivement, comme la texture des matériaux, les jeux de lumière et les ombrages.
Cette précision transforme les attentes esthétiques, car les clients et les parties prenantes peuvent voir et comprendre des aspects du projet qui étaient autrefois abstraits ou laissés à l’imagination. Par exemple, les formes fluides et dynamiques des bâtiments de Zaha Hadid Architects sont souvent le résultat de ces technologies avancées, redéfinissant ce qui est possible dans l’architecture contemporaine.
La réalité virtuelle offre une immersion totale dans les projets architecturaux, permettant aux utilisateurs de ressentir les proportions, les textures et l’ambiance d’un espace avant même qu’il ne soit construit. Cette immersion change radicalement la manière dont les espaces sont perçus, rendant l’expérience architecturale plus intuitive et émotionnelle. Les utilisateurs peuvent explorer un bâtiment virtuellement, ressentant l’espace comme s’ils y étaient réellement, ce qui améliore la compréhension et l’engagement avec le design.
Les simulations en temps réel permettent également de visualiser les variations de lumière naturelle et artificielle à différents moments de la journée et de l’année. Cette capacité à simuler la temporalité enrichit la conception atmosphérique en montrant comment la lumière et les ombres évoluent, influençant ainsi l’ambiance et la fonctionnalité des espaces. Les architectes peuvent ainsi créer des environnements qui s’adaptent dynamiquement aux conditions changeantes, améliorant le confort et l’expérience sensorielle des utilisateurs.
Les nouvelles technologies permettent une exploration plus profonde et plus détaillée des concepts architecturaux. Elles ouvrent des voies vers des designs plus complexes et plus innovants, tout en facilitant la communication et la collaboration entre les différentes parties prenantes. Les outils de modélisation 3D et de visualisation avancée offrent une plateforme où les idées peuvent être testées, modifiées et perfectionnées avec une précision inégalée.
Les avancées technologiques dans les outils de représentation architecturale ont fondamentalement transformé la manière dont les architectes conçoivent et perçoivent les atmosphères architecturales. Ces technologies, en permettant une exploration plus profonde et plus immersive des espaces, ont ouvert de nouvelles perspectives sur la création et l’évaluation des atmosphères.
Ces innovations se distinguent par leur capacité à enrichir l’expérience sensorielle et à offrir une compréhension plus intuitive et émotionnelle des espaces architecturaux. Contrairement aux simples évolutions technologiques qui améliorent la précision des dessins ou la vitesse d’exécution, ces avancées permettent de simuler et d’interagir avec des environnements virtuels de manière dynamique et immersive. Les technologies avancées ont permis aux architectes de repousser les frontières de la créativité en explorant des formes, des matériaux et des configurations spatiales innovantes. Les outils paramétriques, par exemple, permettent la génération de formes complexes basées sur des algorithmes, offrant une flexibilité et une liberté créative accrues. (Lucan, 2012)
Jacques Lucan, dans son ouvrage «Un état présent de l’architecture», offre une analyse approfondie et critique de l’architecture contemporaine, marquée par une transition significative due à l’intégration massive des technologies numériques. Selon Lucan, l’architecture de notre temps est caractérisée par une capacité sans précédent à explorer et à matérialiser des formes et des structures innovantes, grâce à l’arrivée des outils numériques. Ces technologies ont permis aux architectes de repousser les limites de la conception traditionnelle, en ouvrant de nouvelles perspectives créatives et en facilitant la réalisation de projets complexes.
Cependant, Lucan exprime également une critique nuancée de cette révolution numérique. Il observe que l’essor des outils digitaux peut, paradoxalement, conduire à une architecture qui, bien que techniquement avancée, risque de devenir déconnectée des réalités humaines et contextuelles. Selon lui, une sur-dépendance aux technologies peut parfois mener à des créations architecturales qui privilégient l’esthétique numérique et la complexité formelle au détriment de la fonctionnalité, de la durabilité et du bienêtre des occupants. Lucan insiste sur la nécessité de maintenir un équilibre entre l’innovation technologique et les principes fondamentaux de l’architecture, tel que l’intégration harmonieuse dans le contexte, la réponse aux besoins des utilisateurs et la durabilité environnementale.
Lucan appelle à une réflexion critique sur l’usage des technologies numériques dans l’architecture, afin de s’assurer qu’elles servent véritablement la qualité de vie et la pertinence contextuelle des projets architecturaux. Il met en garde contre une approche technocentrée qui pourrait négliger les dimensions humaines et culturelles

fig 30 : Jacques Lucan, à Paris, en septembre 2022. Babelio
de l’architecture. Selon lui, les architectes doivent utiliser les outils numériques de manière judicieuse, en les intégrant dans une vision plus large qui prend en compte les valeurs humanistes et environnementales de l’architecture.
Finalement, Jacques Lucan propose une vision de l’architecture contemporaine où l’innovation technologique doit être équilibrée par une réflexion éthique et contextuelle. Il encourage les architectes à exploiter les potentialités des outils digitaux tout en restant attentifs aux implications sociales, culturelles et environnementales de leurs créations. Pour Lucan, l’architecture de demain doit être à la fois technologiquement avancée et profondément humaine, capable de répondre aux défis complexes de notre époque tout en enrichissant la qualité de vie des individus et des communautés. (Lucan, 2012)
Cette critique éclairée de Jacques Lucan nous amène naturellement à explorer une autre dimension de l’innovation technologique en architecture : les outils génératifs et l’intelligence artificielle. Alors que les outils digitaux ont transformé les processus de conception et de réalisation architecturale, les outils génératifs promettent d’aller encore plus loin en introduisant des capacités de création algorithmique et d’apprentissage automatique.

fig 31 : Précisions sur un état présent de l’architecture, 2015, Jacques Lucan distingué par le Prix du livre d’architecture EPFL, 2015
Dans cette partie, nous examinerons comment ces nouvelles technologies, encore plus avancées, influencent la pratique architecturale contemporaine. Les outils génératifs, tels que les logiciels de conception paramétrique et les algorithmes d’intelligence artificielle, permettent aux architectes de dépasser les limites traditionnelles de la conception. En effet ces outils explorent des milliers de solutions de conception en temps réel, optimisent les performances énergétiques, et simulent des scénarios complexes avec une précision sans précédent.
Nous aborderons dans un premier temps les principes de fonctionnement de ces outils, puis nous analyserons des études de cas qui illustrent leur application concrète. Enfin, nous discuterons des avantages, des défis et des enjeux éthiques liés à l’intégration de l’intelligence artificielle dans la pratique architecturale. Cette exploration nous permettra de comprendre comment ces technologies peuvent enrichir, mais aussi potentiellement transformer, la manière dont les architectes conçoivent et réalisent des espaces qui répondent aux besoins de notre époque. (Wikipédia, 2024. Large Language Model)
En posant ces questions, il est crucial de reconnaître que la maîtrise des outils IA ne doit pas se limiter à la création de rendus séduisants, mais doit aussi inclure une compréhension profonde des réalités pratiques et des défis inhérents à la construction physique. Comment les architectes peuvent-ils équilibrer les promesses des outils numériques avec les exigences du monde réel pour garantir que l’architecture produite soit non seulement visuellement impressionnante, mais aussi fonctionnelle, durable et véritablement enrichissante pour ses utilisateurs ? La réponse à ces questions déterminera l’impact réel de l’IA sur l’architecture de demain, et soulignera l’importance de maintenir un lien fort entre la conception numérique et la réalisation physique.
3.1.1 Définition et fonctionnement des LLM (principe de l’IA, les types d’IA)
L’intelligence artificielle (IA) et la création de dessins et d’atmosphères architecturales ont révolutionné le domaine de l’architecture, introduisant de nouvelles méthodes de conception et de visualisation. DALL-E, développé par OpenAI, et Midjourney sont deux exemples notables d’outils d’IA capables de générer des images à partir de descriptions textuelles, facilitant ainsi le processus de conception architecturale.
Un Modèle de Langage à Grande Échelle (LLM) est une intelligence artificielle basée sur des réseaux de neurones profonds, entraînée sur d’énormes quantités de données textuelles pour comprendre, générer et manipuler le langage naturel. Ces modèles sont utilisés pour accomplir diverses tâches, telles que la traduction automatique, la génération de texte, et la réponse à des questions. Le fonctionnement d’un LLM repose sur plusieurs étapes clés. (Wikipédia, 2024. Large Language Model)
Tout d’abord, le pré-entraînement utilise des corpus massifs de données textuelles provenant de sources variées comme des livres, des articles et des sites web. La plupart des LLM utilisent des architectures de transformateurs, qui gèrent des dépendances complexes entre les mots grâce à des mécanismes d’attention. Par exemple, GPT-3 d’OpenAI utilise une architecture de transformateur avec 175 milliards de paramètres. L’objectif de cette phase est d’entraîner le modèle à prédire le mot suivant dans une séquence donnée. (Wikipédia, 2024. ChatGPT)

Ensuite, vient l’affinage ou «fine-tuning», où le modèle est adapté à des tâches spécifiques ou à des domaines particuliers pour améliorer ses performances. Cette phase peut impliquer un nouvel entraînement avec des ensembles de données plus ciblés. Lors de l’utilisation, les LLM sont intégrés dans des applications via des API ou des interfaces utilisateur, permettant aux utilisateurs de fournir des entrées textuelles et de recevoir des réponses générées. Le modèle génère du texte en prédisant les mots les plus probables qui suivent dans le contexte fourni.
Les LLM offrent de nombreux avantages, mais présentent aussi des défis et des limitations. Parmi les avantages, on note leur capacité à générer du contenu créatif et à offrir des solutions innovantes, ainsi que leur efficacité à automatiser des tâches répétitives et à traiter rapidement de grandes quantités de données textuelles. Cependant, les LLM peuvent reproduire et amplifier les biais présents dans les données d’entraînement, posant des défis éthiques significatifs. De plus, malgré leurs capacités avancées, ils peuvent parfois manquer de compréhension contextuelle profonde, produisant des réponses inexactes ou hors contexte. Enfin, l’entraînement et l’utilisation des LLM nécessitent des ressources computationnelles considérables, rendant ces technologies coûteuses et énergivores.
Dans le domaine de l’architecture, ces outils offrent plusieurs avantages. Ils permettent une visualisation rapide, où les architectes peuvent rapidement visualiser des concepts et des idées en fournissant des descriptions textuelles, accélérant ainsi le processus de conception. Ils favorisent l’exploration créative, ouvrant de nouvelles possibilités pour des idées et des formes architecturales non conventionnelles.
fig 33 : Schéma de fonctionnement d’un Large Language Model, Data Science Dojo, 2024

En termes de communication avec les clients, les images générées peuvent être utilisées pour transmettre efficacement les idées de conception, rendant les présentations plus immersives et compréhensibles. Enfin, ces outils facilitent l’optimisation des designs en générant plusieurs variations d’une idée, permettant aux architectes d’affiner et d’optimiser leurs conceptions en fonction des préférences esthétiques et des contraintes fonctionnelles.
DALL-E, développé par OpenAI, est un modèle d’intelligence artificielle capable de générer des images à partir de descriptions textuelles. Il utilise une version modifiée de GPT-3, appelée GPT-3’s image encoderdécoder, pour traduire le texte en images. Le processus commence par une entrée textuelle fournie par l’utilisateur, comme «un chat portant un chapeau de cowboy en train de jouer de la guitare». Le modèle encode cette description en une séquence de vecteurs latents, une représentation numérique du texte. Ces vecteurs sont ensuite décodés pour générer une image correspondant à la description. DALL-E utilise des algorithmes d’apprentissage profond, notamment les réseaux de neurones convolutionnels, pour créer des images réalistes et détaillées. Il peut produire plusieurs variations d’une même description, permettant à l’utilisateur de choisir celle qui correspond le mieux à ses attentes.
Midjourney est un autre outil de génération d’images basé sur l’IA, souvent utilisé pour créer des œuvres d’art à partir de descriptions textuelles. Comme avec DALL-E, l’utilisateur commence par fournir une description textuelle de l’image souhaitée. Midjourney utilise des techniques d’intelligence artificielle telles que les GANs (Generative Adversarial Networks) ou les modèles de diffusion pour créer des images à partir de texte.
Le modèle a été formé sur une vaste base de données d’images et de textes associés, lui permettant de comprendre et de générer des images qui correspondent précisément aux descriptions fournies. L’utilisateur reçoit plusieurs options d’images générées, parmi lesquelles il peut choisir. Midjourney se distingue par sa capacité à créer des œuvres d’art qui ont un aspect plus artistique et créatif. (Wikipédia, 2024. Midjourney)
Il est possible de transformer des descriptions textuelles détaillées en images réalistes et créatives, ainsi que d’avoir des conversations et des réponses intelligentes à partir de textes.DALL-E utilise une version modifiée de GPT-3, appelée «image encoder-decoder», pour traduire le texte en images. Le processus commence par l’entrée


textuelle où l’utilisateur fournit une description détaillée de l’image souhaitée, par exemple, «un chat portant un chapeau de cowboy en train de jouer de la guitare». Cette description est ensuite codée en une séquence de vecteurs latents, représentant numériquement le texte. Ces vecteurs sont décodés pour générer une image réaliste et détaillée, grâce à des algorithmes d’apprentissage profond, notamment des réseaux de neurones convolutionnels. DALL-E peut également produire plusieurs variations d’une même description, permettant ainsi à l’utilisateur de choisir celle qui correspond le mieux à ses attentes.
Midjourney utilise des techniques d’IA telles que les GANs (Generative Adversarial Networks) ou les modèles de diffusion pour créer des images à partir du texte. Le modèle a été formé sur une vaste base de données d’images et de textes associés, ce qui lui permet de comprendre et de générer des images précises et créatives. L’utilisateur reçoit plusieurs options d’images générées, parmi lesquelles il peut choisir, permettant une personnalisation et une créativité accrues.
Ainsi, l’intégration de l’IA dans le processus de conception architecturale transforme la manière dont les architectes envisagent, créent et communiquent leurs projets. Cette évolution technologique offre des perspectives nouvelles et stimulantes pour l’avenir de l’architecture, où la représentation des atmosphères devient un élément central du design process.
3.1.2 Analyse fonctionnelle (Interface type et prompts)
L’analyse fonctionnelle des outils génératifs en architecture, notamment ceux basés sur l’intelligence artificielle et le machine learning, se concentre sur deux aspects principaux : l’interface utilisateur et les prompts. Ces deux éléments sont cruciaux pour maximiser l’efficacité et l’innovation dans le processus de conception. (Wikipédia, 2024. ChatGPT)
L’interface utilisateur (UI) des outils génératifs est conçue pour être intuitive et accessible, même pour ceux qui ne sont pas experts en programmation. Elle se compose généralement des éléments suivants :
1. Tableau de Bord (Dashboard) : Le tableau de bord fournit une vue d’ensemble des projets en cours, des modèles disponibles, et des paramètres de génération. Il permet une navigation facile entre différentes sections de l’outil.
2. Fenêtre de Visualisation : Cet espace est destiné à la prévisualisation en temps réel des modèles générés. Les architectes peuvent interagir directement avec les rendus 3D, ajuster les paramètres et voir instantanément les résultats des modifications apportées.
3. Panneau de Paramètres : Ici, les utilisateurs peuvent régler les paramètres de génération tels que les dimensions, les matériaux, les styles architecturaux, et autres spécifications techniques. Ce panneau peut inclure des curseurs, des champs de saisie, et des menus déroulants pour affiner les détails.

4. Zone de Saisie de Prompts : Un champ de texte où les utilisateurs peuvent entrer des commandes ou des descriptions en langage naturel pour guider le processus de génération. Par exemple, un architecte pourrait entrer «créer un pavillon en bois avec des ouvertures circulaires pour maximiser la lumière naturelle».
5. Boutons d’Action : Ces boutons permettent de lancer des actions spécifiques, comme générer un nouveau
modèle, enregistrer un projet, ou annuler une action. Ils sont souvent situés de manière à être facilement accessibles pour améliorer la fluidité du workflow.
Les prompts sont des commandes ou des descriptions en langage naturel que les utilisateurs entrent pour guider le processus de génération. Ils sont au cœur de l’interaction avec les outils génératifs et déterminent la qualité et la pertinence des résultats. Voici quelques types de prompts couramment utilisés et leur fonction : (Wikipédia, 2024. Prompt Engineering)
1. Descriptifs Formels : Ces prompts décrivent les caractéristiques spécifiques de l’architecture désirée. Par exemple, «générer une façade en verre avec des panneaux solaires intégrés».
2. Contexte Environnemental : Les prompts peuvent inclure des détails sur l’environnement où le bâtiment sera situé. Par exemple, «créer un bâtiment résidentiel adapté à un climat tropical avec une ventilation naturelle optimale».
3. Fonctionnalité et Usage : Les utilisateurs peuvent spécifier l’utilisation prévue du bâtiment et les exigences fonctionnelles. Par exemple, «concevoir un espace de co-working avec des zones de silence et des espaces de collaboration ouverts».
4. Styles et Esthétiques : Ces prompts orientent le générateur vers un style architectural particulier. Par exemple, «créer une maison dans le style Bauhaus avec une palette de couleurs minimaliste».
5. Contraintes Techniques : Les prompts peuvent inclure des contraintes spécifiques comme le budget, les matériaux disponibles, ou les régulations locales. Par exemple, «construire une structure en béton ne dépassant pas 1000 m² avec un budget limité à 1 million d’euros».
L’interface et les prompts des outils génératifs jouent un rôle essentiel dans le processus de conception architecturale. Une interface bien conçue permet aux utilisateurs de naviguer facilement et d’explorer diverses options créatives, tandis que des prompts précis et détaillés garantissent que les résultats générés répondent aux besoins et aux attentes spécifiques des projets. Ces innovations technologiques transforment non seulement la manière dont les architectes travaillent, mais aussi la qualité et l’efficacité de leurs créations, ouvrant la voie à de nouvelles possibilités dans le domaine de l’architecture.

fig 37 : Schémas, Crafting Effective AI Prompts: A Guide to Elevate Your Conversations, Vikash Singh, Nov 24, 2023, Medium
fig 38 : Schémas, Use this guide to master ChatGPT in 6 simple steps:Robin Delta, Jan 5, 2024, Medium

3.1.3 Les outils aboutis (Présentation des outils fonctionnels)
L’innovation technologique et l’intelligence artifi cielle (IA) transforment profondément le domaine de l’architecture. Voici quelques-uns des outils d’IA les plus aboutis utilisés par les architectes aujourd’hui :
1. Finch : (finch3d.com
Finch est un outil génératif basé sur l’IA qui aide les architectes à concevoir des espaces optimisés dès les premières phases de conception. Il utilise des algorithmes pour générer des plans et des confi gurations spatiales en fonction de paramètres défi nis par l’utilisateur.
• Génération Automatique : Finch propose des plans et des confi gurations optimales basés sur des critères tels que la lumière, la ventilation, et l’utilisation de l’espace.
• Interface Intuitive : Les architectes peuvent ajuster les paramètres et voir instantanément les modifi cations dans la conception.
• Optimisation : Finch permet d’explorer rapidement de nombreuses variantes de conception, optimisant l’effi cacité et l’utilisation de l’espace.
2. Hypar : (hypar.io)
Hypar est une plateforme basée sur le cloud qui utilise l’IA pour automatiser les tâches de conception et générer des solutions architecturales. Elle est conçue pour faciliter la collaboration et la standardisation dans les projets de construction.
• Automatisation : Hypar automatise la génération de plans, la modélisation structurelle et les analyses de performance.
• Collaboration : Permets aux équipes de travailler ensemble en temps réel sur des modèles partagés.
• Adaptabilité : Les utilisateurs peuvent personnaliser les algorithmes pour répondre à des besoins spécifi ques de conception.
3. Autodesk Forma AI: (autodesk.com)
Forma est un outil d’IA destiné à optimiser l’utilisation de l’espace dans les projets urbains et résidentiels. Il aide les architectes et les urbanistes à maximiser le potentiel des sites en tenant compte de multiples facteurs environnementaux et réglementaires.
• Analyse de Site : Forma eff ectue des analyses approfondies des sites, y compris la topographie,








41 : Autodesk, Autodesk, 2024
le climat et les infrastructures environnantes.
• Optimisation : Génère des propositions de conception qui optimisent l’ensoleillement, la ventilation naturelle et l’utilisation de l’espace.
• Simulation : Off re des simulations pour évaluer les impacts des diff érentes confi gurations sur le bien-être des résidents et sur l’environnement.
4. TestFit : (testfit.io)
Présentation : TestFit est un logiciel qui utilise des algorithmes pour générer des confi gurations optimales pour des projets résidentiels et commerciaux. Il est particulièrement utile pour les phases de faisabilité et de pré-conception.
• Génération Rapide : TestFit peut créer des plans d’étage et des confi gurations de site en quelques secondes, basés sur les contraintes de zonage et les besoins du projet.
• Scénarios Multiples : Permet d’explorer rapidement diff érents scénarios de conception pour trouver la solution la plus effi cace.
• Feedback Instantané : Fournit des analyses instantanées sur la viabilité économique et la conformité réglementaire des propositions de conception.
5. Delve by Sidewalk Labs : (bluelabellabs.com)
Delve est un outil d’IA développé par Sidewalk Labs qui aide à planifi er et à optimiser les quartiers urbains. Il utilise l’IA pour générer des plans de quartier en tenant compte de divers critères de durabilité et de qualité de vie.
• Génération de Quartiers : Delve propose des confi gurations de quartiers optimisées pour la densité, l’accès aux services et la durabilité environnementale.
• Analyse Multicritères : Évalue les impacts des propositions de conception sur la mobilité, les émissions de carbone, et le bien-être des résidents.
• Scénarios Interactifs : Les utilisateurs peuvent interagir avec les modèles pour explorer diff érentes options et ajuster les paramètres en temps réel.




fig 42 : Test fit IA, 2024




fig 43 : Delve, 2024

6. Spacio : (spacio.ai)
Spacio est un outil d’IA conçu pour améliorer la planifi cation des espaces intérieurs en optimisant la disposition des meubles et des équipements.
• Optimisation de l’Espace : Propose des confi gurations optimales pour l’agencement des meubles en fonction de l’usage prévu et des fl ux de circulation.
• Simulation d’Ambiance : Permets de visualiser l’impact des diff érentes confi gurations sur l’ambiance générale de l’espace.
• Analyse Ergonomique : Évalue le confort et l’ergonomie des propositions de conception pour garantir des espaces fonctionnels et agréables.
7. ARCHITEChTURES : (architechtures.com)
ARCHITEChTURES est une plateforme d’IA qui facilite la création de plans architecturaux en tenant compte des réglementations locales et des exigences du client.
• Génération de Plans : Propose des plans d’étage optimisés basés sur les contraintes du site et les préférences des utilisateurs.
• Conformité Réglementaire : Assure que les propositions de conception respectent les codes du bâtiment et les régulations locales.
• Personnalisation : Permets aux utilisateurs de personnaliser les paramètres pour obtenir des plans sur mesure.
8. VERAS : (evolvelab.io)
VERAS est un outil d’IA développé par Morpholio qui aide les architectes à générer des dessins et des représentations artistiques de haute qualité à partir de croquis initiaux.
• Transformation de Croquis : Permets de transformer des croquis et des dessins faits à la main en rendus numériques de haute qualité.
• Filtres Artistiques : Off re une variété de fi ltres artistiques qui peuvent être appliqués pour styliser les dessins et les rendus.
• Intégration avec d’Autres Outils : S’intègre avec d’autres outils de CAO et de modélisation pour faciliter le fl ux de travail.




fig 44 : Spacio, 2024








fig 45 : ARCHITECThTURURE, 2024




fig 46 : VERAS, 2024
9. Cove.Tool : (covetool.com)
Cove.Tool est une plateforme basée sur l’IA conçue pour l’analyse de performance énergétique des bâtiments. Elle aide les architectes à optimiser la durabilité et l’effi cacité énergétique de leurs projets.
• Simulation Énergétique : Cove.Tool utilise des algorithmes pour simuler les performances énergétiques des bâtiments, en tenant compte des facteurs climatiques, des matériaux et des systèmes mécaniques.
• Analyse de Coût : L’outil permet de comparer diff érents scénarios de conception en termes de coût initial et de retour sur investissement énergétique.
• Visualisation de Données : Off re des visualisations claires et interactives des analyses énergétiques, facilitant la prise de décision pour des conceptions durables.
10. Augmenta : (augmenta.ai)
Augmenta est une plateforme d’IA dédiée à l’optimisation des processus de conception et de construction, en mettant l’accent sur l’effi cacité et la durabilité.
• Conception Automatisée : Augmenta utilise des algorithmes pour générer des conceptions de bâtiments optimisées en termes de coûts et de performances.
• Intégration BIM : S’intègre avec les outils BIM existants pour améliorer la précision et la cohérence des modèles numériques.
• Analyse de Cycle de Vie : Permets d’évaluer l’impact environnemental des matériaux et des systèmes tout au long du cycle de vie du bâtiment.
11. Archistar : (archistar.ai)
Présentation : Archistar est une plateforme d’IA qui aide les architectes et les urbanistes à générer des conceptions optimales pour les projets résidentiels et commerciaux. Elle intègre des données géospatiales pour améliorer la précision et l’effi cacité des projets.
• Génération Automatique : Archistar propose des confi gurations optimales en fonction des contraintes du site et des règlements locaux.
• Analyse Spatiale : Utilise des données géospatiales pour optimiser l’utilisation de l’espace, la lumière naturelle et les vues.








• Simulation et Évaluation : Permets d’évaluer différentes options de conception en termes de faisabilité économique et d’impact environnemental.
12. DeepBlocks : (deepblocks.com)
Présentation : DeepBlocks combine l’IA et les données du marché immobilier pour aider les architectes et les promoteurs à identifier les opportunités de développement et à générer des modèles financiers précis.
• Analyse de Site : Évalue le potentiel de développement des sites en tenant compte des régulations de zonage et des tendances du marché.
• Génération de Modèles Financiers : Propose des projections financières basées sur les données du marché et les coûts de construction.
• Scénarios de Développement : Offre des simulations pour explorer différentes stratégies de développement et optimiser le retour sur investissement.

3.1.4 Les outils IA intégrés aux outils digitaux traditionnels
Les outils d’IA commencent à apparaître nativement dans plusieurs autres logiciels utilisés par les architectes, au-delà de Photoshop. Voici quelques exemples :
1. AutoCAD
2. Revit
3. SketchUp
4. Rhino,Grasshopper
5. Archicad
6. Blender

L’intégration des technologies de l’intelligence artificielle (IA) aux outils digitaux traditionnels a transformé la manière dont les architectes conçoivent et réalisent leurs projets. Cette combinaison permet non seulement de bénéficier des avantages des outils traditionnels comme les logiciels de modélisation 2D et 3D, mais aussi d’exploiter les puissantes capacités analytiques et génératives de l’IA.


Les outils IA intégrés, tels que ceux disponibles dans AutoCAD, Revit, et ArchiCAD, permettent aux architectes de réaliser des analyses complexes et des optimisations automatiques. Par exemple, l’IA peut analyser des milliers de configurations spatiales en quelques secondes, optimisant l’utilisation de l’espace, l’efficacité énergétique et la lumière naturelle.
• AutoCAD : Utilisation de plugins IA pour la génération automatique de plans basés sur des paramètres prédéfinis.
• Revit : Intégration de l’IA pour la détection des conflits dans les modèles BIM, réduisant ainsi les erreurs de construction.
• ArchiCAD : Utilisation de l’IA pour l’analyse énergétique et la simulation de performances environnementales.
Les outils de la suite Adobe, notamment Photoshop, Illustrator et InDesign, intègrent des fonctionnalités d’IA qui améliorent considérablement le flux de travail des architectes en matière de visualisation, de retouche et de présentation des projets.
• Photoshop : Utilisation de l’IA pour l’auto-réparation des images, la sélection intelligente des objets et la génération de contenus via Adobe Sensei. Par exemple, l’outil de remplissage basé sur le contenu (Content-Aware Fill) permet de supprimer des éléments indésirables d’une image et de les remplacer par un fond généré automatiquement pour correspondre à l’environnement.
• Illustrator : Intégration de l’IA pour la vectorisation automatique des dessins, la suggestion de palettes de couleurs et la création de motifs répétitifs.
• InDesign : Utilisation de l’IA pour la mise en page automatique, l’ajustement des cadres de texte et l’optimisation de la typographie pour des publications plus harmonieuses et visuellement attrayantes.
L’IA n’est pas seulement intégrée aux outils de conception graphique, mais aussi aux logiciels de traitement de texte et de bureautique, comme Microsoft Word et Excel, facilitant ainsi la gestion de documents et l’analyse de données.
• Word : Utilisation de l’IA pour la correction grammaticale avancée, les suggestions de style d’écriture et la génération automatique de résumés de texte via Microsoft Editor et autres outils similaires. L’IA aide également à la traduction automatique et à la recherche intelligente de contenu pertinent pour améliorer la qualité des documents.
• Excel : Intégration de l’IA pour l’analyse de données, les prévisions et les recommandations de graphiques. Les fonctionnalités telles que Ideas dans Excel permettent d’explorer les données de manière intuitive et de générer des insights utiles grâce à des algorithmes d’apprentissage automatique.
Outre les logiciels de la suite Adobe et de Microsoft, l’IA est également intégrée dans d’autres outils spécialisés utilisés par les architectes et les designers. (Applicit.com “La conception générative de l’intelligence artificielle dans Revit”)
• Rhino et Grasshopper : Ces outils utilisent l’IA pour la création paramétrique et la personnalisation des formes et des structures. Ils permettent de concevoir des structures complexes basées sur des paramètres définis par l’utilisateur, facilitant l’exploration de nouvelles solutions architecturales.
• Blender : En tant que logiciel de modélisation 3D open source, Blender intègre des outils d’IA pour l’animation, la simulation physique et le rendu photoréaliste. Les fonctionnalités d’IA aident à automatiser des tâches complexes et à optimiser les workflows créatifs.
• Fusion 360 : Utilise l’IA pour l’optimisation topologique, permettant de créer des modèles structurels optimisés pour la performance et l’efficacité des matériaux. Cette approche aide les architectes à concevoir des structures plus légères et plus résistantes.
L’intégration de l’IA aux outils digitaux traditionnels offre une multitude d’avantages aux architectes, améliorant l’efficacité, la précision, et la capacité à générer des conceptions innovantes. Cette combinaison permet de tirer parti des forces des deux mondes, facilitant une conception plus intelligente, plus rapide, et plus collaborative. Cependant, cette évolution technologique nécessite une adaptation continue des compétences et une vigilance accrue pour gérer les défis éthiques et sociaux qu’elle pose.
Les outils génératifs et l’intelligence artificielle (IA) sont en train de révolutionner le domaine de l’architecture en offrant des capacités de conception et de simulation avancées. Ces outils permettent aux architectes de créer des modèles tridimensionnels détaillés, de simuler des conditions environnementales et d’optimiser les performances énergétiques des bâtiments. Grâce à ces technologies, il est possible d’explorer des milliers de variantes de conception en un temps record, facilitant ainsi la prise de décision et l’innovation.
Aujourd’hui, les outils génératifs transforment le processus de conception en offrant des possibilités de personnalisation et d’optimisation sans précédent. Ces outils permettent aux architectes d’explorer rapidement une large gamme de solutions de conception, facilitant ainsi l’innovation et l’efficacité. Par exemple, les algorithmes d’intelligence artificielle peuvent générer des configurations spatiales optimales en fonction de critères définis par l’utilisateur, tels que la lumière naturelle, la ventilation et l’usage prévu de l’espace. (Mortice, Zach. 2023)
Les outils génératifs comme Grasshopper pour Rhino ou Finch utilisent des paramètres définis par les architectes pour générer des formes et des structures complexes. Cela permet de tester différentes options de conception rapidement et efficacement, réduisant ainsi le temps de développement des projets. En outre, l’utilisation de ces outils facilite l’intégration de considérations environnementales et de durabilité dès les premières phases de conception, optimisant ainsi les performances énergétiques et réduisant l’empreinte écologique des bâtiments.
L’intégration des outils génératifs dans des projets actuels se manifeste dans des bâtiments avantgardistes qui exploitent pleinement les capacités de l’IA pour améliorer la performance et l’esthétique. Des projets comme le Pavilion of the Future à Dubaï illustrent comment ces technologies peuvent être

utilisées pour créer des structures innovantes et durables. Ce pavillon utilise des algorithmes génératifs pour concevoir une structure qui s’adapte aux conditions climatiques locales, optimisant ainsi la ventilation naturelle et la gestion de la chaleur.
D’autres exemples incluent des bâtiments comme le «Algorithmic Design Tower» à New York, où des outils génératifs ont été utilisés pour créer une façade dynamique qui s’adapte aux conditions environnementales en temps réel. Ce type de conception permet non seulement d’améliorer l’efficacité énergétique, mais aussi de créer des expériences visuelles uniques pour les occupants et les passants.
3.2.3
Malgré leurs avantages, ces outils présentent des défis, notamment en termes de coût, de courbe d’apprentissage et de complexité. Le coût des logiciels et du matériel nécessaire pour utiliser ces technologies peut être prohibitif pour certaines entreprises, en particulier les plus petites. De plus, la courbe d’apprentissage associée à ces outils peut être abrupte, nécessitant une formation spécialisée pour les architectes et les designers. (Mortice, Zach. 2023)
La complexité des modèles générés par l’IA peut également poser des problèmes en termes de constructibilité et de faisabilité. Les résultats générés par des algorithmes peuvent parfois manquer de praticité, nécessitant une validation humaine rigoureuse pour s’assurer qu’ils sont réalisables et conformes aux normes de construction. En outre, il peut y avoir une résistance à l’adoption de ces technologies, certains professionnels étant réticents à accepter des conceptions générées par des machines plutôt que par des humains.
Financièrement, de nombreux outils de modélisation IA proposent des versions éducatives gratuites ou à prix réduit grâce à des licences éducatives, des partenariats académiques, et des ressources en ligne, les étudiants en architecture peuvent désormais accéder aux outils IA de manière plus abordable et pratique, leur offrant une opportunité précieuse de développer leurs compétences et d’explorer de nouvelles avenues dans leur processus de conception.
Finalement, bien que les outils génératifs et l’IA offrent des capacités révolutionnaires pour la conception architecturale, ils nécessitent également une gestion prudente des défis associés. Les architectes doivent équilibrer l’utilisation de ces technologies avec une validation humaine rigoureuse pour garantir des conceptions pratiques, durables et véritablement innovantes.
Les outils génératifs posent des questions éthiques importantes, notamment en matière de responsabilité, d’authenticité et de sécurité des données. Il est crucial de garantir que ces technologies soient utilisées de manière éthique et transparente.
Les opportunités offertes par ces outils sont immenses, incluant la possibilité de concevoir des espaces plus durables et inclusifs. Les technologies génératives peuvent également démocratiser l’accès à des outils de conception avancés, ouvrant de nouvelles perspectives pour les architectes du monde entier. Créativité et innovation : Les outils génératifs offrent des possibilités inédites pour l’exploration de nouvelles formes et concepts architecturaux. Ils peuvent aider les architectes à repousser les limites de leur créativité en générant rapidement des centaines de variantes d’un même concept.
Efficacité et précision : L’intégration de l’IA dans les processus de conception peut améliorer l’efficacité et la précision des projets. Les algorithmes peuvent analyser de vastes ensembles de données pour optimiser les performances énergétiques, les coûts de construction et les impacts environnementaux. Accessibilité et collaboration : Les technologies numériques facilitent la collaboration entre les différents acteurs du projet, permettant une meilleure communication et une intégration des idées en temps réel. Cela peut rendre l’architecture plus inclusive et participative, impliquant davantage les clients et les communautés locales dans le processus de conception.
Personnalisation : Les outils génératifs permettent de créer des designs personnalisés adaptés aux besoins spécifiques des utilisateurs, améliorant ainsi le confort et la fonctionnalité des espaces. Cette personnalisation peut s’étendre à l’optimisation des conditions de vie en temps réel, en adaptant les espaces aux préférences individuelles.
3.3.3 Risques et précautions
Les risques incluent la dépendance excessive aux technologies et la possible dévalorisation des compétences traditionnelles. Il est essentiel de maintenir un équilibre entre l’utilisation des outils numériques et la préservation des savoir-faire manuels.
L’intégration des outils génératifs et de l’IA dans l’architecture représente une évolution majeure qui redéfinit les pratiques de conception et de représentation des atmosphères. En explorant les capacités actuelles et futures de ces technologies, ainsi que les enjeux éthiques et sociaux associés, cette recherche ouvre la voie à une compréhension plus profonde de l’impact des outils de représentation sur la qualité des atmosphères architecturales.
Une trop grande dépendance à l’égard des technologies numériques peut réduire les compétences traditionnelles des architectes, limitant leur capacité à concevoir sans outils numériques. Il est essentiel de maintenir un équilibre entre les compétences manuelles et numériques.
Les algorithmes peuvent reproduire et amplifier les biais présents dans les données utilisées pour les entraîner. Cela peut mener à des conceptions qui favorisent certains groupes ou qui ne répondent pas adéquatement aux besoins de tous les utilisateurs. Une vigilance constante est nécessaire pour identifier et corriger ces biais.
L’intégration de technologies avancées peut augmenter la complexité des systèmes de construction, rendant plus difficiles leur maintenance et leur gestion. Il est crucial de développer des solutions qui
restent compréhensibles et gérables pour les professionnels de la construction. L’utilisation de l’IA et des technologies connectées pose des défis en matière de sécurité et de confidentialité des données. Il est impératif de mettre en place des mesures robustes pour protéger les informations sensibles et garantir la sécurité des systèmes automatisés.
Les opportunités offertes par les technologies génératives sont immenses. Elles permettent de concevoir des espaces plus durables, inclusifs et adaptés aux besoins spécifiques des utilisateurs. En démocratisant l’accès à des outils de conception avancés, ces technologies ouvrent de nouvelles perspectives pour les architectes du monde entier, favorisant l’innovation et l’expérimentation. Cependant, il est essentiel de rester vigilant face aux risques associés, tels que la dépendance excessive aux technologies, les biais algorithmiques et les défis en matière de sécurité des données.
Pour conclure, l’intégration des outils génératifs et de l’IA dans la conception de l’architecture représente une évolution majeure qui redéfinit les pratiques de conception et de représentation des atmosphères. Ces technologies offrent des avantages significatifs, notamment en termes de créativité, d’efficacité, de précision et de personnalisation. Les outils génératifs permettent aux architectes de repousser les limites de leur imagination, d’explorer rapidement des milliers de variantes, de concepts et de créer des espaces hautement optimisés en fonction des besoins spécifiques des utilisateurs. De plus, l’IA facilite la collaboration entre les différents acteurs du projet, améliorant la communication et l’intégration des idées en temps réel.
Méthodes de recherche Conférences Analyses de Cas
MÉTHODOLOGIE
Méthodes de recherche
L’objectif principal de cette recherche est d’analyser le rapport entre les outils de conception architecturale et la production réelle de l’espace, en se concentrant sur les qualités spatiales et l’expérience vécue dans les projets construits. Pour ce faire, la démarche implique une exploration approfondie des transformations des techniques de conception depuis les outils traditionnels jusqu’aux technologies paramétriques et génératives contemporaines. Cela commence par une étude des outils manuels utilisés par les architectes au cours du 20e siècle, en examinant comment ces méthodes influençaient la conception des espaces. Ensuite, l’accent est mis sur l’évolution vers les outils numériques, tels que CAD, BIM, et les logiciels paramétriques comme Rhino et Grasshopper, en analysant leur impact sur la complexité et l’efficacité des projets. Enfin, l’étude se penche sur l’intégration des outils génératifs d’intelligence artificielle, en explorant comment ces technologies peuvent transformer la conception architecturale en permettant une personnalisation accrue et une optimisation des performances spatiales et énergétiques. Cette analyse est enrichie par des retours d’expériences à travers l’analyse de conférence pour obtenir des insights pratiques sur l’application de ces outils dans divers projets, ainsi que par une revue de la littérature académique et technique pour situer cette recherche dans un contexte théorique plus large.
Pour comprendre comment les architectes utilisent ces outils dans leur processus de conception, cette recherche s’intéresse également aux récits des architectes sur leur propre pratique. Des vidéos de conférences, des interviews sur YouTube, et des articles détaillant les processus de conception de différentes agences d’architecture seront analysés. Ces sources fournissent des informations précieuses sur les méthodes employées par les architectes pour intégrer les outils numériques et génératifs dans leur travail quotidien. Par exemple, les conférences TED, les colloques académiques, et les interviews de personnalités influentes du domaine, comme Marc Burry et Antoine Picon, offrent des perspectives directes sur les avantages et les défis de l’utilisation des technologies modernes en architecture. En examinant comment ces professionnels décrivent leur processus de conception et leur utilisation des outils, des innovations remarquables, et des obstacles récurrents. Cette analyse permet également de contextualiser les recommandations des experts et de comprendre comment elles peuvent être appliquées dans la pratique architecturale.
La méthodologie comprend également une analyse de cas détaillée de projets spécifiques pour comprendre comment le processus de conception influence la qualité des espaces vécus et l’atmosphère des bâtiments. Les cas étudiés incluent un projet incontournable au sujet de l’atmosphère telle que la maison sur la cascade de Frank Lloyd Wright, des projets emblématiques réalisés avec des outils paramétriques, tels que The Mountain par BIG et Ycone par Atelier Jean Nouvel, ainsi que des projets innovants utilisant l’IA comme Mjøstårnet. Les données collectées incluent des textes descriptifs, des images, des photos, des plans architecturaux, et des rendus 3D. Cette approche permet de mettre en lumière le lien entre les techniques de conception employées et les caractéristiques spatiales des projets construits. Par exemple, en analysant les schémas, les rendus visuels et les simulations des performances énergétiques, il est possible d’évaluer comment les choix de conception influencent l’expérience des utilisateurs finaux en termes de confort, d’esthétique, et de fonctionnalité. L’analyse de ces projets permet également de dégager des recommandations pour l’utilisation des outils génératifs dans la conception architecturale, en soulignant les aspects qui contribuent le plus à la qualité spatiale et à l’optimisation des ressources.
A. Les outils manuels : Frank Lloyd Wright et la Maison sur la Cascade
B. Les outils paramétriques : The mountain, BIG et Ycone, Jean Nouvel
C. Les outils génératifs : Stanislas Chaillou et Mjøstårnet, Voll Arkitekter

Frank Lloyd Wright est l'une des figures les plus emblématiques de l'architecture moderne. Né en 1867 et décédé en 1959, Wright a révolutionné la manière de concevoir et de percevoir les espaces architecturaux. Son style distinctif, caractérisé par des lignes épurées, une intégration harmonieuse avec l'environnement naturel et une utilisation novatrice des matériaux, a laissé une empreinte indélébile sur l'architecture.
Connu aujourd’hui pour les « Prairies houses » et le Guggenheim de New-York l’architecte a développé un ensemble de théories architecturales qui ont profondément influencé la pratique et laissé son empreinte sur l'architecture moderne. Ses idées étaient souvent en opposition avec les tendances dominantes de son époque, privilégiant une approche plus humaniste et contextuelle. Une approche centrée sur l’humain et ses sensations. Wright prônait une architecture en harmonie avec la nature, où les bâtiments devaient sembler s’intégrer naturellement de leur environnement. Il croyait que chaque construction devait respecter et compléter le paysage dans lequel elle s'insérait. Il accordait toujours une importance primordiale à la lumière naturelle et à l'espace ouvert. Il concevait des intérieurs lumineux et aérés, souvent avec de grandes fenêtres et des espaces interconnectés, créant une sensation de fluidité et de liberté. Il utilisait la lumière pour animer les espaces, jouer avec les ombres et mettre en valeur les matériaux.
Wright insistait sur l'utilisation de matériaux naturels et locaux. Il pensait que les matériaux devaient refléter l'authenticité et la vérité de la construction, et non pas être dissimulés sous des ornements superflus. Il utilisait fréquemment le bois, la pierre, et le verre pour créer des textures et des contrastes riches et variés. Inspiré par les principes du mouvement moderne, Wright croyait que la forme devait suivre la fonction. Il cherchait à éliminer les éléments inutiles, en se concentrant sur des lignes épurées et des formes simples. Cette simplicité ne signifiait pas une austérité, mais plutôt une élégance et une clarté dans la conception. Dans ses premières œuvres, notamment les maisons de la Prairie, Wright développait un style qui reflétait les vastes paysages de l'Amérique du Nord. Ces maisons étaient caractérisées par des toits plats ou à faible pente, des lignes horizontales étendues, et des plans ouverts. Elles visaient à créer une continuité entre l'intérieur et l'extérieur, renforçant le lien avec la nature.
Parmi ses œuvres les plus célèbres, la Maison sur la Cascade (Fallingwater), construite entre 1935 et 1939 en Pennsylvanie, se distingue par son intégration spectaculaire dans le paysage environnant et son utilisation audacieuse de structures en porte-à-faux. Elle incarne la vision de Wright de l'architecture organique, où le bâtiment et son environnement naturel sont en parfaite symbiose. Conçue pour le magnat des magasins de détail Edgar J. Kaufmann, la maison s'élève directement au-dessus d'une chute d'eau, créant une connexion unique entre l'architecture et la nature. Wright a utilisé une combinaison de béton, de pierre locale, d'acier et de verre pour réaliser cette œuvre maîtresse, qui continue d'inspirer et de fasciner les architectes et les amateurs d'architecture à travers le monde.
L'étude des outils de représentation manuels utilisés par Wright dans la conception de la Maison sur la Cascade est cruciale pour plusieurs raisons. Premièrement, elle permet de comprendre comment ces outils ont influencé la conception de l'espace et la création de l'atmosphère unique de la maison. Deuxièmement, elle offre des insights précieux sur le processus créatif de Wright et la manière dont il a surmonté les défis techniques et esthétiques pour réaliser sa vision.
Les objectifs de cette analyse sont triples. Premièrement, il s'agit de documenter et d'analyser en détail les croquis, esquisses et maquettes de Wright pour la Maison sur la Cascade afin de comprendre leur impact sur le processus de conception. Deuxièmement, cette étude vise à évaluer comment ces outils ont permis à Wright de surmonter les défis techniques et esthétiques de son projet. Troisièmement, il s'agit de tirer des leçons de l'approche de Wright pour proposer des recommandations sur la manière de combiner efficacement les compétences manuelles et numériques dans la pratique architecturale contemporaine.
fig 55 : Falling water, F.L W, 2002, Taschen
Le début du XXe siècle a vu l'émergence de plusieurs mouvements modernistes, dont le Bauhaus en Allemagne, le constructivisme en Russie, et le style international en Europe et aux États-Unis. Ces mouvements rejetaient les ornements excessifs des styles précédents, privilégiant des formes épurées, des lignes géométriques, et une fonction utilitaire. L'architecture moderne s'efforçait de répondre aux besoins sociaux et économiques de l'époque en utilisant des matériaux industriels tels que l'acier, le béton, et le verre.
Wright, bien qu'influencé par ces mouvements, a développé une vision unique et personnelle de l'architecture. Il a été un pionnier de l'architecture organique, prônant une intégration harmonieuse entre le bâtiment et son environnement naturel. Ses idées se sont souvent opposées aux tendances dominantes de l'architecture moderniste, favorisant une approche plus humaniste et contextuelle.
(Brooks, Gössel. 2002. Frank Lloyd Wright)



Frank Lloyd Wright utilisait plusieurs moyens de représentations dans son travail, alliant croquis et maquettes, les dessins et les maquettes de Frank Lloyd Wright sont remarquables tout comme les peintures se distinguent par leur spontanéité et leur expressivité. Souvent réalisées rapidement pour capturer une idée ou un ressenti du lieu. Les lignes fluides et les formes dynamiques des perspectives reflètent la pensée créative de l’architecte et sa capacité à envisager des concepts complexes dans des paysages singuliers.
Les croquis lui permettaient d'explorer librement les formes et les volumes et offraient une première vue d'ensemble des idées architecturales, servant de base pour les esquisses détaillées ultérieures. Les esquisses détaillées étaient caractérisées par leur précision et leur attention aux détails. Chaque ligne, chaque angle, et chaque proportion étaient soigneusement calculés pour refléter fidèlement les concepts architecturaux. Les esquisses incluaient souvent des annotations et des dimensions, offrant une compréhension claire de la structure et des éléments architecturaux. Elles permettaient aussi de définir les éléments architecturaux spécifiques, tels que les rencontres entre les fenêtres et les murs ou alors les vues et leurs paysages. Ces dessins offraient une connaissance plus approfondie des interactions entre les différents composants du bâtiment, aidant à anticiper le résultat de chaque assemblage.
Les maquettes lui permettaient aussi de tester l'apparence et la performance des matériaux dans des conditions réelles, aidant à choisir les meilleures options pour le projet final. Les maquettes offraient également une opportunité d'explorer les jeux d'ombre et de lumière, créant des ambiances variées et enrichissantes. Mais l’architecte est plus connu pour ses maquettes de situation très fidèle envers le site projet qui lui permettaient de saisir la topographie, les singularités du lieu et les palettes de couleurs de la zone dans laquelle le projet s’inscrit. (Brooks, Gössel. 2002. Frank Lloyd Wright)
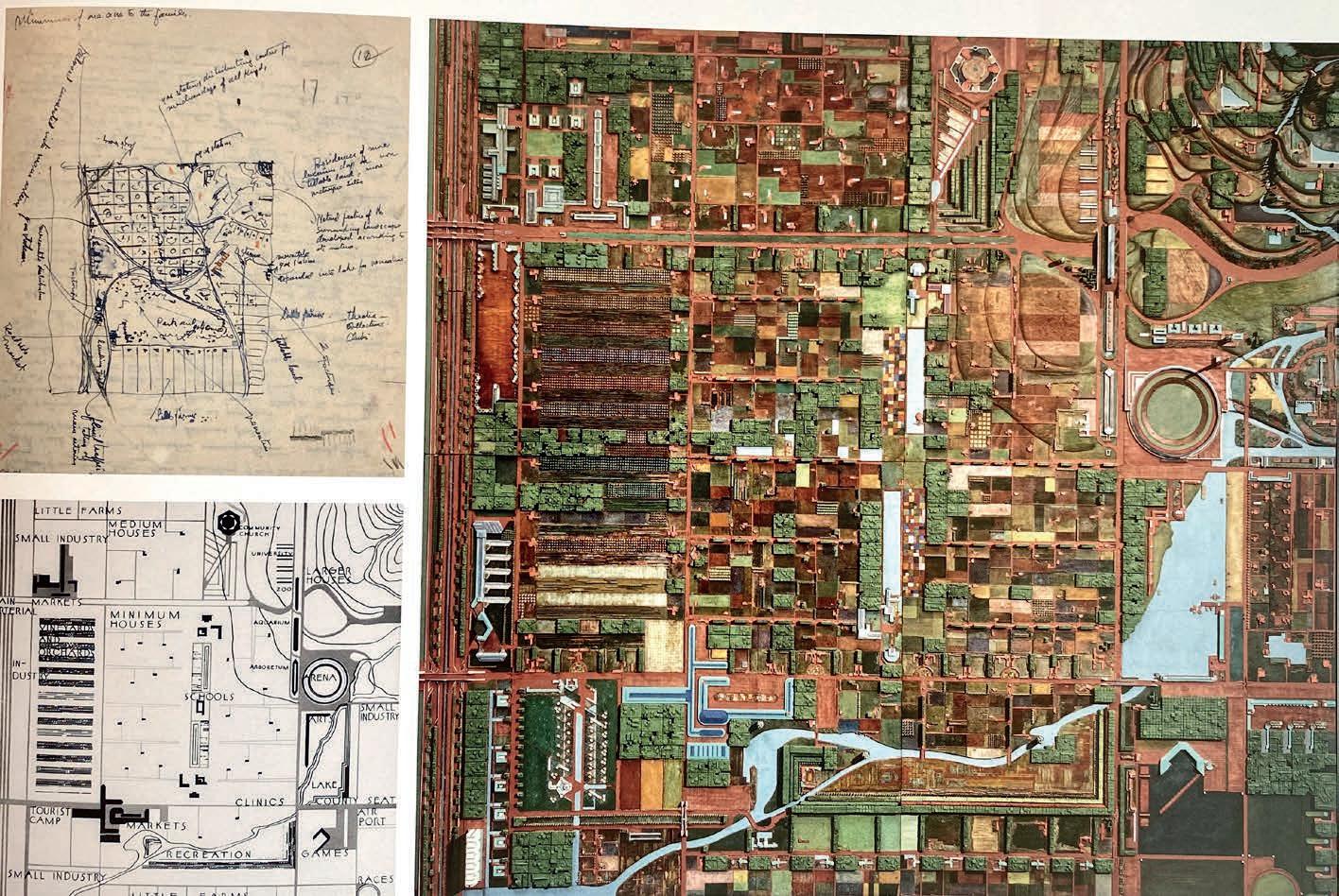

A.1.2
En plus de sa grande maitrise architecturale, Frank Lloyd Wright avait une passion pour la musique depuis son plus jeune âge. Il a même dirigé des orchestres, une expérience qui a enrichi sa compréhension du rythme et de l’harmonie, éléments qu’il a transposés dans son travail architectural. Dans le livre «Frank Lloyd Wright» de Bruce Brooks Pfeiffer et Peter Gossel, publié par les éditions Taschen, une double page est consacrée aux «hand movements». Ces mouvements de main sont des gestes explicatifs montrant comment Wright assemblait les éléments architecturaux. Ces gestes symbolisent l’interconnexion des murs et des structures pour former des espaces intégrés et harmonieux.
Wright voyait les matériaux et les éléments de construction comme des entités devant être « enfouies » ou « emboîtées » les unes dans les autres, concepts qu’il appelait « buried ». Cette approche reflète une pensée organique où chaque composant est intimement lié aux autres, créant une unité cohérente et intégrée. (Manufacturing Intellect, 2019. A Conversation with Frank Lloyd Wright (1953).)
«La musique et le rythme furent toujours des composantes primordiales de l'environnement architectural de Wright.» F.L W, 2002, Taschen

fig 58 - 60 : F.l Wright chef d’orchestre, et en interview à sa résidence de Taliesin, Il explique ses méthodes de conceptions, introduction, F.L W, 2002, Taschen

Pour comprendre comment l’architecte intégrait les nouveaux éléments architecturaux dans le contexte existant, décomposer les collages et photomontages en leurs éléments constitutifs est utile. En les examinant, on peut comprendre comment Wright a anticipé les interactions entre les nouvelles structures et l’environnement du lieu existant.
En suite, les différents médiums de représentation de l’artiste révèlent un procédé qui démarre par un jeu plastique avec une vision abstraite ou formelle, mais qui finit par se raccrocher à un élément remarquable du lieu et qui finalement permet au projet et aux concepts architecturaux de s’accorder tous ensemble.
Étudiant les techniques de superposition et de juxtaposition utilisées dans les collages, on comprend comment Wright a manipulé les images pour communiquer ses idées de manière efficace.
Les illustrations suivantes montent bien le processus, comme illustré (Fig 61), pour explorer des concepts de forme et de structure sans contraintes immédiates. Les motifs géométriques dans ces esquisses symbolisent des idées de proportion et de symétrie, lui permettant de s’expérimenter librement et de réfléchir à des formes novatrices. (Brooks, Gössel. 2002. Frank Lloyd Wright)
Le dessin détaillé d’une salle à manger (Fig 62) montre comment Wright intègre des éléments spécifiques du lieu, tels que le mobilier et l’aménagement intérieur, dans ses dessins. Ces détails soulignent l’importance qu’il accorde aux matériaux utilisés et à la manière dont la lumière interagit avec l’espace. L’arrangement spatial de ses dessins démontre comment l’espace intérieur est interagir l’environnement extérieur, un aspect crucial de sa philosophie organique.

fig 61 : F.l Wright dessin d’une tapisserie témoignant d’un grand intérêt pour les proportions, introduction, F.L W, 2002, Taschen

fig 64 : F.l Wright un dessin qui peut s’apparenter à une coupe ou simplement une décoration, F.L W, 2002, Taschen

fig 62 : F.l Wright Au sol un dessin de calepinage des mêmes formes géométriques que sur les tapisseries, F.L W, 2002, Taschen

Les dessins techniques (Fig 66) révèlent l’attention de Wright aux détails structurels et constructifs de ses projets. En utilisant des techniques de superposition et de juxtaposition, il montre comment les différents éléments architecturaux s’intègrent les uns aux autres. Cela permet de communiquer efficacement ses idées et de montrer la précision de son approche technique.
La photographie d’un corridor dans une résidence (Fig 64) illustre comment les espaces conçus par Wright s’intègrent harmonieusement dans leur environnement. Les matériaux naturels, comme le bois, et l’éclairage naturel créent des atmosphères chaleureuses et accueillantes, respectant la philosophie organique de Wright. Cette image capture également l’expérience spatiale, montrant l’importance de la fluidité entre les différents éléments architecturaux.


66 a : F.l Wright, Les dessins techniques témoignant du véritable travail de maitrise totale des éléments architecturaux, de leur forme et de chaque assemblage avec d’autres objets. Tous dessinés sur mesure, à la main, F.L W, Taschen
Le processus de conception de Frank Lloyd Wright commence par une phase d’expérimentation abstraite, où il explore des formes et des concepts sans contrainte. Ensuite, il contextualise ses idées en intégrant des éléments spécifiques du site, en utilisant des dessins techniques détaillés pour finaliser les aspects structurels. La superposition et la juxtaposition d’éléments dans ses représentations graphiques permettent de comprendre comment ses concepts architecturaux se traduisent en espaces construits. Wright attache une importance particulière à la matérialité, à la lumière et à l’expérience spatiale, assurant une harmonisation parfaite entre l’intérieur et l’extérieur de ses constructions.

66 b : F.l Wright, Les dessins techniques témoignent du véritable travail de maitrise totale des éléments architecturaux, de leur forme et de chaque assemblage avec d’autres objets. Tous dessinés sur mesure, à la main, F.L W, Taschen
A.2.1
La Maison sur la Cascade (Fallingwater) est un exemple parfait de l’approche holistique de Frank Lloyd Wright en matière de conception d’espace. Il a utilisé des croquis détaillés pour explorer et définir les proportions, les volumes et l’agencement spatial de la maison. Les plans et les coupes dessinés à la main montrent comment Wright a intégré la maison dans son environnement naturel, jouant avec les formes organiques pour créer des espaces qui harmonisent l’intérieur et l’extérieur.

fig 67 : Falling Water, Perspective montrant l’attention de Wright aux couleurs des matériaux projetés dans le contexte. De plus elle illustre l’idée organique de Wright et la notion de la maison cabane qui ne fait qu’un avec le milieu (tronc traversant la terrasse de gauche), F.L W, Taschen
Les croquis de Wright montrent une attention méticuleuse aux détails architecturaux, tels que les lignes fluides, les formes organiques et les interactions entre les différents éléments structurels. Les dessins capturent la fluidité et l’harmonie de l’espace intérieur et extérieur. Dans cette première perspective on remarque la restitution des couleurs du lieu dans les matériaux de construction, mais aussi la dualité murs verticaux en pierre signifiant la solidité et le rapport à la pierre et de l’autre coté les terrasses en béton lisse d’un couleur plus légère. On remarque aussi que les angles des terrasses en béton sont représentés vifs, ce qui évolue par la suite.
En examinant les plans de «Falling water», on remarque que la maison est stratégiquement placée au nord de la rivière, ou plus précisément de la cascade. Cette position permet d’orienter les terrasses vers le sud, maximisant ainsi l’ensoleillement et offrant des vues imprenables sur la nature environnante.
À l’intérieur, les plans révèlent une distinction nette entre les murs porteurs et les éléments plus légers de la structure. Les murs porteurs, en pierre apparente, sont situés côté nord. Cette disposition permet de placer ces murs sur un sol rocheux stable, assurant une fondation solide pour la maison. En contraste, la partie sud de la maison est conçue avec des murs plus fins ou des colonnes, favorisant l’ouverture et la légèreté, conformément au concept de plan libre. Cette zone sud s’ouvre largement sur des terrasses, intégrant l’extérieur à l’intérieur. (Brooks, Gössel. 2002. Frank Lloyd Wright)
Les plans montrent également l’aménagement de la partie basse du rez-de-chaussée en lien direct avec la rivière, et du bel étage, où se trouve le salon. Les sols intérieurs sont dessinés avec des pierres, soulignant la continuité matérielle entre l’intérieur et l’extérieur. Les murs porteurs sont pochés en noir sur les plans, indiquant clairement leur fonction structurelle et permettant de visualiser la pénétration lumineuse à travers les murs légers percés de fenêtres.
fig 68 : Falling water, Procésus de conception, les


fig 69 : Falling water, Les dessins ou la matérialité et les formes commences à ce préciser, les gardes corps commencent à perdre leurs arêtes saillantes et la forme s’adoucit F.L W, Taschen
Frank Lloyd Wright a intentionnellement rompu avec l’idée moderniste, qu’il qualifiait de «fasciste», des angles fermés. Il a donc intégré des fenêtres d’angle du sol au plafond pour ouvrir les angles sur le paysage, créant ainsi une interaction fluide entre l’intérieur et l’extérieur. Les matériaux lourds en pierre contrastent avec les éléments en béton travaillés pour donner un effet de légèreté, tels que les gardecorps et les terrasses. Ces éléments en béton sont arrondis, sans angles saillants, ajoutant une dimension organique et légère à l’ensemble. (Manufacturing Intellect, 2019. A Conversation with Frank Lloyd Wright (1953).)
L’analyse des plans révèle une intégration qualitative des principes architecturaux organiques, utilisant la matérialité et la lumière pour créer une harmonie entre la maison et son environnement naturel, enrichissant ainsi l’espace sensoriel. Les croquis et esquisses ont permis à Wright de s’assurer que chaque espace fonctionne harmonieusement avec le reste de la maison, tandis que les esquisses ont aidé à trouver la meilleure configuration spatiale.


fig 70 : Falling water, Dessins techniques F.L W,
fig 71 : Falling water, Dessins techniques, F.L W,
fig 72 : Falling water, Dessins techniques finaux qui témoignes de l’importance du matériau et de sa relation avec la lumière, on voit clairement le poché du plan et l’on devine le degré d’ouverture vers les terrasses et le sud, F.L W, Taschen

Tout d’abord, il est important de noter que Wright a, tout au long de sa carrière, réalisé un grand nombre de projets avec une vision très claire de la manière dont les éléments se combinent entre croquis, dessins, perspectives et leur matérialisation dans le projet. Pour explorer ce rapport, nous allons analyser les atmosphères réelles créées en se basant sur des photographies d’époque et en commentant la composition des plans. Nous nous intéresserons particulièrement à la disposition des espaces, leur orientation et l’ouverture vers l’extérieur donné par les percements et l’impacte de l’ensemble sur l’espace perçu.
Les percements dans les murs, les fenêtres et les ouvertures jouent un rôle crucial en permettant une interaction fluide entre l’intérieur et l’extérieur, maximisant l’entrée de lumière naturelle et offrant des vues destinées à captiver les occupants. Ces éléments sont essentiels pour comprendre comment Wright a réussi à créer des atmosphères immersives et dynamiques. Il est évident que chaque choix de placement et d’orientation des espaces vise à enrichir l’expérience sensorielle des occupants.





fig 75 : Falling water, Ces photographies montrent la matérialisation des concepts employés pour concevoir les plans, l’espace est baigné de lumière , les vues sont cadrées et l’intérieur donne l’impression que l’extérieur s’est invité, cela grâce aux détails de pierre au mur et au sol et grâce au jeu de couleur intérieure rappelant les couleurs de la nature entourant la maison au cours des saisons, F.L W, Taschen

Les images présentées de la maison Falling Water de Frank Lloyd Wright transmettent une atmosphère caractérisée par une horizontalité marquée et une impression de légèreté. L’horizontalité est une caractéristique dominante dans ces images. Les lignes longues et basses des terrasses en porte-à-faux s’étendent parallèlement au sol, accentuant une connexion fluide avec le paysage environnant. Cette horizontalité donne une sensation de stabilité et d’harmonie avec la nature, une signature de l’architecture organique de Wright. La légèreté est également omniprésente dans ces images. Les terrasses en porteà-faux semblent flotter au-dessus de la cascade, renforçant l’impression que la maison est suspendue dans l’air. Cette illusion de légèreté est obtenue grâce à l’utilisation habile de matériaux comme le béton et le verre, qui permettent des structures robustes, mais visuellement aériennes.
Les matériaux naturels, comme la pierre locale utilisée pour les murs, renforcent cette intégration avec le paysage environnant. Les fenêtres larges et les surfaces vitrées permettent une vue panoramique sur la forêt et la cascade, brouillant les frontières entre l’intérieur et l’extérieur. Les images dégagent une ambiance naturelle et paisible, où l’architecture se fond parfaitement avec son environnement. La lumière naturelle inonde les espaces intérieurs, créant une atmosphère sereine et invitante.
L’intégration des éléments architecturaux, tels que les murs en pierre qui semblent s’entrelacer avec les terrasses en béton, illustre la philosophie de Wright de l’emboîtement et de l’entrelacement des matériaux. Cette approche crée une continuité visuelle et structurelle, renforçant l’harmonie globale de la conception. (Washington Noé, 2013. The Falling Water House)

Frank Lloyd Wright a mis un accent particulier sur l’expérience sensorielle dans la conception de Fallingwater, cherchant à engager tous les sens des occupants pour créer une atmosphère immersive. Le bruit constant et apaisant de la cascade sous la maison contribue à une ambiance sereine et naturelle, renforçant la connexion avec l’environnement. La texture des matériaux est également soigneusement choisie : les sols en pierre rugueuse offrent une sensation tactile distincte sous les pieds, tandis que les surfaces lisses des murs en béton contrastent avec la rugosité des pierres apparentes.
La maison Fallingwater ne se contente pas d’offrir une vue spectaculaire sur la nature environnante, elle sert également de décor enchanteur pour les usagers qui se baignent dans la rivière en contrebas. La structure, avec ses terrasses suspendues et ses murs en pierre locale, sublime la cascade, créant une harmonie visuelle et sensorielle avec le paysage. Les matériaux et leurs teintes naturelles permettent à la maison de se fondre parfaitement dans le décor, renforçant l’idée d’une architecture en symbiose avec son environnement. La présence de la maison enrichit ainsi l’expérience naturelle, transformant chaque baignade en une immersion totale dans un cadre à la fois construit et sauvage.
Enfin, l’intention de Wright avec Fallingwater est de faire ressentir à l’utilisateur qu’il est à l’intérieur d’un objet avec ses propres codes, éléments, et règles, toujours présents et fonctionnant ensemble harmonieusement. Cette cohérence permet à l’usager de se repérer dans le bâtiment et de reconnaître sa singularité à tout moment. Malgré une matérialité riche et texturée, l’usager perçoit toujours la personnalité unique de l’édifice, résultant de l’assemblage et de la conjugaison entre la nature, l’esprit du lieu, et l’atmosphère des espaces. Ce lien profond avec l’environnement naturel renforce l’expérience immersive et cohérente qu’offre Fallingwater. (Manufacturing Intellect, 2019. A Conversation with Frank Lloyd Wright (1953).)


fig 77 : Falling water, On retrouve ici un principe d’assemblage qu’il appelle «enfois» les cadres des fenêtres disparaissent enfoncés dans la pierre, cela donne évidemment une impression de légèreté, F.L W, Taschen
fig 78 : Wright était très intéressé par le design de tapisserie et de collection de mobilier, F.L W, Taschen



fig 79 : La palette de couleur de l’architecte réalisée pour un projet particulier, F.L W, Taschen
Frank Lloyd Wright a reconnu l’importance cruciale d’une communication claire et détaillée pour la réussite de ses projets, notamment pour Fallingwater. Le chantier de Fallingwater, initié au printemps 1936, a débuté avec la contribution d’un seul petit artisan local, responsable de la mise en place du béton aidé par les assistants de Franck Lloyd Wright. Sa stratégie de communication sur le chantier se déclinait en plusieurs aspects clés. (Manufacturing Intellect, 2019. A Conversation with Frank Lloyd Wright (1953).)
Les bout en bout, assurant la continuité des concepts architecturaux de l’architecte. Wright, bien que présent occasionnellement, déléguait la supervision quotidienne à ses étudiants, probablement une dizaine sur place,
Les matériaux utilisés, considérés comme organiques à l’époque, comprenaient les pierres locales venant châssis approche organique.
Tous les meubles et éléments de menuiserie de la maison, dessinés par Wright, ont été probablement fabriqués dans les ateliers de Taliesin ou directement sur le site de Fallingwater par les étudiants et assistants de Wright. Cette démarche a permis une cohérence esthétique et fonctionnelle, garantissant que chaque détail répondait aux intentions de l’architecte.
À tout moment, des personnes formées et imprégnées de la vision de Wright étaient présentes sur le chantier, présence qui incarne pleinement la philosophie de Wright.
Wright s’assurait que les ouvriers comprenaient non seulement les directives techniques, mais aussi les intentions derrière chaque décision de conception. Il expliquait comment chaque élément architectural contribuait à l’ensemble, ce qui permettait aux ouvriers de saisir l’importance de la précision et de l’exécution
Les dessins de Wright étaient accompagnés de notes explicatives et de directives précises. Ces annotations comprenaient des instructions sur les techniques de construction, les matériaux à utiliser, et pierres de la cascade pour maximiser leur intégration naturelle. SOURVE Vidéo et livre

fig 80 : Falling water, Photos du chantier ou l’on voit le travail des artisans et des assistants de Wright sur place au quotidien pour guider les artisans F.L W, Taschen
Wright a fourni des plans et des esquisses très détaillés, incluant des annotations précises pour guider les ouvriers. Ces documents étaient essentiels pour traduire sa vision en directives concrètes, couvrant des aspects tels que les proportions, les matériaux et les techniques de construction.
Wright utilisait ses apprentis comme relais sur le chantier, leur inculquant ses méthodes et s’assurant qu’ils pouvaient transmettre ses instructions aux ouvriers de manière précise et cohérente.
Conscient que la main-d’œuvre locale n’était pas initialement familière avec ses techniques, Wright a organisé des formations rapides pour les ouvriers, les éduquant sur les spécificités de son approche architecturale.
L’entrepreneur local, bien que superviseur principal, suivait les directives strictes de Wright, assurant que chaque étape de la construction respectait le design original. Cette supervision constante était cruciale pour maintenir l’intégrité de la conception de Wright.
Wright a insisté pour que les pierres soient coupées localement, intégrant ainsi l’architecture dans son environnement immédiat et renforçant l’harmonie entre la maison et la nature.
Malgré les doutes de certains experts locaux sur la viabilité de son design, Wright a persévéré, démontrant par la réalisation même de Fallingwater que ses concepts étaient non seulement innovants, mais également réalisables et durables.
Ces stratégies ont permis à Wright de surmonter les défis de la construction de Fallingwater, en assurant que l’idée originale reste intacte et que l’exécution sur le chantier reflète fidèlement sa vision architecturale. Finalement, la réussite de Fallingwater réside dans la gestion rigoureuse et la supervision continue du chantier, assurée par Wright et ses apprentis, qui ont transformé les concepts architecturaux en une réalité sensorielle et organique.

Premièrement, cette analyse met en évidence que ce travail est le résultat de la vision de Frank Lloyd Wright, la vision ayant été portée par tous les travailleurs qui ont été impliqués dans ce projet, de par les assistants et étudiants de Frank Lloyd Wright qui étaient majoritaires sur le chantier, sur place, et qui ont pu s’assurer que la vision de l’architecte soit respectée et surtout comprise par les autres ouvriers comme l’entreprise de construction qui a conçu le béton.
Deuxièmement c’est le travail d’une seule et même équipe qui a été responsable de chantier et de la conception du premier coup de crayon jusqu’à la fin du chantier, sachant qu’en plus le fils du client était étudiant et assistant de l’architecte et que par conséquent même les choix et les décisions techniques et spatiales qui nécessitaient l’avis du client ont pu être prises sur place et très rapidement et avec une grande connaissance des avantages et des inconvénients du choix à faire.
Toute cette situation presque parfaite a permis à l’architecte, à l’équipe et au chantier de rencontrer très peu de problématiques de compréhension des différents acteurs, d’éviter au maximum les compromis esthétiques et/ou les sabotages conceptuels, ce qu’on retrouve souvent dans les chantiers actuels de par des acteurs techniques qui pour des raisons techniques ou des normes techniques sont obligés de faire reculer l’architecte dans sa vision. Et donc la communication renforcée par les architectes sur place pour produire les détails, les croquis, sélectionner les pierres et les matériaux ont permis vraiment à magnifier la construction.

Pour revenir sur le sujet principal du mémoire qui est les outils, ici c’est l’utilisation des outils manuels directs entre le concept, la planche à dessin et la réalisation qui est l’élément ou le processus clé de ce projet. C’est parce que les outils manuels étaient sur place et utilisés par les architectes qui eux aussi étaient sur place qui ont permis vraiment ce niveau de détail, ce niveau de maîtrise.
Les analyses menées sur l’utilisation des outils de représentation manuels à travers le travail de Frank Lloyd Wright ont révélé des enseignements précieux sur le rôle de ces techniques dans la conception d’atmosphères. Wright, par son usage habile des croquis, et des perspectives colorés, a démontré comment ces outils peuvent servir de fondement à l’appréhension du contexte et à la définition précise des éléments d’architecture.
L’étude a également mis en lumière l’importance de la visualisation détaillée des concepts architecturaux, les outils manuels directement présents sur le lieu de construction ont facilité la communication des idées entre Wright et les parties prenantes, renforçant ainsi la collaboration et la cohérence du projet. Les documents analysés montrent comment chaque aspect de la conception a évolué, de la première idée aux détails fins, en passant par l’ajustement des proportions et des volumes pour créer un ensemble harmonieux et fonctionnel. Ils permettent aux architectes de traduire rapidement leurs idées en formes visuelles, d’explorer diverses solutions et de tester l’impact des matériaux, de la lumière et des volumes. Cette méthode de travail favorise une approche holistique de la conception, où chaque élément est soigneusement étudié et ajusté pour s’intégrer harmonieusement dans l’ensemble du projet.
Cependant, bien que les outils manuels offrent une grande liberté créative dans certains cas, ils présentent certaines limites. En effet, ils peuvent manquer de la précision millimétrique nécessaire pour les aspects techniques complexes des projets architecturaux. Les erreurs potentielles dans les dimensions et les proportions peuvent entraîner des ajustements coûteux et chronophages pendant la phase de construction. De plus, la création de croquis détaillés, de maquettes et de collages nécessite un investissement significatif en temps et en ressources, ce qui peut devenir une contrainte pour les projets à grande échelle ou avec des délais serrés.
L’évolution vers les outils numériques permet de surmonter certaines de ces limitations en offrant des capacités de modélisation et de simulation avancées. Cependant, il est important de reconnaître que les outils numériques ne remplacent pas entièrement le processus de conception architecturale, la main à toujours son rôle à jouer à travers les croquis et la recherche en utilisant le calque, bien qu’il digitalise la production graphique finale.




L’intégration des outils digitaux dans l’architecture moderne a révolutionné la manière dont les projets sont conçus, planifiés et réalisés. Cette partie explore l’impact de ces technologies à travers l’analyse de deux projets emblématiques : The Mountain de BIG (Bjarke Ingels Group) et Ycone de Jean Nouvel.
The Mountain de BIG (2008), (photo 1),
Le projet The Mountain situé à Copenhague, Danemark, est une réalisation architecturale innovante qui combine logements et espaces de stationnement. Conçu par le Bjarke Ingels Group (BIG) en 2008, ce projet exemplifie l’utilisation pionnière de la modélisation numérique pour résoudre des défis complexes de design et de fonctionnalité.
BIG a utilisé des outils de modélisation 3D avancés pour créer une structure en terrasses où chaque appartement bénéficie d’un jardin privé et d’une vue dégagée. La superposition des unités résidentielles au-dessus d’un parking en terrasses a été optimisée grâce à des simulations numériques, permettant de maximiser l’espace disponible et d’assurer une distribution homogène de la lumière naturelle. Les outils BIM (Building Information Modeling) ont joué un rôle crucial dans la coordination des différents aspects du projet, du design initial à la construction finale, en assurant une communication fluide entre les architectes, ingénieurs et entrepreneurs.
Ycone de Jean Nouvel (2019), (photo 2),
Ycone, conçu par Jean Nouvel et achevé en 2019, est un autre exemple remarquable de l’utilisation des technologies numériques dans l’architecture résidentielle. Situé à Lyon, France, Ycone est une tour résidentielle de 86 mètres de hauteur qui se distingue par son design audacieux et ses innovations technologiques.
Jean Nouvel a exploité les outils numériques pour concevoir une structure dynamique et sculpturale, avec des façades en verre et en métal qui changent de couleur et de texture selon la lumière du jour. Les logiciels de modélisation paramétrique ont permis de simuler les effets de la lumière sur les façades et d’optimiser l’utilisation des matériaux pour des performances énergétiques élevées. Le BIM a également été utilisé pour gérer les complexités de la construction en haute densité urbaine, en assurant la précision et l’efficacité des travaux sur site.
Ces deux projets illustrent comment les outils digitaux transforment l’architecture contemporaine, en permettant une plus grande précision, une meilleure collaboration et une optimisation des ressources. À travers l’analyse de The Mountain et Ycone, nous explorerons les bénéfices et les défis de l’utilisation des technologies numériques dans la création d’espaces résidentiels innovants et durables.
L’analyse se porte particulièrement sur ces exemples, car ils représentent deux aspects représentatifs de l’architecture paramétrique. Pour The Mountain, la schématisation est un élément clé : le bâtiment est une matérialisation du schéma de l’idée de l’architecte, illustrant comment une idée conceptuelle peut être transformée en une structure physique complexe grâce aux outils numériques. Pour Ycone, la façade ingénieusement conçue ressort fortement et contraste avec le reste de la conception de l’immeuble, mettant en évidence l’impact des technologies paramétriques sur des éléments architecturaux spécifiques et leur intégration dans l’ensemble du projet.
Cependant, pour comprendre pleinement la logique de ces projets, il est essentiel de revenir sur le contexte historique entre 1980 et 2000, car l’évolution des outils de conception architecturale au cours de cette période est une charnière. Celle-ci a vu une transition des méthodes manuelles traditionnelles vers l’adoption progressive des techniques digitales et paramétriques. Cette exploration nous permettra de mieux appréhender les innovations actuelles et de situer les projets The Mountain et Ycone dans un continuum historique de transformation de la pratique architecturale.
fig 83 et 84 : The mountain de BIG (2008) et Ycone de Jean Nouvelle (2019) Archdaily
Premièrement, bien comprendre l’impact des outils digitaux sur l’architecture contemporaine, il est essentiel de se pencher sur l’évolution historique du logement et de ses atmosphères. L’analyse de la collection des livres DOMUS (1928-1979) nous offre une perspective riche sur cette évolution. Ces articles retracent l’histoire du logement à travers différentes phases, illustrées par des figures emblématiques comme Gio Ponti.

Dans les années 1940, Gio Ponti, architecte et designer italien, a joué un rôle crucial dans la redéfinition de l’habitat individuel. Ponti, à travers ses conceptions et ses articles dans DOMUS, a promu une vision de la maison qui combine esthétique, fonctionnalité et une profonde interaction avec l’environnement. Ses projets mettaient l’accent sur l’intégration de l’art et de l’architecture, créant des espaces harmonieux et personnalisés qui répondaient aux besoins individuels de ses occupants.






L’après-guerre a également marqué une période de fascination pour les objets de la maison, alimentée par l’essor de l’industrie et du design. Les articles de DOMUS de cette époque reflètent un intérêt croissant pour les produits manufacturés, qui promettaient de transformer la vie domestique par l’innovation et la commodité. Cette fascination pour les objets allait au-delà de la simple fonctionnalité; elle représentait une nouvelle esthétique de la modernité, où chaque élément du foyer était conçu pour améliorer l’expérience quotidienne des habitants. (Domus 1960-1969, Domus 437 - 443- 494)














Un exemple notable est le Palais des Congrès de Lucerne par Jean Nouvel, où le verre et l’acier sont

Metz de Shigeru Ban et Jean de Gastines illustre également cette tendance, avec une structure en bois



Avec l’arrivée des logiciels paramétriques et des nouvelles technologies de conception assistée par permettent aux architectes de concevoir des structures complexes et organiques qui seraient impossibles
L’Opéra de Pékin de Paul Andreu et le Phaeno Science Center de Zaha Hadid sont des exemples de cette tendance où l’espace devient une sculpture dynamique. Ces projets utilisent les capacités des logiciels paramétriques pour créer des formes innovantes et des espaces immersifs. Les structures courbes et les


L’évolution de la composition architecturale entre les années 90’ et 2000’ montre la transition des grands projets concrets traduisant littéralement des schémas en formes bâties, à l’ostentation des matériaux utilisés comme éléments de prestige, jusqu’à l’incurvation de l’espace grâce aux logiciels paramétriques. Cette évolution illustre non seulement les innovations techniques, mais aussi une exploration continue de

Bjarke Ingels, né le 2 octobre 1974 à Copenhague, Danemark, est l’un des architectes les plus novateurs et influents du XXIe siècle. Il a poursuivi ses d’architecture à l’Académie Royale Danoise des BeauxArts, École d’Architecture, où il a été influencé traditions modernistes et fonctionnalistes du design scandinave.(Wikipédia, 2024. Bjarke Ingels)
Bjarke Ingels a commencé sa carrière professionnelle en travaillant avec la célèbre firme d’architecture (Office for Metropolitan Architecture) sous la direction de Rem Koolhaas. Cette expérience chez OMA a été cruciale pour son développement, car elle l’a exposé à des projets innovants de grande envergure et aux complexités de l’architecture urbaine. L’influence de Koolhaas est évidente dans le travail d’Ingels, notamment dans son approche de la fusion entre l’architecture et l’urbanisme et son intérêt pour l’interaction entre les bâtiments et leur environnement.

fig 114 : Bjark Ingels, «Cartooning», Depuis enfant il voulait être créateur de bandes dessinées et dans cette illustration il dessine de cette manière, Archdaily, 2022
En 2001, après avoir acquis une précieuse expérience chez OMA, Ingels a cofondé son premier studio, PLOT Architects, avec l’architecte Julien De Smedt. PLOT a rapidement gagné en reconnaissance grâce à ses designs audacieux et non conventionnels, tels que les VM Houses à Copenhague, qui présentaient des appartements de formes irrégulières pour maximiser les vues et la lumière. Ce projet a été un succès critique et a marqué Ingels comme une étoile montante dans le monde de l’architecture.
En 2005, Bjarke Ingels a créé le Bjarke Ingels Group (BIG), un studio qui est depuis devenu synonyme de design durable et de pointe. L’approche de BIG est caractérisée par un utopisme pragmatique qui vise à intégrer le développement durable à l’innovation architecturale. Les projets de la firme défient souvent les normes architecturales conventionnelles et repoussent les limites de ce que les bâtiments peuvent accomplir.
L’un des premiers projets notables de BIG fut les Mountain Dwellings (2008) à Copenhague, un bâtiment résidentiel qui combine parking et logements dans une structure en terrasse unique. Chaque appartement dispose d’un jardin et d’une vue magnifique, démontrant l’engagement d’Ingels à intégrer la nature dans les espaces de vie urbains. Ce projet a solidifié la réputation de BIG en tant que pionnier du design inventif et respectueux de l’environnement.
La philosophie architecturale de Bjarke Ingels repose sur l’idée que les bâtiments doivent être conçus pour améliorer la qualité de vie de leurs utilisateurs et contribuer positivement à leur environnement. Il met l’accent sur la durabilité non pas comme un ajout, mais comme une partie intégrante du processus de conception. Ses projets incorporent souvent des technologies vertes, des sources d’énergie renouvelable et des designs qui favorisent l’interaction sociale et la communauté.
L’influence d’Ingels s’étend au-delà de l’architecture dans les domaines de la planification urbaine et du design environnemental. Ses idées sur la façon dont les villes peuvent croître de manière durable et innovante façonnent l’avenir du développement urbain à l’échelle mondiale.
Bjarke Ingels est une figure transformative dans l’architecture contemporaine. Son travail, caractérisé par des designs innovants et un engagement envers la durabilité, continue d’inspirer les architectes et les urbanistes du monde entier. Grâce à BIG, Ingels a redéfini les possibilités du design architectural, alliant praticité et esthétique visionnaire pour créer des bâtiments qui ne sont pas seulement fonctionnels, mais aussi enrichissants pour la vie de ceux qui les utilisent.
Bjarke Ingels et son équipe sont connus pour leur approche conceptuelle innovante, souvent décrite comme «l’utopie pragmatique». Elle utilise des diagrammes simples et clairs pour expliquer les idées de conception complexes, essentiels pour communiquer les idées aux clients, aux parties prenantes et au grand public. Les projets racontent souvent une histoire ou chaque élément de composition a une raison d’être, contribuant à une narration cohérente qui renforce la compréhension et l’acceptation du projet.
BIG place l’utilisateur au centre de ses conceptions, leurs projets sont conçus pour améliorer l’expérience des occupants, en créant des espaces qui sont à la fois fonctionnels et esthétiquement plaisants. Le studio implique souvent les utilisateurs dans le processus de conception, recueillant leurs avis et suggestions pour créer des espaces qui répondent à leurs besoins réels. L’architecture de l’agence est conçue pour stimuler les sens, en utilisant des matériaux, des textures et des jeux de lumière pour créer des atmosphères immersives et engageantes. (ArchDaily, 2008. Mountain Dwellings)
L’équipe de Bjarke intègre largement les technologies numériques dans son processus de conception. Ceux-ci leur permettent de visualiser, simuler et optimiser les projets avant leur réalisation, de tester différentes configurations et de prévoir les impacts visuels et environnementaux. Les simulations numériques sont utilisées pour analyser les performances énergétiques, l’éclairage naturel, la circulation de l’air... Ce processus permet aux équipes d’optimiser la conception afin d’améliorer le confort et l’efficacité des bâtiments.

fig 115 - 117 : Design process, Le design est très droit au but, en danois le mot architecte se traduit par «Form giving» ce qu’il prend au pied de la lettre au moins au début du processus de création, BIG


«The Mountain» est un projet résidentiel novateur situé à Copenhague, conçu par le cabinet d’architecture Bjarke Ingels Group (BIG). Achevé en 2008, ce projet combine ingénieusement des espaces résidentiels et des espaces de stationnement dans une structure unique qui évoque une montagne artificielle. La conception répond à plusieurs objectifs, notamment l’optimisation de la lumière naturelle, la maximisation des vues et la création d’espaces verts pour les résidents.
Le projet se compose de 80 appartements, chacun bénéficiant d’une grande terrasse ensoleillée. Les unités résidentielles sont empilées en une structure pyramidale, chaque niveau de l’immeuble étant légèrement en retrait par rapport à celui en dessous, ce qui crée des terrasses en cascade. Ces terrasses sont orientées vers le sud, permettant une exposition maximale au soleil, ce qui est essentiel dans le climat nordique de Copenhague. (Arquitectura Viva. «Viviendas Mountain Dwellings»)
L’un des aspects les plus innovants de «The Mountain» est l’intégration des espaces de stationnement au sein de la structure. Les appartements résidentiels sont construits au-dessus d’un parking de 10 étages, qui constitue la base de la «montagne». Cette conception permet de libérer l’espace au sol pour d’autres utilisations et d’offrir une vue imprenable depuis les terrasses des appartements.



BIG a utilisé des technologies numériques avancées pour la conception et la réalisation de «The Mountain». Les logiciels de modélisation 3D ont permis de simuler différentes configurations et d’optimiser la disposition des appartements pour maximiser la lumière naturelle et les vues. Les simulations numériques ont également aidé à planifier l’intégration des espaces de stationnement et à concevoir la façade en métal perforé.
La forme pyramidale de l’ensemble est obtenue en alignant les terrasses de manière à créer une série de plates-formes en escalier. Chaque niveau est décalé pour offrir des vues non obstruées et un ensoleillement optimal, faisant de chaque appartement un espace unique et lumineux.
Les coupes transversales et les élévations révèlent une juxtaposition claire entre les espaces résidentiels et les espaces de stationnement. Le socle en béton abrite le parking, avec des rampes internes assurant une circulation fluide des véhicules. Les niveaux résidentiels, situés au-dessus, s’étendent en terrasses ouvertes, offrant une interaction harmonieuse entre les espaces intérieurs et extérieurs.

fig 121 - 122 : The Moutain, Plan,

123:
La circulation interne des voitures est optimisée par un système de rampes intégrées, assurant un flux continu et efficace des véhicules à tous les niveaux du parking. Les résidents bénéficient d’un accès direct et sécurisé à leurs appartements depuis les espaces de stationnement, ajoutant une dimension pratique et sécurisée au projet.
Dans le projet “The Mountain” de BIG, un aspect frappant est la prédominance des détails techniques de construction sur l’ensemble des documents produits par l’agence. Les plans, sections et dessins fournis mettent en avant une minutieuse attention aux techniques d’assemblage sur le site des différentes pièces préfabriquées. (Arquitectura Viva. «Viviendas Mountain Dwellings»)
Cependant, on remarque qu’il y a très peu, voire pas du tout, de plans habités illustrant les usages des futurs résidents. Les documents ne montrent pas comment les habitants vont pratiquer, habiter et vivre dans ces espaces. Cette absence de représentation des usages et de la vie quotidienne des résidents dans les plans contraste avec l’importance accordée aux aspects techniques de la construction. Cela soulève des questions sur la manière dont l’espace sera réellement vécu et utilisé par ses occupants, et laisse une part d’incertitude sur l’expérience quotidienne des résidents dans ce projet architectural.





fig 124 - 128: The Moutain, Détails, Voici une collection de détails techniques qui contrastes avec ceux de Wright plus haut ou ici le résultat sensible n’est pas considéré, 2008, BIG

fig 129: The Moutain, Plan type dénué de tout contexte, voisinage et/ou masses vues en plan comme les terrasses des voisins , 2008, BIG
Le plan est extrêmement pragmatique, répondant aux besoins de base des habitants avec une disposition efficace. Cela reflète l’approche de BIG en matière de design, qui privilégie la fonctionnalité. La simplicité du plan, avec peu de murs et une disposition ouverte, crée une atmosphère minimaliste. Cela peut être perçu comme apaisant et contemporain, mais aussi un peu stérile sans personnalisation par les habitants. La grande terrasse et les baies vitrées laissent entrer beaucoup de lumière naturelle, créant une atmosphère lumineuse et aérée. La fluidité entre les espaces intérieurs et extérieurs est un point fort de ce design. Le plan, en étant vide et minimaliste, ne montre pas comment les habitants pourraient personnaliser l’espace pour répondre à leurs besoins et styles de vie spécifiques. Cela peut donner une impression de déconnexion par rapport à l’usage réel des espaces.
Ce plan d’appartement de “The Mountain” est un exemple typique du pragmatisme et du minimalisme de BIG. Bien que fonctionnel et efficace, il manque d’indications sur la personnalisation et l’usage réel par les habitants. La conception ouverte et lumineuse offre une bonne qualité de vie, mais la prédominance du béton et le vis-à-vis peuvent réduire le confort et l’intimité, créant un décalage entre les intentions initiales et la réalité perçue des espaces.
La conception de «The Mountain» par Bjarke Ingels Group (BIG) témoigne de leur grande appétence pour les détails techniques de construction et leur maîtrise des logiciels paramétriques, cependant, cette focalisation sur l’ingénierie et la technologie pourrait soulever des questions quant à la prise en compte des usages réels des habitants et la qualité de vie au sein des espaces créés.


L’atmosphère ressentie dans le projet “The Mountain” de BIG, à travers les images fournies, est particulièrement intéressante. Ce projet se distingue par son approche innovante de la composition spatiale, intégrant à la fois des espaces résidentiels et des aménagements paysagers, tout en créant une interaction dynamique avec l’environnement urbain.
Les terrasses en cascade, visibles sur les photos, permettent une transition harmonieuse entre les espaces intérieurs et extérieurs. Chaque appartement bénéficie d’un accès direct à une terrasse de jardin, créant ainsi une continuité visuelle et physique avec la nature. Cette conception permet non seulement d’offrir des vues panoramiques sur la ville environnante, mais aussi de maximiser l’ensoleillement et la ventilation naturelle, renforçant ainsi le confort des résidents.
À l’intérieur, les espaces sont lumineux et ouverts. Les grandes baies vitrées et les portes-fenêtres laissent entrer une abondante lumière naturelle, accentuant le sentiment d’ouverture et de connexion avec l’extérieur. Les matériaux utilisés, tels que le bois et le béton, sont à la fois modernes et chaleureux, créant une ambiance conviviale et accueillante. Le contraste entre les surfaces lisses et les textures naturelles ajoute une dimension tactile à l’expérience spatiale.




Cependant on remarque que l’univers de The Mountain est très minéral et bétonné, cette matérialité prend toute la place dans le système de parking, qui sert également d’entrée au bâtiment. Cette omniprésence du béton crée une atmosphère presque austère, qui peut contraster fortement avec les attentes initiales d’un cadre de vie plus naturel et chaleureux. Ces espaces de stationnement, intégrés au cœur du bâtiment, bien que pratique, peuvent nuire à l’accueil et à la convivialité des espaces d’entrée, donnant une première impression froide et industrielle. (Denis, Almer, 2015. This is not a mountain)
À l’intérieur des logements, les terrasses offrent certes des espaces extérieurs privés, mais les photos révèlent un vis-à-vis direct avec les terrasses des voisins. De plus, on observe un vis-à-vis avec VM House, un autre projet de BIG situé juste en face. Ce manque d’intimité peut réduire le confort des résidents, qui se sentent exposés et sans véritable espace personnel isolé.

fig 137: The Moutain, 3D, 2008, BIG
En outre, l’aménagement des corridors et des espaces de circulation, avec leurs surfaces vitrées et leurs lignes épurées, contribue à une atmosphère de transparence et de fluidité. La luminosité et la clarté de ces espaces favorisent une sensation de sécurité et de bien-être.
Les images des jardins sur les toits montrent comment les espaces verts sont intégrés à différents niveaux du bâtiment, créant des lieux de détente et de socialisation pour les résidents. Ces jardins suspendus enrichissent l’environnement urbain en ajoutant une dimension écologique et esthétique.
En somme, le projet “The Mountain” de BIG réussit à créer des atmosphères immersives et dynamiques en intégrant des espaces verts, une architecture innovante et des matériaux soigneusement sélectionnés. Les choix de conception de Bjarke Ingels et de son équipe démontrent une compréhension profonde des besoins des résidents et de l’importance de créer des environnements de vie harmonieux et inspirants.
La mise en œuvre des matériaux pour le bâtiment «The Mountain» de BIG a été minutieusement planifi ée et exécutée grâce à l’utilisation de logiciels paramétriques. Ces outils ont permis de modéliser précisément la structure complexe et de coordonner les diff érentes phases de construction. Les logiciels paramétriques ont été essentiels pour concevoir les terrasses en cascade et les unités d’habitation, optimisant ainsi la disposition des espaces et l’utilisation des matériaux.
Le processus a commencé par la création de modèles numériques détaillés, qui ont permis de visualiser et d’ajuster chaque aspect du bâtiment avant le début de la construction. Ces modèles ont également servi à générer des plans de fabrication et des dessins de construction précis. Les éléments structuraux, tels que les cadres en acier et les panneaux de béton, ont été préfabriqués en usine selon les spécifi cations exactes des modèles numériques. Cette préfabrication a permis de réduire les erreurs et d’assurer une meilleure qualité de construction sur site.
Sur le chantier, la précision des modèles paramétriques a facilité l’assemblage des éléments préfabriqués. Chaque pièce a été installée conformément aux plans numériques, garantissant ainsi une cohérence et une exactitude accrues. Les logiciels paramétriques ont également permis de gérer les aspects logistiques de la construction, en planifi ant l’ordre d’installation des éléments et en optimisant les délais de livraison et d’assemblage. (BIG - Bjarke Ingels Group, 2009. Youtube. «MTN Mountain.»)



















fig 138 - 142 : MNT Mountain, ou l’on voit l’assemblage des éléments constructifs, tel un légo, 2008, Youtube
L’intégration de la végétation sur les terrasses a été un autre aspect clé de la mise en œuvre. Les logiciels paramétriques ont permis de concevoir des systèmes de drainage et d’irrigation effi caces, garantissant que les plantes reçoivent l’eau nécessaire tout en évitant l’accumulation excessive d’humidité. Cette attention aux détails a contribué à créer des espaces de vie confortables et esthétiquement plaisants.
La mise en œuvre des matériaux pour «The Mountain» a bénéfi cié de l’utilisation de technologies avancées, qui ont permis de transformer les conceptions numériques en réalité de manière précise et effi cace. Les logiciels paramétriques ont joué un rôle crucial en optimisant chaque étape du processus de construction, de la conception initiale à l’assemblage fi nal, assurant ainsi la réussite du projet dans le respect de la vision architecturale de BIG.
L’utilisation des outils numériques et paramétriques par BIG dans la conception de “The Mountain” a permis d’atteindre des niveaux de précision et d’innovation impressionnants pour l’époque (2008). Ces techniques ont facilité une modélisation complexe et une optimisation des ressources, permettant de construire rapidement et efficacement un projet de grande envergure. La capacité à générer des modèles 3D détaillés a également permis de résoudre de nombreux défis structuraux et architecturaux avant même le début de la construction.
Le processus de préfabrication et l’utilisation de la modélisation paramétrique ont permis de réduire les délais de construction et de minimiser les erreurs. Cela a été crucial pour la réalisation d’un projet aussi ambitieux que “The Mountain”. La précision des éléments préfabriqués et la coordination entre les différents corps de métier ont contribué à la fluidité et à l’efficacité du chantier.
L’attention portée aux vues panoramiques et à l’intégration de la végétation est un aspect clé du projet. Les jardins en terrasse offrent aux résidents un espace extérieur privé et verdoyant, améliorant la qualité de vie et créant un lien visuel avec l’environnement urbain et naturel. Cette approche démontre une sensibilité particulière aux besoins des habitants en matière de lumière naturelle et d’espaces verts.
Malgré ces qualités, “The Mountain” présente des défis importants en termes d’atmosphère et de convivialité. L’omniprésence du béton crée un environnement très minéral, voire austère, qui peut sembler écrasant pour les résidents. De plus, le système d’entrée par le parking, bien que fonctionnel, pose des problèmes de parcours et de convivialité. Les résidents et leurs visiteurs peuvent se sentir perdus dans ce labyrinthe de béton, rendant les déplacements quotidiens et les réceptions de proches moins agréables.
Le parcours labyrinthique pour accéder aux appartements, avec des entrées multiples et peu intuitives, peut compliquer l’expérience résidentielle. Le vis-à-vis direct avec les voisins et d’autres bâtiments, comme l’IMAP, réduit également l’intimité des espaces extérieurs. Ces éléments soulignent une déconnexion entre les intentions initiales de créer un cadre de vie harmonieux et la réalité perçue par les habitants.


Malgré ces critiques, il est important de reconnaître “The Mountain” comme une prouesse technique et innovatrice pour son époque. L’utilisation des outils digitaux et paramétriques en 2008 était avant-gardiste et a ouvert la voie à de nouvelles possibilités dans l’architecture et la construction. Le projet demeure un exemple emblématique de ce que peut accomplir une approche numérique avancée.
fig 143 - 145 : Visite à pied, ou l’on voit bien l’aspect très industriel ou “béton” de la réalité constructive du projet Ep 17, Archi Lablife, 2023, Youtube

Jean Nouvel, né le 12 août 1945 à Fumel, France, est un architecte français de renommée internationale, reconnu pour ses contributions audacieuses et novatrices à l’architecture contemporaine. (Wikipédia, 2024. Jean Nouvel)
Durant ses études, il a travaillé comme assistant auprès de l’architecte Claude Parent et de l’urbaniste Paul Virilio, ce qui lui a permis de développer une compréhension profonde de l’urbanisme et de l’architecture avant de se lancer dans sa propre carrière.
En 1970, après avoir remporté plusieurs concours d’architecture, Jean Nouvel a cofondé son premier studio, le «Mars 1976», avec des collègues architectes. Ce collectif a été créé pour répondre aux défis architecturaux et urbains de l’époque, prônant une approche critique et innovante. Cependant, c’est en 1985 qu’il a fondé son propre atelier, l’Atelier Jean Nouvel (AJN), qui est devenu l’un des bureaux d’architecture les plus influents et respectés au monde.

Parmi ses premiers projets notables, on trouve l’Institut du Monde Arabe à Paris, achevé en 1987. Ce bâtiment emblématique, avec sa façade en moucharabieh, a reçu de nombreux prix pour son innovation technologique et son intégration harmonieuse de la culture arabe dans un contexte contemporain. Ce projet a véritablement lancé Nouvel sur la scène internationale et a démontré sa capacité à fusionner technologie, esthétique et fonctionnalité. (Peter, Leuthäuser. 2006. L’architecture du XXe siècle)
Il est reconnu pour la Fondation Cartier pour l’Art Contemporain (1994) : située à Paris, cette structure transparente en verre et en acier est un exemple parfait de l’intégration de l’architecture dans son environnement naturel. Aussi pour le Louvre Abou Dhabi (2017) : Ce musée, avec son impressionnante coupole géométrique, représente un mariage harmonieux de la culture traditionnelle et de l’architecture contemporaine.
Chaque projet de Nouvel est unique, réfléchi en fonction de son contexte et de son environnement. Il utilise souvent la lumière, les ombres et les reflets pour créer des espaces dynamiques et immersifs. Ses œuvres sont caractérisées par une combinaison audacieuse de matériaux et de technologies innovantes, visant à enrichir l’expérience sensorielle des utilisateurs. (Peter, Leuthäuser. 2006. L’architecture du XXe siècle)
Nouvel accorde une grande importance à la lumière dans ses conceptions, souvent en utilisant des éléments tels que des filtres, des écrans et des jeux de transparence pour manipuler la manière dont la lumière interagit avec l’espace. Cette approche crée des atmosphères uniques et changeantes, qui évoluent avec la lumière naturelle au cours de la journée.
En tant que pionnier de l’architecture contemporaine, Nouvel a reçu de nombreux prix prestigieux, dont le Pritzker Prize en 2008, considéré comme le Nobel de l’architecture. Son travail continue d’influencer de nombreux architectes et urbanistes à travers le monde, inspirant de nouvelles générations à repousser les limites de la créativité architecturale. Jean Nouvel est un architecte qui a su marier innovation technologique et respect du contexte environnemental et culturel. Ses projets, allant des gratte-ciels emblématiques aux musées révolutionnaires, démontrent une maîtrise exceptionnelle de l’espace, de la lumière et des matériaux. Son approche contextuelle et sa capacité à créer des expériences architecturales immersives et dynamiques font de lui l’une des figures les plus influentes de l’architecture moderne. Grâce à ses réalisations, Nouvel continue de redéfinir les possibilités de l’architecture contemporaine, tout en inspirant et en guidant les futures générations d’architectes.
Jean Nouvel est un architecte qui a toujours cherché à être en avance sur son temps, comme en témoignent les célèbres diaphragmes de l’Institut du Monde Arabe à Paris en 1987.
Sa vision est grandement inspirée par ses nombreux centres d’intérêt, tels que le cinéma, le théâtre et le design. Jean Nouvel revendique une absence de style qui lui est propre. Il entame chacun de ses projets depuis le début, de manière à garder l’esprit libre et dégagé de toutes notions préconçues. Pour ses designs, il explore de nouveaux langages et tente de se dissocier d’un style particulier.
Pour Jean Nouvel, « l’architecture doit désormais signifier. Elle doit s’adresser à l’esprit plus qu’à l’œil, traduire une civilisation vivante plus qu’un héritage. Pour cela, tous les moyens sont bons. Le symbole, la référence, la métaphore, le signe, le décor, l’humour, le jeu, l’ironie, le plagiat, l’innovation, la tradition, le style. Principes que l’architecte a utilisés entre autres lors de l’élaboration du musée quai Branly, où le lieu est marqué de symboles de la forêt du fleuve, dans le but d’émouvoir ».
Il cherche à réintroduire l’image à l’échelle urbaine par le biais de la lumière colorée, de verres imprimés et de programmation d’effets dans la conception de son architecture. Il explore cette idée dans la conception de la tour Agbar à Barcelone, où l’architecte a recouvert une tour de béton de parois de verre mobile qui reflète la lumière artificielle. La tour s’éclaire différemment lors des équinoxes et devient animation dans la ville. Cette idée s’inscrit dans la volonté de l’architecte de créer une architecture d’immatérialité ou de jeu avec la matière et la lumière qui lui est propre. (Peter, Leuthäuser. 2006. L’architecture du XXe siècle)
L’innovation est donc au cœur du processus de design de l’Atelier Jean Nouvel. Ils expérimentent constamment avec de nouvelles technologies et techniques de construction pour repousser les limites de l’architecture contemporaine. Jean Nouvel met un fort accent sur le dialogue entre les espaces intérieurs et extérieurs. Les transitions fluides et les connexions visuelles entre ces espaces sont des marques de fabrique de ses projets, créant une continuité et une interaction constante avec l’environnement.
Les projets de Jean Nouvel sont souvent caractérisés par une complexité spatiale, avec des volumes interconnectés et des perspectives multiples. Cette richesse spatiale crée des expériences variées et stimulantes pour les utilisateurs.
Le processus de design de l’Atelier Jean Nouvel a débuté sa carrière dans un contexte où les outils numériques n’étaient pas encore présents. Il a commencé avec des méthodes traditionnelles de conception, réalisées manuellement. L’arrivée des outils digitaux et paramétriques a marqué une évolution significative dans la pratique de Jean Nouvel. Ces technologies ont représenté une évolution enrichissant son approche initiale, lui permettant de réaliser des projets de plus en plus ambitieux et complexes.




147 - 149 :
Le projet se veut un repère visuel dans le quartier de la Confluence, symbolisant la modernité et le dynamisme de Lyon tout en respectant le contexte historique de la ville. L’architecture de Ycone cherche à être immédiatement reconnaissable et à marquer durablement le paysage urbain. L’optimisation de la performance environnementale a été un aspect crucial de la conception. Le projet intègre des solutions de durabilité telles que des systèmes de gestion de l’énergie, l’utilisation de matériaux écologiques et des dispositifs de contrôle climatique passif. (ArchDaily, 2019. YCONE)
Jean Nouvel a mis un fort accent sur le dialogue entre le bâtiment et son environnement immédiat. Cela inclut des considérations sur les vues, les perspectives urbaines et l’interaction avec les espaces publics environnants, cela est formalisé par le concept des filtres physiques ou végétaux.
Ces filtres végétaux permettent aux résidents de se sentir plus à l’aise, comme chez eux, tout en ne s’isolant pas complètement de leurs voisins. Ils permettent également de définir le bâtiment comme un lieu plus calme, un endroit où l’on ne se presse pas, tout en amorçant la création d’un espace public, même si ce n’est qu’un micro-espace public, centré autour du bâtiment.
Ces éléments incitent à explorer le bâtiment, à se promener derrière les arbres, à différents niveaux. Il y a une manière d’entrer dans le bâtiment par un socle, par des terrasses, avec même une entrée pour les voitures. L’objectif est de créer un lieu où les gens ont envie de rester, où ils se sentent chez eux. Cela nécessite de se sentir confortable, ce qui implique de ne pas subir le vis-à-vis. Protéger l’intimité est donc primordial. (ArchDaily, 2019. YCONE)


Cependant, il est aussi important d’offrir une forme d’extériorité. Chaque fois que c’est possible, il faut créer un espace intermédiaire qui permet de sortir sans quitter le confort de son logement. Ces espaces ne sont pas automatiquement des terrasses ou des balcons traditionnels, mais des lieux à partir desquels on peut observer le paysage à travers un verre légèrement imprimé, qui déforme la vue. Ces espaces
intermédiaires sont en continuité avec l’espace habité et constituent une extension de l’appartement. Ces espaces créent une variété de lumières et de sensations, caractérisant chaque appartement de manière unique. Les orientations sont essentielles : chaque direction offre une vue différente, une exposition solaire différente, et chaque fenêtre devient une composition en soi. À travers des verres déformants, des légères colorations, des pleins et des déliés, chaque cadre offre une nouvelle perspective.

fig 152 - 154 : Ycone, AJN, 2024

Un des éléments ressortant de cette idée est l’utilisation créative de la lumière et de la transparence. Le naturelle, des espaces communs

Le projet Ycone reflète l’ingéniosité et l’innovation caractéristiques de Jean Nouvel. L’utilisation des outils paramétriques et BIM a permis d’explorer des formes nouvelles et des solutions techniques avancées, repoussant les limites de l’architecture contemporaine.
La conception du projet Ycone à Lyon par Jean Nouvel est un exemple remarquable de l’intégration de l’innovation technologique, du respect du contexte urbain et de l’attention aux détails matériels et sensoriels. Ce projet résume la capacité de Nouvel à créer des bâtiments emblématiques qui non seulement s’intègrent dans leur environnement, mais aussi enrichissent l’expérience urbaine et humaine.
Jean Nouvel a mis un fort accent sur le dialogue entre le bâtiment et son environnement immédiat. Cela inclut des considérations sur les vues, les perspectives urbaines et l’interaction avec les espaces publics environnants. (Grand Lyon TV, 2019. YCONE)
Bien que l’ingénierie complexe des fi ltres soit impressionnante et transforme le bâtiment en un véritable phare pour le quartier, il est possible que ces eff orts ne soient pas toujours pleinement perçus par les résidents eux-mêmes. Certains pourraient ressentir que toute cette sophistication technique semble superfl ue depuis l’intérieur de leur logement. Cependant, il est important de reconnaître les bénéfi ces concrets et perceptibles de cette ingéniosité.
Les fi ltres végétaux et les éléments de design complexes jouent un rôle essentiel en off rant une protection visuelle effi cace sans compromettre la lumière naturelle. Ces dispositifs permettent de préserver l’intimité des résidents tout en maintenant une transparence exceptionnelle, maximisant ainsi la luminosité à l’intérieur des logements. Cette combinaison ingénieuse assure un équilibre entre confort visuel et éclairement, créant des espaces de vie agréables et lumineux.
En outre, bien que l’impact de cette ingénierie puisse sembler moins tangible au quotidien pour certains résidents, la qualité et la performance des éléments de fi ltre sont indéniables. Ils off rent une solution élégante pour protéger l’intimité sans créer de barrières visuelles oppressantes, enrichissant ainsi l’expérience sensorielle et le confort des occupants.

fig 155 : Vue 3d de l’intérieur des logements ou l’on voit la luminosité et les reflets de l’enveloppe du bâtiment, Ycone, AJN, 2024
L’utilisation des outils paramétriques et BIM a été centrale dans la conception. Ces outils ont permis de modéliser les formes complexes des fi ltres en façade et du toit et d’optimiser la performance du bâtiment en termes de structure, d’effi cacité énergétique et de confort des utilisateurs. La sélection des matériaux a été faite avec soin pour créer une richesse tactile et visuelle.
Le projet se veut un repère visuel dans le quartier de la Confl uence, symbolisant la modernité et le dynamisme de Lyon tout en respectant le contexte historique de la ville. L’architecture de Ycone cherche à être immédiatement reconnaissable et à marquer durablement le paysage urbain. Le projet intègre des solutions de durabilité telles que des systèmes de gestion de l’énergie, l’utilisation de matériaux écologiques et des dispositifs de contrôle climatique passif.
Finalement, même si les aspects techniques du projet peuvent parfois sembler discrets pour les usagers, leur contribution à la qualité de vie est signifi cative. L’ingéniosité de Jean Nouvel permet de combiner transparence, lumière naturelle et protection visuelle de manière harmonieuse, off rant ainsi aux résidents un cadre de vie à la fois fonctionnel et esthétiquement plaisant. Ce projet résume la capacité de Nouvel à créer des bâtiments emblématiques qui non seulement s’intègrent dans leur environnement, mais aussi enrichissent l’expérience urbaine et humaine.
La mise en œuvre de YCONE a nécessité une coordination rigoureuse entre les diff érentes équipes et disciplines impliquées. Jean Nouvel ayant utilisé des outils BIM pour orchestrer cette coordination, assurant une communication fl uide et une intégration parfaite des diff érents systèmes architecturaux, structurels et mécaniques. Cette planifi cation méticuleuse a permis d’anticiper et de résoudre les défi s techniques avant même le début de la construction.
L’un des aspects clés de la mise en œuvre de YCONE est la précision dans le choix et l’utilisation des matériaux. Jean Nouvel a insisté sur des matériaux de haute qualité, choisis non seulement pour leur durabilité, mais aussi pour leurs qualités esthétiques et tactiles. La sélection des matériaux a été suivie d’une fabrication et d’une installation précises, garantissant une fi nition parfaite et une longévité optimale. La mise en œuvre du chantier YCONE à Lyon, bien qu’innovante dans son design, se présente comme une énième illustration de la réalisation d’un projet utilisant des outils BIM (Building Information Modeling). Ce processus repose largement sur la préfabrication des éléments et leur assemblage sur place par des équipes d’artisans et d’entreprises de construction traditionnelles. (Groupe Cardinal. YCONE)












fig 156 - 160 : Les photos de l’assemblage sur site de la structure pré-construite, Photo du Groupe Cardinal, 2024, YouTube
Le projet YCONE a bénéfi cié des avantages des outils BIM pour sa conception et sa réalisation. Ces technologies ont permis de modéliser avec précision chaque composant du bâtiment, assurant une coordination parfaite entre les diff érentes disciplines et une gestion optimisée des ressources. Les outils BIM ont facilité la planifi cation et la détection des confl its potentiels avant même le début de la construction, améliorant ainsi l’effi cacité globale du chantier.
Les éléments constitutifs du bâtiment, y compris les façades et les structures porteuses, ont été largement préfabriqués en usine. Cette approche a permis de garantir une qualité constante et de réduire le temps de construction sur site. Les pièces préfabriquées ont été conçues pour un assemblage rapide et précis, minimisant les erreurs et les ajustements nécessaires une fois sur le chantier.
Les fi ltres visuels, qui sont des pièces d’ingénierie complexes, ont été découpés et fabriqués selon une trame précise. Cette trame a été conçue pour faciliter leur assemblage sur site, malgré leur complexité technique. Les fi ltres permettent de protéger l’intimité des résidents tout en laissant passer la lumière naturelle, combinant fonctionnalité et esthétique.
En dépit de l’innovation apportée par les outils paramétriques et BIM, la mise en œuvre du chantier YCONE reste classique dans sa structure. Les artisans et les entreprises de construction ont suivi des méthodes éprouvées pour assembler les éléments préfabriqués, bénéfi ciant de la précision et de la préplanifi cation permises par les outils numériques. Ce processus a permis de maintenir les standards de qualité tout en intégrant des innovations techniques.
La mise en œuvre du chantier YCONE à Lyon par Jean Nouvel, bien qu’utilisant des outils paramétriques et BIM avancés, s’inscrit dans une tradition de construction préfabriquée et d’assemblage sur site par des équipes expérimentées.
L’analyse du projet Ycone à Lyon, conçu par Jean Nouvel, offre des insights précieux sur l’impact des outils de représentation et de conception sur la qualité des atmosphères créées. Voici les principaux enseignements tirés de cette étude, ainsi que les limites et les enjeux futurs liés à l’utilisation de ces outils dans la pratique architecturale.
L’utilisation des outils BIM a permis une coordination efficace entre les différentes disciplines et une modélisation précise des éléments du projet. Cela a conduit à une exécution de haute qualité et à une réduction des erreurs sur le chantier, assurant que les intentions de design soient réalisées fidèlement. Les outils paramétriques ont permis à Jean Nouvel de concevoir des formes complexes et innovantes et d’optimiser l’utilisation de la lumière naturelle en concevant des filtres visuels efficaces.
Cependant, malgré l’ambition de créer un bâtiment avec une présence unique et une âme distincte, l’intérieur du bâtiment reste relativement classique. Les innovations techniques et les efforts d’ingénierie déployés pour la façade et la toiture ne se traduisent pas nécessairement par une expérience intérieure radicalement différente ou supérieure. À l’intérieur, les espaces de logement suivent des configurations et des qualités qui, bien qu’efficaces et confortables, ne se démarquent pas fondamentalement des standards des logements contemporains.


fig 161 - 163 : Plans et coupes avec un aspect très constructif et peu sensible pour un immeuble se voulant être une expérience, Ycone, AJN

On remarque aussi, notamment dans les plans publiés sur Archdaily, qui sont des plans de construction détaillés, que la réflexion de AJN s’est portée davantage à l’image du bâtiment qu’au confort réel et au choix des matériaux intérieurs. Ces plans révèlent que, bien que l’extérieur du bâtiment soit hautement ingénieré, l’intérieur semble souffrir d’une certaine pauvreté des matériaux de finition et de scénarios possibles de l’usage de l’espace.
Malgré l’ingéniosité technique et la complexité de la façade, le projet ne parvient pas à offrir une expérience intérieure à la hauteur de ses promesses extérieures. Les espaces de vie intérieurs restent relativement standards et ne reflètent pas l’innovation et la qualité perçues de l’extérieur, ce qui pourrait décevoir les résidents cherchant un cadre de vie unique et personnalisable.
B.4 Conclusion générale Les Outils Paramétriques dans le logement d’aujourd’hui
Dans les deux projets précédents que nous avons analysés, “The Mountain” par BIG et “ICON” par l’Atelier Jean Nouvel, il apparaît que les logements contemporains réalisés avec des outils BIM et paramétriques sont souvent très réfléchis et architecturés. Ces bâtiments témoignent d’un immense travail de modélisation, de tests et de recherches, tant sur la complexité de l’assemblage que sur la recherche formelle du bâtiment.
Les outils BIM et paramétriques permettent de concevoir des structures complexes avec une précision et une efficacité accrues. Ils facilitent la coordination entre les différentes disciplines impliquées dans la construction, optimisent l’utilisation des matériaux et réduisent les erreurs sur le chantier. Cela conduit à des bâtiments techniquement sophistiqués et visuellement impressionnants.
Cependant, malgré ces avancées technologiques et cette sophistication, le résultat final du logement reste souvent assimilé à l’idée du logement minimum normé. Ces logements répondent aux cadres minimaux déterminés par les normes, les lois ou les coutumes, mais ils manquent souvent de profondeur en termes de qualité spatiale. Les espaces intérieurs, bien que fonctionnels, sont souvent réduits à des configurations standardisées, avec des murs blancs, des sols blancs et des plafonds blancs, rappelant presque l’esthétique minimaliste du “Carré blanc sur fond blanc” de Malevitch.
Cette approche, bien qu’efficace sur le plan technique, laisse un sentiment d’inachevé en termes d’expérience résidentielle. On constate un écart notable entre l’effort consacré à la conception des éléments architecturaux et des formes extérieures, et celui porté à l’expérience d’usage des espaces intérieurs. Les innovations et les complexités techniques semblent principalement orientées vers la résolution de problèmes de construction et la création d’images architecturales percutantes, plutôt que vers l’amélioration de la qualité de vie des occupants.
Il est quelque peu regrettable que tant de ressources et de moyens soient investis dans les aspects techniques et formels, sans une attention équivalente à la qualité spatiale et au confort des résidents. Les outils BIM et paramétriques, bien qu’extrêmement puissants pour la conception et la réalisation, pourraient également être utilisés pour enrichir l’expérience quotidienne des usagers, en créant des espaces plus variés, personnalisables et sensoriellement riches.
Par exemple, l’intégration de matériaux de haute qualité, la création de zones de transition fluides entre intérieur et extérieur, et la conception d’espaces intérieurs avec des caractéristiques architecturales distinctives pourraient transformer ces logements en environnements véritablement accueillants et stimulants. De plus, permettre une certaine flexibilité et personnalisation des espaces pourrait répondre aux besoins individuels des résidents, améliorant ainsi leur satisfaction et leur bien-être.
Finalement, bien que les projets “The Mountain” et “ICON” démontrent l’énorme potentiel des outils BIM et paramétriques ayant révolutionné l’architecture, il est crucial de réévaluer l’utilisation de ces technologies pour qu’elles servent directement la qualité spatiale et l’expérience de vie des occupants. En équilibrant l’innovation technique avec une attention accrue à l’usage et au confort résidentiel, il est possible de créer des logements qui ne sont pas seulement des chefs-d’œuvre architecturaux, mais aussi des lieux de vie réellement agréables et innovants.

fig 164 : Procésus bim, PMIRAC2019 «Relevance & Applicability of Agile Driven Bim at Conceptual & Design Phases of a Project-A Case Study», Reserch Gate, March 2019

L’intelligence artifi cielle est devenue un sujet omniprésent dans l’actualité, touchant de nombreux domaines allant de la santé à la fi nance, et maintenant à l’architecture. Son utilisation est souvent abordée de manière superfi cielle, parfois pour intriguer ou choquer le public. Des entreprises technologiques et des médias, comme la chaîne Arte, ont exploré l’idée que l’IA pourrait un jour construire les logements de demain, suggérant que cette technologie a le potentiel de révolutionner la manière dont nous concevons et vivons nos espaces résidentiels.
Dans le cadre de cette recherche, il est crucial de questionner les impacts de l’IA sur la conception des atmosphères du logement. Pour cela, il est nécessaire de comprendre en quoi l’IA se distingue des outils de conception qui la précède et en quoi à-t-elle le potentiel d’enrichir la conception des atmosphères des logements de demain. (Chaillou, Stanislas. 2021)
Pour cela on s’intéresse dans un premier temps à la thèse de Stanislas Chaillou, chercheur et architecte diplômé de la Harvard Graduate School of Design. Il a également étudié à l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), à Institute for Advanced Architecture of Catalonia (iaac), où il a développé une solide base en ingénierie et en sciences. Son parcours académique et professionnel se concentre sur l’intégration de l’intelligence artifi cielle dans l’architecture, cherchant à repousser les frontières traditionnelles de la conception architecturale à travers des technologies de pointe.
Parmi ses découvertes marquantes, Chaillou a démontré comment les algorithmes de l’IA peuvent être utilisés pour générer des plans d’étage optimisés, analyser les conditions environnementales et proposer des solutions de conception innovantes. Ses recherches montrent que l’IA peut non seulement automatiser des tâches répétitives, mais aussi apporter une valeur ajoutée signifi cative en termes de créativité et d’effi cacité. Chaillou a également exploré l’impact de l’IA sur la collaboration interdisciplinaire, montrant comment ces outils peuvent faciliter une meilleure communication et coordination entre les architectes, les ingénieurs et les clients.
Dans sa thèse de recherche «AI + ARCHITECTURE: Towards a New Approach», Stanislas Chaillou explore comment l’IA peut révolutionner l’architecture. Il soutient que l’IA, en tant qu’approche statistique, peut surmonter les limitations des méthodes paramétriques traditionnelles. L’IA permet aux machines de créer des paramètres intermédiaires basés sur les données recueillies, allant au-delà des modèles déterministes traditionnels. Cette capacité à «apprendre» et à générer des solutions basées sur une compréhension statistique des données représente un changement de paradigme pour l’architecture. Chaillou discute également des défi s et des opportunités liés à l’intégration de l’IA dans la pratique architecturale, notamment la nécessité de former les machines et de choisir les bons outils pour communiquer les intentions des concepteurs.(Chaillou, Stanislas. 2020. AI + Architecture: Towards a New Architectural Paradigm)
fig 165 : Les trois étapes du processus génératif, 1 l’empreinte, 2 la division, 3 l’ameublement Thèse de Stanislas Chaillou, Académia, 2019
C.1 Introduction de la recherche AI + Architecture, Towards a New Approach
La thèse démarre par une remise en contexte et un regard en arrière quant aux outils numériques. Stanislas Chaillou commence par critiquer les systèmes de conception modulaire traditionnels. Bien que ces systèmes soient faciles à construire et répondent bien aux critères de faisabilité de la construction, ils off rent peu de variété dans les options de conception. Cette limitation a conduit à une qualité architecturale souvent remise en question dès le début. Les conceptions modulaires limitent la diversité des options de design. La qualité architecturale est souvent compromise en raison de ces limitations.
Il poursuit avec les systèmes de conception assîtes par ordinateur, avec lesquels les architectes ont pu échapper aux contraintes rigides des systèmes modulaires. Les logiciels de conception digitaux permettent de dessiner des formes complexes et de nombreuses itérations de design, off rant ainsi plus de fl exibilité et de créativité dans la conception.
Il continue avec la mouvance paramétrique, qui apporte un contrôle encore plus grand sur les formes organiques, améliorant la faisabilité de la construction. En systématisant la géométrie, il devient possible de découper des bâtiments entiers en éléments constructibles et de résoudre les systèmes d’assemblage. Cependant, cette méthode s’est rapidement banalisée, générant des motifs génériques et répétitifs qui ont conduit à une faible qualité architecturale. Le paramétrisme off re un contrôle accru sur les formes et améliore la faisabilité de la construction.
Il en vient à développer l’intelligence artifi cielle qui promet de combiner les avantages des générations précédentes tout en évitant les styles génériques et lisibles du paramétrisme. Selon Chaillou, l’IA représente la poussée ultime vers une qualité architecturale supérieure, marquant le début d’une nouvelle ère. L’IA permet de générer des designs qui échappent à la trivialité et à la répétition des méthodes paramétriques, off rant ainsi des solutions plus innovantes et personnalisées. L’IA intègre les bénéfi ces des méthodes de conception modulaire, digitale, et paramétrique. Elle permet de surmonter les limitations des motifs génériques du paramétrisme qui pousse vers une qualité architecturale supérieure et une innovation accrue.
Le point de vue de Stanislas Chaillou sur les outils IA en architecture est clair : il voit l’IA comme une évolution signifi cative qui non seulement surmonte les limitations des méthodes précédentes, mais ouvre également la voie à une nouvelle ère de qualité architecturale. (Chaillou, Stanislas. 2020. AI + Architecture)
fig 167 : La ligne du temps en fonction des outils architecturaux et des styles qui en découle, du bâtiment modulaire aux outils génératifs, Thèse de stanislas chaillou, Académia, 2019


L’intelligence artifi cielle est fondamentalement une approche statistique de l’architecture. La prémisse de l’IA, qui mélange les principes statistiques avec le calcul, représente une nouvelle approche capable de surmonter les limitations de l’architecture paramétrique. Le «learning», tel qu’il est compris par les machines, correspond à la capacité d’un ordinateur, lorsqu’il est confronté à un problème complexe, d’abord de saisir la complexité des options qui lui sont présentées, puis de construire une «intuition» pour résoudre le problème en question. En réalité, lorsque John McCarthy a élaboré le concept de l’IA en 1956, il l’a défi ni comme «l’utilisation du cerveau humain comme modèle pour la logique des machines».
Au lieu de concevoir, un modèle déterministe, construit pour un nombre défi ni de variables et de règles, l’IA permet à l’ordinateur de créer des paramètres intermédiaires à partir des informations soit collectées à partir des données, soit transmises par l’utilisateur.
Une fois la «phase d’apprentissage» terminée, la machine peut générer des solutions, non pas simplement en répondant à un ensemble de paramètres prédéfi nis, mais en créant des résultats imitant la distribution statistique des informations qui lui ont été montrées pendant la phase d’apprentissage. Ce concept est au cœur du changement de paradigme apporté par l’IA. L’indépendance partielle de la machine pour construire sa propre compréhension du problème, couplée à sa capacité à digérer la complexité d’un ensemble d’exemples, renverse les mécaniques des techniques de conception antérieures. Puisque tous les règles et paramètres ne sont pas explicitement déclarés par l’utilisateur, la machine peut révéler de manière inattendue des phénomènes sous-jacents et même tenter de les imiter.
Selon Chaillou ce n’est que dans les années 1990, avec la mathématisation de l’IA, que le domaine a commencé à produire des résultats vraiment prometteurs. L’arrivée d’un nouveau type de modèles a révélé le véritable potentiel de l’IA : les réseaux et l’apprentissage automatique. Grâce à l’utilisation d’un pipeline en couches, également appelé réseau, une machine est désormais capable de saisir des complexités plus élevées que les modèles précédemment développés. Ces modèles peuvent être «entraînés», c’est-à-dire ajustés pour des tâches spécifi ques. Encore plus intéressant, l’idée embarquée dans un type spécifi que de ces modèles : les réseaux antagonistes génératifs (GAN).
Théorisé pour la première fois par Ian Goodfellow, chercheur chez Google Brain, en 2014, ce modèle permet d’utiliser des réseaux pour générer des images, tout en assurant la précision grâce à une boucle de rétroaction auto-corrective. La recherche de Goodfellow renverse la défi nition de l’IA d’un outil analytique à un agent génératif. Par la même occasion, il rapproche l’IA des préoccupations architecturales : le dessin et la production d’images. En somme, des réseaux simples aux GANs, une nouvelle génération d’outils couplée à une puissance de calcul de plus en plus abordable et accessible positionne aujourd’hui l’IA comme un outil puissant et abordable.


Bien que d’après ce travail le potentiel de l’IA pour l’architecture est prometteur, il reste contingent à la capacité des concepteurs à communiquer leur intention à la machine. Et comme la machine doit être entraînée pour devenir un «assistant» fiable, les architectes sont confrontés à deux défis principaux : (1) ils doivent choisir une taxonomie adéquate, c’est-à-dire le bon ensemble d’adjectifs qui peuvent se traduire en métriques quantifiables pour la machine, et (2) ils doivent sélectionner, dans le vaste champ de l’IA, les outils appropriés et les entraîner. Ces deux préconditions détermineront finalement le succès ou l’échec de l’architecture assistée par l’IA. (Chaillou, Stanislas. 2020. AI + Architecture)
Cependant cette attitude nécessaire face à l’outil n’est pas nouvelle. Pour exemple les logiciels comme Rhino et Grasshopper, renforcés par des plugins puissants tels que Ladybug et Honeybee, ont permis aux architectes de réaliser des analyses avancées, de générer des itérations de conception complexes, et de produire automatiquement des documents techniques. Ces innovations ont conduit à la création de bâtiments avec des designs très architecturés, fortement dessinés, et techniquement complexes, souvent avec une attention portée à la forme et à la technicité.
Les architectes, en explorant les possibilités offertes par ces outils, ont parfois perdu de vue l’espace vécu, se concentrant davantage sur la complexité apparente et la sophistication technique. Cette approche est souvent reconnaissable dans des projets où la complexité formelle prend visuellement le pas sur la fonctionnalité et le confort des espaces de vie.
Les plugins d’IA ont commencé à être intégrés dans des outils comme Rhino et Grasshopper, promettant de simplifier le processus de conception tout en augmentant les capacités créatives des architectes. En automatisant les tâches répétitives et en offrant des solutions optimisées basées sur de vastes ensembles de données, ces plugins permettent désormais aux architectes de se concentrer davantage sur l’exploration des sensations spatiales et sur l’amélioration de la qualité de vie des occupants.
De nombreux projets paramétriques sont caractérisés par des formes architecturales très complexes. Bien que visuellement impressionnantes, ces complexités formelles ne contribuent pas toujours à la qualité de vie des occupants. De plus la puissance des outils paramétriques peut entraîner une focalisation excessive sur la résolution de problèmes techniques et les projets peuvent devenir des démonstrations de compétence technique plutôt que des espaces de vie confortables et accueillants. Cela peut détourner l’attention des architectes des aspects fondamentaux de la qualité de vie et de l’expérience utilisateur. Il est essentiel de trouver un équilibre entre la résolution technique et la création d’espaces confortables et humains pour que l’architecture paramétrique atteigne son plein potentiel.

fig 167 : Cet article vient poser la question la plus simple, mais qui est pour moi la plus importante, Article de 3XN, Artificial Intelligence in Architecture / 3XN, Archdaily, 2021
Dans le domaine de l’architecture, l’IA est utilisée pour automatiser des tâches répétitives, optimiser les processus de conception et analyser de vastes ensembles de données pour générer des solutions innovantes. (Leitch, Neil. Architecture in the Age of Artificial Intelligence.)
Les outils génératifs utilisent des algorithmes pour produire des designs et des solutions de manière automatique selon différents processus :
Le text-to-image : est un processus qui génère des images à partir de descriptions textuelles. Les modèles d’IA comme DALL-E d’OpenAI utilisent des descriptions textuelles pour créer des images réalistes ou artistiques qui correspondent à la description fournie. Utile pour visualiser des concepts de design, générer des rendus rapides de propositions de projets, et explorer des variations de conception sans avoir à dessiner chaque option manuellement.
Le text-to-mesh : est un processus qui convertit des descriptions textuelles en modèles 3D détaillés. Les algorithmes d’IA analysent le texte fourni et génèrent des maillages 3D qui peuvent être utilisés dans des logiciels de modélisation et de rendu. Cela permet aux architectes de passer rapidement de l’idée à la visualisation 3D, facilitant ainsi le processus de conception et d’itération.
Le mesh-to-image : Créer des rendus à partir des modèles 3d et des descriptions textuelles des atmosphères pour des présentations rapides.
Voici les cinq avantages que l’on peut tirer de cette approche :
1. Optimisation de la conception:
Les outils IA peuvent analyser les données sur l’utilisation des espaces, les conditions environnementales et les préférences des utilisateurs pour proposer des designs optimisés qui maximisent le confort, l’efficacité énergétique et l’esthétique.
2. Automatisation des tâches répétitives:
L’IA peut automatiser des tâches comme la génération de plans, les analyses structurelles et les simulations thermiques, permettant aux architectes de se concentrer sur les aspects créatifs et qualitatifs de la conception.
3. Personnalisation et adaptabilité:
Les outils génératifs et “no-code” permettent de créer des espaces personnalisés qui répondent spécifiquement aux besoins des utilisateurs. Par exemple, une IA peut générer des configurations d’espace adaptées aux habitudes de vie des résidents, améliorant ainsi leur qualité de vie.
4. Innovation dans les formes architecturales:
Les technologies text-to-image et text-to-mesh permettent aux architectes d’explorer des formes et des concepts innovants rapidement et efficacement. Cela ouvre de nouvelles possibilités pour la créativité et l’expérimentation dans la conception architecturale.
5. Amélioration de la Communication visuelle:
Les rendus générés par IA facilitent la communication des idées de design aux clients et aux parties prenantes, en fournissant des visualisations claires et attractives qui peuvent aider à obtenir des approbations plus rapides et à affiner les concepts basés sur le feedback.
L’intégration de l’intelligence artificielle, des outils génératifs et des technologies no-code dans l’architecture ouvre de nouvelles possibilités pour la conception et la création d’espaces. Ces outils permettent non seulement d’optimiser les processus de conception et de construction, mais aussi d’améliorer la qualité des environnements bâtis en les rendant plus personnalisés, efficaces et esthétiques, transformant ainsi la manière dont nous concevons et vivons nos espaces.
C.1.3 Le processus conception génératif selon Stanislas Chaillou
Stanislas Chaillou explore l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) pour améliorer la génération de plans d’étage architecturaux. L’objectif principal est d’optimiser le style et l’organisation des plans d’étage, en exploitant les capacités des outils IA pour dépasser les limitations des méthodes traditionnelles. Ce processus vise à fournir des outils fiables et robustes pour tester et démontrer le potentiel de l’IA dans la planification des espaces. (Chaillou, Stanislas. 2020. AI + Architecture)
C.1.3.1
Les Réseaux Antagonistes Génératifs ou Générative Adversarial Network (GANs) sont au cœur de la méthode de Chaillou pour générer des plans d’étage. Les GANs se composent de deux modèles principaux : le Générateur et le Discriminateur.
Le Générateur
Rôle : Le Générateur est responsable de créer des images qui ressemblent aux images du dataset. Il utilise les feedbacks du Discriminateur pour améliorer ses productions.
Fonctionnement : Entraîné à partir des données existantes, le Générateur essaie de produire des images réalistes et conformes aux critères architecturaux.
Le Discriminateur
Rôle : Le Discriminateur évalue les images créées par le Générateur et les compare aux images réelles du dataset.
Fonctionnement : Il est formé pour distinguer les images réelles des images «fausses» produites par le Générateur. En fournissant des feedbacks, il aide le Générateur à affiner ses productions.
Boucle de Feedback
Processus : Le Générateur produit des images, et le Discriminateur les évalue. Les feedbacks du Discriminateur permettent au Générateur d’ajuster et d’améliorer ses images de manière itérative.
À travers cette boucle de feedback continue, les GANs améliorent leur capacité à créer des images synthétiques de haute qualité, intégrant des phénomènes observés dans les données réelles.
Les GANs offrent une capacité créative unique qui permet de repousser les limites de la planification d’espaces. En utilisant les GANs, Chaillou peut générer des plans d’étage avec une organisation et un style nettement améliorés. Cela permet non seulement de respecter les critères de faisabilité architecturale,

fig 168 : Schéma du processus de génération initial Thèse de Stanislas Chaillou , Académia, 2019
1.Choisir le bon ensemble d’outils.
La sélection des GANs est cruciale pour leur capacité à générer des images réalistes et pertinentes. La structure unique des GANs, avec le Générateur et le Discriminateur, permet d’améliorer continuellement la qualité des images produites.
2.Isoler les phénomènes pertinents.
Il est essentiel d’identifier les phénomènes statistiques significatifs dans les données présentées aux GANs. En montrant les bons exemples et contextes, on s’assure que la machine apprend les caractéristiques importantes pour la génération de plans d’étage de qualité.
3.Assurer un apprentissage correct.
La formation adéquate du Discriminateur est nécessaire pour qu’il distingue efficacement les images réelles des images générées. Le Générateur utilise ces feedbacks pour s’ajuster et produire des images de plus en plus réalistes et pertinentes.
Le système de génération de Stanislas Chaillou, basé sur les GANs, illustre comment l’IA peut transformer la génération de plans d’étage en architecture. En intégrant les GANs dans le processus de conception, il est possible de créer des plans d’étage plus organisés, stylisés et réalistes. Cela améliore non seulement la qualité architecturale, mais aussi l’innovation dans la conception des espaces de vie. Ce processus représente une avancée significative par rapport aux méthodes traditionnelles, permettant aux architectes de repousser les limites de la créativité et de l’efficacité.
C.1.3.2
L’approche de Chaillou consiste à imbriquer trois modèles distincts (footprint, program, et furnishing) pour créer une «pile de génération» complète. Chaque modèle se concentre sur un aspect spécifique du plan d’étage, permettant ainsi d’améliorer la qualité des résultats à chaque étape.
- Générer l’empreinte du bâtiment, c’est-à-dire la disposition générale et les limites extérieures de la structure. Utilise des GANs pour créer une forme de bâtiment réaliste basée sur les contraintes du site et les données de base.
- Définir l’organisation interne des espaces, y compris la disposition des pièces et la répartition des fonctions (par exemple, salon, chambres, cuisines). Entraîné pour organiser les espaces internes de manière logique et fonctionnelle, en tenant compte des exigences programmatiques.
- Ajouter des détails de mobilier et d’agencement intérieur aux plans. Utilise des patches de couleur pour coder les types de meubles et les transforment en dessins détaillés, améliorants ainsi la précision visuelle et l’utilité des plans.
- Enfin d’inclure une boucle de Feedback et l’interaction Homme-Machine
fig 169 : Démonstration pas à pas des différentes étapes du processus de génération, Thèse de Stanislas Chaillou, Académia, 2019

Ils proposent une interface permettant aux utilisateurs de solliciter chaque modèle à différents moments du processus de dessin. Cette boucle de feedback entre la machine et le designer permet de raffiner continuellement le processus de conception. Les utilisateurs peuvent intervenir et ajuster les paramètres de conception à chaque étape, en fonction des résultats générés par les GANs. Cette interaction itérative améliore la qualité et la précision des plans produits, tout en permettant aux designers de maintenir un contrôle créatif sur le processus. (Chaillou, Stanislas. 2020. AI + Architecture)
L’approche de Chaillou n’est pas limitée à des unités individuelles; elle peut être étendue à la génération de bâtiments entiers et à la mise en page de plans maîtres (master plan layout). En automatisant le traitement multi-unités, le système peut générer des conceptions pour des bâtiments complets et des développements à grande échelle. Cela permet de gérer des projets plus complexes et de plus grande envergure tout en maintenant une haute qualité de conception. Le système inclut également des techniques de transfert de style pour appliquer différents styles esthétiques aux plans générés. Cela permet de personnaliser davantage les designs en fonction des préférences des utilisateurs et des exigences spécifiques du projet.
Chaillou ajoute un cadre rigoureux pour analyser et classer les résultats générés, permettant aux utilisateurs de naviguer de manière cohérente à travers les options créées. Les plans générés sont classés selon divers critères (fonctionnalité, esthétique, conformité aux contraintes).Cela facilite la sélection et la comparaison des différentes options de conception. Les utilisateurs peuvent parcourir les options générées pour trouver les solutions les plus adaptées à leurs besoins spécifiques. Ce cadre de navigation améliore l’expérience utilisateur en rendant le processus de sélection plus intuitif et efficace.
En imbriquant plusieurs modèles spécialisés et en intégrant des boucles de feedback interactives, cette approche permet de produire des plans d’étage précis, organisés et esthétiquement variés. L’évolutivité du système et l’inclusion de techniques de style transfert ajoutent une dimension supplémentaire de personnalisation et de flexibilité, rendant cette méthode particulièrement puissante pour la conception architecturale moderne.
La génération de l’empreinte (footprint) est une étape fondamentale dans le processus de conception des plans d’étage. En utilisant des modèles spécifiques basés sur une vaste base de données, Stanislas Chaillou parvient à créer des empreintes réalistes et adaptées aux types de propriétés spécifiques. Cette approche améliore non seulement la qualité et l’efficacité de la conception, mais aussi l’intégration harmonieuse des bâtiments dans leur environnement.
La première étape du pipeline de génération de plans d’étage de Stanislas Chaillou consiste à créer une empreinte de bâtiment appropriée pour une parcelle donnée. Cette étape est cruciale, car elle détermine la forme et les limites extérieures du bâtiment en fonction de la géométrie de la parcelle et du type de propriété.
fig 170 : Démonstration de génération de différentes emprises au sol et leurs résultats, Thèse de Stanislas Chaillou, Académia, 2019


Pour entraîner ce modèle, Chaillou a utilisé une vaste base de données des empreintes des bâtiments de Boston. Cette base de données comprenait divers types de propriétés, permettant de créer des modèles spécifiques à chaque type de propriété.
Chaillou présente des exemples d’empreintes générées en utilisant le modèle résidentiel. Ces exemples montrent comment le modèle peut créer des empreintes qui sont non seulement réalistes, mais aussi adaptées aux dimensions et au style des résidences pour lesquelles il a été formé.
C.1.3.4
Après la génération de l’empreinte du bâtiment, l’étape suivante naturelle consiste à disposer les pièces à travers cette empreinte. Cette phase est cruciale pour assurer la fonctionnalité et l’ergonomie de l’espace intérieur. L’objectif est de diviser un plan d’étage donné tout en respectant les adjacences significatives, les dimensions typiques des pièces, et les ouvertures appropriées.
Chaillou utilise les Réseaux Antagonistes Génératifs (GANs) pour aborder cette tâche complexe. Grâce à un dataset d’environ 700+ plans d’étage annotés, il a pu entraîner une large gamme de modèles capables de générer des dispositions de pièces pertinentes pour des empreintes de bâtiments vides.
Résultats et Exemples
Chaillou présente des exemples de dispositions typiques générées par les modèles. Ces exemples montrent comment les GANs peuvent diviser efficacement un plan d’étage tout en maintenant une logique spatiale et une fonctionnalité élevées.
C.1.3.5 L’aménagement
La dernière étape de la génération des plans d’étage selon Stanislas Chaillou consiste à ajouter des meubles dans les espaces. Cette étape pousse le principe de génération au niveau le plus granulaire, en s’assurant que chaque pièce est meublée de manière cohérente et fonctionnelle.
Pour accomplir cette tâche, Chaillou a d’abord entraîné un modèle capable de meubler l’intégralité d’un appartement en une seule fois. Ce réseau a appris à partir de chaque programme de pièce, la disposition relative des meubles dans l’espace et les dimensions de chaque élément.
L’aménagement intérieur est la dernière étape du processus de génération des plans d’étage, selon Stanislas Chaillou. En utilisant des GANs, il est possible de meubler automatiquement les pièces de manière cohérente et fonctionnelle. Cette approche offre un niveau de détail granulaire, assurant que mais aussi prêts à être utilisés. Les résultats logiquement disposés, permettant une visualisation réaliste et pratique des plans d’étage. (Chaillou, Stanislas. 2020. AI + Architecture)

fig 171 : De la division programmatique à l’ameublement, Thèse de Stanislas Chaillou, Académia, 2019
Stanislas Chaillou propose d’utiliser la flexibilité des Réseaux Antagonistes Génératifs (GANs) pour aller au-delà de la génération de simples appartements standards, permettant ainsi la planification de bâtiments entiers et de quartiers. Les GANs s’adaptent facilement aux changements de dimension et de forme des empreintes des bâtiments, démontrant une intelligence adaptative qui gère efficacement les variations complexes dans les dimensions et les dispositions des espaces. Cette adaptabilité est essentielle pour partitionner et meubler l’espace de manière efficace malgré les contraintes changeantes.
Chaillou met en avant la capacité de contrôler des éléments structuraux spécifiques, tels que les portes d’entrée et les positions des fenêtres. Les utilisateurs peuvent spécifier ces éléments, assurant une intégration harmonieuse avec la conception globale. Cette capacité, combinée avec la flexibilité des modèles, permet de planifier des espaces à une échelle plus large que celle d’une unité unique. En intégrant des algorithmes simples au pipeline de génération, il est possible de passer de la conception d’unités individuelles à des bâtiments entiers et même à des quartiers. Cette méthodologie peut être mise à l’échelle pour gérer des projets de plus grande envergure, assurant la cohérence et la fonctionnalité entre les différentes unités. (Chaillou, Stanislas. 2020. AI + Architecture)
Les résultats de cette méthodologie montrent des bâtiments entiers et des quartiers avec une planification optimisée des espaces. Les exemples illustrent la capacité des modèles à maintenir la cohérence et la fonctionnalité à grande échelle, démontrant l’efficacité de l’approche. En étendant l’utilisation des GANs


fig 172 - 174 : Les plans d’étages et leurs assemblages, Thèse de Stanislas Chaillou, Académia, 2019

Stanislas Chaillou explore l’impact des styles architecturaux sur la composition des plans d’étage. Il Stanislas Chaillou propose de considérer les plans d’étage comme des compositions avant d’être des produits d’ingénierie. Cette approche permet à l’IA d’offrir des réponses significatives en étudiant les forces motrices de la composition architecturale. Chaque style architectural contient une mécanique implicite de l’espace, influençant profondément la composition des plans d’étage. Les choix stylistiques affectent directement la disposition des espaces. Par exemple, un style moderniste favorise des plans ouverts et fluides, tandis qu’un style victorien privilégie des espaces cloisonnés et formels.
Les styles architecturaux sont vus comme des sous-produits de l’histoire. Leur étude permet de comprendre l’évolution des règles fonctionnelles implicites au fil du temps. En encapsulant chaque style, il devient possible d’aller au-delà de l’étude des précédents et de comprendre le comportement des modèles de GANs formés pour imiter ces styles. Les GANs offrent une nouvelle méthode pour étudier et comprendre les styles architecturaux. (Chaillou, Stanislas. 2020. AI + Architecture)
Les modèles de GANs peuvent capturer et reproduire les caractéristiques stylistiques implicites, offrant une nouvelle perspective sur la manière dont les styles influencent la composition des espaces. En émulation des règles implicites, les GANs permettent d’explorer la qualité architecturale au-delà des aspects visibles et tangibles. Chaillou affirme que la présence inhérente du style dans chaque modèle de GAN constitue une conclusion clé. Contrairement à une pratique objective et sans style de la conception générative, le style imprègne irrémédiablement l’essence même de tout processus génératif.
Le style n’est pas un ajout superficiel ou décoratif, mais constitue le cœur de la composition. Reconnaître cette réalité est essentiel pour comprendre ce que l’IA peut apporter à l’architecture. Chaque modèle ou algorithme de GAN vient avec sa propre « saveur », sa personnalité et son savoir-faire, ce qui influence le résultat généré. L’étude des styles architecturaux à travers l’IA révèle que les styles ne sont pas simplement des éléments décoratifs, mais des composants fondamentaux de la composition spatiale.

les règles implicites qui gouvernent la qualité architecturale. En reconnaissant que chaque modèle de




Stanislas Chaillou souligne l’importance de nommer correctement les éléments dans l’étude de l’architecture pour éviter la confusion et le désordre. Lorsque les architectes comptent de plus en plus sur les ordinateurs pour les aider dans leur processus de conception, il devient essentiel de transformer des adjectifs en métriques quantifiables que les machines peuvent comprendre et utiliser.
L’utilisation de termes et d’adjectifs précis permet de créer un pont entre les humains et les machines. En codant ces termes en métriques quantifiables, les architectes peuvent s’assurer que les ordinateurs comprennent et peuvent évaluer les différents aspects du design architectural.
Chaillou propose six métriques essentielles pour qualifier les aspects de la conception des plans d’étage. Chaque métrique est développée sous forme d’algorithme, testée en profondeur et disponible en open source. Ces métriques permettent d’aborder les dimensions stylistiques et organisationnelles des plans d’étage de manière complète. (Chaillou, Stanislas. 2020. AI + Architecture)
La première métrique est l’empreinte (Footprint), qui se réfère à la forme et aux limites extérieures du bâtiment. Une empreinte bien définie influence la disposition des espaces intérieurs et l’intégration du bâtiment dans son environnement. Ensuite, le programme (Program) définit l’organisation interne des espaces, y compris la répartition des pièces et des fonctions. Cela assure que chaque espace répond aux besoins fonctionnels et programmatiques du projet. L’orientation (Orientation) s’intéresse à la disposition des pièces en fonction des points cardinaux et des sources de lumière naturelle données.
Deuxièmement la métrique d’épaisseur et texture (Thickness & Texture) concerne les caractéristiques des murs et des surfaces, incluant la matérialité et les finitions contribuées à l’esthétique et à l’ambiance des espaces intérieurs, ainsi qu’à la performance thermique et acoustique. La connectivité (Connectivity) se réfère aux relations spatiales entre les différentes pièces et espaces, incluant les points de circulation principaux améliorant la fonctionnalité et la fluidité de la circulation à l’intérieur du bâtiment. Enfin, la circulation (Circulation) concerne la disposition et l’organisation des chemins de circulation, y compris les couloirs, escaliers et ascenseurs qui assurent une accessibilité et une mobilité efficaces au sein du bâtiment.
Cette métrique «Thickness & Texture» est intéressante pour le sujet de recherche, elle permet de qualifier l’épaisseur des murs et la variation de cette épaisseur dans un plan d’étage. Cette métrique capture ce que Chaillou appelle le «gras» du plan, c’est-à-dire l’épaisseur des murs et la géométrie de la surface des murs. Ces caractéristiques peuvent varier considérablement d’un style architectural à un autre.
Cette métrique permet de distinguer facilement les styles architecturaux en fonction de l’épaisseur et de la texture des murs. Par exemple, les murs épais et texturés des bâtiments Beaux-Arts contrastent avec les murs fins et rectilignes des conceptions modernes de Mies van der Rohe. L’histogramme des épaisseurs fournit une description visuelle intuitive des caractéristiques structurelles des différents styles.
En analysant l’épaisseur et la texture des murs, les architectes peuvent optimiser la structure des bâtiments pour améliorer à la fois l’esthétique et la performance technique. Cette métrique permet également de personnaliser les designs selon les préférences stylistiques et les contraintes spécifiques du projet.
L’histogramme permet une comparaison objective des plans en termes d’épaisseur et de texture des murs, facilitant l’identification des points forts et des points faibles des conceptions. Cela permet d’évaluer la qualité structurelle des bâtiments de manière plus précise.
En définissant ces six métriques, Stanislas Chaillou propose un cadre complet pour aborder les dimensions stylistiques et organisationnelles des plans d’étage. Chaque métrique est traduite en algorithmes quantifiables, permettant aux ordinateurs de participer efficacement au processus de conception architecturale. Cette approche méthodique et rigoureuse facilite une meilleure compréhension et une meilleure utilisation des outils numériques dans la création de designs architecturaux de haute qualité.
Dans la génération de plans d’étage, chaque modèle produit plusieurs options à chaque étape du processus de génération. Le concepteur est alors invité à choisir une option avant de passer à l’étape suivante. Cependant, la navigation à travers les options générées peut être frustrante et chronophage. C’est ici que les métriques définies dans le chapitre «Qualify» démontrent tout leur potentiel en complément du pipeline de génération.



fig 180 - 181 : Résultat imprimé en 3d style choisit et les effets d’ombres, Thèse de Stanislas Chaillou, Académia, 2019


fig 182 - 183 : Les différents critères ou curseurs pouvant être utilisés pour améliorer la conception, Thèse de Stanislas Chaillou, Académia, 2019

Une fois les options filtrées selon un critère donné, une représentation arborescente des choix est fournie à l’utilisateur. L’option sélectionnée se trouve alors au centre, entourée de ses voisins les plus proches classés selon le critère sélectionné par l’utilisateur.
L’utilisateur peut ensuite affiner la recherche et trouver l’option de design idéale, ou sélectionner une autre option dans l’arborescence pour recalculer le graphe. Cela permet de présenter de nouvelles options pertinentes.
Les métriques de filtrage permettent de réduire considérablement le temps nécessaire pour trouver une option pertinente, améliorant ainsi l’efficacité du processus de conception et la représentation arborescente qui offre une navigation intuitive et visuelle à travers les options générées, facilitant le processus de sélection.
La partie «Mapping & Browsing» de la thèse de Stanislas Chaillou met en évidence l’importance de combiner la génération et le filtrage pour optimiser le processus de conception architecturale. En utilisant des métriques définies pour filtrer les options générées par les GANs, les concepteurs peuvent rapidement et efficacement trouver des solutions de design pertinentes. La représentation arborescente des options permet une navigation intuitive et améliore l’accessibilité de l’outil, offrant ainsi un cadre complet qui maximise le potentiel des outils génératifs dans la conception architecturale.
C.1.3.10
Critique de l’Aspect Mécanique de l’Utilisation des Outils IA dans la Conception Architecturale L’utilisation des outils d’intelligence artificielle (IA), notamment les réseaux antagonistes génératifs (GAN), pour la conception architecturale a considérablement transformé la manière dont les espaces sont conçus et visualisés. Cependant, cette transformation n’est pas sans ses limitations, particulièrement en ce qui concerne la paramétrisation des matériaux et la communication des atmosphères.
À ce stade de leur développement, les GAN sont capables de générer des conceptions visuellement attrayantes en imitant les styles architecturaux existants. Toutefois, la précision dans la paramétrisation des matériaux reste un défi majeur. Les GAN peuvent produire des rendus réalistes, mais ces rendus manquent souvent de détails techniques nécessaires pour une application pratique. Par exemple, les propriétés spécifiques des matériaux, telles que la texture, la résistance et la durabilité, sont difficilement contrôlables et ajustables via les outils IA actuels. Cette limitation entrave la capacité des architectes à s’assurer que les matériaux sélectionnés répondront aux exigences structurelles et esthétiques du projet.
Un autre défi est la communication efficace des atmosphères créées par les GAN. Bien que ces outils puissent générer des images et des rendus qui illustrent une ambiance générale, il est difficile pour les concepteurs de piloter et de peaufiner ces atmosphères de manière précise. L’intuition et la sensibilité esthétique des architectes sont souvent réduites à des interactions avec une interface numérique, ce qui peut nuire à l’expression subtile et nuancée des idées conceptuelles. En d’autres termes, les GAN produisent des atmosphères visuellement captivantes, mais les outils manquent de transparence et de contrôlabilité pour ajuster ces atmosphères de manière fine et intuitive.
En résumé, bien que les outils IA, y compris les GAN, apportent des avantages considérables en termes de rapidité et de créativité dans la conception architecturale, ils présentent des limitations notables. La paramétrisation précise des matériaux et la communication claire des atmosphères restent des domaines où les outils IA doivent encore évoluer pour être pleinement intégrés et utiles dans le processus de conception architecturale. Les architectes doivent donc continuer à combiner leur expertise et leur sensibilité artistique avec ces nouvelles technologies pour maximiser leur potentiel.
fig 184 - 187 : fig 175 - 179 : De la génération d’un plateau à la personnalisation et l’impression d’un appartement en fonction du style et de l’ameublement choisit, on peut le voir dans le futur intégrer une métrique matériaux et assemblages, Thèse de Stanislas Chaillou, Académia, 2019








C.2 L’état actuel de l’utilisation des outils génératifs dans la pratique architecturale.
Mjøstårnet, situé à Brumunddal en Norvège, est le plus haut bâtiment en bois du monde, achevé en 2019. Conçu par Voll Arkitekter, ce projet se distingue par l’utilisation de matériaux durables. Selon certaines sources comme BusinessNorway.com, il a été affirmé que l’intelligence artificielle (IA) avait joué un rôle crucial dans sa conception et sa construction. Cependant, après une analyse plus approfondie, il apparaît que cette affirmation est quelque peu exagérée. En réalité, Mjøstårnet a principalement utilisé des outils paramétriques et des méthodes de construction traditionnelles pour sa réalisation. (BusinessNorway.com. 2023. «Norway is Greening the Construction Industry.»)
Le projet a essentiellement tiré parti des outils BIM (Building Information Modeling) pour coordonner les différentes phases de construction et optimiser l’utilisation des ressources. Les modèles BIM ont permis de simuler les différentes étapes de la construction, assurant une logistique efficace et réduisant les délais ainsi que les coûts. Cependant, il n’y a pas eu une utilisation significative d’algorithmes d’apprentissage automatique pour optimiser les performances structurelles ou environnementales du bâtiment.
Malgré cette clarification, Mjøstårnet reste un projet intéressant, car il évoque une qualité de symphonie architecturale, rappelant les travaux de Frank Lloyd Wright avec ses intégrations harmonieuses de matériaux naturels et d’espaces intérieurs. L’usage intensif du bois crée une ambiance chaleureuse tout en étant durable et esthétiquement plaisant.
Cependant, il offre une excellente base pour l’application future des techniques de conception avancées proposées par Stanislas Chaillou. Les modèles GAN pourraient être utilisés pour diviser l’empreinte des appartements de manière optimale, en tenant compte des contraintes structurelles existantes. Chaque appartement serait conçu en fonction des colonnes structurelles et des dalles de plancher, permettant une utilisation efficiente de l’espace tout en maintenant l’intégrité structurelle du bâtiment.
L’IA pourrait optimiser la disposition des pièces en fonction des nécessités structurelles et des préférences des futurs occupants. En envisageant une interaction dynamique entre deux niveaux différents, la structure pourrait s’ajuster en fonction des besoins spécifiques de chaque étage. Par exemple, les colonnes structurelles pourraient être légèrement déplacées ou redimensionnées pour mieux s’adapter aux configurations optimales générées par l’IA. Cette flexibilité permettrait de créer une structure intérieure plus fluide et harmonieuse, offrant une possible adaptabilité, une meilleure qualité spatiale et des atmosphères plus agréables.
Une des caractéristiques intéressantes de l’utilisation du bois dans la construction est l’effet visuel et tactile qu’il apporte aux espaces intérieurs. En combinant cela avec des techniques de design génératif, il serait possible de jouer avec les ressentis de par la présence ou l’absence de la structure en bois dans les espaces intérieurs. Par exemple, certaines zones pourraient mettre en valeur la structure en bois pour créer une atmosphère chaleureuse et naturelle, tandis que d’autres pourraient intégrer la structure dans les murs ou les plafonds, offrant ainsi une plus grande liberté de design.
Cette approche combinée pourrait grandement améliorer les atmosphères intérieures de Mjøstårnet. Les espaces seraient non seulement fonctionnels et esthétiquement plaisants, mais aussi optimisés pour le confort et l’efficacité énergétique. La symbiose entre une structure en bois rigide et un design génératif flexible permettrait de créer des espaces variés et personnalisés, répondant mieux aux besoins des habitants.
Bien que les informations initiales sur l’utilisation de l’IA dans la conception de Mjøstårnet aient été exagérées, ce projet reste une référence précieuse pour la recherche architecturale. Il démontre l’importance des matériaux naturels dans la création d’atmosphères intérieures de qualité et offre un potentiel considérable pour l’application future des techniques de conception assistée par l’IA. En utilisant la structure et la matérialité de Mjøstårnet comme base, il est possible de développer des appartements aux styles diversifiés, optimisés par des outils paramétriques et IA, assurant ainsi une synergie entre atmosphère et innovation technologique.
fig 188 - 190 : Mjøstårnet The Tower of Lake Mjøsa / Voll Arkitekter, 2019, Archdaily,

C.3 Le processus de conception via les outils génératifs «no-code»
L’exploration des outils génératifs «no-code» offre un potentiel considérable pour la conception architecturale, en particulier dans la création d’atmosphères uniques et de bâtiments optimisés. Ces outils d’intelligence artificielle et de modélisation algorithmique peuvent transformer ces trois étapes clés du processus de conception : l’analyse volumétrique, le développement conceptuel et la résolution technique. Chacune de ces étapes bénéficie de l’application de l’IA, permettant aux architectes de repousser les limites de la créativité tout en améliorant l’efficacité et la précision.
Les outils génératifs peuvent simuler différentes configurations volumétriques en fonction des paramètres de site, optimisant ainsi l’exposition à la lumière naturelle et minimisant les problèmes de vis-àvis. Par exemple, des logiciels comme Autodesk Forma utilisent des algorithmes pour proposer des volumes optimisés en fonction des contraintes spécifiques du site et des exigences de performance environnementale. (Mortice, Zach. 2023. «De la vision à la conception, comment l’IA redéfinit l’architecture.»)
Le concept d’un bâtiment inclut son intégration dans le contexte urbain ou naturel, le choix des matériaux, et la définition de sa volumétrie et de sa toiture. Cette étape détermine l’identité visuelle du bâtiment et son dialogue avec l’environnement. Des outils comme Midjourney ou Photoshop IA peuvent générer des concepts architecturaux qui répondent aux critères esthétiques et fonctionnels tout en intégrant les contraintes contextuelles.
La phase technique de la conception implique la résolution de problèmes complexes liés à la structure, aux systèmes de ventilation, de chauffage, et à d’autres aspects techniques du bâtiment. Cette étape est cruciale pour assurer la faisabilité et la durabilité du projet. L’IA peut accélérer le processus de résolution des problèmes techniques en automatisant des tâches répétitives et en optimisant les solutions. Par exemple, Procore et ALICE Technologies utilisent des algorithmes pour gérer les calendriers de construction, optimiser les ressources, et prévoir les besoins en matériaux, réduisant ainsi les délais et les coûts tout en améliorant la précision.
L’intégration des outils génératifs grand public dans la conception architecturale offre des avantages significatifs. En optimisant les analyses volumétriques, en facilitant la création de concepts intégrés et en automatisant la résolution des problèmes techniques, ces outils permettent aux architectes de se concentrer sur l’innovation et la qualité des atmosphères.
C.3.1 Les outils précurseurs dans la génération d’images et l’analyse urbanistique
Dans cette partie, nous allons explorer différents outils d’intelligence artificielle qui jouent un rôle crucial dans le processus de conception architecturale, en particulier pour déterminer le contexte et la volumétrie d’un projet. Nous commencerons par deux outils clés : MidJourney et Autodesk Forma (anciennement Spacemaker). Ces outils permettent de définir le champ lexical et spatial d’un projet, facilitant ainsi une conception intégrée et cohérente.
MidJourney est un outil d’Image génératif utilisé pour créer des concepts visuels et des images basées sur des descriptions textuelles. Ce logiciel permet aux architectes de visualiser rapidement des idées et des concepts à travers des images générées par l’IA, facilitant ainsi l’exploration de diverses options stylistiques et esthétiques dès le début d’un projet.
MidJourney permet de générer une variété d’images basées sur des mots-clés ou des descriptions, offrant un large éventail de possibilités visuelles pour inspirer le design. Les images générées aident à définir le champ stylistique du projet, en identifiant les éléments visuels qui résonnent avec les intentions conceptuelles de l’architecte. En générant des représentations visuelles de différents matériaux et textures, MidJourney facilite la prise de décision concernant les choix matériels et leur intégration dans le projet. (Midjourney. «Home.» Midjourney)
fig 191 : Elbo Group & Studio Lynn, Technicolor Bloom, Photographie personnelle tirée du livre : Rattenbury, Kester, et Robert Bevan. 2009.





fig 192 - 194 : Premièrement la zone de projet en suite la volumétrie et les variantes , en suite le design des différents types d’appartements, T1 - T2 - T3 - ... et la répartition automatiquement générée, Autodesk Forma, Autodesk, 2024
Autodesk Forma, est un outil d’IA conçu pour optimiser la volumétrie et la planification urbaine des projets architecturaux. Il aide les architectes à analyser et à optimiser l’utilisation de l’espace en tenant compte de diverses contraintes et paramètres environnementaux. (Autodesk Format AI)
Forma permet de créer et d’évaluer différentes configurations volumétriques, optimisant ainsi l’utilisation de l’espace en fonction des contraintes du site. L’outil simule l’ensoleillement, l’éclairage naturel, et l’impact des conditions environnementales, aidant à optimiser le confort intérieur et l’efficacité énergétique du bâtiment. En prenant en compte les contraintes urbaines et environnementales, Forma aide à intégrer le bâtiment dans son contexte, assurant une harmonisation avec l’environnement bâti et naturel.
L’intégration de ces outils IA dans le processus de conception permet aux architectes de définir clairement le contexte et la volumétrie dès les premières étapes du projet. MidJourney facilite l’exploration des concepts visuels, tandis qu’Autodesk Forma optimise la planification spatiale et environnementale. En combinant ces outils avec d’autres plateformes IA avancées, les architectes peuvent créer des designs innovants, durables et esthétiquement plaisants, tout en améliorant l’efficacité et la précision de la réalisation du projet.

fig 195 - 196 : Dès l’étape de la volumétrie et les variantes de multiples modes d’analyse de l’ensoleillement, de son et d’autres viennent affiner le processus de conception, Autodesk Forma, Autodesk, 2024

Alors que des outils comme MidJourney et Autodesk Forma (Spacemaker) ont pavé la voie dans l’utilisation de l’IA pour la conception architecturale, de nouveaux outils ont émergé pour répondre à des besoins spécifi ques et optimiser diff érentes phases de la conception. Cette section explore l’évolution du choix des outils génératifs et leurs spécialités, en mettant en lumière des logiciels tels que Veras, Finch, et autres, qui apportent des solutions innovantes et complémentaires aux précurseurs.
Veras est un outil d’intelligence artifi cielle développé par EvolveLAB qui se concentre sur l’amélioration des processus de conception architecturale à travers des algorithmes génératifs. Veras utilise l’IA pour générer rapidement des options de design, permettant aux architectes d’explorer diverses confi gurations et concepts en peu de temps. (Veras AI)
Il utilise des algorithmes d’IA pour générer automatiquement des options de design basées sur les contraintes et les paramètres défi nis par l’utilisateur. Cela permet une exploration rapide de multiples confi gurations possibles. L’outil ajuste les paramètres en temps réel pour optimiser les designs en fonction des critères spécifi ques comme l’ensoleillement, la ventilation, et l’effi cacité énergétique. Veras s’intègre directement avec les logiciels BIM, facilitant la transition entre la conception générative et la documentation technique.
Veras aide à explorer diff érentes formes et volumes pour le bâtiment, permettant une analyse rapide des impacts volumétriques. L’outil permet de tester et de visualiser diff érents concepts architecturaux, facilitant la prise de décision précoce dans le processus de conception. Veras optimise les designs pour répondre aux contraintes techniques, améliorant ainsi la faisabilité et la durabilité du projet.














fig 197 -203 : Veras propose une approche centrée sur l’enveloppe qui peut permettre, à la suite de la volumétrie, de rechercher une enveloppe propre au bâtiment, Veras, 2024
Finch est un logiciel de conception générative qui aide les architectes à explorer et à optimiser les confi gurations d’appartements et de bâtiments. Finch utilise des algorithmes d’IA pour générer des plans d’étage optimisés en fonction des contraintes spatiales et des besoins des utilisateurs.
Il utilise des algorithmes génératifs pour créer des confi gurations de plans d’étage en fonction des contraintes spatiales et des exigences programmatiques. L’outil ajuste les dispositions des pièces pour maximiser l’effi cacité de l’espace, l’accès à la lumière naturelle, et la ventilation. Finch intègre les contraintes structurelles et techniques dans le processus de génération, assurant la faisabilité des designs. (Finch 3D)
Finch aide à optimiser la disposition des espaces intérieurs en tenant compte des contraintes structurelles et des besoins des utilisateurs.
Concept: Il permet d’explorer diff érentes confi gurations spatiales et de tester leur impact sur le confort et la fonctionnalité.
Technique: L’outil prend en compte les aspects techniques dès les premières étapes de la conception, assurant la viabilité des plans générés.
Ces outils génératifs grand public jouent un rôle crucial dans la conception architecturale moderne. En combinant des analyses de site détaillées, des générations de volumétrie optimisées, et des résolutions de problèmes techniques, ils permettent aux architectes de créer des bâtiments innovants, durables, et esthétiquement plaisants. Veras, Autodesk Forma, et Finch illustrent comment l’IA peut transformer chaque étape du processus de conception, de l’exploration conceptuelle initiale à la réalisation technique fi nale.












fig 204 -208 : Finch 3D propose un lien direct avec Rhino, ce qui enrichit le processus de conception et surtout simplifie la courbe d’apprentissage de l’outil par les architectes, Finch, 2024
Le processus de conception architecturale est voué à connaitre une évolution (Leitch, Neil, 2022) grâce aux avancées technologiques, notamment avec l’intégration des outils d’intelligence artificielle (IA) et des logiciels paramétriques. Ce chapitre décrit en détail le nouveau processus de conception, en commençant par l’utilisation des outils précurseurs tels que MidJourney et Autodesk Forma en amont de l’esquisse, puis en intégrant des outils comme Veras et Finch, et enfin en passant par les logiciels traditionnels de CAO tels que Revit, Rhino, ou ArchiCAD, jusqu’à la publication des plans de réalisation. Nous examinerons également comment des outils tels qu’ALICE et Procore peuvent être intégrés pour optimiser le processus de construction.
Première étape, l’idéation conceptuelle avec MidJourney et Autodesk ou l’architecte utilise MidJourney pour explorer des idées et définir une direction esthétique. Les images générées servent de base pour les discussions et les itérations initiales du design. Après l’étape d’idéation conceptuelle, Autodesk Forma est utilisé pour créer des simulations environnementales et optimiser la volumétrie du projet en fonction des contraintes spécifiques du site.
Deuxième étape, le passage entre Autodesk Forma et Finch se fait généralement en exportant les données volumétriques et les analyses de site depuis Autodesk Forma vers Finch pour une optimisation plus détaillée de l’organisation spatiale.
Autodesk Forma permet d’exporter les modèles 3D et les données d’analyse sous différents formats compatibles avec Finch, tels que les fichiers IFC (Industry Foundation Classes) ou les fichiers DXF (Drawing Exchange Format). Une fois les données exportées, Finch les importe pour commencer à générer des configurations optimisées des plans d’étage. Finch utilise les contraintes spatiales et les exigences programmatiques pour ajuster les dispositions des pièces.
Le passage entre Finch et Revit se fait par le biais de l’exportation des modèles optimisés de Finch vers Revit pour une documentation détaillée et une coordination avec d’autres disciplines. Finch permet d’exporter les plans d’étage optimisés et les configurations spatiales sous des formats compatibles avec
Revit, tels que les fichiers IFC ou les fichiers RVT (Revit). Les données exportées de Finch sont importées dans Revit pour créer un modèle BIM complet. Revit facilite l’intégration des aspects structurels, MEP (Mechanical, Electrical, and Plumbing), et architecturaux, assurant une coordination fluide et une documentation détaillée.
Revit est un logiciel de BIM (Building Information Modeling) qui permet de créer des modèles 3D détaillés et de gérer les informations de construction. Les modèles générés par Veras et Finch sont importés dans Revit pour être développés en modèles BIM complets. Revit facilite la coordination entre les différentes disciplines (architecture, structure, MEP) et permet de produire des plans de construction détaillés.
ALICE utilise des algorithmes génératifs pour simuler et évaluer des scénarios de construction, optimisant les calendriers et les ressources. Il est utilisé pour planifier et gérer les phases de construction, en optimisant l’allocation des ressources et en réduisant les coûts et les délais. Procore est une plateforme de gestion de la construction qui améliore la productivité, réduit les erreurs et optimise la coordination entre les différentes parties prenantes du projet. Procore est utilisé tout au long du processus de construction pour gérer les documents, les communications, et les flux de travail, assurant ainsi une exécution efficace et sans accroc.
Le nouveau processus de conception architecturale intègre de manière transparente des outils d’IA et des logiciels de modélisation paramétrique pour optimiser chaque étape, de l’idéation conceptuelle à la réalisation technique. En combinant les capacités de MidJourney, Autodesk Forma, Veras, Finch, Revit, Rhino, ALICE, et Procore, les architectes peuvent créer des designs innovants et durables tout en améliorant l’efficacité et la précision du processus de conception. Cette approche intégrée permet de relever les défis de la complexité croissante des projets architecturaux contemporains, tout en offrant des solutions esthétiques et fonctionnelles adaptées aux besoins modernes.
L’intégration des outils d’intelligence artificielle (IA) dans le processus de conception architecturale apporte des gains significatifs en termes de rapidité, de précision, et d’optimisation des résultats finaux. Cette section explore ces gains et comment ils aident les architectes à mieux concevoir, maîtriser et anticiper les atmosphères au sein du logement. (Leitch, Neil, 2022)
Les outils IA tels que MidJourney et Autodesk Forma permettent de générer rapidement des concepts visuels et des configurations volumétriques, réduisant considérablement le temps nécessaire pour passer de l’idée initiale à une proposition concrète. Par exemple, MidJourney génère des images inspirantes à partir de descriptions textuelles en quelques minutes, tandis qu’Autodesk Forma analyse les données du site et propose des solutions optimisées en un temps record.
Des outils comme Veras et Finch automatisent les tâches répétitives et chronophages telles que la génération de plans d’étage et l’optimisation des espaces intérieurs. Cela permet aux architectes de se concentrer sur les aspects créatifs et stratégiques du projet. Selon EvolveLAB, l’utilisation de Veras peut réduire le temps de conception initiale de 30 à 50% .
Les algorithmes d’IA sont capables d’analyser de grandes quantités de données pour optimiser divers aspects de la conception, y compris l’efficacité énergétique, la ventilation naturelle, et l’ensoleillement. Par exemple, Spacemaker utilise des simulations avancées pour évaluer l’impact des choix de conception sur la durabilité et la constructibilité, assurant que les projets sont à la fois réalisables et performants.
L’intégration de l’IA dans les logiciels BIM tels que Revit permet de détecter et de corriger les erreurs dès les premières phases de la conception. Les outils d’IA peuvent simuler différents scénarios et prévoir les problèmes potentiels, ce qui réduit les risques de retards et de surcoûts pendant la construction. Une étude menée par Autodesk a montré que l’utilisation de BIM avec IA réduit les conflits de conception de 40% en moyenne .
Les outils IA permettent aux architectes de concevoir des espaces qui répondent mieux aux besoins des utilisateurs en utilisant des données réelles et des simulations précises. Par exemple, Finch optimise les plans d’étage en fonction des habitudes de vie des occupants, améliorant ainsi le confort et la fonctionnalité des logements.
Grâce à l’IA, les architectes peuvent proposer des solutions de conception personnalisées qui s’adaptent aux préférences individuelles des clients. Les outils génératifs permettent de créer des designs sur mesure qui répondent aux spécificités du site et aux exigences des utilisateurs, offrant une expérience plus riche et plus personnalisée.
L’intégration des outils d’IA dans le processus de conception architecturale offre des gains substantiels en termes de rapidité et de précision, tout en améliorant la qualité des atmosphères au sein des logements. Ces technologies permettent aux architectes de concevoir des espaces plus performants, confortables et personnalisés, répondant mieux aux attentes et aux besoins des utilisateurs. En automatisant les tâches répétitives et en optimisant les choix de conception grâce à des analyses de données précises, l’IA libère les architectes des contraintes techniques et leur permet de se concentrer sur la création de designs innovants et durables.
L’évolution technologique rapide dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) et de la modélisation numérique ouvre des perspectives innovantes pour l’architecture et la conception des atmosphères intérieures. Une des avancées potentielles les plus prometteuses serait le développement d’un lien direct entre les images générées par des outils IA comme MidJourney et les logiciels de conception tels que Revit, Rhino, Veras, et Finch. Cette intégration permettrait de traduire efficacement les visions esthétiques des architectes en modèles numériques précis, transformant ainsi la manière dont les espaces sont conçus et réalisés. (Leitch, Neil, 2022)
Les architectes utilisent souvent des images pour exprimer des concepts esthétiques complexes. La possibilité de traduire directement ces images en modèles numériques permettrait de capturer et de reproduire fidèlement les nuances visuelles envisagées par les concepteurs.
Actuellement, la modélisation manuelle des détails visuels peut être chronophage. Un lien direct entre les images IA et les logiciels de conception permettraient d’automatiser cette étape, réduisant considérablement le temps de conception.
La capacité de générer des modèles détaillés basés sur des images permettrait aux architectes de communiquer plus efficacement leurs visions aux clients, ingénieurs et autres parties prenantes, facilitant ainsi une meilleure collaboration et une compréhension mutuelle.
L’intégration des caractéristiques visuelles permettrait de personnaliser facilement les espaces en fonction des préférences spécifiques des clients, en ajustant les éléments de design tels que les textures, les couleurs, et l’éclairage selon les images fournies.
En permettant aux outils de conception de simuler précisément les conditions réelles basées sur des images, les architectes pourraient mieux anticiper et ajuster les atmosphères intérieures pour qu’elles correspondent aux visions initiales.
La possibilité d’utiliser des images pour influencer directement les modèles de conception encouragerait les architectes à expérimenter de nouvelles idées et concepts, poussant les limites de l’innovation architecturale.
L’intégration des caractéristiques visuelles des images générées par des outils IA dans les logiciels de conception représente une avancée majeure pour l’architecture. Cela permettrait non seulement de traduire plus fidèlement les visions esthétiques des architectes, mais aussi de réduire le temps de conception, d’améliorer la collaboration, de personnaliser les espaces intérieurs, et d’encourager l’innovation. En somme, cette intégration transformerait profondément la manière dont les atmosphères architecturales sont conçues et réalisées, offrant des avantages significatifs en termes de précision, de rapidité, et de satisfaction des occupants.
Marc Burry est un architecte et universitaire australien renommé, reconnu pour ses travaux sur la Sagrada Familia de Gaudi, où il a utilisé des outils numériques pour continuer et compléter cette œuvre complexe. Actuellement professeur à l’Université de Melbourne, il est également un pionnier dans l’utilisation des technologies numériques et paramétriques en architecture, et il explore activement le potentiel de l’intelligence artificielle pour transformer la pratique architecturale. (IAAC, 2024. IAAC Lecture Series-6 Markbury, Barcelona)
Marc Burry, dans son texte, met en lumière une problématique centrale de l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) en architecture : la potentielle dévalorisation du talent et de la créativité humaine. Il explique que des individus sans compétence architecturale pourraient utiliser des outils d’IA pour créer des designs basés sur des styles iconiques, comme ceux de Gaudi, sans véritable compréhension ou innovation. Il appelle cela «l’affranchissement de l’amateur».
«Je n’ai aucune idée, mais mon client veut que sa maison ressemble à une maison de Gaudi, donc je vais chercher une source d’images de Gaudi et je vais faire mon entraînement pour cela et ensuite je vais obtenir mon remboursement. C’est ce que j’appelle l’affranchissement de l’amateur. Donc si vous êtes un architecte incompétent, avare ou pas un architecte du tout, c’est le danger de l’intelligence artificielle.»
Marc Burry met en garde contre l’utilisation superficielle de l’IA qui permettrait à des non-professionnels ou à des architectes sans grande créativité de produire des designs en s’appropriant des styles existants sans véritable innovation ou compréhension. Il critique l’idée que l’IA puisse remplacer le génie créatif et l’intuition humaine qui sont au cœur de l’architecture.
Pour Burry, les architectes talentueux continueront à devancer les machines en termes d’idées et de vision créative. L’IA, selon lui, devrait être vue comme un outil d’optimisation et non comme un substitut à la créativité humaine. Les machines peuvent aider à analyser et à évaluer, mais elles ne peuvent pas générer de véritables idées architecturales.
Marc Burry met donc en avant un point crucial dans le débat sur l’utilisation de l’IA en architecture : la nécessité de maintenir la créativité et l’innovation humaines au cœur du processus de conception. Bien que l’IA offre des outils puissants pour optimiser et accélérer la conception, elle ne peut remplacer l’intuition, l’ingéniosité et la vision unique des architectes talentueux. Pour maximiser les bénéfices de l’IA tout en préservant l’essence de l’architecture, il est essentiel d’utiliser ces technologies comme des outils complémentaires, et non comme des substituts à la créativité humaine.

fig 209 : Ici au côté d’une maquette de la Sagrada Familia à Barcelone l’un de ses grands projets en tant qu’architecte Matk Burry, 2024
Antoine Picon est un théoricien de l’architecture et historien français, professeur à la Graduate School of Design de l’Université Harvard. Il est spécialisé dans l’impact des technologies numériques sur l’architecture et l’urbanisme. Picon explore comment les outils numériques transforment la conception architecturale et met en évidence les limites et les illusions associées à ces technologies, tout en insistant sur l’importance de l’écart entre représentation et réalité construite. (Picon, Antoine, 2012)
Antoine Picon, lors d’une conférence en 2012, s’est concentré sur les outils numériques et leur impact sur l’architecture. Il a soutenu que l’écart entre la représentation et l’objet bâti est intrinsèque à la discipline architecturale. Selon Picon, cette distance ne pourra jamais être complètement abolie, même avec l’arrivée des technologies numériques. Il critique l’idée naïve selon laquelle le numérique pourrait éliminer cette différence, qualifiant cette perspective de fiction moderne. Picon argue que la vraie fiction réside dans le désir d’abolir cette distance, un désir qu’il considère comme une illusion.
Historiquement, les architectes et le public ont souvent perçu les bâtiments à travers des images avant de les voir en réalité, influençant ainsi leur perception. Picon cite l’exemple de la Villa Savoye de Le Corbusier, que peu de personnes voient pour la première fois sans être influencées par les nombreuses photos existantes. Il note également que les constructions modernes, souvent vantées pour leur qualité grâce aux technologies avancées, peuvent parfois surprendre par des aspects inattendus lorsqu’elles sont finalement construites.
Extrapolant ses observations aux outils d’intelligence artificielle (IA), Picon pourrait argumenter que ces technologies, tout comme les outils numériques, ne peuvent pas éliminer la distance entre la conception et la réalisation physique d’un bâtiment. Cette distance est un moteur de la créativité architecturale et fait partie intégrante de la discipline. L’illusion que les représentations générées par IA peuvent pleinement remplacer l’expérience physique de l’architecture est critiquée, soulignant que l’architecture reste une discipline fondamentalement liée à l’expérience tridimensionnelle et physique.
Antoine Picon nous rappelle que, malgré les promesses des nouvelles technologies qu’elles soient simplement numériques ou basées sur l’IA, l’architecture conserve une dimension intrinsèquement liée à l’écart entre la représentation et la réalité construite. Cet écart est essentiel à la création architecturale et doit être reconnu comme tel.

1. Objectifs
2. Résultats
3. Perspective


L’objectif principal de cette recherche a été d’évaluer l’influence des outils de conception sur la qualité spatiale dans la production architecturale contemporaine. L’examen portait sur l’impact des outils de conception, des plus traditionnels aux plus modernes, sur la création des espaces et, par conséquent, sur la qualité de l’expérience vécue par les occupants. Divers projets ont été analysés pour comprendre comment l’usage des outils par les architectes influence la qualité des espaces créés.
Il a été observé que l’attrait pour la complexité technique et paramétrique tend souvent à passer avant l’objectif fondamental de l’architecture, qui est de servir les besoins des habitants. Bien que ces outils permettent des réalisations architecturales impressionnantes sur le plan technique, ils peuvent parfois négliger les aspects essentiels de la qualité de vie et de l’expérience spatiale.
L’étude a également porté sur l’impact direct des outils de conception sur l’expérience vécue à l’intérieur des espaces créés. La question centrale était de savoir si l’utilisation accrue de la technologie dans la conception architecturale améliore ou détériore la qualité des espaces pour les usagers. Les analyses ont montré que l’influence est nuancée. Si certains outils permettent une personnalisation et une optimisation accrues, d’autres risquent de complexifier inutilement les espaces sans améliorer significativement l’expérience vécue par les occupants.
Dans le cadre de cette recherche, des techniques et des outils alternatifs susceptibles de remédier aux limitations observées dans l’approche paramétrique conventionnelle ont été explorés. L’objectif était de déterminer si les outils génératifs et d’intelligence artificielle pouvaient offrir des solutions viables aux enjeux spatiaux identifiés précédemment.
Une analyse approfondie des outils génératifs et d’intelligence artificielle a été entreprise pour déterminer si ces nouvelles technologies pouvaient améliorer la conception des espaces en mettant l’accent sur la qualité de vie des habitants. Des outils tels que MidJourney, Forma, Veras et Finch ont été évalués pour leur capacité à générer des concepts visuels, à optimiser les configurations spatiales et à améliorer la précision de la conception. La recherche a révélé que bien que les outils génératifs et d’IA ne soient pas encore parfaits, ils représentent une voie prometteuse pour l’avenir de la conception architecturale. Ces technologies ont le potentiel de transformer la manière dont les architectes travaillent, en permettant une plus grande fluidité et interopérabilité entre les différentes phases de la conception et en améliorant la qualité des espaces vécus.
À travers cette recherche, il est pertinent de revisiter le travail de Frank Lloyd Wright, un architecte dont les œuvres sont souvent décrites comme des symphonies de matériaux et d’ambiances. Chaque projet de Wright est une composition harmonieuse où les éléments matériels, philosophiques et sensoriels se combinent pour créer une expérience architecturale unique. Cette approche intégrée et holistique est une référence essentielle pour comprendre comment les matériaux et les atmosphères peuvent être orchestrés de manière à enrichir l’expérience vécue dans les espaces construits.
Dans un second temps, l’analyse des projets contemporains de Bjarke Ingels Group (BIG) et de Jean Nouvel révèle une tendance à exploiter les capacités techniques des outils paramétriques pour créer des formes architecturales complexes. Cependant, cette quête de complexité technique semble parfois détourner les architectes de l’objectif de créer des espaces harmonieux et sensibles, comparables à ceux de Wright. Les projets paramétriques, bien que techniquement impressionnants, peinent souvent à atteindre le niveau de symphonie spatiale que Wright a su maîtriser. Cette observation souligne les limites des outils paramétriques lorsque l’usage de ceux-ci devient trop centré sur les prouesses techniques au détriment de la qualité spatiale.
Enfin, l’analyse des outils génératifs et d’intelligence artificielle (IA) montre une ambition claire de simplifier le processus de conception architecturale. Ces outils sont conçus pour être accessibles et intuitifs, permettant ainsi aux architectes de se concentrer davantage sur les aspects qualitatifs des espaces qu’ils créent. Les outils génératifs, en particulier, offrent la possibilité de libérer les architectes
fig 211 : Endless skyscraper, Eduard Haiman, 2021
des contraintes techniques et des tâches répétitives, leur permettant ainsi de se focaliser sur l’essence même de la conception : la qualité spatiale et l’expérience de l’usager.
Les outils génératifs et paramétriques ont transformé la manière dont les architectes conçoivent leurs projets. L’utilisation de ces technologies permet une plus grande précision et efficacité dans la conception architecturale. L’IA, en particulier, a montré un potentiel significatif pour améliorer la qualité des espaces en facilitant la personnalisation. Les algorithmes d’apprentissage automatique peuvent analyser les propriétés des matériaux pour prédire et améliorer leur comportement sous diverses conditions, comme vu dans des projets utilisant Spacemaker. Ces outils permettent de créer des simulations réalistes qui aident à optimiser la structure et l’efficacité énergétique des bâtiments.
Ils offrent des avantages en termes de rapidité d’itération, de précision, et de personnalisation, tout en améliorant la communication et la collaboration. Pour que ces outils réalisent pleinement leur potentiel, une intégration plus fluide et une interopérabilité accrue sont nécessaires, ainsi qu’une focalisation continue sur l’expérience utilisateur et l’évolution technologique.
Ainsi les outils génératifs représentent une avancée significative dans le domaine de l’architecture et du design, offrant un potentiel immense pour transformer la conception des logements. En optimisant les espaces pour le confort, la fonctionnalité et la durabilité, ces outils peuvent créer des environnements de vie plus agréables et mieux adaptés aux besoins des utilisateurs. Les avancées dans ce domaine promettent de transformer la manière dont nous concevons et vivons nos espaces résidentiels, tout en renforçant la qualité de vie des occupants grâce à des configurations spatiales bien conçues et des utilisations efficaces des ressources disponibles.
L’accent doit être mis sur l’amélioration de l’expérience utilisateur pour les architectes, en rendant les outils plus intuitifs et accessibles. Cela inclut la formation continue et le support technique pour aider les professionnels ou étudiants à adopter et à maîtriser ces technologies avancées.
Les outils doivent continuer à évoluer pour répondre aux besoins changeants de la conception architecturale. Cela implique d’investir dans la recherche et le développement pour intégrer des fonctionnalités encore plus avancées et adaptées aux pratiques modernes. L’IA et les technologies génératives offrent un potentiel immense pour transformer l’architecture, mais elles doivent être continuellement améliorées pour maximiser leur impact positif sur la qualité des espaces construits et vécus.
À travers cette recherche, il apparaît que l’utilisation des outils génératifs et d’intelligence artificielle en architecture doit être abordée avec une certaine philosophie et une réflexion approfondie sur leur impact réel sur la conception et la qualité des espaces. Antoine Picon, dans ses travaux, souligne l’importance de maintenir une distance entre la représentation et l’objet bâti. Il rappelle que cette distance est constitutive de l’architecture et que les outils numériques, aussi avancés soient-ils, ne doivent pas prétendre abolir cette distinction fondamentale. Picon nous met en garde contre l’illusion que les technologies peuvent créer une correspondance parfaite entre l’image et la réalité construite. Cette réflexion pousse à considérer que, malgré les capacités avancées de modélisation et de visualisation offertes par l’IA, l’essence de l’architecture réside dans la transformation d’une vision en une expérience tangible et unique.
D’autre part, Marc Burry met en lumière les dangers potentiels d’une utilisation non réfléchie des outils IA. Il met en garde contre le risque de standardisation et de perte d’authenticité architecturale si ces technologies sont utilisées sans discernement. Selon Burry, l’IA doit être un outil qui augmente les capacités créatives des architectes et non qui les remplace. Cette perspective est cruciale, car elle rappelle que la créativité humaine et l’ingéniosité sont au cœur de l’architecture. L’IA doit donc être utilisée pour enrichir la conception architecturale, en servant les idées et la vision de l’architecte plutôt qu’en les dominant.
Ces réflexions soulignent l’importance d’adopter une attitude critique et humaniste envers les technologies génératives. En tant qu’architecte, il est essentiel de veiller à ce que l’IA et les outils numériques servent à enrichir la qualité spatiale et les atmosphères des projets. Les technologies doivent être intégrées de manière à soutenir et à renforcer la vision architecturale, en créant des espaces uniques et significatifs. L’utilisation de ces outils doit être guidée par une philosophie qui valorise l’humain, la créativité et la profondeur des espaces construits.
Il est crucial de minimiser les subtilités du processus de conception pour permettre aux architectes de se concentrer davantage sur la matérialisation de leurs concepts initiaux. Les outils doivent être conçus pour fonctionner ensemble de manière harmonieuse, réduisant ainsi le besoin de multiples conversions et ajustements manuels. De plus, une focalisation continue sur l’expérience utilisateur et l’évolution technologique est nécessaire pour maximiser l’impact positif de ces technologies sur la qualité des espaces construits et vécus.
Cependant, pour réaliser pleinement ce potentiel, il est crucial que les architectes utilisent ces outils avec une conscience philosophique et éthique. Comme le souligne Marc Burry, l’IA doit être un moyen d’enrichir la créativité architecturale et non de la remplacer. De même pour Antoine Picon, rappelant que l’écart entre la représentation numérique et l’objet bâti est une caractéristique inhérente de l’architecture qui ne doit pas être ignorée.
En conclusion, l’intégration des outils génératifs et d’intelligence artificielle en architecture offre un potentiel immense pour transformer la conception des espaces résidentiels. Cependant, leur utilisation doit être guidée par une réflexion philosophique et humaniste, assurant que ces technologies enrichissent la qualité spatiale et servent véritablement la vision et l’intention de l’architecte. Les outils IA doivent être utilisés pour renforcer les qualités spatiales et les atmosphères des projets, garantissant que l’architecture reste une discipline où la créativité humaine et l’innovation technique se conjuguent pour produire des espaces de vie exceptionnels.
Glossaire Sources Iconographie
BIBLIOGRAPHIE
Atmosphère : Qualité intangible et subjective perçue par les occupants d’un espace, influencée par la lumière, le son, les textures et la configuration spatiale.
Axonométrie : Technique de représentation graphique montrant des objets en trois dimensions sans distorsion des proportions.
Building Information Modeling (BIM) : Technologie de modélisation 3D intégrant des informations techniques, structurelles et environnementales pour améliorer la conception et la gestion des bâtiments.
Certifications Écologiques (LEED, BREEAM, HQE) : Normes et systèmes de certification pour évaluer et reconnaître les bâtiments durables et performants.
Collage : Technique artistique consistant à assembler divers matériaux graphiques pour explorer et présenter des concepts.
Construction Modulaire : Méthode de construction où les bâtiments sont fabriqués en sections standardisées hors site et assemblés sur place.
Croquis : Dessins rapides et souvent imprécis pour capturer des idées initiales et explorer des concepts.
Design Thinking : Méthode de résolution de problèmes centrée sur l’humain pour développer des solutions innovantes.
Dessin à Main Levée : Technique de dessin manuel pour capturer des idées et des concepts de manière intuitive.
Élévations : Dessins techniques montrant les façades extérieures d’un bâtiment.
Énergie Embodied : Totalité de l’énergie utilisée pour produire les matériaux de construction, leur transport et leur mise en œuvre.
Enscape : Outil de visualisation en temps réel intégré dans des logiciels de modélisation pour créer des rendus photoréalistes et des expériences de réalité virtuelle.
Enveloppe du Bâtiment : Ensemble des éléments composant la peau extérieure d’un bâtiment.
Esquisses : Dessins préliminaires rapides pour explorer des idées de conception et des configurations spatiales.
Façade Dynamique : Conception de façade changeant en réponse aux conditions environnementales ou aux besoins des occupants.
Fine-tuning : Affinage d’un modèle d’intelligence artificielle pour améliorer ses performances sur des tâches spécifiques.
Firmitas, Utilitas, Venustas : Les trois principes fondamentaux de l’architecture définis par Vitruve : solidité, utilité et beauté.
Finch : Outil génératif basé sur l’IA pour concevoir des espaces optimisés dès les premières phases de conception.
GANs (Generative Adversarial Networks) : Réseaux antagonistes génératifs utilisés pour créer des images réalistes en faisant s’affronter deux réseaux neuronaux.
Grasshopper : Plugin pour Rhino permettant la conception paramétrique avancée et l’optimisation des formes complexes.
Harmonie : Unité et cohérence esthétique d’un espace ou d’un édifice, résultant de la combinaison équilibrée des proportions, des formes et des matériaux.
Hypar : Plateforme basée sur le cloud utilisant l’IA pour automatiser les tâches de conception et générer des solutions architecturales.
Intelligence Artificielle (IA) : Technologies simulant des processus cognitifs humains pour automatiser la conception, optimiser les performances énergétiques et créer des visualisations réalistes.
Lignes Convergentes : Lignes dans un dessin en perspective se dirigeant vers un ou plusieurs points de fuite pour créer l’illusion de profondeur.
LLM (Large Language Model) : Modèle de langage à grande échelle capable de comprendre, générer et manipuler le langage naturel.
Lumière Artificielle : Éclairage artificiel utilisé pour créer des ambiances et mettre en valeur des éléments du design.
Lumière Naturelle : Lumière du soleil utilisée pour influencer l’atmosphère et l’ambiance des espaces.
Maquettes Paramétriques : Modèles tridimensionnels générés par des algorithmes utilisant des paramètres spécifiques pour créer des formes et configurations spatiales.
Maquettes Physiques : Modèles tridimensionnels réduits d’un projet pour visualiser et tester les proportions, les matériaux et les effets de lumière.
Modélisation 3D : Création de représentations tridimensionnelles numériques des projets pour visualiser et manipuler les formes et les espaces.
Modélisation Topologique : Technique de conception assistée par ordinateur optimisant les formes structurelles pour améliorer leur performance.
Modèle d’Information de la Construction (CIM) : Extension du BIM à l’échelle de la ville ou de l’infrastructure pour une planification urbaine plus efficace.
Modèle de Conception Itératif : Approche de conception où les solutions sont continuellement testées, évaluées et améliorées.
Modèle Numérique de Terrain (MNT) : Représentation numérique de la surface terrestre utilisée pour la planification et la conception de projets d’infrastructure.
Morphogenèse : Processus de développement de la forme architecturale basé sur des principes biologiques et naturels.
Optimisation Paramétrique : Utilisation d’algorithmes pour générer et évaluer de multiples configurations de conception afin de trouver les solutions optimales.
Paramètres : Variables et critères définis par l’utilisateur dans les outils génératifs pour orienter le processus de création.
Perspectives : Techniques de dessin représentant des objets en trois dimensions sur une surface bidimensionnelle pour créer l’illusion de profondeur et de volume.
Photogrammétrie : Technique de mesure et de modélisation des objets en 3D à partir de photographies, utilisée pour la documentation et la restauration architecturale.
Photomontage : Technique de représentation visuelle combinant des photographies et des éléments graphiques pour créer des images composites.
Points de Fuite : Points vers lesquels convergent les lignes parallèles dans un dessin en perspective pour simuler la perception de la distance et de la profondeur.
Proportion : Relation harmonieuse entre les différentes parties d’un édifice ou d’un espace.
Prototypage Rapide : Fabrication rapide de modèles physiques ou numériques pour tester et évaluer les concepts avant leur mise en œuvre finale.
Réalité Augmentée (AR) : Technologie superposant des informations numériques sur le monde réel pour visualiser des projets dans leur contexte réel.
Réalité Virtuelle (VR) : Technologie immersive permettant aux utilisateurs d’explorer des environnements
numériques en 3D pour visualiser des projets avant leur construction.
Rendu Immersif : Technique de visualisation permettant aux utilisateurs de s’immerger dans un environnement numérique avec la réalité virtuelle ou augmentée.
Rendu Photorealiste : Images générées par ordinateur simulant de manière réaliste l’apparence finale d’un projet, en tenant compte des matériaux, de la lumière et des ombres.
Simulation : Utilisation de logiciels pour modéliser les conditions réelles comme la lumière, les ombres et les matériaux, permettant d’évaluer l’atmosphère et l’ambiance des espaces.
Stratégies de Ventilation Naturelle : Techniques de conception pour maximiser la circulation de l’air sans recours à des systèmes mécaniques, améliorant le confort thermique et la qualité de l’air.
Symétrie : Équilibre et correspondance des éléments architecturaux de chaque côté d’un axe central.
Textures des Matériaux : Propriétés tactiles et visuelles des matériaux utilisés dans la construction et la finition des bâtiments.
Télédétection : Utilisation de satellites ou de drones pour collecter des données sur un site pour l’analyse géospatiale et la planification urbaine.
TestFit : Logiciel utilisant des algorithmes pour générer des configurations optimales pour des projets résidentiels et commerciaux, utile pour les phases de faisabilité et de pré-conception.
Transformateur (Architecture) : Réseau de neurones utilisé dans les modèles de langage à grande échelle pour gérer des dépendances complexes entre les mots avec des mécanismes d’attention.
Twinmotion : Moteur de rendu en temps réel permettant de créer des visualisations interactives et immersives des projets pour faciliter la prise de décision.
Visualisation de Données : Utilisation de graphiques et de diagrammes pour représenter les informations et analyses de conception, facilitant la prise de décision.
Workflow : Ensemble des processus et étapes suivis dans un projet architectural, souvent optimisés grâce aux outils numériques et à l’IA.
Ouvrages
Boudon, Philippe, Philippe Deshaies, Frédéric Pousin, and Françoise Schatz. 1991. La conception architecturale: Histoire, théories et pratiques. Paris: Éditions de l’École d’Architecture de Paris-La Villette, Volumen. ISBN: 978-2904540167.
Canepa, Elisabetta. 2019. Architecture is Atmosphere. Milan: Mimesis International. ISBN: 9788869772520.
Chaillou, Stanislas. 2021. L’intelligence artificielle au service de l’architecture. Paris: Le Moniteur. ISBN: 978-2281144897.
Ching, Francis D.K. 2003. Architecture: Form, Space, and Order. Paris: Éditions Erol. ISBN: 9782212112276.
Ching, Francis D.K. 2010. Design Drawing. 2d ed. Hoboken: Wiley. ISBN: 978-0470533697.
Domus. 2010. Domus 1928-1939. Taschen. ISBN: 978-3836509584.
Domus. 2010. Domus 1940-1949. Taschen. ISBN: 978-3836510887.
Domus. 2010. Domus 1950-1959. Taschen. ISBN: 978-3836510894.
Domus. 2010. Domus 1960-1969. Taschen. ISBN: 978-3836510900.
Domus. 2010. Domus 1970-1979. Taschen. ISBN: 978-3836510917.
Gössel, Peter, et Leuthäuser. 2006. L’architecture du XXe siècle. Taschen. ISBN: 978-3822811621.
Lucan, Jacques. 2009. Composition, non-composition: architecture et théorie, XVIIIe-XXe siècles. Lausanne: EPFL Press. ISBN: 978-2940222020.
Lucan, Jacques. 2012. Précisions sur un état présent de l’architecture. Lausanne: EPFL Press. ISBN: 978-2940222594.
Lucan, Jacques. 2021. Habiter : ville et architecture. 1st ed. Lausanne: EPFL Press. ISBN: 978-2940222976.
Noë, Jean-Luc. 2007. Heidegger et la question de l’habitat: Une philosophie de l’architecture. Paris: Éditions Eupalinos. ISBN: 978-2915056247.
Pfeiffer, Bruce Brooks, et Peter Gössel. 2002. Frank Lloyd Wright. Cologne: Taschen. ISBN: 9783822811607.
Rocchiella, Graziella. 2009. Gio Ponti. Cologne: Taschen. ISBN: 978-3836500338.
Von Meiss, Pierre. 2010. De la forme au lieu: une introduction à l’étude de l’architecture. Lausanne: EPFL Press. ISBN: 978-2880748442.
Zumthor, Peter. 2006. Atmospheres: Architectural Environments, Surrounding Objects. Basel: Birkhäuser. ISBN: 978-3764374952.
Ouvrages en ligne
Chaillou, Stanislas, 2022. Artificial Intelligence and Architecture: From Research to Practice [en ligne]. Birkhäuser. Disponible à l’adresse : https://birkhauser.com/books/9783035624045
Leitch, Neil, 2022. Architecture in the Age of Artificial Intelligence. Bloomsbury ISBN : 978-1-35016551-9. Disponible à l’adresse : https://www.bloomsbury.com/uk/architecture-in-the-age-of-artificialintelligence-9781350165519/ (Consulté le 3 Juillet 2024).
Mazzola, Lisa. 2006. Louis I. Kahn: A Guide for Educators. Édité par Peter Reed et Rebecca Roberts, design par Elizabeth Elsas et Tamara Maletic, gestion de production par Claire Corey. The Museum of
Modern Art, 2006. Disponible à l’adresse : https://www.moma.org/momaorg/shared/pdfs/moma_learning/ docs/kahn_full.pdf [Consulté le 3 Novembre 2024].
Pages web
Applicit.com, 2022. «La conception générative de l’intelligence artificielle dans Revit.» Applicit [online]. Disponible à l’adresse : https://www.aplicit.com/la-conception-generative-la-intelligenge-artificiel-dansrevit/ [Consulté le 9 Juillet 2024].
ArchDaily.com, 2019. YCONE La Confluence Residential Tower, Atelier Jean Nouvel. ArchDaily [en ligne]. Disponible à l’adresse : https://www.archdaily.com/922042/ycone-la-confluence-residential-tower-ateliersjean-nouvel?ad_source=search&ad_medium=projects_tab [Consulté le 5 Juillet 2024].
ArchDaily, 2008. Mountain Dwellings / BIG. ArchDaily [en ligne]. Date de publication : 20 novembre 2008. Disponible à l’adresse : https://www.archdaily.com/15022/mountain-dwellings-big [Consulté le 5 Juillet 2024].
Arquitectura Viva. Viviendas Mountain Dwellings. Arquitectura Viva [en ligne]. Disponible à l’adresse : https://arquitecturaviva.com/works/viviendas-mountain-0 [Consulté le 5 Juillet 2024].
Balik, Denis et Asalia Almer, 2015. This is not a mountain: Simulation, imitation and representation in the Mountain Dwellings project Copenhagen. ResearchGate [en ligne]. Disponible à l’adresse : https:// www.researchgate.net/publication/282549285_This_is_not_a_mountain_Simulation_imitation_and_ representation_in_the_Mountain_Dwellings_project_Copenhagen[Consulté le 09 août 2024].
BusinessNorway.com. 2023. «Norway is Greening the Construction Industry.» Business Norway [online]. Publié le 27 Mars 2023. Disponible à l’adresse : https://businessnorway.com/articles/norway-is-greeningthe-construction-industry [Consulté le 10 Juillet 2024].
Chaillou, Stanislas, 2020. Space Layout and GAN. Medium [en ligne]. Disponible à l’adresse : https:// medium.com/spacemaker-research-blog/space-layouts-gans-2329c8f85fe8 [Consulté le 20 Juin 2024].
Chaillou, Stanislas, 2020. Architecture as a Graph. Medium [en ligne]. Disponible à l’adresse : https:// medium.com/spacemaker-research-blog/architecture-as-a-graph-e7b3387cd3c5 [Consulté le 20 Juin 2024].
Chaillou, Stanislas, 2020. The Advent of Architectural AI. Medium [en ligne]. Disponible à l’adresse : https:// towardsdatascience.com/the-advent-of-architectural-ai-706046960140 [Consulté le 20 Juin 2024].
Chaillou, Stanislas, 2020. Metabolism, Space Flexibility in the 21st Century. Medium [en ligne]. Disponible à l’adresse : https://medium.com/built-horizons/metabolism-s-spatial-flexibility-in-the-21st-centuryd7cef8aaaf84 [Consulté le 20 Juin 2024].
Chaillou, Stanislas, 2020. AI and Architecture. Medium [en ligne]. Disponible à l’adresse : https:// towardsdatascience.com/ai-architecture-f9d78c6958e0 [Consulté le 20 Juin 2024].
Construction21.org, 2019. Cas illustré, Tour YCONE à Confluence Lyon, Jean Nouvel se met presque au bois. Construction21 [en ligne]. Disponible à l’adresse : https://www.construction21.org/france/articles/h/ cas-illustre-tour-ycone-a-confluence-lyon-jean-nouvel-se-met-presque-au-bois.html [Consulté le 6 Juillet 2024].
Divisare.com, 2018. Peter Zumthor, Morphosis Architects, Tom Mayne, Thermal Baths at 7132 Hotel. Divisare.com [en ligne]. Publié le 11 juin 2018. Disponible à l’adresse : https://divisare.com/projects/388269peter-zumthor-morphosis-architects-thom-mayne-fabrice-fouillet-thermes-vals-at-7132-hotel [Consulté le 5 Avril 2024].
Dezeen, 2008. Mountain Dwellings by BIG. Dezeen [en ligne]. Disponible à l’adresse : https://www.dezeen. com/2008/02/17/mountain-dwellings-by-big/ [Consulté le 09 août 2024].
Groupe Cardinal, 2019. YCONE, Bayes-Jean-Nouvel, Lyon-Confluence. GroupeCardinal.com [en ligne]. Auteur : Jean-Christophe Larose. Disponible à l’adresse : https://www.groupecardinal.com/realisations/
residentiel/ycone-by-jean-nouvel [Consulté le 5 Juillet 2024].
JeanNouvel.com, 2019. YCONE Lyon-France. JeanNouvel.com [en ligne]. Disponible à l’adresse : http:// www.jeannouvel.com/en/projects/ycone/ [Consulté le 4 Juillet 2024].
Mortice, Zach. 2023. «De la vision à la conception, comment l’IA redéfinit l’architecture.» Autodesk [online]. Publié le 4 Octobre 2023. Disponible à l’adresse : https://www.autodesk.com/fr/design-make/articles/iaarchitecture [Consulté le 09 Novembre 2023].
OfficeSnapshot.com, 2019. Inside Foster + Partners Headquarters. OfficeSnapshot.com [en ligne]. 25 juillet 2019. Disponible à l’adresse : https://officesnapshots.com/2013/01/04/foster-partners-headquartersoffice-design/ [Consulté le 1 Juillet 2024].
Universaliste.fr, 2024. Andréa Palladio 1508-1580, Le Vitruve des Temps Modernes. Universaliste.fr [en ligne]. Disponible à l’adresse : https://www.universalis.fr/encyclopedie/andrea-palladio/2-le-vitruve-destemps-modernes/ [Consulté le 3 Juillet 2024].
Wikipédia, 2024. Adobe Photoshop. Wikipédia: The Free Encyclopedia [en ligne]. Dernière modification août 2024. Disponible à l’adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop [Consulté le 25 Juillet 2024].
Wikipédia, 2024. Archicad. Wikipédia: The Free Encyclopedia [en ligne]. Dernière modification août 2024. Disponible à l’adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Archicad [Consulté le 25 Juillet 2024].
Wikipédia, 2024. Blender (Software). Wikipédia: The Free Encyclopedia [en ligne]. Dernière modification août 2024. Disponible à l’adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Blender [Consulté le 25 Juillet 2024].
Wikipédia, 2024. ChatGPT. Wikipédia: The Free Encyclopedia [en ligne]. Dernière modification août 2024. Disponible à l’adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/ChatGPT [Consulté le 25 Juillet 2024].
Wikipédia, 2024. De Architectura - Vitruvius. Wikipédia [en ligne]. Disponible à l’adresse : https://fr.wikipedia. org/wiki/De_architectura [Consulté le 25 Juillet 2024].
Wikipédia, 2024. Grasshopper 3D. Wikipédia: The Free Encyclopedia [en ligne]. Dernière modification août 2024. Disponible à l’adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Grasshopper_3D [Consulté le 25 Juillet 2024].
Wikipédia, 2024. Large Language Model (LLM). Wikipédia: The Free Encyclopedia [en ligne]. Dernière modification août 2024. Disponible à l’adresse : https://en.wikipedia.org/wiki/Large_language_ model [Consulté le 25 Juillet 2024].
Wikipédia, 2024. L’Art d’édifier - Leon Battista Alberti. Wikipédia [en ligne]. Disponible à l’adresse : https:// fr.wikipedia.org/wiki/L%27Art_d%27%C3%A9difier [Consulté le août 2024].
Wikipédia, 2024. Midjourney. Wikipédia: The Free Encyclopedia [en ligne]. Dernière modification août 2024. Disponible à l’adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Midjourney [Consulté le 25 Juillet 2024].
Wikipédia, 2024. Prompt Engineering. Wikipédia: The Free Encyclopedia [en ligne]. Dernière modification août 2024. Disponible à l’adresse : https://en.wikipedia.org/wiki/Prompt_engineering [Consulté le 25 Juillet 2024].
Wikipédia, 2024. 3D Rendering. Wikipédia: The Free Encyclopedia [en ligne]. Dernière modification août 2024. Disponible à l’adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/3D_Rendering [Consulté le 25 Juillet 2024].
Wikipédia, 2024. Bjarke Ingels. Wikipédia: The Free Encyclopedia [en ligne]. Dernière modification août 2024. Disponible à l’adresse : https://en.wikipedia.org/wiki/Bjarke_Ingels [Consulté le 15 Juillet 2024]
Wikipédia, 2024. Jean Nouvel. Wikipédia: The Free Encyclopedia [en ligne]. Dernière modification août 2024. Disponible à l’adresse : https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Nouvel [Consulté le 15 Juillet 2024].
Archistar, intelligence artificielle pour la conception architecturale. Archistar [en ligne]. Disponible à l’adresse : https://www.archistar.ai [Consulté le 15 février 2024].
Architechture, plateforme de conception générative pour l’architecture. Architecture Tech [en ligne]. Disponible à l’adresse : https://architechtures.com/en [Consulté le 7 novembre 2023].
Augmenta, plateforme de conception générative pour l’architecture. Augmenta [en ligne]. Disponible à l’adresse : https://www.augmenta.ai [Consulté le 3 mars 2024].
Autodesk Format AI, outil de planification assistée par IA. Autodesk [en ligne]. Disponible à l’adresse : https:// www.autodesk.com/products/forma/overview?term=1-YEAR&tab=subscription&plc=SPCMKR [Consulté le 12 juin 2024].
Cove Tool AI, optimisation des performances énergétiques des bâtiments avec IA. Cove Tool [en ligne]. Disponible à l’adresse : https://www.covetool.com [Consulté le 21 avril 2024].
Delve by Sidewalk Labs, plateforme d’analyse urbaine alimentée par IA. Sidewalk Labs [en ligne]. Disponible à l’adresse : https://www.bluelabellabs.com/work/delve/ [Consulté le 9 avril 2024].
Deep Blocks AI, intelligence artificielle pour l’analyse de faisabilité immobilière. Deep Blocks [en ligne]. Disponible à l’adresse : https://www.deepblocks.com [Consulté le 26 mars 2024].
Finch 3D, logiciel d’architecture utilisant l’intelligence artificielle. Finch 3D [en ligne]. Disponible à l’adresse : https://www.finch3d.com [Consulté le 30 mars 2024].
HyparIA, l’intelligence artificielle au service de l’architecture. HyperIA [en ligne]. Disponible à l’adresse : https://hypar.io [Consulté le 11 juillet 2024].
Midjourney. «Home.» Midjourney [en ligne]. Disponible à l’adresse : https://www.midjourney.com/ home [Consulté le 1 Avril 2024]
Playground AI. NVIDIA [en ligne]. Disponible à l’adresse : https://www.nvidia.com/en-us/research/aiplayground/ [Consulté le 30 mars 2024].
Spatio AI, solution d’optimisation de l’espace avec intelligence artificielle. Spatio AI [en ligne]. Disponible à l’adresse : https://spacio.ai [Consulté le 4 février 2024].
Test & Fit, plateforme d’optimisation spatiale avec IA. Test & Fit [en ligne]. Disponible à l’adresse : https:// www.testfit.io [Consulté le 28 mars 2024].
Veras AI, outil de visualisation architecturale par Evolve Labs. Evolve Labs [en ligne]. Disponible à l’adresse : https://www.evolvelab.io/veras [Consulté le 27 mars 2024].
Travail de bachelor/master, thèse, mémoire
Chaillou, Stanislas. 2020. AI + Architecture: Towards a New Architectural Paradigm [thèse]. Paris: École nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville. Disponible à l’adresse : https://www.academia. edu/39599650/AI_Architecture_Towards_a_New_Approach [Consulté le 20 Juin 2024].
Chelkoff Grégoire. 2022. Perception et expérience critique : explorer l’architecture comme ambiance. Cahiers thématiques, 2022, Théorie critique et pensée critique au prisme de l’architecture, 21, pp.149-161. Disponible à l’adresse : https://shs.hal.science/halshs-03838687/document [Consulté le 27 Janvier 2024].
Delvalet, Thimonier, 2019. Concevoir une architecture phénoménologie de la perception spatiale [support en ligne]. ResearchGate. Disponible à l’adresse : https://www.researchgate.net/publication/331688253_ Concevoir_une_architecture_Phenomenologie_de_la_perception_spatiale [Consulté le 28 Janvier 2024].
Dufresne, Maud, 2021. Le dessin d’architecture, variation d’un outil, support de la réflexion et du dialogue [support en ligne]. HAL Open Science. Disponible à l’adresse : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/ dumas-01624459/file/M1820163174_DUFRENEMaude.pdf [Consulté le 27 Janvier 2024].
Scheib, Corentin, 2021. La Photographie. Outil de conception d’espace architectural pour l’interrogation [support en ligne]. HAL Open Science. Disponible à l’adresse : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/ dumas-01622318v1/file/M1820142927_SCHIEBCorentin.pdf [Consulté le 2 Février 2024].
Conférence, colloque, congrès
Bauhaus Movement, 2017. Falling Water 3D by Frank Lloyd Wright, n.d. [support en ligne]. Édition YouTube. Disponible à l’adresse : https://www.youtube.com/watch?v=2AIPbJRP71E [Consulté le 9 Juillet 2024].
BIG - Bjarke Ingels Group, 2009. «MTN Mountain.» YouTube [en ligne]. Publiée le 13 mai 2009. Disponible à l’adresse : https://www.youtube.com/watch?v=CrbvTasfPno [Consulté le 10 août 2024].
Grand Lyon TV, 2019. YCONE. Une nouvelle tour signée Jean Nouvel à la Confluence, Lyon, 2019 [support en ligne]. Édition YouTube. Lyon : Grand Lyon TV, 2019. Disponible à l’adresse : https://www.youtube.com/ watch?v=pZ3sbQgJEDU&t=2s [Consulté le 1 Juillet 2024].
IAAC, 2024. IAAC Lecture Series-6 Markbury, Barcelona, 20 Février 2024 [support en ligne]. Édition YouTube. Barcelone : IAAC, 2024. Disponible à l’adresse : https://www.youtube.com/watch?v=bL_ Cg3AeNwE [Consulté le 3 Juillet 2024].
Manufacturing Intellect, 2017. Frank Gehry Interview on Frank Lloyd Wright and More, 2001, n.d. [support en ligne]. Édition YouTube. Disponible à l’adresse : https://www.youtube.com/ watch?v=HvU2z2mgvJE [Consulté le 1 août 2024].
Manufacturing Intellect, 2019. A Conversation with Frank Lloyd Wright (1953). YouTube [en ligne]. Disponible à l’adresse : https://www.youtube.com/watch?v=W8EABJrMplY [Consulté le 12 août 2024].
Next Pittsburgh, 2023. What’s in the Basement of Falling Water, Pittsburgh, 2023 [support en ligne]. Édition YouTube. Pittsburgh : Next Pittsburgh, 2023. Disponible à l’adresse : https://www.youtube.com/ watch?v=ZPZWkcBKloY [Consulté le 9 juillet 2024].
Pavillon de l’Arsenal, 2020. INTELLIGENCE ARTIFICIELLE & ARCHITECTURE EXPOSITION PRÉSENTÉE DU 27 FÉVRIER 2020 AU 17 MARS 2020. Pavillon de l’Arsenal [en ligne]. Disponible à l’adresse : https://www.pavillon-arsenal.com/fr/expositions/11466-intelligence-artificielle-architecture. html [Consulté le 21 Juin 2024].
Picon, Antoine, 2012. Pour une histoire culturelle de la construction, Lausanne, 12 Novembre 2012 [support en ligne]. Édition Archizoom EPFL. Lausanne : Archizoom EPFL, 2012. Disponible à l’adresse : https:// www.youtube.com/watch?v=YnoY5v9zVTQ [Consulté le 20 Juillet 2024].
Western Pennsylvania Conservancy, 2021. A Spatial Unveiling / Kendalline, PhD, AIA, Pittsburgh, 2021 [support en ligne]. Édition YouTube. Pittsburgh : Western Pennsylvania Conservancy, 2021. Disponible à l’adresse : https://www.youtube.com/watch?v=dMrW40z5NP4 [Consulté le 8 Juillet août 2024].
Washington Noé, 2013. The Falling Water House, n.d. [support en ligne]. Édition YouTube. Disponible à l’adresse : https://www.youtube.com/watch?v=qvQZbC1OOZc [Consulté le 1 Juillet 2024].
fig 1: Atelier de projet 2022_2023, Irène Lund et Jean-marc Simond. Archiexpo.ulb.be
fig 2: Digital Fabrication Studio, Atelier devenu la Q-A Architecture et paramétrique design, 2021. Archiexpo. ulb.be
fig 3 : Les trois principes fondamentaux de l’architecture, De Architectura Vitruve, 2023, Disponible à l’adresse : https://www.researchgate.net/publication/370093494_The_Analysis_of_the_MaintainedDisowned_ Relationship_among_Firmitas_Utilitas_and_Venustas_to_Preserve_the_Cultural_Heritage_An_H-BIM_ Approach_for_the_Management_of_Historic_Buildings
fig 4 : La Villa Rotonda, dans ses proportion «parfaites» illustre bien l’idée de la «beauté» Andréa Palladio, 1566, Archweb.com, Disponible à l’adresse : https://www.archweb.com/cad-dwg/villa-capra-la-rotonda/
fig 5 : L’atmosphère au centre du projet architectural, projet à petit budget qui ne se fait pas l’excuse de la qualité spatiale, PROJET : Marina Tabassum Architects, Biat ur Rouf Mosque, Dhaka, Bangladesh, 2012. Disponible à l’adresse : https://www.archdaily.com/796498/2016-aga-khan-award-for-architecturewinners-announced/57f02001e58ece3d820003c3-2016-aga-khan-award- for-architecture-winnersannounced-photo
fig 6 : Elisabetta Canepa, Reseshgate, 2022, Disponible à l’adresse : https://www.researchgate.net/profile/ Elisabetta-Canepa
fig 7 : Elisabetta Canepa, Architecture is atmosphere, 2022, Disponible à l’adresse : https:// mimesisinternational.com/architecture-is-atmosphere-notes-on-em pathy-emotions-body-brain-andspace/
fig 8 : Faire une ambiance, creating an atmosphere : actes du colloque international Grenoble 10-12 septembre 2008, 2010, Disponible à l’adresse : https://lcv.hypotheses.org/files/2011/11/Faire-uneambiance3.pdf
fig 10 : Therme de vals, Peter Zumthor, Archdaily, 2000, Disponible à l’adresse : https://www.archdaily. com/13358/the-therme-vals
fig 11 : Faces 67, Atmosphère, Grégoire Chelkoff, 2010, Disponible à l’adresse : https://www.infolio.ch/ livre/faces-67-atmosphere-printemps-2010/
fig 12 : Generators of Architectural Atmosphere, Interface 3, 2022, Reserchgate, Disponible à l’adresse : https://www.researchgate.net/publication/367012458_Generators_of_Architectural_Atmosphere
fig 13 : Outils de l’architecte, Dessins d’architecture médiévaux, 2019, Strasbourg, Musée de l’Œuvre Notre-Dame Disponible à l’adresse : https://histoiresduniversites.wordpress.com/2019/11/21/dessinsdarchitecture-medievaux/
fig 14 : Outils de l’architecte, Dessins d’architecture médiévaux, 2019, Strasbourg, Musée de l’Œuvre Notre-Dame Disponible à l’adresse : https://histoiresduniversites.wordpress.com/2019/11/21/dessinsdarchitecture-medievaux/
fig 15 : Perspective, La Cité idéale - Urbino, Wikipédia 1480, Disponible à l’adresse : https://fr.wikipedia. org/wiki/La_Cité_idéale_(Urbino)
fig. 16: Axonométrie, Bauhaus. Photographie personnelle tirée du livre : Droste, Magdalena. 2019. Bauhaus. Édition révisée. Cologne : Taschen. ISBN : 978-3836560141
fig. 17: Guggenheim, F.L. Wright. Photographie personnelle tirée du livre : Pfeiffer, Bruce Brooks, and Peter Gössel. 2002. Frank Lloyd Wright. Taschen. ISBN: 978-3822811607.
fig 18 : Chicago Auditorium Building, exterior from Michigan Avenue, 1989, Wikipédia, Disponible à l’adresse : https://en.wikipedia.org/wiki/Auditorium_Building
fig 19 : Superstudio, Vita (Supersuperficie), 1971 - 1972, Archives, Centre Pompidou, Disponible à l’adresse : https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/cgzj4XA
fig 20 : «Taliesin West», Home and studio, F.L Wright, 1935, Taschen, Photographie personnelle tirée du livre : Pfeiffer, Bruce Brooks, and Peter Gössel. 2002. Frank Lloyd Wright. Taschen. ISBN: 978-3822811607.
fig 21 : Inside Foster + Partners Headquarters, Office Snapshots, 2013, Disponible à l’adresse : https:// officesnapshots.com/2013/01/04/foster-partners-headquarters-office-design/
fig 22 : Interface Photoshop 3.0, la version ayant introduit les calques et les palettes, 1994, Wikipédia, Disponible à l’adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
fig 23 : Interface Guimp 2.8, la version ayant introduit les groupes de calques et les palettes, 2012, GIMP, Disponible à l’adresse : https://wastingtimepodcast.wordpress.com/2012/08/30/gimp-2-8-2-native-macapp/
fig 24 : ArchiCAD 5.1, Première version permettant le partage de fichier via Teamwork permet à plusieurs architectes de travailler sur un même projet, 1997, macintosh repository 2015, Disponible à l’adresse : https://www.macintoshrepository.org/1006-archicad-5-0
fig 25 : Revit 13, Depuis Revit 2013, les différentes disciplines (Structure et MEP (MEP : Mechanical, Electricity and Plumbing) soit pour la dernière discipline : ventilation, électricité, sanitaire, chauffage, climatisation) sont réunies en un seul produit, simplement appelé Revit, 2013, Salam Albaradie, Grabcad Comunity, 2014, Disponible à l’adresse : https://grabcad.com/library/mep-using-revit-2014-1
fig 26 : Interface Grasshopper, Grasshopper est principalement utilisé pour créer des algorithmes génératifs. Ici en version 1, première version après avoir été développé sous le nom d’Explicit History, 2007, Wikipédia, Disponible à l’adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Grasshopper_3D
fig 27 : Twinmotion, création 2005, En octobre 2015 récompensé lors du Concours de l’innovation des «Mondial du Bâtiment Awards» Twinmotion, Disponible à l’adresse : https://www.twinmotion.com/en-US/ solutions/architecture
fig 28 : Enscape, création 2017, Enscape, Disponible à l’adresse : https://blog.enscape3d.com/fr/raisonsenscape-visualisation-architecturale
fig 29 : Blender, création 1994, Blender a sorti une version stable de Blender 2.5x en avril 2011 : Blender 2.57. En octobre 2011 sort la version 2.60, qui marque l’aboutissement et la fin de développement de la série 2.5x, Blender 3D Architect, Avril 2024, Disponible à l’adresse : https://www.blender3darchitect.com/ bim/blenderbim-0-0-240402-released/
fig 30 : Oculus rift, sorti en 2013, conception 3d à partir de revit, Virtuo Visio, Disponible à l’adresse : http:// www.virtuovisio.com/index.htm
fig 30 : Jacques Lucan, à Paris, en septembre 2022. Disponible à l’adresse : https://www.babelio.com/ auteur/Jacques-Lucan/236581
fig 31 : Précisions sur un état présent de l’architecture, 2015, Jacques Lucan distingué par le Prix du livre d’architecture EPFL, 2015, Disponible à l’adresse : https://www.epflpress.org/produit/743/9782889151141/ precisions-sur-un-etat-present-de-l-architecture
fig 32 : Schéma de fonctionnement d’un Large Language Model, ml6, 2024, Disponible à l’adresse : https:// www.ml6.eu/resources/large-language-models
fig 33 : Schéma de fonctionnement d’un Large Language Model, Data Science Dojo, 2024, Disponible à l’adresse : https://datasciencedojo.com/blog/open-source-llms-for-enterprises-benefits/
fig 34 : Dall-E, OpenAI,2024, Disponible à l’adresse : https://openai.com/index/dall-e-2/
fig 35 : Midjourney, Midjourney, 2024, Disponible à l’adresse : https://www.midjourney.com/home
fig 36 : Chat GPT, OpenAI, 2024, Disponible à l’adresse : https://help.openai.com/en/
fig 37 : Schémas, Crafting Effective AI Prompts: A Guide to Elevate Your Conversations, Vikash Singh, 24 Novembre 2023, Medium, Disponible à l’adresse : https://medium.com/@vikashsinghy2k/craftingeffective-ai-prompts-a-guide-to-elevate-your-conversations-6bbcd26b9b3c
fig 38 : Schémas, Use this guide to master ChatGPT in 6 simple steps : Robin Delta, 5 Janvier 2024, Medium, Disponible à l’adresse : https://medium.com/@msgforrobin/use-this-guide-to-master-chatgpt-in6-simple-steps-f7e3869a8b0f
fig 39 : Finch 3D, Finch, 2024, Disponible à l’adresse : https://www.finch3d.com
fig 40 : Hypar, hypar io, 2024, Disponible à l’adresse : https://hypar.io
fig 41 : Autodesk, Autodesk, 2024, Disponible à l’adresse : https://www.autodesk.com/
fig 42 : Test fit IA, 2024, Disponible à l’adresse : https://www.testfit.io
fig 43 : Delve, 2024, Disponible à l’adresse : https://www.bluelabellabs.com/work/delve/
fig 44 : Spacio, 2024, Disponible à l’adresse : https://spacio.ai
fig 45 : ARCHITECThTURURE, 2024, Disponible à l’adresse : https://architechtures.com/en
fig 46 : VERAS, 2024, Disponible à l’adresse : https://www.evolvelab.io/veras
fig 47 : Cove.Tool, 2024, Disponible à l’adresse : https://www.covetool.com
fig 48 : Augmenta, 2024, Disponible à l’adresse : https://www.augmenta.ai
fig 49 : Archistar, 2024, Disponible à l’adresse : https://www.archistar.ai
fig 50 : DeepBlocks, 2024, Disponible à l’adresse : https://www.deepblocks.com
fig 51 : Autodesk Forma, Autodesk, 2024, Disponible à l’adresse : https://www.autodesk.com/products/ forma/overview?term=1-YEAR&tab=subscription&plc=SPCMKR
fig 52 : Graphisoft, 2024, Disponible à l’adresse : https://graphisoft.com
fig 53 : Sketchup, 2024, Disponible à l’adresse : https://blog-fr.sketchup.com/sketchup-blog/sketchup-iagénérative-concrétisez-votre-vision-plus-rapidement-avec-diffusion
fig 54 : «A custom algorithm was developed to determine the optimal arrangement to create this unique shape for the museum.» PM ideas, Musée du futur, 2021, Dubai, Disponible à l’adresse : https://pmideas. es/2023/05/museun-of-the-future.html
fig 55 : Falling water, F.L W, 2002, Taschen, Photographie personnelle tirée du livre : Pfeiffer, Bruce Brooks, et Peter Gössel. 2002. Frank Lloyd Wright. Cologne: Taschen. ISBN: 978-3822811607.
fig 56 : F.L W, 2002, Taschen, Photographie personnelle tirée du livre : Pfeiffer, Bruce Brooks, et Peter Gössel. 2002. Frank Lloyd Wright. Taschen. ISBN: 978-3822811607.
fig 57a : Chandler Arizona, F.L W, 2002, Taschen, Photographie personnelle tirée du livre : Pfeiffer, Bruce Brooks, et Peter Gössel. 2002. Frank Lloyd Wright. Cologne: Taschen. ISBN: 978-3822811607.
fig 57b : Chandler Arizona, F.L W, 2002, Taschen, Photographie personnelle tirée du livre : Pfeiffer, Bruce Brooks, and Peter Gössel. 2002. Frank Lloyd Wright. Cologne: Taschen. ISBN: 978-3822811607.
fig 58 : Chandler Arizona, F.L W, 2002, Taschen, Photographie personnelle tirée du livre : Pfeiffer, Bruce Brooks, et Peter Gössel. 2002. Frank Lloyd Wright. Cologne: Taschen. ISBN: 978-3822811607.
fig 58 et 60 : F.l Wright, F.L W, 2002, Taschen, Photographie personnelle tirée du livre : Pfeiffer, Bruce Brooks, et Peter Gössel. 2002. Frank Lloyd Wright. Cologne: Taschen. ISBN: 978-3822811607.
fig 61 : F.l Wright, F.L W, 2002, Taschen, Photographie personnelle tirée du livre : Pfeiffer, Bruce Brooks, et Peter Gössel. 2002. Frank Lloyd Wright. Cologne: Taschen. ISBN: 978-3822811607.
fig 62 : F.l Wright, F.L W, 2002, Taschen, Photographie personnelle tirée du livre : Pfeiffer, Bruce Brooks, et Peter Gössel. 2002. Frank Lloyd Wright. Cologne: Taschen. ISBN: 978-3822811607.
fig 64 : F.l Wright, F.L W, 2002, Taschen, Photographie personnelle tirée du livre : Pfeiffer, Bruce Brooks, et Peter Gössel. 2002. Frank Lloyd Wright. Cologne: Taschen. ISBN: 978-3822811607.
fig 65 : F.l Wright, introduction, F.L W, 2002, Taschen, Photographie personnelle tirée du livre : Pfeiffer, Bruce Brooks, et Peter Gössel. 2002. Frank Lloyd Wright. Cologne: Taschen. ISBN: 978-3822811607.
fig 66 : F.l Wright, introduction, F.L W, 2002, Taschen, Photographie personnelle tirée du livre : Pfeiffer, Bruce Brooks, et Peter Gössel. 2002. Frank Lloyd Wright. Cologne: Taschen. ISBN: 978-3822811607.
fig 67 : Falling water, F.L W, Taschen Photographie personnelle tirée du livre : Pfeiffer, Bruce Brooks, et Peter Gössel. 2002. Frank Lloyd Wright. Cologne: Taschen. ISBN: 978-3822811607.
fig 68 : Falling water, F.L W, Taschen, Photographie personnelle tirée du livre : Pfeiffer, Bruce Brooks, et Peter Gössel. 2002. Frank Lloyd Wright. Cologne: Taschen. ISBN: 978-3822811607.
fig 69 : Falling water, F.L W, Taschen, Photographie personnelle tirée du livre : Pfeiffer, Bruce Brooks, et Peter Gössel. 2002. Frank Lloyd Wright. Cologne: Taschen. ISBN: 978-3822811607.
fig 70 : Falling water, F.L W, Taschen, Photographie personnelle tirée du livre : Pfeiffer, Bruce Brooks, and Peter Gössel. 2002. Frank Lloyd Wright. Cologne: Taschen. ISBN: 978-3822811607.
fig 71 : Falling water, F.L W, Taschen, Photographie personnelle tirée du livre : Pfeiffer, Bruce Brooks, et Peter Gössel. 2002. Frank Lloyd Wright. Cologne: Taschen. ISBN: 978-3822811607.
fig 72 : Falling water, F.L W, Taschen, Photographie personnelle tirée du livre : Pfeiffer, Bruce Brooks, et Peter Gössel. 2002. Frank Lloyd Wright. Cologne: Taschen. ISBN: 978-3822811607.
fig 73 : Falling water, F.L W, Taschen, Photographie personnelle tirée du livre : Pfeiffer, Bruce Brooks, and Peter Gössel. 2002. Frank Lloyd Wright. Cologne: Taschen. ISBN: 978-3822811607.
fig 74 : Falling water, F.L W, Taschen, Photographie personnelle tirée du livre : Pfeiffer, Bruce Brooks, and Peter Gössel. 2002. Frank Lloyd Wright. Cologne: Taschen. ISBN: 978-3822811607.
fig 75 : Falling water, F.L W, Taschen, Photographie personnelle tirée du livre : Pfeiffer, Bruce Brooks, et Peter Gössel. 2002. Frank Lloyd Wright. Cologne: Taschen. ISBN: 978-3822811607.
fig 76 : Falling water, F.L W, Taschen, Photographie personnelle tirée du livre : Pfeiffer, Bruce Brooks, et Peter Gössel. 2002. Frank Lloyd Wright. Cologne: Taschen. ISBN: 978-3822811607.
fig 77 : Falling water, F.L W, Taschen, Photographie personnelle tirée du livre : Pfeiffer, Bruce Brooks, et Peter Gössel. 2002. Frank Lloyd Wright. Cologne: Taschen. ISBN: 978-3822811607.
fig 78 : Falling water, F.L W, Taschen, Photographie personnelle tirée du livre : Pfeiffer, Bruce Brooks, et Peter Gössel. 2002. Frank Lloyd Wright. Cologne: Taschen. ISBN: 978-3822811607.
fig 79 : Falling water, F.L W, Taschen, Photographie personnelle tirée du livre : Pfeiffer, Bruce Brooks, and Peter Gössel. 2002. Frank Lloyd Wright. Cologne: Taschen. ISBN: 978-3822811607.
fig 80 : Falling water, F.L W, Taschen, Photographie personnelle tirée du livre : Pfeiffer, Bruce Brooks, et Peter Gössel. 2002. Frank Lloyd Wright. Cologne: Taschen. ISBN: 978-3822811607.
fig 81 : Falling water, F.L W, Taschen, Photographie personnelle tirée du livre : Pfeiffer, Bruce Brooks, et Peter Gössel. 2002. Frank Lloyd Wright. Cologne: Taschen. ISBN: 978-3822811607.
fig 82 : Taliesin Studio, F.L W, Taschen, Photographie personnelle tirée du livre : Pfeiffer, Bruce Brooks, et Peter Gössel. 2002. Frank Lloyd Wright. Cologne: Taschen. ISBN: 978-3822811607.
fig 83 et 84 : The mountain de BIG (2008) et Ycone de Jean Nouvelle (2019) Archdaily, Disponible à l’adresse : BIG : https://www.archdaily.com/15022/mountain-dwellings-big JN : https://www.archdaily. com/922042/ycone-la-confluence-residential-tower-ateliers-jean-nouvel?ad_source=search&ad_ medium=projects_tab
fig 85 - 104 : DOMUS, Taschen, Photographie personnelle tirée du livre : Domus. 2010. Domus 19281979. Taschen. (ISBN : voir plus haut)
fig 105 - 108 : L’architecture du XXe siècle, 2006, Photographie personnelle tirée du livre : Taschen Gössel, Peter, and Gabriele Leuthäuser. 2006. L’architecture du XXe siècle. Taschen. ISBN: 978-3822811621.
fig 109 : Chapitre « Le retour du matériau », 2006, Photographie personnelle tirée du livre : Taschen Gössel, Peter, et Gabriele Leuthäuser. 2006. L’architecture du XXe siècle. Taschen. ISBN: 978-3822811621.
fig 110 - 111 : Chapitre « Quand l’espace s’incurve », 2006, Photographie personnelle tirée du livre : Taschen Gössel, Peter, et Gabriele Leuthäuser. 2006. L’architecture du XXe siècle. Taschen. ISBN: 9783822811621.
fig 112 - 113 : Chapitre « Quand l’espace s’incurve », 2006, Photographie personnelle tirée du livre : Taschen Gössel, Peter, et Gabriele Leuthäuser. 2006. L’architecture du XXe siècle. Taschen. ISBN: 9783822811621.
fig 114 : Bjark Ingels, Wikipedia, Disponible à l’adresse : https://en.wikipedia.org/wiki/Bjarke_Ingels
fig 115 - 117 : Design process, BIG, Disponible à l’adresse : https://big.dk
fig 118 : The Moutain, Diagrams, BIG, Disponible à l’adresse : https://big.dk
fig 119 - 120 : The Moutain, 3D, Divisare, Disponible à l’adresse : https://divisare.com/projects/64782-jdsjulien-de-smedt-architects-big-bjarke-ingels-group-home-mountain-dwellings
fig 121 - 122 : The Moutain, Plan, BIG, Disponible à l’adresse : https://big.dk
fig 123: The Moutain, Coupe, BIG, Disponible à l’adresse : https://big.dk
fig 124 - 128: The Moutain, Détails, BIG, Disponible à l’adresse : https://big.dk
fig 129: The Moutain, Plan type, BIG, Disponible à l’adresse : https://big.dk
fig 130 - 131: The Moutain, Photo, BIG, Disponible à l’adresse : https://big.dk
fig 132 - 133: The Moutain, Photo, BIG, Disponible à l’adresse : https://big.dk
fig 134 - 136: The Moutain, Photo, BIG, Disponible à l’adresse : https://big.dk
fig 137: The Moutain, 3D, BIG, Disponible à l’adresse : https://big.dk
fig 138 - 142 : MNT Mountain, Youtube, Disponible à l’adresse : https://www.youtube.com/ watch?v=CrbvTasfPno
fig 143 - 145 : Visite à pied, Ep 17, Archi Lablife, Youtube, Disponible à l’adresse : https://www.youtube. com/watch?v=sJ484QdivhU
fig 146 : Jean Nouvel, Archdaily, Disponible à l’adresse : https://www.archdaily.com/922042/ycone-laconfluence-residential-tower-ateliers-jean-nouvel
fig 147 - 149 : Jean Nouvel, L’architecture du 20°S, Taschen Photographie personnelle tirée du livre : Taschen Gössel, Peter, and Gabriele Leuthäuser. 2006. L’architecture du XXe siècle. Taschen. ISBN: 9783822811621
fig 150 - 151 : Ycone, AJN, Disponible à l’adresse : http://www.jeannouvel.com/en/projects/ycone/
fig 152 - 154 : Ycone, AJN, Disponible à l’adresse : http://www.jeannouvel.com/en/projects/ycone/
fig 155 : 3d, Ycone, AJN, Disponible à l’adresse : http://www.jeannouvel.com/en/projects/ycone/
fig 156 - 160 : Photo de chantier, Groupe Cardinal, YouTube, Disponible à l’adresse : https://www.youtube. com/watch?v=4R6v7V843q8
fig 161 - 163 : Plans, Ycone, AJN, Disponible à l’adresse : http://www.jeannouvel.com/en/projects/ycone/
fig 164 : Procésus BIM, PMIRAC2019 “Relevance & Applicability of Agile Driven Bim at Conceptual & Design Phases of a Project-A Case Study”, Reserch Gate, Mars 2019, Disponible à l’adresse : https:// www.researchgate.net/publication/333672442_PMIRAC2019_Relevance_Applicability_of_Agile_Driven_ Bim_at_Conceptual_Design_Phases_of_a_Project-A_Case_Study
fig 165 : Thèse de Stanislas Chaillou, Académia, 2019, Disponible à l’adresse : https://www.academia.
edu/39599650/AI_Architecture_Towards_a_New_Approach
fig 166 : Thèse de Stanislas Chaillou, Académia, 2019, Disponible à l’adresse : https://www.academia. edu/39599650/AI_Architecture_Towards_a_New_Approach
fig 167 : Article de 3Xn, Artificial Intelligence in Architecture / 3XN, Archdaily, 2021, Disponible à l’adresse : https://www.archdaily.com/936999/pioneers-6-practices-bringing-ai-into-architecture/5e8afac db357653921000193-pioneers-6-practices-bringing-ai-into-architecture-image
fig 168 : Thèse de Stanislas Chaillou, Académia, 2019, Disponible à l’adresse : https://www.academia. edu/39599650/AI_Architecture_Towards_a_New_Approach
fig 169 : Thèse de Stanislas Chaillou, Académia, 2019, Disponible à l’adresse : https://www.academia. edu/39599650/AI_Architecture_Towards_a_New_Approach
fig 170 : Thèse de Stanislas Chaillou, Académia, 2019, Disponible à l’adresse : https://www.academia. edu/39599650/AI_Architecture_Towards_a_New_Approach
fig 171 : Thèse de Stanislas Chaillou, Académia, 2019, Disponible à l’adresse : https://www.academia. edu/39599650/AI_Architecture_Towards_a_New_Approach
fig 172 - 174 : Thèse de Stanislas Chaillou, Académia, 2019, Disponible à l’adresse : https://www.academia. edu/39599650/AI_Architecture_Towards_a_New_Approach
fig 175 - 179 : Thèse de Stanislas Chaillou, Académia, 2019, Disponible à l’adresse : https://www.academia. edu/39599650/AI_Architecture_Towards_a_New_Approach
fig 180 - 181 : Thèse de Stanislas Chaillou, Académia, 2019, Disponible à l’adresse : https://www.academia. edu/39599650/AI_Architecture_Towards_a_New_Approach
fig 182 - 183 : Thèse de Stanislas Chaillou, Académia, 2019, Disponible à l’adresse : https://www.academia. edu/39599650/AI_Architecture_Towards_a_New_Approach
fig 184 - 187 : Thèse de Stanislas Chaillou, Académia, 2019, Disponible à l’adresse : https://www.academia. edu/39599650/AI_Architecture_Towards_a_New_Approach
fig 188 - 190 : Mjøstårnet The Tower of Lake Mjøsa / Voll Arkitekter, 2019, Archdaily, Disponible à l’adresse : https://www.archdaily.com/934374/mjostarnet-the-tower-of-lake-mjosa-voll-arkitekter?ad_ source=search&ad_medium=projects_tab
fig 191 : Elbo Group & Studio Lynn, Technicolor Bloom, Photographie personnelle tirée du livre : Rattenbury, Kester, et Robert Bevan. 2009. Architecture et design contemporain - Conception et fabrication numériques. ISBN: 978-8496969865.
fig 192 - 194 : Autodesk Forma, Autodesk, 2024, Disponible à l’adresse : https://www.autodesk.com/ products/forma/overview?term=1-YEAR&tab=subscription&plc=SPCMKR
fig 195 -196 : Autodesk Forma, Autodesk, 2024, Disponible à l’adresse : https://www.autodesk.com/ products/forma/overview?term=1-YEAR&tab=subscription&plc=SPCMKR
fig 197 -203 : Veras, Veras, 2024, Disponible à l’adresse : https://www.evolvelab.io/veras
fig 204 -208 : Finch 3D, Finch, 2024, Disponible à l’adresse : https://www.finch3d.com
fig 209 : Matk Burry, 2024, Photo, Disponible à l’adresse : https://www.rnz.co.nz/national/programmes/ ninetonoon/audio/2018697069/future-cities-thought-leader-nz-architect-mark-burry Conférence disponible : https://www.youtube.com/watch?v=bL_Cg3AeNwE
fig 210 : Antoine Picon, Photo, 2024, Disponible à l’adresse : https://www.gsd.harvard.edu/person/antoinepicon/ Conférence disponible : https://www.youtube.com/watch?v=YnoY5v9zVTQ
fig 211 : Endlessskyscraper, Eduard Haiman, 2021, Disponible à l’adresse : https://www.behance.net/ gallery/132966579/Endlessskyscraper
Complexité
Matérialité
Qualité
Matérialisation
Logement
Génération