HABITER L’ENVIRONNEMENT : Réexamen des outils et techniques architecturales.



Camille DUGIT-GROS _ MÉMOIRE _Master 1 Architecture Paysage Montagne et territoire d’invention
Sous la direction de Thomas MOUILLON _ Année 2020-2021
École Nationale Supérieure D’architecture de Grenoble

Au cours de ce travail de mémoire, j’ai pu explorer un sujet vaste qui a suscité beaucoup de curiosité en moi. J’ai apprécié mêler lecture, écriture et enquête. Je remercie Thomas Mouillon qui a toujours été de bon conseil et qui m’a accordé de longs moments de discussion. Je tiens aussi à remercier sincèrement les agences de l’atelier de la Place, de Gasnier-Eco et de Caracol architecture qui ont généreusement accepté de m’accorder de leur temps. Elles m’ont permis de mener un travail d’enquête plus poussé grâce à nos longs entretiens, aux visites et les documents qu’elles ont acceptés de me communiquer. De plus, je tiens à souligner l’investissement et la gentillesse des habitants du projet de Vimines et Corrençon-en-Vercors avec qui j’ai pu échanger sur leurs vécus en tant qu’usager et maître d’ouvrage. Je n’oublie pas la gentillesse de la fille de Monsieur Dutheil qui a bien voulu m’accorder une visite de la maison de la Tronche. Ceci malgré l’absence de ses parents, avec qui je n’ai malheureusement pas pu échanger, étant partis à l’étranger.
Je remercie l’équipe enseignante et mes camarades pour les séances de soutenance blanche qui m’ont apporté des conseils et des pistes pour ne pas m’égarer et étayer mon travail.
J’ai une pensée particulière pour Mathilde, Julien et Louise qui m’ont respectivement aidé en qualité de relectrice, compagnon et coach.
Enfin, je tiens à remercier très sincèrement madame Edith Chezel pour son soutien, sa bienveillance et ses encouragements pour que je mène au bout ce mémoire.
INTRODUCTION
L’actualité liée à la conscience de l’état des ressources primaires mondiales et la dégradation des écosystèmes a permis d’affirmer le caractère primordial des enjeux environnementaux liés à l'activité humaine, et notamment en matière de construction. L’exploitation raisonnée des ressources et du territoire ainsi que l’impact environnemental de la construction font partie des enjeux actuels et futurs. C’est à partir des années 80 qu’on prend conscience de la nécessité de faire muter les modes de construction et de faire entrer l’environnement dans les préoccupations de conception architecturale. Depuis, un certain nombre de normes et techniques de construction dites « écologique » ont été abordées et mises en place (RT 2012, HQE, construction passive, positive etc).
Ceci me mène à la problématique suivante : Comment les outils du bioclimatisme permettent de questionner la conception environnementale dans l’habitat ?
Je partirai de cet état de fait pour m’intéresser particulièrement à l’architecture bioclimatique, qui sera définie dans la première partie du mémoire. Je souhaite déconstruire la définition de l’environnement et analyser la posture que propose l’architecture bioclimatique, comprendre quels en sont les outils. Je poursuivrai ensuite en remettant en cause les acquis dans le domaine de la construction et de la conception par rapport à la consommation, les usages et la durabilité. L’intérêt est de questionner le processus historique et l’évolution des procédés constructifs pour comprendre la pertinence des réponses vis-à-vis des enjeux environnementaux. Dans cette partie il sera intéressant d’établir un lien avec les cultures constructives liées aux connaissances des matériaux. Comme nous l’avons défini, le traitement des ressources dû à leur épuisement font partie de la construction environnementale au sens large.
L’objectif est de ré-interroger la conception architecturale dans sa manière d’intégrer l'environnement au projet. Dans la seconde partie, il s’agira d’illustrer tous ces questionnements par des exemples de projet d’habitat individuel, c’est-à-dire le type de logement le plus répandu en France. Cette étude a pour intérêt de mettre en parallèle une multitude de postures vis à vis de l’environnement. Il sera intéressant de les comprendre puis de les analyser avec l’appui d’entretiens avec les architectes et les usagers, autour des points identifiés en première partie (consommation, usage et pérennité). Le tout sera conclu sur un aperçu d’une synthèse des réponses et ouvertures obtenues.
Remerciements
Introduction
Sommaire
I / Architecture et environnement : bilan et remise en cause des acquis.
1) Notion du bioclimatisme, entre bon sens et environnement
a. Définir la notion d’environnement
b. Architecture bioclimatique, quels outils architecturaux manipule cette pratique?
2) Questionner la conception architecturale dite environnementale
a. Consommation (matériaux, ressources, énergies)
b. Usages (définir le confort, se chauffer et s’isoler)
c. Pérennité / Durabilité (rapport au temps, entretiens, impacts)
II / Quelles postures face à l’enjeu : habiter l’environnement ?
1) Démarche et méthodologie
2) Présentation des projets
a. Rénovation et extension : Chalet Correncon en Vercors, Atelier de la Place
b. Construction neuve passive : Maison, La Tronche, Gasnier Eco
c. Construction neuve autonome : Maison (Z+H), Vimines, Caracol Architecture
3) Analyse comparative
a. Analyse consommation
b. Analyse usages
c. Analyse pérennité
d. Synthèse
Conclusion
Bibliographie
Annexes
Bilan et remise en cause des acquis.
1. Notion du bioclimatisme entre bon sens et environnement
a) Définir la notion d’environnement
L’environnement est un terme qui englobe beaucoup de sens et il est utilisé dans beaucoup de contextes. Il est nécessaire de bien le définir, pour comprendre le cadre de ce travail.
En architecture, l’environnement tend à représenter tout ce qui entoure le projet. C’est une notion qui regroupe le vivant, et plus particulièrement la faune et la flore, défini comme « ensemble des éléments objectifs (qualité de l’air, bruit, etc.) et subjectifs (beauté d’un paysage, qualité d’un site, etc.) constituant le cadre de vie d’un individu. »1 Dans le langage commun, il s’agit de « l’ensemble des éléments (biotiques ou abiotiques) qui entourent un individu ou une espèce et dont certains contribuent directement à subvenir à ses besoins »2 Selon ces définitions, l’environnement est ce qui entoure un être vivant. La notion instaure une question de relation et d’interaction entre ces deux éléments.
Ainsi, en architecture, on peut définir l’environnement comme l’origine de la constitution vernaculaire des constructions. En effet, c’est pour se protéger de la nature et de ses contraintes que l’architecture a vu le jour. Elle agit comme une seconde peau au corps capable d’adapter les constructions à leur environnement. Ceci a impliqué de développer des savoir-faire et un apprentissage de l’environnement et des méthodes pour y vivre convenablement. Cependant l’évolution des civilisations a conduit à progressivement abandonner ces savoir-faire, un phénomène accentué vers la fin du 19e siècle après les débuts de l’industrialisation. En effet, le développement de l’industrie a mené à standardiser notre accès au confort, aux ressources, et notre manière de construire donc de vivre. C’est seulement à la fin du 20e siècle que l’environnement est reconsidéré dans l’architecture comme un facteur du projet. C’est une notion qui est progressivement prise en compte suite au premier choc pétrolier dans les années 1970, où l’homme commence à prendre conscience de l’impact du développement des activités
1 définition environnement dictionnaire en ligne Larousse consulté le 14/03/21 , source : https://www.larousse.fr
2 définition environnement dictionnaire en ligne Larousse consulté le 14/03/21, source : https://www.larousse.fr
humaines sur la planète. Le “facteur 4”, une notion créée dans les années 1990 par le club de Rome3 , incarne l’ambition de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050.
A partir de cette période, l’architecture dite environnementale voit le jour. C’est un adjectif qui qualifie une conception qui prend en compte l’impact de la construction sur la nature et le vivant.
3 Le Club de Rome est “un groupe de réflexion réunissant des scientifiques, des économistes, des fonctionnaires nationaux et internationaux, ainsi que des industriels de 52 pays, préoccupés des problèmes complexes auxquels doivent faire face toutes les sociétés, tant industrialisées qu’en développement.
Réunie pour la première fois en avril 1968, l’organisation acquiert une notoriété mondiale à l’occasion de la publication de Les Limites à la croissance en 1972.” Source : Wikipédia
b) Architecture bioclimatique, quels outils architecturaux manipule cette pratique ?
A travers ce travail, je prends l’exemple du bioclimatisme pour illustrer une posture de conception architecturale intégrant l’environnement.
Le bioclimatisme naît à la fin des années 1960 en réponse à la prise de conscience de l’urgence climatique. Il prend la forme de multiples prototypes expérimentaux constructifs. Ces habitats prônent l’usage de matériaux locaux et tirent profit du soleil. Ces constructions sûrement trop en avance sur leur temps ne coïncident pas avec les politiques publiques en termes d’ambition écologique de l’époque.Elles prennent différent noms, notamment « architecture solaire », « solaire passif » et architecture bioclimatique. On peut citer notamment le travail de Mike Reynold qui conçoit et construit de nombreuses maisons autonomes en énergie nommé Weaver Earthship. Il participe grandement à l’évolution de ce courant vers la maison bioclimatique.1
Néanmoins, comment définir le bioclimatisme ? Le préfixe ”bio-”, pour biologique, fait écho au terme “d’origine naturelle” ou respectueux de l’environnement. Quant à “climatique”, le terme implique le facteur des contraintes et caractéristiques d’un climat propre à un lieu, un site. Ainsi le terme d’architecture bioclimatique regroupe le principe de respect, d’adaptation à un environnement et ses caractéristiques.
Dans l’écrit architectural, diverses définitions ressortent de ce terme. Il se caractérise par la volonté, premièrement, de diminuer les consommations énergétiques et de profiter au maximum des caractéristiques de son site et, deuxièmement, d’en tirer parti pour le confort thermique, lumineux et spatial. Le guide de l’éco-construction définit cette notion ainsi :« Bioclimatique : architecture prenant en compte le climat dans lequel l’édifice est construit pour tirer parti des apports solaires passifs et de la luminosité naturelle permettant de réaliser des
économies d’énergie. »2
De plus, l’architecture bioclimatique prend en compte l’usage et les ressources. Ainsi, on peut citer la fiche architecture bioclimatique, réalisée par le Programme International de Soutien à la Maîtrise de l’Énergie (Prisme) : « L’architecture bioclimatique utilise le potentiel local (climats, matériaux, main d’œuvre…) pour recréer un climat intérieur respectant le confort de chacun en s’adaptant aux variations climatologiques du lieu. Elle rétablit l’architecture dans son rapport à l’homme et au climat. »3
Cette même étude souligne que le bioclimatisme constitue un enjeu : « proposer des habitations confortables et économes énergétiquement en utilisant au maximum les ressources disponibles à proximité (ressources matérielles, main d’œuvre, valeurs culturelles également). »4
Pour résumer, voici la définition que propose Samuel Courgey : « une recherche d’équilibre vertueux et cyclique entre habitant, habitat et lieu, qui réside dans une réflexion concernant les habitants, le lieu la forme, les matériaux, la mise en œuvre, les fluides et l’énergie. ». 1
Ainsi, les objectifs principaux de cette architecture sont d’obtenir un confort thermique autant de jour que de nuit, et ce durant toutes les saisons tout en limitant l’apport d’énergies supplémentaires. On peut caractériser l’architecture bioclimatique par la mise en place d’outils et de principes de conception. Dans son écrit, Samuel Courgey qualifie le bioclimatisme de recherche d’un équilibre entre l’habitat et son climat, puis entre l’habitant et son habitat dans ses usages.
Comme le dit Andrée Ravéreau, dans l’esprit de l’architecture bioclimatique : « On ne le répète jamais assez aux élèves d’architecture : armons-nous sur les conditions climatiques ; le soleil, la pluie, le froid, la chaleur, le vent… Préoccupons-nous des contraintes de l’environnement, et nous serons certains de construire avec sérieux. Cherchons donc l’essentiel sans avoir recours à des apports superflus de jeux de matières, effets, formes, et sans vouloir accomplir des prouesses techniques qui dépassent la stricte nécessité. »2
Le site /implantation
Tirer parti du site et identifier ses caractéristiques est essentiel. Pour cela il faut réaliser un travail d’analyse notamment sur les accès, les limites, l’ensoleillement, l’ombrage, etc. Tous ces éléments sont à prendre en compte pour positionner le futur projet. La fonction du bâti est aussi déterminante dans le choix de l’implantation.
qu’explique le guide de l’éco-construction dans cet extrait : « Le vent engendre des déperditions thermiques importantes sur les façades exposées. Une maison peut s’en protéger à l’aide du relief du terrain, de la végétation, des maisons avoisinantes, mais également grâce à sa forme. En effet, les formes de toitures basses détournent le vent. Les ouvertures de la maison ne doivent pas être placées sur les façades trop exposées au vent. Si cela n’est pas possible, des sas d’entrée peuvent jouer un rôle de zone tampon. (…)Il est possible de tirer parti du terrain s’il est en pente en enterrant une partie de la maison. Le sol restant à une température constante d’une dizaine de degrés toute l’année, les déperditions seront réduites en hiver et la maison bénéficiera d’un rafraîchissement en été. »3
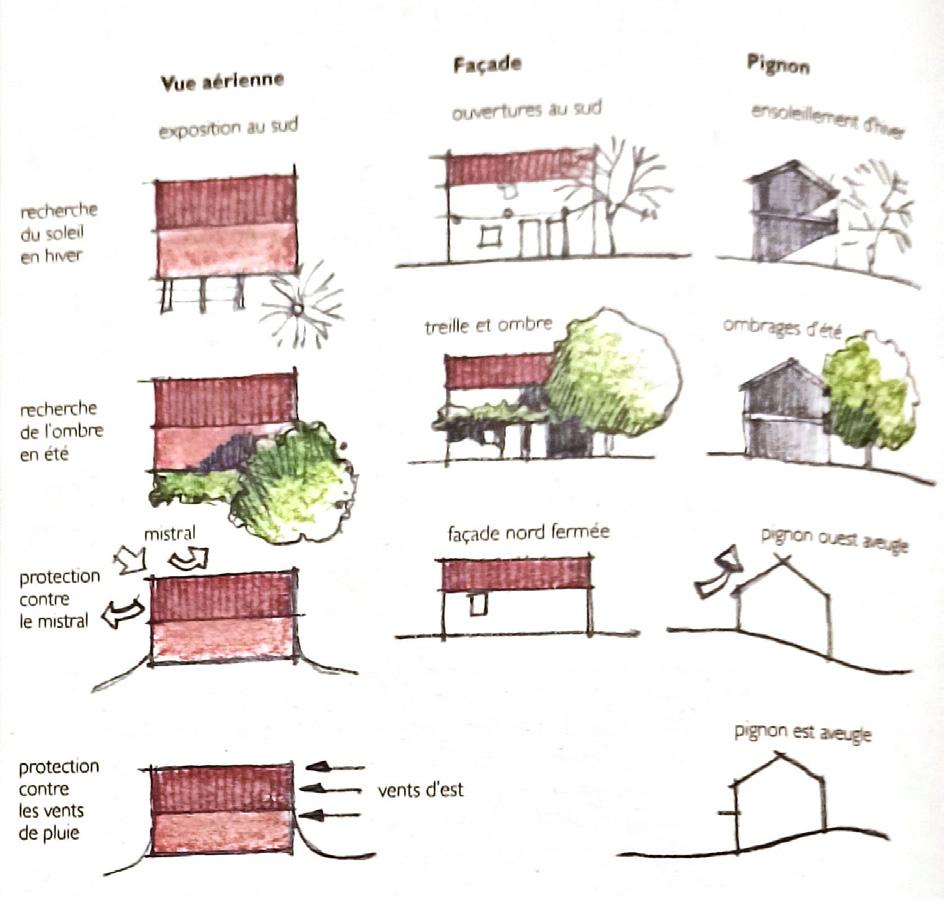
2 Source : « Guide de l’éco-construction » définition du terme bioclimatique. Document édité par l’Agence Régionale de l’Environnement en Lorraine, l’ADEME et l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, en 2006. p54
3 Source : Fiche du Prisme « architecture bioclimatique ». p1
1 Source : « La conception bioclimatique, des maisons confortables et économes », Courgey Samuel et Oliva JeanPierre. p19
4 Source : « La conception bioclimatique, des maisons confortables et économes », Courgey Samuel et Oliva JeanPierre
Un site est soumis à des contraintes tel que le vent, mais il est possible de s’en protéger ou de se servir des éléments du site pour s’en protéger. C’est ce
1 Source : « Guide de l’éco-construction » définition du terme bioclimatique. p54
2 Le M’ Zab, une leçon d’architecture, cité dans « La conception bioclimatique, des maisons confortables et économes », Courgey Samuel et Oliva Jean-Pierre, p39
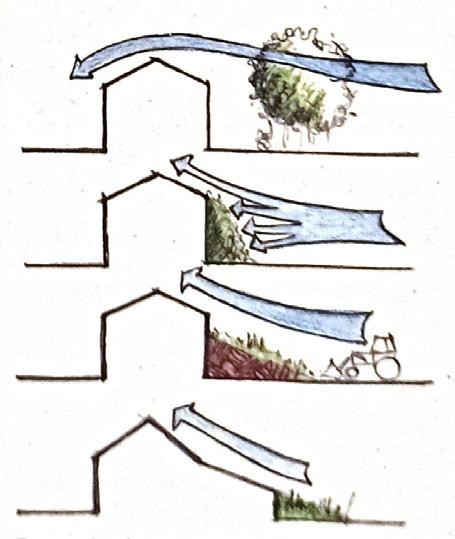
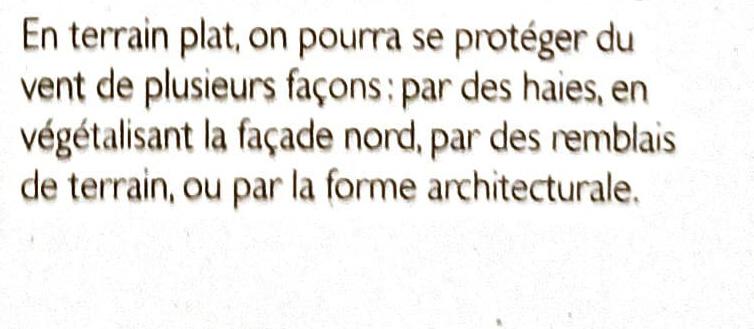
3 Source : « Guide de l’éco-construction » p4 Croquis stratégie d’implantation dans un site, Source :« La conception bioclimatique, des maisons confortables et économes », Courgey Samuel et Oliva Jean-Pierre
Climat et exposition solaire
L’architecture bioclimatique se base sur la connaissance du climat et de l’exposition solaire du site d’implantation. Elle valorise la ressource gratuite que représente le rayonnement solaire car il s’agit d’un gain en luminosité et un apport calorifique afin d’éclairer et réchauffer un espace sans énergie complémentaire.
Afin de s’adapter au mieux au site, il faut analyser les données locales et faire le point sur les avantages et contraintes du lieu pour savoir comment s’en protéger ou en tirer parti.
Le relevé des températures moyennes, minimales et maximales du climat en été et en hiver fait partie de ces outils. Le temps d’insolation en heures par an permet de comprendre quelle stratégie il faudra privilégier.
Il existe également différentes échelles de climat, notamment le mezzo-climat (relief, eau, ouverture du sol plus ou moins étendues) et le microclimat (proche environnement, végétation, construction soleil, vents…), qui tendent à différencier des facteurs plus ou moins proches du site d’implantation.
Enfin, le territoire français a fait l’objet d’un zonage thermique climatique (tempéré, continental et méditerranéen). Ces climats sont déterminés selon les caractéristiques de rayonnement solaire, l’amplitude des températures, le régime des vents (leur secteur et leur vitesse), l’humidité, l’altitude, les sols et l’environnement proche.
Végétation et masques solaires
La végétation sur un site permet de maîtriser l’ombrage. Elle peut constituer une barrière qui protège le bâti du soleil, elle forme de l’ombrage sur les façades, elle permet aussi de rafraîchir un espace. En hiver, les arbres caducs perdent leurs feuilles et l’on peut profiter pleinement de l’apport solaire.
De plus, la végétation participe au rafraîchissement par un phénomène nommé l’évapotranspiration. Il s’agit de l’évaporation de l’eau stockée dans les plantes et les sols vers l’air. Ainsi de l’eau sous forme
de vapeur vient rafraîchir l’air et abaisser la température ressentie. Il faut néanmoins une végétation conséquente et des sols poreux pour favoriser ce phénomène.
La végétation peut jouer le rôle de masque solaire, qui se définit par l’ensemble des éléments qui constituent un obstacle au rayonnement solaire et modifient la surface de la façade exposée (végétation, habitations environnantes, etc.). De pair avec cette idée, la notion de réflexivité des parois et leurs capacités d’absorption sont à prendre en compte pour déterminer si la paroi exposée aura tendance à stocker ou refléter le rayonnement solaire.
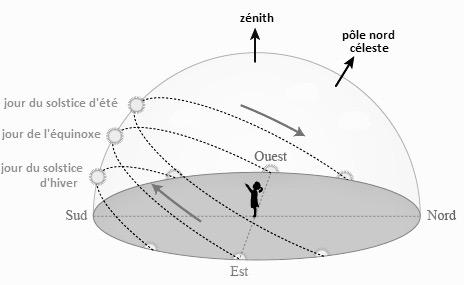
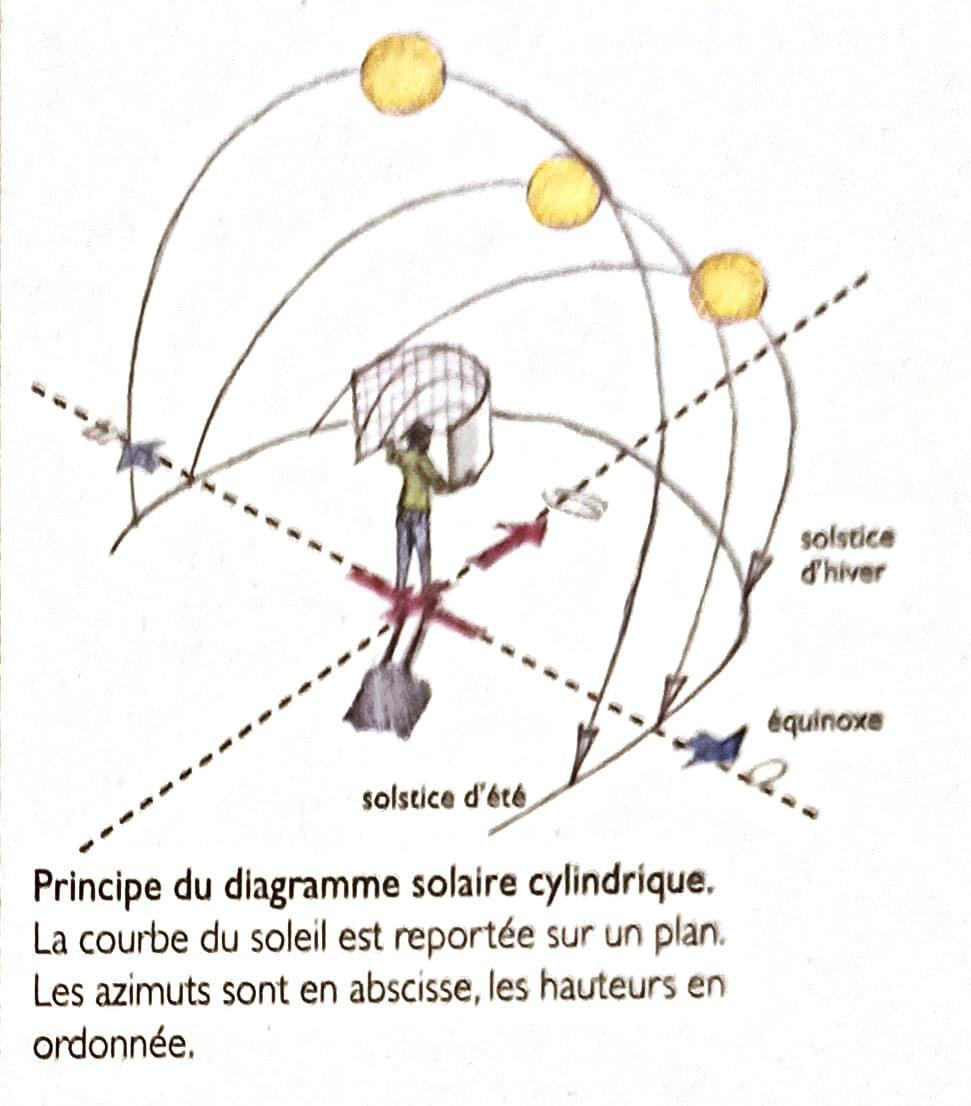
Conception
Dans la conception bioclimatique, il faut chercher, par le dessin, à optimiser les orientations afin de maîtriser les apports de chaleurs et de maximiser les gains durant l’hiver. Le soleil se lève à l’Est, se couche à l’Ouest, et suit une inclinaison variable selon le moment de l’année et de la saison.
En saison froide il faut favoriser les apports de chaleur gratuit liés au soleil. En saison chaude il faut diminuer les apports caloriques et rafraîchir les espaces. L’objectif est d’orienter les espaces selon l’exposition. La façade Sud est la plus exposée, cependant elle reçoit le soleil du midi, à sa position la plus haute, ce qui implique que l’on peut facilement s’en protéger. La façade Ouest quant à elle est exposée en après-midi lorsque le soleil est bas et qu’il rentre plus profondément dans les pièces. Ainsi, ce sont les deux expositions les plus problématique en termes de confort d’été, c’est-à-dire sujettes à des problèmes de surchauffe. Pour assurer un éclairage naturel, il faut privilégier les ouvertures au sud et organiser une forme plutôt allongée dans l’axe Est-Ouest. Afin d’obtenir des pièces lumineuses et de minimiser l’apport de chauffage complémentaire au rayonnement solaire, il faut déterminer la profondeur des pièces selon la dimension des ouvertures (2,5xh=p).
L’habitant entretient une relation entre son rythme de vie, son habitat et son environnement. L’habitant change d’activités et d’espaces à travers la journée. Ainsi, les usages peuvent aussi être rythmés selon le climat et la saison. Durant l’été, en journée, on est à l’intérieur et le soir en extérieur, pour s’abriter de la chaleur puis retrouver la fraîcheur nocturne. Tandis qu’en hiver, le jour, on reste à l’extérieur pour profiter du soleil et le soir on rentre se reposer au chaud à l’intérieur.
En été, il arrive qu’en période de canicule la température n’ait pas le temps de retomber durant la nuit. Il est nécessaire de mettre en place du free-cooling. Cela consiste à ouvrir les fenêtres pendant la nuit pour surveiller et faire redescendre la température intérieure. En hiver, la stratégie est inverse car il faut
optimiser et récupérer toute l’énergie solaire en journée. On met en place une ventilation courte et forte. Pour pallier les déperditions énergétiques et maximiser le rendement, on peut utiliser des protections sur les ouvertures (volets).
Les espaces tampons sont des locaux non chauffés qui protègent et isolent les autres locaux. Placés au nord, ils permettent de mettre en retrait les espaces de vie par rapport aux façades déperditives. Ceci permet de réduire de 20 à 30% les pertes. Au sud, des espaces de transition entre l’intérieur et l’extérieur, comme une serre, peuvent constituer une protection solaire contre la surchauffe, et créer un espace de vie tempéré.
La performance énergétique se calcule en kilowattheure par mètre carré par an. Des réglementations thermiques classifient les types de construction et leur efficacité. Cela va du bâtiment basse énergie dispositif accessible, pour aller jusqu’au bâtiment passif c’est-à-dire autonome en énergie. La réhabilitation permet de diviser de 3 à 8 fois les besoins en chauffage et rafraîchissement. En France un bâtiment existant consomme entre 150 et 450 kwh/ m2.an tandis qu’un bâtiment basse énergie est 3 fois plus performant puisqu’il consomme entre 45 et 75 kwh/m2 par an.
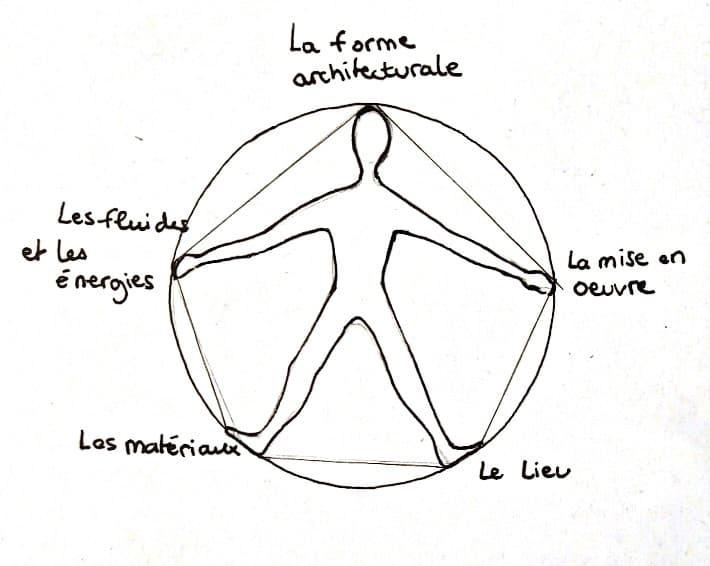
Schéma homme habitat environement. Source : production personnelle, inspirée d’illustration « La conception bioclimatique, des maisons confortables et économes », Courgey Samuel et Oliva Jean-Pierre
Compacité
La compacité est un principe qui implique une efficacité dans la volumétrie avec peu de parois extérieures pour minimiser les déperditions thermiques. La compacité est un coefficient de forme. Elle s’inscrit dans une démarche économique et écologique car elle se veut économe en matériaux et donc en coût. Elle implique l’optimisation du point de chauffage qui devient unique et central grâce à la forme efficace et compacte du bâti.
« Des formes compactes limitent les déperditions énergétiques et optimisent la répartition de la chaleur. Les éléments de prises au vent comme les balcons ou les décrochements sont à éviter : ils constituent d’importants ponts thermiques et engendrent des déperditions thermiques importantes. » 1
Dispositifs
L’architecture bioclimatique, bien que low-tech de manière générale, c’est-à-dire employant une technologie simple et accessible, a développé des dispositifs pouvant être mis en place dans une optique d’économie et de durabilité énergétique et environnementale.
On relève notamment la véranda, qui constitue un volume captant la lumière et le rayonnement solaire et constituant un apport de chaleur et de lumière intéressant tout en constituant un volume tampon entre l’extérieur et l’intérieur.
Les murs capteurs et accumulateurs font appel au principe de réflexivité et d’absorption. En effet, certains matériaux, en général de couleur sombre, ont pour caractéristique de capter la lumière et donc accumuler du rayonnement et de la masse thermique. D’autres matériaux ont une tendance à refléter la lumière et donc évitent la surchauffe. Le puits canadien est un dispositif visant à ventiler naturellement un bâtiment par la géothermie, soit en réchauffant, soit en rafraîchissant l’air ventilé. Ce dispositif utilise l’inertie du sol qui passe par un conduit enterré.
1 Source: Guide de l’éco-construction p4
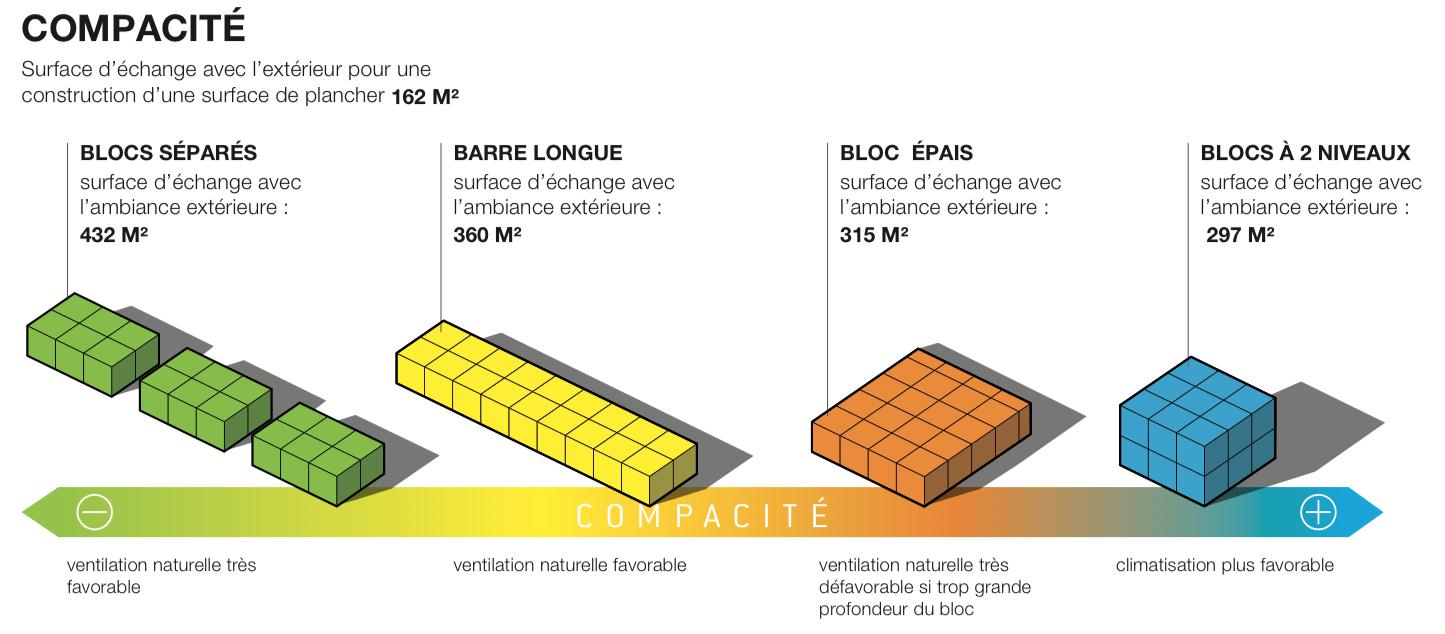
Shéma principe du diagramme solaire. Source : « La conception bioclimatique, des maisons confortables et économes », Courgey Samuel et Oliva Jean-Pierre
2. Questionner la conception architecturale dite environnementale
a) Consommation (matériaux, ressources, énergies)
Secteur du batiment et environement politique française.
« Le secteur du bâtiment représente 44 % de l’énergie consommée en France, loin devant le secteur des transports (31,3%). Chaque année, le secteur du bâtiment émet plus de 123 millions de tonnes de C02, ce qui en fait l’un des domaines clés dans la lutte contre le réchauffement climatique et la transition énergétique. Pour rendre le bâtiment plus économe en énergie, il faut rénover massivement l’existant et développer des normes plus strictes en termes de consommation d’énergie pour les bâtiments neufs.
C’est l’objet de la politique de l’énergie dans les bâtiments. »1 Ce texte, extrait d’un site gouvernemental pour le secteur du bâtiment et l’environnement, met en évidence la stratégie politique adoptée pour la mise en accord du secteur du bâtiment avec les contraintes environnementales, fondée sur deux axes : soit réglementer, soit sensibiliser et inciter.
Point historique : depuis consomme-t-on des énergies fossiles ?
C’est à la suite de la révolution industrielle que l’homme a progressivement oublié la contrainte thermique. Le faible coût de l’énergie, l’essor et le développement des machines thermiques ainsi que le développement des procédés constructifs industriels ont participé à l’automatisation de nos méthodes de construction. Ceci a aussi contribué à l’exploitation de ressources carbonées en faveur du confort énergétique dans la construction.
Cela a mené à l’oubli des techniques constructives vernaculaires pré-existantes. Elles visaient à tirer parti du climat. La mutation des modes de vie a aussi entraîné une plus forte consommation d’énergie (pièces multiples chauffées). Comme nous l’avons rappelé plus haut, le choc pétrolier de 1973 « sonne le glas de cette joyeuse inconscience »2. A partir de
1 Source: site du gouvernement sur les politiques environnementales et le secteur du bâtiment. lien: https://www. ecologie.gouv.fr/energie-dans-batiments
2 Source: « La conception bioclimatique, des maisons
là, deux politiques nationales se mettent en place : réduire les déperditions en isolant les constructions, et améliorer les rendements énergétiques. Néanmoins, la notion de toxicité et durabilité n’est pas prise en compte dans les solutions apportées. Parallèlement, le chauffage électrique se développe en France. Des réglementations thermiques voient le jour et visent à poser des objectifs d’efficacité thermique dans une optique d’économie.
En 1992, le sommet de Rio fait naître le concept de développement durable, à cette époque l’homme fait le constat du réchauffement climatique et comprend l’urgence de « concilier développement économique et préservation de la planète ».
L’Agence de développement et de maîtrise de l’énergie (ADEME)3 a pour mission « la promotion d’une consommation énergétique plus responsable ». Malheureusement, comme le soulève l’ouvrage « La conception bioclimatique des maisons confortables et écologiques », cette politique encourage la maîtrise des techniques de chauffage et de ventilation mais pas la « remise en cause les principes de conception et de construction hérités d’une histoire où les soucis environnementaux étaient inconnus ».
Pour autant, les réglementations thermiques ont effectivement porté leurs fruits puisqu’au début des années 2000, les habitations en Europe consomment 60% moins d’énergie que 30 ans plus tôt. Cependant, la consommation totale d’énergie dans le bâtiment a doublé en raison de l’augmentation du nombre d’habitats et des surfaces par habitant (25 fois supérieure), de la hausse du niveau des températures moyennes et de l’usage de la climatisation.
confortables et économes », Courgey Samuel et Oliva JeanPierre
3 L’ADEME est un Établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) placé sous la tutelle des ministères de la Transition écologique et solidaire, et de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
Point historique sur les réglementations thermiques
Afin de mieux comprendre les réglementations mises en place au cours de cette dernière décennie, il paraît indispensable de se pencher sur l’historique des réglementations qui ont rythmé le domaine de la construction vis-à-vis de l’environnement.
Le 10 mai 1974,1 la première Réglementation thermique (RT) , instaurée par décret, réglemente l’isolation thermique et le réglage des installations de chauffage des bâtiments neufs de logement. En 1976, un nouvel arrêté vient compléter le précédent en l’étendant aux autres domaines du bâtiment (secteur tertiaire notamment). Toutefois, ces réglementations n’imposent pas de contrainte de réduction de consommation d’énergie.
En 1997, la France s’engage, à travers la signature du protocole de Kyoto, à atteindre des objectifs de réductions des émissions de gaz à effet de serre (GES). Ce protocole a pour bénéfice de renforcer les politiques nationales de réductions des émissions (efficacité énergétique, agriculture durable, développement de sources d’énergies renouvelables, etc.). Il encourage les Etats signataires à coopérer avec les autres parties contractantes (échanges d’expériences ou d’informations, coordination des politiques nationales à travers des permis d’émission, mise en œuvre conjointe et développement propre).
La RT 2000 met en place un coefficient de compacité qui fait la somme des consommations de chauffage, de ventilation, de l’eau chaude sanitaire et de l’éclairage. Elle établie Le coefficient Ubât qui est un facteur de transmission surfacique qui fait la moyenne entre la température de l’enveloppe (séparant l’intérieur du bâtiment de l’extérieur), un local non chauffé et le sol. L’Ubât intègre les ponts thermiques et tient compte des pertes vers les locaux non chauffés. En revanche il ne prend pas en
1 Instaurée par décret à partir de 1974, la Réglementation thermique encadre la consommation énergétique des bâtiments neufs pour le chauffage, la ventilation, la climatisation, la production d’eau chaude sanitaire et l’éclairage.
compte les pertes thermiques dues à la ventilation et aux infiltrations.
En 2005, une nouvelle RT vise la réduction de 20% des consommations énergétiques par rapport à la RT 2000. Deux nouvelles notions apparaissent : la température intérieure conventionnelle (TIC) et le bâtiment basse consommation (BBC) qui correspond à un maximum de 50 kwh/m2 shonRT/an. 2
La RT 2012 ambitionne la réduction de 60% des consommations par rapport à la RT 2005 soit une consommation d’énergie primaire inférieure à 50 kWh/ m2/an en moyenne. Elle met en place une exigence d’efficacité énergétique minimale du bâti. La réglementation module l’exigence de consommation en fonction des émissions de GES des bâtiments et de de critères techniques (localisation géographique avec 8 zones thermique en France, caractéristiques et usage des bâtiments). Pour cela elle met en place un nouvel indicateur, le CEPmax, qui correspond à la consommation d’énergie primaire (chauffage, électricité, ventilation, Eau chaude sanitaire et auxiliaires soustraits aux productions d’énergie renouvelable).
Le Besoin Bioclimatique conventionnel (Bbio) est une évaluation de la conception bioclimatique du bâtiment exigée par la réglementation de 2012. Elle va au-delà de l’idée d’une enveloppe isolante efficace et détermine le besoin de chauffage en fonction du besoin de refroidissement et du besoin d’éclairage artificiel.
La réglementation E+C- 3au sens de la future RT-Réglementation environnementale (RE) 2020 prend en compte les consommations énergétiques d’un bâtiment. Elle tend vers plus de sobriété et d’efficacité que la RT 2012 et insère le principe de chaleur renouvelable. Elle se concentre sur un aspect peu traité jusqu’alors dans les réglementations, les usages mobiliers, en traitant la question des consommations électriques dans l’idée toujours de sobriété et d’efficacité. Pour cela, elle favorise la pro-
2 Surface hors d’oeuvre nette soumis à la réglementation thermique dans un an.
3 Réglementation E+C- vise dans le bâtiment une production d’énergie positive et un émission carbone négative.
duction locale d’électricité. Les apports d’énergie produit dans le bâtiment est comptabilisé et ajouter aux réseaux publique. Ainsi il sont alimentés par de l’énergie renouvelable .1
1 Source : cours optionnels Parin vidéos SCTB et Building Energie Modeling, Master 1 2020 ENSAG.
Shéma évolution des objectifs de consommations et des réglementations thermique. Source : Liébard (Alain), Ménard (JeanPierre), « Le grand livre de l’habitat solaire, 110 réalisations en France, Le développement durable à la portée de tous », Patrick Piro, éd. Observ’ER ; France, 2007.
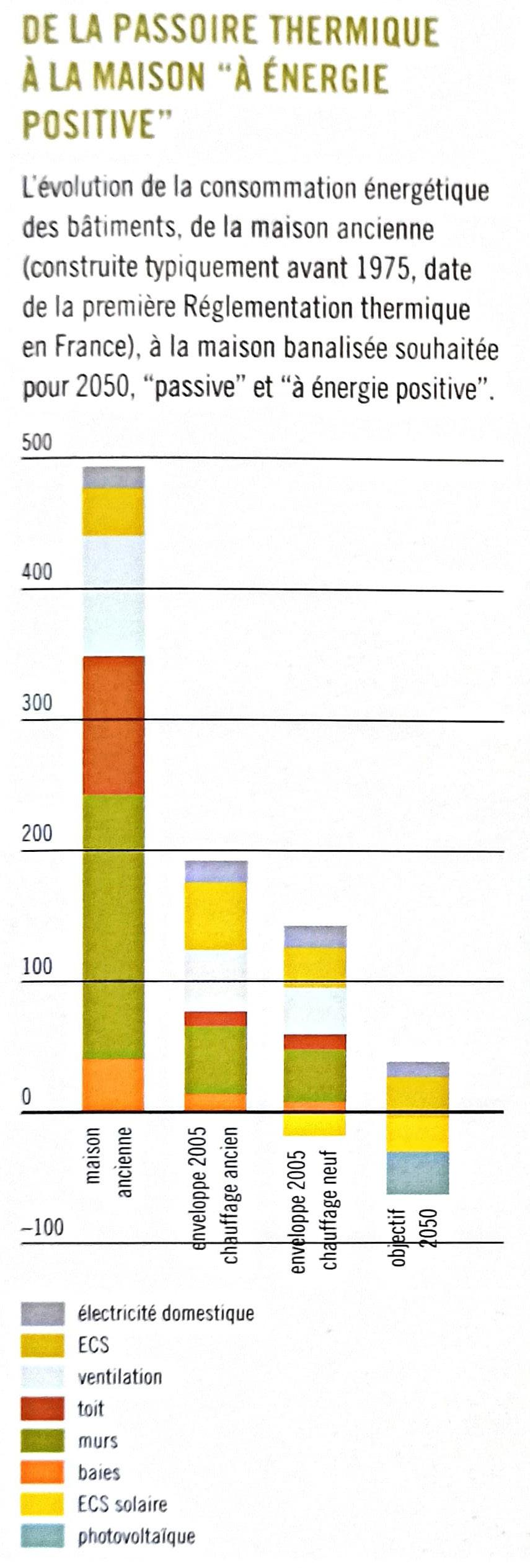
Quels rapports avons-nous avec les matériaux ? Histoire, origine, culture constructive
Les matériaux de construction dits traditionnels sont principalement d’origine naturelle : le bois, la pierre, la terre. Certains des matériaux traditionnels sont artificiels et constitués à partir de matériaux naturels, comme la brique (terre crue ou cuite). Ces matériaux font appel à des techniques et des processus de fabrication qui ont évolué au cours du temps et ont suivi les avancées et découvertes scientifiques. On peut citer par exemple le gypse et la chaux obtenue par chauffage.
Des grands tournants de l’histoire ont marqué l’évolution des matériaux employés dans le domaine de la construction. A partir de la Révolution industrielle, les matériaux manufacturés comme le verre et la fonte vont progressivement être utilisés en construction. C’est l'arrivée des énergies fossiles qui permet l’industrialisation et l’automatisation des procédés constructifs et les matériaux. Dans une logique capitaliste, les matériaux doivent être moins chers, plus rapides à produire. Les matériaux utilisés pour leurs caractéristiques statiques comme la pierre deviennent des gravats utilisés pour le béton.
Des nouveaux matériaux voient le jour au cours du 20e siècle, notamment avec les découvertes en chimie et en science des matériaux. La synthèse de nouveaux matériaux chimiques fait naître une gamme de matériaux légers, résistants et faciles d’entretien qui s’introduit progressivement dans le domaine du bâtiment. Cette arrivée correspond avec la prise de conscience environnementale et le choix de diriger le bâtiment vers des enveloppes plus efficaces thermiquement. C’est ainsi que les matériaux isolants synthétiques voient le jour pour répondre à des problématiques d’économie d’énergie liées à des choix constructifs parfois inadaptés. C’est à partir de la fin 20e siècle que la question de l’impact des matériaux sur l'environnement se pose. En effet, ces matériaux sont principalement d’origine synthétique et souvent nocifs pour l’environnement. De plus, il faut s’interroger sur le recyclage de ces nouveaux déchets qui ne sont pas biodégradables.
Néanmoins, depuis l’an 2000 environ, la question de la réintroduction de matériaux naturels se pose dans une optique écologique. Ces matériaux sont qualifiés de biosourcés. En effet, on considère désormais que « l’impact des matériaux sur la santé est important. Des produits naturels, présentant un intérêt écologique, permettent d’évoluer dans un environnement intérieur sain et confortable. Prêter attention au cycle de vie du matériau depuis l’extraction des matières premières jusqu'à sa fin de vie, limite l’impact de la construction sur l’environnement. » 1On peut ainsi considérer le bois, la terre crue, la paille, le chanvre, la ouate de cellulose, le textile recyclé, la laine de mouton, etc. comme des matériaux plus écologiques.
Rapport à la géographie, techniques construction et ressources locales
Les matériaux et les ressources sont des éléments spécifiques à un lieu et son climat. La question de l’origine géographique des ressources et de leur déplacement pour en faire des matériaux de construction est un point déterminant. Historiquement, l’architecture a souvent été contrainte par l’accès aux ressources ; ceci a déterminé des cultures constructives spécifiques à des lieux. La construction en bois, en terre ou en pierre fait écho à une matière première peu transformée et à des procédés constructifs identitaires de régions ou lieux.
La fracture de l’évolution des matériaux marque un changement dans les procédés de mises en oeuvre et aussi l’approvisionnement des matériaux. L’accès aux ressources étant moins limité, et la fabrication industrielle se développant, le détournement des matériaux a progressivement opéré. Ainsi les techniques constructives ont été remplacés au profit de procédés constructifs plus économes et industrialisés. Peu à peu ces savoirs ont été oubliés et mis de côté.
b. Usages ( définir le confort, se chauffer et s’isoler…)
Définir le confort
Le confort est un état de bien-être ressenti par un individu dans un milieu. Il existe différents types de confort. En architecture, on peut relever principalement le confort thermique (chaud, froid) voire climatique, le confort visuel, acoustique. On peut aussi souligner le fait que le confort est déterminé par les habitudes et les usages. Il fait souvent écho à des modes de vie et des milieux sociaux. Le confort est également une question culturelle.
Il est important de rappeler que l’architecture et l’habitat sont des outils de protection qui cherchent à contrebalancer l’inconfort que provoque l’environnement climatique d’un individu dans un lieu. On peut comparer l’habitat à une seconde peau et une interface avec l’environnement.
Voici comment Samuel Courgey définit le confort thermique dans son ouvrage Architecture bioclimatique : « Ne pas avoir trop froid, ni trop chaud, ne pas sentir de courants d’air désagréables ».1 Il insiste sur le fait qu’il s’agit d’une notion inconsciente, qui de ce fait se définit plus facilement par sa situation contraire, soit l’inconfort.
Le bien-être est plus large que le confort thermique, il fait intervenir l’idée de plaisir. Il est lié aux différents sens et la perception de l’ambiance thermique et climatiques (vent, rayonnement, humidité).
La thermique a longtemps été gérée de manière naturelle grâce à la ventilation et l’inertie du bâtiment sans faire appel à des procédés industriels. La fonction et l’activité des pièces avaient une influence sur le choix de stratégie pour obtenir le confort. Lorsque le corps est actif, il produit plus de chaleur, de ce fait il peut se trouver dans une pièce plus fraîche tandis que lorsque l’activité est plus calme il est nécessaire que la température ressentie soit plus élevée. En effet, il existe un lien entre mode de vie et utilisation du bâti pour optimiser son confort thermique.
1 « La conception bioclimatique, des maisons confortable et économes » p 27
Le corps humain est à 37°, il échange de la chaleur avec son environnement. La première interface entre le corps et l’environnement est l’habillement, il est très déterminant dans le ressenti thermique tout comme l’activité. Il existe plusieurs mécanismes de transfert thermique, notamment la conduction, la convection, le rayonnement ou encore l’évaporation.
La conduction a lieu par contact entre deux surfaces, tandis que la convection intervient entre l’air et les fluides. L’échange thermique est lié à un écart de température entre les éléments. Plus l’écart est grand, plus le ressenti est important. La vitesse de l’air accentue le phénomène. Le rayonnement consiste en la radiation infrarouge entre le corps et les parois. Par exemple, il est très significatif entre une zone ensoleillée et une ombragée. Pour finir, l’évaporation établit un transfert thermique lorsqu’un liquide passe à l’état gazeux. L’eau absorbe alors les calories et rafraîchit l’air ou une surface. On peut citer la transpiration qui, en s’évaporant, rafraîchit la surface de la peau.
L’habitat permet de mettre en place un microclimat et des conditions de confort. La température ressentie est à la base de la définition du confort thermique. Elle diffère de la température de l’air et est influencée par la température de paroi. Elle se calcule par la moyenne entre la température des parois et la température de l’air.
Schéma facteurs et type de confort en architecture, Source : production personnelle
La température des parois est donc primordiale. Les matériaux n’ont pas tous la même effusivité (vitesses d’échauffement), ce qui influe sur le rayonnement et le ressenti. Par exemple le carrelage a une forte effusivité, ainsi il va mettre du temps à s’échauffer et donc rester froid plus longtemps ; il est à privilégier dans des climats chauds ou des pièces ou l’on veut éviter la surchauffe. A contrario le bois a une faible effusivité, il va donc plus vite monter en température ou refroidir. Une notion complémentaire à celle-ci est la diffusivité. Elle correspond à la capacité à transmettre une énergie calorifique. Une paroi diffuse est une paroi qui transmet rapidement le froid ou le chaud. L’émissivité caractérise la quantité d’énergie émise par une surface à une température donnée, et se situe en moyenne entre 0,6 et 0,8.
Aujourd’hui, on observe que, conventionnellement, on répond au confort par l’addition de dispositifs résolvant une seule problématique. La climatisation en est un exemple : au lieu de concevoir des bâtiments moins sujets à la surchauffe, il est habituel de mettre en place un dispositif de ventilation mécanique. De plus, ce système est traditionnellement énergivore et produit aussi de la chaleur à l’usage. Ainsi, il paraît intéressant de formuler une réponse unique à plusieurs problématiques, mêlant la fonction et les besoins en parallèle du climat d’été et d’hiver. Ainsi il est souhaitable de privilégier un apport de chauffage d’appoint en hiver, pour parvenir à un espace sans surchauffe ni climatisation en été, tandis qu’en demi-saison on vise l’autonomie thermique.
Se protéger du froid
L’enveloppe est un organe de transfert thermique c’est l’interface entre le climat extérieur et l’intérieur. Une stratégie pour se protéger du froid est de se chauffer. Dans nos climats tempérés de France cela paraît souvent indispensable. Avant d’étudier cet aspect, on peut se demander quels moyens de chauffage existent afin d’interroger leurs technologies, l’usage et le confort qu’ils génèrent.
Il existe des dispositifs qui permettent de se passer de chauffage, c’est d’ailleurs l’objectif de la mai-
son passive. C’est une maison construite selon des principes bioclimatiques qui permettent d’optimiser les apports solaires et l’enveloppe, le tout complété par des principes de ventilation, notamment la ventilation double flux qui permet d’homogénéiser les températures entre les pièces. C’est un principe de maison très étanche à l’air et compacte. Vivre sans chauffage implique d’adapter ses usages en profitant de la chaleur produite par les activités de la maison (cuisine et salle de bain).
Comme expliqué auparavant, il existe des moyens dans l’implantation du bâti pour limiter son exposition aux déperditions, notamment le fait d’enterrer une partie du bâti, de se servir de la topographie, ou de limiter les circulations des vents dominants. Il faut aussi privilégier le gain de chaleur gratuit par l’apport solaire, à travers le dimensionnement et l’orientation des ouvertures. Une seconde stratégie est de choisir des matériaux qui ont une bonne inertie et qui seront capables de restituer la chaleur plus tard.
Dans l’architecture contemporaine, la stratégie visée face au froid résulte des matériaux de construction couramment employés, qui nécessitent, en complément de la structure, une isolation qui va rendre plus efficace l’enveloppe.
Il parait évident que les dispositifs de chauffage influe sur la production de chaleur et ressenti. Cependant il important de rappeller que ceci est lier aux usages.
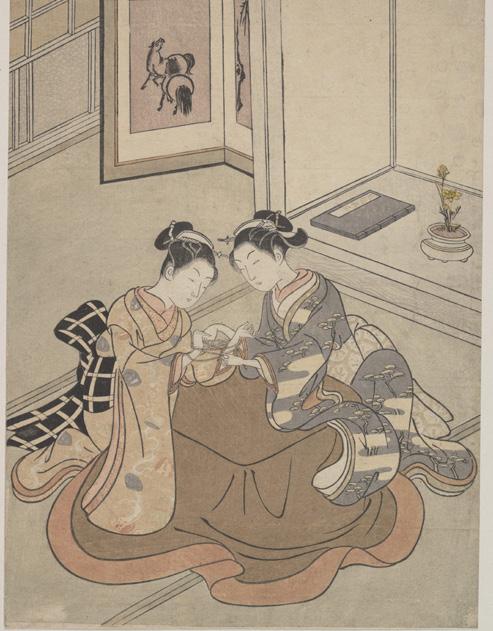
« Deux jeunes femmes assises sur un kotatsu jouant au berceau du chat », Suzuki Harunobu, vers 1765. Source : Wikipédia Le kotatsu est une table basse recouverte d’une couverture qui merpmet de garder la chaleur d’un foyer placer sous la table. Ainsi il réchauffe les corps.
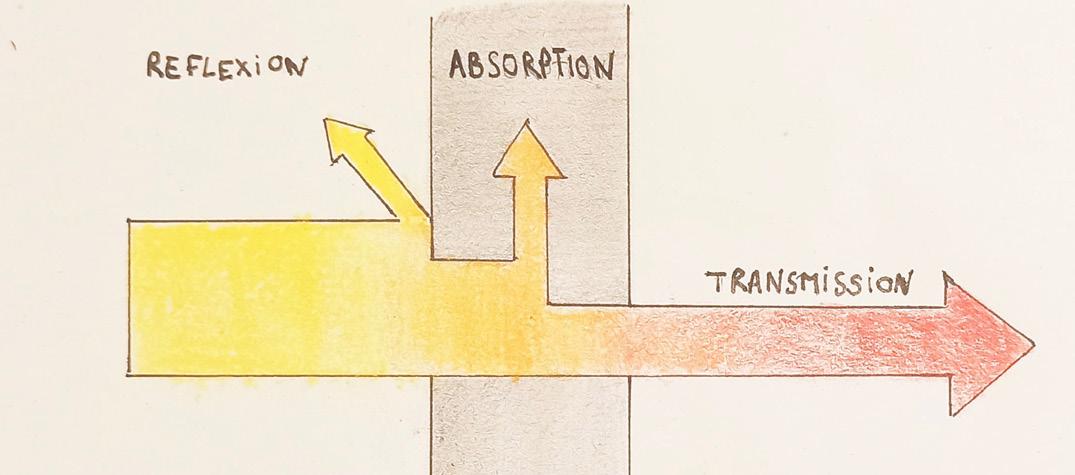
Transfert thermique du rayonnement solaire. Source : production personnelle.
Se protéger de la chaleur : dispositifs de protection solaire, free cooling, ventilation, inertie, puits canadien
Le confort d’été est une problématique importante dans le bâtiment de nos jours, en effet nous avons plus de problèmes de surchauffe que d’isolation. En effet, la paroi doit protéger du soleil et dissiper la chaleur pour diminuer les apports internes. Elle doit aussi permettre un rafraîchissement simple. Le but est qu’elle soit capable de s’adapter en demi-saison en limitant les moyens mécaniques.
Les matériaux conventionnels d’aujourd’hui ont peu d’inertie, c’est-à-dire qu’ils ont un temps de restitution assez court. Les matériaux avec une inertie élevée ont la capacité de stocker puis restituer la chaleur et la fraîcheur avec un temps long, ce qui permet de préserver l’équilibre thermique du bâtiment. La terre en est un bon exemple de matériau avec un bon niveau d’inertie. On peut aussi citer le béton, mais sa masse importante peut le rendre sujet à la surchauffe en milieu urbain.
La question de confort thermique s’accompagne de celle de la qualité de l’air et du renouvellement d’air. Dans un bâtiment étanche, il paraît indispensable de mettre en place un système permettant de renouveler le besoin en air « neuf » pour en préserver la qualité (oxygène, pollution, hygrométrie). Des dispositifs de ventilation permettent de réguler la température de l’air, notamment la ventilation double flux qui permet de compenser l’échange thermique entre air neuf et air sortant.
Cependant, en termes d’usage quelle est la place de la ventilation manuelle ? Pour maintenir une fraîcheur en saison chaude, des dispositifs de protection solaire peuvent compléter le choix des matériaux (occultant, casquette, pergola, dimensionnement des ouvertures…). La façade sud et la façade ouest sont les plus exposées car elles reçoivent le soleil de l’après midi, qui rentre profondément dans les pièces.
Il est important de noter que le confort d’été est lié à l’usage. Ainsi, il est logique d’adapter ses activités et leur production d’énergie ou de chaleur au moment de la journée. Le soir, du free cooling c’est-à-dire une surventilation peut venir compenser les problèmes de surchauffe d’un bâtiment et le rafraîchir pleinement.
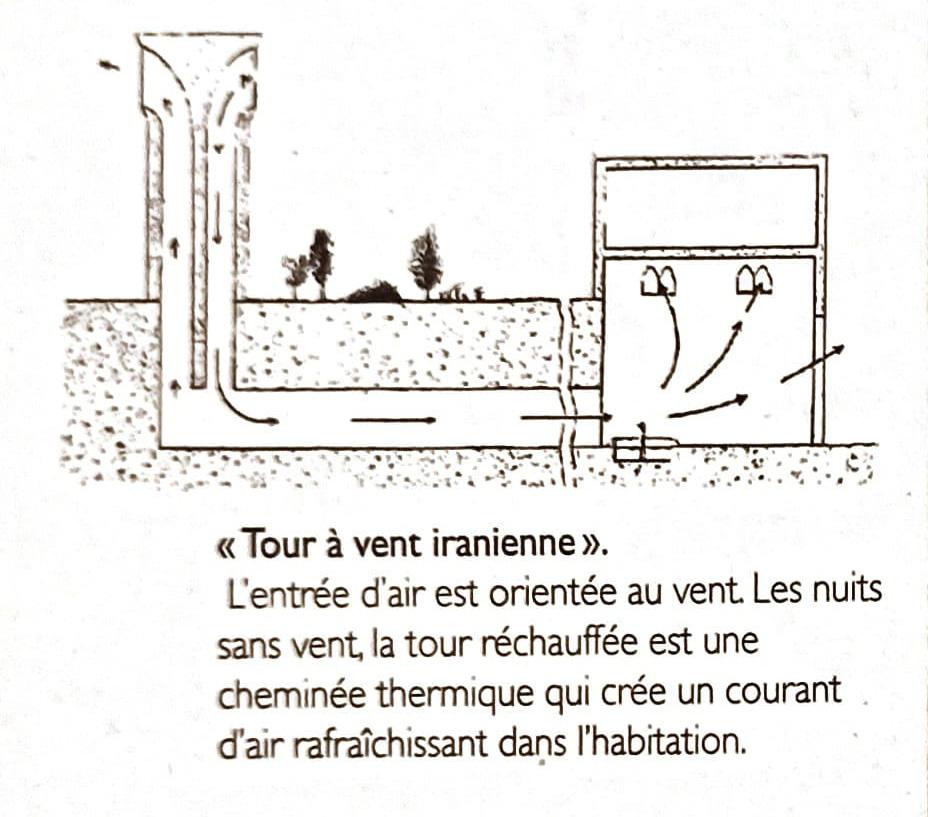
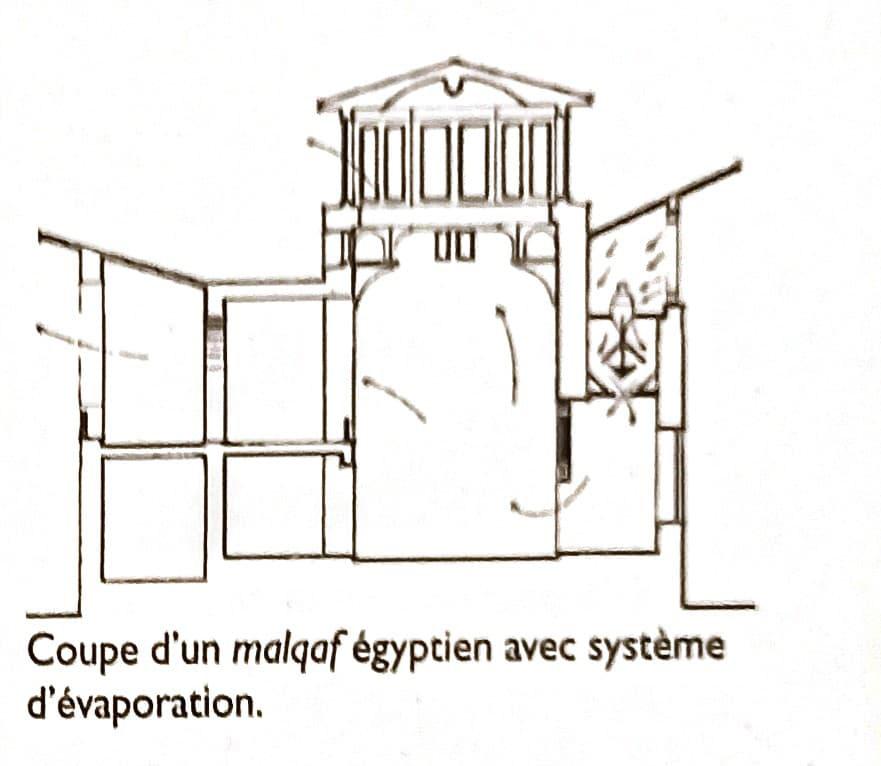
Sources : « La conception bioclimatique, des maisons confortables et économes », Courgey Samuel et Oliva Jean-Pierre.
c. Pérennité/ Durabilité (rapport au temps, entretiens, impacts)
De nos jours, notre rapport aux matériaux implique une idée de surconsommation. Il apparaît qu’à travers l’histoire de l’architecture, le principe de déchet de matériaux de construction s’est mis en place et que les bâtiments ont une date de « péremption » de plus en plus courte. En effet, les matériaux modernes du 20e siècle ont tendance à offrir une durabilité réduite. Elle est renforcée par leur impact environnemental et leur faible potentiel de recyclage et de réemploi.
L’analyse de cycle de vie est un principe qui permet d’estimer l’impact carbone d’un matériau, voire d’un bâtiment, à l’échelle de la totalité de sa vie.
“L’analyse du cycle de vie (ACV) recense et quantifie, tout au long de la vie des produits, les flux physiques de matière et d’énergie associés aux activités humaines. Elle en évalue les impacts potentiels puis interprète les résultats obtenus en fonction de ses objectifs initiaux. Sa robustesse est fondée sur une double approche. (...)“1 Il s’agit de l’approche cycle de vie, “Qu’il s’agisse d’un bien, d’un service, voire d’un procédé, toutes les étapes du cycle de vie d’un produit sont prises en compte pour l’inventaire des flux, du « berceau à la tombe » : extraction des matières premières énergétiques et non énergétiques nécessaires à la fabrication du produit, distribution, utilisation, collecte et élimination vers les filières de fin de vie ainsi que toutes les phases de transport.”1
La seconde approche est nommé multicritère : “ Une ACV se fonde sur plusieurs critères d’analyse des flux entrants et sortants. On appelle « flux » tout ce qui entre dans la fabrication du produit et tout ce qui sort en matière de pollution (...). La collecte des informations relatives aux flux est une étape importante de l’ACV. Ils sont quantifiés à chaque étape du cycle et correspondent à des indicateurs d’impacts potentiels sur l’environnement. La complexité des phénomènes en jeu et de leurs interactions est une source d’incertitude sur la valeur réelle des impacts, c’est pourquoi on les qualifie de « potentiels ».”1
Ainsi, l’analyse de cycle de vie est un outil intéressant
pour comprendre l’impact d’un matériau ou procédé sur le l’environnement. Néanmoins, il nécessite une approche scientifique quantifié et sourcé d’où la nécessiter de bien définir les critères d’analyse.
En partant de cet élément, on peut se questionner sur les choix constructifs dans les procédés de mise en œuvre et le choix des matériaux que génère un projet. On peut s’interroger sur la durabilité des matériaux conventionnels, mais aussi des matériaux avec une démarche plus propre. Tel que les matériaux biosourcés, certes d’origine naturels, mais sont ils recyclables ou réemployables ?
Les matières premières tels que le bois, la terre ont prouvés par le passé qu’ils ont une certaine pérennité. Ces matériaux traditionnels font appel à des constructions dites vernaculaires qui caractérisent un territoire. La région Rhône-Alpes est le terrain d’étude du corpus abordé dans la deuxième partie de ce mémoire. Ainsi, il est intéressant de se pencher sur les matériaux et les techniques constructives reliés à ce territoire. Nous aborderons principalement la terre et le bois afin de comprendre les propriétés et techniques liées à ces ressources. Estce que la complexité des dispositifs ne génère pas trop de difficultés pour la pérennité des bâtiments, leurs rénovations et leurs fins de vie ?
On peut aussi se demander si la conception d’enveloppe efficace thermique ne génère pas trop de complexité ? Serait-il accessible de rénover ce type de projet ?
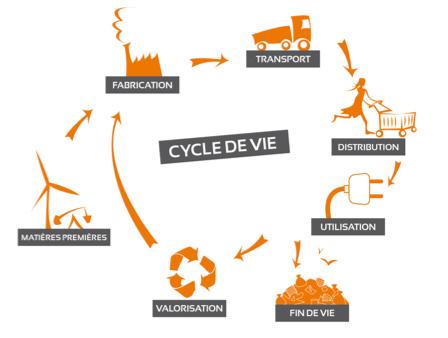
PARTIE 2 // QUELLES POSTURES FACE À L’ENJEU :
Habiter l’environnement ?
Transition et rappel problématique
Cette première partie a permis de mettre en valeur les outils de conception architecturale que manipule le bioclimatisme. Elle a aussi révélé des problématiques liées aux consommations de ressources matérielles et énergétiques. La remise en cause des stratégies adoptées face à l’urgence de la situation a mené à des interrogations sur les acquis dans la conception. Notamment concernant le confort et les solutions conventionnels apportées souvent additionnelles plutôt que global. Toutes les solutions techniques et architecturales apportées peuvent être requestionnées dans leurs qualités de durabilité.
Ceci nous ramène à la problématique énoncé en introduction de ce mémoire. Comment les outils du bioclimatisme permettent de questionner la notion d’environnement dans l’habitat ?
A l’ordre du jour, le logement individuel en France représente plus de la moitié du patrimoine foncier. Étant un point d’enjeu pour l’avenir, il est intéressant d’aborder la notion d’habitat à travers le prisme de la conception environnementale. C’est la raison qui m’a poussé à étudier trois projets de logements individuels qui ont cherché à intégrer l’environnement dans leurs conceptions et constructions. Pour cela, cette partie d’étude de cas se déroulera au travers quartes points. Tout d’abord, la présentation de la méthodologie de travail et d’élaboration du corpus. Puis, la présentation de chacun des projets choisit. Puis, en troisième point une analyse selon les points consommation, usage et pérennité identifiés dans la première partie de ce mémoire. Enfin, en quatrième point, cette partie sera résumée sous la forme d’une synthèse.
1. Démarche et méthodologie
Définition du corpus :
Les cas d’études identifiés sont des projets d’habitats individuels réalisés par des agences ayant une opinion et une posture vis-à-vis de l’environnement. Chaque projet possède une réponse différente, c’est un aspect recherché dans le choix du corpus. Chacun est présenté et analysé sur la base d’entretiens avec les architectes et les usagers pour comprendre la posture et le rôle de ces acteurs. L’objectif est de les comparer en gardant à l’esprit les interrogations développées dans la première partie.
Les projets sont inscrits dans un terrain relatif au territoire de la Région Rhône-Alpes et plus particulièrement entre l’Isère et la Savoie. Comme le rappel Gérard et Hugo Gasnier durant notre entretien, il s’agit d’une région dynamique qui a un engouement autour de la construction écologique.
Corpus :
a. Rénovation et extension : Chalet Corrençon-en-Vercors, Atelier de la Place 2009
b. Construction neuve passive, maison La Tronche, Gasnier Eco, 2019
c. Construction neuve autonome, Maison (Z+H) Vimines, Caracol Architecture, 2016



2. Présentation des projets
a) Rénovation et extension, Chalet Correncon en Vercors, Atelier de la Place
Contexte géographique et site
Le projet s’implante dans la ville de Corrençon-en-Vercors, la commune est située dans la région RhônesAlpes, dans le département de l’Isère. Il s’agit d’un village de montagne connu pour sa station de ski. Il est implanté dans les chaînes montagneuses du Vercors, à 1102m d’altitude, au sud du plateau du Vals de Lans.
La commune marque la fin de la route, qui s’arrête aux portes de la réserve naturelle des Hauts plateaux du Vercors. Ainsi, elle est entourée de forêt et de deux pics, la Petite et la Grande Moucherolle (2 156m et 2 285m respectivement). L’environnement bâti est rural, les habitations sont principalement des maisons individuelles et habitations secondaires. Il y a un rapport d’espace végétalisé équilibré, la densité de surface bâti est faible.
Le village a un climat tempéré. Le mois de l’année le plus chaud est celui de juillet (moyenne maximale 20,9°), tandis que le mois le plus froid est celui de janvier (-3,5°).1
Information générale
Programme : Maison de vacance, espace de vie, chambre et mezanine, sdb, garage, studio indépendant RDC.
Projeter : Rénovation de l’enveloppe, extension garage.
Localisation : Corrençon-en-Vercors date : 2009-2011
Maître d’ouvrage et ou usagers : Monsieur et Madame Richard
Maître d’oeuvre : Atelier de la place, Thomas Braive architecte.
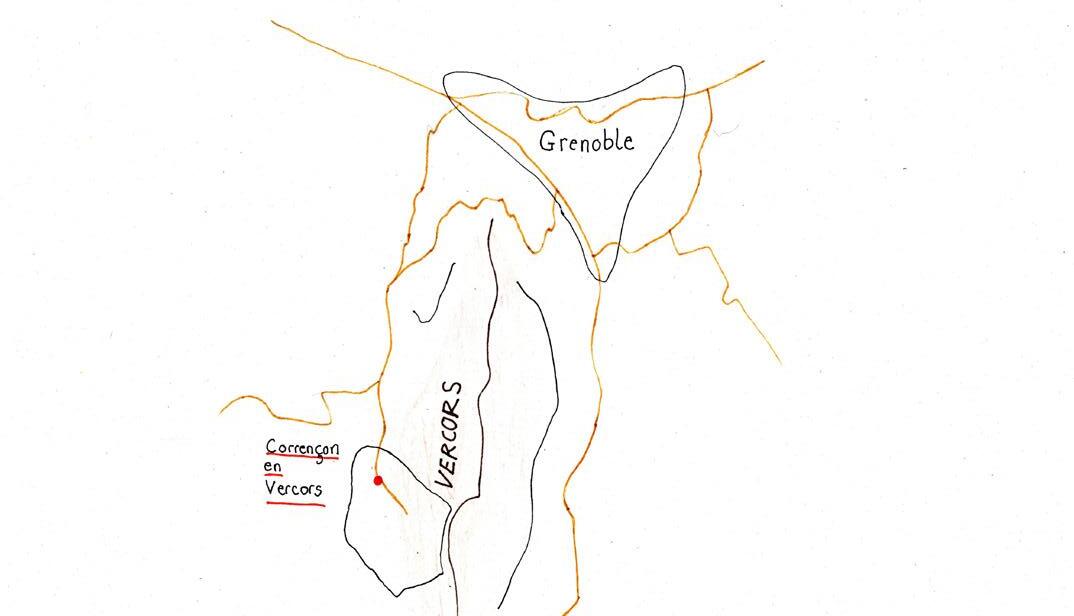
Schéma situation dans le territoire, production personnel.

Le chalet dans son site se trouve à l’entrée du village. Il suit l’orientation de la parcelle et se place dans l’axe Nord-Est et Sud-Ouest. Il mime ses voisins et adopte une emprise similaire, cependant il s’aligne à la limite parcellaire ouest. L’extension réalisée correspond au garage qui s’inscrit dans le prolongement du chemin d’accès. Le site est peu arboré dans l’environnement proche, sauf en limite ouest et sud où se trouvent quelques arbres distinctifs. Cette végétation constitue une barrière visuelle, elle crée un peu d’ombrage au sud et coupe le vis-à-vis. Le village est situé sur un plateau, ainsi le projet se positionne dans un site avec une morphologie plutôt plate. Dans le paysage lointain, les montages et les forêts environnantes ponctuent l’environnement. Ils offrent un climat tempéré et bien exposé.

Contexte historique
Pourquoi et comment le projet a vu le jour ?
La famille Richard habite en appartement dans la ville de grenoble. Le couple, alors quarantenaire, souhaite trouver un lieu de rassemblement pour accueillir leurs enfants et futurs petits-enfants. Dans cette idée, ils choisissent d’investir dans l’achat d’un chalet à Corrençon-en-Vercors. C’est un lieu qu’ils affectionnent. Le site est plus à la campagne, au vert, et constitue un lieu paisible pour la famille. Le chalet préexistant est une construction très sobre et frugale, le confort y est rudimentaire. La morphologie s’inspire du chalet traditionnel avec des pans de toiture assez raide, un soubassement en maçonnerie et une ossature bois surmonté d’un bardage bois intérieur et extérieur. L’étanchéité à l’air et l’isolation sont manquantes. C’est la raison qui pousse la famille à réaliser une rénovation énergétique ainsi qu’une extension de leur bien.


a) Rénovation et extension, Chalet Correncon en Vercors, Atelier de la Place
Conception et organisation spatial
La maison est un chalet de vacances il est rénové pour accueillir la famille, les enfants et petits-enfants dans un confort thermique et spatial plus important.
Une première partie à l’est correspond à l’extension. Au rez-de-chaussée, il abrite les espaces de garage et un studio qui est conçu de manière autonome pour être loué plus tard. Un couloir de distribution constitue un espace tampon, il dessert l’étage où est le logement principal.
On trouve au premier niveau un espace assez ouvert orienté vers le sud avec une grande pièce de vie chauffée par un poêle à bois central. La cuisine est au nord. La vue est transversale et la terrasse est rénovée pour offrir un espace de repas abrité au sud. On trouve aussi une première chambre au nord. Au-dessus de l’espace de distribution on trouve une pièce d’appoint de taille réduite et une salle d’eau. Un second escalier permet d’accéder au dernier niveau où l’on trouve une mezzanine avec une grande chambre.
L’espace est compact et efficace, il profite des orientations. Il est assez simple et correspond à l’usage des habitants. Il se base sur l’existant en cherchant à améliorer la qualité spatiale du lieu.
Entretien Extraits habitant monsieur et madame Richard :
“La salle de vie est vraiment très chouette et elle correspond complètement à notre manière de vivre et de fonctionner quand on est là-haut, avec cette ouverture sur le balcon. C’est une pièce qui nous correspond complètement.”
“je me souviens que je tenais à ce qu’il y ait une ouverture du côté jardin, une baie un peu en hauteur, pour profiter de la vue. Lui me disait que c’est du côté nord donc que ça nous rabaisserait en termes de gain thermique, mais on y tenait beaucoup. Après je ne pense pas qu’on ait eu des demandes. En gros on savait ce qu’on voulait et il nous a aidé à rendre opérationnelles nos propres idées.”
Entretien Extrait Thomas Braive :
“D’abord le garage, était très complexe d’accès et il n’était pas possible de rentrer une voiture à l’abri. Ensuite, l’isolation acoustique était nulle entre un niveau et l’autre. Le plan est le plus fonctionnel possible avec la terrasse. Il a fallu quand même reprendre l’organisation spatiale pour essayer de l’adapter aux besoins sur les 30/50 ans à venir”.
“C’est le premier projet que j’ai réalisé en tant qu’indépendant et en autonomie. Par des contacts et du bouche à oreille, j’ai rencontré les Richard. Ils avaient investi dans ce chalet comme résidence secondaire, donc inoccupée une partie de l’année. Les clients étaient très investis et voulaient réaliser une rénovation énergétique pour avoir un meilleur confort dans ce lieu. C’est un projet avec une extension, et nouvelle peau assez simple. La maison était assez mal implantée sur son site et il a fallu remettre un peu les pièces et espaces dans le bon sens. Il n’y avait aucune étanchéité à l’air et aucune résistance thermique.”
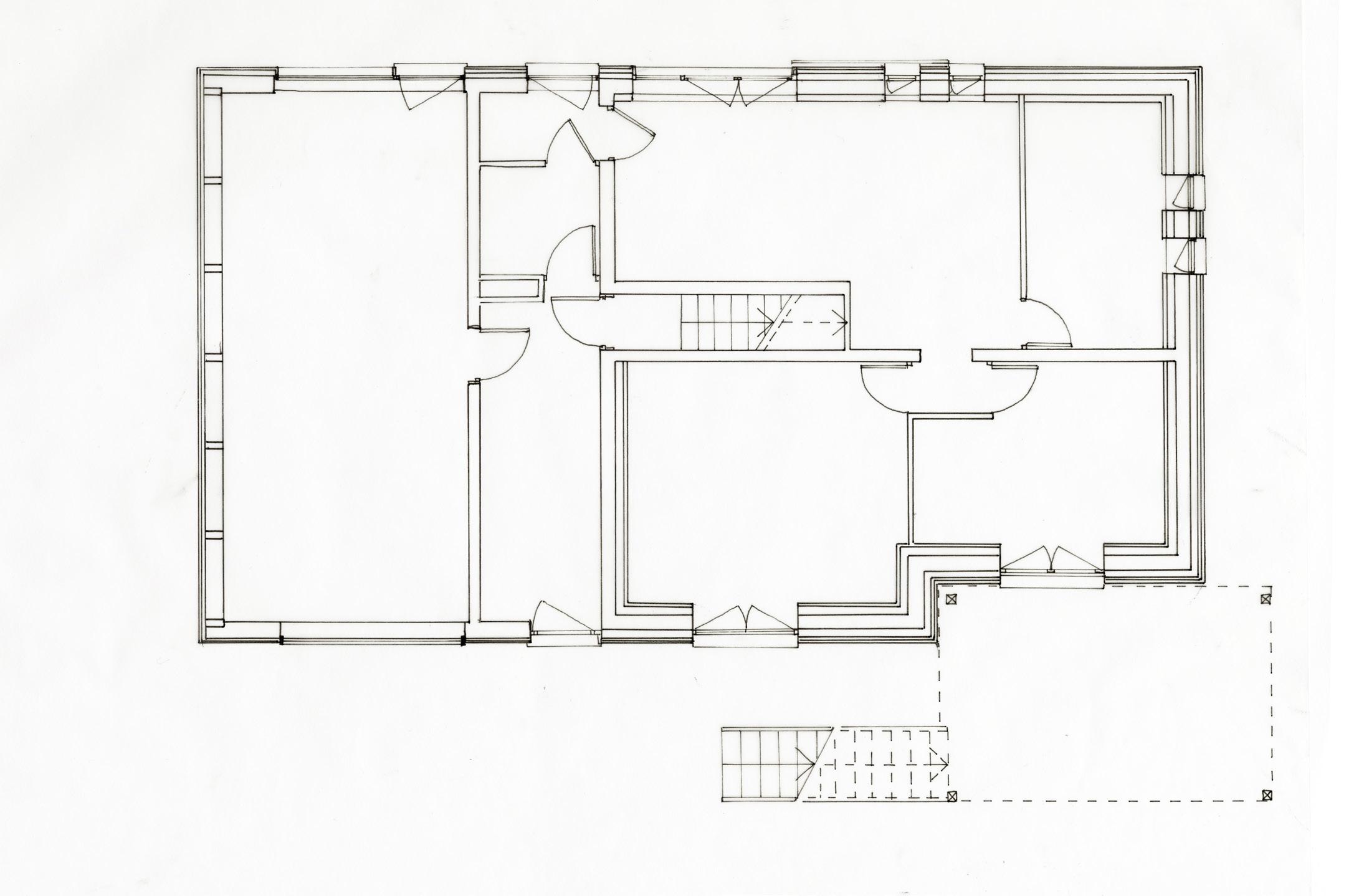
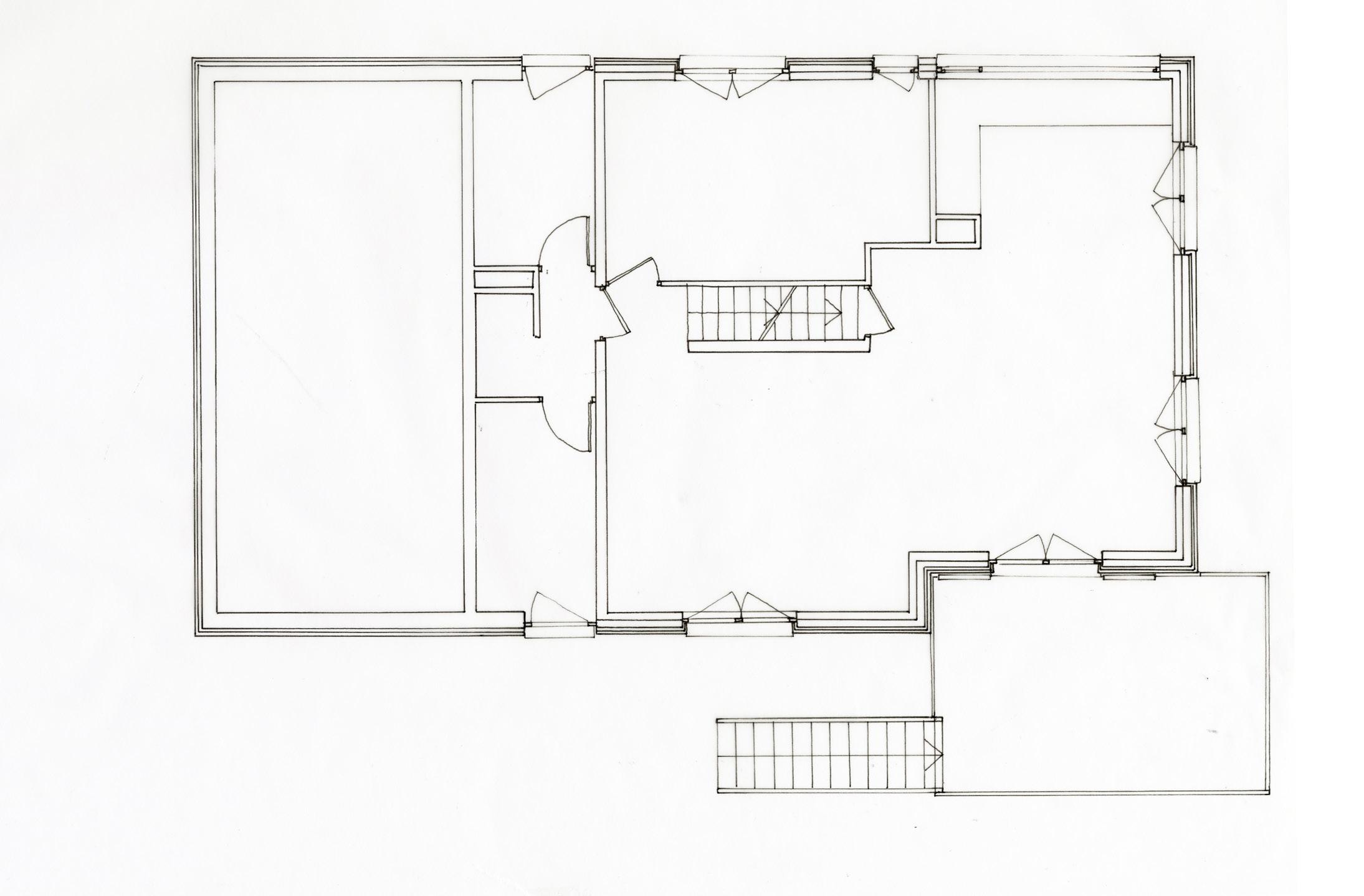
a) Rénovation et extension, Chalet Correncon en Vercors, Atelier de la Place
Le chalet a gardé sa structure originelle en maçonnerie au rez-de-chaussée et en bois à l’étage. Il a été surmonté d’une seconde peau constituant un manteau thermique. En effet, le bâtiment originel était très précaire et peu étanche à l’air. Il a fallu reconstituer une isolation par l’extérieur. Ainsi, toutes les façades et le toit sont surmontés de panneaux de fibre de bois et d’une épaisseur de ouate de cellulose, complétant l’isolant de laine de verre présent initialement. Dans une logique économique et écologique, il était intéressant de maintenir ce matériau bien conservé.
Les habitants et l’architecte ont fait le choix de retrouver le bois comme ligne conductrice. C’est un choix dans la logique du site et de l’existant. Ainsi la structure de l’extension est en ossature bois. Dans ce projet, une vraie logique constructive s’articule autour du bois. Une volonté des propriétaires était de choisir un bois local et de faire fonctionner des entreprises de proximité. Ainsi, ils ont choisi le mélèze, arbre du plateau de Corrençon-en-Vercors. La complexité de ce projet réside dans le dessin des détails constructifs qui ont permis de le rendre étanche à l’air et confortable d’un point de vue thermique. Un travail tout particulier est réalisé sur la façade, les ouvertures et le rythme créé par le bardage.

Entretien Extraits habitant monsieur et madame
Richard :
“D’abord on est en montagne et le bois est assez naturel. En plus, on avait demandé à Thomas Braive de travailler avec des entreprises locales. Cela nous paraissait important de faire fonctionner l’économie locale. ”
“En fait nous n’avons pas réellement demandé à faire des économies mais qu’avec la même somme on gagne en confort. On partait avec un lieu qui était quand même sommaire au niveau thermique. C’était un peu comme une passoire. On se contentait de 12-14°C, alors que là on arrive à 17-18°. Et puis on a augmenté les m2 ici donc c’était forcément un coût supplémentaire. On a aussi vieilli et on supporte beaucoup moins le froid.”
Entretien Extrait Thomas Braive :
La rénovation énergétique de ce projet était-elle motivée par des objectifs de consommation ? (chauffage)
« Pas vraiment, l’objectif n’était pas de faire des économies de consommation d’énergie mais plus d’avoir un accès au confort raisonnable et de rendre le lieu plus efficace dans son enveloppe et sa thermie.»

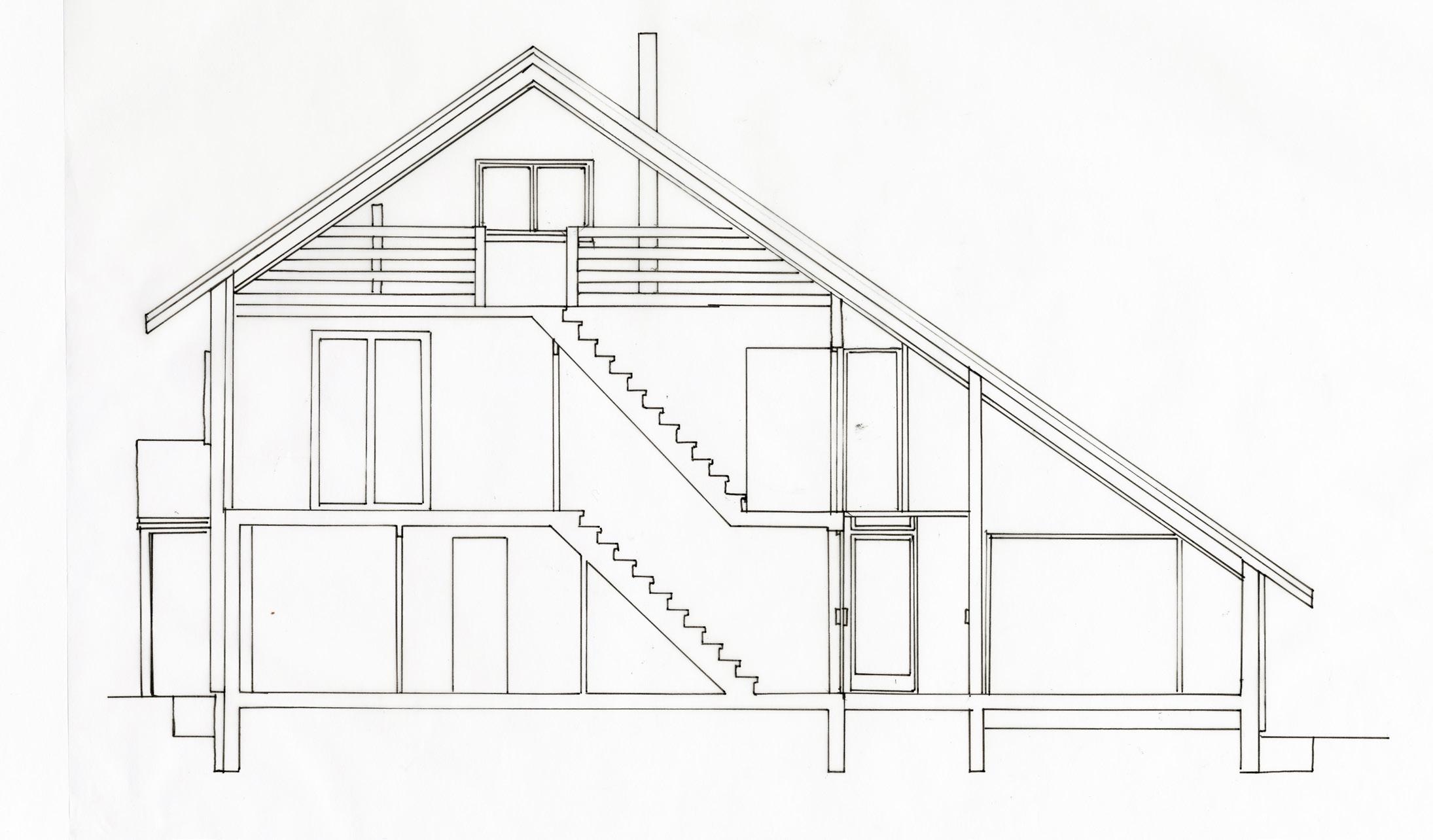
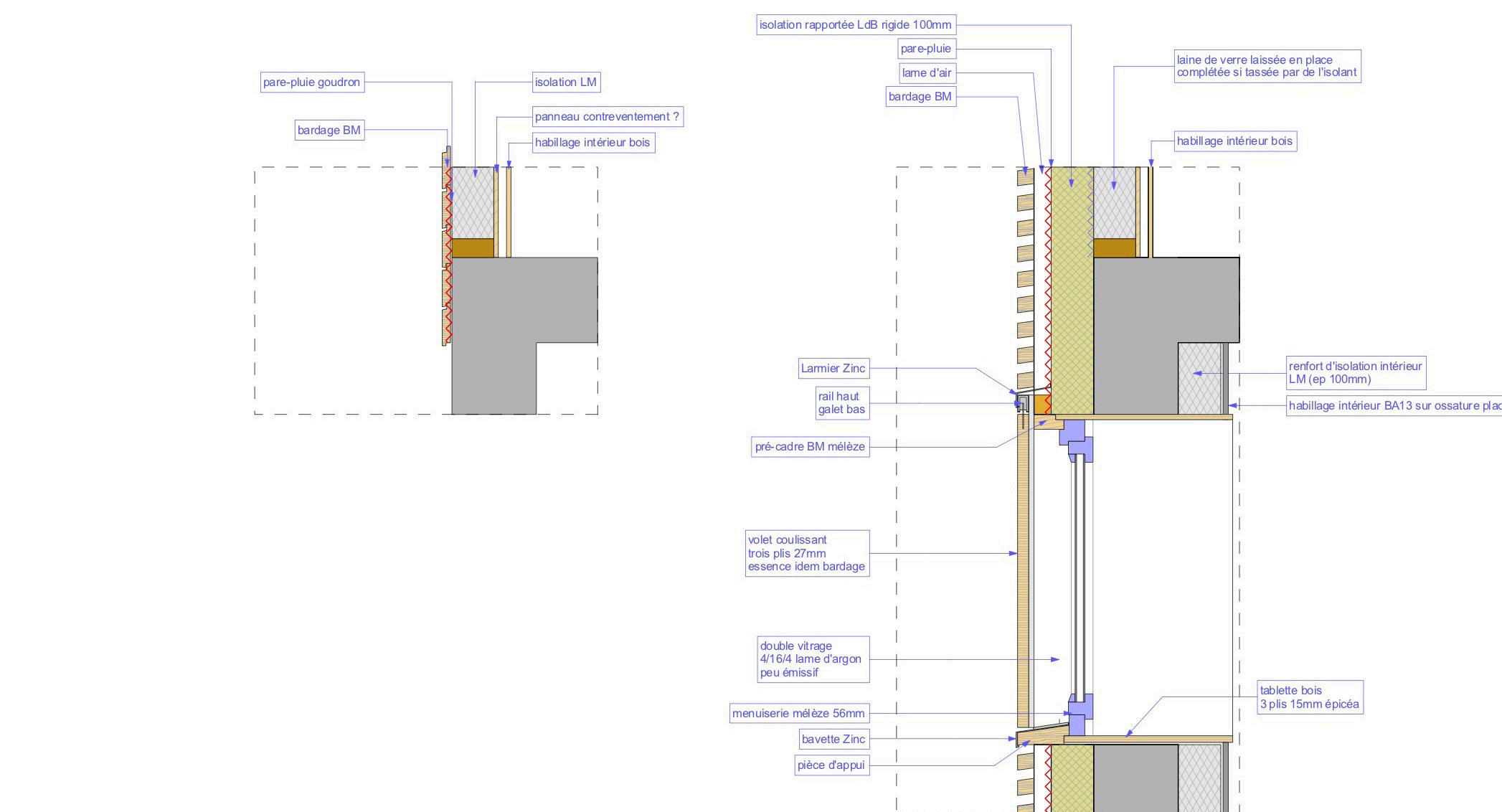
2. Présentation des projets
b) Construction neuve Passive, Maison La tronche, Gasnier Eco
Contexte géographique/ site
Le projet s’implante dans la ville de la Tronche. Il s’agit d’une commune de l’Isère, dans la région Rhônes-Alpes. Elle se situe dans la périphérie urbaine de Grenoble et s’inscrit dans la métropole. La commune s’étend sur le versant est de la Chartreuse et possède donc un dénivelé important, entre 207 et 1045m d’altitude.
Le projet est situé à 470m. La Tronche est une ville urbanisée qui s’inscrit dans le prolongement de Grenoble, à laquelle elle est connectée par les réseaux de transport urbain. La densité de population atteint 1026 habitants au km2. L’urbanisation de la ville s’est progressivement faite depuis les années 1950.
Par sa position, elle est abritée des vents du Nord ce qui lui confère un microclimat favorable ensoleillé et chaud. Le bassin grenoblois est entouré de 3 massifs (voir schéma de localisation). Ils ont pour conséquence de constituer une cuvette dans laquelle s’est développée la métropole. Celle-ci favorise la présence de microclimats urbains et d’îlots de chaleur. Le climat est tempéré avec une maximale au mois de juillet à 29,3° et une température
Information générale
Programme : Logement m2, Espace de vie, buanderie et cave, sdb, 2 chambre, mezanine et bureau. En extérieur abris garade avec local.
Projeter : Maison individuelle Passive
Localisation : Chemin de chantemerle La Tronche
Date : 2017- 2019
Maître d’ouvrage et ou usagers : Famille Dutheil
2 adultes et un enfant en bas âge.
Maître d’oeuvre : Gasnier-Eco ( agence d’architecture sur grenoble) .
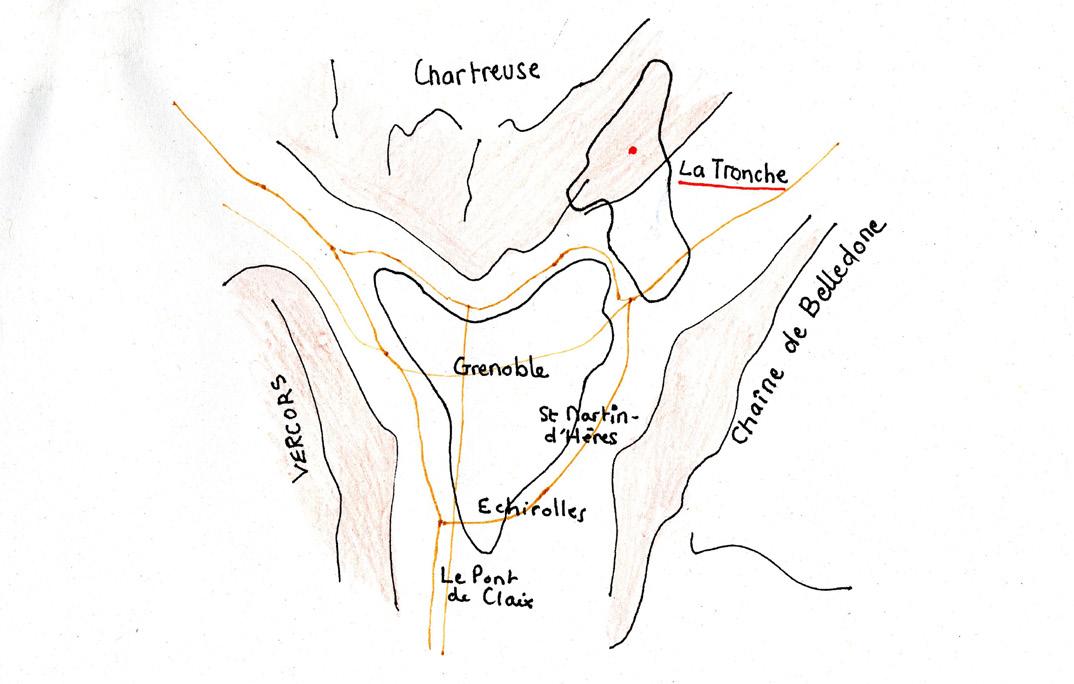
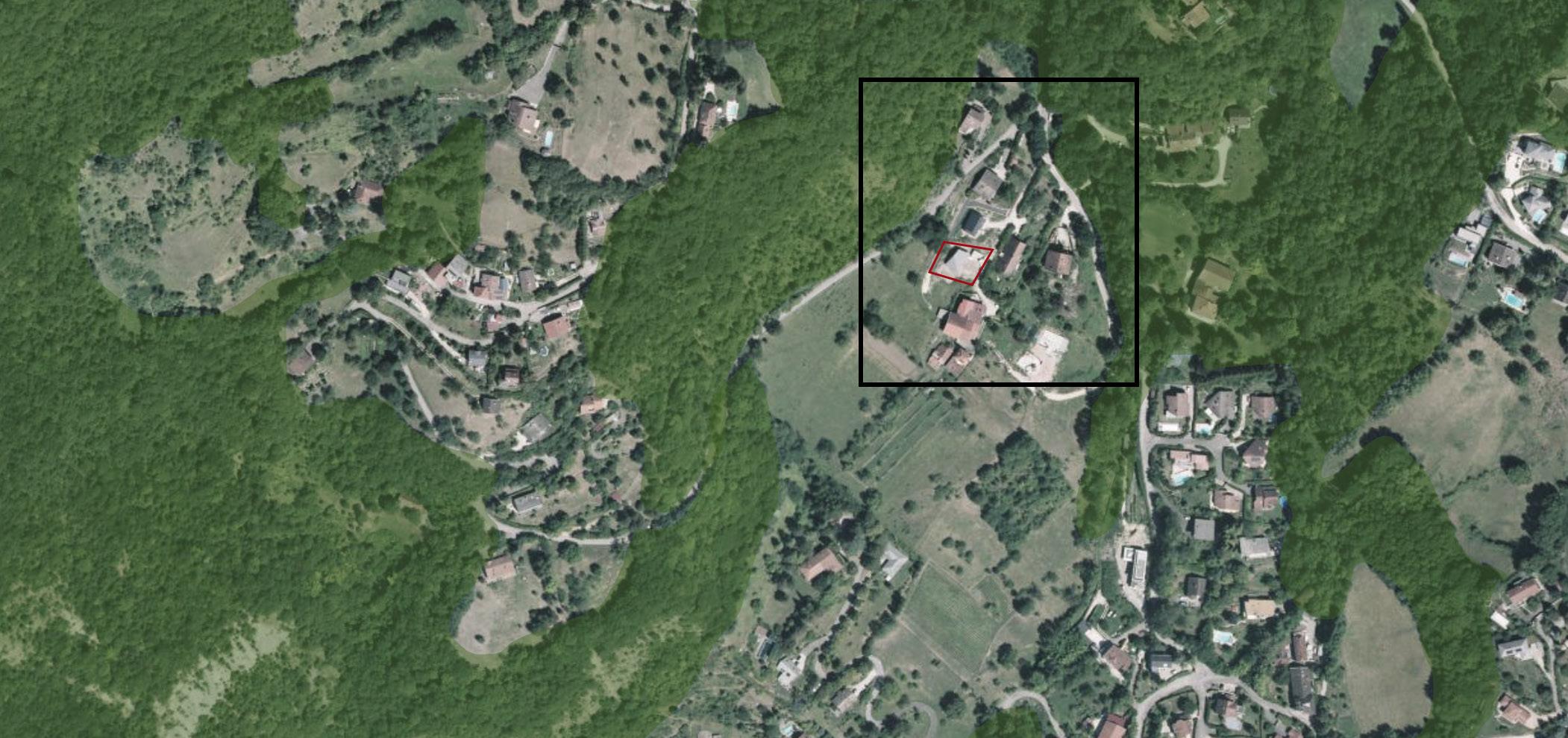
minimale à -1° au mois de janvier en moyenne entre 1991 et aujourd’hui.1 En outre, la densité et la morphologie des hauteurs de La Tronche lui confèrent une meilleure circulation de l’air et un rafraîchissement par la présence de forêt.
Le projet s’inscrit dans une parcelle orientée dans le sens de la pente. Le terrain est en pente avec 5m de dénivelé entre le point haut et le point bas. La maison mime l’implantation de ses voisins, parallèle à la voirie d’accès. Elle est située en retrait de ce chemin, 4m plus haut. Pour atteindre l’entrée, il faut déambuler selon une séquence d’accès qui débute par un abri voiture et vélo, puis un escalier qui longe la façade nord-est. Autrement, on peut emprunter un chemin dessinant sinueux.
La maison est enterrée, elle se protège du vent et des dépressions au nord en minimisant la façade. La végétation est plutôt située au lointain. Au nord, on note tout de même la forêt à proximité. La maison profite pleinement de son exposition en s’ouvrant au sud-est. La maison est relativement compacte avec des pentes de toit suivant les courbes du site. Tout de même, une loggia dessine une terrasse abritée formant un décroché dans la façade.

1 source: infoclimat.fr Entretien avec agence Gasnier-ECO :
Si vous pouviez résumer en quelque point principaux ce projet, quels seraient-ils ?
Gérard : « Le projet est pour une famille recomposée avec juste un jeune enfant. Il n’y a en fait pas un gros besoin en nombre de pièces. Il n’y a que deux chambres, une mezzanine et un grand espace de vie. Les clients étaient très attachés à la qualité de cet espace de vie, très lumineux.


b) Construction neuve Passive, Maison La tronche, Gasnier Eco
Conception et organisation spatial
Le projet est une maison individuelle, destinée à un couple recomposé avec un enfant en bas âge. Les habitants voulaient une maison en bois, économe en énergie mêlant qualité spatial et confort. La maison est dans un terrain en pente et se tourne vers le paysage. Afin de préserver de l’intimité, un patio se développe sous la forme d’une terrasse au centre de la maison. Ainsi la maison s’articule autour avec au rez-de-chaussée l’entrée et des sanitaires, puis le salon au sud-est avec un niveau un peu plus bas. Au centre, on trouve le hall avec l’escalier en voûte sarrasine, puis on trouve la cuisine et la buanderie, et la cave qui est enterrée en profitant de la pente. La terrasse, au centre, est une volonté des clients dès le début du projet. Ils voulaient disposer de cet espace extérieur qui deviendra en été un lieu de vie et une pièce extérieure.
A part cette forme assez spécifique, le projet se veut efficace et simple. A l’étage, on accède à un bureau sous la forme d’une mezzanine et d’un espace de filet en double hauteur sur le salon. Cet espace est un lieu de détente supplémentaire. Ensuite, au sud et à l’ouest, on trouve deux chambres correspondant aux besoins des habitants. Une plus grande, pour le couple, et une plus petite pour l’enfant. Au centre, on trouve la salle de bain, très ouverte vers l’extérieur.
Dans ce projet, les vues sont privilégiées et les ouvertures permettent de maximiser l’apport solaire de lumière et chaleur. La façade la plus au nord est fermée et enterrée. Le plan est travaillé pour correspondre aux usages des habitants.
Le projet se rapproche de l’ambition d’une maison passive avec une enveloppe isolante et étanche. C’est la stratégie choisie pour obtenir un confort thermique avec peu de consommation énergétique. Pour cela, le concept est complété d’un dispositif de ventilation double-flux pour renouveler l’air, couplé à une chaudière créant de l’eau chaude sanitaire.
Entretien Gasnier Eco, Gérard et Hugo Gasnier :
“Les clients étaient très attachés à la qualité de cet espace de vie, très lumineux. Dès le départ il y avait cette volonté, de leur part, d’avoir un patio intérieur entre deux pièces, par rapport à des choses qu’ils avaient vues.
Quand on est sur le site, il y a quelques maisons autour. Ils avaient vraiment le souhait de ne pas être à la vue de tout le monde lorsqu’ils sortaient de chez eux, et de se ménager un petit coin terrasse à l’abri des regards. La maison n’est pas plein sud, elle est orientée vers la vue Sud-Est. La forme est une base rectangulaire simple avec juste un décroché. Il y a un jeu de toiture intéressant grâce au faitage décalé et en biais, ce qui permet de générer ces volumes avec un aspect qui crée des biais. Ainsi, il n’y a pas vraiment de pignon, toutes les façades ont des biais, et cela génère des volumes entre le salon et la mezzanine et un volume suffisant pour aménager les chambres et les parties habitables. ”
« Autour du patio, il y a un demi-niveau dans le salon. Il y a un vrai avantage, c’est que lorsqu’il fait froid ils font le tour, mais en été c’est ouvert partout et ils circulent. Le patio c’est une vraie troisième pièce à vivre. Elle est beaucoup utilisée comme elle est couverte.»
“Il y a une VMC compacte. En France ça n’existe pas, ça vient du Danemark. Elle a un système de double-flux avec un chauffe-eau et une pompe à chaleur intégrés. Ainsi, elle permet de chauffer l’eau chaude et de préchauffer l’air qu’on réinsuffle dans toutes les pièces, salon, séjour et chambre. Ce sont des machines qui ont été développées par les concepteurs de la maison passive.”
Plan R+1 Source : Schéma personnel et fond de plan de Gasnier-Eco. source de chaleur
R+1
: Schéma personnel et fond de plan de Gasnier-Eco.
Cette maison est basée sur une ossature bois Douglas. Les matériaux sont biosourcés au maximum. On trouve de la ouate de cellulose comme isolant, dans les murs et en toiture. Le projet mise sur une enveloppe très performante et étanche à l’air pour garantir le confort thermique. De cette manière, on trouve des menuiseries bois et avec du triple vitrage. En façade, il y a deux types de bardage bois, un non traité sur la partie protégée du patio et l’autre grisé. Ainsi le bois prend une teinte qui s’insère dans le paysage et fait écho à la roche de la montagne environnante. A l’intérieur, on trouve du parquet bois massif qui constitue un support de transfert thermique plus chaleureux. Dans la cuisine, le béton ciré correspond plus à l’usage. Dans cette maison, le confort d’été est primordial et il fait bon vivre dans cet espace de vie tout ouvert. On note aussi l’élégance de l’escalier et sa technique de construction en matériaux plus propres, comme l’expliquent les architectes lors notre entretien.
Entretien Gasnier Eco, Gérard et Hugo Gasnier :
“L’escalier en voute sarrasine est en brique. C’est une technique qui permet d’avoir un escalier maçonné avec des briques et du plâtre sur une voute avant de refaire des marches. Il n’y a pas de béton, pas de ferraille, et c’est très léger et simple avec une légère courbe.Cela permet d’avoir les planchers en bois apparent entre le rez-dechaussée et l’étage. Le bois est resté apparent dedans. Le mur qui monte à l’étage est en bois.”

Entretien Gasnier Eco, Gérard et Hugo Gasnier :
“L’ossature est en bois, c’est du Douglas. Le bardage c’est aussi du Douglas avec deux textures différentes. L’enveloppe extérieure est en bardage grisé, traité en usine (grisement de surface). Le patio est resté naturel sur les parties où il est a priori plus protégé et moins exposé aux intempéries, pour garder ce contraste. Dans les mus et toiture nous avons utilisé de la ouate de cellulose.
L’escalier en voute sarrasine est en brique. C’est une technique qui permet d’avoir un escalier maçonné avec des briques et du plâtre sur une voute avant de refaire des marches. Il n’y a pas de béton, pas de ferraille, et c’est très léger et simple avec une légère courbe. Cela permet d’avoir les planchers en bois apparent entre le rez-de-chaussée et l’étage. Le bois est resté apparent dedans. Le mur qui monte à l’étage est en bois.”
“Ce n’est pas une idéologie, il faut rester dans quelque chose de pragmatique et de logique, à la fois en termes d’usage et d’investissement dans les isolants. Il ne faut pas être fou de la maison passive. La maison n’est pas forcement efficace en termes de performance mais par contre en termes d’usage, il n’y a pas photo. Il faut jouer avec chaque curseur pour trouver la maison la plus équilibrée, de ce point de vue-là. “


c) Construction Neuve Autonome, Maison ( Z+H)Vimines, Caracol Architecture
Le projet s’implante dans la ville de Vimines. Cette ville se situe en périphérie de Chambéry dans le département de la Savoie, en région AuvergneRhônes-Alpes. La ville est constituée d’un chef-lieu et de plusieurs hameaux et lieux-dits. Elle se situe au sud-ouest de Chambéry, sur le versant est de la chaîne de l’Epine appartenant à la Chartreuse. Elle est donc assez vallonnée et s’étend entre 320 et 1370m d’altitude.
Le projet s’inscrit dans le hameau de L’Achat qui est en plein développement. En effet il s’agit d’un secteur en construction avec beaucoup de lotissements qui se sont créés ces dernières années. Vimines est principalement constitué de maisons individuelles pavillonnaires. Le milieu est assez rural et calme, il offre un cadre de campagne. En effet, on remarque la présence de forêts et d’exploitations agricoles. C’est un milieu peu construit avec une densité d’habitation très faible (145 hab/km²).
Sa topographie et son exposition lui confèrent un climat tempéré. La température maximale est de 27,7° au mois de juin (moyenne entre 1991 et aujourd’hui), tandis que la température minimale moyenne est de -1°, au mois de février. 1
Information générale
Programme : Maison inviduelle avec espace de vie, 3 chambres, salle de bain, buanderie, espace de rangement en mézanine. En extérieur, garage abriter véhilcule et vélo.
Projeter : Maison passive en bois, paille et terre. Localisation : Vimines, périphérie de Chambéry.
Date : début projet 2014 - 2016 livraison.
Maître d’ouvrage et ou usagers : Damien Zisswiller et pour 2 adultes et 2 enfants.
Maître d’oeuvre : Thomas Jay de Caracol Architecture (Grenoble).
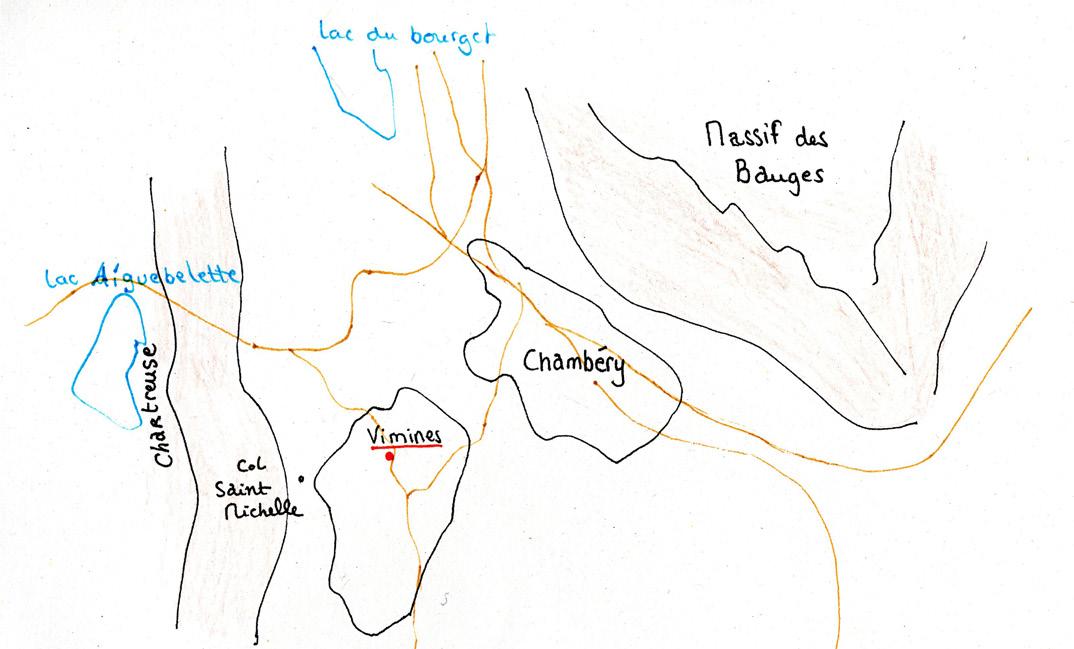

La maison est située dans un hameau de la commune qui reste à proximité de Chambéry. Elle s’inscrit dans un quartier développé sous la forme d’un lotissement récent, qui a été construit en même temps que le projet. Les maisons voisines ont une plus grande emprise au sol. Pour profiter au maximum du site et de son exposition, la maison du couple s’oriente vers le sud et s’acquitte de l’implantation de ses voisins tous alignés selon les limites parcellaires et le chemin d’accès. Pour ne pas être impactée par le masque solaire et la proximité des voisins, la construction se dissocie en deux volumes. Ainsi on trouve le volume de stationnement dans la continuité de la voirie d’accès, puis la maison qui se décale et qui est accessible par un passage abrité. La maison est assez compacte avec une forme simple. Elle se distingue tout de même de ses voisins par son revêtement extérieur mélange terre, chaux et bois. Elle développe au sud un jardin et deux terrasses.
Entretien habitants Vimines : Quand, comment et pourquoi est né le projet de votre maison?
“ Il y a plusieurs réponses.
D’abord on n’avait pas forcément cette envie de maison ou de maison individuelle. On avait en tous cas le projet d’investir. On avait plusieurs possibilités. On regardait des terrains nus pour une construction qui nous ressemble dès le départ, dès la genèse de la maison. On avait aussi eu des idées ou en tous cas des envies de rénovation de maison. Trouver un corps de ferme, une vieille grange, une vieille bâtisse, un bout de chalet, que sais-je… Quelque chose qui permette de venir refaçonner un petit peu sans artificialiser le sol de manière plus conséquente, donc de repartir d’un projet existant.
On avait les deux projets et on avançait de manière un peu parallèle sur ces deux sujets. Et finalement au bout d’un an de visite de maisons à rénover, on s’est aperçus que le projet qui nous correspondait le plus, notamment sur des questions financières, était probablement plus la construction neuve. Parce que sur notre secteur la moindre ruine coûtait déjà très cher, donc après le ticket de rénovation, d’extension, etc. c’était trop élevé.
On s’est recentrés sur un projet de construction neuve.
Assez rapidement, parce que c’est notre sensibilité, on a eu envie d’un projet assez sain, assez propre dans les matériaux, dans sa construction.”



Conception et organisation spatial
Le projet se veut efficace et économe. Ainsi, on rentre à l’est, on accède au rez-de-chaussée où on trouve un grand espace de vie, très ouvert, avec la cuisine, le salon et la salle à manger. Au nord-est, on trouve juste une petite buanderie et un WC. Au centre est placé un mur en pisé qui est porteur, auquel s’adosse le poêle à bois granulés. De cette manière, le mur en terre stocke la chaleur et la restitue plus lentement. L’escalier est placé proche de l’entrée, sa trémie est largement ouverte pour laisser la chaleur monter à l’étage. A l’étage on trouve trois chambres d’une taille moyenne. Elles correspondent à l’usage de la famille et se placent sur la façade ouest et sud. Pour limiter la surchauffe, les volets à brise soleil orientable (BSO) permettent de limiter l’apport solaire. De plus, la plus des ouvertures sont positionnées en partie en base, ce qui permet d’éclairer sans surexposer. Des espaces de détente et de stockage sous la forme de mezzanine permettent d’optimiser la place.
Entretien habitants Vimines, Damien Zisswiller
- Comment vous vous sentez dans cette maison, vous y vivez bien?
« Oui super bien, et honnêtement on n’est pas les seuls. Alors je ne sais pas s’ils sont tous gentils avec nous mais nos amis et notre famille qui viennent dans cette maison disent qu’on s’y sent bien. Il y a une espèce d’âme assez chaleureuse. C’est vrai que la terre… on a une partie du sol en béton ciré et puis un sol en terre crue damée. Du coup, entre le pisé, les murs en terre et le bois ça donne quelque chose d’assez chaleureux, d’assez cocoon. Nous on s’y sens extrêmement bien à tous points de vue, à la fois dans l’usage dans les espaces, qui de notre point de vue sont très bien dimensionnés. Il y a un espace en bas, tout ouvert, vitré et très tourné vers l’extérieur. Les chambres ne sont pas trop petites ni trop grandes. On a des petits espaces, des petites mezzanines, des choses comme ça qui sont assez sympa. Je sais que les enfants aiment bien y passer du temps, ça leur fait plusieurs lieux qu’ils peuvent investir, surtout par ces temps de confinement et de télétravail… Ce n’était pas calibré pour cela. En tout cas on y vit très bien, on s’y sent très bien.»
Entretien habitants Vimines, Damien Zisswiller :
“On va dire qu’on n’avait pas d’exigence technique mais des exigences de confort bioclimatique, été comme hiver.
On avait envoyé un document à Thomas qui regroupait nos attentes. On souhaitait un projet aux lignes simples, des traits originaux, non rébarbatifs, profitant au maximum de l’ensoleillement, bien intégré dans le site, pas gênant pour les voisins, accès facile aux espaces extérieurs privatifs, un jardin privatif, de taille suffisante et en un seul morceau (pas autour du bâtiment), exposition sud à minima et est-ouest selon le terrain. Il y avait plusieurs terrains à ce moment sur l’ensemble du lot, accès discret, stationnement, espace atelier... Sans faire un schéma fonctionnel on l’avait fait de manière littéraire, avec les connexions entre les espaces. On avait décrit comment est-ce que chaque espace communique avec l’autre, l’emplacement, le dimensionnement.”
Entretien Caracol architecture Thomas Jay :
« C’est un projet qui a été fait dans un lotissement. C’était particulier : il y avait des constructeurs sur le lotissement qui proposaient des maisons, il y avait un enjeu de ce côté-là car nous allions proposer quelque chose de complètement différent. On avait une démarche bioclimatique, alors que les autres pas du tout. Ça a donné une implantation un peu particulière, on a retrouvé une orientation au sud, effectué un travail sur l’ancrage dans la parcelle, une circulation couverte, un stationnement à l’entrée… pour essayer de reconstruire un petit peu un environnement. La conception avec eux s’est assez bien passée. Ils avaient un budget assez serré, de l’ordre de 200 000 €, 1800 € du m2 environ. Il y avait un petit challenge par rapport à ça. »
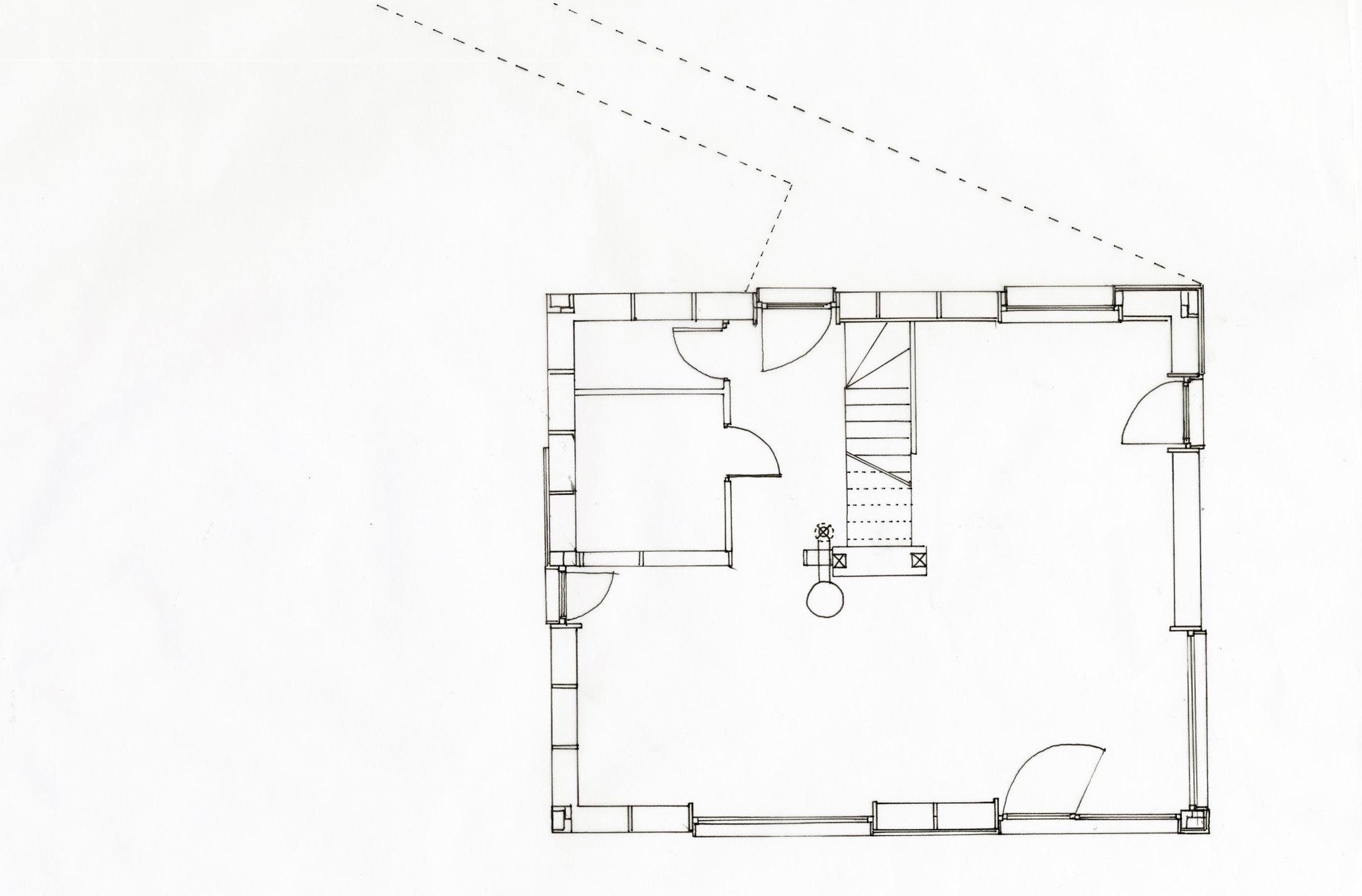
paille
ossature bois
enduit terre et chaud
enduit terre
mur pisé
Plan R+1 Source : Schéma et fond de plan personnels.
chambres espace de vie espace buanderie espace circulation
non chauffé jour nuit / chauffé passage
source de chaleur
Plan R+1 Source : Schéma et fond de plan personnels.
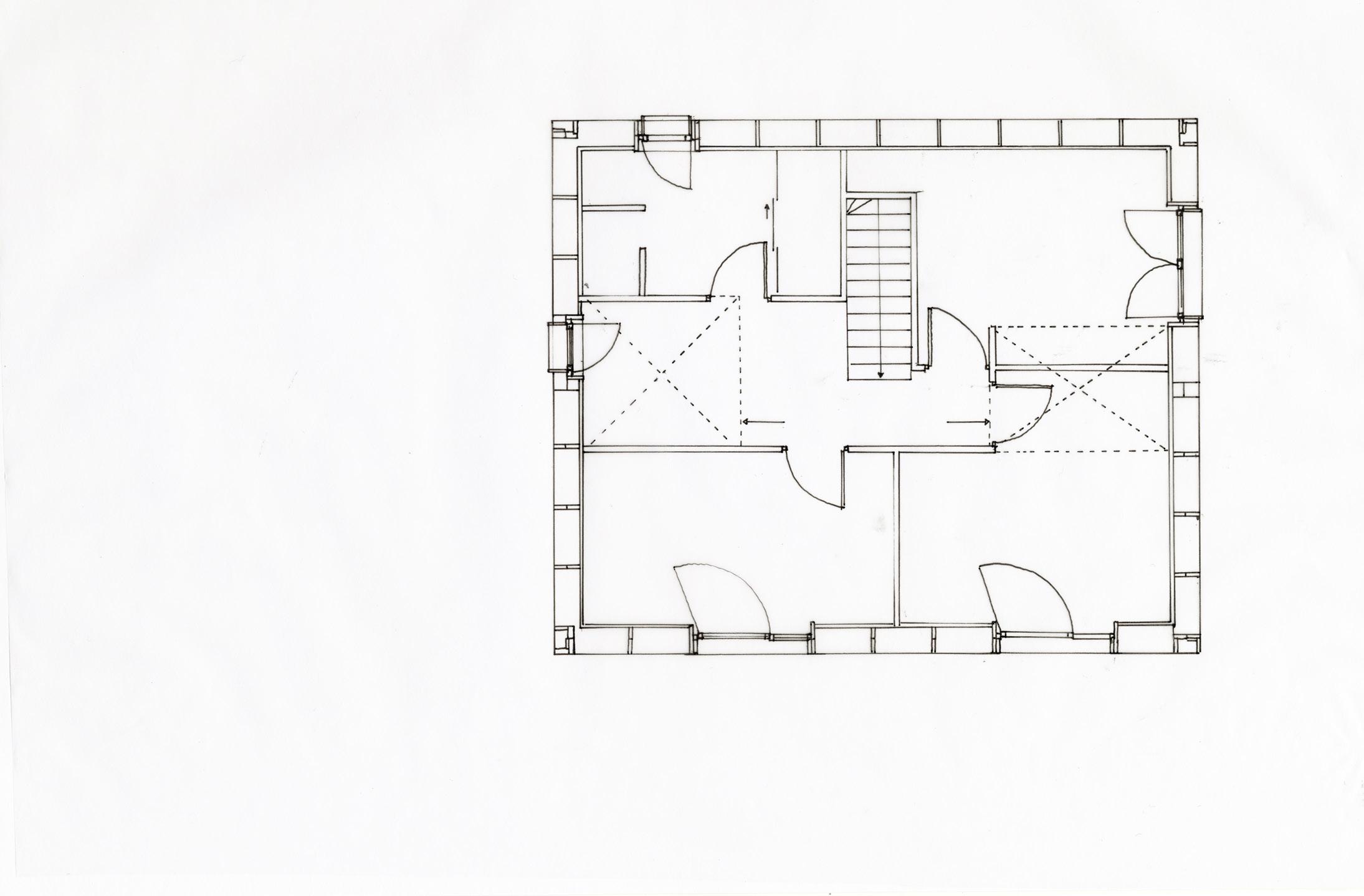
Matériaux et procédés constructif
Dans cette maison, comme beaucoup de projets réalisés par Caracol architecture, l’ossature est en bois et l’isolation en paille. Ensuite, il y a la terre en façade extérieure, mêlée à de la chaux. En revêtement intérieur, des murs sous la forme d’un enduit de 8 cm. Pour finir, au sol, on trouve un revêtement sous la forme d’un sol en terre damé et traité à l’huile de lin et térébenthine. On note aussi la présence du mur pisé au centre. Le bois et la paille constituent une enveloppe légère et des matériaux assez propres pour l’environnement. C’est la démarche recherchée. La terre est là pour ramener de l’inertie, elle régule la température et favorise le confort thermique en été comme en hiver. Le projet a vraiment été mené avec cette réflexion sur le choix des matériaux les plus confortables et éthiques dans leurs procédés constructifs et leur impact. De plus, le projet a en partie été réalisé en auto-construction, ce qui lui donne une dimension d’autant plus économe. D’ailleurs, beaucoup de choix techniques ont été faits selon cet objectif, notamment celui du système de ventilation qui a fait débat.
Entretien habitants Vimines, Damien Zisswiller :
Y a-t-il des dispositifs techniques? J’ai entendu parlé d’une histoire de ventilation double flux!
« Oui ! C’est Thomas qui vous en a parlé. Là-dessus c’est un point sur lequel on n’était pas forcément d’accord. On avait un ami (..) dont s’était le métier, il restait assez sceptique sur la qualité de l’air et du renouvellement de l’air. Thomas était partisan du « C’est pas grave, tu ouvres ta fenêtre le matin et tu renouvelles ton air ». Mon ami était plutôt dans l’idée de me dire qu’il était difficile d’avoir cette rigueur, d’ouvrir 10 minutes le matin pour renouveler l’air. Surtout en plein hiver quand il fait -10° dehors.(...) lui nous préconisait d’installer une ventilation mécanisée, pas vraiment double-flux mais plutôt bricolée… C’est une arrivée d’air qui arrive dans un petit caisson qui est préchauffer. C’est le truc qui n’est pas super propre quand même dans la maison, le fait qu’on fasse entrer de l’air extérieur chauffé par une petite résistance puis restitué dans les pièces à vivre.( ...) on a une colonne nord-ouest qui marche en extraction naturelle parce que, la maison étant mise en pression par l’arrivé d’air, il y a une extraction naturelle. Cela marche plutôt bien, on est contents et cela nous enlève l’idée d’ouvrir la fenêtre 10 minutes quand il fait
-10° dehors.
“Pour partie, on a été formés. Moi je suis un peu bricoleur et il y a des choses que je me sentais capables de faire et d’autres non !
Notamment sur la terre, on a collaboré avec le maçon terre. Il nous a formés sur les finitions terre durant une demi-journée et on a fait un demi pan de mur ensemble et ça ne lui posait pas de problème. Cela c’est la qualité de l’artisan qui fait que, d’ailleurs on a gardé de très bons contacts avec lui. ”
Entretien Caracol architecture Thomas Jay :
“ Eux voulaient absolument travailler la terre et avec beaucoup d’inertie. Ils avaient des amis qui avaient construit leur maison en habitat groupé, ossature bois et botte de paille, mais qui n’avaient pas travaillé la terre et avaient amené très peu d’inertie à l’intérieur du bâtiment, donc leurs amis étaient un peu déçus. Il leur manquait des parois chaudes pour stabiliser la température. (...) Ils ont fait une partie eux-mêmes : les enduits de finition sur les parois. Ils ont étés formés par l’entrepreneur Laurent Petrone. Il n’a pas trop trainé, en moins d’un an le chantier était boucler. A la fin, ils étaient assez contents, et ça fait un beau projet franchement, simple, compact…
Ils ont eu des idées d’économies, par exemple n’y a pas de dépasser de toitures. Ce sont eux qui m’ont demandé si c’était vraiment nécessaire, car ça représentait beaucoup de surface et de plus-values. (...) Je me souviens qu’au rez-de-chaussée, pour faire des économies, il y a assez peu d’ouvrant. Il y a quand même pas mal de fixes. C’est assez chouette, ça cale le paysage”

:



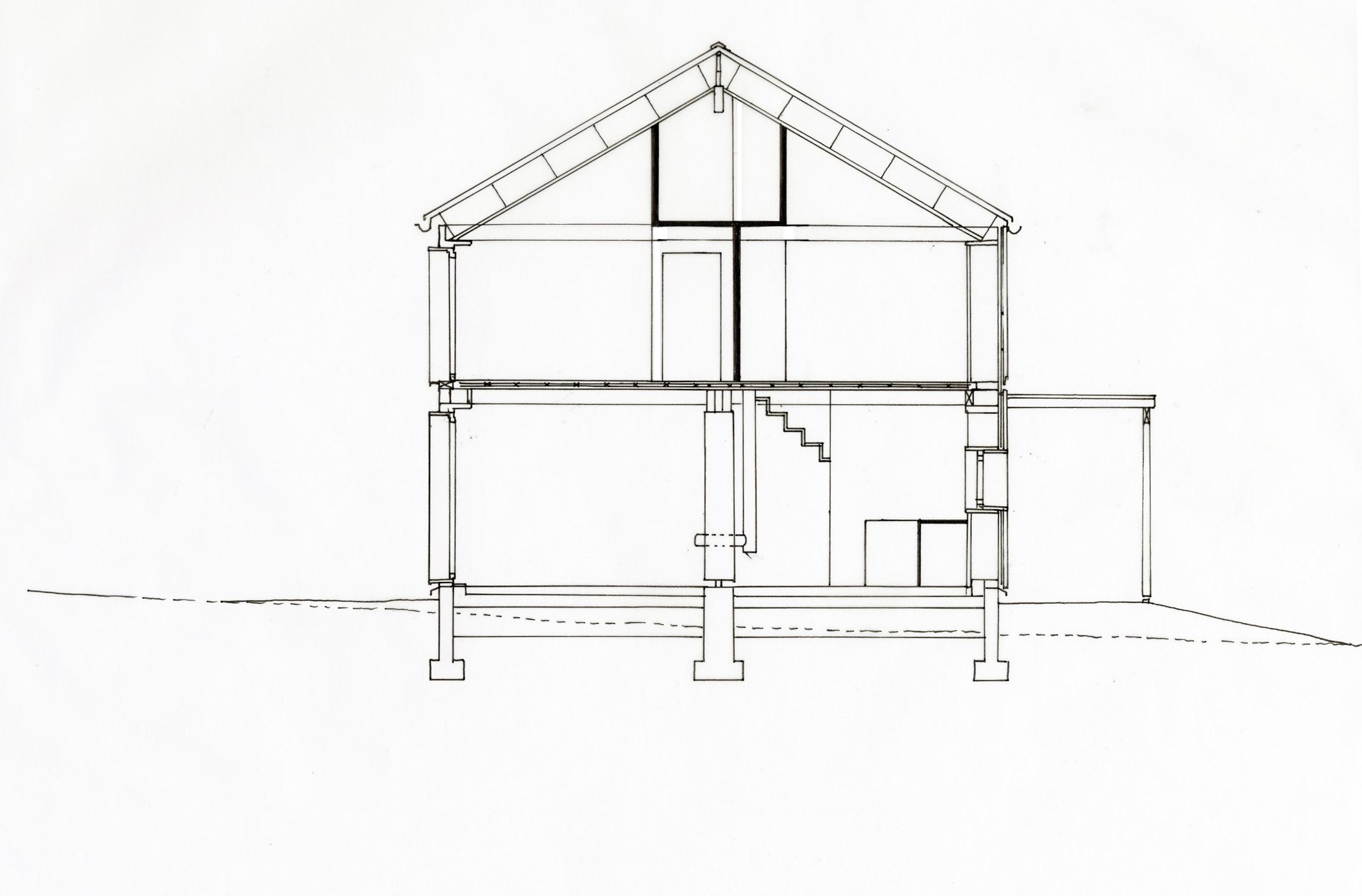
Photographies de chantier ,construction du mur pisé et revêtement intérieur en enduit terre.
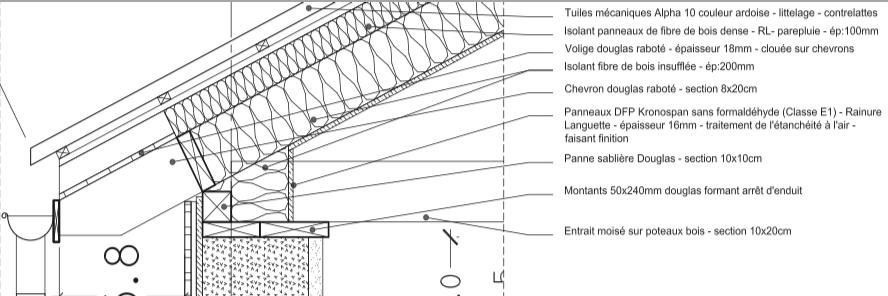
Photographie 1: Canise en bois et grille plastique revetement de façade.
Photographie 2 : Ouate de cellulose insuflé en toiture (papier recycler et gypse).
Source : production personnel réaliser lors d’une visite de chantier de Caracol architecture à St Ismier.
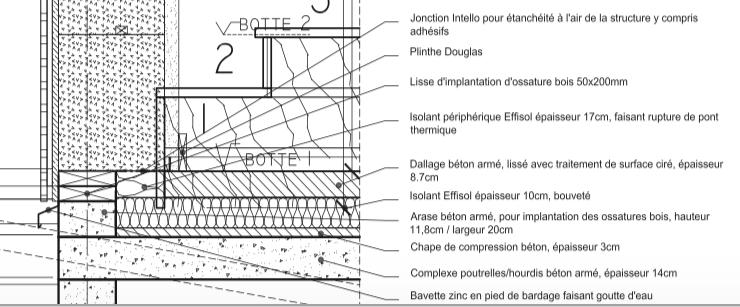
3. Analyse comparative
a) Consommation
Il est intéressant d’analyser, à travers ces trois projets, la question de la consommation telle qu’abordée dans la première partie de ce mémoire.
Dans le projet de rénovation et d’extension mené par l’Atelier de la Place à Corrençon-en-Vercors, la problématique est particulière du fait que le projet s’appuie sur un bâtiment existant. Ainsi, une logique d’économie de matière s’installe, puisqu’une grande partie des matériaux de construction est maintenue. En effet, la structure en maçonnerie est conservée, de même que l’ossature en bois, et ce sont seulement des matériaux pour rénover l’enveloppe qui s’ajoutent à l’existant. Dans cette logique économique, on note des changements dans les choix techniques qui ont eu lieu durant les travaux, notamment le maintien de l’isolation existante. De ce fait, la laine de verre, certes peu écologique mais en bon état, a été conservée pour consommer moins d’isolant en laine bois neuve. La consommation au cours de ce projet se justifie par une ambition de faire des compromis entre qualité et investissement. Néanmoins, une attention très particulière est portée au choix des filières de construction, et leur proximité exprime une volonté de faire marcher l’économie locale. De plus, ce choix a permis de diminuer l’impact carbone du projet dans sa consommation énergétique en termes de déplacements. L’objectif de ce projet n’était pas des performances en économie de consommation énergétique électrique, mais bien de retrouver un confort thermique raisonnable et de rendre le lieu moins énergivore. Pour autant, on note que la consommation électrique des habitants est restée équivalente, malgré l’augmentation de la surface habitable.
La maison de La Tronche conçue par Gasnier-Eco est, quant à elle, caractérisée par l’ambition de se placer dans une logique d’économie d’énergie, sur le poste de chauffage principalement. En effet, il s’agit de la définition même du logement passif, but visé par l’agence et les habitants. Cependant, il important de nuancer l’importance de cet objectif en rappelant qu’un compromis a été trouvé avec le confort. En théorie, comme le soulignent les architectes, une maison passive peut se passer de chauffage ; néanmoins, ce projet ne l’est pas réellement à cause du patio.
Ainsi, les habitants ont eu recours à un poêle à bois, par ailleurs relativement économe, comme le souligne la fille des habitants. Par ailleurs, la ventilation mécanique double-flux est nécessaire au confort car, grâce à la pompe à chaleur intégrée, elle permet de renouveler l’air et insuffler de l’air chaud dans les différentes pièces. Ce dispositif reste assez énergivore.
Le choix des matériaux pour la construction privilégie leur origine biosourcée. On note aussi la volonté d’une consommation de matériaux de qualité. Sur l’aspect des consommations énergétiques, le bâtiment est chauffé grâce à un poêle à bois.
Les choix spatiaux et architecturaux servent l’autonomie en éclairage et en chauffage de la maison. En effet, les nombreuses et larges baies vitrées orientées au sud et à l’est captent le rayonnement solaire et permettent d’éclairer la maison et d’économiser de l’énergie électrique.
Pour finir, concernant la maison de Vimines réalisée par Caracol architecture, la posture vis-à-vis des consommations est là-aussi différente. Une vraie logique d’économie s’installe à travers tout le projet. C’est le cas dans la construction, par le choix des matériaux et les techniques constructives. En effet, le bois et la paille sont renouvelables et font fonctionner un réseau d’artisans de proximité, avec des chantiers moins invasifs et artificialisants pour le site. De plus, la terre est un matériau organique qui peut faire l’objet de réemploi à l’infini pour un mur en pisé par exemple.
Dans ce projet très compact, la consommation de matériaux est limitée car l’espace est optimisé. Ces matériaux permettent de moins consommer car ils accroissent la maîtrise du confort thermique. La terre, notamment, apporte de l’inertie et régule l’hygrométrie. Un choix moins économique dans les consommations est d’installer une ventilation mécanique, cependant elle reste à extraction naturelle ce qui nuance cet aspect.
La conception est réellement annoncée comme bioclimatique, autant par le maitre d’œuvre que le maitre d’ouvrage. Ainsi, les choix conceptuels d’orientation de dimensionnement, de dispositifs techniques de protection, servent le projet et le rendent plus passif et donc économe. Ce projet a d’ailleurs fait l’objet d’une analyse de cycle de vie qui a mis en évidence un seuil de consommation largement en dessous des 15kwh par an par m2 annoncés pour le niveau passif. La facture de consommation électrique et en sac de granule pour le chauffage en témoigne d’ailleurs.
Comme le souligne l’article de la maison écologique, la maison se distingue aussi de ses voisines pour son confort d’été : « Là encore nos voisins nous envient, quand ils étouffent en pleine canicule, nous on ne dépasse pas les 25°C, le confort thermique estival devient un véritable enjeu, même en montagne ».
Corrençon-en-Vercors Rappel données techniques
Chauffage : Poêle à bois logement principale et radiateur éléctrique studio de location.
Ventillation : mécanique double flux
Eau Chaude Sanitaire : ballon éléctrique
Matériaux et procédès constructif : Existant mur en maconnerie et structure bois, maintient de la laine de verre.
Extension et rénovation en bois mélèze local. Charpente chevrons sur panne et isolation par ouate 280mm insufflée.
OSB + laine de bois 100mm pour l’ensemble des toitures (existant + extension).
Murs en ossature bois 200mm et ouate de cellulose insufflée. La Tronche Rappel données techniques
Chauffage : Poêle à bois, et petit apport par la VMC
Ventillation : Mécanique Compact. Système combiné entre pompe à chaleurs, ECS, ventillation mécanique en double flux.
Eau Chaude Sanitaire : ballon élécctrique
Matériaux et procédès constructif : Ossature bois isolation en ouate de cellulose. Bardage extérieur bois grisé et bois naturel pour le patio.
Intérieur finition bardage bois et plaque de plâtre.
Vimines Rappel données techniques
Chauffage : Poêle à pelé
Ventillation : Mécanique à extraction naturelle, resitance qui réchauffe l’air entrant.
Eau Chaude Sanitaire : Chauffe eau solaire avec panneau photovoltaic.
Matériaux et procédès constructif : Ossature bois douglas, paille (locale), enduit terre intérieur, enduit terre et chaud extérieur. Bardage bois élément de façade.
b) Usage
Après avoir abordé comment ces différents projets ont traité l’aspect de consommation, nous allons nous pencher sur les choix dans l’usage et le confort, comment ces problématiques sont abordées dans chacun de ces projets et quels sont les éléments à retenir.
En ce qui concerne le chalet rénové de Corrençon-en-Vercors, on peut affirmer que le confort thermique était le point qui a motivé l’ensemble de ce projet.
Néanmoins, il est intéressant de s’attarder sur la spécificité du rapport au confort des propriétaires. En effet, ils ont pris pour habitude de sacrifier le confort thermique pour le confort que représente ce lieu pour eux, lieu qui constitue facteur primordial dans leur ressenti. En effet, ce sont la beauté de l’emplacement et les qualités qu’il offre en termes de paysages et de calme qui ont donné à ses habitants envie de créer un habitat d’autant plus confortable et respectueux du cadre. Ainsi, le confort spatial et visuel participe grandement à leur appréciation du site et correspond, selon eux, à leur usage. Il est important de souligner ici que les propriétaires ne résident pas dans ce lieu, ce qui les rend plus tolérants. Les usages sont le point qui a permis d’arbitrer les choix techniques en matière de matériaux et de dispositifs. En effet, le bois a été sélectionné car il est effusif et chaleureux et s’inscrit dans la logique du site, dans une recherche de qualité et de confort. Il en est de même pour le poêle à bois central, qui favorise le rassemblement par le rayonnement et participe à l’ambiance et au confort. Ces choix ne se sont pas réellement inscrits dans l’ambition d’avoir une posture environnementale, mais plutôt dans la logique de répondre à une attente de confort en accord avec le lieu dans lequel s’installe ce projet, par intuition et déduction.
Concernant la maison de La Tronche, elle a été conçue dans le dialogue entre architecte et clients afin de correspondre parfaitement aux usages de ces derniers.
Premièrement, on note la recherche d’un confort spatial dans l’usage. En effet, les habitants ont indiqué dès le départ vouloir organiser l’espace de vie autour d’un patio, formant une pièce de vie extérieure supplémentaire en été. Ils voulaient aussi un rapport au paysage très fort et tourné vers la vue. Les espaces à l’étage, dans leur articulation et leurs volumes, sont soignés et chaleureux ; ils participent à la qualité du lieu.
Ainsi, ces choix de confort spatial et visuel ont été complémentaires au confort thermique fourni par l’apport en luminosité et en rayonnement solaire.
Néanmoins, dans les faits, ils ne sont pas totalement en accord avec un confort thermique optimal car ils génèrent une forme plus complexe, moins compacte, et plus difficile à chauffer uniformément. En effet, le poêle est le seul dispositif de chauffage, néanmoins dans l’usage il semblerait que sa position dans le salon ne diffuse pas bien la chaleur dans le reste du rez-de-chaussée. Dans cette même idée, l’habitante relève qu’en hiver la cuisine est un peu froide en raison de son éloignement vis-à-vis du poêle. Ainsi, dans l’usage, elle ne correspond pas vraiment à un lieu de repas.
On peut toutefois nuancer cet aspect en soulignant que cet inconvénient se module par l’usage plus intensif du poêle en période froide. En outre, pour le reste du projet, les dispositifs techniques choisis semblent correspondre. En effet, la VMC compacte qui fonctionne couplée à une pompe à chaleur et un ballon eau chaude sanitaire (ECG) permet d’augmenter le confort thermique et d’uniformiser la température des pièces. Le site dans lequel s’implante la maison est assez contrait par le vis-à-vis et la pente, mais le projet à su tirer parti de ces avantages pour générer du confort. En effet, il se protège des voisins et optimise la surface du terrain en s’enterrant et limitant la façade la plus au nord. Pour résumer, il semble important de souligner que le projet est un lieu jugé confortable et qualifié d’agréable par l’habitant, qui correspond aux envies projetées par la famille.
Le projet de Vimines propose une autre réponse pour gérer l’usage. En effet, dans cette maison, l’usage et la conception des espaces ont été déterminés par l’objectif d’avoir un lieu sain pour l’habitant, agréable et avec un impact minimal.
Tout d’abord, les matériaux comme la terre et le bois participent grandement à l’ambiance chaleureuse du lieu. De plus, ils influent sur le confort thermique et hygrométrique. De plus, la conception spatiale et architecturale met en évidence un bâtiment bioclimatique, bien orienté, qui favorise le confort visuel et thermique. Cette conception correspond aux attentes et aux usages de la famille dans le choix des dispositifs de chauffage et leurs consommations. En outre, cette maison possède des espaces dimensionnés et organisés selon les attentes de la famille et ses modes de vie.
Dans l’usage, on peut souligner certains choix potentiellement controversés comme la ventilation mécanique, qui chauffe l’air et consomme de l’énergie. Cependant, il faut souligner que ces choix sont en accord avec l’usage et le mode de vie.
A cet égard, l’habitant Damien Zisswiler souligne le rôle et la qualité qu’un architecte apporte en tant que conseiller et technicien. Il met en lumière le dialogue nécessaire à la conception d’un projet adapté à ses convictions et son mode de vie. En effet, dans ce projet, la part d’appropriation met en évidence la conception des usages, en parallèle des objectifs de qualité environnementale. En partie réalisé en auto-construction, l’implication des usagers est d’autant plus présente..
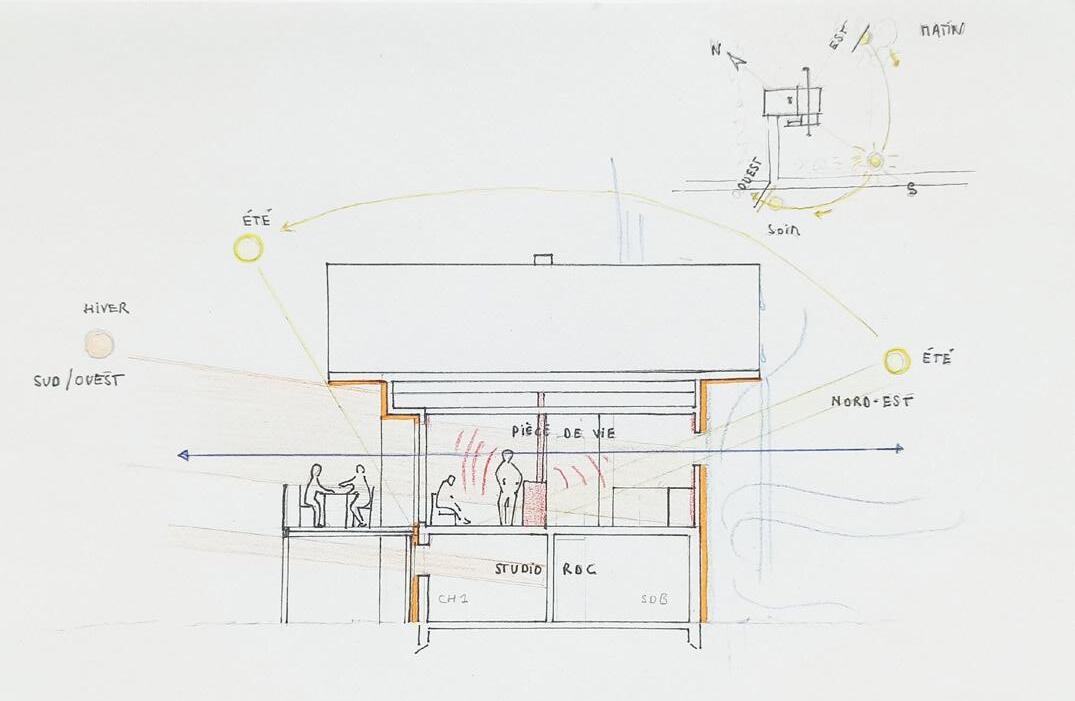
Source : production personnelle
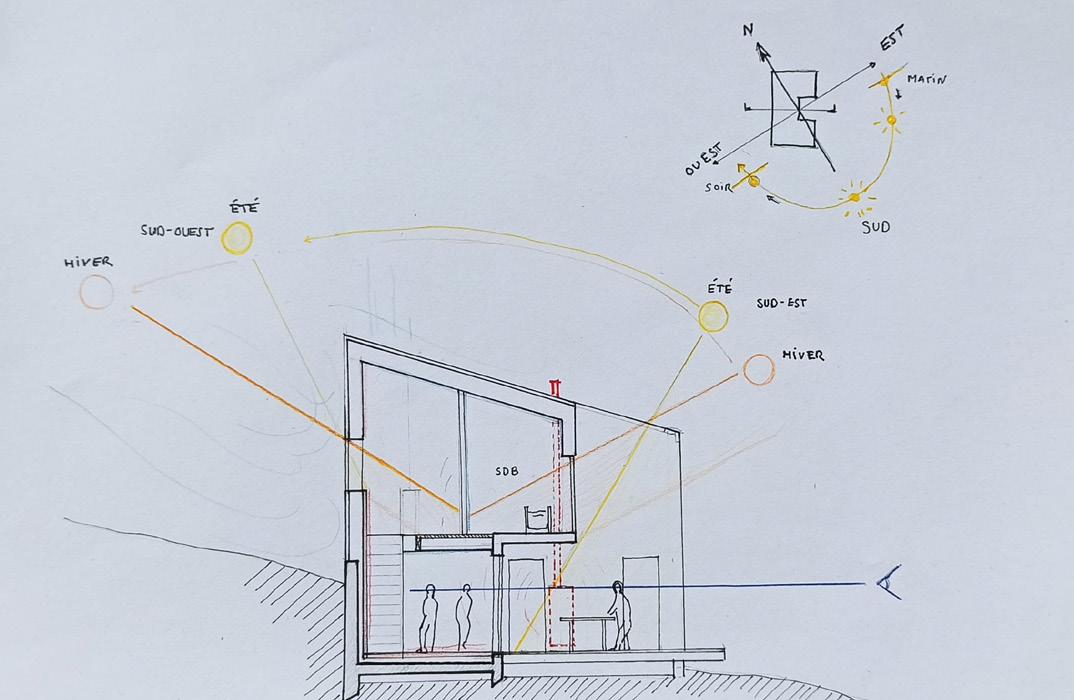
Source : production personnelle
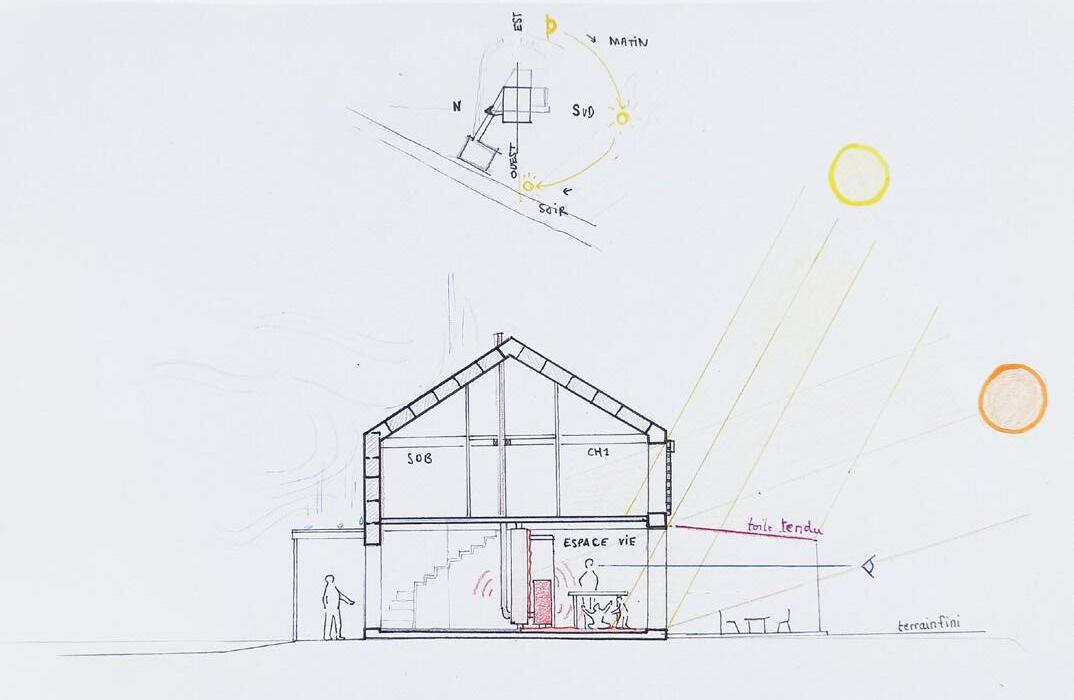
Source : production personnelle
c) Pérennité
- Apres avoir abordé les notions de consommations et d’usage il convient de questionner ses projet et lleur conception pour savoir si elle manipule la question de pérennité.
Le projet de Corrençon en Vercors comme nous l’avons souligner en parlant des consommations, est un projet de rénovation. Ainsi il parait évident que ce projet se bassant sur l’existant est plus pérenne. Il introduit la question du réemploi et de la durée de vie d’un batîment. Le choix de la rénovation est à nuancé car il l’implique un investissement économique et une étendue de travaux qui peuvent avoir un impact environementale fort.
Il est important de souligner que c’est le choix des matériaux, par leurs qualités et leurs provenances à proximité qui minise l’impact du projet et le rend plus durable.
Ainsi le bois est un matériau renouvellable, qui a la propriéé de stocker du Co2. De plus ill est simple de l’utilisé en réamploi. C’est un déchet qui a cycle de vie assez durable.
Dans le projet de Gasnier éco la question de la pérénnité du projet peut aussi être abordé et comparé à celle des autres projets.
Premièrement il s’agit d’une construction neuve. Ainsi tout les matériaux ont été acheminé jusqu’au site et mise en oeuvre pour réalisé un nouvel ouvrage. La maison reste de taille modeste néanmoins les espaces sont assez spacieux et la place n’est pas limité donc on peut dire la logique d’économie de matière n’est pas vriament présente dans ce projet. En quelques sorte cela le rend moins prérenne car il à consommer beaucoup de matéière à la construction. Deuxièmement concernant le choix des matériaux. Tout comme pour le chalet de correçon en vercors le bois a était privilégier. C’est assez qui rend le projet plus durable avec un impact carbone plus mesuré. Cependant, bien que le douglas soit une essence qui est classe trois et donc non traité et plus resistance dans le temps, il important de revelé que ce bois et as une proximité plus relative (dans la région Auvergnes-Rhones-Alpes 7% de la forêt de production). De plus le Douglas connais une popularité récente qui le mène à une crise de l’approvisionnement assez forte due a son utilisation plus intense.1 Dans un autre aspect il est intéressant de relevé que le système de chauffage au bois constitue un mode assez doux et peu énergivore quand il est combiné à une envellope thermique efficace. Néanmoins on peut se demander si le choix d’une ventillation mécanique implique pas une certaine dépendance énergétique ? Sur le long therme comment s’entretiennent ces machines, sont simple elle à réparer ? Pour finir les détails constructifs liées à la création d’une envelloppe très efficace et étanche implique une certaine complexité dans leurs mise en oeuvre et dessin. Comment vieillissent-ils ? Si ce type de bâtiment devait subir une rénovation ou extension serait-il accessible de remettre en état ?
Tous les points abordés aux travers ces deux projet son valablent et interresant à replacer dans le contexte de la maison de Vimines.
En effet ce projet en construction bois, paille et terre mobilise là encore des matériaux biosourcé qui le rendre plus propre dans son imprunte environementale. De plus l’introduction de la terre, rend le projet plus perenne sous différent aspect. Il laisse la possibilté du réemploie du mur pisé pour une futur construction par exemple, c’est qu’explique Thomas Jay au cours de nos échanges.
Ensuite la terre est un matériau robuste et qu’il s’entretien assez simplement, avec un peu de terre et d’eau. Néanmoins quand l’enduit et aditionné à la chaux, la réaction chiminique fige la matière et la rend inerte, elle devient un dechet plus complexe à recycler.
Toujours au niveau des matériaux choisient pour ce projet, la paille semble assez durable. Elle est d’origine naturel certe mais elle permet de réintroduuire des logique de filière courte dans l’approvisionement surtout pour des projets en milieu rural.
De plus ces matériaux participent comme nous l’avons vue au confort et au économies de consommation énergétique du bâtiment. Ainsi cela participe à son autonomie énergétique et donc ça perennité.
Bien que les techniques de construction semblent accessible et simple à mettre en oeuvre et il serait interressant de voir comment ce genre de batiment vieilli et se conserve au cours du temps.
1 Document les chiffres clefs de la filière foret bois auvergnes Rhones Alpes 2019. Source : fibois-aura.org
Coupe estimative impact environemental Corrençon-en-Vercors
Source : production personnelle
Coupe estimative impact environemental La Tronche
Source : production personnelle
Coupe estimative impact environemental Vimines
Source : production personnelle
CONCLUSION
4. Synthèse
Ces trois projets se dissocient par leurs différences. Il s’agit bien de trois maisons individuelles, mais elles varient dans leurs usages, dans un cas, il s’agit d’une maison de vacances tandis que les autres sont des lieux habiter au quotidien. De plus, l’un est un projet d’extension et de rénovation alors que les deux autres sont des maisons neuves. Ce sont des éléments à garder en tête pour bien comprendre les conclusions que l’on peut en tirer.
Cette analyse a mis en évidence les différentes postures adoptées concernant les consommations de chaque projet. Il apparaît que le choix des matériaux est le point qui influe majoritairement sur cet aspect. En effet, chacun de ces projets a choisi d’employer des matériaux biosourcés, renouvelable et durable. Le bois apparaît dans ces trois exemples comme une matière première qui correspond à l’intégration de la dimension environnementale. À la fois dans ses procédés de mises en œuvre et dans son accessibilité. Il est adapté à l’échelle du logement individuel. C’est un matériau polyvalent pouvant convenir autant en structure qu’en enveloppe. La terre introduite par le projet de Caracol met en évidence des questions de confort thermique et hygrométrique qui font écho à des points abordé en première partie de ce mémoire concernant le rôle de l’inertie d’un matériau.
La dimension des consommations énergétique mobilisée à l’usage des bâtiments est traitée très différemment selon chaque projet. Cela correspond à la fois aux méthodes de conception des agences et aux usages imager pour et par les habitants. Dans le projet de Corrençon, la motivation qui a fédéré la rénovation n’est pas la réduction des consommations énergétique, mais l’augmentation du confort. Tandis que dans les projets de La Tronche et Vimines avaient bien pour objectif d’avoir un impact plus faible dans les consommations énergétique. Cependant, c’est un point à nuancer, car dans l’usage et la conception la maison de la Tronche à privilégié le confort spatial tandis que le projet de Vimines, c’est concentré sur l’usage au profit des économies de consommations. Avec un objectif passif confortable-
ment atteint.
De plus, nous avons vu que les matériaux influencent grandement sur la notion de confort et d’usage. Car ils entretiennent l’ambiance visuelle, sonore et thermique d’un espace. Leurs capacités effusives les rendent plus chaleureux et augmentent le confort ressenti de ces lieux. Le bois joue ce rôle dans chacun des projets et la terre dans le projet de Vimines. Néanmoins, la maison de la Tronche et celle de Corrençon emploie des matériaux qui constituent des parois froides (plaque de plâtre).
Ensuite, le rapport entre le site et l’habitation a impacté beaucoup de choix dans le but d’intégré l’environnement à leurs postures. Notamment le cadre paysager (orientation, intégration) let le traitement des ressources.
Dans cet aspect un point intéressant à souligner est l’impact des choix de procédés constructifs et des matériaux sur le projet. Notamment sur le choix des entreprises, la proximité de la main d’œuvre et des ressources.
Pour finir l’analyse des projets en questionnant leur prise en compte de la pérennité a permis de mettre en évidence et de confirmer l’hypothèse qui se révèle dans cette synthèse.
L’analyse de la pérennité de ces ouvrages à permis de révélé une hypothèse qui émerge de l’ensemble de l’analyse. Il s’agit que là encore, les matériaux et les procédés constructifs influencent l’impact et la pérennité d’un projet. C’est-à-dire, dans leurs capacités à résister dans le temps leur nature et provenance.
Pour finir, dans chacun de ces projets un équilibre est recherché entre des consommation raisonnées, d’un impact mesuré et des choix d’usage fessant une balance entre confort spatial et thermique. Leurs objectifs communs étant bien de formuler un projet conscience de l’environnement.
Comme nous l’avons établi à travers la première partie de ce mémoire, la notion d’environnement est directement liée à l’architecture. Il s’agit du cadre dans lequel s’inscrit et évolue une construction, mais aussi l’homme, déterminant un rapport intrinsèque entre ces éléments, un dialogue et une interaction. La définition de l’architecture bioclimatique à permis de qualifier une architecture cherchant à se dissocier de l’architecture conventionnelle du 20e siècle marquée par l’industrialisation. En effet, celle-ci mêle architecture et climat. Pour cela, elle propose de concevoir en joignant une démarche passive à une conception qualitative dans l’usage et le confort. Nous pouvons retenir qu’elle développe des outils qui se penchent sur la compréhension et l’appropriation du site, dans ses contraintes et ses qualités afin d’en tirer profit. Cette conception s’appuie sur une recherche de confort principalement thermique, consciente du climat, des saisons et des stratégies pour obtenir des solutions adaptées à l’usage.
Deuxièmement la définition de ces notions et outils du bioclimatisme ont permis d’introduire un travail de réflexion sur la remise en cause de nos acquis en terme de conception environnementale. Concernant notre rapport à la consommation d’énergie et de ressource. Puis la définition du confort dans son rapport aux usages. Et enfin le caractère pérenne ou durable d’une construction, dans le choix des matériaux et de la mise en œuvre.
Maintenant, afin de répondre à la problématique définit en introduction de ce travail, soit : “Comment les outils du bioclimatisme permettent de questionner la conception environnementale dans l’habitat ?“. Il est intéressant de mettre en parallèle la première et la seconde partie de ce mémoire. En effet la deuxième partie à permis d’illustrer ces questionnements et de regarder à travers trois projets d’habitats, que signifie avoir une posture environnementale. Puis d’analyser ces projets au regard des trois points consommation, usage et pérennité.
Pour finir ce travail, on peut revenir sur les points qui ont principalement été questionnés. Pour cela, il est
intéressant de se pencher sur des extraits d’entretiens qui résument les questions abordées.
Premièrement, la définition des pratiques des agences met en évidence une intégration de la dimension environnementale.
Entretien avec agence Gasnier-ECO : Hugo : “ l’agence Gasnier-éco est une agence qui a été créée par Gérard Gasnier et qui est orientée, depuis le début, vers l’architecture écologique, même à un moment où les pratiques écologiques n’étaient pas encore très développées “.
Entretien avec l’agence Atelier de la Place : “ Oui, ça prend de la place tout de suite, dès les premiers mots et traits, puis tout au long du projet et du chantier. Tous les choix sont guidés par ça. A chaque fois qu’on doit faire un choix, on le met à la lumière de ce critère. Parfois, on fait des concessions, mais c’est toujours un arbitrage qu’on fait en conscience cette préoccupation.” Entretien avec Thomas Jay de Caracol architecture : “ L’agence existe depuis 2008, maintenant, on est 3 associés. On a dû faire une cinquantaine d’opérations. Il a une stagiaire qui va sûrement faire sa HMO avec nous. Depuis 15 ans, on essaie de travailler toujours de la même façon : l’ossature bois, remplissage en bottes de paille et puis les enduits terre, terre crue. Après, on travaille aussi pas mal avec la terre crue sous d’autres formes : le pisé, les murs en adobes, les murs en matériaux composites, terre, copeaux, terre coulée, les sols en terre. On essaye d’apporter de l’inertie et de la masse autant que possible dans nos bâtiments. On aborde les projets d’une manière technique, sur la technique constructive. “
Deuxièmement, le rapport aux réglementations thermiques met en évidence des opinions et des stratégies différentes. Néanmoins, c’est un aspect qui semble globalement reconnu aux yeux des trois agences, mais questionné dans sa logique et son application. Celle-ci va parfois en dépit du bon sens, suivant la stratégie adoptée.
Entretien avec agence Gasnier-ECO Gérard : « Il faut savoir qu’il y a encore des maisons qui se construisent sans l’attestation RT 2012 aujourd’hui, et les gens sont bien obligés de les habiter comme ça. C’est vraiment dommage d’ailleurs. Mais la RT fait évoluer les
promoteurs et constructeurs. Notamment l’étanchéité à l’air avec un test final, c’est quelque chose qui a vraiment fait évoluer à la fois les constructeurs et les entreprises, qu’ils sont obligés de vérifier et d’appliquer.”
Entretien avec Thomas Braive de l’Atelier de la Place : “J’ai envie d’être un peu radical en disant que ça ne sert à rien, mais ce n’est pas vrai. Donc disons que ça nous oblige à réfléchir et se positionner. Mais souvent, ça peut devenir une contrainte aberrante : on se retrouve à faire les choses à l’envers, en dépit du bon sens, ce qui est un peu dommage. La règle devrait servir à aller vers du positif, parfois, on a l’impression qu’on ne le fait pas bien. Ce n’est pas vraiment un outil de travail. Ça peut le devenir, mais il faut arriver à ne pas en être esclave... Mais on se plaint pas mal de la réglementation thermique, car elle se complexifie et elle est de plus en plus loin de la réalité, du terrain... Par exemple, un bâtiment qui n’est pas du tout biosourcé peut être très vertueux, et un qui est biosourcé peut-être considéré comme erratique, ce qui n’est pas normal d’un point de vue énergétique. Il y a problème qui est politique et économique, qui fait que les petites filières locales ne peuvent pas rentrer dans ce débat national.”
Entretien avec Thomas Jay de Caracol architecture : “ Franchement, je pense que dans l’ensemble, c’est plutôt bien, quand on a une approche conventionnelle. Il y a un niveau de performance plutôt intéressant. Mais je trouve que ça peut être aussi une contrainte quand on ne construit pas de manière conventionnelle, parce que cela crée des incohérences : les bâtiments ne fonctionnent pas de la même façon, presque à l’opposé l’un de l’autre… Typiquement, dans nos bâtiments, l’énergie, la chaleur sont contenues dans la masse à l’intérieur du bâtiment ; si le bâtiment n’est pas totalement étanche à l’air, cela ne nous embête pas parce que la chaleur n’est pas contenue dans l’air. Cela ne risque pas de le refroidir parce que la chaleur est contenue dans la masse. A contrario, dans les bâtiments conventionnels, il y a très peu de masse à l’intérieur et c’est l’air qu’il faut chauffer. Il y a beaucoup de clients qui laissent les fenêtres ouvertes toute l’années et ils n’ont pas de sensation de froid parce que le rayonnement des parois réchauffe automatiquement l’air qui rentre.”
Troisièmement, il y a un accord commun autour du choix de matériaux biosourcés. Concernant les procédés constructifs, on ressent une recherche de simplicité et un rapport à la localité.
Entretien avec agence Gasnier-ECO :
“On travaille en collaboration avec des gens qu’on a formés pour être performants dans cette démarche-là. On ne fait plus de concessions. » « Les matériaux et leur rareté, c’est quelque chose auquel on est de plus en plus sensibles. Cela va être de plus en plus contraignant, réglementairement. “
Entretien avec Thomas Jay de Caracol architecture : “On essaye autant que possible de travailler avec des matériaux qu’on trouve à proximité. La terre, ici, c’est assez simple parce qu’elle est bonne et, car c’est une tradition constructive du coin, donc il y en a suffisamment. Pour le bois, on travaille beaucoup avec le Douglas. Il n’est pas particulièrement local, il vient souvent des monts du Lyonnais et parcourt quand même 100 km… Et puis pour la paille, on travaille quasiment tout le temps avec les agriculteurs à proximité du chantier.”
Pour finir, l’usage se révèle être un élément qui fait évoluer les projets de manière déterminante, il implique le rôle du maître d’ouvrage, primordial dans la définition des objectifs.
Entretien avec l’agence Gasnier-ECO Gérard : “Oui, effectivement, même s’ils viennent très souvent avec des intentions, ils n’ont pas forcément toutes les connaissances, et c’est normal. Donc ça demande de faire de la pédagogie pour leur expliquer à quoi va ressembler leur maison, qu’est-ce qui va être différent, pourquoi ça va être vraiment mieux et pourquoi ça vaut le coup à tel moment de faire tel ou tel choix en termes de confort. Il y a toujours un moment où il faut argumenter, même s’ils ont des intentions à la base, ils ont aussi un budget et des contraintes, comme tout le monde. Il faut les aider à bien comprendre quelle est la démarche.”
Ainsi pour conclure ce travail et répondre à la problématique “Comment les outils du bioclimatisme permettent de questionner la conception environnementale dans l’habitat ?”. On peut répondre que la gestion des ressources et des procédés constructifs, au profit des usages introduits par une conscience du site et de son climat, est une manière de formuler des réponses adaptées à la recherche du confort.
BIBLIOGRAPHIE
• Cadoni (Gianluca), thèse « Les systèmes de rafraîchissement passifs dans l’architecture contemporaine et la conception bioclimatique du bâtiment. Méthodologie d’analyse et évaluation de réalisations à travers le monde. » ENSA Marseille, 2012
• Camous (Roger) & Watson (Donald) « L’habitat bioclimatique », éd. L’étincelle 1990
• Liébard (Alain), Ménard (Jean-Pierre), « Le grand livre de l’habitat solaire, 110 réalisations en France, Le développement durable à la portée de tous », Patrick Piro, éd. Observ’ER ; France, 2007.
• Madec (Philippe) Revue La Découverte, article : “Le sens de la nature dans l’oeuvre architectural”, 2002, p105 à119 disponible en ligne sur cairn info.
• Chatelet (Alain), Collaboration Brejon (Paul) et Fernandez (Pierre), « Architecture climatique, Une contribution au développement durable Tome 1 et 2 : Bases Physiques » ; éd. Édisud, 1994
• Courgey (Samuel) et Oliva (Jean-Pierre), « La conception bioclimatique, des maisons économes et confortables en neuf et en réhabilitation », éd. Terre vivante, 2006.
• De Lacour Sussac (Henri), Mémoire, « L’architecture bioclimatique, pour une meilleure manière de construire en Charente-Maritime » 2018, ENSAB.
• Drevet (Estelle), Mémoire, « Architecture bioclimatique et bien être en milieu urbain », 2015, ENSAG.
• Dutreix (Armand); « Bioclimatisme et performances énergétiques des bâtiments », éd. Eyrolles, 2010.
• Izard (Jean Louis) « Archi Bio » ; éd. Parenthèses, 1979.
• Liébard (Alain), De Herde (André),« Guide de l’architecture bioclimatique- éd. Systèmes solaires », volumes 1 & 2, de 1996 à 2004.
• Liébard (Alain), De Herde (André), « Traité d’architecture et d’urbanisme bioclimatiques : Concevoir, édifier et aménager avec le développement durable », éd. Observ’ER ; France, 2005.
• Mazria (Edward), « Le guide de l’énergie solaire passive » – éd. Parenthèses, 1979.
• Moréteau (Sylvain), « Le ba-ba de l’habitat écologique » ; éd. Rustica, 2009.
• Wright (David) « Manuel d’architecture naturelle »; éd. Parenthèses 2004.
• Fédération Française du Batîment, “Guide des matériaux biosourcés pour le batîment”,Novembre 2015/147 Disponible en ligne : www.ffbatiment. fr
• Thierry Joffroy, Arnaud Misse, Robert Celaire, Lalaina Rakotomalala, “Architecture bioclimatique et efficacité énergétique des batîments au sénégal. 2017.” Disponible en ligne : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02025559
• AURA,fibois, Document “Les chiffres clefs de la filière foret bois auvergnes Rhones Alpes 2019.” Disponible en ligne : fibois-aura.org
• Prisme (Programme International de Soutien à la Maîtrise de l’Énergie), rédigé par Frédéry Lavoye en collaboration avec André De Herde,« Architecture bioclimatique », janvier 2008.
• ADEME « Guide de l’éco-construction ». Document édité par l’Agence Régionale de l’Environnement en Lorraine, et l’Agence de l’eau RhinMeuse, en 2006.
• Infoclimat.fr
Historiques des températures, ensoleillement et précipitations ville La Tronche, Corrençon-en-Vercors et Chambéry. Consulté le 03/05/2021
• https://www.larousse.fr définition environnement dictionnaire en ligne Larousse Consulté le 14/03/21
• https://fr.wikipedia.org/wiki/Club_de_Rome définition du club de Rome. Consulté le 12/04/21
• heliorecflect.com
Diagramme solaire ville La Tronche, Corrençon-en-Vercors et Chambéry. Consulté le 03/05/2021
• https://www.ecologie.gouv.fr/energie-dans-batiments
Site du gouvernement sur les politiques environnementales et le secteur du bâtiment. Consulté le 14/03/21
• https://www.ademe.fr Consulté le 25/04/21
• Atelierdelaplace.fr Consulté le 15/05/21
• https://www.gasnier-eco.fr Consulté le 15/05/21
• http://www.caracol-architectures.com Consulté le 15/05/21
Interview Gasnier-Eco, Hugo et Gérard Gasnier , avril 2021
Maison : La Tronche, maison passive Entretiens Agence du corpus : (réalisés personnellement)
Interview Atelier de la Place, Thomas Braive , mars 2021
Maison : « REHABILITATION CHALET A CORRENCON-EN-VERCORS (38) »
Interview Caracol architecture, Thomas Jay, avril 2021
Maison : «Maison Z+H, Passive à Vimines »
Entretiens Habitant : (réalisés personnellement)
Interview Habitant Corrençon-en-Vercors, Monsieur et Madame Richard, mars 2021.
Maison : « REHABILITATION CHALET A CORRENCON-EN-VERCORS (38) »
Interview Habitant Vimines, Damien ZissWiller, mai 2021.
Maison : «Maison Z+H, Passive à Vimines »
Photographies des projets :
Photographies Source : Atelierdelaplace.fr et Thomas Braive
Maison : « REHABILITATION CHALET A CORRENCON-EN-VERCORS (38) »
Photographies, Source : Damien ZissWiller
Maison : «Maison Z+H, Passive à Vimines »
Photographies, Source : Damien ZissWiller
Maison : «Maison Z+H, Passive à Vimines »
Interview Gasnier-Eco, Hugo et Gérard Gasnier
Maison : La Tronche, maison passive.
Partie 1 Pratique et expérience
Comment vous définiriez votre agence et votre manière de travailler (équipe, pluridisciplinaire…) ? Dans cette idée, quelle est votre formation ?
Hugo : « l’agence Gasnier-éco est une agence qui a été créée par Gérard Gasnier et qui est orientée, depuis le début, vers l’architecture écologique, même à un moment où les pratiques écologiques n’étaient pas encore très développées. Le démarrage et le tournant dynamique s’est fait en même temps que celui qu’il y a eu avec le CAUE et Serge le Gros, avec Créabois, et Lambourou, un groupe d’architectes autour de la construction bois. Il y a eu des moments forts, comme un voyage dans le Vorarlberg où Gérard a fait la rencontre de personnes engagées, conscientes, qui s’interrogeaient sur comment mettre en place l’ingénierie nécessaire pour pouvoir réaliser des maisons passives. Il y a eu les « Assises de la maisons passive », en parallèle du salon du bois, en 2009. C’est l’année où Gérard a gagné le prix de la maison que tu avais identifiée au départ. (Maison passive écologique à Bernin avec le label BBC, réalisée en 2009.)
Ce qui intéressant c’est de voir comment on a évolué et progressé depuis, parce que le démarrage s’est fait à une époque où il était compliqué de trouver des matériaux écologiques. Aujourd’hui, ça parait invraisemblable, mais par exemple l’isolant en fibre de bois n’existait pas, idem pour des entreprises compétentes sur ces questions. En fait c’était un engagement de l’agence de partir dans cette direction. »
Gérard : « Aujourd’hui, c’est un peu plus la norme. C’était long, il y a eu des pionniers, des essais, mais qui avaient quand même du mal à se généraliser, donc c’était compliqué. J’avais la volonté depuis longtemps, mais pour la mettre en œuvre il a fallu qu’il y ait cette conjonction de moyens, de compétences et de volontés, y compris de la part des clients. Sans eux, on ne travaillerait évidemment pas, il faut le garder à l’esprit. Je me souviens qu’à cette époque-là, des clients m’ont qu’ils voulaient une maison passive, et moi je ne savais pas encore vraiment faire mais j’ai quand même accepté car le concept m’intéressait et ça me paraissait faisable. Heureusement qu’il y a eu ça pour nous motiver à trouver des solutions et s’entourer des bonnes compétences. »
Hugo : « Aujourd’hui, l’agence fait beaucoup de maisons
Date : avril 2021
individuelles qui sont presque toutes au niveau passif ou proche, mais aucune n’est labélisée ou certifiée. »
Gérard : « On reviendra dessus, mais c’est vrai qu’on peut aussi faire de la maison passive sans utiliser des matériaux sains et écologique. En France, il y a l’association de la Maison passive France, qui fait la labélisation des projets. Ils ne sont pas forcément orientés matériaux écologiques. Pour eux, faire une maison passive isolée en polystyrène et avec des menuiseries PVC, si c’est performant, ça marche. Ils vous suggèrent même, si vous n’arrivez pas à faire du passif avec des matériaux naturels, d’en employer d’autres. Même si c’est vrai que la question des matériaux écologique est souvent associée à la maison passive, c’est pas toujours le cas. Nous on combine les deux. Les gens sont sensibilisés à la qualité de vie, donc ils ne veulent plus de matériaux nocifs. Ils veulent des matériaux respectueux pour eux, leur santé, et pour limiter leur impact sur l’environnement, sur la planète, et toutes ces choses convergent effectivement, mais elles sont parfois dissociées. »
Hugo : « donc ce sont deux choses qu’on traite dans l’agence mais c’est vrai qu’il peut y avoir des agences qui les traitent séparément. Effectivement on travaille la maison ossature bois mais aussi en botte de paille. On fait aussi des enduits terres, on a une palette de matériaux vraiment variés, et des artisans qui sont associés à ces savoirs faire »
Gérard : « On travaille en collaboration avec des gens qu’on a formés pour être performants dans cette démarche-là. On ne fait plus de concessions. »
2) Quelle est la place de l’environnement dans votre conception ?
Hugo : « C’est sûr qu’elle est centrale. C’est vrai qu’aujourd’hui, le fait de s’afficher et de s’engager d’un point de vue environnemental fait que les gens viennent nous voir pour ça. Aujourd’hui quand on décroche le téléphone, à moins qu’il s’agisse de quelqu’un qui s’est vraiment trompé, les clients viennent nous voir parce que c’est ce qu’ils recherchent. On le voit en ce moment et depuis un certain nombre d’années, il y a un engouement. »
Gérard : « C’est vrai qu’il y a 15-20 ans on passait beaucoup de temps à expliquer ce qu’on faisait et à présenter, alors que maintenant on a plus à le faire. Les gens sont informés par les réseaux, par internet et par les médias…
On passe moins de temps à expliquer. »
- Est-ce une dimension que vous intégrez dès la phase esquisse ? Si oui, est-ce que vous pourriez énoncer les outils qui sont employés ?
Hugo : « Déjà, il y a le fait d’aller sur le site pour bien en prendre connaissance, mais ça c’est une chose basique. Aujourd’hui, je ne pense pas qu’il y ait des architectes qui conçoivent sans aller sur le site. Après, il y a tout un travail sur la question du bioclimatique, le premier jalon : orienter correctement son bâtiment, prendre au maximum la lumière… On a toujours en tête de rester sur quelque chose d’extrêmement simple en termes de conception et en structure avec une base étanche à l’air et isolée, ce sont les deux éléments qui sont importants pour la construction passive. Cela n’empêche pas d’avoir des choses qui font que le bâtiment ait une vraie identité, un décroché dans la façade, etc., mais on reste sur quelque chose qui est le plus pragmatique possible en termes de volume… Cela va dans le sens qu’effectivement l’architecture aujourd’hui n’es pas faite pour dépenser de l’énergie pour rien, mais pour rester assez frugale. Mais malgré tout ça permet d’apporter une vraie richesse derrière, en termes d’usage, et c’est toujours assez central.»
Gérard : « C’est là que le rôle de l’architecte est, trouver un équilibre entre sobriété, simplicité de l’enveloppe, technique, et offrir le maximum en qualité spatiale, usage et de lieu de vie. »
Hugo : « On le voit très bien dans ce projet justement : la maison n’est pas très grande en termes de surface mais chaque endroit apporte des qualités différentes. Mais ce n’est pas vraiment à la base de la démarche passive, c’est plus la question de l’enveloppe et de l’isolation et cela ce sont des choses qu’on maîtrise parce qu’on a l’habitude.
Gérard : « Nous, on a ce souci de qualité architecturale, parce qu’on peut faire des maisons passives très « moches ». D’ailleurs, au départ, c’est une démarche très technique initiée par des ingénieurs : la maison calculée pour arriver à un niveau de performance à 15kwh/m2. C’est vrai que les clients veulent en général des maisons très ouvertes, très lumineuses, avec une relation intérieur-extérieur, ces concepts-là...
Des études thermiques, avant ? Pas trop… Pour être clair on n’a jamais fait de maison labélisée passive parce que justement cela a un cout de faire la labélisation et il n’y
a pas d’aide financière pour ça, c’est juste pour avoir les étiquettes, donc les gens ne le font pas. On ne fait pas de maisons vraiment calculées passives, sauf si les clients nous le demandent, dans ce cas on peut le faire faire par des bureaux d’études. Mais nous, on les calcule à la RT 2012, ce qui est demandé aujourd’hui pour les maisons neuves, et cela se voit à travers les besoins de chauffage qui deviennent vraiment ridicules.»
3) Selon vous, la dimension environnementale est-elle primordiale dans le projet par rapport :
- Au paysage et au site (intégration, matérialité, orientation, implantation, perméabilité) ?
- A l’usage et au confort (dans les outils manipulés pour se protéger du froid, de la chaleur) ?
- Aux ressources, leur rareté, et leur dimension épuisable (biosourcé, provenance, etc.) ?
- A l’impact environnemental des matériaux ?
Gérard : « Les matériaux et leur rareté, c’est quelque chose auquel on est de plus en plus sensibles. Cela va être de plus en plus contraignant, réglementairement. »
Hugo : « C’est vrai qu’il y a un peu ces trois dimensions : les matériaux, les usages et le paysage. Ce sont des choses qu’on traite mais c’est vrai que c’est aussi en fonction des projets. Sur les matériaux, on est très exigeants et toujours à l’affut de choses intéressantes… Les isolants, on est toujours avec du naturel. Les bois, on essaye de trouver le plus local possible. On travaille aussi avec des démarches et des artisans qui sont du coin.»
Gérard : « On fait les détails ensemble et du coup c’est ça qui permet une vraie qualité dans la réalisation derrière. L’architecture ne s’arrête pas qu’au trait. Derrière, il y a un vrai travail de réalisation, de manière collaborative, avec tous les artisans. Mais oui, la dimension environnementale se reflète est à travers tous ces aspects. Ça valorise même les artisans, ça leur permet de ne pas travailler avec des choses qui les mettent leur santé en danger. Le fait d’avoir une démarche éco-responsable alimente chaque étapes et échelle du projet. »
4) Qu’elle est votre définition de la maison passive ?
Hugo : « Ma définition, c’est limiter au maximum le besoin de chauffage, et cela ça se fait techniquement. Déjà, par une conception bioclimatique, une enveloppe simple et
une isolation performante, comme cela on arrive à des optimums un peu supérieurs. On est en triple vitrage, avec des ventilations double-flux qui permettent de renouveler l’air. Disons que c’est la partie un peu plus technique. C’est obligatoire avec la RT 2012, de tester l’étanchéité à l’air des maisons. Cela embête pas mal de gens, alors que nous on le fait déjà depuis plusieurs années. »
Quel est l’enjeu de la maison passive selon vous ?
Hugo : « Premièrement, des maisons confortables pour les gens. En tant qu’architectes, ces éléments qui peuvent être contraignants ne doivent pas devenir pas des obstacles à la création architecturale et aux résultats. Nous, on prend ça plutôt à contrepied et on les valorise. On en fait un atout et cela mène à faire des maisons qui sont plutôt confortables. D’ailleurs les clients nous le disent, on a beaucoup de retours là-dessus.»
Gérard : « Les détracteurs de la maison passive, au début, parlaient de maison Tupperware. L’étanchéité à l’air, ils trouvent que c’est superflu. Les clients sont surpris de la qualité et du confort que ça leur amène, et ça ne les empêche pas de vivre. On entend souvent qu’il ne faut pas ouvrir les fenêtres. C’est faux, ce n’est pas interdit, on peut très bien le faire. C’est juste que s’il fait -10° quand on ouvre les fenêtres on va refroidir la maison donc c’est un choix. Mais si on a cette enveloppe étanche et un système performant pour assurer le renouvellement d’air, on n’a pas besoin de les ouvrir. L’enjeu a vraiment évolué parce que maintenant les gens sont intéressés par ces démarches-là, du coup aujourd’hui le but est de faire des maisons qui consomment le moins d’énergie possible. »
Est-ce que vous avez pour habitude de travailler avec des bureaux d’études ou collaborer avec des ingénieurs thermiques ?
Gérard : « Systématiquement, c’est un atout et un partenaire et, si on a des doutes, il y a toujours des allers-retours avec eux, des recherches pour optimiser des choses »
Hugo : « Ce n’est pas seulement vrai pour l’aspect thermique, il y a aussi les bureaux d’études de structure bois. Ils permettent d’optimiser les matériaux, la quantité de matière. L’énergie grise permet d’optimiser, c’est obligatoire. »
Est-ce que les réglementations thermiques sont un outil, une nécessité ou bien est-ce un frein/une contrainte dans votre travail ?
Hugo : « Pour la RT 2012 et la prochaine RE pour nous ce ne sont pas des contraintes puisqu’on est déjà dedans. Ce qui risque d’être plus contraignant, avec la RE c’est de devoir fournir une justification. Cela engendrera surement des études supplémentaires et des coûts pour les clients. Mais en termes de performance on est déjà bons pour la RE donc il n’y aura pas de problèmes.
Après, il y a encore de grands débats en ce moment, par exemple est-ce que le bois va être comptabilisé comme un élément qui stocke le carbone ou pas ? Il y des matériaux qui n’auront pas de fiches FDES non plus. Bref, la RT2012 ça va, c’est un premier pas vers la performance thermique, on a toujours été au-delà. Quant à la RE 2020, ce sera un peu plus contraignant mais nous n’avons pas de problème avec ça. »
Selon vous, servent-elles l’enjeu environnemental ou sont-elles sources d’incohérence ?
Gérard : « Il faut savoir qu’il y a encore des maisons qui se construisent sans l’attestation RT 2012 aujourd’hui, et les gens sont bien obligés de les habiter comme ça. C’est vraiment dommage d’ailleurs. Mais la RT fait évoluer les promoteurs et constructeurs. Notamment l’étanchéité à l’air avec un test final, c’est quelque chose qui a vraiment fait évoluer à la fois les constructeurs et les entreprises, qu’ils sont obligés de vérifier et d’appliquer. Désormais, ceux qui sont intelligents se disent qu’il vaut mieux bien faire le travail dès le départ. Je le dis toujours, mais avec la maison passive on n’a pas inventé des choses fondamentalement différentes, ce sont toujours les mêmes métiers, mais avec une prise de conscience sur où on veut aller, tous ensemble, pour arriver à l’enjeu et l’objectif du client. Ceux qui n’ont pas compris ça sont mal barrés. Je pense que ça a quand même fait évoluer la mentalité des artisans. »
Est-ce que vous accordez de l’importance à sensibiliser vos clients, même s’ils ne viennent pas avec l’intention d’apporter une dimension environnementale à leur projet ?
Gérard : « Oui effectivement, même s’ils viennent très sou-
vent avec des intentions ils n’ont pas forcément toutes les connaissances, et c’est normal. Donc ça demande de faire de la pédagogie pour leur expliquer à quoi va ressembler leur maison, qu’est-ce qui va être différent, pourquoi ça va être vraiment mieux et pourquoi ça vaut le coup à tel moment de faire tel ou tel choix en termes de confort. Il y a toujours un moment où il faut argumenter, même s’ils ont des intentions à la base, ils ont aussi un budget et des contraintes, comme tout le monde. Il faut les aider à bien comprendre quelle est la démarche. Il y a toujours plein d’idées reçues, même chez ceux qui ont déjà lu plein de livres sur le sujet. Parfois c’est n’importe quoi et on essaye de recadrer. En fait, ce n’est pas si compliqué que ça ; c’est cela qu’il faut arriver à faire comprendre aux clients. Par exemple, parfois ils nous demandent de faire une maison positive. Ça nous amuse parce qu’une maison positive c’est facile à faire sans être performant sur l’enveloppe. Avec des panneaux solaires photovoltaïques sur le toit on est tout de suite positif. On n’est pas du tout dans cette démarche. Avant de faire une maison positive, on veut d’abord faire une maison très performante pour vraiment réduire les consommations. Si, en plus, on peut se payer du photovoltaïque, tant mieux, c’est un peu la cerise sur le gâteau, mais typiquement ça ne fait pas partie du projet. Souvent ils le font après. Il y a des gens pour qui les maisons positives c’est top. »
Hugo: « Et nous on réexplique tout ! »
Quel est votre opinion sur la formation au métier d’architecte vis à vis de la dimension environnementale ?
Gérard : « A l’époque, il y a trente-cinq ans, il y avait déjà des cours de thermique, et ça me passionnait (…) On calculait nos maisons avec les mêmes principes de calcul, mais bon beaucoup moins performants et aboutis. On était quand même déjà bien sensibilisés à ça. C’était des cours non obligatoires mais on y allait quand même, et c’était intéressant. »
Hugo : « Moi j’enseigne en première année, en master aussi AE&CC, et je bosse pour le laboratoire CRAterre. Je pense qu’à Grenoble on est plutôt bien lotis. Il y a de bons enseignants comme Jacques Felix-Faure, il y pas mal de gens qui sont engagés dans ces démarches-là et ça joue. J’ai vu les autres écoles d’architecture et c’est vrai que Grenoble c’est un peu une exception au niveau du territoire. Cette dynamique autour de Grenoble est
liée à la dynamique professionnelle dans les agences qu’il y avait, à l’époque, avec le CAUE et des enseignants à l’école et des laboratoires de recherche historique comme CRAterre, montagne, tout ça a constitué une dynamique toujours présente à Grenoble. »
Partie 2 Le projet
Si vous pouviez résumer en quelque point principaux ce projet, quels seraient-ils ?
Gérard : « Le projet est pour une famille recomposée avec juste un jeune enfant. Il n’y a en fait pas un gros besoin en nombre de pièces. Il n’y a que deux chambres, une mezzanine et un grand espace de vie. Les clients étaient très attachés à la qualité de cet espace de vie, très lumineux. Dès le départ il y avait cette volonté, de leur part, d’avoir un patio intérieur entre deux pièces, par rapport à des choses qu’ils avaient vues.
Quand on est sur le site, il y a quelques maisons autour. Ils avaient vraiment le souhait de ne pas être à la vue de tout le monde lorsqu’ils sortaient de chez eux, et de se ménager un petit coin terrasse à l’abri des regards. La maison n’est pas plein sud, elle est orientée vers la vue Sud-Est. La forme est une base rectangulaire simple avec juste un décroché. Il y a un jeu de toiture intéressant grâce au faitage décalé et en biais, ce qui permet de générer ces volumes avec un aspect qui crée des biais. Ainsi, il n’y a pas vraiment de pignon, toutes les façades ont des biais, et cela génère des volumes entre le salon et la mezzanine et un volume suffisant pour aménager les chambres et les parties habitables. »
I/ Ressources (matériaux)
Quels sont les matériaux qui constituent ce projet ?
« L’ossature est en bois, c’est du Douglas. Le bardage c’est aussi du Douglas avec deux textures différentes. L’enveloppe extérieure est en bardage grisé, traité en usine (grisement de surface). Le patio est resté naturel sur les parties où il est a priori plus protégé et moins exposé aux intempéries, pour garder ce contraste. Dans les mus et toiture nous avons utilisé de la ouate de cellulose. L’escalier en voute sarrasine est en brique. C’est une technique qui permet d’avoir un escalier maçonné avec des briques et du plâtre sur une voute avant de refaire des marches. Il n’y a pas de béton, pas de ferraille, et c’est très léger et simple avec une légère courbe.
Cela permet d’avoir les planchers en bois apparent entre le rez-de-chaussée et l’étage. Le bois est resté apparent dedans. Le mur qui monte à l’étage est en bois.»
Apporter des spécificités et la raison qui a motivé ce choix (dimension environnementale,provenance, intégration paysagère, culture constructive). Pourquoi le choix de ces matériaux ?
« En général, c’est nous qui proposons. Le bois, le Douglas par exemple. En ce moment, il y a une pénurie et on ne sait pas trop comment on va faire pour continuer à construire. Le choix du Douglas c’est pour travailler avec du bois non traité, comme il est classe 3, donc pour des raisons de santé, et puis ça permet de le mettre en intérieur comme en extérieur. Aujourd’hui ça nous arrive de travailler avec d’autres essences sur certains projets.»
II/ L’usage et le confort
En phase esquisse, le dessin de l’organisation spatiale a-t-il été motivé par des qualités dites bioclimatiques (orientation, exposition, site, climat) ?
« Autour du patio, il y a un demi-niveau dans le salon. Il y a un vrai avantage, c’est que lorsqu’il fait froid ils font le tour, mais en été c’est ouvert partout et ils circulent. Le patio c’est une vraie troisième pièce à vivre. Elle est beaucoup utilisée comme elle est couverte.»
La conception de ce projet était-elle motivée par des objectifs “énergétique” de consommation ?(chauffage) «Oui.»
Quels sont les dispositifs techniques mis en place dans ce projet ?(chaudière, ventilation double flux)
Gérard : « Il y a une VMC compacte. En France ça n’existe pas, ça vient du Danemark. Elle a un système de double-flux avec un chauffe-eau et une pompe à chaleur intégrés. Ainsi, elle permet de chauffer l’eau chaude et de préchauffer l’air qu’on réinsuffle dans toutes les pièces, salon, séjour et chambre. Ce sont des machines qui ont été développées par les concepteurs de la maison passive.
Le concept de la maison passive c’est d’arriver à un niveau de performance, les fameux 15kw/h/m², qui nous permettent de se passer de chauffage. C’est-à-dire que dans une maison passive, on n’aurait même plus beso-
in de poêle. Donc la Vmc permet de constituer le petit point de chauffage dont on a besoin de 2kw/H . La machine consomme 400w et elle produit 2kw de chaleur et ça peut être suffisant pour une maison passive. D’ailleurs, au début, quand on a commencé à faire des maisons passives et des maisons étanches, on avait des problèmes parce qu’on ne pouvait pas mettre des poêles dans les maisons parce que les conduit de cheminée traversent l’isolant et l’étanchéité à l’air. On n’avait pas encore trouvé de solution pour gérer à la fois l’étanchéité et l’isolation, c’est-à-dire qu’il fallait laisser un vide d’air entre le conduit de fumée et l’isolant, ce qui causait des fuites. Donc on était réellement obligés de ne pas mettre de poêle si on voulait faire une maison passive. Les gens sont enchantés, ils n’ont pas de poêle. On les appelle aussi, par abus de langage, les maisons sans chauffage. Plus tard, ils ont réussi à trouver un système pour rendre étanche les conduits de fumée. Il y a des blocs de laine de roche aux endroits où ces conduits traversent l’isolant, matériau qu’on n’avait pas le droit d’utiliser à l’époque. (…) A un moment donné il faut faire la part des choses entre l’investissement et le retour aussi. »
Hugo : « Ce n’est pas une idéologie, il faut rester dans quelque chose de pragmatique et de logique, à la fois en termes d’usage et d’investissement dans les isolants. Il ne faut pas être fou de la maison passive. La maison n’est pas forcement efficace en termes de performance mais par contre en termes d’usage, il n’y a pas photo. Il faut jouer avec chaque curseur pour trouver la maison la plus équilibrée, de ce point de vue-là. “
Y a t-il un rapport entre investissement économique et économie d’énergie ?
Hugo : « Non, ça nous ne le faisons pas, on ne compare pas, n’utilise pas le témoin performance. On ne sait pas calculer l’amortissement de l’investissement qu’on fait sur l’enveloppe pour consommer moins d’énergie. Par rapport à un besoin de chauffage, ce n’est pas important parce qu’on ne peut pas vraiment se projeter sur l’accès à l’énergie dans quelques années. »
Gérard : « En même temps si, le diagnostiqueur calcul les consommations avec un estimation l’évolution des énergies, c’est quand il faut justifier quand on fait des réhabilitations thermique, des isolation par l’extérieur ou retraiter de tout l’enveloppe. Dans ce cas a on se fait accompagner d’un diagnostiqueur parce qu’il y a des aides
financières. Il calcule l’amortissement des travaux et sur combien d’années. Quand on part de chaudière fioul il y a une nette différence. C’est vrai que la réhabilitation thermique, c’est vraiment intéressant. “
Quelle a été l’implication des maîtres d’ouvrage dans ce projet ?
« Je dirais qu’ils étaient investis et qu’on est très vite arrivés sur un consensus au niveau du plan. Dans notre métier on essaye d’être à l’écoute, on réalise la maison des clients pas la nôtre, donc avant même de commencer à dessiner les premiers traits on essaye de passer du temps à bien cerner les gens, de savoir comment ils vivent, leurs besoins, pour arriver à un projet qui leur ressemble le plus possible. C’est pour ça que, quand on leur présente la première esquisse, quelque fois ils sont un peu surpris, mais en général ça correspond à leurs attentes et leurs modes de vie. Dans ce cas particulier, ils voulaient surtout une maison bois et performante ; lui avait déjà fait construire une maison en ossature bois quelque années auparavant. »
Quels ont été les éléments complexes à travailler dans ce projet ?
Hugo : « Il n’y a pas de projet simple, mais ça fait partie du métier. On passe notre temps à résoudre les complexités. L’expérience fait que les artisans sont conscients et engagés dans cette démarche donc ça c’est un vrai plus. On est ouvert aux autres entreprises mais c’est vrai que si on arrive à travailler avec les mêmes, on met au point, ensemble, un certain nombre de détails qu’ils peuvent répliquer ensuite. Il y a quand même beaucoup de points techniques pour arriver à ce niveau d’étanchéité à l’air. Ce n’est pas très compliqué mais il faut anticiper à chaque étape. Et du coup, travailler avec des artisans qui y sont formés, ça fait qu’ils ont les bons réflexes. »
Interview Atelier de la Place, Thomas Braive Maison : « REHABILITATION CHALET A CORRENCON-EN-VERCORS (38) » Date : avril 2021
Partie 1 Pratique et expérience
Comment définiriez-vous votre agence et votre manière de travailler ?
« On peut dire qu’on est une petite agence (on n’est que deux). On travaille essentiellement sur des marchés publics, assez peu pour des marchés privés, et un peu pour des particuliers. On essaye de travailler avec une démarche écologique.
On aime être disponibles et faire l’intégralité de la mission de l’architecte si possible. Un des choix qu’on a faits pour ne pas avoir de salariés c’est de travailler en association et collaboration avec d’autres agences d’architectes.»
Quelle est la place de l’environnement dans votre conception ?
Est-ce une dimension que vous intégrez dès la phase esquisse ?
« Oui, ça prend de la place tout de suite, dès les premiers mots et traits, puis tout au long du projet et du chantier. Tous les choix sont guidés par ça. A chaque fois qu’on doit faire un choix, on le met à la lumière de ce critère. Parfois on fait des concessions mais c’est toujours un arbitrage qu’on fait en conscience cette préoccupation.
En général, nos contraintes ce sont le budget et la sensibilité du maître d’ouvrage, qui est plus ou moins réceptif. Souvent on le tire un peu vers le haut, mais quand on a en face un client, par exemple un maire ou une commune, qui n’est finalement pas très sensible à l’écologie, c’est compliqué de lui imposer des choix qui coûtent plus cher.
Souvent les choix écologiques impliquent des surcoûts qu’il faut pouvoir intégrer. Bien sûr ce n’est pas tout le temps vrai, je me rappelle une commande où le maître d’ouvrage était très « écolo » et finalement c’était un des projets les moins chers que j’ai réalisés, mais parce qu’il était capable d’arbitrer sur certains critères. Par exemple, un client qui n’a pas beaucoup de moyens va mettre de la laine de verre au lieu de la laine de bois. On ne pourra pas le forcer, à un moment donné il va nous demander de faire des économies et on sera obligés de rétrograder dans des matériaux qui ne sont pas biosourcés. Un maître d’ouvrage qui est très engagé peu faire des choix, des arbitrages, par exemple en acceptant de construire en paille mais en demandant une climatisation. Cela dépend des usagers, c’est un choix qui n’est pas négociable, ce sont des choses qu’on n’aurait pas forcément faites tout
seul mais on y est poussés par la demande. » Si oui, comment ? Quels sont vos outils ?
« On n’a pas formalisé de méthode et de mode d’emploi, c’est notre manière de travailler qui fait qu’on est sensible et qu’on l’a intégré cette question, mais notre méthode n’est pas revendable à un autre cabinet d’architecture en l’état. En général, on a le temps de tout balayer avec notre bureau d’étude. »
Selon vous, la dimension environnementale est-elle primordiale dans le projet par rapport :
- Au paysage et au site (intégration, matérialité, orientation, implantation, perméabilité) ? subjectif
- A l’usage et au confort (dans les outils manipulés pour se protéger du froid, de la chaleur) ? accepter le confort ? vitale ?
- Aux ressources, leur rareté, et leur dimension épuisable ? (biosourcé, provenance etc)
«Les trois critères sont importants. J’aurais une petite préférence pour le troisième mais en général on gère les trois en même temps. Ce qui est un peu particulier en architecture c’est qu’on fait un peu tout en même temps : on traite un sujet, après on fait les autres. On essaye d’avoir une approche globale. On ne dit pas « je prends ce matériau parce qu’il est local mais par contre je me fiche des autres.
Dans les critères de confort, on ne pousse pas vraiment les gens, on essaye plutôt de les interroger sur la réalité de leur besoin, pour essayer de ne pas mettre de l’argent là où le confort n’est pas forcément vital. Pour l’intégration paysagère, je trouve que c’est un peu subjectif.»
Quel est l’enjeu de la réhabilitation, rénovation selon vous ?
« Déjà je dirais qu’on en fait de plus en plus. Il y a une tendance à penser que c’est l’avenir, que faire du neuf c’est un peu du luxe, que la réhabilitation c’est la voix normale qu’il faut perfectionner de manière à avoir une approche la plus fine possible. Mais on n’est qu’au début. Nous, ça correspond à un peu moins de la moitié de notre historique mais ça va le devenir de plus en plus. Maintenant, c’est quasiment que des extensions et/ou de la réhabilitation. Je crois que dans tous nos projets aujourd’hui on en a qu’un seul qui est vraiment neuf. »
C’est une réalité, ça devient rare qu’on nous demande une maison ou un bâtiment neuf, quelque soit le programme. Environnementalement parlant, c’est vertueux de ne pas démolir et reconstruire. Ce n’est pas forcément moins cher ; souvent c’est même plus cher. Souvent les gens privilégient la réhabilitation en pensant économiser et au final on sort quasiment au prix du neuf, voire plus. Mais dans tous les cas, on est plus vertueux écologiquement puisqu’on crée moins de déchets et qu’on recycle plus. »
Est-ce que vous avez pour habitude de travailler avec des bureaux études ou collaborer avec des ingénieurs thermiques ?
« On a été formés dans une école d’ingénieur mais on n’a pas le diplôme. On est dans un dialogue vertueux. On choisit notre bureau d’étude par rapport à leur créativité plutôt que leur capacité technique. Je pense qu’il faut que les architectes puissent être un peu plus techniques et les ingénieurs plus créatifs pour que cela puisse coller, parce que sinon on ne se comprend pas. Globalement on apprend à faire équipe, surtout l’architecte qui est censé être le dirigeant et jouer un rôle d’animateur.»
Est-ce que les réglementations thermiques sont un outil, une nécessité ou bien est-ce un frein/une contrainte dans votre travail ? Selon vous, servent-elles l’enjeu environnemental ou sont-elles sources d’incohérence ?
« J’ai envie d’être un peu radical en disant que ça ne sert à rien, mais ce n’est pas vrai. Donc disons que ça nous oblige à réfléchir et se positionner. Mais souvent, ça peut devenir une contrainte aberrante : on se retrouve à faire les choses à l’envers, en dépit du bon sens, ce qui est un peu dommage.
La règle devrait servir à aller vers du positif, parfois on a l’impression qu’on ne le fait pas bien. Ce n’est pas vraiment un outil de travail. Ça peut le devenir mais il faut arriver à pas en être esclave. Ce n’est pas évident parce qu’elle est très puissante, cette règle, surtout dans le neuf.
Dans la réhabilitation, elle est un peu plus souple, donc justement on a peu plus de facilité à la façonner par rapport au projet.
Mais on se plaint pas mal de la réglementation thermique, car elle se complexifie et elle est de plus en plus loin de la réalité, du terrain. Alors qu’on aurait aimé qu’elle s’en rapproche. On a l’impression d’avoir affaire à une machine à calculer, un gros ordinateur complexe qui génère des
calculs, qui à la fin valide des solutions aberrantes et invalide des solutions pertinentes. Par exemple, un bâtiment qui n’est pas du tout biosourcé peut être très vertueux, et un qui est biosourcé peut être considéré comme erratique, ce qui n’est pas normal d’un point de vue énergétique. Il y a problème qui est politique et économique, qui fait que les petites filières locales ne peuvent pas rentrer dans ce débat national.»
Est-ce que vous accordez de l’importance à sensibiliser vos clients même s’ils ne viennent pas avec l’intention d’apporter une dimension environnementale à leur projet ?
« Les gens sont de plus en sensibilisés donc c’est bien. Après, on fait ce qu’on peut, et quand on y arrive tant mieux et quand on sent qu’ils ne sont pas réceptifs ça nous arrive de lâcher prise. On ne peut pas aller contre son client et il a toujours le dernier mot. En général, c’est la partie économique qui fait qu’on lâche les critères environnementaux et les matériaux biosourcés, parce que les non-biosourcés sont produit industriellement et donc moins chers.»
Quel est votre opinion sur la formation au métier d’architecte vis à vis de la dimension environnementale ?
« Moi je n’ai pas eu de formation environnementale ; j’ai été formé dans les années 1990 et à l’époque le mouvement écologique c’était presque un gros mot. Je me suis formé dans les années 2000.
Je n’ai aucune vision sur ce qu’il se passe dans les écoles d’architecture. Après, j’ai l’impression que ça prend de l’ampleur, même si j’ai la sensation que c’est plus les étudiants et la société qui poussent vers ça que les école d’architecture et les enseignants. Mais je me trompe peutêtre et ça dépend sûrement des enseignants.
Cela m’arrive de faire des interventions de façon ultra-ponctuelle. Je sens que les étudiants sont assoiffés, mais ce n’est pas vraiment ce qu’ils reçoivent en première ligne. Globalement que les programmes ont quand même évolué et des modules que j’ai fait après le diplôme sont rentrés dans le programme de base.»
Partie 2 Le projet
Dans mon travail de mémoire j’ai choisi un corpus de plusieurs projets et plus particulièrement le vôtre car il s’agit d’une rénovation et d’une extension.
Ceci implique que le maître d’œuvre n’a pas la même posture dans la conception et doit s’adapter à l’existant. Différents points m’intéressent concernant ce projet :
Pourriez-vous résumer de manière simple ce projet par les points importants qui le caractérisent ?
« C’est le premier projet que j’ai réalisé en tant qu’indépendant et en autonomie. Par des contacts et du bouche à oreille, j’ai rencontré les Richard. Ils avaient investi dans ce chalet comme résidence secondaire, donc inoccupée une partie de l’année. Les clients étaient très investis et voulaient réaliser une rénovation énergétique pour avoir un meilleur confort dans ce lieu.
C’est un projet avec une extension, et nouvelle peau assez simple. La maison était assez mal implantée sur son site et il a fallu remettre un peu les pièces et espaces dans le bon sens. Il n’y avait aucune étanchéité à l’air et aucune résistance thermique. »
I/ Ressources (matériaux bois, réemploie de l’existant)
Quels sont les matériaux qui caractérisent ce projet ?
Apporter des spécificités et la raison qui a motivé ce choix (dimension environnementale, provenance, intégration paysagère, culture constructive).
- Structure, isolation, fondation
- Existant et projeté
«C’est un projet d’extension entièrement en ossature bois et laine de bois.
Il était projeté initialement en laine de bois par l’extérieur et en toiture ré-enveloppée en laine de bois, avec des menuiseries bois. Tout était fait depuis l’extérieur pour préserver la superfine intérieur. Il faut savoir qu’il y avait un réel inconfort thermique avec un chalet limite insalubre.
Donc on est partis de là pour atteindre un objectif de confort proche d’une construction neuve. Il me semble qu’ils avaient fait une proposition initiale de faire en fibre de coton recyclable, un matériau biosourcé. Ils avaient envie de rester dans des matériaux comme le bois, liés à l’aspect originel du chalet et un peu à une
sorte de sensibilité écologique.»
Quels sont les procédés constructifs et de mise en œuvre
?
« Ce qui était prévu était de travailler avec des entreprises de la commune. Une envie du couple et d’ailleurs un choix qui correspondait au meilleur prix. Ils voulaient des produits locaux.
Je ne sais pas si c’était un hasard ou une chance.
Pour la construction il a fallu démonter le bardage existant. On a découvert que la laine de verre initiale était en bon état, donc dans une logique d’économie budgétaire et écologique de matière, on a décidé de la maintenir et ajoutant moins d’isolation complémentaire.
Puis le bardage bois et les menuiseries étaient en mélèze, d’une production locale là-encore. »
II/ L’usage et le confort
En phase esquisse le dessin de l’organisation spatial a t-il été motivé par des qualités dites bioclimatique (orientation, exposition, site, climat) ?
« D’abord le garage, était très complexe d’accès et il n’était pas possible de rentrer une voiture à l’abri. Ensuite, l’isolation acoustique était nulle entre un niveau et l’autre. Le plan est le plus fonctionnel possible avec la terrasse. Il a fallu quand même reprendre l’organisation spatiale pour essayer de l’adapter aux besoins sur les 30/50 ans à venir».
4) La rénovation énergétique de ce projet était-elle motivée par des objectifs de consommation ? (chauffage)
« Pas vraiment, l’objectif n’était pas de faire des économies de consommation d’énergie mais plus d’avoir un accès au confort raisonnable et de rendre le lieu plus efficace dans son enveloppe et sa thermie.»
Quels sont les dispositifs techniques mis en place dans ce projet ? (chaudière, ventilation double flux)
« Il y a une VMC. Il a fallu rendre le bâtiment étanche a l’air pour aspirer dans la salle de bain et la cuisine. Un poêle à bois est le poste de chauffage principal placé dans la partie privée à l’étage, dans l’espace de vie très ouvert, tandis qu’en bas le chauffage est complètement électrique pour
le studio qu’ils voulaient louer. C’était une solution plus adapter.»
Quels le rapport entre investissement économique et économie d’énergie ?
« Je ne sais pas vraiment mais le coût et l’investissement était important pour la famille. Cependant ils n’avaient pas l’intention de réduire les dépenses énergétiques. Les prestations étaient assez basiques et pas très qualitatives, en particulier à l’intérieur, avec un sol souple. »
Selon vous,
Quelle a été l’implication des maitres d’ouvrage dans ce projet ?
« Les maitres ouvrage étaient très demandeurs, ils voulaient choisir des entreprises dans un rayon de 10km. Ils ont influencé tous les grands choix de stratégies, dans le dialogue. Par exemple concernant la création des ouvertures au nord.
Ils étaient engagés, sympathiques et ouverts à la discussion, pas tordus ni butés. Ils avaient beaucoup de bienveillance. Ils avaient tout de même envie de qualité et étaient assez ouverts à la posture environnementale.»
Quels ont été les éléments complexes à travailler dans ce projet ?
« Déjà c’était un projet préexistant à améliorer. Ensuit le plus délicat était la question financière. Ainsi il ne fallait pas trop démolir, ni doubler le prix de la maison qui était de 200 000 euros.
Il étaient en fin de carrière professionnelle donc voulaient trouver un équilibre entre le prix de la maison et la rénovation.»
Quels sont les points qui ont fonctionné ou non dans ce projet ?
«Il y a eu des erreurs de la part du plombier, avec des problèmes dans les canalisations. Le travail n’avait pas très bien été réalisé. C’était une déception d’avoir ces problèmes avec cette entreprise.
La conception de la toiture et l’extension était limitée par la proximité de la limite de propriété. Ainsi il était difficile de gérer l’évacuation de la neige. Des crochets ont été mis en place sur la toiture pour éviter que la neige ne se
décharge chez les voisins. C’était assez borderline mais la gestion du voisinage s’est bien déroulée. L’extension était relativement exigeante mais correspondait à leurs attentes.»
Avez des anecdotes ou remarques supplémentaires ?
« A un moment Mme Richard voulait mettre une baie au nord élargissant la cuisine. Il a fallu trouver une parade parce que le PLU Corrençon-en-Vercors interdisait de mettre des baies horizontales. Ainsi, un système de bardage en trompe l’œil avec une modénature lisse a permis de modifier l’aspect de la façade. Et cela a marché, la demande de PC a été acceptée en 3 jours, très simplement.»
Partie 1 Pratique et expérience
Comment définiriez-vous votre agence et votre manière de travailler ?
« L’agence existe depuis 2008, maintenant on est 3 associés. On a dû faire une cinquantaine d’opérations. Il a une stagiaire qui va surement faire sa HMO avec nous. Depuis 15 ans, on essaie de travailler toujours de la même façon : l’ossature bois, remplissage en bottes de pailles et puis les enduits terre, terre crue. Après, on travaille aussi pas mal avec la terre crue sous d’autres formes : le pisé, les murs en adobes, les murs en matériaux composite terre copeaux, terre coulée, les sols en terre. On essaye d’apporter de l’inertie et de la masse autant que possible dans nos bâtiments. On aborde les projets d’une manière technique, sur la technique constructive »
Quelle est la place de l’environnement dans votre conception ?
- Est-ce une dimension que vous avez intégré dès la phase esquisse ?
- Si oui, quels sont vos outils ?
Selon vous, la dimension environnementale est-elle primordiale dans le projet par rapport :
- Au paysage et au site (intégration, matérialité, orientation, implantation, perméabilité) ?
- A l’usage et au confort (dans les outils manipulés pour se protéger du froid, de la chaleur) ?
- Aux ressources, leur rareté et leur dimension épuisable ? (biosourcé, provenance, etc.)
« On essaye autant que possible de travailler avec des matériaux qu’on trouve à proximité. La terre, ici, c’est assez simple parce qu’elle est bonne et car c’est une tradition constructive du coin, donc il y en a suffisamment. Pour le bois, on travaille beaucoup avec le Douglas. Il n’est pas particulièrement local, il vient souvent des monts du Lyonnais et parcourt quand même 100km… Et puis pour la paille, on travaille quasiment tout le temps avec les agriculteurs à proximité du chantier. Cela demande un peu de recherche : ils n’ont pas l’habitude de revendre leurs bottes, il faut discuter des longueurs de bottes. Ce sont des contraintes parce que la moisson a lieu à un moment donné de l’année, donc il faut aussi caler le chantier. Généralement ça tombe plutôt bien, parce que si on arrive à avoir une enveloppe hors d’eau mi-juillet, ça permet de mettre les bottes à l’abri. Sinon, on se débrouille pour que les agriculteurs les stockent. »
Date : avril 2021
Du côté plus technique et plus conceptuel, on travaille sur de la maison individuelle, en marché privé. On fait des missions complètes et surtout on s’occupe de toute la mission maîtrise d’œuvre donc on fait l’économie du projet nous-mêmes. Cela nous permet d’avoir une bonne maîtrise du projet, en parallèle de la conception.
On essaye d’avoir une conception la plus bioclimatique possible. On va utiliser en parallèle des logiciels de simulation thermique (Pléiade) pour avoir un retour sur la conception bioclimatique et le comportement thermique du bâtiment et un descriptif quantitatif estimatif avec UE qu’on va développer en même temps que le projet, pour toujours savoir un peu combien il coûte.
Ce sont les trois axes : la conception bioclimatique, l’aspect thermique et puis l’aspect économique, sur une base technique qui est toujours la même. La paille est apparente depuis l’extérieur, et on penser enduire directement sur la paille »
Est-ce que vous avez pour habitude de travailler avec des bureaux d’études ou de collaborer avec des ingénieurs thermiques ?
« Nous on s’en occupe beaucoup, mais on fait toujours faire une étude thermique réglementaire par un bureau d’étude et on travaille de temps en temps avec le bureau de structures bois, un collègue juste au-dessus. Sinon, on fait toujours une étude structure béton armé pour la sismique, on n’a pas bien le choix. »
Est-ce que les réglementations thermiques sont un outil, une nécessité ou bien est-ce un frein/une contrainte dans votre travail ? Selon vous, servent-elles l’enjeu environnemental ou sont-elles sources d’incohérence ?
« Franchement, je pense que dans l’ensemble c’est plutôt bien, quand on a une approche conventionnelle. Il y a un niveau de performance plutôt intéressant.
Mais je trouve que ça peut être aussi une contrainte quand on ne construit pas de manière conventionnelle, parce que cela crée des incohérences : les bâtiments ne fonctionnent pas de la même façon, presque à l’opposé l’un de l’autre… Typiquement, dans nos bâtiments, l’énergie la chaleur est contenue dans la masse à l’intérieur du bâtiment ; si le bâtiment n’est pas totalement étanche à l’air, cela ne nous embête pas parce que la chaleur n’est
pas contenue dans l’air. Cela ne risque pas de le refroidir parce que la chaleur est contenue dans la masse. A contrario, dans les bâtiments conventionnels, il y a très peu de masse à l’intérieur et c’est l’air qu’il faut chauffer. Il y a beaucoup de clients qui laissent les fenêtres ouvertes toute l’années et ils n’ont pas de sensation de froid parce que le rayonnement des parois réchauffe automatiquement l’air qui rentre.
Donc la RT, c’est bien pour les bâtis conventionnels. Elle oblige à certaines choses. Mais pour les autres techniques constructives, qui ne suivent pas la même logique, elle est contraignante… On a le droit de ne pas mettre de VMC dans le cadre de la RT 2012, mais en étude thermique ça ne fonctionne pas parce qu’il n’y a pas de débit de fuites quantifiable. Cela fait exploser les consommations énergétiques et ça ne passe pas. C’est un peu embêtant.
Dans les RT, la notion d’inertie n’est pas prise en compte. Certes c’est difficile à prendre en compte. Le fait aussi qu’il faille mettre un moyen de chauffe automatisé est problématique : nous on ne mettait pas de poêle à bûches car, au rendement, les gens l’utilisent très peu, ils pourraient très bien vivre sans mais c’est une barrière psychologique. Ils un peu peur et en réalité ils ne l’allument jamais. Dans le cadre de la RT, on n’a plus de droit de faire ça, il faut un système automatisé comme chauffage principal ; soit une chaudière soit un poêle à granulé qui vaut cher. Pour nous c’est une contrainte. Ce sont pas mal de choses qui ne vont pas dans le sens de la logique…
Il y a aussi de très bons aspects, notamment sur la notion de bioclimatique avec le Bbios report surface vitrée, orientation et protection solaire. Ce sont des choses qui se sont quand même généralisées et c’est pas mal. A voir pour la prochaine, ce que ça donne.
Je trouve que c’est intéressant parce qu’on commence à prendre en compte l’analyse de cycle de vie des matériaux de construction et ça on le voit bien. Aujourd’hui on a des bâtiments très peu consommateurs en énergie de fonctionnement, et l’énergie liée à la construction du bâtiment devient très importante, primordiale. C’est là-dessus qu’on peut avoir une action : on voit vite que, suivant les matériaux qu’on utilise, on peut avoir des équivalents de 30, 40, 50 voire 60 ans de consommation liées à l’activités du bâtiment. L’énergie de consommation est du coup presque l’entièreté de la vie du bâti. Je trouve que c’est vraiment pas mal . Cela va aider les gens à conscientiser
la nature des matériaux, à s’y intéresser, à être curieux, à développer les choses, à plus être matraqués par la laine de verre et le parpaing qui ont une place de monopole. On le sent aujourd’hui, les filières bois s’organisent, elles deviennent de plus en plus importantes. Toute la filière du béton s’intéresse beaucoup à l’utilisation de la terre crue puis développe des travaux de recherche et développement pour utiliser tous les stocks d’argile qui sont mis de côté depuis une dizaine d’années dans l’extraction des granulats. Je trouve que c’est un mouvement intéressant.»
Partie 2 Le projet
Quels sont les matériaux qui caractérisent ce projet ?
Quels sont les procédés constructifs et de mise en œuvre ?
« Vimines c’est particulier, il y a un enduit terre en extérieur et intérieur. Même les plafonds sont en enduits terre. Au sol il y a une partie béton ciré et une partie terre damée, enduite en sous face de toiture, c’est ce qui fait qu’elle se comporte bien.
En toiture c’est de la laine de bois et en revêtement extérieur, des tuiles grises en ardoises. Sinon, tout le reste est en paille, et il me semble qu’il y a des panneaux de polyuréthane ou de liège sous le dallage et sur les bords, de 10 ou 12cm. »
Quels sont les dispositifs techniques mis en place dans ce projet (chaudière, ventilation double flux) ? Avez des anecdotes ou remarques supplémentaires ?
« Dans cette maison, au début, Sophie et Damien [Le couple d’habitant] et un copain thermicien avaient fait faire une étude thermique. Il avait préconisé une ventilation, une VMC. Nous, très souvent, on essaye de ne pas mettre de VMC. Une ventilation sert à renouveler l’air, pour extraire l’humidité et les polluants et surtout renouveler l’oxygène. Or, nous partons du principe que dans les bâtiments qu’on construit, l’humidité est gérée par la terre, donc il n’y a pas besoin de l’extraire. Ils sont plutôt secs voire parfois peut-être un peu trop. Pour les polluants, il n’y en pas. On utilise des matériaux sans polluants, à part le mobilier par exemple. Une grande partie des polluants intérieurs sont annulés. Et pour le renouvellement de l’air, pour la respiration, ça se fait en partie par les défauts d’étanchéité des bâtiments, parce que nous on n’est pas 100% passif, il y a toujours des fuites d’air. On est à la
limite du quota autorisé. Après il faut que les habitants ouvrent les fenêtres, 5 minutes suffisent à renouveler l’air. Donc on part du principe que cela ne vaut pas forcément le coup d’installer une VMC parce qu’on répond déjà aux 3 problématiques. Puis, une VMC, c’est vraiment très inconfortable parce que ça ne régule pas la température : ça fait rentrer de l’air froid et sortir de l’air chaud. A moins que l’on mette une VMC double flux, mais même ça, ça fait rentrer de l’air froid un peu réchauffé par l’air chaud qui sort. Imaginez qu’elle tourne en hiver, par -5°. Cet air qui rentre à -5° va croiser de l’air qui sort à 20°. Sachant que le rendement de la VMC c’est 80%, il est plutôt à 18°, donc au final l’air qui va arriver sera à 13°. C’est froid, il faut le remonter jusqu’à 20°. Donc la ventilation c’est vraiment un point de règlement de la thermique du bâtiment. Au final, Damien ne l’a jamais branchée, il m’a dit « on n’en a pas besoin, tout va très bien comme ça …elle est installée mais elle ne fonctionne pas » [Damien].
« Donc, si vous ne répondez pas aux 3 critères qui sont gérer les polluants, évacuer l’humidité et renouveler l’air autrement qu’avec la structure du bâtiment, effectivement il faut une VMC. Typiquement, dans le bâtiment conventionnel d’aujourd’hui, c’est obligatoire sinon vous allez avoir des gros problèmes d’humidité, d’autant plus si le bâtiment est étanche à l’air… Evidemment, ça n’a pas été inventé par hasard, mais c’est adapté aux techniques conventionnelles, pas forcément intelligentes. »
Quelle a été l’implication des maîtres d’ouvrage dans ce projet ? Quels ont été les éléments complexes à travailler dans ce projet ?
« C’est un projet qui a été fait dans un lotissement. C’était particulier : il y avait des constructeurs sur le lotissement qui proposaient des maisons, il y avait un enjeu de ce côtélà car nous allions proposer quelque chose de complètement différent. On avait une démarche bioclimatique, alors que les autres pas du tout. Ça a donné une implantation un peu particulière, on a retrouvé une orientation au sud, effectué un travail sur l’ancrage dans la parcelle, une circulation couverte, un stationnement à l’entrée… pour essayer de reconstruire un petit peu un environnement. La conception avec eux s’est assez bien passée. Ils avaient un budget assez serré, de l’ordre de 200 000 €, 1800 € du m2 environ. Il y avait un petit challenge par rapport à ça. »
Les usages, la manière d’habiter la maison sont-ils liés à sa conception et ses ambitions environnementales?
« Eux voulaient absolument travailler la terre et avec
beaucoup d’inertie. Ils avaient des amis qui avaient construit leur maison en habitat groupé, ossature bois et botte de paille, mais qui n’avaient pas travaillé la terre et avaient amené très peu d’inertie à l’intérieur du bâtiment, donc leurs amis étaient un peu déçus. Il leur manquait des parois chaudes pour stabiliser la température. Donc eux, a contrario de cette expérience, avaient la volonté de mettre beaucoup de terre.
Ils ont fait une partie eux-mêmes : les enduits de finition sur les parois. Ils ont étés formés par l’entrepreneur Laurent Petrone. Il n’a pas trop trainé, en moins d’un an le chantier était boucler. A la fin, ils étaient assez contents, et ça fait un beau projet franchement, simple, compact…
Ils ont eu des idées d’économies, par exemple n’y a pas de dépasser de toitures. Ce sont eux qui m’ont demandé si c’était vraiment nécessaire, car ça représentait beaucoup de surface et de plus-values. Au final, ça ne change pas grand-chose, y compris au niveau du confort d’été, parce que des BSO vont protéger les façades, alors que la toiture n’aurait jamais pu protéger les vitrages de toute façon.
Je me souviens qu’au rez-de-chaussée, pour faire des économies, il y a assez peu d’ouvrant. Il y a quand même pas mal de fixes. C’est assez chouette, ça cale le paysage.
Situés au milieu de maisons en parpaing… Il fait un peu sensation. Les voisins sont assez curieux de comment se comporte le bâtiment et Damien et Sophie l’ont fait visiter il me semble. Voilà, ça sort un peu du conventionnel, même si dans la forme extérieure on ne le lit pas tellement, ça reste assez commun. C’est aussi très compact, ça cherche l’économie donc il n’y a pas de fioritures »
En phase esquisse, le dessin de l’organisation spatiale a-t-il été motivé par des qualités dites bioclimatiques (orientation, exposition, site, climat) ?
« On a essayé d’orienter le bâtiment avec sa façade principale au sud, de placer le maximum de vitrage à cet endroit-là. Il y a eu tout un travail sur le type de vitrage selon l’orientation, avec des compostions particulières de vitrage, des épaisseurs de verre et de vides suivant chaque face, pour maximiser les apports solaires et minimiser les déperditions… par exemple il y a peu de fenêtre au Nord, seulement une dans la cuisine et une dans la salle de bain. ».
Interview Habitant Corrençon-en-Vercors, Monsieur et Madame Richard. Maison : « REHABILITATION CHALET A CORRENCON-EN-VERCORS (38) » Date : mars 2021
Présentation générale
Présentez-vous actuellement et à l’époque de création du projet ? activité, tranche d’âge -le projet est né quand, comment et pourquoi ? ( projet de vie, contexte )
« Le projet a commencé en 1998, au moment où notre fille attendait son premier enfant, avec l’idée d’avoir une maison qui serait un peu une maison de famille. Et puis on a vécu avec ce chalet sans faire de travaux et à un moment on a réellement eu envie qu’il soit rénové, plus adapté à des jeunes et des ados, et surtout qu’il soit mieux isolé, parce qu’à l’époque il ne l’était pas du tout. Donc on a eu envie de le rénover pour qu’il soit adapter à la fois à nos besoins et en même temps qu’il nous permette d’avoir un plus grand confort.
A cette époque, Thomas Braive venait de s’installer. On habitait dans un habitat collectif, lui travaillait sur ce genre de projet et quelqu’un nous a donné son nom. On aimait bien son approche et voilà comment on a commencé à travailler avec lui. C’est un peu un coup de cœur, comme dit mon mari. En tous cas une relation de personne à personne. C’est son approche et le contact qu’on a eu avec lui qui nous ont convaincus.»
Pour quels usages et fonctions est-il destiné ? lequel en fait vous actuellement ? (période d’occupation)
« A Grenoble on vit en appartement. Ce n’est pas du tout pareil d’accueillir des petits enfants dans un appartement que de les accueillir dans un bel endroit où il y a de la nature, de la neige. Maintenant, ce lieu a toujours la même fonction, et on peut dire que c’est vraiment un lieu de rassemblement. Vous voyez quand on l’a acheté ils n’étaient pas nés et maintenant nos petits-enfants ont 22 et 20 ans et ils commencent à se l’approprier, à y venir avec leurs copains. Il y en a un qui a passé un mois de confinement seul là-bas parce qu’il en avait vraiment envie. C’est un lieu de ressource pour le week-end.
Il faut savoir que c’était un chalet qui datait du début des années 1970 ; les conditions de construction et d’isolation n’étaient pas les mêmes. On avait comme axe de faire une rénovation énergétique.
En même temps, on voulait aussi améliorer l’espace. En effet, comme on savait que ça aller coûter assez cher quand on fait ce type de rénovation, on a voulu qu’il y ait un gain dans les circulations dans l’espace. On manquait de place pour stocker surtout dans le garage mal config-
uré. C’est aussi tout ça qu’on a travaillé avec Thomas.»
Phase de Conception
Quel a été votre investissement personnel, pour la participation à la conception ?
« Bah nous on as beaucoup de discuter sur l’organisation de l’espace libre, de jeux, de vie.
Je pense que les choses se sont plutôt faites dans la discussion. Nous on n’est pas du tout dans le métier du bâtiment donc de toute façon on avait besoin de quelqu’un avec qui on était en confiance. Lorsqu’on me dit 10 ou 12cm de laine de verre ou de je sais quoi, j’ai besoin d’être en confiance parce qu’on est pas du tout dans le métier. Donc je n’ai pas le sentiment qu’on ait demandé des choses, mais peut-être que Thomas Braive ne dirait pas la même chose.
Par contre je me souviens que je tenais à ce qu’il y ait une ouverture du côté jardin, une baie un peu en hauteur, pour profiter de la vue. Lui me disait que c’est du côté nord donc que ça nous rabaisserait en termes de gain thermique, mais on y tenait beaucoup. Après je ne pense pas qu’on ait eu des demandes. En gros on savait ce qu’on voulait et il nous a aidé à rendre opérationnelles nos propres idées.»
Avez-vous revendiqué des choix (d’espaces, de matériaux d’usage) ? Si oui lesquels plus précisément ?
Pourquoi réhabilitation thermique ? objectifs ? ( vivable, agréable, économie d’énergie, environnement )
« En fait nous n’avons pas réellement demandé à faire des économies mais qu’avec la même somme on gagne en confort. On partait avec un lieu qui était quand même sommaire au niveau thermique. C’était un peu comme une passoire. On se contentait de 12-14°C, alors que là on arrive à 17-18°. Et puis on a augmenté les m2 ici donc c’était forcément un coût supplémentaire. On a aussi vieilli et on supporte beaucoup moins le froid.»
Phase chantier
La technique de construction bois vous tenait-elle à cœur ? Pourquoi ?
« D’abord on est en montagne et le bois est assez naturel. En plus, on avait demandé à Thomas Braive de travailler avec des entreprises locales. Cela nous paraissait import-
ant de faire fonctionner l’économie locale. Entre Thomas Braive et l’entreprise Sauvageon, les propositions qu’ils nous ont faites nous ont tout de suite séduit. Et puis il n’y aurait eu aucune logique de mettre autre chose, le chalet était déjà en bois pour une grosse partie ça paraissait logique.
C’est ça aussi pour l’aspect environnement : en montagne ça fait partie du lieu. »
Les matériaux d’isolations sont soit biosourcés soit écologiques, d’où vient ce choix ?
« Ce sont des discussions qu’on a eues. On s’est trouvés en accord tout de suite là-dessus. On n’est pas des écolos purs et durs mais on voulait quelque chose d’efficace. Enfin, on a tenu compte du rapport qualité-prix. Tout cela a joué en même temps. »
Phase retour/exploration
Globalement avez-vous eu la sensation que le projet était une expérience positive ?
«Tout a fait ! On a jamais regretté les choix qu’on a faits.»
Qu’est-ce que vous aimez en particulier dans le projet ?
«La salle de vie est vraiment très chouette et elle correspond complètement à notre manière de vivre et de fonctionner quand on est là-haut, avec cette ouverture sur le balcon. C’est une pièce qui nous correspond complètement.»
Quels sont les points faibles du projet et les éléments que voudriez changer ?
«S’il y avait quelque chose, je reverrais les circuits d’électricité, parce qu’on n’a pas mis certains interrupteurs et c’est dommage. Il y a des petits trucs comme ça, auxquels nous n’avons pas assez réfléchi. Mais sinon vraiment on n’a jamais rien regretté.»
Avez-vous changé et modifié des éléments ?
«Normalement on avait prévu en bas une possibilité de louer afin qu’éventuellement ça nous revienne moins cher. Donc on a fini d’installer la cuisine en bas. Mais notre santé et d’autres choses font que pour l’instant on ne se lance pas dans la location. Nous avons terminé de l’aménager pour que ce soit possible, mais pour l’instant nous n’avons pas le temps.»
Avez vous des anecdotes ou remarques à raconter concernant le projet, soit pendant la conception, les travaux ou pendant votre quotidien après la livraison ?
«C’est vraiment un projet qui a été conduit très sereinement et sans inquiétude !
Notre notion d’écologie était moins forte il y a 10 ans qu’aujourd’hui, mais je pense que ce qui a aussi beaucoup guidé nos choix c’est que Corrençon-en-Vercors est un magnifique endroit et quelque part on avait envie que le chalet soit intégré dans cet environnement. On est dans un bel endroit, on voulait qu’il soit à la hauteur de ce lieu.
La municipalité a choisi le projet et a publié un mot sur le journal de Corrençon-en-Vercors, c’est un signe que c’est une belle intégration. Ce n’est pas un truc hyper chic mais c’est un chalet intégré, je crois que c’est important pour nous ! »
Présentation générale
Présentez les habitants, qui vit dans cette maison ?
« On est une famille de 4 personnes donc 2 adultes et 2 enfants en bas âges, 7 et bientôt 6 ans. Donc nos enfants étaient tout jeunes quand on a eu ce projet et construit cette maison, il y a cinq ans.
Ma compagne travaille dans le domaine du social et de l’éducation pour le ministère de la Justice, pour la protection judiciaire de la jeunesse, pour les jeunes mineurs délinquants ou en difficultés sociale, scolaire, familiale ou personnelle. Moi je travaille dans l’aménagement d’espaces de loisir, je suis ingénieur en aménagement touristique territorial et je travaille pour le compte du ministère des Affaires étrangères.
On adore la nature, on aime bien être très souvent dehors c’est aussi pour cela que notre maison est très vitrée comme ça on a toujours l’impression d’être dehors même quand on est dedans. Et on adore le sport.
Je travaille à 6 ou 7 km et ma compagne en a peut être 8, donc on n’habite pas très loin et cela c’était une exigence dans le choix du terrain et dans nos recherches. Il devait être dans un rayon de moins de 10 km de nos lieux de travail, 15 minutes à vélo du centre-ville de Chambéry. C’est aussi pour cela qu’on a mis du temps à trouver un terrain dans notre budget et dans le périmètre souhaité. Un terrain qui soit bien ensoleiller, dans un cadre plutôt calme etc.»
Quand, comment et pourquoi est né le projet de votre maison ? Expliquez les étapes (projet de vie, contexte).
« Il y a plusieurs réponses.
D’abord on n’avait pas forcément cette envie de maison ou de maison individuelle. On avait en tous cas le projet d’investir. On avait plusieurs possibilités. On regardait des terrains nus pour une construction qui nous ressemble dès le départ, dès la genèse de la maison. On avait aussi eu des idées ou en tous cas des envies de rénovation de maison. Trouver un corps de ferme, une vieille grange, une vieille bâtisse, un bout de chalet, que sais-je… Quelque chose qui permette de venir refaçonner un petit peu sans artificialiser le sol de manière plus conséquente, donc de repartir d’un projet existant.
On avait les deux projets et on avançait de manière un peu parallèle sur ces deux sujets. Et finalement au bout d’un an de visite de maisons à rénover, on s’est aperçus que le projet qui nous correspondait le plus, notamment
Date : mai 2021
sur des questions financières, était probablement plus la construction neuve. Parce que sur notre secteur la moindre ruine coûtait déjà très cher, donc après le ticket de rénovation, d’extension, etc. c’était trop élevé. On s’est recentrés sur un projet de construction neuve.
Assez rapidement, parce que c’est notre sensibilité, on a eu envie d’un projet assez sain, assez propre dans les matériaux, dans sa construction. Je dirais qu’on n’a pas d’exigence. Alors Thomas ne vous dira peut-être pas ça, il vous dira peut-être qu’on était des clients très exigeants. Mais on n’avait pas d’exigence matérielle incroyable sur des équipements de la maison. On voulait une maison la plus simple possible, à la fois dans les volumes, dans sa construction, dans ses matériaux et dans l’usage. Alors ce n’était pas forcément un projet paille, on aurait pu faire un projet en isolation fibre de bois, en pisé, etc. Ça s’est plutôt décidé en rencontrant Thomas, qui nous a séduits sur les caractéristiques techniques et écologiques, environnementales, d’un projet comme celui-ci. Donc on lui a fait confiance. »
Décrivez en quelques lignes votre projet, et vos envies/ objectifs ?
(type d’espaces, de matériaux, dimension environnementale)
Pour quelles raisons avoir avec construit avec ces matériaux ? en bois, paille et terre ? Est-ce un choix personnel ? Avez-vous revendiqué des choix (espaces, matériaux, usages, dispositifs techniques...) si oui lesquels, plus précisément ?
« On va dire qu’on n’avait pas d’exigence technique mais des exigences de confort bioclimatique, été comme hiver. On avait envoyé un document à Thomas qui regroupait nos attentes. On souhaitait un projet aux lignes simples, des traits originaux, non rébarbatifs, profitant au maximum de l’ensoleillement, bien intégré dans le site, pas gênant pour les voisins, accès facile aux espaces extérieurs privatifs, un jardin privatif, de taille suffisante et en un seul morceau (pas autour du bâtiment), exposition sud à minima et est-ouest selon le terrain. Il y avait plusieurs terrains à ce moment sur l’ensemble du lot, accès discret, stationnement, espace atelier... Sans faire un schéma fonctionnel on l’avait fait de manière littéraire, avec les connexions entre les espaces. On avait décrit comment est-ce que chaque espace communique avec l’autre, l’emplacement, le dimensionnement.
Je crois qu’on avait même mit le budget qu’on s’était fixé en amont qui d’ailleurs pas beaucoup évoluer. En tout cas mention spéciale à Thomas aussi pour le coût parce qu’effectivement le budget a été respecté à 5% près, même pas à 2%près on est dans l’enveloppe.
Je lui avais transmis le cadastre des photos, le diagramme solaire, etc.»
Phase de Conception
Quel a été votre investissement personnel, pour la participation à la conception ?
« On s’est beaucoup investis, mais c’était fort de la relation qu’on a eue avec notre architecte, parce qu’il nous a beaucoup impliqués dans ce projet. Et comme c’est la maison dans laquelle on va vivre à priori pour un petit moment, on avait envie de s’investir et de construire une maison qui nous ressemble.
Thomas avait beaucoup de question, pour traduire nos besoins nos attentes, faire des propositions. Je dirais que la relation entre un architecte et ses clients est un peu différente que celle avec un promoteur. Et on l’a vu d’ailleurs dans notre entourage au sens géographique, où les voisins sont exclusivement passés par des constructeurs. Ce n’est pas péjoratif mais un projet sera clef en main et ce sera comme au magasin, voilà la maison B12 ou C14, ou on change la porte, les volets et le pot de fleur. Je pense qu’on s’est quand même beaucoup investis, d’ailleurs Thomas m’avais dit qu’il n’avait jamais eu autant de mails. Si vous posez la question à Thomas il vous dira qu’on était très exigeants je pense. Mais parce qu’on est aussi exigeants avec nous même à la fois dans notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Il y a un autre paramètre on était en mode auto construction pour partie, donc il y a forcément une implication et une coordination à trouver entre les artisans qui sont suivis par le maitre d’œuvre et les travaux que réalise le maitre d’ouvrage. Donc forcément il y a une imbrication très fine, et rien que pour cela il fallait nécessairement une implication à notre sens assez forte. Et puis parce qu’on n’aime pas laisser les choses au hasard, Thomas était assez surpris de savoir qu’on tenait un calendrier et que lorsqu’on disait que tel jour on aurait posé tel élément, ce jour c’était fait. Il n’y avait pas de délais, donc l’exigence qu’on amenait à la fois à notre maitre d’œuvre et nos artisans, on se l’appliquait à nous aussi. »
Phase chantier et vécu après installation
Aviez-vous l’intention d’intégrer l’environnement à votre projet ? Si oui par quels aspects ?
« Oui tout à fait ça faisait partie du projet et de nos exigences. On avait tout un paragraphe sur la question du confort thermique. Il y a des choses qu’on a pu faire et d’autres non, pour des questions d’ordre principalement budgétaire. On avait aussi l’idée de faire un double réseau d’eau pour récupérer les eaux pluviales pour les basculer dans un réseau d’arrosage extérieur. Après il a fallu faire des choix… mais oui, on avait certaines exigences techniques, bioclimatiques et thermiques sur l’ensemble isolation de la maison. Thomas nous as fait plusieurs simulations avec différents matériaux qui nous ont forcé de constater que la paille serait de très bonne qualité et un très bon rendement et que si on croisait avec le prix c’était pas mal.»
Au niveau des matériaux il y a de la paille mais il y a aussi de la terre. Donc la terre ça rajoute de l’inertie et favorise le confort d’été. Est-ce que c’est une dimension dont vous aviez connaissance ou non ?
« Ce sont des choses qu’on a apprises sur des questions d’hygrométrie, que même dans une salle de bain on peut mettre de la terre. Pas dans la douche mais sur murs et au contraire c’est plutôt bien parce que l’humidité est absorbée et elle est restitué un peu plus tard. Tous ces éléments, on n’en avait pas du tout connaissance. Pour le coup, la découverte technique a été apportée à la faveur des éclairages techniques de Thomas. Tout comme le mur en pisé central que vous savez peut-être vu sur les plans, devant lequel est placé notre poêle qui permet d’emmagasiner la chaleur puis de la restituer et de lisser les effets de pics de température qu’on pourrait avoir dans une maison classique, quand on chauffe la maison elle est super chaude et puis 1h après c’est gelé. Donc c’est Thomas qui nous a apporté ces connaissances. Moi je ne suis pas architecte donc je n’ai pas ces connaissances-là et ma compagne non plus donc on était assez preneurs de ces conseils.»
Ensuite le chantier a été mené pour partie en auto-construction. Comment cela s’est dérouler ? Vous avez été formés ?
« Effectivement nous avons mené le projet en auto-construction ; ce qu’on allait faire était calé dès le départ avec Thomas, à 70 ou 75%, en disant que nous voulions gard
er certains postes à partir des détails approximatifs qu’il nous avait donnés. Puis après il y a eu certaines surprises : il y avait des choses qu’on imaginait plus chères, d’autre moins, ce qui a fait qu’on a fait des choses qu’on ne pensait pas pouvoir faire.
Bon, a contrario, moi il m’est arrivé une tuile. J’ai fait une chute de l’échafaudage et me suis retrouvé avec un poignet cassé et une fracture, du coup on a dû abandonner certains postes que je ne pouvais plus faire. Voilà, donc je dirais que la plupart des postes étaient connus dès le départ.
Pour partie, on a été formés. Moi je suis un peu bricoleur et il y a des choses que je me sentais capables de faire et d’autres non !
Notamment sur la terre, on a collaboré avec le maçon terre. Il nous a formés sur les finitions terre durant une demi-journée et on a fait un demi pan de mur ensemble et ça ne lui posait pas de problème. Cela c’est la qualité de l’artisan qui fait que, d’ailleurs on a gardé de très bons contacts avec lui.
Il y a certaines parties sur lesquelles on s’est fait former et d’autres qu’on a faites seuls. Après il y a beaucoup de choses qu’on découvre, pour ça Youtube et les tutos sur internet c’est pas mal. On a aussi beaucoup d’amis qui sont de la partie, qui nous ont donné des conseils. On a fait chantier participatif pour la pose de la paille par exemple, c’est un jour et demi de travail, avec 20-25 personnes dans la maison, parmi lesquelles deux trois coordinateurs selon leurs niveaux et un copain cuisinier qui s’occupe du repas du midi. Là aussi on s’était fait accompagner par un ami charpentier, qui avait besoin d’obtenir sa formation d’artisan paille. Il nous a proposé d’être son cobaye, c’est-à-dire qu’on lui fournissait un terrain d’expérimentation et nous on avait un coordinateur, pour qu’il obtienne sa formation de poseur paille par le biais de cette participation.»
En termes de performance énergétique, vous aviez des attentes particulières ? et en termes de consommation ?
« Oui, tout à fait. On avait envoyé des éléments à Thomas sur cela.
Donc, on avait une exigence du niveau passif avec un objectif de 15kw/h/m2 et une étanchéité à l’air de 0,6 volume/heure. Donc on ne voulait pas forcément avoir la certification du label passive house mais on voulait s’en rapprocher au maximum.
On avait fait d’ailleurs le bilan à +2 ans qui évaluait no-
tre consommation à 1300Kw/H/an, ce qui inférieur de 100Kw/H/an au ratio. Pour vous donner un ordre d’idée on paye grosso modo entre 300 et 320€/an d’électricité donc moins de 30 euros par mois y compris le chauffage et les pelés pour le poêle.»
Au final quel était l’objectif de ces économies d’énergie, consommer moins ou économiser financièrement ?
« Consommer moins. On est prêts à mettre plus cher dans l’investissent pour essayer d’avoir des consommations plus faibles tout au long de la vie de la maison. Accessoirement, on est tous sensibles à la question économique, mais notre première préoccupation était de consommer moins. »
Y a-t-il des dispositifs techniques ? J’ai entendu parler d’une histoire de ventilation double flux…
« Oui ! C’est Thomas qui vous en a parlé. Là-dessus c’est un point sur lequel on n’était pas forcément d’accord. On avait un ami en lequel on avait entièrement confiance, ingénieur des fluides, qui restait assez sceptique sur la qualité de l’air et du renouvellement de l’air. Thomas était partisan du « C’est pas grave, tu ouvres ta fenêtre le matin et tu renouvelles ton air ». Mon ami était plutôt dans l’idée de me dire qu’il était difficile d’avoir cette rigueur, d’ouvrir 10 minutes le matin pour renouveler l’air. Surtout en plein hiver quand il fait -10° dehors. Donc notre ami thermicien nous préconisait d’installer une ventilation mécanisée, pas vraiment double-flux mais plutôt bricolée…
C’est une arrivée d’air qui arrive dans un petit caisson qui est préchauffer. C’est le truc qui n’est pas super propre quand même dans la maison, le fait qu’on fasse entrer de l’air extérieur chauffé par une petite résistance puis restitué dans les pièces à vivre. Dans la salle de bain et les sanitaires, on a une colonne nord-ouest qui marche en extraction naturelle parce que, la maison étant mise en pression par l’arrivé d’air, il y a une extraction naturelle. Cela marche plutôt bien, on est contents et cela nous enlève l’idée d’ouvrir la fenêtre 10 minutes quand il fait -10° dehors.
Ce n’était pas une exigence mais un choix de notre part, entre les éclairages qu’on a pu avoir par les conseils de Thomas et ceux de notre ami.
On avait également l’idée d’avoir une consommation énergétique la plus faible, donc par exemple d’installer un chauffe-eau solaire et de mettre un des panneaux photovoltaïques. Après certaines choses sont passées au sec-
ond plan pour des raisons financières. Pour la question du chauffage bois pelé/bois bûches, je crois qu’au départ on était plus bois bûches, mais sur les conseils de Thomas on a choisi l’autre option. Il nous a expliqué qu’aujourd’hui on faisait des poêles à pelés plutôt efficaces et avec des réservoirs assez conséquents, pertinent dans notre cas comme la maison consomme assez peu. C’est vrai parce que, pour vous donner un ordre d’idée, cet hiver j’ai dû passer 20 sacs de 15 kg, grand maximum. On a suivi Thomas et on ne le regrette pas du tout.»
Au niveau des usages, comment vous vous sentez dans cette maison, vous y vivez bien ?
« Oui super bien, et honnêtement on n’est pas les seuls. Alors je ne sais pas s’ils sont tous gentils avec nous mais nos amis et notre famille qui viennent dans cette maison disent qu’on s’y sent bien. Il y a une espèce d’âme assez chaleureuse. C’est vrai que la terre… on a une partie du sol en béton ciré et puis un sol en terre crue damée. Du coup, entre le pisé, les murs en terre et le bois ça donne quelque chose d’assez chaleureux, d’assez cocoon. Nous on s’y sens extrêmement bien à tous points de vue, à la fois dans l’usage dans les espaces, qui de notre point de vue sont très bien dimensionnés. Il y a un espace en bas, tout ouvert, vitré et très tourné vers l’extérieur. Les chambres ne sont pas trop petites ni trop grandes. On a des petits espaces, des petites mezzanines, des choses comme ça qui sont assez sympa. Je sais que les enfants aiment bien y passer du temps, ça leur fait plusieurs lieux qu’ils peuvent investir, surtout par ces temps de confinement et de télétravail… Ce n’était pas calibré pour cela.
En tout cas on y vit très bien, on s’y sent très bien.»
Quels sont les points faibles du projet et les éléments que vous aimeriez changer ?
« Il y a forcément des choses qu’on réajusterait, par exemple sur la façade est on a des volets extérieurs en bois coulissant qui ne s’ouvrent que depuis l’extérieur. Il y a notamment un grand volet sur la grande baie vitrée qui est à l’angle sur la façade est au rez-de-chaussée. C’est vrai que si on l’avait électrifié avec des brises soleil orientable (BSO) comme la façade sud, ce serait un peu moins contraignant. Parce que là, à chaque fois, sortir ce n’est pas une grande contrainte mais l’hiver, quand il y a de la neige sur la terrasse, il faut les chaussures pour ouvrir ou fermer le volet. Ce n’est pas des plus agréable.
Au-delà de cela, je ne sais pas ce qu’on aurait fait de plus. Souvent, quand on nous pose la question, peut être agrandir un peu l’espace de stationnement, on l’avait calibré un peu à minima pour deux voitures. Donc deux petites voitures rentrent. Alors bon en réalité nous on a qu’une voiture. Mais dès qu’on a des amis qui viennent à la maison, tout de suite on ne trouve pas de place pour se garer. Le quartier est configuré d’une manière ou s’est pas évident. Donc il faut se garer loin et ça peut être une contrainte d’accueil. Peut-être qu’aujourd’hui on ferait un espace vélo un peu plus grand parce que c’est notre moyen de locomotion principal. On a 8 vélos pour 4 personnes pour vous donner un ordre d’idée. On a plus de carriole maintenant parce que les enfants sont un peu plus grands, mais on fait tout à vélo : travail, voyage, école, tout. En tous cas on se déplace en doux. Donc on réfléchirait à agrandir l’espace de stationnement. On voulait qu’il soit le plus petit possible pour justement ne pas avoir la vue des voitures, etc. On ne l’a pas, c’est clair, mais je pense que ça ne nous aurait rien couté d’agrandir un peu, pour avoir un peu plus de confort et a minima garer deux voitures sans avoir à réfléchir à bien manœuvrer, et faire un vrai espace vélo plus grand. »
Avez-vous des anecdotes ou remarques à raconter concernant le projet ? Soit pendant la conception, les travaux ou pendant votre quotidien après la livraison.
« Des anecdotes pas forcément, mais en tous cas des bons souvenirs, à la fois forcément une période un peu tendue, un peu stressante parce qu’on investit un peu de ses économies et de celles à venir sur un projet de vie. A la fois on a peur de ne pas faire les bons choix, enfin l’ambition de faire les bons. Donc forcément cela soulève plein de questions, on échange à droite à gauche. Et à la fois ce sont de très bons moments de partage, en mode co-construction avec notre entourage, et puis des très bons moments avec des artisans comme je vous disais. Cela c’est aussi agréable, de ne pas avoir qu’une relation de « donneur d’ordre financier » et « artisans-exécutants ». C’était vraiment très positif, une très belle expérience.»
Source :
et

















