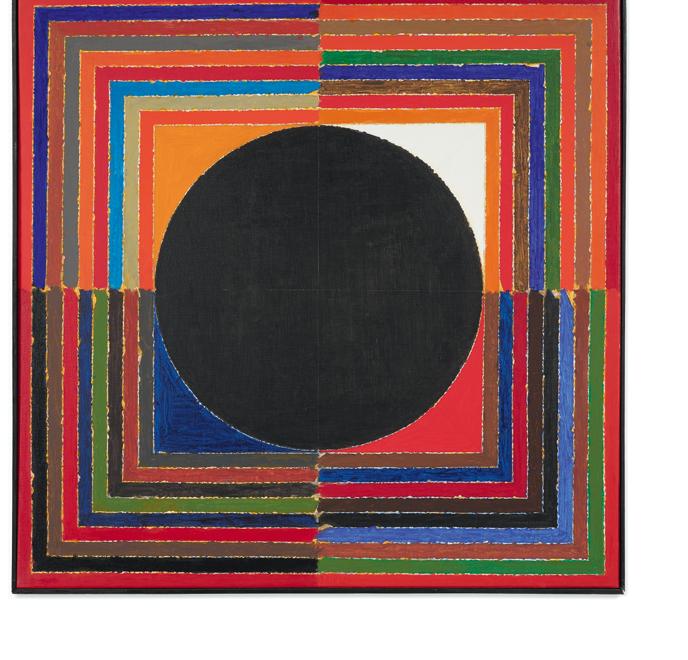SELECTED 20/21
Samedi 25 octobre 2025 – 16h
7 rond-point des Champs-Élysées Marcel Dassault 75008 Paris

© Vincent Everats
Lot 16, Anish Kapoor, Mirror, 1997, p. 90
SELECTED 20/21
Samedi 25 octobre 2025 – 16h
7 rond-point des Champs-Élysées Marcel Dassault 75008 Paris

Lot 5, Joaquín Torres-García, Figura de mujer sendata construtiva, 1936 (détail), p. 28

Lot 18, Serge Poliakoff, Composition abstraite, 1967 (détail), p. 100

Lot 25, Tom Wesselmann, Monica lying down, one arm up (gray), 1986-90 (détail), p. 134
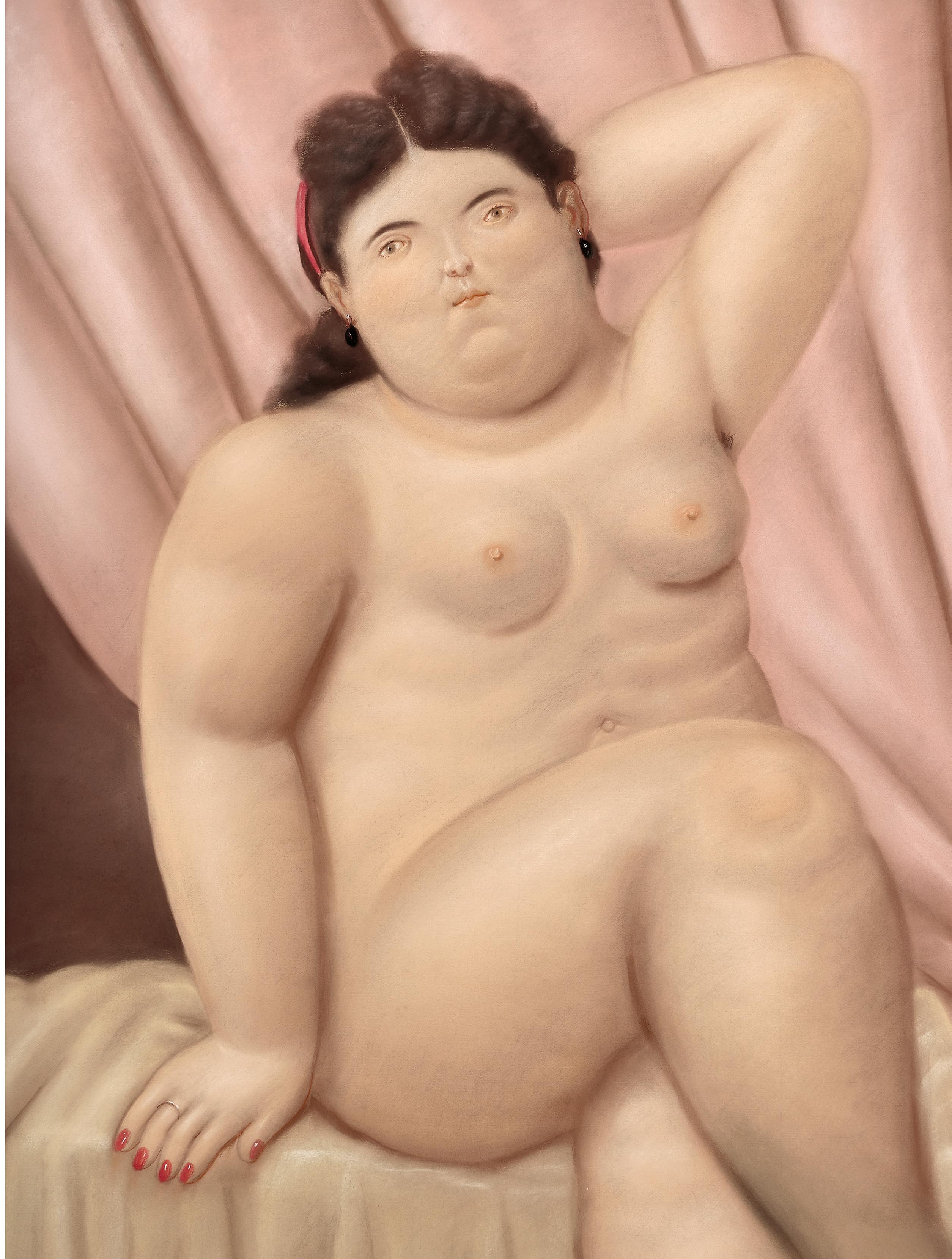
ARTS DES XXe & XXI e SIÈCLES

Isaure
Viel Castel Vice-présidente Arts des XXe & XXIe siècles

Impressionniste & Moderne Commissaire-priseur

Sinnah Administrateurcatalogueur Urban Art et Estampes & Multiples

Bruno Jaubert Directeur Impressionniste & Moderne


Hugues Sébilleau Directeur Post-War & Contemporain


Fantuzzi Administratrice Post-War & Contemporain

Directeur Urban Art Commissaire-priseur


Alexandra Michel Administratrice junior Impressionniste & Moderne
RTCURIAL DANS LE MONDE

International senior advisor

Nicolas Beurret Directeur associé
Artcurial Beurret Bailly Widmer, Suisse


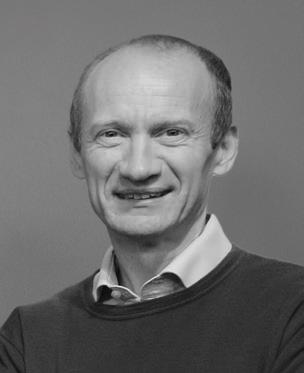
Emmanuel Bailly Directeur associé
Artcurial Beurret Bailly Widmer, Suisse

Markus Schöb Directeur associé
Artcurial Beurret Bailly Widmer, Suisse

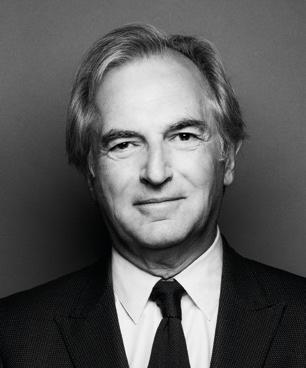
& Multiples



Alexandre Dalle Administrateur junior Bandes dessinées, Urban Art, Estampes & Multiples


et certificat
Art Moderne & Contemporain




Artcurial
Martin Guesnet
Miriam Krohne Directrice Allemagne
Olivier Berman Directeur Maroc
Florent Wanecq Spécialiste
Elodie Landais Administratricecatalogueur Impressionniste & Moderne
Sophie Cariguel Spécialiste Post-War & Contemporain
Karine Castagna Directrice Estampes
Jessica Cavalero Recherche
Francis Briest Commissaire-priseur Co-fondateur
de
Arnaud Oliveux
Emilie Volka Directrice Italie
Nadja Scribante Amstutz Directrice Suisse romande
Beurret Bailly Widmer, Suisse
Vinciane de Traux Directrice Belgique
Olga de Marzio Directrice Monaco
Florent
Louise Eber Recherche et certificat Art Moderne & Contemporain
Margot Denis-Lutard Spécialiste Art Contemporain Africain
Vanessa Favre Chef de projetExpositions culturelles et Ventes Privées
Sara Bekhedda Catalogueur Post-War & Contemporain
Beatrice
SELECTED 20/21
vente n°6195
EXPOSITION PUBLIQUE
Téléphone pendant l’exposition
Pour les lots 4, 5, 7 à 9, 11 à 14 et 23 :
Tél : +33 (0)1 42 99 20 84
Pour les lots 1 à 3, 6, 10, 15 à 22 et 24 à 28 : Tél : +33 (0)1 42 99 20 34
Dimanche 19 octobre 14h - 18h
Lundi 20 octobre 11h - 18h
Mardi 21 octobre 11h - 18h
Mercredi 22 octobre 11h - 18h
Jeudi 23 octobre 11h - 18h
Vendredi 24 octobre 11h - 18h
Samedi 25 octobre 11h - 16h
Lots 5, 14 et 15 précédés du symbole m ou sont en importation temporaire (m) ou vendus HT ( ) : Dans ces deux cas, l’adjudication est HT. La TVA au taux réduit de 5,5% s’applique sur l’adjudication et la commission de vente. Cette TVA est récupérable pour le professionnel français. Elle est remboursable pour un acheteur hors UE sur présentation des justificatifs d’exportation hors UE ou pour un adjudicataire professionnel justifiant d’un numéro de TVA intracommunautaire et d’un document prouvant la livraison dans l’État membre.
Lots 5, 14 and 15 identified with the symbol m and are either under temporary importation (m) or sold VAT excluded ( ) : In these two cases, the hammer price will be VAT excluded. 5.5% VAT will be added to the hammer price and buyer’s premium. Upon request, this VAT can be refunded to the purchaser on presentation of written proof of exportation outside the EU or to the EU purchaser who will submit his intracommunity VAT number and a proof of shipment of his purchase to his EU country home address.
VENTE AUX ENCHÈRES
Samedi 25 octobre 2025 – 16h
Commissaire-priseur Arnaud Oliveux
Vice-présidente Arts des XXe et XXIe siècles
Isaure de Viel Castel
Tél. : +33 (0)1 42 99 20 66 idevielcastel@artcurial.com
IMPRESSIONNISTE & MODERNE
Spécialiste - Directeur
Bruno Jaubert
Tél. : +33 (0)1 42 99 20 35 bjaubert@artcurial.com
Spécialiste
Commissaire-priseur
Florent Wanecq
Tél. : +33 (0)1 42 99 20 63 fwanecq@artcurial.com
Administratrice - catalogueur
Élodie Landais
Tél. : +33 (0)1 42 99 20 84 elandais@artcurial.com
Administratrice junior
Alexandra Michel
Tél. : +33 (0)1 42 99 06 14 amichel@artcurial.com
POST-WAR & CONTEMPORAIN
Spécialiste - Directeur
Hugues Sébilleau
Tél. : +33 (0)1 42 99 16 35 hsebilleau@artcurial.com
Spécialiste
Sophie Cariguel
Tél. : +33 (0)1 42 99 20 04 scariguel@artcurial.com
Catalogueur
Sara Bekhedda
Tél. : +33 (0)1 42 99 20 25 sbekhedda@artcurial.com
Administratrice
Beatrice Fantuzzi
Tél. : +33 (0)1 42 99 20 34 bfantuzzi@artcurial.com
RECHERCHE ET AUTHENTIFICATION
Jessica Cavalero
Tél. : +33 (0)1 42 99 20 08 jcavalero@artcurial.com
Marine Oriente
Tél. : +33 (0)1 42 99 20 48 moriente@artcurial.com
Catalogue en ligne www.artcurial.com
Comptabilité acheteurs
Tél. : +33 (0)1 42 99 20 71 salesaccount@artcurial.com
Comptabilité vendeurs
Tél. : +33 (0)1 42 99 17 00 salesaccount@artcurial.com
Transport et douane Inès Tekirdaglioglu
Tél. : +33 (0)1 42 99 16 37 itekirdaglioglu@artcurial.com
Ordres d’achat, enchères par téléphone
Tél. : +33 (0)1 42 99 20 51 bids@artcurial.com
Assistez en direct aux ventes aux enchères d’Artcurial et enchérissez comme si vous y étiez, c’est ce que vous offre le service Artcurial Live Bid.
Pour s’inscrire: www.artcurial.com
Vous avez également la possibilité d’enchérir en direct pendant la vente via les plateformes Drouot Live et Invaluable.
Couverture
Lot n°8 - Alberto Giacometti (détail)
Lot n°15 - Sayed Haider Raza
Photographes
Nohan Ferreira
Studio Sebert-Ooshoot
Graphiste
Ambre Quemin
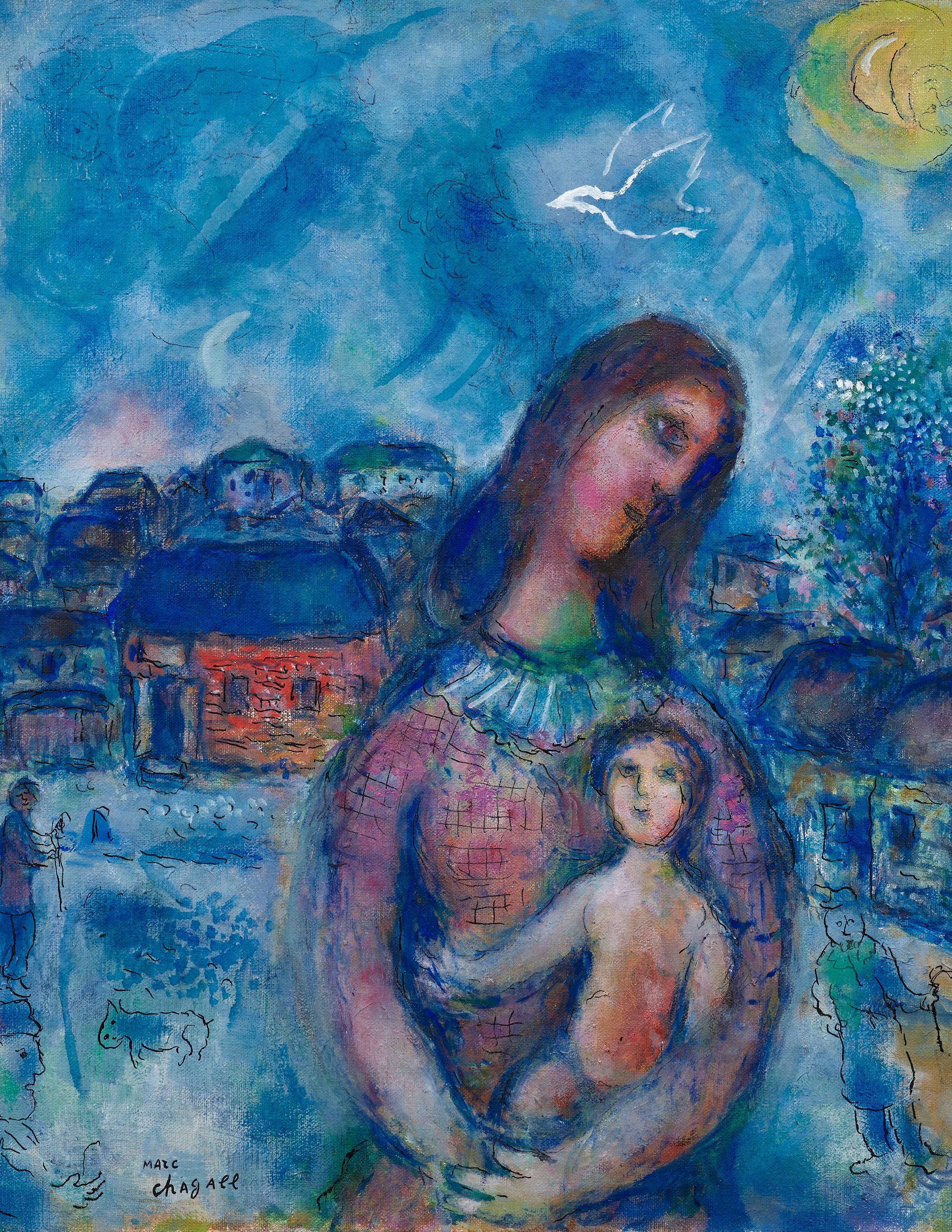
Lot 4, Marc Chagall, Maternité sur fond bleu, 1976, p. 24
INDEX DES ARTISTES
L
C
Fernando BOTERO – 11
Alexander CALDER – 6
CÉSAR – 24
Marc CHAGALL – 4
CHRISTO – 22
Robert COMBAS – 26
DJean DUBUFFET – 1
G
Alberto GIACOMETTI – 8
H
Simon HANTAÏ – 2, 3
Jean HÉLION – 14
K
Anish KAPOOR – 16
Joseph KOSUTH – 28
Wifredo LAM – 10
Fernand LÉGER – 7
Baltasar LOBO – 12
M
Robert MANGOLD – 27
André MASSON – 9
Georges MATHIEU – 19
P
Francis PICABIA – 13
Serge POLIAKOFF – 18, 20
R
Sayed Haider RAZA – 15
S
Jesús Rafael SOTO – 17
Pierre SOULAGES – 21
T
Joaquín TORRES-GARCÍA – 5
W
Tom WESSELMANN – 25
ZOssip ZADKINE – 23
Crédits photographiques
Pour les artistes listés ci-dessous, le copyright est le suivant : © Adagp, Paris, 2025
Fernando Botero, Marc Chagall, Christo, Robert Combas, Jean Dubuffet, Jean Hélion, Joseph Kosuth, Fernand Léger, Baltasar Lobo, André Masson, Georges Mathieu, Serge Poliakoff, Sayed Haider Raza, Jesús Rafael Soto, Pierre Soulages, Tom Wesselmann, Ossip Zadkine
Alexander Calder : © 2025 Calder Foundation, New York / ADAGP, Paris
César : © SBJ / Adagp, Paris 2025
Alberto Giacometti : © Succession Alberto Giacometti / Adagp, Paris 2025
Anish Kapoor (p. 91) : © 2025 Anish Kapoor. All rights Reserved, DACS Images / ADAGP, Paris 2025
Anish Kapoor (deuxième de couverture) : © Vincent Everarts
Wifredo Lam : © Succession Wifredo Lam, Adagp, Paris, 2025
Jean DUBUFFET
1901-1985
Jindrinvince – 1962
Gouache sur papier
Signé et daté en bas vers la droite « J. Dubuffet, 62 » 67 × 45 cm
Provenance :
Collection de l’artiste
Galerie Beyeler, Bâle
Galerie Charles Kriwin, Bruxelles
Acquis directement auprès de cette dernière par l’actuel propriétaire
Exposition :
Paris, Galerie Daniel Cordier, Dubuffet : Paris Circus, juin-juillet 1962, n°57
Amsterdam, Stedelijk Museum, Jean Dubuffet : tekeningen, gouaches, novembre 1964-janvier 1965, n°177 Morges (Suisse), Musée Alexis Forel, Jean Dubuffet : dessins, gouaches, lithographies provenant de la collection personnelle de l’artiste, mars-avril 1967, n°69
Bâle, Kunstmuseum, Jean Dubuffet : Zeichnungen, Aquarelle, Gouachen, Collagen, juin-août 1970, n°113
New York, The Pace Gallery, Dubuffet : works on paper, mars-avril 1971, n°34
Bibliographie :
M. Loreau, Catalogue des travaux de Jean Dubuffet, Paris Circus, fascicule XIX : Paris Circus, Éditions
Jean-Jacques Pauvert, Lausanne, 1965, reproduit en noir et blanc sous le n°414, p. 186
Andreas Franzke, Dubuffet, Editions
Harry N. Abrams, New York, 1981, p. 151
Nous remercions la Fondation Dubuffet pour les informations qu’elle nous a aimablement communiquées.
Cette œuvre a été réalisée le 15 mai 1962.
Gouache on paper; signed and dated lower right; 26 × 16 ⅞ in.
200 000 - 300 000 €

Jindrinvince – 1962

Après sept années passées à Vence, à explorer les environs, armé d’un filet à papillons et d’une loupe de naturaliste (recherches qui donnèrent naissance aux séries des Matériologies, Texturologies et autres Topographies), Jean Dubuffet retrouve la capitale en 1955. Paris incarne pour l’artiste le théâtre de la vie sociale et urbaine, un laboratoire de métamorphoses et de spectacles permanents, avec ses magasins, ses façades, ses rues, ses automobiles, sa foule et sa frénésie… Naît de cette profusion visuelle et sonore, la série Paris Circus
Dans sa correspondance, Dubuffet insiste : il ne cherche pas à échapper à la figuration, mais à la réinventer par des voies inédites. Aux matériaux épais et terreux de ses travaux antérieurs succèdent des graphismes effervescents et des couleurs criardes.
Désormais, son regard se tourne vers la vie urbaine plutôt que vers la nature ou le monde minéral. L’art devient pour lui un moyen de dépouiller l’ordinaire et de faire surgir un regard neuf sur les êtres, la ville et la vie quotidienne.
La genèse de Paris Circus repose sur une volonté assumée : retranscrire des objets donnés, puis les transformer.
Dubuffet s’empare de formes déjà établies, les déforme et les projette dans le tumulte urbain pour engendrer des figures vibrantes. La cité se voit traversée par les turbulences de la matière, tandis que du chaos surgissent des silhouettes maladroites mais animées d’une nouvelle intensité.
Le prolongement naturel de ce cycle conduit à la série des Légendes
After seven years in Vence, exploring the surroundings armed with a butterfly net and a naturalist’s magnifying glass (research that gave rise to the Matériologies, Texturologies, and Topographies series), Jean Dubuffet returned to Paris in 1955. For the artist, the city embodied the theatre of social and urban life, a laboratory of constant metamorphoses and spectacles, with its shops, façades, streets, cars, crowds, and frenzy… From this visual and auditory abundance emerged the Paris Circus series. In his correspondence, Dubuffet emphasizes that he was not seeking to escape figuration but to reinvent it through new means. The thick, earthy materials of his earlier works were replaced by effervescent graphics and garish colours. His attention now turned to urban life rather than
nature or the mineral world. Art became for him a way to strip away the ordinary and reveal a fresh perspective on people, the city and everyday life.
The genesis of Paris Circus rested on a deliberate intention: to depict given objects and then transform them. Dubuffet took already established forms, distorted them and projected them into the urban tumult to generate vibrant figures. The city is traversed by the turbulence of matter, while from the chaos emerge awkward but intensely animated silhouettes.
The natural continuation of this cycle led to the Légendes series. Opposite to the previous approach, Dubuffet adopted a process based on lines, spots and erratic forms, entirely devoid of prior intention.
Jean Dubuffet, Le Folâtreur, 1961

Jean DUBUFFET 1901-1985
Jindrinvince – 1962

À l’opposé de la démarche précédente, Dubuffet y adopte un processus fondé sur des lignes, des tâches et des formes erratiques, dénuées d’intention préalable.
Dans ce graphisme indéterminé, l’artiste décèle peu à peu des personnages en devenir. L’œuvre procède désormais d’une trame abstraite et arbitraire, où la matière devient le terrain d’apparitions inattendues, de silhouettes à peine formées, plus griffonnées que définies. L’artiste explique dans une lettre du 14 mai 1961 : « C’est de ce goût que relève tout l’art appelé improprement et pédantesquement ‘informel’ (tâches, salissures, etc.). Il faut remarquer, en effet, que tout cet art est en quête de formes et pas du tout d’absence de formes, s’agissant seulement de registres de formes différents de ceux utilisés traditionnellement.
On pourrait plus justement qualifier ces formes d’antigéométriques. Elles sont en effet beaucoup plus complexes que les formes géométriques, et infiniment plus riches ».
Dans la série des Légendes, l’œuvre intitulée Légende du Bonheur (1961) est considérée comme la première toile et l’incarnation précoce et fondatrice des recherches de l’artiste. Elle sera suivie par l’épisode Exodus, constitué de dessins à l’encre.
Puis le 15 mai 1962, Dubuffet réalise Jindrinvince. De l’entrelacs chaotique de tâches de couleurs éclatantes et de lignes noires biscornues émerge la silhouette d’un personnage en pied.
L’artiste trace une ligne qui n’est ni droite ni circulaire composant une multitude de formes organiques. Tout semble mouvant, instable, comme pris dans un flux
Within this indeterminate graphic, the artist gradually discerned figures in the making. The work now proceeded from an abstract and arbitrary framework, where matter became the ground for unexpected appearances, figures barely formed, more scribbled than defined. In a letter dated May 14, 1961, the artist explained: “It is from this taste that all art improperly and pedantically called ‘informal’ (spots, smudges, etc.) derives. It should be noted that all this art is in search of forms and not at all the absence of forms, involving only registers of forms different from those traditionally used. These forms could more justly be called anti-geometric. They are, in fact, much more complex than geometric forms, and infinitely richer”.
Within the Légendes series, the work Légende du Bonheur (1961)
is considered the first painting and the early, foundational embodiment of the artist’s explorations. It was followed by the Exodus episode, consisting of ink drawings.
On May 15, 1962, Dubuffet created Jindrinvince. From the chaotic interplay of bright coloured spots and crooked black lines emerged a full-length figure. The artist drew lines that were neither straight nor circular, composing a multitude of organic forms. Everything seems in motion, unstable, caught in a flux of perpetual transformation. No reference points, no plan, no centre remain, only a clownish, excessively saturated atmosphere. The impulses of the lines in this gouache produce a non-fixed representation, entirely in motion, giving rise to a whimsical and jubilant being, as a child might
En Fr
Jean Dubuffet, Emplettes hâtives, 1961 © DR
en perpétuelle métamorphose. Plus de repères, plus de plan ni de centre : seule une atmosphère bouffonne et saturée à l’excès demeure. Les impulsions des lignes de cette gouache créent une représentation non figée, toute en mouvement, engendrant un être fantasque et jubilatoire, tel que l’imaginerait un enfant, comme si le monde réel se trouvait affecté par un vent de folie.
Le titre de l’œuvre (Jindrinvince), dénué de sens, rappelle également l’attirance de Dubuffet pour l’art des fous, dont il admire la force créatrice. Il décrit sa méthode comme « totalement non-intentionnelle », l’assimilant à la spontanéité de l’art brut. Il cherche à entrouvrir les vannes de l’imaginaire dans le quotidien, convaincu que les sujets les plus dérisoires recèlent un potentiel pictural réjouissant et une magie inédite. « J’ai souvent considéré
l’œuvre comme une prise directe sur les mécanismes de l’esprit […] », confie-t-il. Les Légendes sont donc aussi un hommage à ceux qui, depuis leur aliénation, lui ont permis de mieux saisir ses propres aspirations.
Les séries Paris Circus et Légendes couvrent la période allant de février 1961 à juillet 1963. Dubuffet passe de l’une à l’autre à la recherche d’une confluence entre ces deux courants créateurs mais contraires. L’artiste les fait dialoguer en explorant le visible qui tend vers l’informe et l’informe qui tend vers la forme. Il ne s’agit pas d’une synthèse mais d’un conflit créatif, un geste formateur doublé d’une déformation, où lignes et couleurs engendrent des phénomènes inédits hors des codes traditionnels.
De cette recherche naîtra une nouvelle série baptisée Hourloupe
imagine it, as if the real world had been swept by a gust of madness. The title of the work (Jindrinvince), devoid of meaning, also recalls Dubuffet’s fascination with the art of the insane, whose creative force he admired. He described his method as “entirely non-intentional”, likening it to the spontaneity of Art Brut. He sought to open the floodgates of imagination within everyday life, convinced that even the most trivial subjects held a delightful pictorial potential and a unique kind of magic. “I have often regarded the artwork as a direct engagement with the mechanisms of the mind […]”, he confided. The Légendes thus also serve as a tribute to those who, from their own alienation, allowed him to better understand his own artistic aspirations.
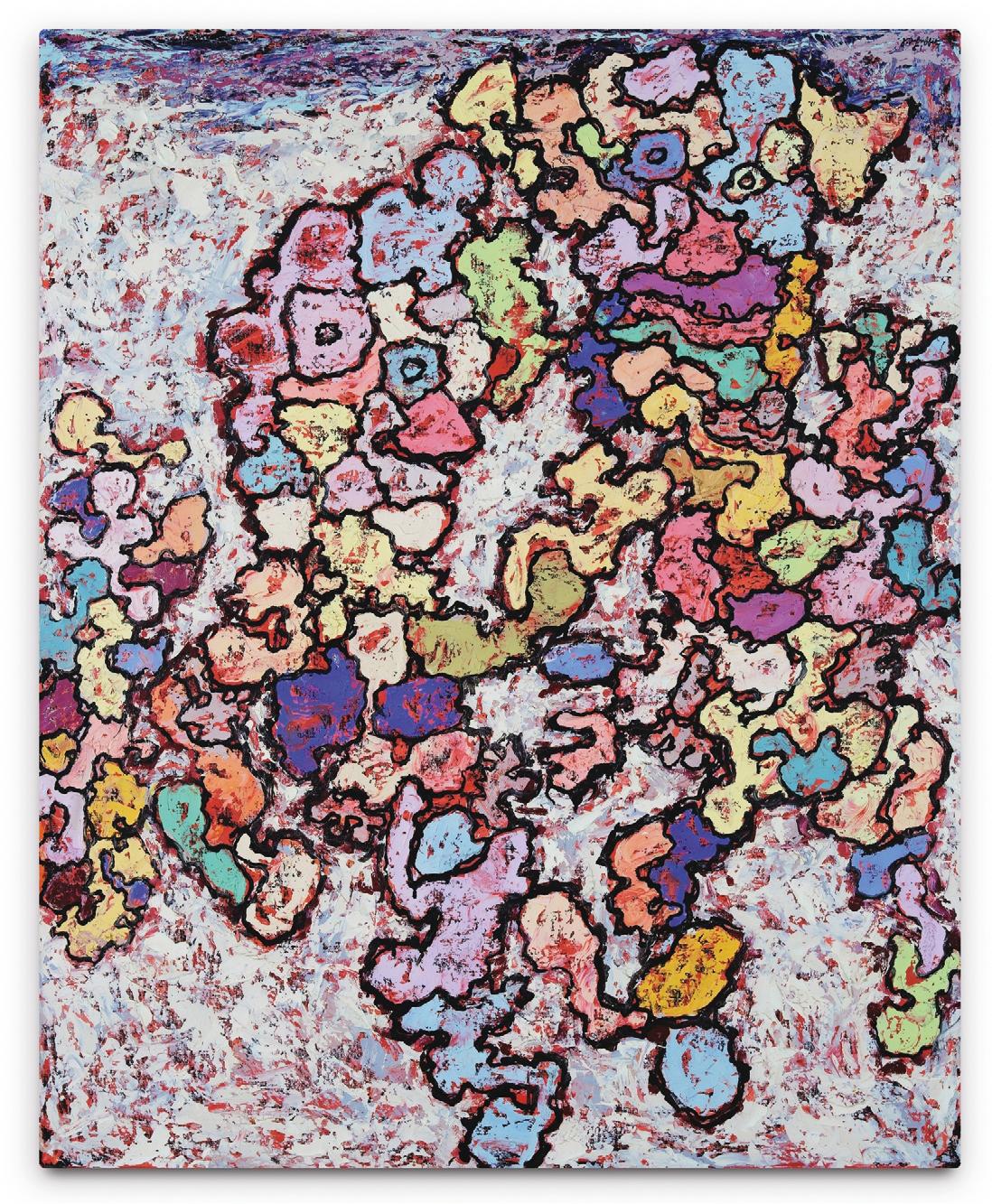
The Paris Circus and Légendes series span the period from February 1961 to July 1963. Dubuffet moved between them in search of a confluence between these two creative yet opposing currents. The artist made them interact by exploring the visible tending toward the formless and the formless tending toward the visible. This was not a synthesis but a creative conflict, a gesture of formation coupled with deformation, where lines and colours produced unprecedented phenomena beyond traditional codes.
From this exploration emerged a new series called Hourloupe.
Jean Dubuffet, Légende du bonheur, 1961
1922-2008
Aquarelle
Aquarelle sur toile
Porte au dos le numéro « A.3.1.255 »
49,50 × 38 cm
Provenance :
Don de l’artiste à l’actuel propriétaire
Bibliographie :
Cette œuvre sera incluse dans le Catalogue Raisonné de l’Œuvre de l’artiste actuellement en préparation par les Archives Simon Hantaï.
Cette œuvre est enregistrée dans les Archives Simon Hantaï sous le n°A 3.1.255.
Watercolour on canvas; bears a number on the reverse; 19 ½ × 15 in.
40 000 - 60 000 €

Simon HANTAÏ
1922-2008
Aquarelle
« La peinture existe parce que j’ai besoin de peindre. Mais cela ne peut suffire. Il y a une interrogation sur le geste qui s’impose. Le problème était : comment vaincre le privilège du talent, de l’art, etc. ? Comment banaliser l’exceptionnel ? Comment devenir exceptionnellement banal ? Le pliage était une manière de résoudre ce problème. Le pliage ne procédait de rien. Il fallait simplement se mettre dans l’état de ceux qui n’ont encore rien vu, se mettre dans la toile. On pouvait remplir la toile pliée sans savoir où était le bord. On ne sait plus alors où cela s’arrête. On pouvait même aller plus loin et peindre les yeux fermés », déclare Simon Hantaï. Dès 1960, l’artiste développe le pliage, qui s’impose rapidement comme le cœur de son œuvre. En pliant la toile avant de la peindre « à l’aveugle », il associe rigueur et hasard, introduisant une dimension inédite de liberté dans son processus créatif. En 1968, Simon Hantaï inaugure la série des Études, où le pliage devient une véritable méthode de création. La toile, froissée par un système de plis réguliers et systématiques puis recouverte
d’une seule couleur – il s’agit ici d’aquarelle bleue – s’ouvre, une fois dépliée, sur un réseau de réserves blanches. D’abord marginal, le blanc s’impose peu à peu comme l’égal de la couleur, jusqu’à structurer l’espace pictural. Il organise la composition et instaure une expérience visuelle fondée sur l’équilibre entre le vide et le plein.
Dans ce processus, Hantaï choisit de s’effacer : la main n’intervient plus pour tracer, mais seulement pour étaler la couleur, laissant au pliage le soin de générer formes et rythmes. Inspirée par l’« all over » américain, cette pratique aborde la surface comme un champ continu, affranchi de la hiérarchie traditionnelle. La toile n’est plus un simple support, mais devient un acteur à part entière de l’œuvre, participant directement à sa genèse.
Les Études sont présentées dès 1969, puis mises en lumière lors de la rétrospective Le pliage comme méthode à la Galerie Jean Fournier en 1971.
L’œuvre présentée ici témoigne parfaitement de la maîtrise technique et du talent de coloriste de Simon Hantaï.
“Painting exists because I need to paint. But that alone is not enough. There is a questioning of the gesture that inevitably arises. The problem was: how to overcome the privilege of talent, of art, etc.? How to make the exceptional ordinary? How to become exceptionally ordinary? Folding was a way to resolve this problem. Folding proceeded from nothing. One simply had to place oneself in the state of those who have not yet seen anything, to enter into the canvas. The folded canvas could be filled without knowing where the edge was. One no longer knew where it ended. One could even go further and paint with eyes closed”, declared Simon Hantaï. From 1960 onwards, the artist developed the technique of folding, which quickly became the core of his work. By folding the canvas before painting it “blind”, he combined rigour and chance, introducing a new dimension of freedom into his creative process.
In 1968, Simon Hantaï began the Études series, in which folding became a true method of creation. The canvas, crumpled through a system of regular and systematic folds, was then covered with a
single colour –in this case, blue watercolour– and when unfolded revealed a network of white reserves. At first marginal, the white gradually asserted itself as equal to colour, until it came to structure the pictorial space. It organized the composition and established a visual experience based on the balance between void and fullness.
In this process, Hantaï chose to withdraw: the hand no longer intervened to draw, but only to spread the paint, leaving the folding to generate forms and rhythms. Inspired by American all-over painting, this practice approached the surface as a continuous field, freed from traditional hierarchy. The canvas was no longer a mere support, but became an active participant in the work, directly involved in its genesis.
The Études were first presented in 1969 and later highlighted in the retrospective “Le pliage comme méthode” at Galerie Jean Fournier in 1971.
The work presented here is a perfect testimony to Simon Hantaï’s technical mastery and his talent as a colourist.

Simon HANTAÏ
1922-2008
Tabula – 1981
Acrylique sur toile
Signée des initiales et datée deux fois en bas à droite et en haut à gauche à l’envers « S.H., 81 », contresignée des initiales et datée au dos « S.H., 81 » 238,5 × 169 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris (acquis directement auprès de l’artiste) À l’actuel propriétaire par descendance
Bibliographie :
Cette œuvre sera incluse dans le Catalogue Raisonné de l’Œuvre de l’artiste actuellement en préparation par les Archives Simon Hantaï.
Acrylic on canvas; 94 × 66 ½ in.
200 000 - 300 000 €
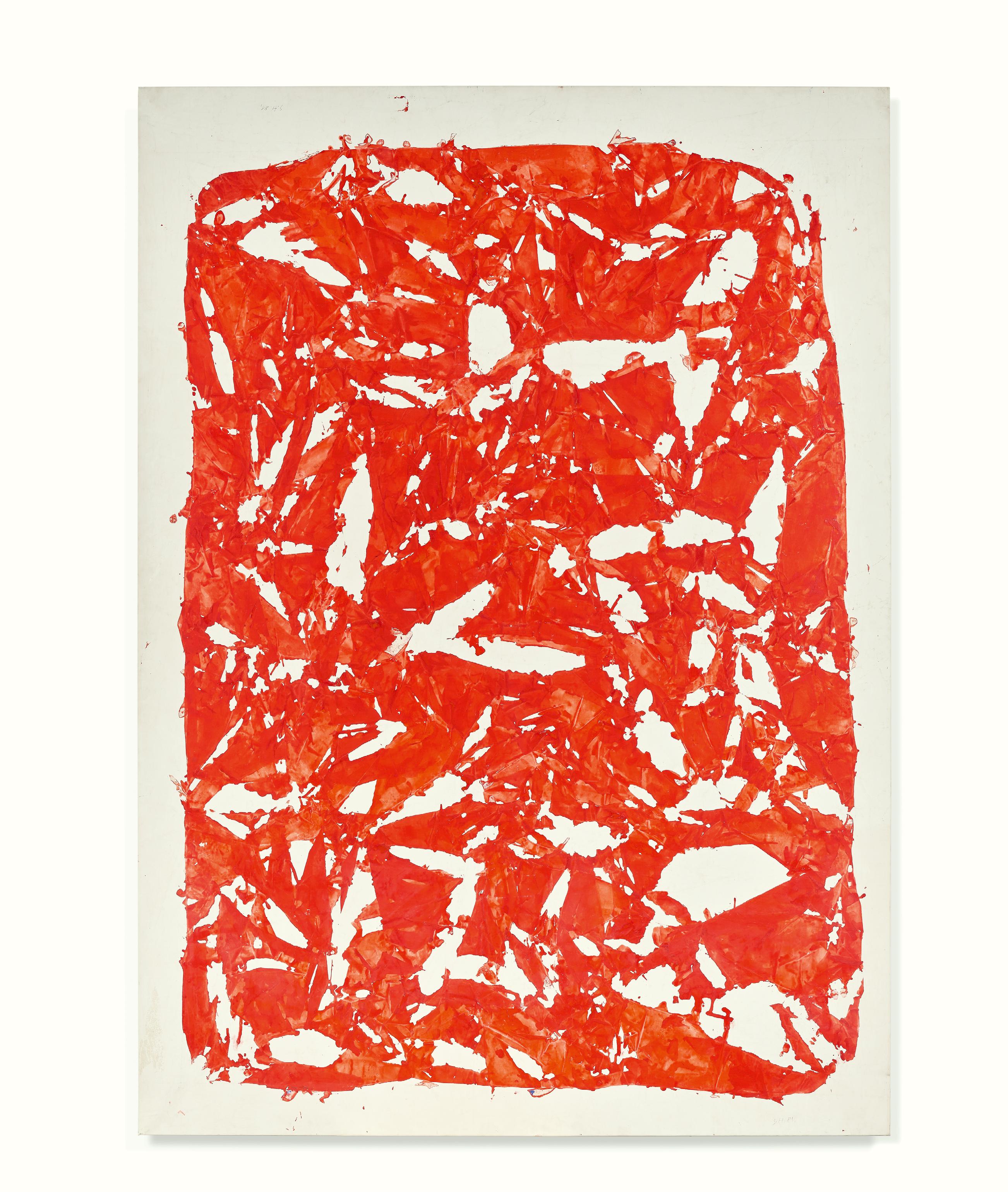
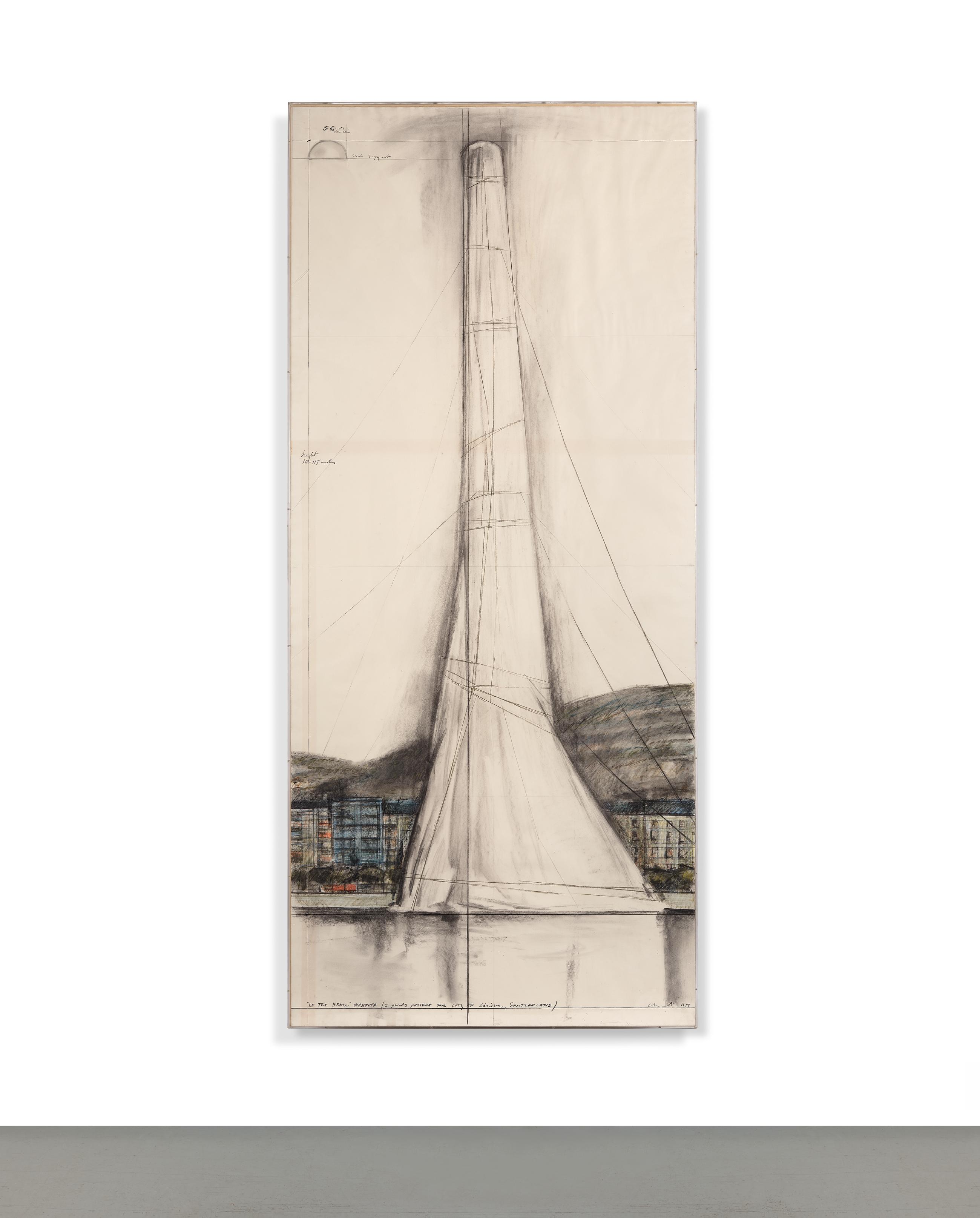
Tabula
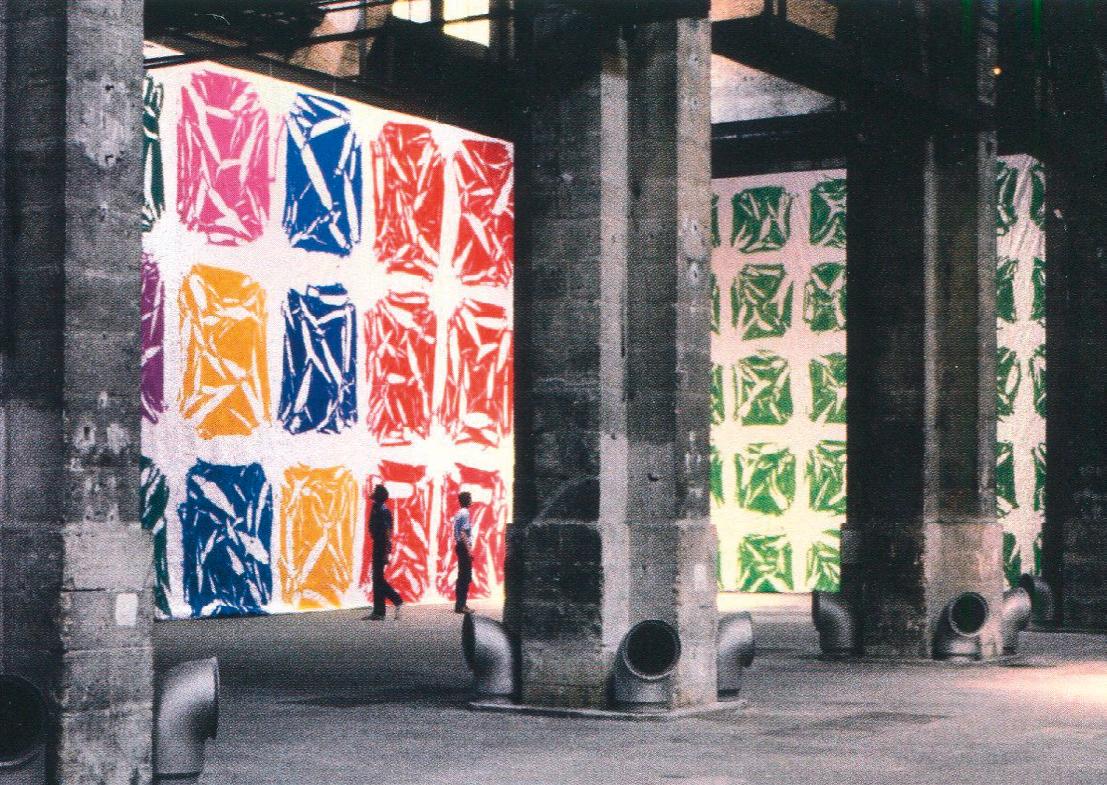
Dans la préface du catalogue de la première exposition personnelle de Simon Hantaï en 1953, André Breton affirme que le peintre est porté par « la lumière du jamais vu ». Le pliage deviendra pour l’artiste l’aboutissement de cette quête de l’inédit, une manière de rendre l’exceptionnel banal et d’ouvrir la peinture à l’infini. Progressivement, sa réflexion se concentre sur l’espace pictural, réalisant notamment des œuvres monumentales. Le but est d’immerger le spectateur dans l’œuvre et de l’intégrer dans le processus de création. La série des Tabulas en constitue l’exemple le plus abouti. La première série s’étend de 1972 à 1976 et la seconde, de 1980 à 1982.
L’œuvre Tabula présentée ici, datée de 1981, appartient à cette dernière série qui fait suite à une longue pause de plus de trois ans dans la carrière de l’artiste, qui se dit las du marché de l’art. Elle procède donc d’une période de réflexion intense et représente ainsi l’apogée de la production de Hantaï.
Après avoir soumis sa toile à une succession de pliages, dépliages, repliements et dépliements,
et appliqué la couleur à l’aveugle, l’artiste, au terme de cette démarche, la déploie : apparaissent alors des réserves et des étoilements, que Hantaï qualifie d’« éclatements spatialisant ». La toile, parcourue de nervures et de plis conserve la mémoire du processus de création. La puissance de la couleur, nourrie de variations de tonalité et d’épaisseur de la matière, s’exprime ici dans ce rouge éclatant, qui dialogue avec le fond blanc dans un contraste saisissant. Hantaï valorise le blanc qui représente pour lui la lumière et qui fait vibrer la couleur. La lumière, confie-t-il, « est nécessairement le fondement du monde, le symbole d’une ouverture sur l’infini… ».
Par son format imposant (près de 2,40 mètres de haut), la force de sa couleur et sa provenance prestigieuse, cette œuvre témoigne de l’importance que Simon Hantaï accorde aussi bien au blanc qu’à la couleur, au fond qu’à la forme. Elle incarne pleinement l’esprit créatif de l’artiste, sa faculté à réinventer sans cesse son langage pictural et à repousser les limites de la peinture traditionnelle.

In the preface to the catalogue of Simon Hantaï’s first solo exhibition in 1953, André Breton asserts that the painter is guided by “the light of the never-seenbefore”. For the artist, folding would become the culmination of this quest for the unprecedented, a way of making the exceptional ordinary and opening painting to infinity. Gradually, his reflection turned to pictorial space, leading him to create, in particular, monumental works. The aim was to immerse the viewer in the work and to integrate him into the creative process. The Tabulas series represents the most accomplished example of this approach. The first series spans from 1972 to 1976, and the second, from 1980 to 1982.
The Tabula presented here, dated 1981, belongs to the latter series, which followed a long pause of over three years in the artist’s career, during which he grew weary of the art market. It thus emerges from a period of intense reflection and represents the pinnacle of Hantaï’s production.
After subjecting the canvas to a succession of folds, unfolds, refolds and unfoldings, and
applying colour blindly, the artist finally unfolds it: reserves and starlike patterns appear, which Hantaï calls “spatializing bursts”. The canvas, marked with ridges and creases, retains the memory of the creative process. The power of the colour, enriched by variations in tone and thickness of the medium, is expressed here in a brilliant red, engaging in a striking contrast with the white background. Hantaï emphasizes white, which for him represents light, and makes the colour vibrate. As he explains, light “is necessarily the foundation of the world, the symbol of an opening onto infinity…”.
By its imposing size (nearly 2.40 meters high), the intensity of its colour and its prestigious provenance, this work demonstrates the importance Simon Hantaï attaches to both white and colour, to background and form. It fully embodies the artist’s creative spirit, his ability to continually reinvent his pictorial language and his drive to push the boundaries of traditional painting.
Exposition Simon Hantaï au Capc de Bordeaux, 1981
© Daniel Hantaï
Simon Hantaï dans l’atelier de Maisons-Alfort, 1981
© Édouard Boubat

Marc CHAGALL
1887-1985
Maternité sur fond bleu – 1976
Huile, tempera et encre de Chine sur toile
Cachet de la signature en bas à gauche « MArC/chAgAll »
46,30 × 38 cm
Provenance :
Succession de l’artiste
Collection particulière européenne À l’actuel propriétaire par cessions successives
Un certificat du Comité Marc Chagall sera remis à l’acquéreur.
Oil, tempera and India ink on canvas, stamp of the signature lower left; 18 ¼ × 15 in.
460 000 - 560 000 €
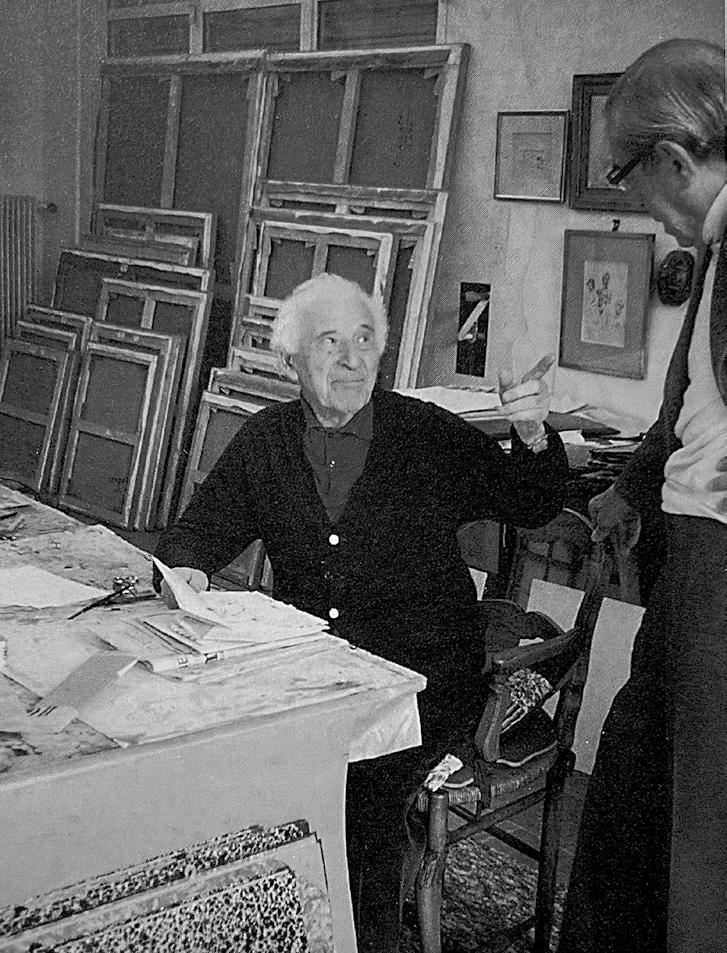

Marc Chagall à l’atelier de La Colline, Saint-Paul-de-Vence, mai 1977
© DR Scannez le QR code pour découvrir la vidéo de l’œuvre
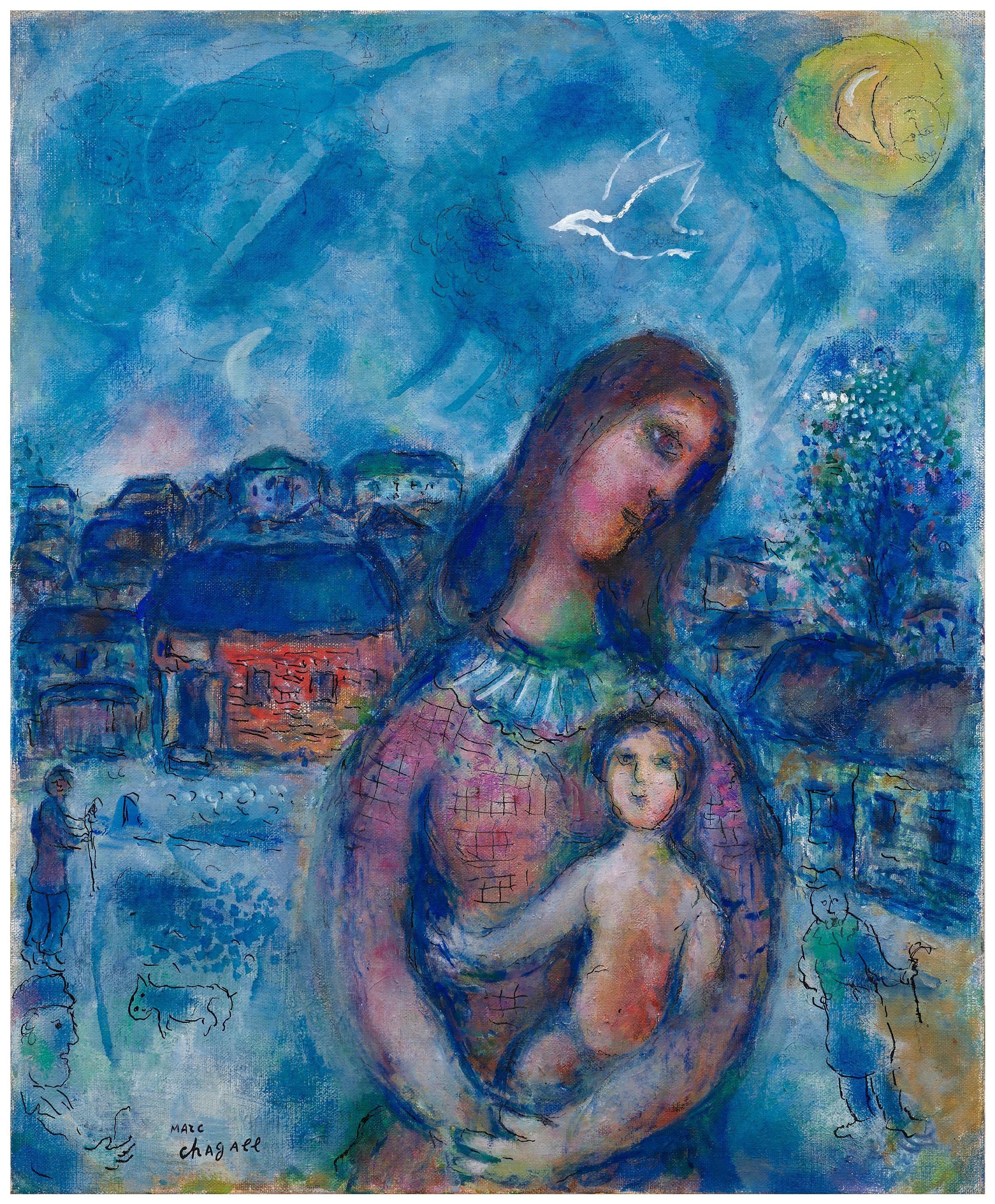
Marc CHAGALL
1887-1985
Maternité sur fond bleu – 1976
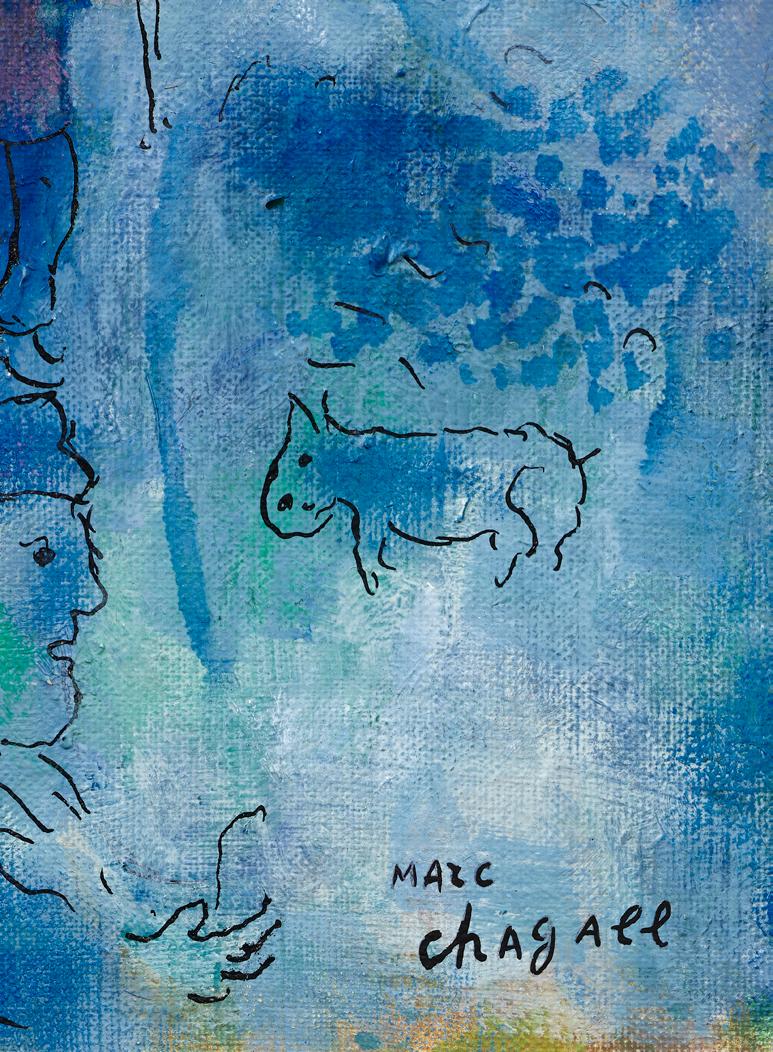
La représentation de la maternité est un sujet récurrent dans l’œuvre de Marc Chagall. Thème plus généralement abordé sous les traits des Vierge à l’Enfant dans la peinture occidentale, il est ici transposé dans un monde juif rêvé. Chagall est en effet profondément marqué par la représentation de la figure maternelle, célébrant l’amour filial à travers notamment l’image de sa femme Bella et de leur fille Ida.
Ici, la mère et son enfant apparaissent comme flottant au centre d’un village, comme si la mère présentait à tous son enfant né au sein du shtetl, ces quartiers où vivaient les communautés juives de Russie et d’Europe de l’Est avant la Seconde Guerre mondiale. La mère est au centre du monde sans le dominer. Elle s’intègre dans un univers cosmique, onirique et protecteur. L’enfant est représenté dans une position
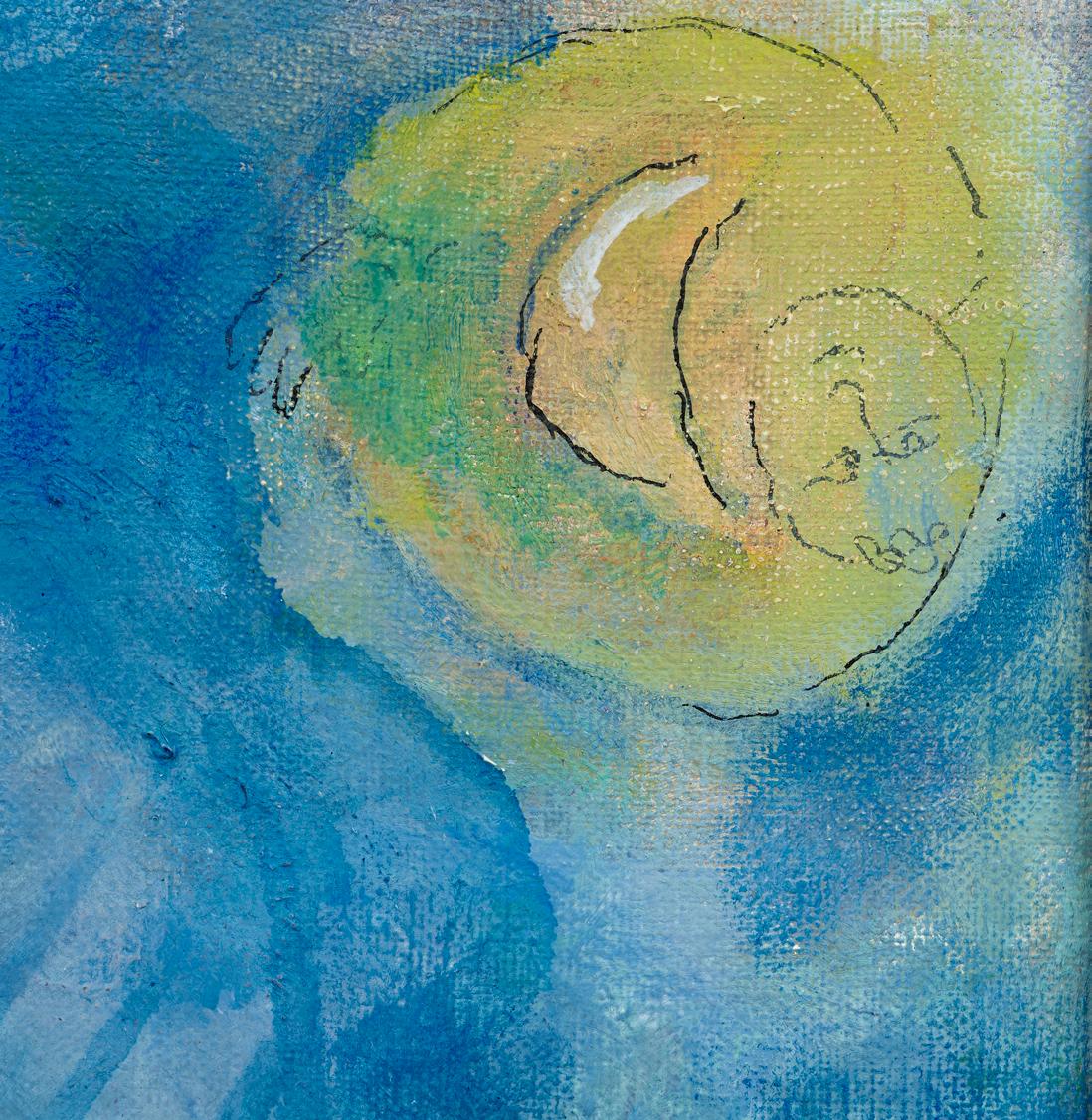
d’accueil, éveillé, symbolisant le renouveau, l’avenir, la renaissance après les épreuves traversées. Autour d’eux, des personnages, représentés tout en transparence, renforcent l’atmosphère irréelle, presque onirique de la scène. Ces personnages bien qu’esquissés ne sont pas anecdotiques, ils sont les témoins, les gardiens du miracle de la vie.
Ainsi on distingue en haut à gauche, un couple de personnes âgées portant également un nouveau-né dans leurs bras. Ces trois petits personnages, flottant dans le ciel, ne seraient-ils pas l’incarnation de la présentation du nouveau-né à des grands-parents défunts ? En pendant de ces trois personnages, Chagall choisit de représenter un petit ange, la tête renversée, au cœur de la Lune qui occupe l’angle supérieur droit de la toile. La Lune, image protectrice, peut également être vue comme
Marc Chagall regularly depicted motherhood in his works. A theme most often addressed in Western paintings in the form of a Madonna with Child, here it is transposed to an imaginary Jewish world. Profoundly marked by the depiction of mother figures, Chagall celebrated filial love, in particular, with the image of his wife Bella and their daughter Ida. Here, the mother and her child seem to float in the middle of a village, as if the mother were presenting to everyone her child born in the midst of the shtetl, the neighbourhoods in which Jewish communities of Russia and Eastern Europe lived before the Second World War. The mother is at the centre of the world without dominating it. She is a part of a cosmic, dreamlike, and protective universe. The child is portrayed in a welcoming, alert position that symbolises revival, the future, and
rebirth after hardships endured. Around them, the translucent characters reinforce the scene’s unreal, almost dreamlike atmosphere. These characters, although simple sketches, are far from inconsequential. They are the witnesses, the guardians of the miracle of life. Thus, in the top left-hand corner, we make out an elderly couple also carrying a newborn child. Could these three small characters, floating in the sky, be the incarnation of the newborn child’s presentation to its deceased grandparents? As a counterpart to these three characters, Chagall chose to portray a small angel, her head tilted backwards, in the middle of the moon that occupies the top right-hand corner of the painting. The moon, a symbol of protection, can also considered as a guardian watching over the mother and her child.
En Fr
Maternité sur fond bleu (détail)
Maternité sur fond bleu (détail)
une gardienne veillant sur la mère et son enfant. Elle est aussi symbole du renouveau, comme peut l’être la naissance d’un enfant.
Juste au-dessus de la mère et de l’enfant notre œil est attiré par les traits blancs d’une colombe. Ce symbole de paix et de protection est redoublé par la représentation d’un mouton, à peine esquissé, également présent au-dessus de la tête de la mère. Le mouton peut être associé à des références religieuses, évoquant la douceur, la vulnérabilité, ainsi que la souffrance dans le cadre des traditions chrétiennes et juives
Cependant, ici, il semble davantage être perçu comme une évocation de l’innocence, de la simplicité et comme faisant un lien entre le monde terrestre et le monde spirituel, puisque volant dans les airs, tout en légèreté.
Notre maternité est nimbée de bleu : le bleu, couleur récurrente dans l’œuvre de Marc Chagall,
plonge les personnages dans un monde onirique ; le bleu devient alors la couleur du rêve, du mystère, de l’intériorité ; mais le bleu renvoie également au ciel, lieu de l’invisible, du divin, des anges, participant ainsi à l’élévation spirituelle. Aussi retrouvons-nous le bleu en majesté pour les vitraux d’une des chapelles de l’Église
Notre-Dame-de-Toute-Grâce du plateau d’Assy que Chagall réalise en 1956-1957 ou encore pour les vitraux de la synagogue de l’hôpital de Hadassah à Jérusalem en 1958 et de ceux de la cathédrale de Metz en 1959.
Par l’utilisation du bleu, Chagall cherche à envelopper ses mariées, ses maternités, ses couples enlacés d’une aura protectrice et douce, créant ainsi une ambiance paisible, propice à la contemplation de l’amour. Chagall nous invite ainsi à la méditation, à l’émerveillement et transforme ici la maternité en une expérience sacrée et intemporelle.
The moon is also a symbol of revival, as can be the birth of a child.
The white outline of a dove just above the mother and child catches our attention. This symbol of peace and protection is amplified by a lightly sketched representation of a sheep, also visible above the mother’s head. The sheep can be associated with religious references, calling to mind gentleness, vulnerability, and suffering in Christian and Jewish traditions.
Yet, here, it seems rather to be perceived as the suggestion of innocence and simplicity, and as a link between the earthly world and the spiritual realm, as it is flying, weightlessly, in the air.
Our motherhood is enshrouded in blue. Blue is the recurring colour in Marc Chagall’s works, which immerses his characters in a dreamlike world. Blue becomes the colour of dreams, mystery, and

intimacy. The colour blue, as it also calls to mind the sky, a place for things invisible, for the divine, and for angels, thus participates in spiritual elevation. The colour blue is also showcased in the stained glass windows that Chagall made in 1956-1957 for one of the chapels of the church of Notre-Dame-deToute-Grâce du Plateau d’Assy, the stained glass windows of Hadassah Hospital synagogue in Jerusalem, dating from 1958, and those of Metz Cathedral from 1959.
In using the colour blue, Chagall sought to enshroud his brides, motherhoods, and embracing couples in a gentle, protective aura, creating a peaceful atmosphere, favourable for contemplating love. In this way, Chagall invites us to meditate and marvel, as with this work, he transforms motherhood into a sacred and timeless experience.
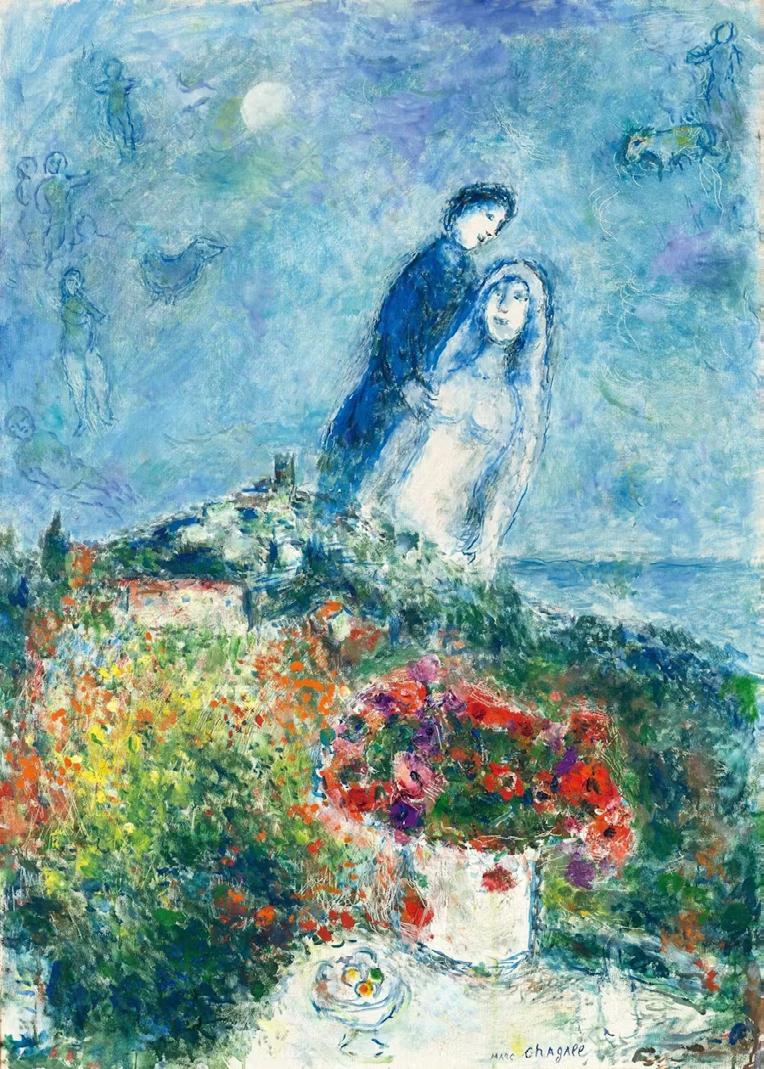
Marc Chagall, Les fiancés aux anémones, 1979 Huile sur toile, collection particulière
Marc Chagall, Vitrail de la Paix d’après la vision d’Esaïe (Esaïe, XI 5-9) 1963-1964, New York, Bâtiment des Nations-unies
Joaquín TORRES-GARCÍA
1874-1949
Figura de mujer sendata construtiva
1936
Huile sur panneau
Signé des initiales en haut à droite « J.T.G », daté en haut à gauche « 36 » 49 × 39,50 cm
Au verso :
Étude de bateau dans un port
Crayon
Provenance :
Atelier de l’artiste
Ifigenia Torres, Montevideo Enric Jardí, Barcelone Galerie Barbié, Barcelone Vente New York, Sotheby’s, 25 novembre 1986, lot 21
Collection particulière, Barcelone Collection particulière européenne
Exposition :
Madrid, Museo Español de Arte Contemporáneo, Barcelone, Museo de Arte Moderno, Exposición Antológica TorresGarcía, avril-juin 1973, n°85 reproduit p.101
Bibliographie :
J.P. Argul, « La irrupción de TorresGarcía en su país », in Mundo Hispánico, Madrid, 1973, n°301, reproduit p.40 in Destino, « La estética de TorresGarcia », Barcelone, 7 juillet 1973, reproduit
E. Jardí, Joaquín Torres-García, Polígrafa, Barcelona, 1973, n°269, reproduit p.197 in Mundo Hispánico, « Extraordinario Dedicado al Pintor Torres García », Madrid, mai 1975, n°326, reproduit p.15
A. Maslach, Joaquín Torres-García: sol y luna del arcano, JTG, Caracas, 1998, n°340, reproduit p.572 (détail)
J.M. Sanguinetti, Joaquín TorresGarcía : El lenguaje de las cosas y del mundo, Clásica : Arte & Cultura, Buenos Aires, 1999, n°134 reproduit à la table des matières
Cette œuvre est référencée dans le catalogue raisonné en ligne de l’Œuvre de Joaquín Torres-García sous le n°1936.15 (estate : 679) https://www. torresgarcia.com/catalogue/entry. php?id=1456
Oil on panel;
signed with the initials upper right; dated upper left, on the reverse; pencil; 19 ¼ x 15 ½ in.
100 000 - 150 000 €

Joaquín TORRES-GARCÍA
Figura de mujer sendata construtiva 1936
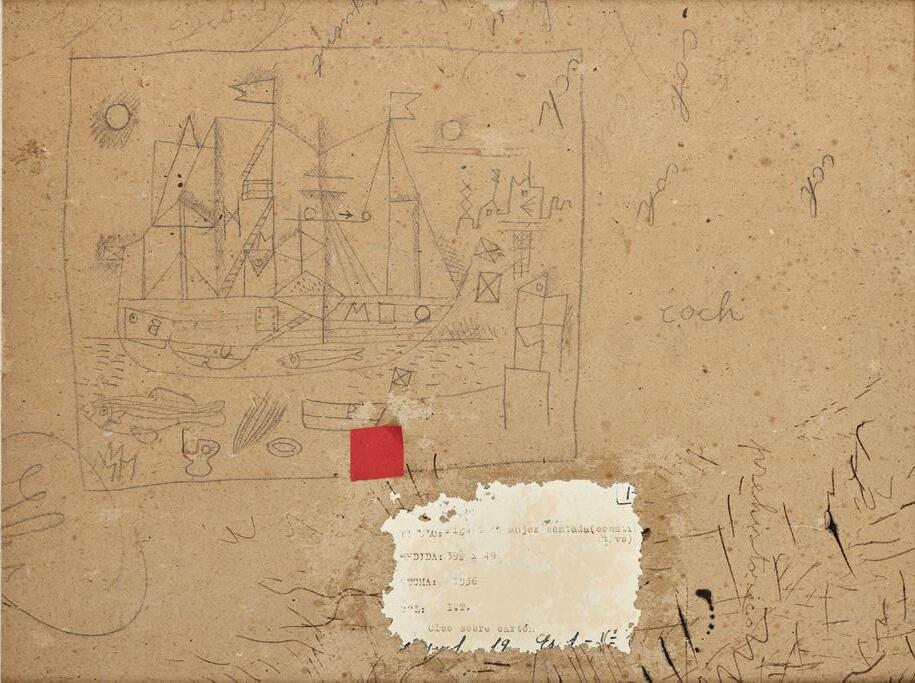
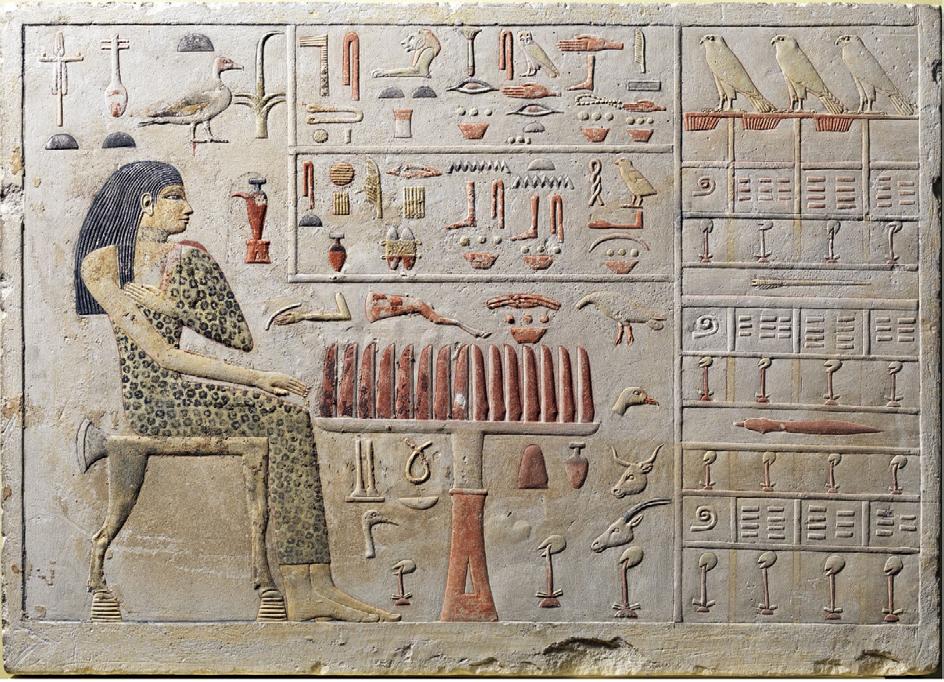
Figura de mujer sentada construtiva (Figure d’une femme assise constructive) est réalisée en 1936, soit deux ans après le retour de Joaquín Torres-García à Montevideo ville de son enfance qu’il avait quittée 43 ans plus tôt. Alors âgé de soixante-deux ans, l’artiste revient en Uruguay après avoir évolué pendant des décennies au sein des cercles d’avant-garde européens + parisiens. C’est lors de son installation à Paris en 1926, que l’artiste découvre l’abstraction géométrique.
C’est ainsi qu’en 1929, il fut l’un des membres fondateurs, aux côtés de l’artiste belge Michel Seuphor, du groupe d’artistes Cercle et Carré, accompagné d’une publication du même nom.
Ce groupe d’artistes qui dédie son travail à une approche rationnelle de l’abstraction géométrique, s’élargit pour inclure des artistes tels que Piet Mondrian, Wassily Kandinsky et Jean Arp.
Selon les mots de Torres-García, leur mission était de trouver « la recherche de l’équilibre, de l’unité, des relations équivalentes entre les formes, les plans, les couleurs, entre
les éléments simples qui composent l’œuvre d’art »
C’est au cours de l’année 1930, que Joaquín Torres-García s’intéresse à l’art précolombien, africain et égyptien après plusieurs visites au musée de l’Homme de Paris, qui sera alors une source d’inspiration lui permettant ainsi de s’extraire de l’influence culturelle européenne. Trois ans plus tard, l’artiste quitte Paris pour retrouver l’Espagne et Madrid où il achève le manuscrit publié en 1935, Arte Constructivo, mouvement artistique ancré dans une volonté de synthèse entre les traditions artistiques européennes modernes et les cultures autochtones d’Amérique latine. Ce mouvement cherche à transcender les frontières culturelles en donnant une vision universelle fondée sur la géométrie et l’ordre symbolique, se traduisant alors par l’utilisation d’une grille structurelle et de formes simples (carrés, cercles, rectangles, lignes droites) et l’intégration de symboles empruntés à des cultures anciennes maya, inca, égyptienne.
Joaquín Torres-García painted Figura de Mujer Sentada Construtiva (Figure d’une femme assise constructive) in 1936, two years after he returned to Montevideo, the town in which he had grown up and that he had left 43 years earlier. At the time, the artist was 62 years old and had returned to Uruguay after spending several decades in avant-garde circles in Europe, particularly in Paris. It was when he moved to Paris in 1926 that the artist discovered Geometric Abstraction.
Thus, in 1929, he was one of the founding members, alongside Belgian artist Michel Seuphor, of the Cercle et Carré (Circle and Square) group of artists, which published a journal with the same name.
This group, which devoted its work to a rational approach to Geometric Abstraction, grew to include artists such as Piet Mondrian, Wassily Kandinsky, and Jean Arp. According to TorresGarcía, their mission was “a search for balance, unity, equivalent relationships between shapes,
planes, and colours, and the simple elements that make up a work of art”
It was in 1930 that Joaquín Torres-García developed an interest in pre-Columbian, African, and Egyptian art after several visits to the Musée de l’Homme in Paris, which would become a source of inspiration that allowed him to disconnect himself from European cultural influence. Three years later, the artist left Paris for Spain and Madrid, where he completed his manuscript, published in 1935, Arte Constructivo, an artistic movement anchored in a desire for synthesis between Modern European artistic traditions and the native cultures of Latin America. This movement sought to cut across cultural borders by giving a universal vision based on geometry and symbolic order, translating into the use of a structural matrix and simple shapes (squares, circles, rectangles, and straight lines), together with the integration of symbols borrowed from the ancient Maya, Inca, and Egyptian civilisations.
En Fr
Stèle pancarte de Nefertiabet, calcaire, de Giza Égypte, 2590-2533 avant J.-C, Musée du Louvre, Paris
© 2013
Musée du LouvreChristian
Verso de l’œuvre
Ainsi, Figura de mujer sentada construtiva, n’est pas sans rappeler la représentation des personnages égyptiens dans les frises antiques, les jambes et les bras presque à angles droits, représentés de profil, le regard droit, s’imposant par son caractère hiératique, donnant à la figure une majesté simple et une puissance écrasante. La femme assise a le corps également parcouru de lignes géométriques noires représentées presque sous forme de grille formant ainsi des rectangles, des cercles remplis de couleurs primaires (rouge, bleu, jaune).
Il serait cependant tentant de voir dans cette représentation de la femme, l’influence de Piet Mondrian sur l’œuvre de Joaquín Torres-García. Les deux artistes utilisent certes tous les deux les
mêmes formes géométriques et la même palette de couleurs mais Torres-García nous donne à voir un art constructif chargé de sens et de symboles, ne renonçant pas à l’image, contrairement à son ami. Ainsi comme le dit l’artiste luimême dans le manifeste Vouloir et construire de la première édition de Cercle et Carré du 15 mars 1930 : « Plus la personne qui dessine a un esprit de synthèse, plus elle nous donnera une image construite. Les dessins de tous les peuples primitifs – noirs, aztèques, etc., ainsi que les Égyptiens, les Chaldéens, etc. – en sont de parfaits exemples. Cet esprit de synthèse, je crois, est ce qui conduit à la construction de l’ensemble du tableau... Cet esprit seul permet de voir l’œuvre dans sa totalité comme un ordre unique, une unité. »

Hence, Figura de Mujer Sentada Construtiva is reminiscent of the way Egyptian characters were portrayed in antique friezes, with her legs and arms almost at right angles, shown in profile, staring straight ahead, striking with her hieratic character, conferring on her a simple majesty and overwhelming force. Geometrical black lines cross the seated woman’s body like a grid, forming rectangles and circles full of primary colours (red, blue, and yellow).
This female figure may tempt the viewer to see Piet Mondrian’s influence on Joaquín TorresGarcía’s work. Certainly, both artists used the same geometric forms and colour palette, but Torres-García displays constructive, meaningful, and
symbolic art, unlike his friend, who chose to forego figurative work. Thus, as the artist himself said in the manifesto “Vouloir et Construire” in the first edition of Cercle et Carré on 15 March 1930: “The more the person who draws has a synthetic mind, the more they will give us a constructed image. The drawings by all the primitive peoples – Africans, Aztecs, Egyptians, and Chaldeans, etc. – are perfect examples of that. I believe that the synthetic mind is what leads to the construction of the entire composition... Only that spirit allows you to see the whole work as a unique order, a unit.”

Figure féminine. Chupícuaro, Mexique, VIIe-IIIe siècle av. J.-C. Terre cuite à engobe. Musée du quai Branly, Paris
Piet Mondrian, Composition en rouge, jaune, bleu et noir, 1921 Huile sur toile, Kunstmuseum Den Haag, La Haye
Alexander CALDER 1898-1976
Cock’s comb (maquette) – 1961
Tôle peinte
60 × 56,50 × 55 cm
Provenance :
Collection particulière, France
Don à l’actuel propriétaire en 2013
Cette œuvre est enregistrée dans les Archives de la Fondation Calder sous le n°A26596.
La sculpture monumentale de cette maquette fait partie de la collection du Whitney Museum of American Art de New York.
Cette œuvre est vendue en collaboration avec Artcurial Toulouse-Jean-Louis Vedovato.
Painted sheet metal; 23 ⅝ × 22 ¼ × 21 ⅝ in
300 000 - 500 000 €

le QR code pour découvrir la vidéo de l’œuvre
Scannez
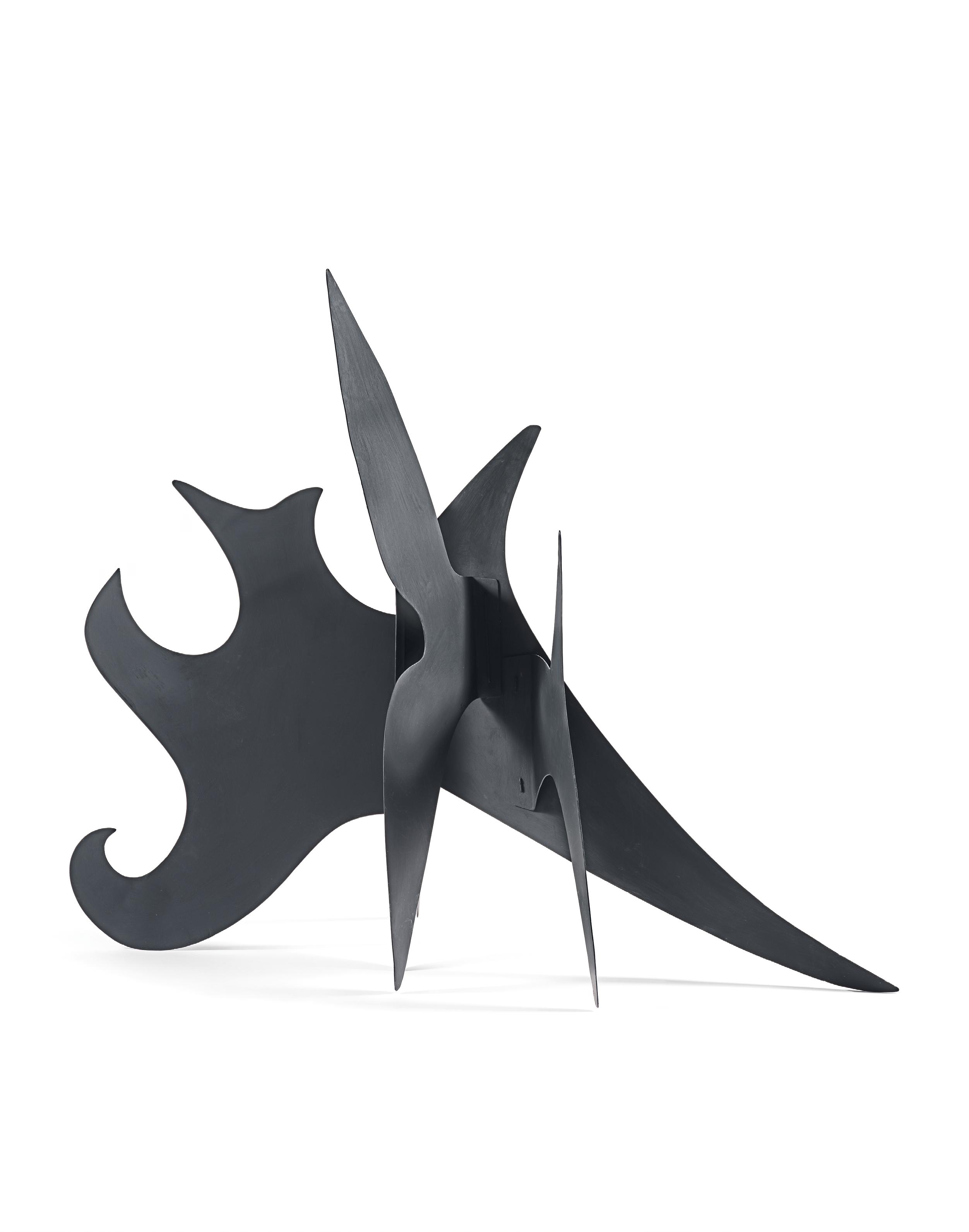
Cock’s comb (maquette) – 1961
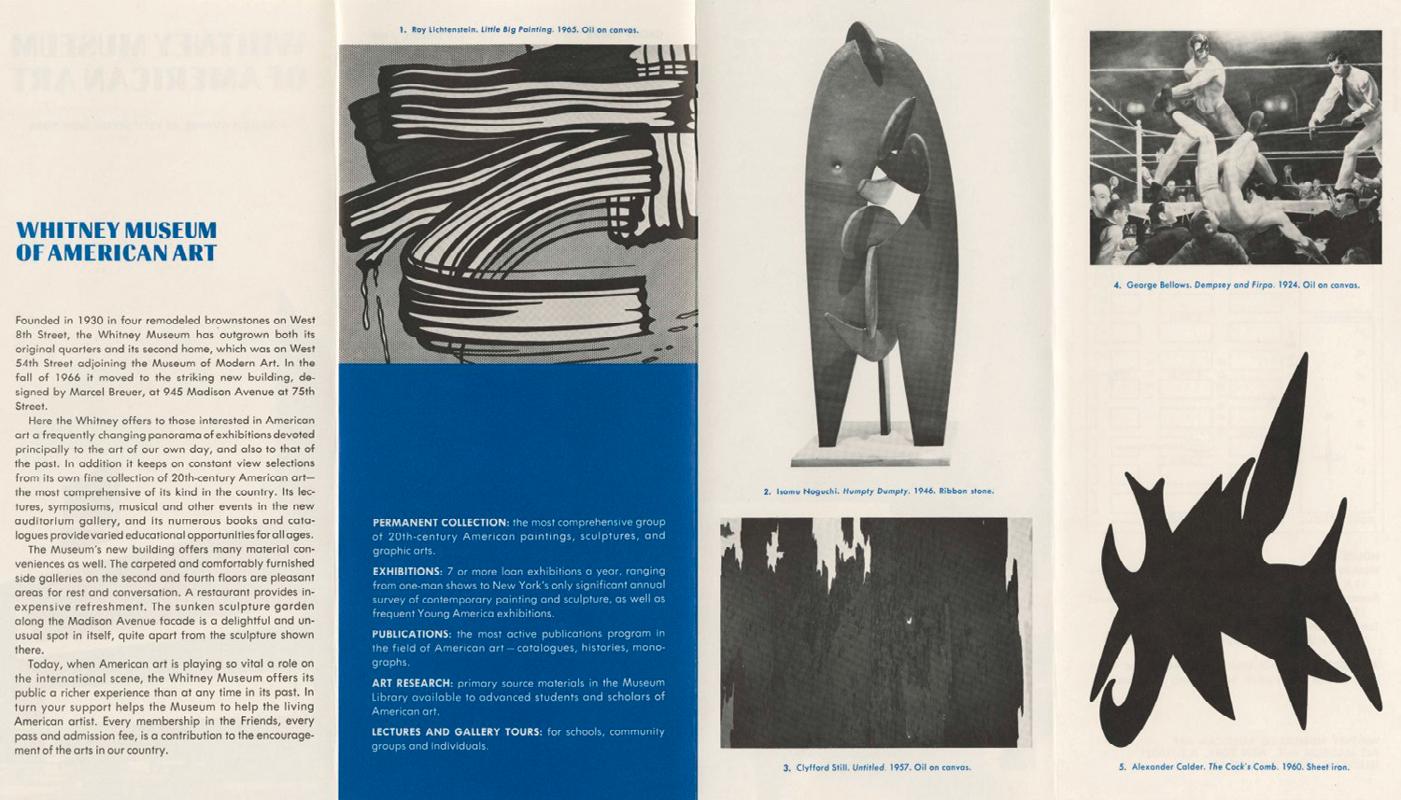
Considéré comme le plus grand innovateur du XXe siècle, l’artiste américain Alexander Calder (1898–1976) a révolutionné la sculpture en explorant la forme à travers la couleur et le mouvement.
Héritier d’une famille d’artistes (sa mère est peintre et son père est sculpteur ainsi que son grand-père), il développe dès ses plus jeunes années une sensibilité particulière pour la tridimensionnalité et l’équilibre des formes. En 1923, Calder entreprend des études d’art à New York avant de partir pour Paris en 1926 pour devenir peintre et illustrateur. Encouragé par sa rencontre avec un fabricant de jouets, Sandy (comme le surnomment ses parents) expérimente le fil de fer et crée de petites figurines d’animaux en s’inspirant des dessins qu’il réalisait dans son enfance dans les zoos de New York, donnant ainsi naissance au Cirque Calder (1926–1931) et à sa vocation de sculpteur.
Les créations les plus célèbres de Calder sont ses mobiles (sculptures aériennes mises en mouvement par le vent) et ses stabiles (structures
fixes, pouvant être monumentales, ancrées solidement dans le sol).
L’année 1930 marque un tournant décisif dans le parcours artistique du sculpteur. Délaissant petit à petit la figuration et ses sculptures en bois et en fil de fer, il s’oriente vers les constructions abstraites. Sa visite, en octobre, à l’atelier de Piet Mondrian à Paris agit comme un véritable déclencheur. Cette tendance est renforcée par son engagement au sein du groupe AbstractionCréation, fondé en 1931 par Auguste Herbin et Georges Vantongerloo.
C’est à cette période qu’apparaissent les stabiles, terme inventé par Hans Arp en 1932, un an après la première exposition de Calder à Paris, à la Galerie Percier. Doté d’une énergie inépuisable et d’un esprit curieux, Calder explore très tôt une grande variété de matériaux. Après le bois, il adopte le métal, qu’il peint de couleurs vives et primaires (rouge, jaune, bleu) auxquelles s’ajoutent le noir et le blanc.
Considered the greatest innovator of the 20th century, the American artist Alexander Calder (1898–1976) revolutionized sculpture by exploring form through colour and movement.
Heir to a family of artists (his mother was a painter, his father and grandfather both sculptors), he developed from a very young age a particular sensitivity to three-dimensionality and the balance of forms. In 1923, Calder began art studies in New York before leaving for Paris in 1926 to become a painter and illustrator. Encouraged by his encounter with a toy maker, Sandy (as his parents nicknamed him) experimented with wire, creating small animal figures inspired by the drawings he had made as a child in New York’s zoos. This led to the creation of Cirque Calder (1926–1931) and to his vocation as a sculptor.
Calder’s most famous creations are his mobiles (aerial sculptures set in motion by the wind) and his stabiles (fixed structures, sometimes monumental, anchored firmly to the ground).
The year 1930 marked a decisive turning point in the
sculptor’s career. Gradually leaving figuration and his wood and wire sculptures behind, he turned to abstract constructions. His visit, in October, to Piet Mondrian’s studio in Paris acted as a true catalyst. This direction was reinforced by his involvement in the AbstractionCréation group, founded in 1931 by Auguste Herbin and Georges Vantongerloo. It was during this period that the stabiles appeared, a term coined by Hans Arp in 1932, one year after Calder’s first exhibition in Paris at the Galerie Percier.
With boundless energy and a curious mind, Calder explored a wide variety of materials from an early age. After wood, he adopted metal, which he painted in bright primary colours (red, yellow, blue), to which he added black and white. His first sculptures were still made of wire, resting on a base. But from 1936 onward, the surfaces became fuller and more stable, eventually freeing themselves from the base and giving rise –especially from the 1950s onward– to majestic monumental steel sculptures that today populate public spaces.
Cock’s comb d’Alexander Calder reproduit dans une brochure du Whitney Museum of American Art, New York
© Whitney Museum of American Art, New York
En Fr
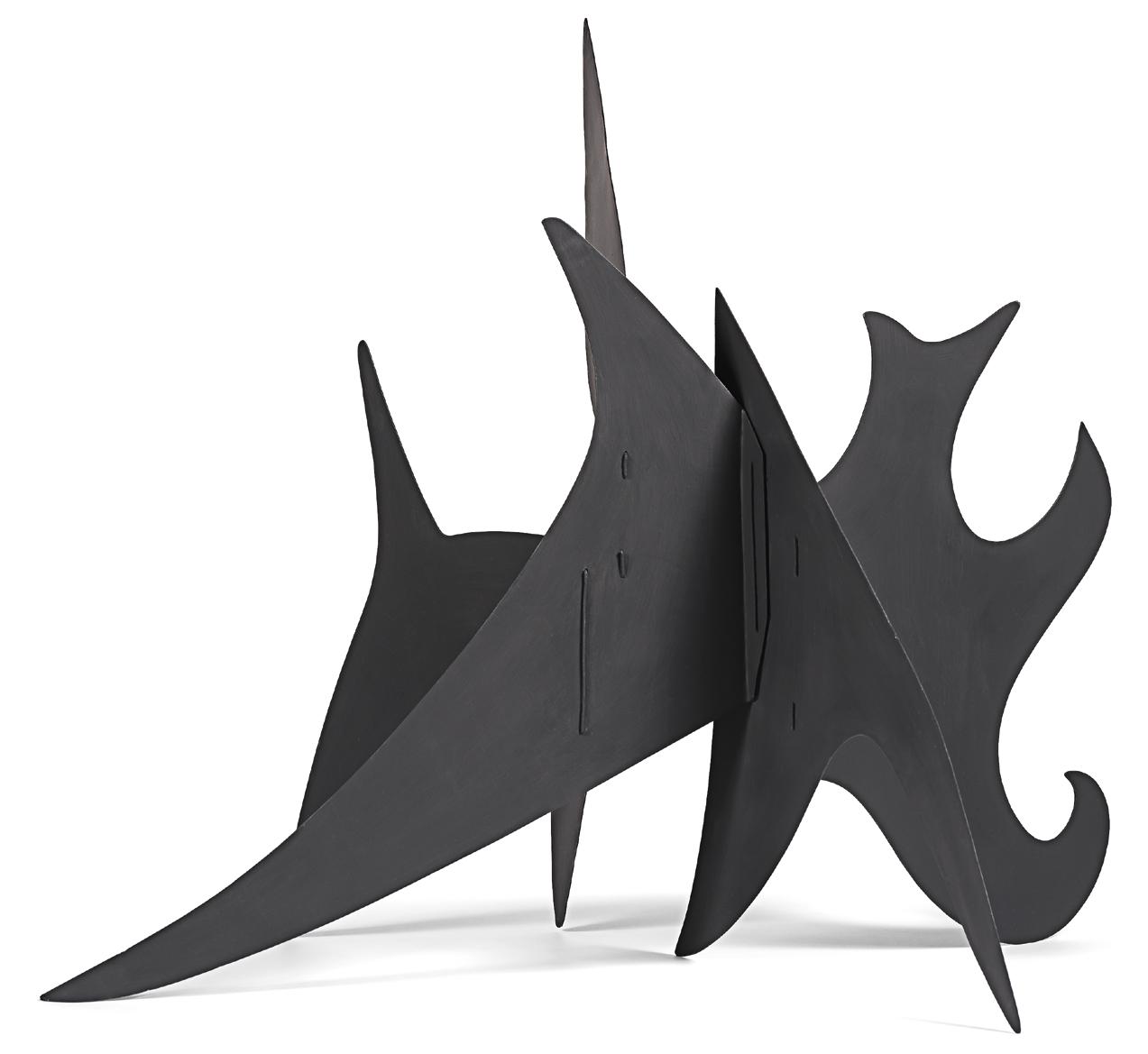
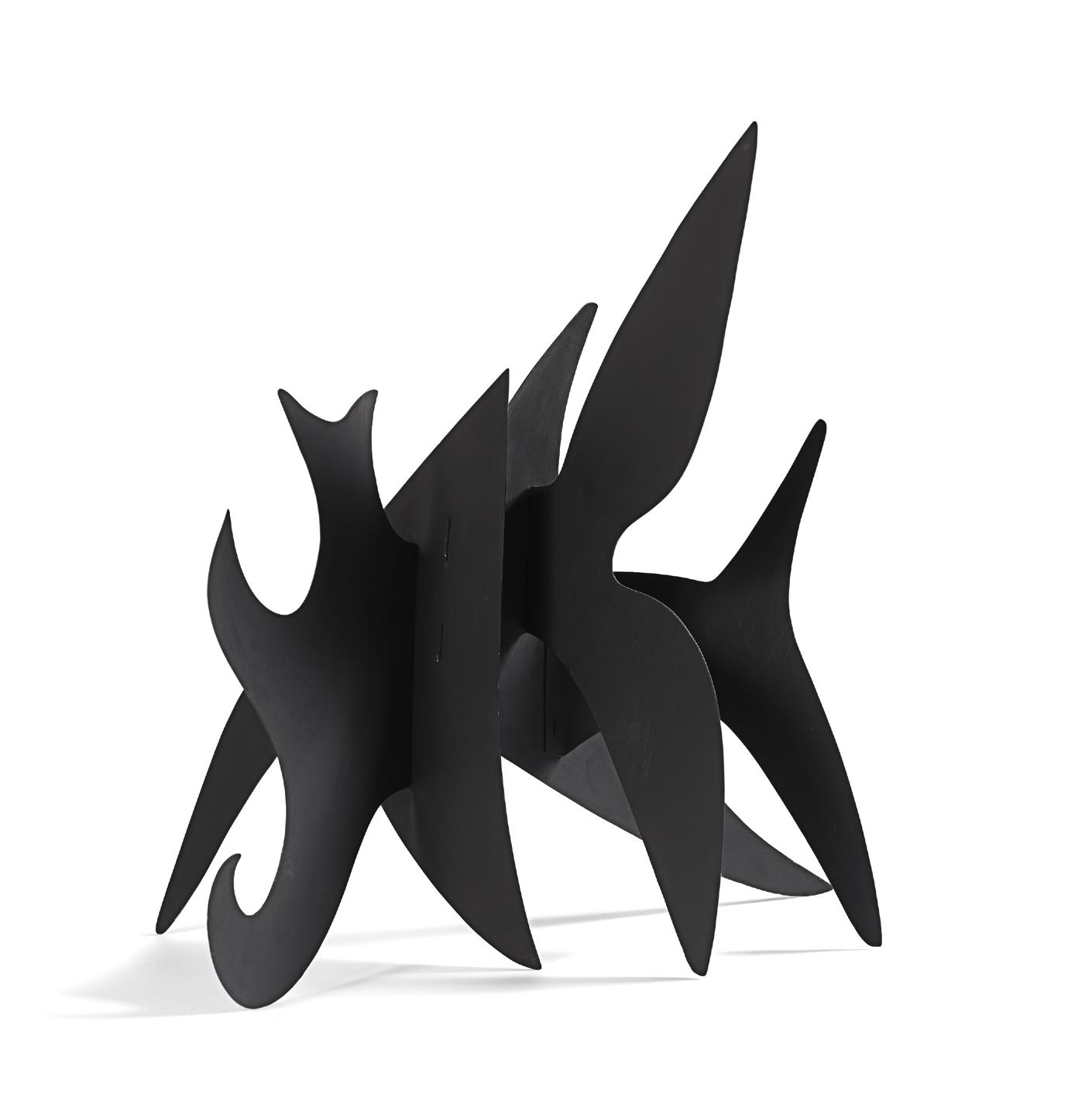
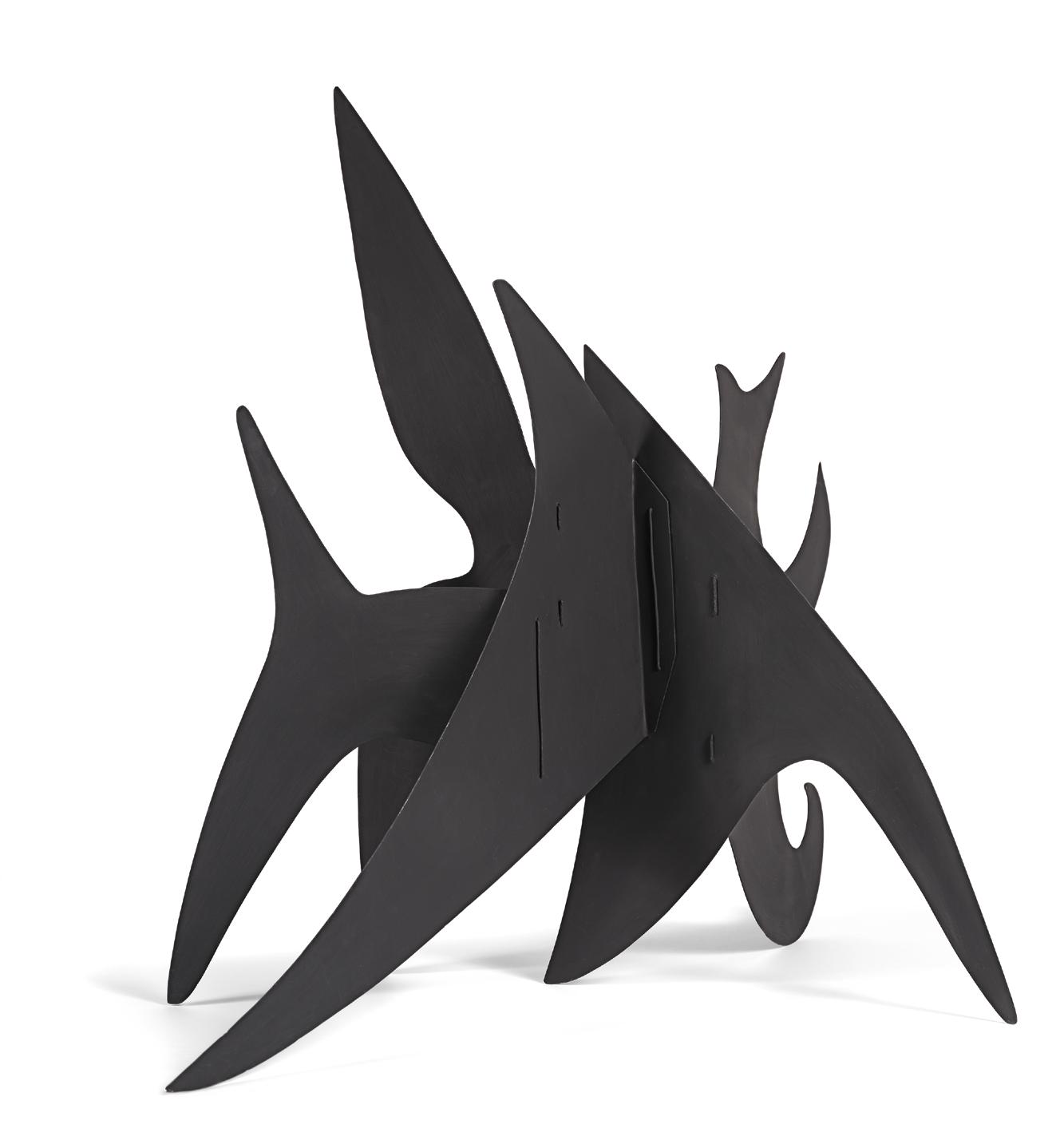
Alexander CALDER 1898-1976
Cock’s comb (maquette) – 1961



Cock’s comb d’Alexander Calder sur le toit du Whitney Museum of American Art, New York
Cock’s comb d’Alexander Calder exposée aux Calder Gardens, à Philadelphie, depuis le 21 septembre 2025 ©
Cock’s comb, 1960, au City Hall Park de New York, en 2006
Les premières sculptures sont encore composées de fils de fer, reposant sur un socle. Mais, dès 1936, les surfaces sont plus pleines et deviennent plus stables jusqu’à se libérer du socle et engendrer par la suite – surtout à partir des années 50 – de majestueuses sculptures monumentales en acier qui jalonnent aujourd’hui l’espace public.
Dans son processus de création de stabiles monumentaux, Calder accorde une place primordiale aux maquettes. Les premiers essais de sculptures en extérieur fragilisées par les vents violents poussent l’artiste à perfectionner sa pratique en réalisant de petites maquettes qu’il agrandit ensuite. Ces modèles réduits lui permettent d’expérimenter proportions, mouvements et jeux d’équilibre avant de réaliser les œuvres finales, en grand format. Les maquettes ne sont pas seulement des étapes préparatoires : elles ont aussi une valeur artistique propre, témoignant de l’inventivité de l’artiste et de son sens du rythme visuel. Elles lui servent également d’outils pour convaincre commanditaires et institutions de la faisabilité de ses projets monumentaux. Grâce à elles, il peut visualiser l’insertion de ses œuvres dans des environnements urbains ou naturels.
Après avoir découpé, suivant son intuition, des plaques de métal à la cisaille et percé les trous destinés aux boulons, il leur donne forme dans un étau entre des blocs de
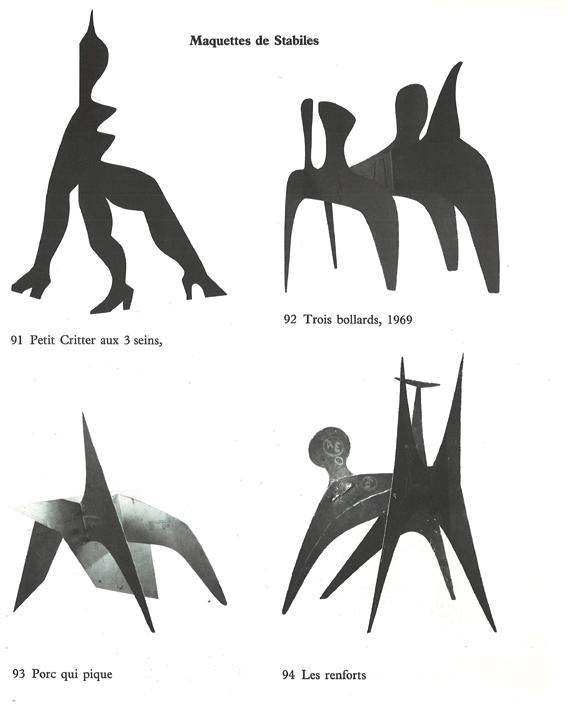
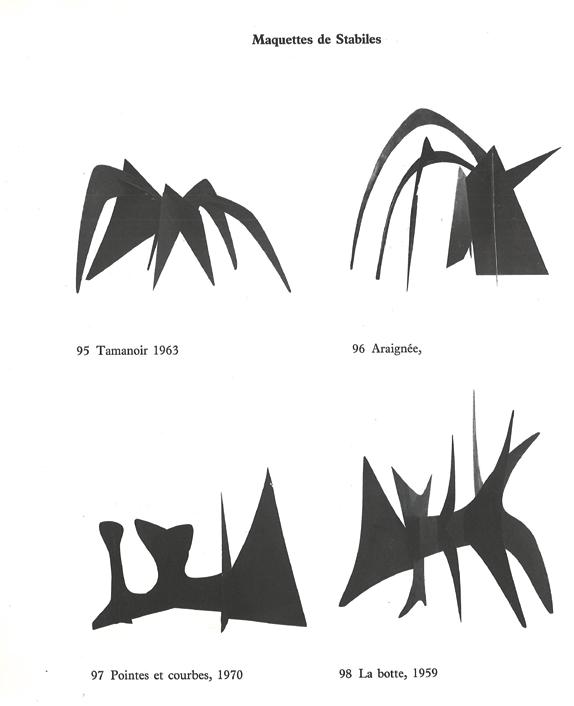
bois, lime les arêtes, puis assemble le tout avec des rivets. L’artiste explique : « Lorsque j’utilise deux ou plusieurs plaques de métal découpées en formes et montées selon des angles différents, j’ai l’impression qu’il existe une forme solide – peut-être concave, peutêtre convexe – venant combler l’angle dièdre entre elles. Je n’ai pas une idée précise de ce que cela pourrait être. Je le ressens simplement et je m’occupe des formes visibles ». Par leur simplicité formelle, ces maquettes témoignent du talent de Calder à exprimer l’espace et le mouvement avec une économie de moyens.
Constantin Brâncuși partage également cette quête d’abstraction et de simplification des formes afin de révéler l’essence du sujet. La principale différence réside dans le mouvement et l’interaction avec l’espace : Brâncuși le suggère, Calder le rend tangible et vivant.
Avec ses courbes à la fois fluides et rythmées, Cock’s comb (crête de coq) est un exemple remarquable de maquette façonnée par la main de Calder en 1961.
Reposant sur six appuis, l’œuvre est réalisée en tôle, peinte en noir mat, typique des maquettes de l’artiste. Entièrement abstraite, elle évoque cependant la crête d’un coq, cet appendice charnu avec sa dentelure irrégulière qui jaillit de part et d’autre. La courbe du dos, s’élevant avec vigueur depuis le sol, structure l’ensemble, tandis que les plaques s’arquent et s’appuient les unes sur les autres.
In creating monumental stabiles, Calder gave a central role to models. His early experiments with outdoor sculptures, weakened by strong winds, prompted him to perfect his process by making small models that he later enlarged. These scale models allowed him to test proportions, movement and balances before producing the final large-scale works. The models were not merely preparatory steps: they held artistic value in themselves, bearing witness to the artist’s inventiveness and visual rhythm. They also served as persuasive tools to convince patrons and institutions of the feasibility of his monumental projects. Thanks to them, he could visualize how his works would integrate into urban or natural settings.
After cutting metal plates with shears according to his intuition and drilling holes for the bolts, he shapes them in a vise between blocks of wood, files the edges, and then assembles everything with rivets. The artist explained: “When I use two or more plates of metal, cut into shapes and arranged at different angles, I feel that there exists a solid form –perhaps concave, perhaps convex– filling the dihedral angle between them. I don’t have a precise idea of what it might be. I simply feel it and work with the visible forms”.
Through their formal simplicity, these models testify to Calder’s talent for expressing space and movement with an economy of
means. Constantin Brâncuși also pursued this quest for abstraction and simplification of forms in order to reveal the essence of the subject. The main difference lies in movement and interaction with space: Brâncuși suggested it, Calder made it tangible and alive. With its fluid yet rhythmic curves, Cock’s comb is a remarkable example of a model fashioned by Calder’s hand in 1961. Resting on six supports, the work is made of sheet metal painted in matte black, typical of the artist’s maquettes. Entirely abstract, it nevertheless evokes the comb of a rooster, that fleshy appendage with its irregular serrations jutting out on either side. The curve of the back, rising forcefully from the ground, structures the whole, while the plates arch and lean against each other. The variety of vertical thrusts evokes in turn different postures or moods of the bird. Although monochrome, the work exudes an unusual and joyful dynamism. Its size, close to that of the actual animal and the richness of its facets invite the viewer to walk around it and discover the infinity of movements contained within its form.
In Calder’s universe, a rich and animated bestiary reveals the playful and poetic dimension of his art, inaugurated by the wire animals of his Circus, at once simple and strikingly expressive.
En Fr
Différentes maquettes de stabiles d’Alexander Calder
Alexander CALDER 1898-1976
Cock’s comb (maquette) – 1961
La diversité des élans verticaux évoque tour à tour différentes postures ou humeurs du gallinacé. Bien que monochrome, l’œuvre dégage un dynamisme insolite et joyeux.
Sa dimension proche de l’animal réel et la richesse de ses facettes invitent le spectateur à en faire le tour pour découvrir l’infinité de mouvements contenus dans son image.
Dans l’univers de Calder, un bestiaire riche et animé fait émerger la dimension ludique et poétique de son art, inaugurée par les animaux en fil de fer de son Cirque, à la fois simples et d’une étonnante expressivité. En 1937, il expose, à la Galerie Pierre Matisse de New York, ses premières formes animales fantastiques devenues caractéristiques de ses stabiles Les représentations stylisées miniatures ou monumentales d’araignées, de chevaux, de chiens, de dinosaures, d’oiseaux, de poissons, de porcs-épics, de tamanoirs ou de vaches gardent toute leur vitalité et leur puissance.
La maquette de Cock’s comb témoigne de l’inventivité et de la virtuosité de Calder. Sa simplicité de forme et sa clarté de contour lui confèrent une intensité visuelle
et la prestance d’une sculpture de grande dimension.
Sa version monumentale de 3 mètres de haut, réalisée la même année, est conservée au Whitney Museum of American Art de New York. L’exemplaire est présenté dans le City Hall Park lors de l’exposition Alexander Calder in New York, entre avril 2006 et mars 2007 et depuis le 21 septembre de cette année, dans les nouveaux Calder Gardens (Jardins Calder) de Philadelphie.
Grâce à son élégance et à sa fraîcheur sur le marché étant restée jusqu’à présent en mains privées, cette œuvre existe à part entière comme une sculpture autonome : elle possède à la fois la délicatesse des petites pièces et l’envergure des projets plus ambitieux.
Aujourd’hui, les maquettes de Calder sont exposées dans les musées du monde entier. Elles témoignent du cheminement créatif de Calder, de ses premières intuitions jusqu’à la matérialisation de sculptures imposantes. En les contemplant, on perçoit la vision d’un artiste qui insuffle la vie au métal, métamorphosant sa lourdeur en un art de l’équilibre, de la légèreté et du mouvement.
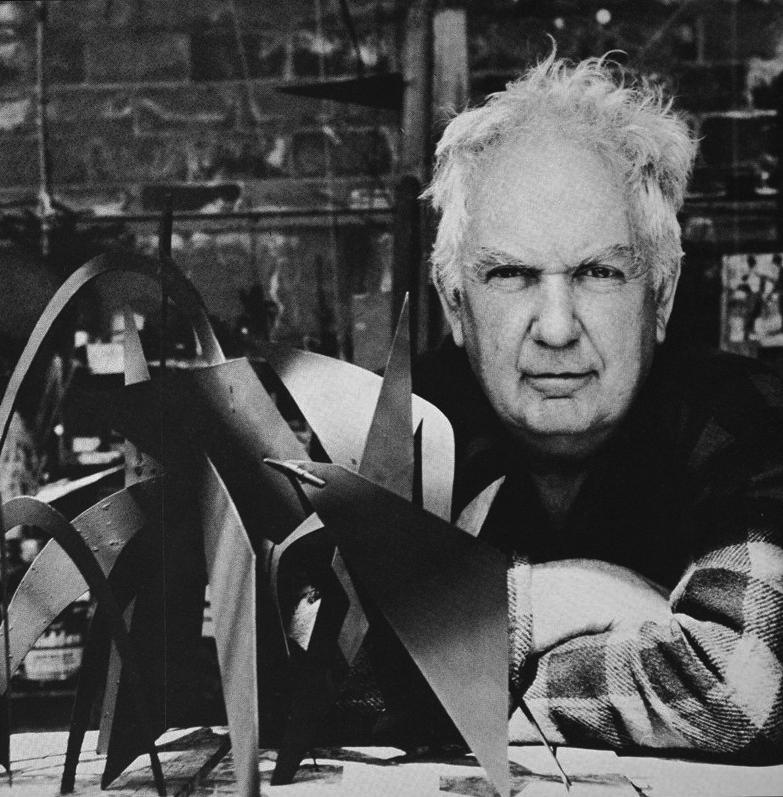
In 1937, at New York’s Pierre Matisse Gallery, he exhibited his first fantastic animal forms that would become characteristic of his stabiles. The stylized miniature or monumental representations of spiders, horses, dogs, dinosaurs, birds, fishes, porcupines, anteaters and cows, retain all their vitality and power.
The Cock’s comb model demonstrates Calder’s inventiveness and virtuosity. Its formal simplicity and clarity of contour give it visual intensity and the presence of a large-scale sculpture. Its monumental version, three meters high, produced the same year, is held in the Whitney Museum of American Art in New York. It was presented in City Hall Park during the exhibition Alexander Calder in New York, from April 2006 to March 2007, and since 21 September this year, in the new Calder Gardens in Philadelphia. Thanks to its elegance and freshness on the market –having remained in private hands until now– this work fully exists as an autonomous sculpture: it possesses both the delicacy of smaller pieces and the scope of more ambitious projects. Today,
Calder’s models are exhibited in museums around the world. They reflect the artist’s creative journey, from his earliest intuitions to the realization of monumental sculptures. In contemplating them, one perceives the vision of an artist who breathed life into metal, transforming its weight into an art of balance, lightness and movement.
Alexander Calder à Roxbury, Connecticut, 1959

Fernand LÉGER
1881-1955
Composition murale – 1953
Huile sur toile
Signée, datée en bas à droite "53 / F. LEGER", inscription au dos "composition /MURALE/F.LEGER.53/N°290"
146 × 97 cm
Provenance :
Atelier Fernand Léger, n°290 Collection particulière À l’actuel propriétaire par cessions successives
Exposition :
Varsovie, Muzeum Naradowe, Cracovie, Muzeum Norodowe, Poznan, Muzeum Narodow, Lodz, Muszeum Sztuki, février-août 1971, Fernand Léger, n°20
Bibliographie :
A.Verdet, Fernand Léger: Dal cubismo alla pittura della realta l’arte di Leger si pone come la libera allegoria del lavoro umano, I Maestri del Novecento, 1969, n°35, reproduit en couleur
I. Hansma, C. Lefebvre du Preÿ, Fernand Léger, catalogue raisonné de l’œuvre peint, 1952 -1953, Editions Irus et Vincent Hansma, Paris, 2013, n°1575 p.182, reproduit en couleur p.183
Oil on canvas, signed, dated lower right, inscription on the reverse; 57 ½ × 38 ¼ in.
550 000 – 650 000 €
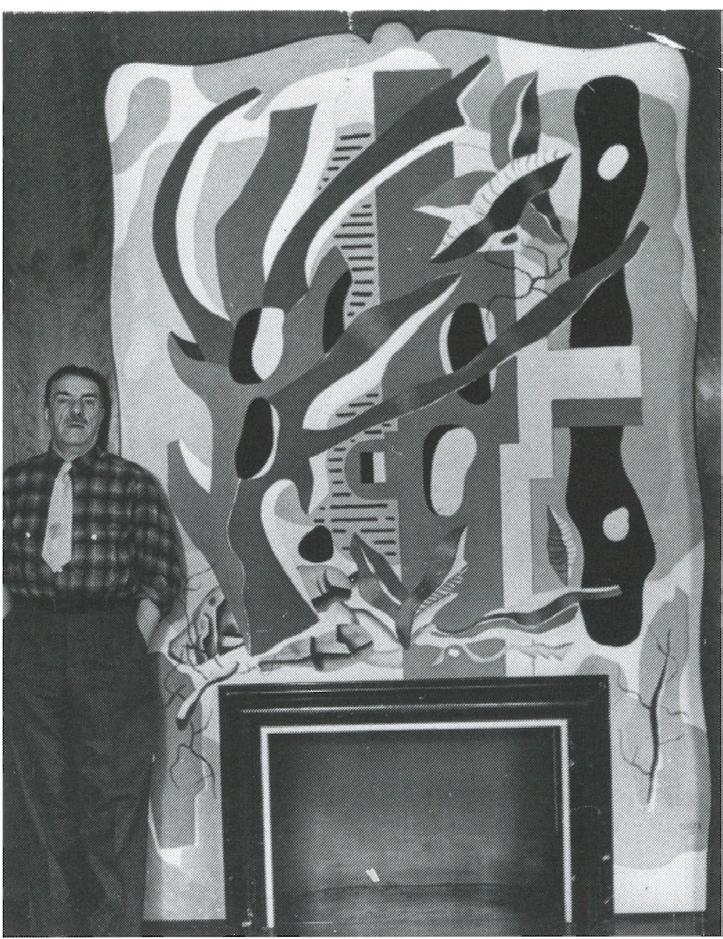
Fernand Léger devant la cheminée de Nelson Rockefeller

Fernand LÉGER
1881-1955
Composition murale – 1953

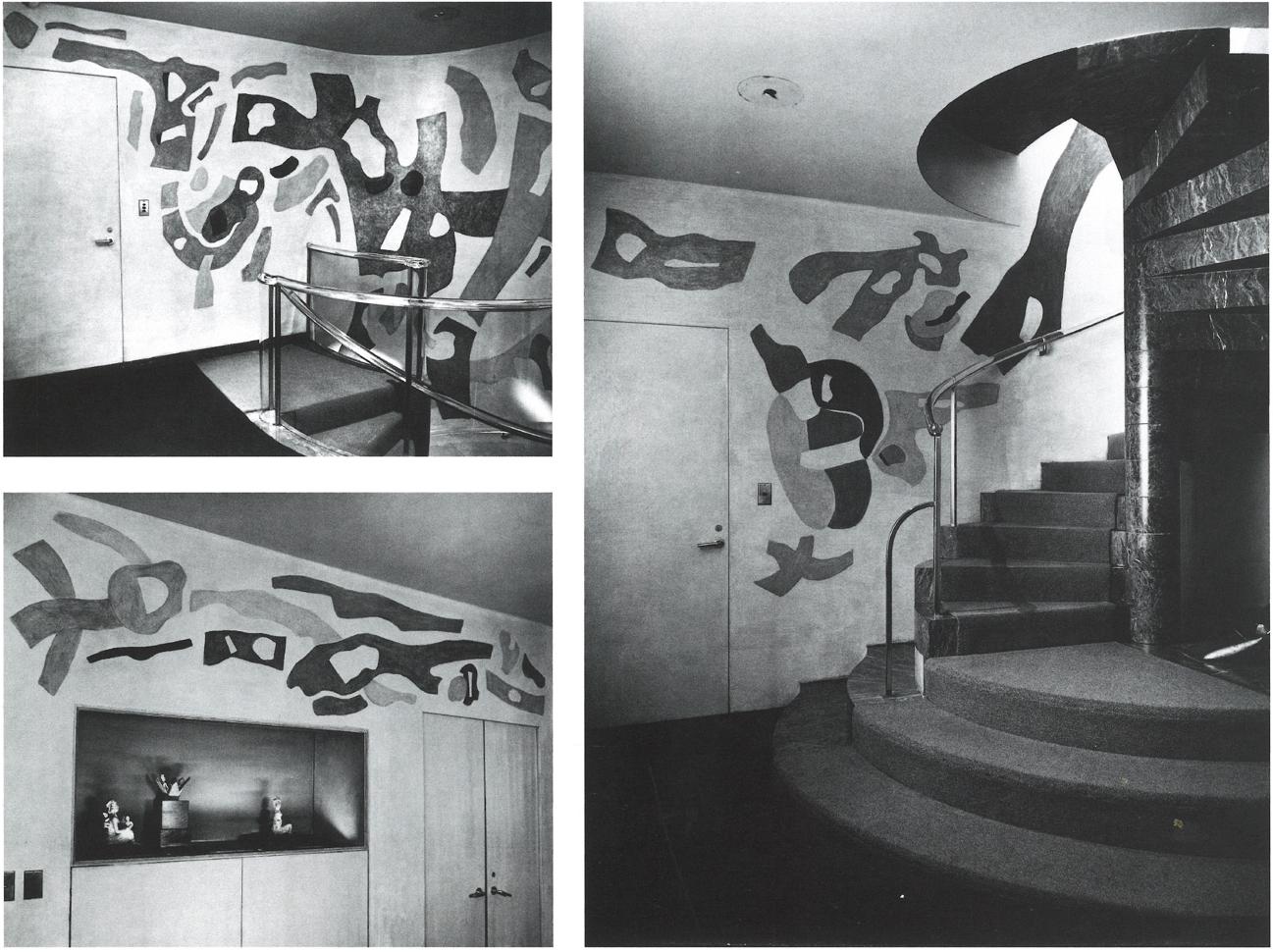
« Créer un bel objet en peinture, c’est rompre avec la peinture sentimentale. Un ouvrier n’oserait livrer une pièce autrement que nette, polie, brunie. Rien n’y est éparpillé, tout fait bloc. Le peintre doit chercher à réaliser le tableau propre, possédant le fini Les Primitifs songeaient à ces choses. Ils avaient la conscience professionnelle. La peinture est jugée au décimètre, alors que la mécanique l’est au dixième de millimètre. L’artiste met sa sensibilité au service d’un travail », affirme le peintre français Fernand Léger. Né en 1881, cette figure de l’art moderne entretient un rapport très précis avec ses compositions. Chaque forme, chaque élément, chaque couleur fonctionne de concert avec le
reste de la toile et l’harmonie qui se dégage de l’œuvre finie ne peut être remise en question : elle est l’unique but recherché. Cette quête rationnelle d’accomplissement par le truchement du travail et de sa qualité justifie la fusion de la peinture de Fernand Léger en tant qu’objet spirituel, contemplatif, non fonctionnel et, au contraire la vision plus décorative de sa pratique artistique.
Très jeune, Léger fait preuve d’un esprit droit, ambitieux et déterminé. Autodidacte, il suit en auditeur libre les cours du peintre Gérôme, à l’École des Beaux Arts à Paris à l’âge de dix-neuf ans alors que rien ne le destine à la peinture. Il se fraye seul un chemin parmi l’effervescence artistique de Montparnasse et
“Creating a beautiful object with painting requires breaking away from sentimental painting. A labourer wouldn’t dare do anything other than deliver a spotless, polished, burnished element. Nothing scattered, everything holding together. A painter must aim to create a spotless work that seems essentially finished. Primitivist artists thought of those things. They had a professional conscience. In painting, every single decimetre is judged, whereas in mechanics, things are judged to the tenth of a millimetre. Artists place their sensitivity at the service of a work of art”, stated French painter Fernand Léger. The relationship that this leading figure in Modern Art, born in 1881, had with his compositions
was based on precision. Every shape, every element, every colour functioned hand-in-hand with the rest of the painting, and the harmony suggested by the finished work could not be questioned: it was the sole result sought. This rational quest for accomplishment through work and its quality justified the fact that Fernand Léger’s paintings became spiritual, contemplative, non-utilitarian objects, and yet, on the contrary, the most decorative vision of his artistic practice.
From an early age, Léger showed a steadfast, ambitious, and determined spirit. He was self-taught and studied informally under the painter Gérôme at the Paris École des Beaux Arts when he was nineteen, even though
En Fr Fernand Léger, Composition murale pour la cheminée de Nelson Rockefeller, 1939, Huile sur toile, The Museum of Fine Arts, Houston
Entrée et escalier de l’appartement de Nelson Rockefeller, New York, 1939
rencontre Cézanne qui l’introduit au cubisme. Son esthétique se singularise d’emblée mais le cubisme restera son outil principal pour retranscrire le dynamisme de son temps, veillant à rester en marge de Braque et Picasso. La peinture de Fernand Léger repose sur les contrastes de formes et de couleurs : « La couleur est un besoin naturel comme l’eau et le feu. C’est une matière première indispensable à la vie, à toute époque de son existence et de son histoire, l’homme l’a associée à ses joies, ses actions, ses plaisirs », affirmet-il. Il s’intéresse à la ville, à la machine, au cinéma, l’architecture et à la beauté plastique de la civilisation industrielle. Ces éléments pénètrent sa peinture qui s’inscrira donc naturellement dans les contextes urbains et les projets de décoration associés à
la ville se multiplient. Ainsi, dès 1925, à l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de Paris, Léger réalise des peintures murales pour le hall du jardin d’hiver du pavillon de l’Ambassade de France. En 1936, l’État lui commande plusieurs décorations, pour le pavillon de la Solidarité nationale construit par Robert Mallet-Stevens, pour le pavillon de l’Union des Artistes modernes (UAM) et pour le Palais de la Découverte.
Lorsque Fernand Léger fuit la France pour New York au début de la guerre, il y rencontre « le plus formidable spectacle du monde ». Le peintre français propose alors de décorer, à l’aide de projections murales, le hall de Radio City, l’une des tours les plus prestigieuses du nouveau complexe édifié par Rockefeller en plein cœur de Manhattan.
nothing predestined him to be a painter. Alone, he carved out a place for himself in the artistic vivacity of Montparnasse and met Cézanne, who introduced him to Cubism. His aesthetics immediately stood out, but Cubism would remain the major medium he used to portray the exuberance of his time while carefully ensuring that he differentiated himself from Braque and Picasso. Fernand Léger’s paintings drew on contrasts in shape and colour. “Colour is a natural necessity like water and fire. It is a raw material, essential to life. Throughout his existence and history, man has associated it with his joys, his actions, his pleasures”, he stated. He was interested in towns, machines, the cinema, architecture, and the physical beauty of industrial civilisation. These elements are visible in his
paintings, which would naturally become a part of urban life and burgeoning city embellishment projects. Hence, in 1925, at the Paris International Exhibition of Modern Decorative and Industrial Arts, Léger painted murals for the lobby to the winter garden in the French Embassy’s pavilion. In 1936, the State commissioned several decorative elements from him for the Pavillon de la Solidarité Nationale (National Solidarity Pavilion), designed by Robert Mallet-Stevens, the Pavillon de l’Union des Artistes Modernes (UAM) (Union of Modern Artists’ Pavilion), and the Palais de la Découverte.
When Fernand Léger fled France for New York at the start of the war, he discovered “the most remarkable spectacle in the world”.

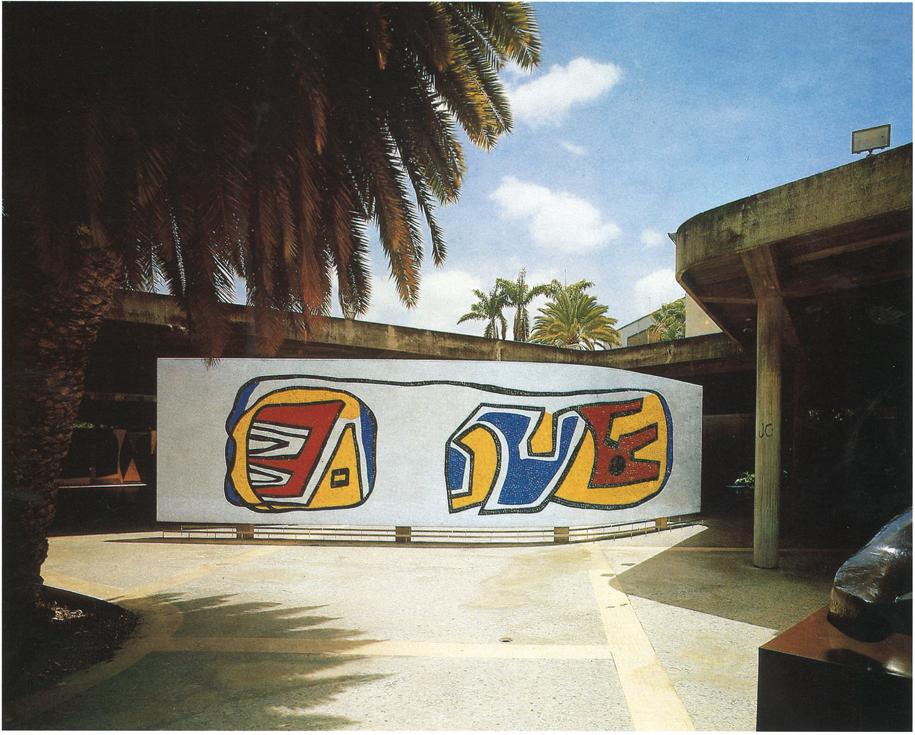
Fernand Léger, vitrail de la bibliothèque de l’Université de Caracas, 1954
Fernand Léger, Mosaïque pour l’Université de Caracas, 1954
Fernand LÉGER 1881-1955
Composition murale – 1953
Si le projet n’est pas réalisé faute de moyens techniques, Nelson Aldrich Rockefeller lui commande néanmoins une décoration destinée à encadrer l’une des cheminées du grand salon de l’appartement du 810 Fifth Avenue à New York, conçu par l’architecte Wallace K. Harrison et décoré par Jean-Michel Frank.
L’œuvre présentée ici, intitulée Composition murale et réalisée en 1953 s’inscrit dans ces grandes ambitions décoratives. Achevée deux ans avant le décès du peintre, la toile est une œuvre de maturité qui témoigne de la grande maîtrise des éléments syntaxiques. En effet, les cernes noirs particulièrement présents ici offrent un véritable contrepoint à la couleur. La palette, rouge, verte, orange, jaune, bleue témoigne de l’expérience visuelle du peintre lors de son séjour américain : « En 1942 quand j’étais à New York, j’ai été frappé par les projecteurs publicitaires de Broadway qui balayent la rue.
Vous êtes là, vous parlez avec quelqu’un et tout à coup, il devient bleu. Puis la couleur passe, une autre arrive et il devient rouge, jaune. Cette couleur-là, la couleur du projecteur est libre : elle est dans l’espace. J’ai voulu faire la même chose dans mes toiles ».
Le titre du tableau trahit l’ambition murale de Fernand Léger qui, en effet, associe sa pratique tardive de la céramique à sa volonté, par l’art mural, de dépasser les limites du tableau. Composition murale évoque les bas-reliefs, les vitraux et mosaïques qu’il réalise l’année qui suit pour l’université de Caracas.

Fernand Léger, Étude (vue en contre-plongée) pour un premier projet de mural pour la salle de l’Assemblée générale de l’ONU à New York circa 1952-1955, Gouache sur papier, Hood Museum of Art, Hanover
The French painter offered to use mural projections to decorate Radio City Hall, one of the most prestigious towers in the new complex built by Rockefeller in the heart of Manhattan. Although the project never saw the light of day due to a lack of technical means, Nelson Aldrich Rockefeller commissioned a decoration intended to frame one of the fireplaces in the large lounge of the apartment at 810 Fifth Avenue in New York, designed by architect Wallace K. Harrison, and decorated by Jean-Michel Frank.
The work presented here, Composition Murale, which was made in 1953, was part of that major decorative project. It was completed two years before the painter died and is a work of great maturity that reflects his absolute mastery of syntactical elements. Effectively, the black shadows that are particularly present here provide a veritable counterpoint to the colour. The palette, red, green, orange, yellow, and blue, reflects
the painter’s visual experience during his time in America. “In 1942, when I was in New York, I was struck by the advertising screens on Broadway that cast their colourful lights the length and breadth of the streets. You’re there, talking with someone, and suddenly, they turn blue. Then, that colour goes and another comes, and the person turns red or yellow. That colour, the colour from the screens, is free. It’s in the air all around. And I wanted to achieve the same thing with my paintings.”
The name of the painting belies Fernand Léger’s love of mural decoration. Effectively, he associated his later work on ceramics with his desire to exceed the mere capacities of paintings through the use of mural works. Composition Murale calls to mind the bas-reliefs, stained glass windows, and mosaics that he created the following year for Caracas University.


Alberto Giacometti
Projet pour un monument à Gabriel Péri & Projet pour une place, 1946
Alberto GIACOMETTI
1901-1966
Ensemble de deux bronzes
1. Projet pour un monument à Gabriel Péri – 1946
Bronze à patine brun vert
Signé sur la gauche de la terrasse
« A. Giacometti », numéroté et cachet du fondeur au dos de la terrasse
« 1/8 CIRE/C.VALSUANI/PERDUE »
39,10 × 10,90 × 18,60 cm15 3/8 × 4 1/4 × 7 3/8 in.
Modèle conçu en 1946
Cet exemplaire fondu circa 1993-1994
2. Projet pour une place - 1946
Bronze à patine brun vert
Signé sur la gauche de la terrasse
A. Giacometti», numéroté et cachet
« du fondeur au dos de la terrasse
« 1/8 CIRE/C.VALSUANI/PERDUE »
18,50 × 9,30 × 12,90 cm7 1/4 × 3 ⅝ × 5 ⅛ in.
Modèle conçu en 1946
Cet exemplaire fondu circa 1993–1994
Provenance : Collection particulière, Luxembourg À l’actuel propriétaire par cessions successives
Exposition :
Heilbronn, Städtische Museen, Künzelsau, Museum Würth, Plätze und Platzzeichen: der Platz - ein Thema der Kleinplastik seit Giacometti, juinseptembre 1996, n° 51 et 52 Francfort, Schirn Kunsthalle Frankfurt, Alberto Giacometti. Werke und Schriften, octobre 1998 - janvier 1999, n° 18 et 20, reproduit p.43 et 45 Milan, Fondazione Antonio Mazzotta, Mannheim, Städtische Kunsthalle, Giacometti. La valle, il mondo, février - septembre 2000, reproduit p.200
Bibliographie :
C. di Crescenzo, Alberto Giacometti: Sculture, dipinti, disegni, Artificio, Florence, 1995, n°29, p. 148, reproduit p. 149 (le plâtre pour Projet pour un monument à Gabriel Péri)
C. Di Crescenzo, “Giacometti: Künstler und Revolutionär.” in Alberto Giacometti, 1901–1966, Vienna: Kunsthalle,1996, n°117-119, p. 48-50
C. Di Crescenzo, “Giacometti, Artist and Revolutionary”, in catalogue d’exposition, Alberto Giacometti, Ravenna, Loggetta Lombardesca, octobre 2004 -février 2005, Milan, 2004, p. 55 ff
Ces œuvres sont référencées par la Fondation Alberto et Annette Giacometti dans sa base de données en ligne, Alberto Giacometti Database (AGD), sous les numéros 3901 (Projet pour un monument à Gabriel Péri) et 4060 (Projet pour une place).
Deux avis d’inclusion du Comité Giacometti seront remis à l’acquéreur.
Two bronzes with brown green patina, signed on the left of the base, numbered and foundry mark on the back of the base (both)
1 500 000 - 2 000 000 €

Alberto Giacometti dans son atelier travaillant sur L’Homme qui marche, 1959

Projet pour un monument à Gabriel Péri & Projet pour une place – 1946

Première représentation de l’homme marchant, le Projet pour un monument à Gabriel Péri de 1946 est un jalon essentiel dans l’œuvre d’Alberto Giacometti. Le motif emblématique de la figure marchant prend corps, pour la première fois, ici dans le cadre d’un hommage au héros de la Résistance, Gabriel Péri (1902–1941) assassiné cinq ans auparavant par les nazis au Mont Valérien. Le symbole est d’une grande force, son expression d’une grande vigueur, sa réalisation d’une essentielle rigueur. L’homme marchant devant une stèle incarne au-delà de l’aspect mémoriel du projet, un développement artistique et intellectuel chez Alberto Giacometti qui s’épanouira au cours des décennies suivantes pour atteindre son point culminant avec son œuvre la plus célèbre, L’homme qui marche, réalisée
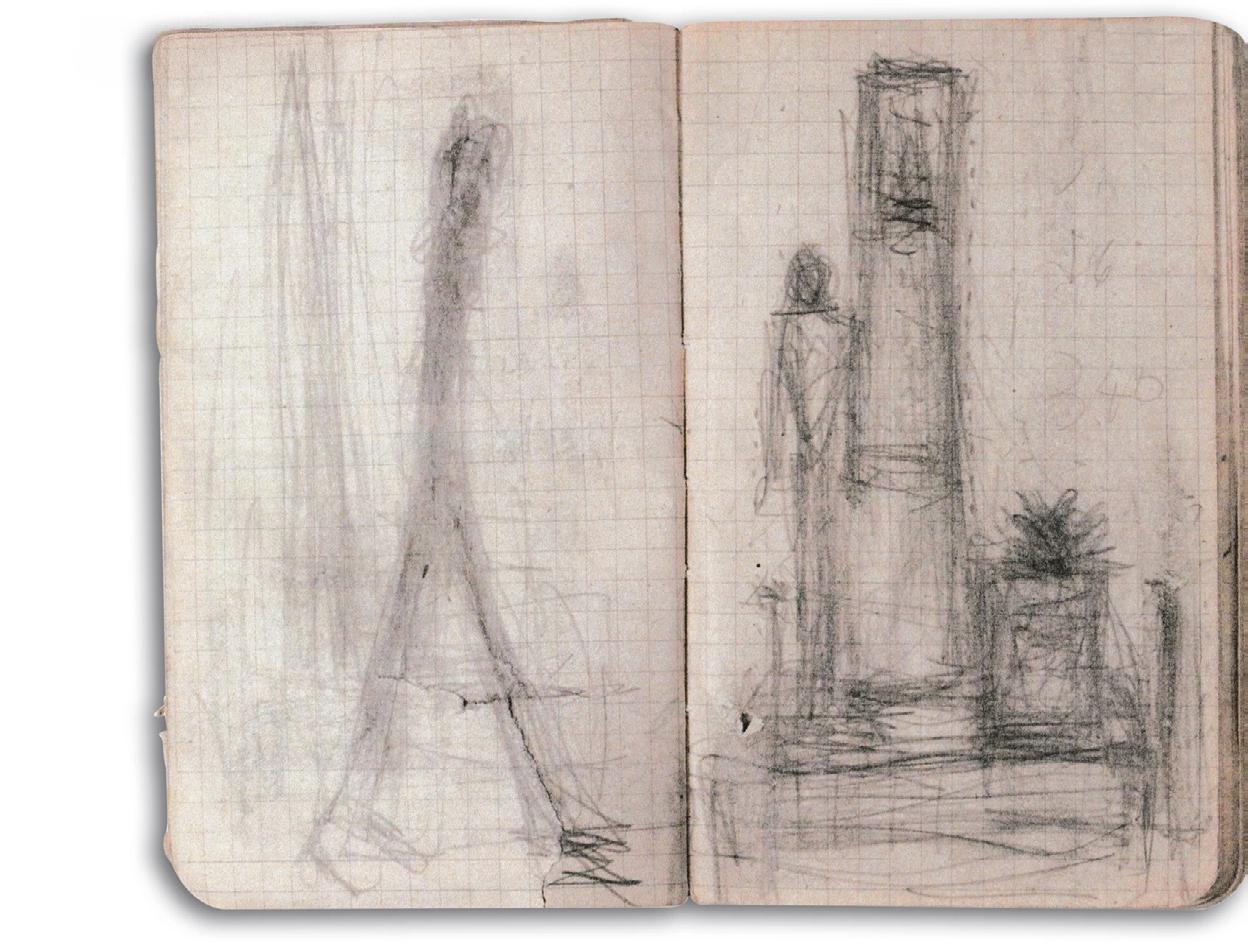
grandeur nature en 1960. Dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux projets artistiques voient le jour en France pour honorer la mémoire des victimes de la barbarie nazie et des héros de la Résistance française. C’est probablement Louis Aragon qui suggéra à Alberto Giacometti de participer à la conception de tels monuments. C’est ainsi qu’en 1946, le journal L’Humanité lance un concours pour honorer la mémoire du député et journaliste communiste Gabriel Péri. Écoutons Casimiro Di Crescenzo, spécialiste d’Alberto Giacometti qui dans le catalogue de l’exposition Giacometti -Artiste et révolutionnaire (1996) a consacré une large étude à notre sculpture : « Il était prévu d’ériger un monument à Gabriel Péri devant la gare Saint-Lazare (aujourd’hui place Gabriel Péri).
The first representation of a walking man, the Projet pour un Monument à Gabriel Péri from 1946, was a crucial milestone in Alberto Giacometti’s work. The emblematic walking figure came to life for the first time, here, in this tribute to a hero of the French Resistance, Gabriel Péri (1902–1941), who had been executed five years before by the Nazis on Mont Valérien. The symbol is powerful, the expression extremely dynamic, and the craftsmanship of absolute precision. Above and beyond the memorial aspect of the project, the man walking in front of a stele embodies Alberto Giacometti’s artistic and intellectual growth, which would flourish in the following decades, reaching its apex with his most famous work, the life-size L’Homme qui Marche, completed in 1960. Immediately after the Second
World War, numerous artistic projects took shape in France to honour the memory of the victims of Nazi barbarity and the heroes of the French Resistance. It was probably Louis Aragon who suggested to Alberto Giacometti that he participate in the design and creation of such monuments. Hence, it was in 1946 that the newspaper L’Humanité organised a competition to honour the memory of the Communist journalist and politician Gabriel Péri. Let us remember the words of Casimiro Di Crescenzo, a specialist in Alberto Giacometti who, in the exhibition catalogue for Giacometti, Artiste et Révolutionnaire (1996) devoted an extensive study to our sculpture: “There was a plan to erect a monument to Gabriel Péri in front of the Gare Saint-Lazare (the site now known as Place Gabriel Péri).
Fr En
Gabriel Péri en 1932
Alberto Giacometti, Études pour le monument à Gabriel Péri, 1946, Crayon sur papier (carnet de croquis) copie
Cet emplacement a été choisi car il s’agissait du terminus de la ligne ferroviaire pour Argenteuil, ville que Gabriel Péri avait représentée en tant que député. Ce concours n’a jamais abouti car le Parti Communiste a quitté le gouvernement en 1947, et l’idée du monument a donc dû être abandonné [...] Projet pour un monument à Gabriel Péri » marque un tournant dans l’œuvre artistique d’Alberto Giacometti, car c’est la première fois qu’il représente un homme marchant. La sculpture allie la forme archaïque d’une stèle dressée à la figure humaine si caractéristique de l’œuvre de Giacometti. La silhouette élancée et allongée de l’homme marchant témoigne de la transition significative vers son
style de maturité, après que ses premières abstractions surréalistes eurent cédé la place a des portraits réalistes au milieu des années 1930. Alors que l’artiste avait utilisé un langage symbolique emprunté à l’art paléochrétien et égyptien pour la tombe de son père en 1934 et pour celle de Gerda Taro en 1937-1938 afin d’exprimer l’idée d’immortalité, il a commencé à développer un symbolisme plus personnel dans Projet pour un monument à Gabriel Péri. La composition se compose d’une figure masculine marchant à côté d’une stèle [...]. Le motif de la flamme est une allusion à la flamme du souvenir sur la tombe du Soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe.
This location had been chosen, as it was the terminus for the Argenteuil train line. Argenteuil being the town that Gabriel Péri represented as a member of parliament. This competition never came to anything because the Communist Party left the government in 1947, and therefore the plan for the monument was abandoned [...]. Projet pour un Monument à Gabriel Péri marked a turning point in the work of Alberto Giacometti, as it was the first time that he had portrayed a walking man. The sculpture combines the archaic outline of a tall stele and a human figure that is so characteristic of Giacometti’s works. The elongated, willowy silhouette of the walking man demonstrates a significant
transition towards his later style, once his Realist portraits of the mid-1930s had replaced his first Surrealist Abstractions. Whilst the artist had used a symbolic language borrowed from Early Christian and Egyptian art for his father’s grave in 1934 and for Gerda Taro’s in 1937-1938 in order to express the idea of immortality, he started developing a more personal symbolism with Projet pour un Monument à Gabriel Péri The composition is made up of a male figure walking by a stele [...]. The flame motif is an allusion to the Flame of Remembrance on the Tomb of the Unknown Soldier beneath the Arc de Triomphe.

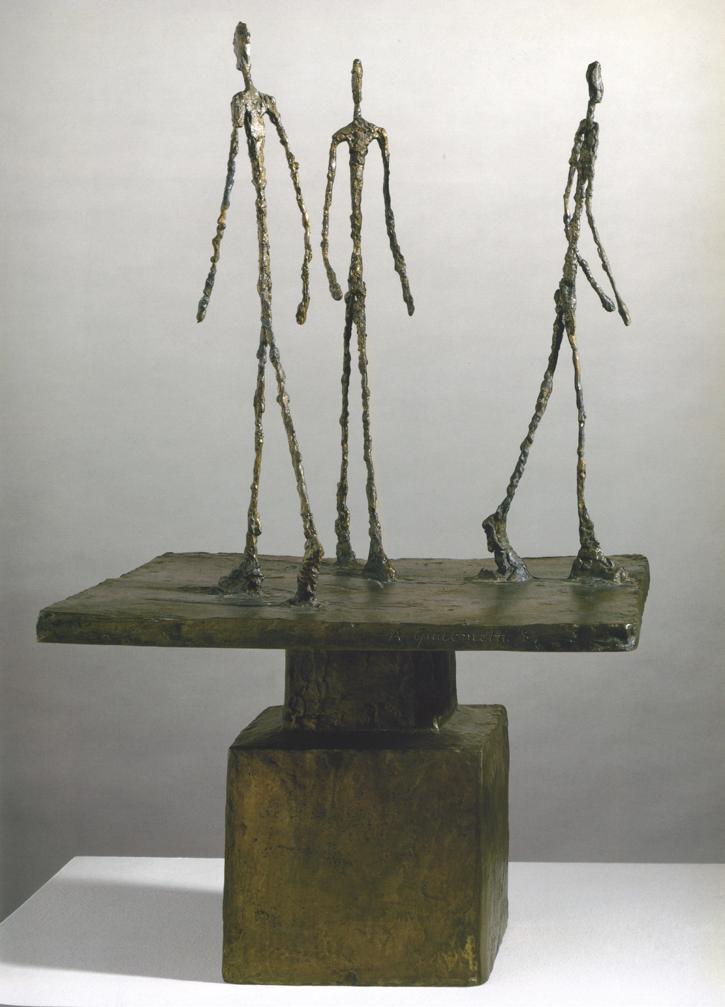
Alberto Giacometti, Trois hommes qui marchent, 1948, Bronze, Kunsthaus, Zurich
Maquette d'un lieu de culte, dite le Sit-shamshi ou cérémonie du lever du soleil, Dynastie des Shutrukides Shilak-Inshushinak, 1150–1120 av. J.-C, Bronze, Musée du Louvre, Paris

Alberto GIACOMETTI 1901-1966
Projet pour un monument à Gabriel Péri & Projet pour une place – 1946

Pour la première fois dans l’œuvre sculpturale de Giacometti, la figure de l’homme marchant est réalisée, certainement en référence à l’art de l’Égypte antique, où ce motif harmonise l’accès au royaume des morts avec la vie éternelle. »
Projet pour une place s’inscrit également dans l’élaboration du monument hommage à Gabriel Péri. Comme le précise Casimiro Di Crescenzo, "la place aurait été identique à la future place Gabriel Péri devant la gare Saint-Lazare. Le monument symbolise la vie et la mort sous la forme d’un arbre en pleine croissance et d’un arbre abattu [...] En termes d’histoire de sa création, le Projet pour une place a précédé de deux à trois ans des sculptures similaires, telles que Place et Trois hommes qui marchent

Ces deux œuvres, conçues ensemble et présentées ici ensemble, marquent un tournant dans le travail de Giacometti, mêlant des symboles forts tels que l’arbre, la stèle avec la représentation novatrice de l’homme qui marche traduisant ainsi la vision intellectuelle de l’artiste en 1946. Projet pour un monument à Gabriel Péri est moins un hommage au sens strict qu’une méditation sur l’humanité confrontée à la violence de l’Histoire. C’est une œuvre charnière à la croisée de l’art, de la mémoire, du politique et de l’existentiel, un projet des plus révélateurs de la pensée d’Alberto Giacometti.
The figure of the walking man was present for the first time in Giacometti’s sculptural work, most certainly in reference to the art of Ancient Egypt, in which this motif synchronised the access to the afterlife with eternal life.” Projet pour une Place was also part of the elaboration of the Gabriel Péri memorial monument. As specified by Casimiro Di Crescenzo, “La Place would have been identical to the future Place Gabriel Péri in front of the Gare Saint-Lazare. The monument uses a tree in full growth and a felled tree to symbolise life and death [...]” As regards the history of its creation, the Projet pour une Place came two or three years before similar sculptures, such as Place and Trois Hommes qui Marchent
These two works, which were designed together and are presented here together, marked a turning point in Giacometti’s work, mingling powerful symbols such as the tree and stele with the innovative representation of the walking man, thus fully expressing the artist’s intellectual vision in 1946. Strictly speaking, Projet pour un Monument à Gabriel Péri is less of a tribute than a meditation on humanity confronted with the violence of history. It is a pivotal work at the crossroads of art, remembrance, politics, and the existential, and one of the projects that most revealed Alberto Giacometti’s mindset.
Fr En
Alberto Giacometti, L'Homme qui marche I, 1960, Bronze, Fondation Giacometti, Paris
Alberto Giaometti, Homme qui marche sous la pluie, 1948, Bronze, Kunsthaus, Zurich
André MASSON 1896-1987
Le Miroir Copte (Coptic Mirror) 1942
Huile et sable sur toile
Signée en bas à gauche « andré Masson », datée et titrée sur le châssis
« Le miroir copte/1942 » 51 × 63,50 cm
Provenance :
Buchholz Gallery, New York
Robert Elkon, New York
Vente New York, Parke Bernet Galleries, 5 décembre 1962, lot 97 Saidenberg Gallery, New York (acquis lors de cette vente)
Vente New York, Sotheby’s, 3 octobre 1990, lot 126 Galerie Cazeau-Béraudière, Paris
Acquis auprès de celle-ci par l’actuel propriétaire en 1999
Exposition :
New York, Whitney Museum, European Artists in America, mars-avril 1945
New York, The Museum of Modern Art, San Francisco Museum of Art, Minneapolis Institute of Art, Symbolism in Painting, 1948 Chicago, Richard Feigen Gallery , Retrospective Exhibition, avril - mai 1961, n° 21 Yokohama, Yokohama Museum of Art, Masson-Matta, les deux univers, avril – juin 1994, p. 55 Paris, Pinacothèque, Jackson Pollock et le Chamanisme, octobre 2008 – février 2009, n° 45 p. 176 et 263, reproduit en couleur p.175 (détail), 176 et 177
Bibliographie :
D.Adès, Les grands maîtres de l’art contemporain, André Masson, Albin Michel, Paris, 1994, n° 77
G.Uhry, M. Sawin "André Masson, America", in catalogue de l’exposition Galerie Cazeau-Béraudière, septembre-novembre 2004, répertorié p.9
Un certificat du Comité André Masson sera remis à l’acquéreur.
Oil and sand on canvas; signed lower left, dated and titled on the stretcher; 20 1/8 × 25 in.
200 000 - 300 000 €

André Masson en 1942

Le Miroir Copte (Coptic Mirror) 1942
« Dans l’art, il n’y a ni formes, ni objets. Il n’y a que des événements, des surgissements, des apparitions », affirme André Masson. Le Miroir Copte (Coptic Mirror), réalisée en 1942 et présentée ici, met en évidence une ‘apparition’. La peinture évoque le reflet de plusieurs visages au sein d’un miroir égyptien, comme l’indique son titre. Sur les marges de l’œuvre, des hiéroglyphes égyptiens, à l’instar d’Ankh (symbole de la vie) apparaissent et lui insufflent une dimension mystique.
André Masson s’intéresse particulièrement aux mythologies grecques et égyptiennes, sous l’influence notamment de son ami Georges Duthuit, spécialiste de l’art Copte, mais aussi aux cultures créoles depuis son passage en Martinique et aux récits des natifs américains. L’exposition de 2009 à la Pinacothèque de Paris, consacrée à son contemporain Jackson Pollock et au chamanisme, et dans laquelle figuraient de nombreuses œuvres de Masson
dont Le Miroir Copte (Coptic Mirror), a montré à quel point le chamanisme et ses rituels permettant de traverser des portails mystiques constituaient pour Pollock une voie privilégiée vers des mondes inaccessibles au commun des mortels et donc le chemin le plus direct vers ce qu’il considérait comme la source même de l’art, le réflexe primitif de l’inconscient.
Cette démarche se rapprochait de l’expérience surréaliste et notamment celle d’André Masson. Le Miroir Copte (Coptic Mirror) illustre bien l’influence de Masson sur la jeune peinture américaine de l’époque et notamment sur Pollock – qui reconnait pleinement sa « dette » – Willem de Kooning et Arshile Gorky, trois des fondateurs de l’expressionnisme abstrait. Le critique d’art américain William Rubin insistera lui-même sur le rôle « stimulateur » de Masson. L’école de New York doit à Masson la libération du geste, la désaliénation de la forme et l’aboutissement du dripping.

“In art, there are neither shapes nor objects. There are only events, sudden appearances, and apparitions”, stated French Surrealist artist André Masson.
Le Miroir Copte (Coptic Mirror), painted in 1942 and presented here, reveals an “apparition”. The painting evokes the reflection of several faces in an Egyptian mirror, as its title suggests. Around the edges of the work, Egyptian hieroglyphs appear, such as Ankh (the symbol of life), giving the work a mystical dimension.
André Masson was particularly interested in Greek and Egyptian mythology, under the influence, in particular, of his friend Georges Duthult, a specialist in Coptic art, but also in creole cultures since his time in Martinique, and Native American legends. The exhibition in 2009, at the Pinacothèque de Paris, devoted to his contemporary Jackson Pollock and Shamanism, and in which comprised numerous works by André Masson including Le Miroir Copte (Coptic Mirror), demonstrated the extent to
which Shamanism and its rituals that allow one to cross through mystical portals were, for Pollock, a privileged means of reaching worlds that were inaccessible to ordinary mortals and therefore the most direct path towards what he considered to be the very source of art, the primitive reflex of the subconscious.
This approach was very similar to Surrealism and, in particular, the way it was practiced by André Masson. Le Miroir Copte (Coptic Mirror) perfectly demonstrates Masson’s influence on young American painters at the time, and in particular on Pollock, who fully acknowledged what he owed to Masson, as well as Willem de Kooning and Arshile Gorky, the three founders of Abstract Expressionism. American art critic William Rubin himself insisted on Masson’s role as a driving force. The New York School owed Masson the freedom of gesture, disalienation of form, and the significance of dripping.
En Fr
La déesse Maât tenant le signe Ankh basse époque, Bois et incrustations de verre, Musée du Louvre, Paris
Pendant sa période américaine qui court de 1941-1945 (sa femme, juive, et son appartenance au groupe surréaliste les mettent doublement en danger et forcent, en mars 1941, la famille à l’exil), Masson rompt avec l’idée que la figure doit se détacher du fonds et promulgue la liberté de la main au premier plan. Ainsi, dans Le Miroir Copte (Coptic Mirror), les visages et le fonds se mêlent pour brouiller les pistes de lecture, symbolisant l’état de confusion mentale qui, selon lui, régit le siècle. L’enchevêtrement des lignes circulaires des visages et du contour du miroir fait surgir des formes suggérant l’inconscient de l’artiste. C’est cet intérêt pour l’inconscient qui l’a initialement rapproché du surréalisme et d’André Breton qui acquiert auprès de l’artiste Les Quatre Éléments, toile de 1924, quelques mois avant de publier la même année le manifeste du mouvement. L’écriture et les dessins automatiques, mis en exergue dans la définition du surréalisme, scanderont la carrière
de Masson qui y voit une porte vers l’inconscient.
La période américaine représente pour Masson un moment de création protéiforme qui le hisse vers une plus large reconnaissance. L’artiste y développe « une conscience aiguë des forces telluriques de la nature, un des fondements de son interprétation allégorique du monde » (Claude Miglieti, avant-propos du Catalogue de l’exposition André Masson, de Marseille à l’exil américain Musée de Marseille/Musée Cantini 2015). Ce moment dans la carrière de l’artiste fait surgir de nouvelles formes et une palette caractérisée par un chromatisme plus élargi que dans les tableaux des années 20. Les formes inédites de ces tableaux « telluriques » tel le Le Miroir Copte (Coptic Mirror) revêtent un aspect presque scintillant encore enrichi par l’apport ponctuel de sable, et contrastent radicalement avec un arrière-plan noir comme la nuit.

During his American period, from 1941 to 1945 (his wife being Jewish and his belonging to the Surrealist movement were both things that endangered them and forced the family into exile in March 1941), Masson broke away from the idea that figures should stand out from the background, and promulgated the use of unrestricted manual gestures in the painting of foreground images. Hence, in Le Miroir Copte (Coptic Mirror), the faces and background mingle together, blurring the reading of the work and symbolising the state of mental confusion that Masson believed governed the century. The intricate entanglement of the circular lines of the faces, together with the mirror’s contour, brings forth shapes that suggest the artist’s subconscious. It was this interest in the subconscious that originally drew him to come closer to Surrealism as practiced by André Breton, who acquired from the artist Les Quatre Éléments, painted in 1924, a few months before publishing the movement’s manifesto that year. The automatic
writing and drawing highlighted in the definition of Surrealism would be visible throughout Masson’s career, and he would see them as a doorway to the subconscious. Masson’s American period was a time of protean creation that brought him towards greater recognition. During this time, the artist developed an “acute awareness of the telluric forces of nature, one of the foundations of his allegorical interpretation of the world” (Claude Miglietti, foreword to the exhibition catalogue for André Masson, de Marseille à l’Exile Américain at Marseille Museum/ Cantini Museum 2015). During this time in the artist’s career, new shapes appeared, as did a palette that was characterised by a broader colour range than in his paintings of the 1920s. The unprecedented shapes on these “telluric” paintings, such as Le Miroir Copte (Coptic Mirror), almost sparkle, as they are enhanced by the addition of sand and contrast radically with a background that is as dark as night.
André Masson, Les quatre éléments, 1924, Huile sur toile, Centre Georges Pompidou, Paris
Le Miroir Copte (Coptic Mirror) 1942
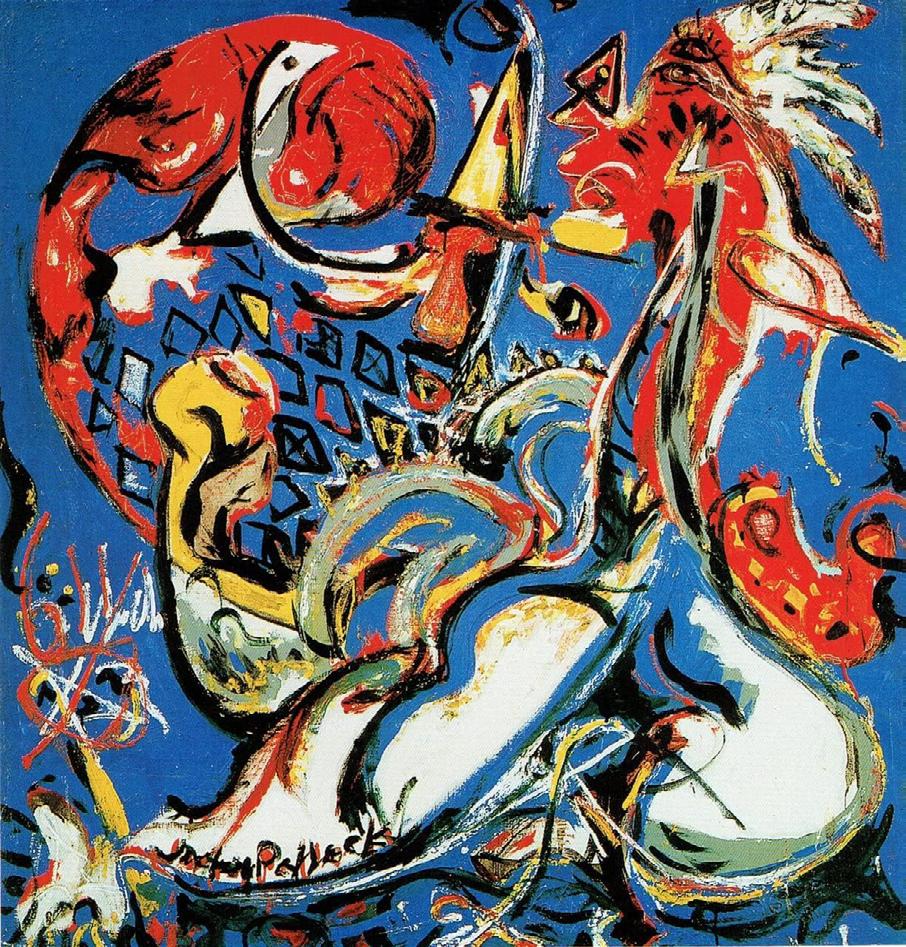
Dans un texte publié au catalogue de l’exposition André Masson –America à la galerie Cazeau –La Béraudière en 2004, Ghislain Uhry évoque ainsi ces œuvres qu’il nomme « Les Hymnes à la nuit » : le noir de ces nuits désespérantes d’où il venait, se muait alors en couleur noire support d’une étrange phosphorescence, comme pour deviner ou rêver les innombrables possibilités d’un nouvel univers. Dans ce vide, dans ce noir, premiers, une nouvelle ligne va naître ; mais cette fois elle ne sera plus l’éclat graphique sec et coupant du sismographeenregistreur ni non plus le contour qui cerne les formes ; au contraire elle devient elle-même forme ; se dilatant, s’élargissant
en masses colorées sans limite, la ligne devient absolument picturale, peinture. Là autant que la ligne, la couleur s’impose comme une nécessité intérieure inspirante ; alors le peintre, maître absolu d’une nouvelle technique, réalise la synthèse de ses dons de dessinateur et de peintre, « au centre de ce qui est ». Tableau syncrétique, carrefour d’influences, écho du fracas de l’histoire, Le Miroir Copte (Coptic Mirror) est avant tout un chefd’œuvre paradoxalement lumineux dans lequel « la nuit pessimiste de l’exil est devenue une nuit fertile où d’indéfinissables alliances se nouent et se dénouent. » (Ghislain Uhry).
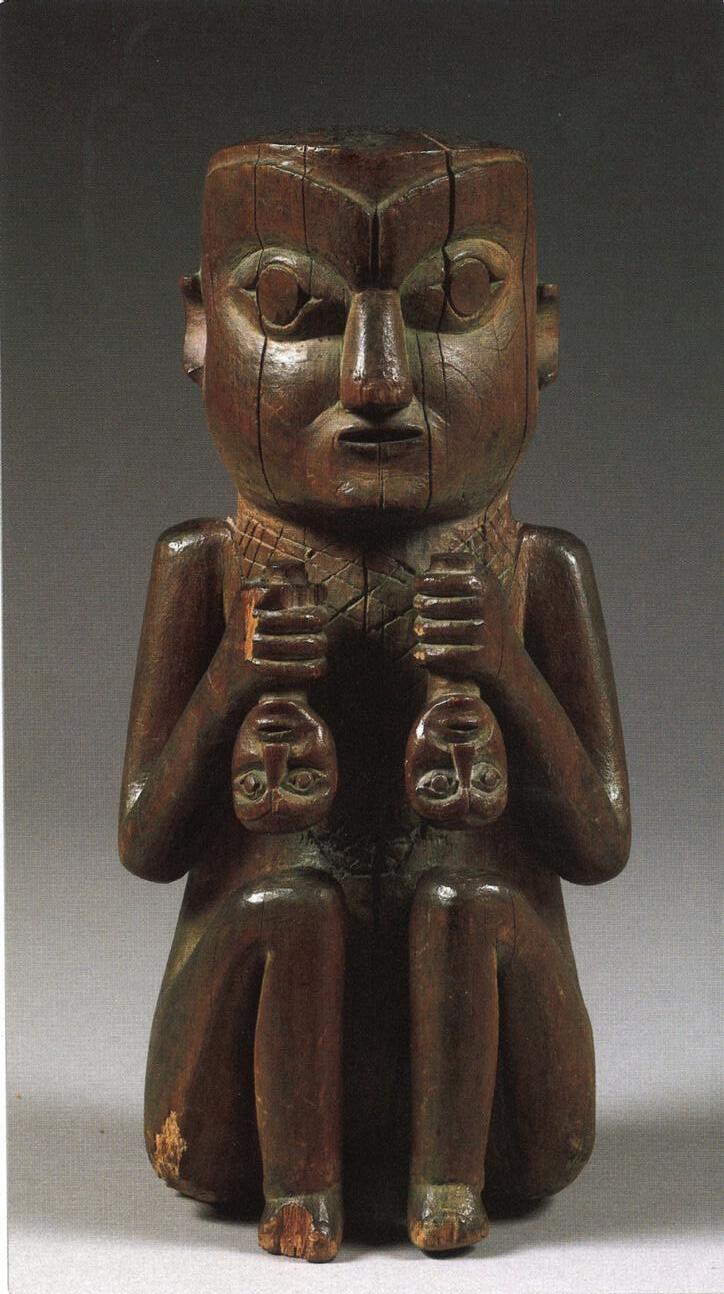
Hence, in a text published in the exhibition catalogue for André Masson –America at the Gallery Cazeau– La Béraudière in 2004, Ghislain Uhry mentioned these works that he called “Hymns to the night”: “the blackness of those desperate nights from which he came, was transformed by black as the background to a strange phosphorescence, as if to foretell or imagine the numerous possibilities of a new universe. In this emptiness, in this blackness,“premiers” , a new line is born; but this time it is no longer the lean, sharp, graphical brightness of the seismographrecorder, nor the outline that surrounds the shapes; on the contrary it becomes a shape in itself; dilating, growing with
unlimited coloured forms, the line becomes completely pictorial, a painting. Here, the colour is as essential as the line, like an inspiring interior necessity; so the painter, total master of a new technique, achieves the synthesis between his gifts as drawer and painter, “at the centre of everything that is”
Le Miroir Copte (Coptic Mirror), a syncretic work, at the crossroads of several influences, the echo of the fracas of history, is first and foremost a paradoxically luminous work in which “the pessimist night of exile became a fertile night where indefinable alliances are made and unmade” (Ghislain Uhry).
Jackson Pollock, The Moon-Woman cuts the circle, 1943, Huile sur toile, Centre Georges Pompidou, Paris
Colombie britannique, Figure totémique, Bois, ancienne collection André Masson

Wifredo LAM
1902-1982
L’enfant et le miroir ou Femme assise et enfant – 1942
Gouache et crayon sur papier
Signé et daté en bas à droite « Wifredo Lam, 28-8-42 » 105,50 × 83 cm
Provenance :
Pierre Matisse Gallery, New York Collection Stanley B. et Helen L. Resor, Greenwich (USA) Vente, New York, Parke-Bernet Galleries, 3 novembre 1966, lot 64 Collection particulière, Europe À l’actuel propriétaire par cessions successives
Exposition :
New York, Pierre Matisse Gallery, Lam paintings, novembre-décembre 1942
Bibliographie :
M-P. Fouchet, Wifredo Lam, 1er édition, Poligrafa/Cercle d’Art, Paris/ Barcelone, 1976, reproduit en noir et blanc sous le n°335, p. 230
M-P. Fouchet, Wifredo Lam, 2e édition, Poligrafa/Cercle d’Art, Paris/ Barcelone, 1989, reproduit en noir et blanc sous le n°367, p. 250
L. Laurin-Lam, Wifredo Lam, Catalogue Raisonné of the Painted Work, Volume I, 1923-1960, Editions Acatos, France, 1996, reproduit en noir et blanc sous le n°42.58, p. 306
Un certificat de Monsieur Eskil Lam sera remis à l’acquéreur.
Gouache and pencil on paper; signed and dated lower right; 41 ½ × 32 ¾ in.
180 000 – 280 000 €
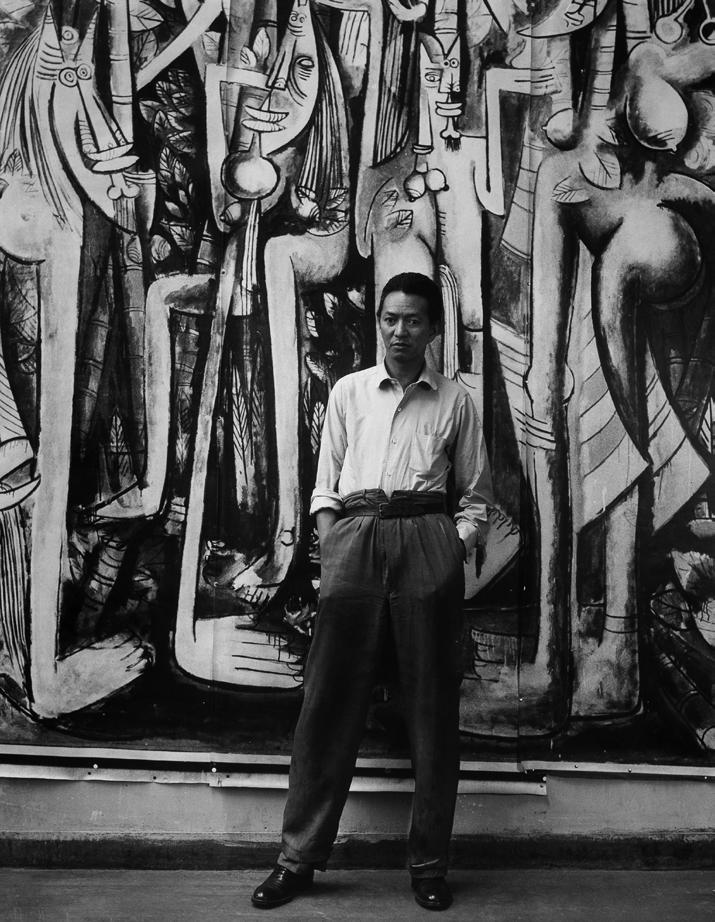
Wifredo Lam, circa 1950-55

Wifredo LAM
1902-1982
L’enfant et le miroir ou Femme assise et enfant – 1942
En mai 1945, le galeriste et collectionneur Pierre Loeb déclare dans la revue Tropiques, au sujet de son ami, l’artiste Wifredo Lam : « Lam sait dessiner et peindre, il a tout lu, il connaît à fond la musique, il est frère des poètes modernes les plus sensibles ; […] il a en lui la magie que l’on désire, recherche, implore ». En effet, la peinture de l’artiste cubain transcende les limites du sensible. Alors qu’il quitte l’Espagne en 1938 pour s’installer à Paris pendant deux ans, il est accueilli par Pablo Picasso qu’il considère comme un « incitateur à la liberté ». Le chef de file du Cubisme lui présente le marchand Pierre Loeb cité plus haut, mais également Georges Braque, André Breton, Paul Éluard, Fernand Léger, Michel Leiris, Matisse, et Joan Miró – parmi d’autres artistes – qui nourrissent largement sa pratique et le guident vers la définition de son esthétique. L’œuvre présentée ici, intitulée L’enfant et le miroir ou Femme assise et enfant, est réalisée en 1942 à la gouache et au crayon. Alors qu’un visage de femme se distingue nettement de la composition, l’influence cubiste et la déconstruction sont si marquées, que les éléments secondaires paraissent moins nets. À ce titre, Picasso dira de Wifredo Lam : « Je ne me suis jamais trompé sur toi. Tu es un peintre. C’est pour cela que j’ai dit la première fois que nous nous sommes vus que tu me rappelais quelqu’un : moi ». En effet, même s’il doit quitter la France après la

défaite de juin 1940, l’artiste reste proche du Cubisme qui lui permet de véhiculer sa réalité - celle de l’injustice, de la misère, du nazisme et du despotisme colonial. Le retour à Cuba en août 1941, précédant de peu l’année de réalisation du tableau, agit comme un catalyseur. Sa peinture est, dès lors, une arme de contestation. À l’automne 1942, l’œuvre est exposée à la Pierre Matisse Gallery de New York, dans le cadre d’une rétrospective consacrée à l’artiste.
Provenant d’une prestigieuse collection, L’Enfant et le miroir ou Femme assise et enfant fut la propriété d’Helen Lansdowne Resor, figure visionnaire de la publicité moderne aux États-Unis. Collectionneuse éclairée et mécène très influente, elle fut membre du conseil d’administration du Museum of Modern Art de New York. Aux côtés de son mari Stanley Burnet Resor, elle rassembla une remarquable collection d’art moderne et fit don, de son vivant, de plus de soixante-dix œuvres au MoMA, parmi lesquelles des pièces majeures de Pablo Picasso, Salvador Dalí et Giorgio de Chirico.
Restée en mains privées depuis 1966, cette œuvre est proposée aujourd’hui en vente publique, offrant aux collectionneurs une occasion rare d’acquérir une importante œuvre historique de l’artiste.
In May 1945, the gallerist and collector Pierre Loeb declared in the journal Tropiques about his friend, the artist Wifredo Lam: “Lam knows how to draw and paint, he has read everything, he knows music inside out, he is a brother to the most sensitive modern poets; […] within him lies the magic that one desires, seeks, implores”. Indeed, the Cuban artist’s painting transcends the limits of perception. When he left Spain in 1938 to settle in Paris for two years, he was welcomed by Pablo Picasso, whom he regarded as an “inciter to freedom”. The leader of Cubism introduced him to the dealer Pierre Loeb, mentioned above, as well as Georges Braque, André Breton, Paul Éluard, Fernand Léger, Michel Leiris, Matisse, and Joan Miró –among other artists– who deeply nourished his practice and guided him toward the definition of his aesthetic.
The work presented here, entitled The Child and the Mirror or Seated Woman and Child, was created in 1942 in gouache and pencil. While a woman’s face emerges clearly from the composition, the Cubist influence and deconstruction are so pronounced that the secondary elements appear less distinct. In this respect, Picasso would say of Wifredo Lam: “I was never mistaken about you. You are a painter. That is why, the first time we met, I said you reminded me of

someone: myself”. Even though he had to leave France after the defeat of June 1940, the artist remained close to Cubism, which allowed him to convey his reality –the reality of injustice, misery, Nazism and colonial despotism. His return to Cuba in August 1941, shortly before the year this work was created, acted as a catalyst. From then on, his painting became a weapon of protest.In the autumn of 1942, the work was exhibited at the Pierre Matisse Gallery in New York as part of a retrospective dedicated to the artist.
Coming from a prestigious collection, L’Enfant et le miroir ou Femme assise et enfant was owned by Helen Lansdowne Resor, a visionary figure in modern advertising in the United States. An enlightened collector and highly influential patron of the arts, she was a member of the board of trustees of the Museum of Modern Art in New York. Together with her husband Stanley Burnet Resor, she assembled a remarkable collection of modern art and donated more than seventy works to MoMA during her lifetime, including major pieces by Pablo Picasso, Salvador Dalí and Giorgio de Chirico.
Remaining in private hands since 1966, this work is now being offered for public sale, offering collectors a rare opportunity to acquire an important historical work by the artist.
Pablo Picasso, Le chandail jaune, 1939
Exposition Wifredo Lam à la Pierre Matisse Gallery de New York en 1942, en présence du lot 10 (à droite)
© Museum
Berggruen, Berlin
En Fr


Fernando BOTERO
1932-2023
Seated woman – 1990
Pastel sur papier marouflé sur toile
Signé et daté en bas à droite
« Botéro 90 »
123 × 89,50 cm
Provenance :
Fondation Veranneman, Belgique
Acquis auprès de cette dernière par le père de l’actuel propriétaire
Collection particulière, Monaco
Bibliographie :
E.J.Sullivan, J-M Tasset, Fernando Botero, Monograph & Catalogue Raisonné, Paintings 1975-1990, Acatos Publisher, Lausanne, 2000, n° 1990/15, reproduit en noir et blanc p. 466 et 472 (technique erronée)
Pastel on paper laid down on canvas; signed and dated lower right; 48 ⅜ × 35 ¼ in.
250 000 - 350 000 €

Fernando Botéro dans son atelier, New York, circa 1968-1969
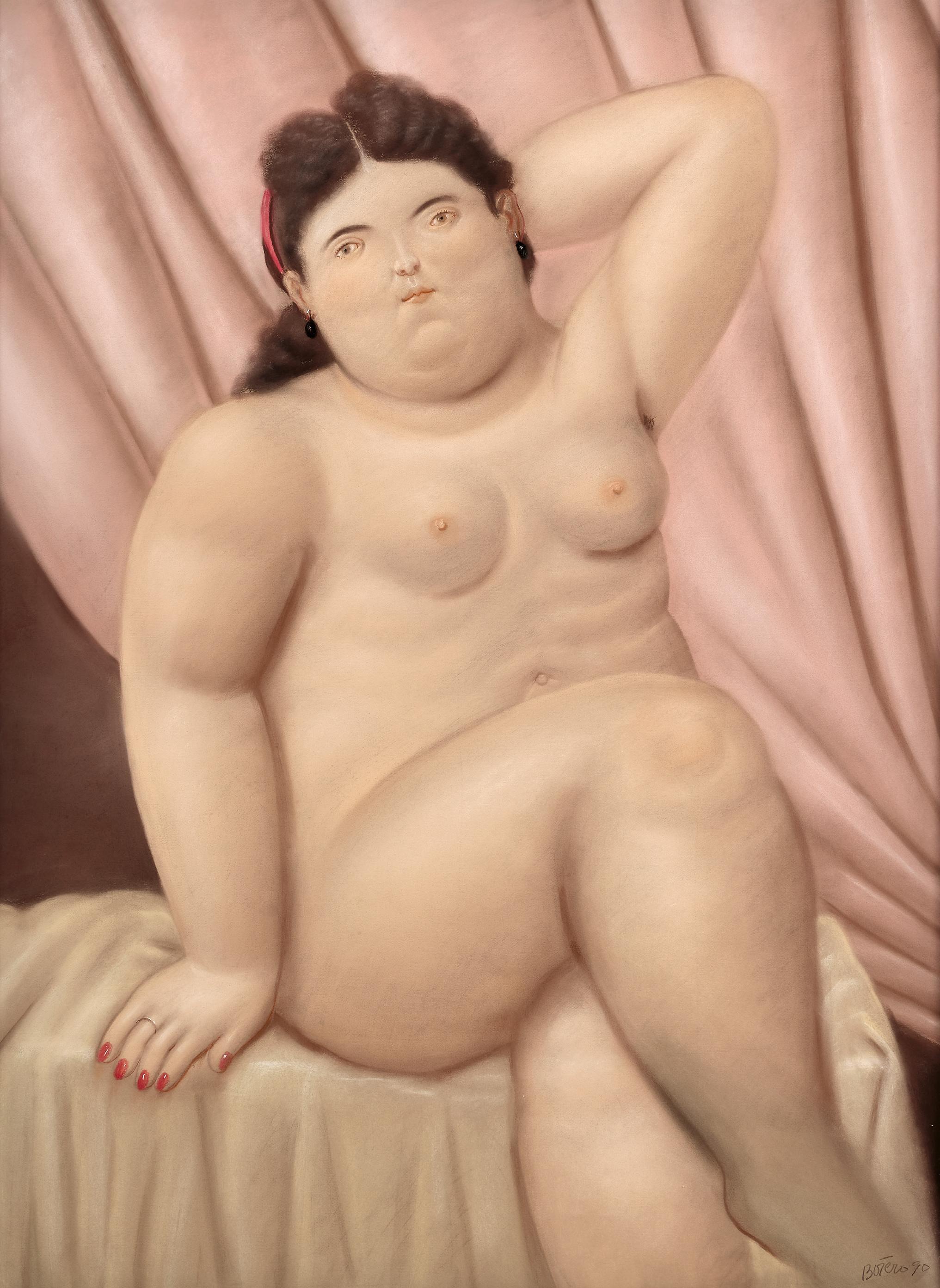
Seated woman – 1990
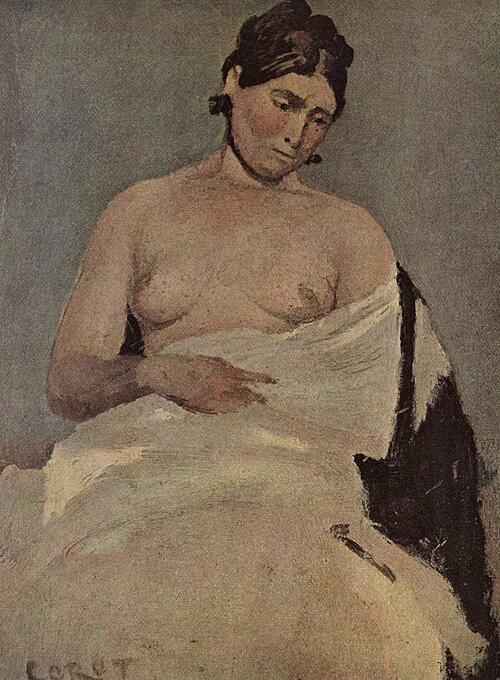

« Prendre pour modèle une peinture d’un autre peintre, ce que je fais souvent, c’est se mesurer à la puissance picturale d’une œuvre. Si la position esthétique que l’on a est absolument originale par rapport à celle à laquelle on se confronte, l’œuvre que l’on fait est elle-même originale », affirme sans ambages le peintre colombien Fernando Botero. Internationalement reconnu pour ses personnages dont les rondeurs côtoient la grâce, l’artiste, qui migre en Europe dès sa vingtième année, n’a cessé d’explorer les voluptuosités de la chair pour affirmer son esthétique propre, en dialogue avec l’histoire de l’art. « Gros, mes personnages ? Non, ils ont du volume, c’est magique, c’est sensuel. Et c’est ça qui me passionne : retrouver le volume que la peinture
contemporaine a complètement oublié », explique-t-il.
Ici, une peinture réalisée au pastel sur papier représente une femme assise sur un divan et croisant les jambes. Nue, les plis de son corps se confondent à ceux des tissus, draps et rideaux, créant une impression étrange d’accord latent entre le sujet et le décor. La présence du rideau en arrière-plan évoque un topos dans l’histoire du nu. Ainsi, Nu devant un rideau vert d’André Derain (1923, conservé au Centre Pompidou) explore l’intimité en éprouvant également l’accessoire suggestif du rideau jusqu’à le souligner dans son titre. Le tissu de manière générale est souvent l’apanage des nus dans l’histoire de l’art, qui semblent tout autant s’en dégager que s’en recouvrir pudiquement, à l’instar de Femme assise aux seins nus
Colombian painter Fernando Botero stated in no uncertain terms, “Using another painter’s painting as your model, which is something I often do, means confronting that work’s visual power. If your aesthetic stance is completely original compared to the one that you are confronting, then the work that you are creating is, itself, an original work”. The artist, internationally renowned for his characters that are as large as they are graceful, came to live in Europe at the age of twenty. He continually explored the sensuality of the flesh to assert his specific aesthetics whilst maintaining a relationship with the history of art. “Fat, my characters? No, they’re voluminous. It’s magical, sensual. And that’s what I feel passionate about: recovering the volume that contemporary painting has
completely forgotten”, he explained. The pastel on paper presented here depicts a cross-legged woman seated on a divan. The folds of her bare body mingle with the folds of the material, sheets, and curtains, creating a strange impression of an embryonic rapport between the subject and the setting. The presence of a curtain in the background evokes a topos in the history of the nude. Hence, Nu Devant un Rideau Vert by André Derain (1923, kept in the Pompidou Centre, Paris) explores intimacy by going so far as to include the suggestive accessory that is the curtain in the work’s title. Broadly speaking, throughout the history of art, such material has often been the prerogative of nudes, who seem as much to emerge from it as to modestly cover themselves with it,
Jean-Baptiste Corot, Femme assise aux seins nus Circa 1830, Huile sur toile, Collection particulière
André Derain, Nu devant un rideau vert, 1923, Huile sur toile, Centre Georges Pompidou, Paris
de Jean Baptiste Corot (circa 1830, figurant dans la collection personnelle de Paul Rosenberg au début des années 1920).
Dans l’œuvre présentée ici, le vernis rouge vif de la jeune femme, sa pose lascive et sa poitrine découverte contrastent avec son alliance et sa coiffure ordonnée derrière un serre-tête rose. La teinte pastel, majoritairement présente dans la composition souligne ces quelques touches chromatiques plus vives et attire l’attention du spectateur. Seated woman est réalisée sur papier tout comme de nombreuses œuvres de Botero qui n’accorde aucune prédominance à une technique ou un support plutôt qu’à un autre. Pour l’artiste colombien, le dessin a toujours compté comme une œuvre en soi, autant que la peinture ou la sculpture.
Dans ses œuvres sur papier, les couleurs ocres et roses sont souvent convoquées, comme c’est le cas ici.
Étrangement, le personnage de la jeune femme ne semble exprimer aucun sentiment. Ses yeux, proportionnellement très petits au vu du reste de son visage, s’y noient, laissant place à une impression de détachement, comme si la jeune femme ellemême regardait la scène en train de se dessiner. À ce titre, l’écrivain
Mario Vargas Llosa évoque un « manque de dramatisme » et une forme d’« imperturbabilité préromantique » dans les peintures de Botero. Seated Woman confirme la force de ce propos et la dimension inclassable et anticonformiste du génie de Botero.
as in Femme Assise aux Seins Nus by Jean Baptiste Corot (circa 1830, which was in Paul Rosenberg’s personal collection in the early 1920s).
In the work presented here, the young woman’s bright red nail varnish, her sensual posture, and her bare breasts contrast with her wedding ring and her tidy hairstyle, held in place behind a pink hairband. The composition’s predominant pastel tone highlights these few touches of brighter colour, which draw the viewer’s attention. Seated Woman is a work on paper, as are many of Botero’s works, which grant no prevalence to any particular technique or support. For the Colombian artist, drawings were always a work in their own right, as much as paintings or sculpture.
In his works on paper, he often used ochre and pink colours, as is the case here.
Strangely, the young woman seems to express no emotions. Her eyes are too small in proportion to the rest of her face, seeming to drown in it, and giving the impression of a sort of detachment as if the young woman herself was looking at the scene being drawn. In that respect, the writer Mario Vargas Llosa spoke of a “lack of drama” and a sort of “preromantic equanimity” in Botero’s paintings. Seated Woman confirms the strength of this message and the unclassifiable and nonconformist dimension of Botero’s genius.

Baltasar LOBO
1910-1993
Mère et enfant sur socle
Bronze à patine vert foncé
Signé et numéroté sur la terrasse
« Lobo E.A. 1/4 », cachet du fondeur sur la tranche de la terrasse
« Susse Fondeur Paris »
Modèle créé circa 1947-1981
Cet exemplaire fondu en 1989
46 × 53 × 23 cm
Provenance :
Galerie Malingue, Paris (acquis auprès de l’artiste en 1989)
Collection particulière, France (acquis auprès de cette dernière en 1989)
Bibliographie :
J-E.Muller, V. Bollmann-Muller, Lobo, Catalogue raisonné de l’œuvre sculpté, La Bibliothèque des Arts, Paris, 1985, n°76, reproduit en noir et blanc (le plâtre)
K. de Baranano, Baltasar Lobo. Catologo Razonado de Esculturas, Volumen II / Obras, Turner Publicaciones S.L., Madrid, 2021, N°8108, reproduit en noir et blanc p.388 (un autre exemplaire)
Cette œuvre est enregistrée dans les Archives Malingue sous le n° S.A. N°8108
Nous remercions la Galeria Freites pour les informations qu’elle nous a aimablement communiquées.
Bronze with dark green patina; signed and numbered on the base, foundry mark on the edge of the base; 18 1/8 × 20 ⅞ × 9 in.
30 000 - 50 000 €

Francis PICABIA
1879-1953
Lit d’eau – circa 1937-1938
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
« Francis Picabia » 81 × 100 cm
Provenance :
Atelier de l’artiste
Dr Gaston Raulot-Lapointe (1946)
Collection Raulot-Lapointe (1949)
Vente Versailles, Floralies, 13 mai 1964
Collection Georges Waisman, Paris (1966)
Collection particulière, Paris (depuis 1991)
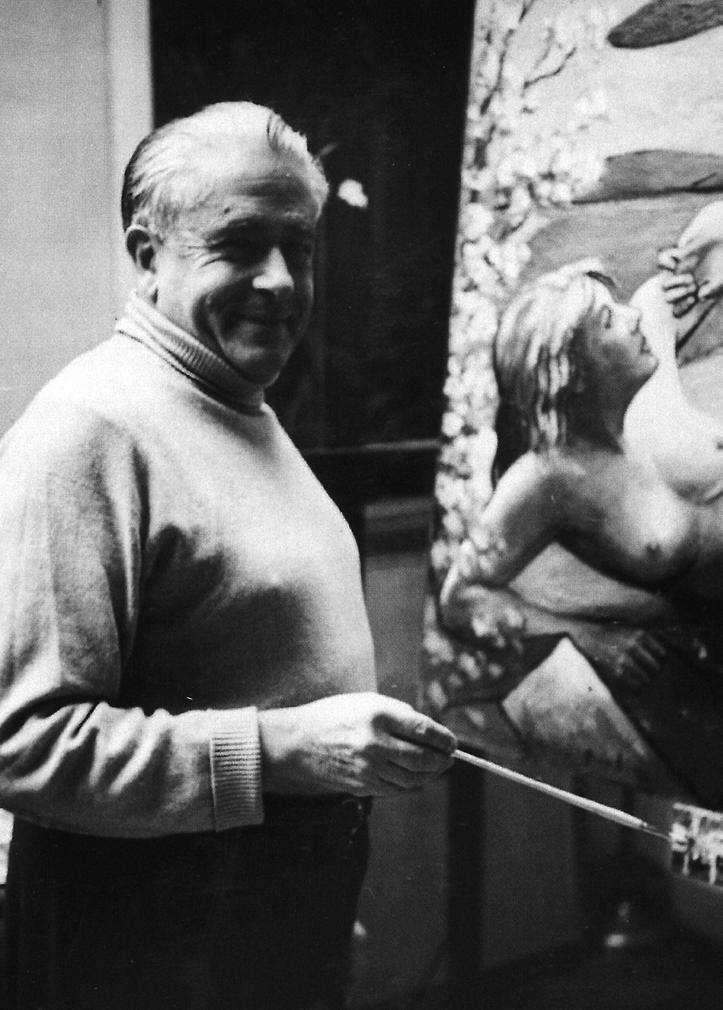
Exposition :
Paris, Galerie René Drouin, 1949, n°68, reproduit
Bibliographie :
M.L Borras, Picabia, Albin Michel, Paris, 1985, n°836, reproduit
W. Camfields, B. Calté, C.Clements, A. Pierre, Francis Picabia catalogue raisonné - Volume III (1927-1939), Mercator, Bruxelles, 2019, n°1445, p.371, reproduit en couleur p.370
Oil on canvas; signed lower left; 31 ⅞ × 39 ⅜ in.
300 000 - 400 000 €
Francis Picabia dans son atelier, janvier 1939, photographie de Thérèse Bonney
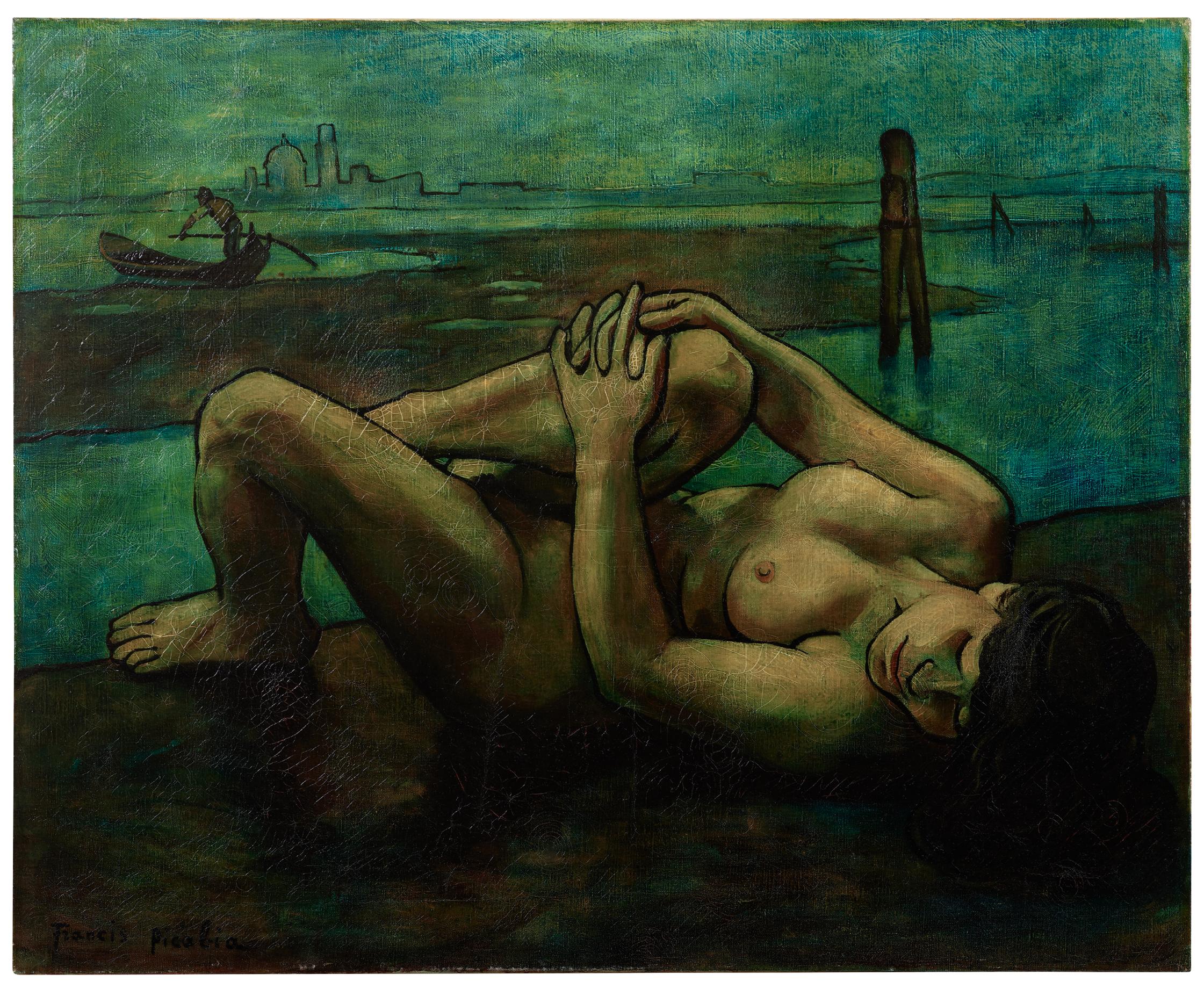
Francis PICABIA
1879-1953
Lit d’eau – circa 1937-1938

« Christophe Colomb de l’art » selon les mots de Jean Arp, Francis Picabia est le grand aventurier des avant-gardes. Du divisionnisme à l’abstraction en passant par Dada et le surréalisme, son insatiable soif de création le pousse à explorer toujours plus loin les territoires modernes. La seconde moitié des années 30 constitue un moment essentiel de remise en question dont la profondeur ne fut pas immédiatement comprise. Le peintre abandonne les effets de transparence qui peuplaient ses œuvres depuis quasiment une décennie pour repartir sur les sentiers inconnus de son art. Entre figuration néo-humaniste
chère à sa protectrice Gertrude Stein et fugace retour de flamme abstrait dimensioniste, Picabia ne craint pas le grand écart, il en fait même sa signature, soulignant que son appétit de peinture submerge limites, catégories et hiérarchies. Les retrouvailles avec le paysage ne sont pas qu’un simple retour aux sources, elles portent la marque du tortueux parcours du peintre, l’empreinte de ses obsessions passées et présentes. Ainsi Lit d’eau peint en 1938 n’a-t-il plus aucun rapport avec les compositions post-impressionnistes des débuts, il est marqué du sceau de l’étrangeté surréaliste.
In the words of Jean Arp, Francis Picabia, the great adventurer of the avant-garde, was the “Christopher Columbus of art”. From Divisionism to Abstraction and Dada to Surrealism, his insatiable thirst for creation drove him to explore the boundaries of modern territories. The second half of the 1930s was a crucial time of reassessment whose depth wasn’t immediately understood.
The painter abandoned the transparency that had infused his works for almost a decade and travelled the uncharted paths of his art. Between the neo-humanist figuration that was dear to his friend and defender
Gertrude Stein and the fleeting return to Dimensionist Abstraction, Picabia had no fear of great changes in direction. Indeed, he made such radical change his signature, highlighting the fact that his appetite for painting vanquished boundaries, categories, and hierarchies. His return to landscapes wasn’t just a simple return to his roots. It was typical of the painter’s meandering pathway, the mark of his past and present obsessions. Thus, Lit d’Eau, painted in 1938, no longer had any form of connection to the compositions of his post-Impressionist debuts and was stamped with the
Fr EN
Giorgione, Vénus endormie, circa 1508, Huile sur toile, Gemäldegalerie, Dresde
Cette figure monumentale surgissant dans les brumes mystérieuses de la lagune vénitienne a tout d’une vision onirique et la posture de ce nu endormi, libérée des conventions de la vraisemblance, annonce le dalinien Rêve causé par le vol d’une d’une abeille autour grenade, une seconde avant l’éveil Lit d’eau est aussi le fruit de la rencontre d’une myriade d’inspirations et d’aspirations contraires, à la fois nu sensuel et paysage mélancolique, où évocation mythologique et imagerie populaire licencieuse se confondent.
Il s’agit en effet peut-être du deuxième nu tiré d’une photographie de revue légère après l’expérience inaugurale du Nu devant un paysage exécuté la même année, un procédé qui fera florès dans la production de Picabia au début des années 40. Mais l’œuvre est, avant tout, une héritière insolente de la grande histoire de l’art et sa cohorte de femmespaysages, déesses inspirantes, filles ineffables de la Vénus endormie qui naît sous les pinceaux de Giorgione et de Titien à Venise, comme le Lido, comme Lit d’eau donc, la boucle est malicieusement bouclée.
strangeness of Surrealism. This monumental figure that bursts out of the mysterious mists of the Venetian Lagoon resembles a dreamlike vision, and the posture of this sleeping nude, freed of the conventions of realism, heralded the Daliesque Rêve Causé par le Vol d’une Grenade, une Seconde avant l’Éveil. Lit d’Eau is also the fruit of the encounter of myriad contradictory inspirations and aspirations. It is both a sensual nude and a melancholic landscape, where mythological evocation and licentious popular imagery mingle. It is, perhaps, the second nude
drawn based on a photograph from an exotic magazine after his first experience with Nu Devant un Paysage painted that same year. An approach that would flourish in Picabia’s works in the early 1940s. But the work is, first and foremost, the insolent heir to the history of art and its cohort of women-landscapes, inspirational goddesses, the ineffable daughters of the Venus Endormie that came to life with the brushstrokes of Giorgione and Titian in Venice, like the Lido, as in Lit d’Eau, mischievously bringing us full circle.
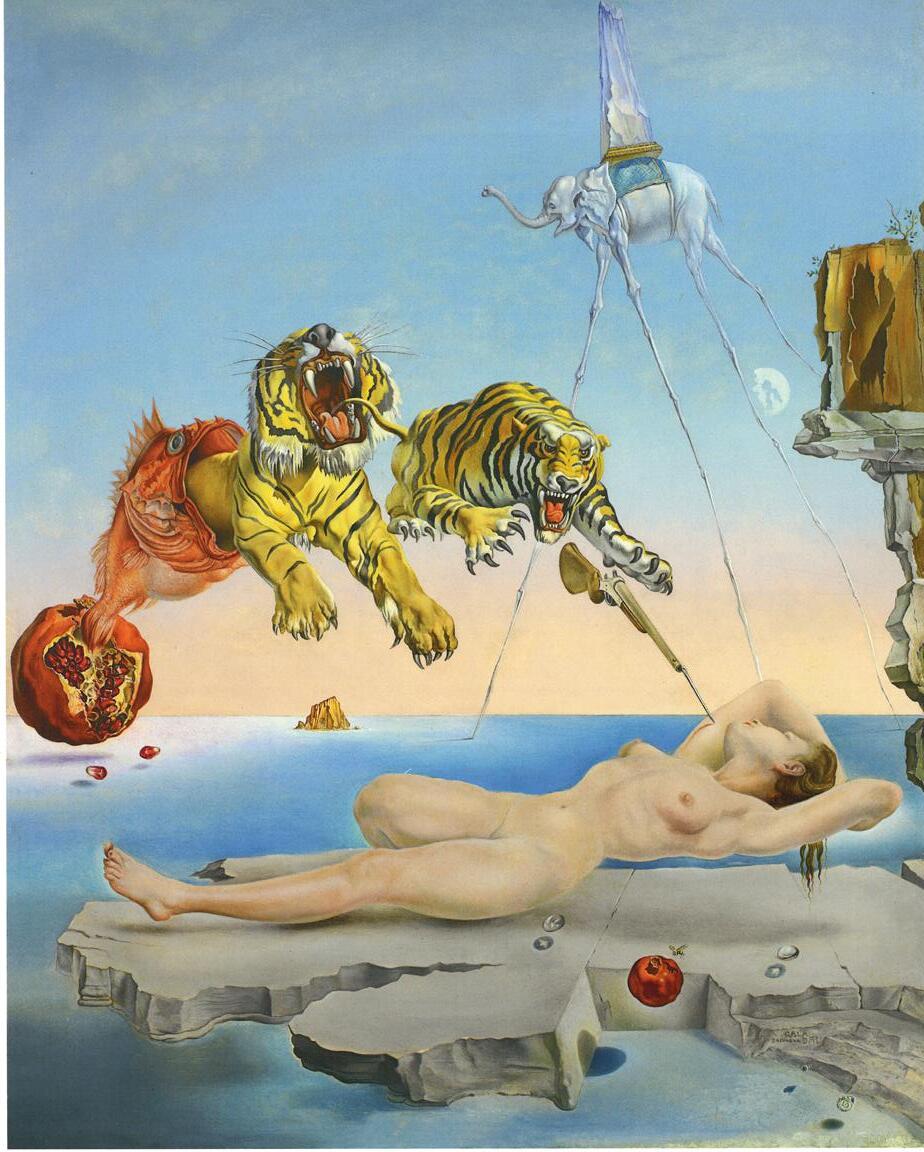

Salvador Dalí, Rêve causé par le vol d’une abeille autour grenade, une seconde avant l’éveil, 1944, Huile sur panneau, Musée Thyssen-Bornemisza, Madrid
Gustav Klimt, Danaé, 1907, Huile sur toile, Collection Dichand
Francis PICABIA
1879-1953
Lit d’eau – circa 1937-1938

Le tableau et son titre, trouvent d’ailleurs un troublant écho dans une autre divinité aquatique du XXe siècle, La Rivière que sculpte quasiment au même moment Aristide Maillol, malgré tout ce qui peut séparer les deux artistes.
Le peintre, maître des illusions et des faux-semblants, prend bien soin de donner à sa composition certains des attributs les plus évidents des œuvres des grands anciens, avec un vernis et de vénérables craquelures qui évoquent parfaitement artificiellement le poids des
siècles qui patine les chefs d’œuvre et façonne notre regard. Le créateur, moderne parmi les modernes, semble mettre en scène son impatience à rejoindre les classiques.
Composition gorgée de références, profondément savante et faussement légère, sincèrement mélancolique et génialement ironique, le Lit d’eau est – comme toutes ses grandes œuvres – un autoportrait de Francis Picabia en navigateur virtuose sur l’océan jubilatoire de la création.
Furthermore, despite all that separates the two artists, the work and its name find an unsettling echo in another of the 20th century’s aquatic divinities, La Rivière, which Aristide Maillol sculpted at practically the same time.
The painter, a master of illusions and imitations, took good care to give his composition some of the most obvious attributes of the works of great masters, using varnish and venerable cracks that perfectly artificially call to mind the passing of the centuries, which
ages masterpieces and shapes our view. The creator, who was among the avant-garde, seems to have staged his impatience to join the Masters.
The composition is gorged with references, profoundly knowledgeable and falsely lighthearted, sincerely melancholic and ingeniously ironic. The Lit d’Eau is –like all of his great works– a self-portrait of Francis Picabia as a masterful navigator on the jubilatory ocean of creation.
En Fr
Aristide Maillol, La Rivière, 1938-1943, sculpture en plomb, Vente Artcurial 2 décembre 2013, Collection particulière


Jean Hélion
Le jugement dernier des choses circa 1978–1979
Triptyque d’une
Jean HÉLION
1904-1987
Le jugement dernier des choses
Circa 1978–1979
Acrylique sur toile (triptyque)
Signée de l’initiale et datée en bas à droite « H78 », contresignée, datée et annotée au dos "Hélion 78-/Le jugement dernier des choses / Volet 1" sur le panneau gauche
Signée, datée, titrée et annotée au dos "Hélion /78-/ Le jugement /dernier / des choses /volet 2" sur le panneau central
Signée de l’initiale et datée en bas à droite « H./78/.9 » , contresignée, datée, titrée et annotée au dos "Hélion 78.79/ le jugement dernier des choses / volet 3" sur le panneau droit
Triptyque :
200 × 844,50 cm - 78 ¾ × 332 ½ in.
Panneau gauche :
200 × 349,50 cm - 78 ¾ × 137 ⅝ in.
Panneau central :
199,70 × 145 cm - 78 ¾ × 57 ⅛ in.
Panneau droit :
200 × 350 cm - 78 ⅝ × 137 ¾ in.
Provenance :
Succession de l’artiste en 1987
Galerie Gérald Piltzer, Paris (acquis du précédent en 1995)
Collection particulière, Suisse (du précédent depuis 1996-1997, jusqu’à ce jour)
Exposition :
Thionville, Centre culturel Jacques Brel, Hélion. Les marchés, avril-mai 1985, n° 7, reproduit en couleur p. 16-17
Danemark, Aarhus Kunstmuseums Forlag, Jean Hélion, rétrospective dessins et peintures 1926-1983, septembre-octobre 1985, n° 46, reproduit en noir et blanc p. 68-69
València, Centre Julio González, Jean Hélion, mars - mai 1990, n° 40 (uniquement le panneau central exposé titré La fin des mannequins)
Paris, Galerie Gérald Piltzer, Hélion à Matignon, septembre-novembre 1995, reproduit en couleur, n.p.
New York, Galerie Salander-O’Reilly, Jean Hélion. Paintings, avril 1996 Monaco, Salle du Quai Antoine 1er,
Hélion ou l’invention de l’Autre, mars-avril 2000, reproduit en couleur p. 72
Paris, Musée national d’Art Moderne, Centre Georges Pompidou, Jean Hélion, décembre 2004-mars 2005, p.167, reproduit en couleur p.167, 168,169,170, détail reproduit p.171
Barcelone, Musée Picasso, Jean Hélion, mars-juin 2005, reproduit en couleur p.168
Paris, Musée d’Art Moderne, Jean Hélion : La prose du monde, mars-août 2024, n° 87, p.239, reproduit en couleur p. 200-201
Bibliographie :
In Silex n°29, « Hélion », Grenoble, 1985, reproduit en noir et blanc p. 72
J. Perl, Paris without end, North Point Press, Berkeley, 1988, n° 45 H.- C. Cousseau, Hélion, Éditions du Regard, Paris, 1992, reproduit en couleur p. 272, 273 et en noir et blanc p. 339
A. Bonfand, L’art en France 1945-1960, Nouvelles éditions françaises, Paris, 1995, reproduit p. 116

P. Dagen, Hélion, Éditions Hazan, Paris, 2004, n° 155, reproduit en couleur p. 238, 239, 240, texte p.251
H. Bize, Hélion, Éditions Cercle d’Art -Découvrons l’art, Paris, 2004, n° 62, reproduit en couleur n.p.
In Pleine marge, n°49-50, octobre 2009, "Jean Hélion présenté par Jed Perl (Hélion’s Freedom) et Pierre Brullé (Façons de peindre, façons de penser)" , reproduit p. 17
H .- C. Cousseau, Hélion, Éditions du Regard, Paris, 2024, reproduit en couleur p. 272-273 et en noir et blanc p.338
Ces œuvres sont référencées dans le catalogue raisonné en ligne : https://associationjeanhelion. fr/2023/07/05/jugement-dernier-deschoses-panneau-gauche/ https://associationjeanhelion. fr/2010/12/23/catrais0230/ https://associationjeanhelion. fr/2023/07/05/jugement-dernier-deschoses-panneau-droit/
Acrylic on canvas (triptych); signed with the initial and dated lower right, signed again, dated and annotated on the reverse on the left panel, signed, dated and annotated on the reverse on the central panel signed with the initial and dated lower right, signed again, dated and annotated on the reverse on the right panel;
300 000 - 600 000 €

Jean HÉLION 1904-1987
Le jugement dernier des choses
Circa 1978–1979
Magistral mausolée à la gloire du quotidien, Le Jugement dernier des choses, fruit de plus de 10 ans de travail et de réflexion et dernier triptyque peint par Jean Hélion, représente l’aboutissement d’une vie de création. Dans cette somme monumentale, la parade familière des objets d’un marché aux puces devient célébration vibrante de la grandeur d’un réel transfiguré par la vision de l’artiste et se pare de la majesté des plus grandioses tableaux d’autel, En 1965, le peintre prophétisait déjà dans ses carnets : « La matière de l’art se rend en pompe et en beauté au jugement dernier, ce mythe indispensable à tout cheminement de l’être entier. ». Dans la construction de son grand

œuvre héritier de la séculaire tradition de l’art occidental, il convoque plutôt les mânes de Giotto à Padoue que celles de Michel-Ange au Vatican. À l’image du maître toscan dans la chapelle des Scrovegni, il offre à son ultime évocation pucière, les atours d’une fresque à la fois monumentale et étonnamment intime, où les frises foisonnantes des parois latérales font cheminer le regard étourdi du spectateur vers l’inexorable acmé du Jugement dernier. Pour ce rendez-vous essentiel, l’artiste prend soin d’accorder une place à tous les grands héros de son épopée figurative qui se poursuit depuis le tournant des années 1940 : les parapluies côtoient la machine à écrire, les
Le Jugement Dernier des Choses, a masterful mausoleum to the glory of daily life, the fruit of over 10 years of work and reflection, and the final triptych painted by Jean Hélion, represents the result of a life of creation. In this monumental outcome, the familiar parade of objects from a flea market becomes a vibrant celebration of the grandeur of reality transfigured by the artist’s eye, draping itself in the splendour of the most grandiose of altar paintings.
As early as 1965, the painter stated in his notebooks: “The substance of art proceeds beautifully and with great pomp towards the Last Judgement, this myth that is indispensable
for any path that must be followed wholeheartedly”. The construction of his great work, which is the successor to the secular tradition of Western art, is more reminiscent of Giotto’s frescoes in Padua than the works of Michelangelo in the Vatican. Like the Tuscan master in the Scrovegni Chapel, he offers his final allusion to flea markets, the finery of a fresco that is both monumental yet astonishingly intimate, in which the abundant friezes on the lateral walls lead the viewer’s dizzy gaze to the inescapable crowning element: the Last Judgement.
For this essential encounter, the artist was careful to give a place to each of the great heroes of his figurative saga that carried on from
En Fr
Giotto, Fresques de la Cappella degli Scrovegni, 1303-1306, Padoue
chaussures s’égaillent avec fantaisie sur la gauche, tandis qu’à droite, le gramophone et les instruments restent silencieux, le chevalet s’échappe à dos d’homme quand l’iconique chapeau se pose sur un escalier qui ne mène nulle part. Les bougies et le crâne sont bien évidemment là aussi, discrets symboles de vanité qui parachèvent un dispositif synthétisant tous les thèmes fondamentaux qui irriguent son œuvre. Les choses, mortes, ont pris le pas sur les êtres vivants, les tableaux sont à terre, le disque est brisé, le tambour est percé. Ainsi, l’ode à l’objet se conclut par un inévitable Triomphe de la mort à la morale ironique et paradoxalement optimiste, car l’artiste chantre de la finitude espère bien que son art lui survivra. Nulle trace de la pesanteur
de la mélancolie beaudelairienne chez Hélion, c’est un constat objectif qui nous est livré avec une mordante fantaisie par celui qui aime rappeler que « la vie est un cirque ». Quand les objets prennent le pouvoir pour nous rappeler notre pathétique condition de mortels, les figures s’effacent, se courbent, se ridiculisent ou se cachent pour s’aimer. Eros et Thanatos sous la tente du brocanteur, Hamlet au royaume des puces et sa tête en plastique ou l’eschatologie au ras du bitume, l’artiste tisse le fil improbable qui lie le dérisoire à la transcendance. Il place même, en majesté, au centre, des mannequins sans tête qui interprètent une saisissante Pietà à l’image de celle d’Enguerrand Quarton.
the early 1940s, with umbrellas to be found alongside typewriters, shoes whimsically scattered to the left, whilst on the right-hand side, the gramophone and instruments remain silent, the easel escapes on a man’s back, and an iconic hat lies on a stairway that leads nowhere. The candles and skull are also there, of course; discreet symbols of vanity that complete an ensemble that summarises all of the fundamental themes to be found in his work. The objects, lifeless, have supplanted living beings. The paintings are on the floor, the record is broken, and the drum has a hole in it. Thus, the ode to objects concludes with an inevitable Triomphe de la Mort that has a paradoxically optimistic and ironic moral, as the artist who was a defender of finitude hoped
that his art would survive him. With Hélion, there is no trace of the weightiness of melancholy typical of Baudelaire. His work is simply an objective analysis delivered with acerbic vision by one who liked to recall, “life is a circus”.
When objects supplant us to remind us of our pathetic condition as mere mortals, human figures are erased, show deference, make fools of themselves, or hide to make love. With Eros and Thanatos hidden beneath the second-hand goods dealer’s tent, Hamlet in the kingdom of flea markets, and his plastic head or eschatology on the asphalt, the artist weaves an improbable web that links the derisory to transcendence.

Jean Hélion, Choses vues en mai, 1969, triptyque, Acrylique sur toile (détail), Centre Georges Pompidou, Paris
Jean HÉLION
1904-1987
Le jugement dernier des choses
Circa 1978–1979
Construction à la fois follement fantaisiste et profondément savante, Le Jugement dernier des choses est aussi un chef d’œuvre de la nécessité, une victoire du peintre sur les limites et les obstacles que lui imposent son corps. Ses mains l’ont déjà privé de l’huile depuis un moment, il en tire une gourmande exploration des couleurs de l’acrylique, mais surtout sa cécité progressant, il mène une quête de nouvelles voies d’expression du visible et trouve dans l’épreuve une ultime clé pour relever l’immense défi qu’il s’est imposé depuis plus de 30 ans avec son retour à la figuration et qu’il résume ainsi : « Telle qu’on l’avait formulée au XIXe siècle, la peinture annonçait sa fin que Mondrian, Picabia et

Duchamp consacrent. Au même point, j’ai senti qu’on pouvait les dépasser avec leurs propres termes, et repartir au lieu de finir, comme ils avaient cru ». Comment dépasser et repartir ?
Le peintre, prophète aveugle, a trouvé, il peint pour « voir clair », « dessine avec [sa] connaissance, colore avec passion, compose avec le songe » et nous livre avec Le Jugement dernier des choses le secret de cet art jusqu’alors inconnu.
He even gives pride of place, in the centre, to headless mannequins that interpret a gripping Pietà, which echoes the work by Enguerrand Quarton. The construction of Le Jugement Dernier des Choses is both madly whimsical and deeply knowledgeable, a masterpiece of necessity, and the painter’s victory over the limits and obstacles his body imposed on him. For some time, his hands had already deprived him of oil painting, yet he made this work a gourmet exploration of the colours of acrylic. But above all, as his blindness progressed, he pursued new means of expressing the visible and, in this trial, found a final key to address the challenge
he had set himself for over 30 years with his return to figurative work, which he resumed as follows: “As announced in the 19th century, the end of painting was imminent. Mondrian, Picabia, and Duchamp would bring about this end. To the same extent, I felt that they could be surpassed using their own terms and brought to start again rather than finish, as they had thought they would”. How can your surpass and start again? The painter, a blind prophet, had found the answer. He painted in order to “see clearly”, “drew with [his] knowledge, coloured with passion, composed with dreams”, and with Le Jugement Dernier des Choses brought us the secret of this hitherto unknown art.
Enguerrand Quarton, Pietà de Villeneuve-lès-Avignon, circa 1455-1460, Tempera sur panneau, Musée du Louvre, Paris


Sayed Haider RAZA 1922-2016
Bindu – 1994
Acrylique sur toile
Signée, datée et titrée au dos « Raza, 1994, Bindu (Espace) » 80 × 80 cm
Provenance : Collection particulière, France
Bibliographie :
Cette œuvre sera incluse dans le Catalogue Raisonné, Volume III (1990-1999) de l’Œuvre de l’artiste, actuellement en préparation par Madame Anne Macklin en collaboration avec la Fondation Raza de New Delhi.
Acrylic on canvas; signed, dated and titled on the reverse; 31 ½ × 31 ½ in.
100 000 - 150 000 €
« Mon travail est le reflet de mon expérience intérieure et de mon dialogue avec les mystères de la nature et des formes, que j’exprime à travers la couleur, la ligne, l’espace et la lumière ».
— S. H. Raza

Sayed Haider RAZA 1922-2016
Bindu – 1994
Sayed Haider Raza compte parmi les plus grands peintres indiens du XXe siècle. Né en 1922 dans l’État du Madhya Pradesh, Raza se passionne très tôt pour la peinture. Il étudie aux Beaux-Arts de Nagpur puis de Bombay. En 1947, il cofonde, aux côtés de ses amis Francis Newton Souza et Maqbool Fida Husain, le Progressive Artists Group. Puis en 1950, il s’installe à Paris grâce à une bourse du gouvernement français. Élève de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts jusqu’en 1953, il expose dès 1955 à la Galerie Lara Vincy.
Son œuvre établit un véritable pont entre l’Inde et l’Occident, en mêlant les enseignements de l’art moderne européen (notamment l’expressionnisme et l’abstraction) aux racines spirituelles et philosophiques de la tradition indienne et s’intègre à ce que l’on appelle aujourd’hui l’École de Paris.
Bien que le travail de Raza ait toujours trouvé ses racines dans le paysage et la nature, sa manière de les représenter a profondément évolué au cours de
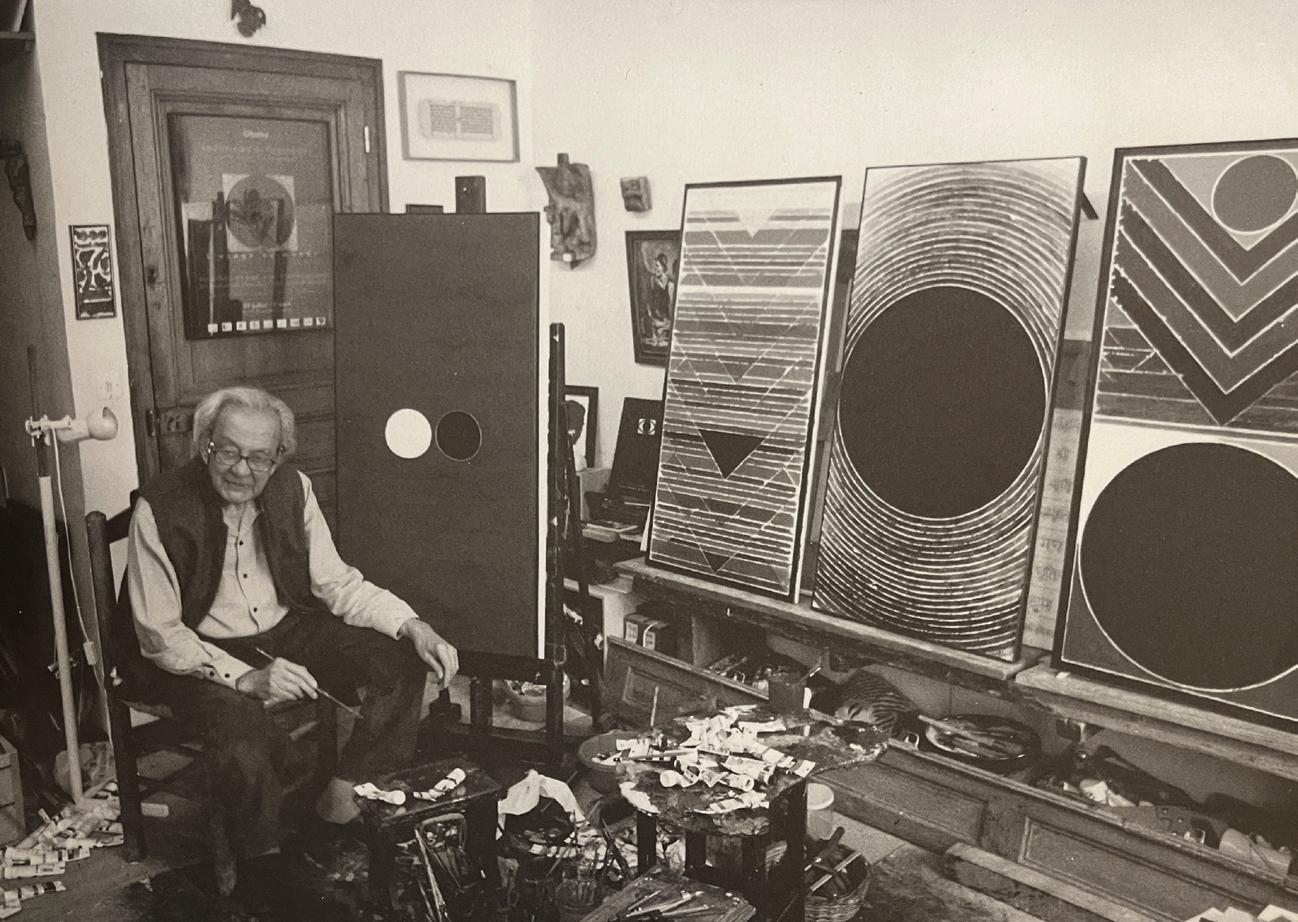
ses huit décennies de création. Progressivement, il délaisse la figuration pour se tourner vers l’abstraction, explorant les formes géométriques et les couleurs intenses afin de révéler l’essence de l’univers. Dans les années 1980, il adopte des compositions géométriques rigoureuses, à travers lesquelles il exprime sa vision du monde naturel et des forces cycliques qui le structurent.
Le point noir apparaît dans son œuvre dès le début des années 1950 sous la forme d’un soleil noir. Il deviendra, à la fin des années
1970, le « bindu », symbole central et élément constitutif de son langage artistique, qu’il continuera à explorer jusqu’à sa mort en 2016.
Dans la tradition indienne, le « bindu » n’est pas un simple signe graphique : il incarne à la fois l’origine et l’infini, la source de toute création mais aussi le centre de méditation et de concentration spirituelle.
Raza relie sa fascination pour le bindu à un souvenir d’enfance marquant. « Je n’étais pas un bon élève et j’étais souvent angoissé.
Sayed Haider Raza is regarded as one of the greatest Indian painters of the 20th century. Born in 1922 in the state of Madhya Pradesh, Raza developed a passion for painting at an early age. He studied at the Fine Arts schools of Nagpur and then Bombay. In 1947, together with his friends Francis Newton Souza and Maqbool Fida Husain, he co-founded the Progressive Artists Group. In 1950, he moved to Paris thanks to a scholarship from the French government. A student at the École Nationale Supérieure des Beaux-Arts until 1953, he began exhibiting at Galerie Lara Vincy in 1955.
His work builds a true bridge between India and the West, combining the lessons of European modern art (particularly Expressionism and Abstraction) with the spiritual and philosophical roots of Indian tradition, integrating into what is today known as the École de Paris. Although Raza’s work has always been rooted in landscape and
nature, the way he represented them evolved profoundly over his eight decades of creation. Gradually, he moved away from figuration towards abstraction, exploring geometric forms and intense colours to reveal the essence of the universe. In the 1980s, he adopted rigorous geometric compositions through which he expressed his vision of the natural world and the cyclical forces that structure it.
The black dot appears in his work as early as the 1950s in the form of a “black sun”. By the late 1970s, it became the “bindu”, the central symbol and foundational element of his artistic language, which he continued to explore until his death in 2016.
In Indian tradition, the “bindu” is not merely a graphic sign: it embodies both origin and infinity, the source of all creation as well as the centre of meditation and spiritual focus. Raza connected his fascination with the bindu to a formative childhood memory: “I was not a good student and often
S.H. Raza dans son atelier rue de Charonne, à Paris
Un jour, alors que j’avais huit ans, mon professeur m’a demandé de rester seul assis sous la véranda de l’école. Il y avait là un mur blanc sur lequel il a dessiné un point. Il m’a dit : “Tu restes tranquille, tu oublies les jeux, le sport, tu ne regardes pas les oiseaux sur les arbres, tu te concentres sur ce point. On le nomme bindu”. J’ai eu peur mais j’ai obéi. J’ai regardé sans comprendre ce qu’il attendait de moi. Quand il est revenu, il m’a dit : “Très bien, maintenant tu rentres déjeuner chez toi et tu reviendras avec ton frère pour tes leçons”.
Cet événement a changé ma vie. J’ai compris quelque chose de capital et j’ai aimé l’école ».
Chez Raza, le bindu est entouré de cercles, de carrés ou de triangles et s’inscrit dans des compositions
équilibrées, presque cosmiques, où la couleur rayonne avec intensité rappelant les mandalas, structures complexes peintes ou sculptées utilisées dans les pratiques initiatiques et méditatives. Dans les dernières décennies de sa carrière, cette forme simple mais fondamentale donne naissance à un vocabulaire symbolique et codifié, dans lequel formes et couleurs représentent différents aspects de l’univers.
Toute la vision plastique et mystique de Raza s’exprime dans Bindu, l’œuvre présentée en vente et peinte en 1994.
L’artiste y pousse son langage non figuratif à son apogée, orchestrant une succession de couleurs au sein d’une vaste composition géométrique.
anxious. One day, when I was eight, my teacher asked me to sit alone under the school veranda. There was a white wall where he drew a dot. He said: ‘You stay still, forget games, forget sports, do not watch the birds on the trees, just focus on this dot. It is called bindu’. I was scared but obeyed.
I looked without understanding what he expected of me. When he returned, he said: ‘Very well, now go home for lunch and come back with your brother for your lessons’. That event changed my life. I understood something essential, and I began to love school”.
For Raza, the bindu is surrounded by circles, squares or triangles and integrated into balanced, almost cosmic compositions, where colour radiates intensely, evoking the
mandalas, complex painted or sculpted structures used in meditative and initiatory practices. In the final decades of his career, this simple yet fundamental form gave rise to a codified symbolic vocabulary, in which shapes and colours represent different aspects of the universe.
Raza’s entire artistic and mystical vision is expressed in Bindu, the work offered for sale, painted in 1994. In it, the artist pushes his non-figurative language to its peak, orchestrating a succession of colours within a vast geometric composition. The canvas, divided into four equal parts by two intersecting lines at the centre of the bindu, displays ten cascading coloured squares in each quadrant.


S.H. Raza, Black sun, 1953
S.H. Raza, Gestation, 1988


La toile, divisée en quatre parties égales par deux lignes se croisant au centre du bindu, déploie, dans chaque quadrant, dix carrés colorés en cascade. L’ensemble s’organise autour de ce point noir d’où tout naît et vers lequel tout retourne. Toutes les lignes à l’extérieur du point ondulent légèrement semblant suivre les pulsations de l’univers, cette vibration diffusant lumière et énergie à travers l’œuvre. L’espace s’anime : le blanc, le rouge, le bleu et l’orange se déploient, reconstituant avec le noir originel le spectre chromatique du monde visible. Dans la pensée hindoue, on distingue cinq éléments : la terre, l’eau, le feu, l’air et l’espace. Chaque couleur exprime ainsi un élément. Par leur répétition méthodique et leur séquence concentrique, les peintures de Raza évoquent celles d’artistes tels que Frank Stella ou Kenneth Noland. Mais là où les abstraits occidentaux cherchent
à écarter toute subjectivité dans leur œuvre, Raza insuffle à son abstraction une intensité émotionnelle. Son langage pictural puise dans une expérience spirituelle intime.
Aujourd’hui, les « bindus » de Raza sont célébrés dans le monde entier. Ils incarnent une synthèse rare entre modernité et tradition, peinture et spiritualité, monde oriental et occidental. Derrière leur apparente simplicité se cache une profondeur métaphysique qui continue de fasciner. À la manière d’une géométrie sacrée, chaque toile devient une quête intérieure, un espace de méditation visuelle, une invitation pour le spectateur à se relier à l’essentiel.
The composition revolves around this black dot from which everything originates and to which everything returns. All lines outside the dot undulate slightly, seemingly following the universe’s pulsations, a vibration that diffuses light and energy throughout the work.
The space comes alive: white, red, blue and orange unfold, recomposing with the original black the visible colour spectrum of the world. In Hindu thought, five elements are distinguished: earth, water, fire, air and space. Each colour thus expresses one element.
Through their methodical repetition and concentric sequencing, Raza’s paintings recall artists such as Frank Stella or Kenneth Noland. But whereas Western abstraction often seeks to eliminate subjectivity, Raza infuses his abstraction with emotional
intensity. His pictorial language draws on a deeply personal spiritual experience.
Today, Raza’s “bindus” are celebrated worldwide. They represent a rare synthesis of modernity and tradition, painting and spirituality, East and West. Beneath their apparent simplicity lies a metaphysical depth that continues to fascinate. Like sacred geometry, each canvas becomes an inner journey, a space for visual meditation, inviting the viewer to connect with the essential.
Frank Stella, Gran Cairo, 1962
Kenneth Noland, Baba Yagga, 1964
Whitney Museum of Art, New York En Fr
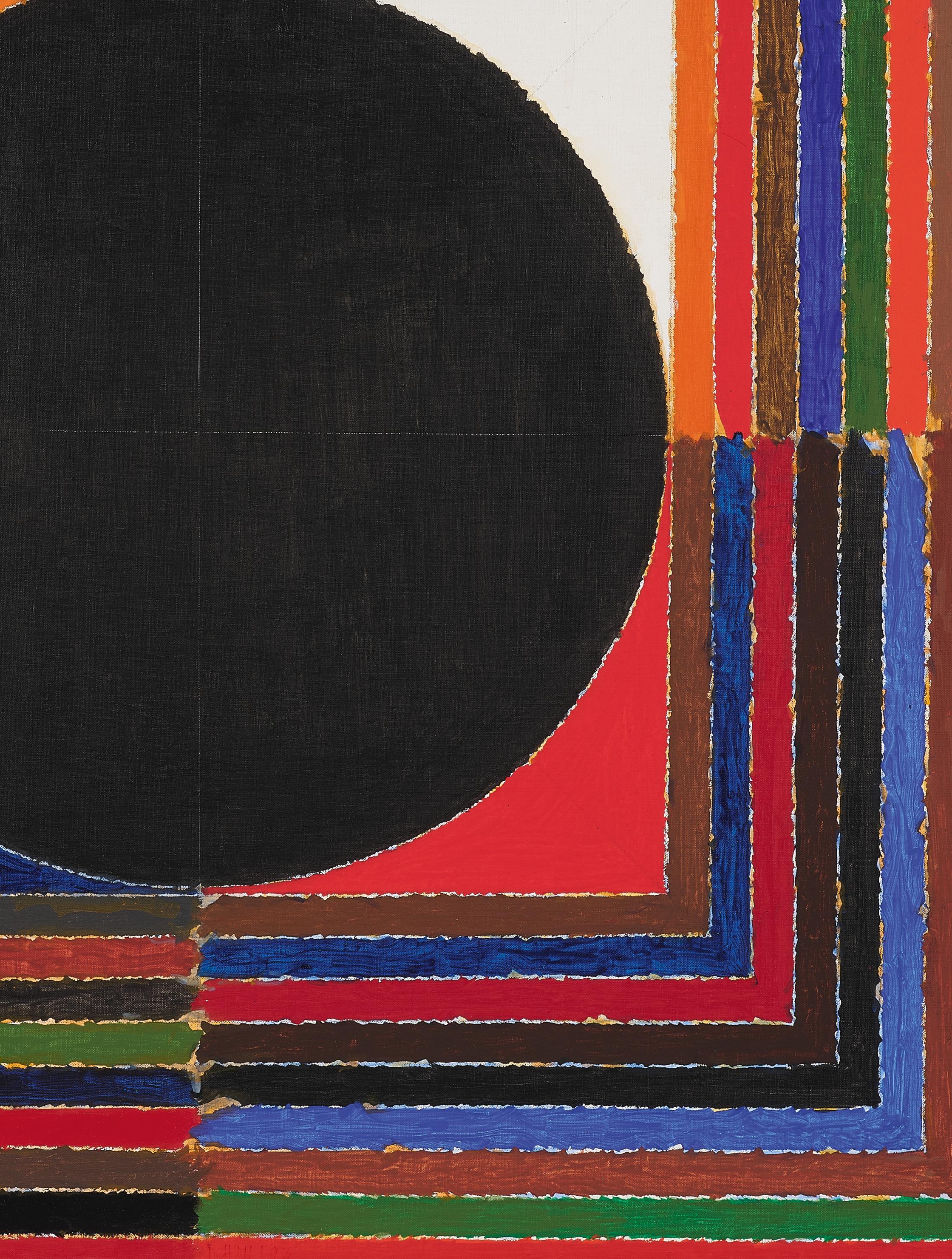
Anish KAPOOR
Né en 1954
Mirror – 1997
Calcaire bleu de Kilkenny (Irelande)
Pièce unique
208 × 178 × 51 cm
Provenance :
Galerie Taché-Levy, Bruxelles Gladstone Gallery, New York Collection Hugo Voeten, Belgique Vente, Paris, Étude Tajan, 10 mars 2015, lot 19
Acquis au cours de cette vente par l’actuel propriétaire
Bibliographie :
Site internet https://anishkapoor. com/6130/mirror, reproduit en couleur
Blue limestone from Kilkenny (Ireland); unique piece; 81 ⅞ × 70 × 20 in.
450 000 - 650 000 €

Anish KAPOOR
Né en 1954
Mirror – 1997
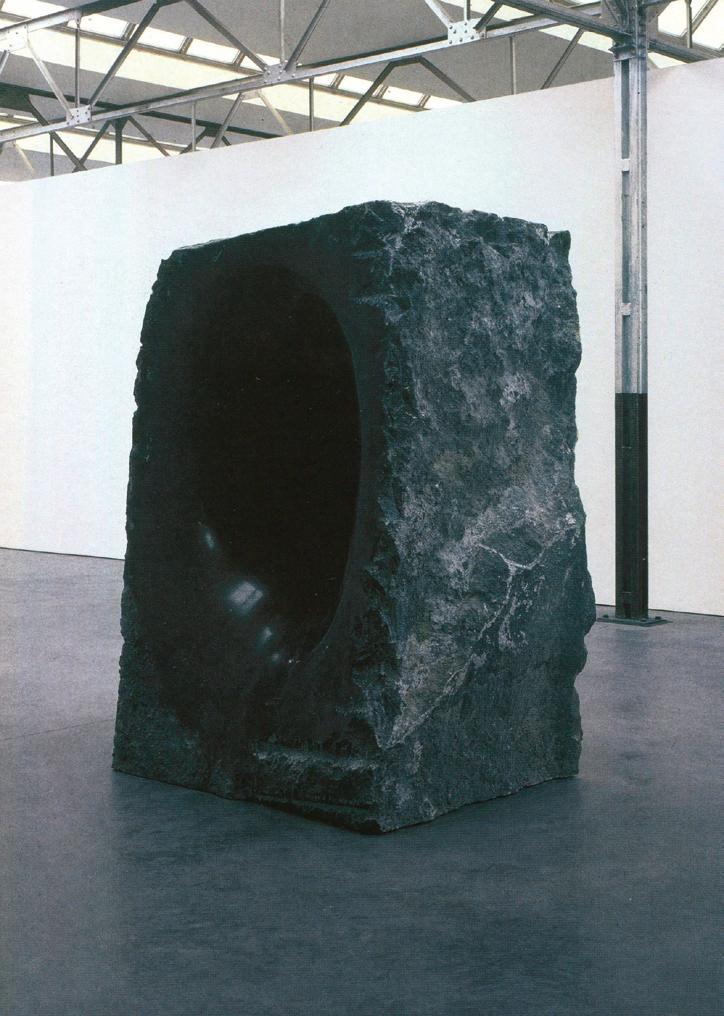

Sir Anish Kapoor, sculpteur britannique d’origine indienne né à Bombay en 1954, s’est imposé comme l’une des figures majeures de l’art contemporain. Eduqué au Royaume-Uni, il a su développer un langage artistique novateur grâce à une utilisation originale des matériaux et de l’espace. Cette approche singulière lui a valu de prestigieuses distinctions, parmi lesquelles le Turner Prize en 1991 et le titre de chevalier en 2013, consacrant sa place parmi les artistes les plus influents de sa génération. Le travail de Kapoor se caractérise par son exploration des formes biomorphiques abstraites, son usage audacieux de couleurs intenses et son goût pour les surfaces parfaitement polies. Dans les années 1980 et 1990, Kapoor s’impose dans le monde de l’art en façonnant des sculptures et installations réalisées dans la pierre, l’aluminium ou la résine, qui interrogent les notions de gravité, profondeur et espace.
Anish Kapoor se saisit du concept de spécularité et utilise le miroir pour refléter l’environnement de l’œuvre : « Je suis vraiment intéressé par la façon dont la sculpture active l’espace. Et c’est ce que ces miroirs sont, ou c’est ainsi qu’ils fonctionnent – c’est comme une peinture. (…) C’est presque comme si l’objet n’existait pas. C’est une sorte de passage sans fin à travers », affirme-t-il sans ambages.
Ici, Mirror, réalisée en 1997, est constituée d’un miroir concave creusé dans une roche calcaire. Le miroir est placé à hauteur d’homme et reflète donc l’entourage direct du spectateur. Il s’agit réellement de s’observer au sein d’une roche, qui est à la fois le socle du miroir et son cadre. L’œuvre devient un instrument de méditation sur soi, sur son rapport au monde, à la nature, à l’espace. Le spectateur-acteur active l’œuvre à chaque passage. La référence au trou noir, due à la concavité du
Sir Anish Kapoor, a British sculptor of Indian origin born in Bombay in 1954, has established himself as one of the leading figures in contemporary art. Educated in the United Kingdom, he has developed an innovative artistic language through his original use of materials and space. This unique approach has earned him prestigious awards, including the Turner Prize in 1991 and a knighthood in 2013, cementing his place among the most influential artists of his generation. Kapoor’s work is characterised by his exploration of abstract biomorphic forms, his bold use of intense colours and his taste for perfectly polished surfaces.
In the 1980s and 1990s, Kapoor made his mark on the art world by creating sculptures and installations in stone, aluminium and resin that question notions of gravity, depth and space. Anish Kapoor takes hold of the concept of specularity and
employs the mirror to reflect the space surrounding the work: “I’m really interested in the way sculpture activates space. And that’s what these mirrors are, or how they function – they’re like a painting. (…) It’s almost as if the object does not exist. It’s a kind of endless passage through”, he states unequivocally.
Here, Mirror (1997) consists of a concave mirror embedded in a block of limestone. Positioned at human height, the mirror reflects the immediate surroundings of the viewer. It is, in essence, about seeing oneself within the stone, which serves both as the support of the mirror and its frame. The work thus becomes an instrument of meditation on the self, on one’s relationship to the world, to nature and to space. The spectator-actor activates the work with each encounter. The reference to the black hole, suggested by the concavity of the mirror, establishes a connection between the infinitely
Anish Kapoor, Sans titre, 1994-95
En Fr
Anish Kapoor, Oblivion, 1994
miroir, fait le lien entre l’infiniment petit (l’ici-bas) et l’infiniment grand (l’espace).
L’œuvre évoque par ailleurs le Cénotaphe d’Isaac Newton réalisé par l’architecte Étienne-Louis Boullée en 1784. Ce dernier imagine une chambre circulaire représentant le ciel étoilé. La coupole, percée de multiples trous, transforme la nuit de l’intérieur du cénotaphe en voie lactée. Le spectateur se trouve « comme par enchantement, transporté dans les airs et porté sur des vapeurs de nuages dans l’immensité de l’espace ».
Fenêtre sur le monde ou sur le ciel, le principe est le même, il s’agit d’offrir au spectateur le miroir de soi face à l’immensité de ce qui l’entoure. Étrangement, la signification même du mot
« cénotaphe » relègue le corps à un plan secondaire puisqu’il élève un tombeau à la mémoire d’un mort dont le corps est absent. Ce jeu entre la présence et l’absence est particulièrement convoqué dans l’œuvre d’Anish Kapoor.
L’œuvre existe-t-elle sans spectateur ? Quelle est la place du corps dans la réflexion ? L’œuvre Mirror appelle-t-elle à une compréhension exclusivement mentale ? La déformation, l’inversion, les illusions optiques des miroirs sont-ils le véhicule d’un changement de paradigme impliquant le passage à une dimension spirituelle par le truchement de l’œuvre ?
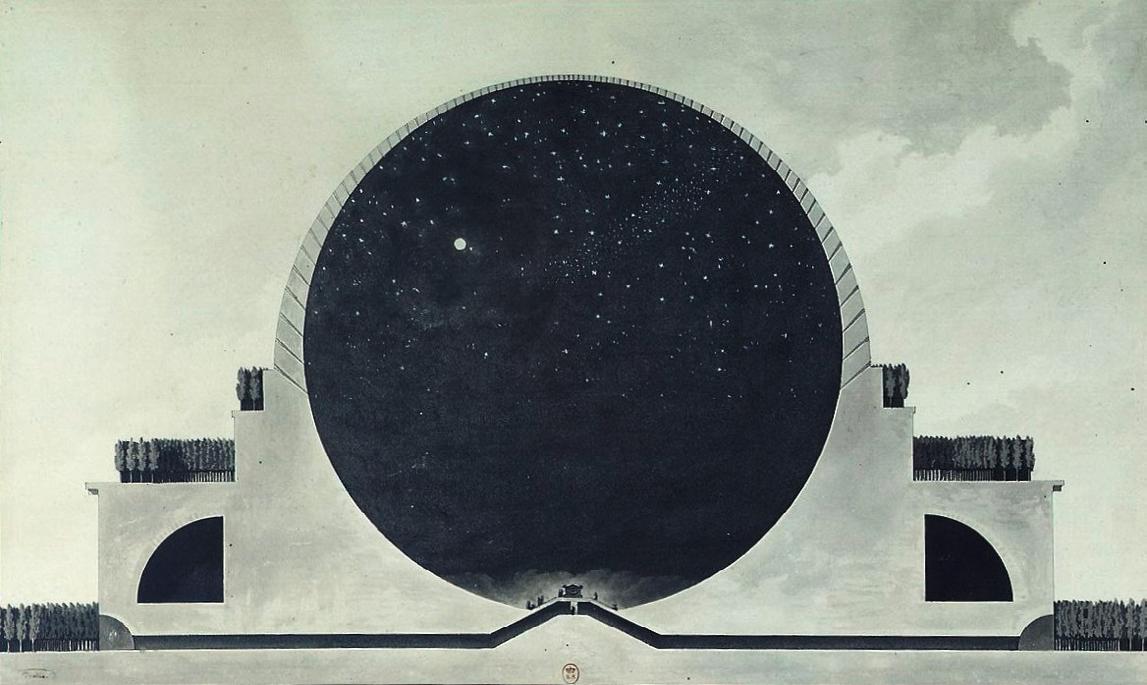
small (the here below) and the infinitely vast (outer space). The work also evokes the Cenotaph of Isaac Newton designed in 1784 by the architect ÉtienneLouis Boullée. He envisioned a circular chamber representing the starry sky. The dome, pierced with countless holes, transformed the interior night of the cenotaph into a Milky Way. The viewer found himself “as if by magic, transported through the air and carried on clouds of vapour into the immensity of space”. Whether as a window onto the world or onto the heavens, the principle is the same: to offer the spectator the mirror of self in the face of the vastness that surrounds him/her. Strangely, the very meaning of the word “cenotaph” relegates the body
to a secondary plane, as it erects a tomb in memory of a deceased person whose body is absent. This play between presence and absence is particularly invoked in Anish Kapoor’s work. Does the work exist without the spectator? What place does the body occupy in reflection? Does Mirror call for an exclusively mental understanding? Are the distortions, inversions and optical illusions of mirrors the vehicle of a paradigm shift, leading toward a spiritual dimension through the mediation of the work?

Anish Kapoor, Sans titre, 2003
© DR
Étienne-Louis Boullée, Cénotaphe d’Isaac Newton, Coupe représentation de jouraveceffet intérieur de nuit, Paris, 1784, non réalisé
Jesús Rafael SOTO
1923-2005
Relación negra y blanca – 1972
Acrylique, métal et bois sur panneau de bois
Signé, daté et titré au dos « Relacion Negra Y Blanca, Soto, 1972 »
167 × 134 × 17 cm
Provenance :
Galerie Charles Kriwin, Bruxelles (acquis directement auprès de l’artiste en 1973)
À l’actuel propriétaire par descendance
Acrylic, metal and wood on wood panel; signed, dated and titled on the reverse; 65 ¾ × 52 ¾ × 6 ⅝ in.
180 000 - 280 000 €
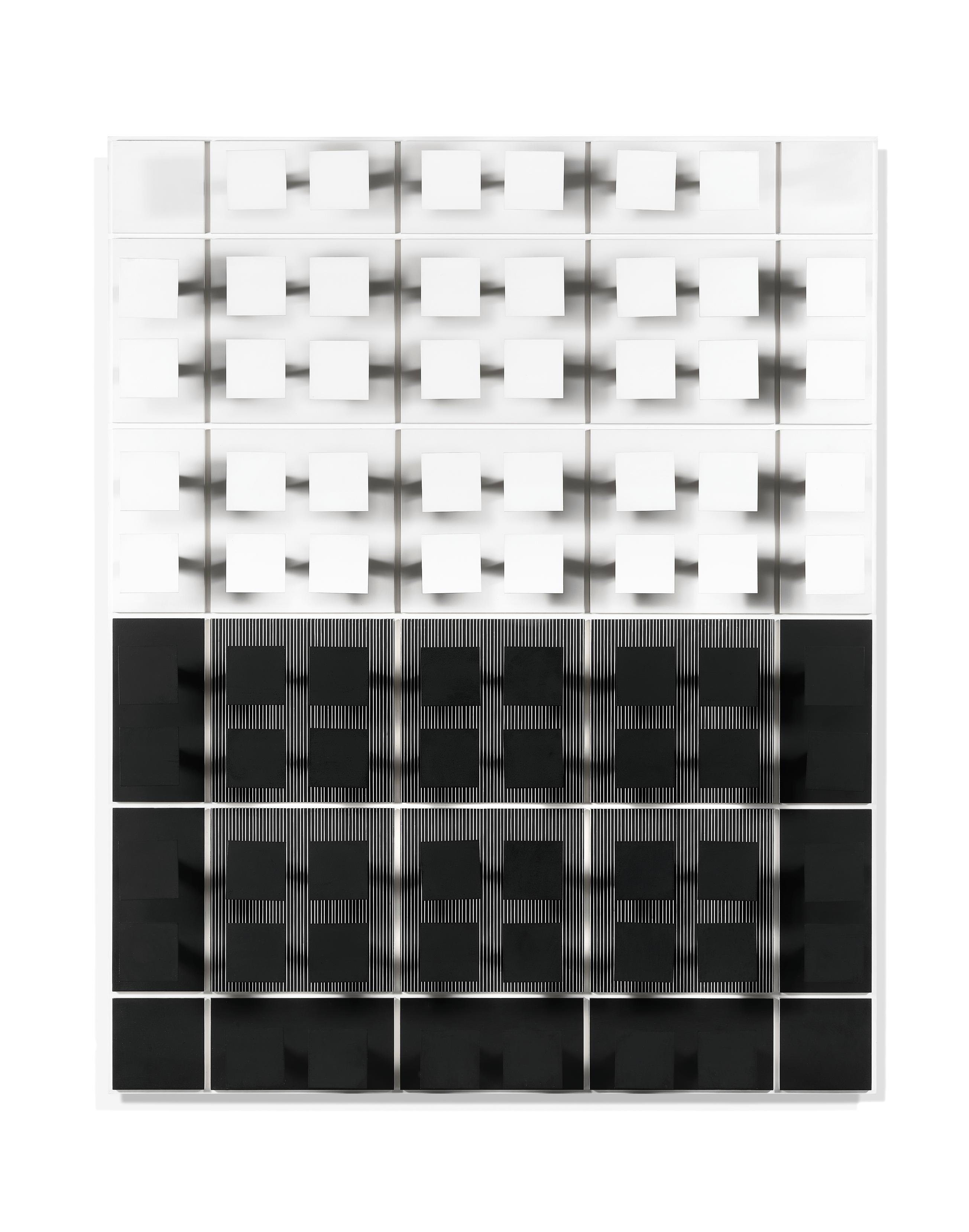
17
Jesús Rafael SOTO 1923-2005
Relación negra y blanca – 1972
Issu d’une génération de jeunes artistes latino-américains désireux de se confronter à la scène artistique parisienne, Jesús Rafael Soto quitte le Venezuela en 1950 pour la capitale française. Il se rapproche rapidement de l’abstraction géométrique d’après-guerre, défendue par le Salon des Réalités Nouvelles où il présente ses œuvres, et par la Galerie Denise René qui organise en 1955 l’exposition Le mouvement Aux côtés de Vasarely, Calder, Agam, Bury, Jacobsen, Tinguely et Duchamp, Soto participe à cet événement fondateur de l’art cinétique en Europe. La même année, Vasarely publie le Manifeste Jaune, qui théorise un art optique où forme, couleur et mouvement ne prennent sens qu’à travers la présence active du spectateur. Soto explique : « La matière, le temps, l’espace constituent une trinité indissociable et le mouvement est la force qui démontre cette trinité ». Pour lui, l’art doit désormais mobiliser des matériaux modernes (plexiglas, métal, lumière artificielle) afin de créer un nouvel espace tridimensionnel qui sollicite la participation du public, indispensable à l’activation des œuvres. Soto commence alors à produire des compositions
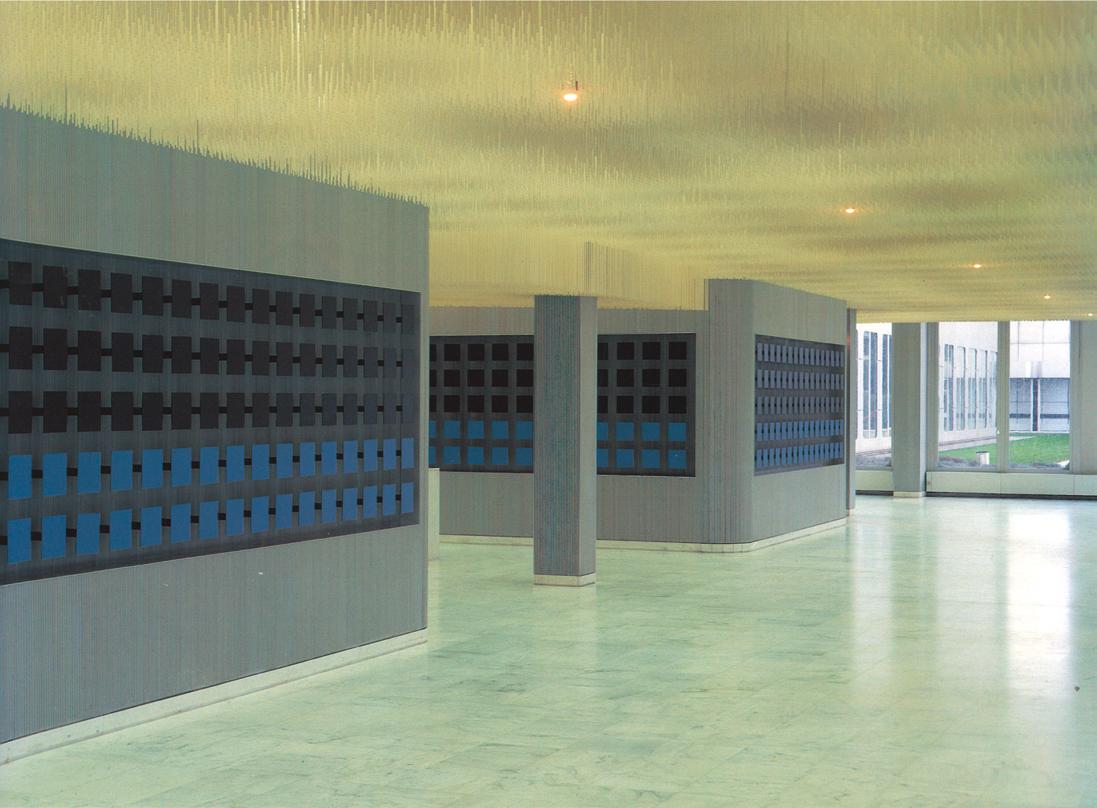
abstraites avec des formes géométriques, qui semblent se mouvoir grâce à l’interaction des couleurs, des lignes, des volumes, des vides et des pleins. Il reprend les problèmes sur la perception que Piet Mondrian avait soulevés, et extrapole les enseignements suprématistes de Kasimir Malevitch en y ajoutant une impression de mouvement induite par l’optique, ce qui lui permet de pousser l’abstraction au-delà d’un simple illusionnisme.
En s’appropriant, à son tour, la figure du carré comme forme géométrique de prédilection, Soto déclare : « Le carré représentait – et représente encore pour moi – la forme la plus authentiquement humaine, dans le sens où il s’agit d’une création purement humaine. Le carré, et les figures géométriques en général, sont purement le fruit de l’esprit humain, des créations purement intellectuelles, et ce qui m’intéresse particulièrement à leur sujet, c’est qu’elles n’ont pas de dimension spécifique... une forme géométrique peut être infiniment petite ou infiniment grande, elle n’a pas de limites mesurables et échappe ainsi complètement à l’anthropocentrisme traditionnel de l’art occidental ».
Part of a generation of young Latin American artists eager to confront the Parisian art scene, Jesús Rafael Soto left Venezuela in 1950 for the French capital. He quickly gravitated toward postwar geometric abstraction, championed by the Salon des Réalités Nouvelles where he exhibited his works, and by Galerie Denise René, which in 1955 organized the exhibition Le Mouvement. Alongside Vasarely, Calder, Agam, Bury, Jacobsen, Tinguely and Duchamp, Soto took part in this landmark event that marked the birth of Kinetic Art in Europe. That same year, Vasarely published the Yellow Manifesto, which theorized an Optical Art where form, colour and movement only take on meaning through the active presence of the spectator.
Soto explained: “Matter, time and space constitute an inseparable trinity, and movement is the force that demonstrates this trinity”. For him, art henceforth had to employ modern materials (plexiglas, metal, artificial light) to create a new three-dimensional space that calls for the public’s participation, essential to activating the works.
Soto then began producing abstract compositions with geometric forms that seemed to
move through the interplay of colours, lines, volumes, voids and solids. He revisited the questions of perception raised by Piet Mondrian and extrapolated from Kasimir Malevich’s Suprematist lessons, adding an impression of movement induced by optics. This allowed him to push abstraction beyond mere illusionism.
By adopting the square as his preferred geometric form, Soto declared: “The square represented –and still represents for me– the most authentically human form, in the sense that it is a purely human creation. The square, and geometric figures in general, are purely the product of the human mind, purely intellectual creations. What interests me most about them is that they have no specific dimension… a geometric form can be infinitely small or infinitely large, it has no measurable limits and thus completely escapes the traditional anthropocentrism of Western art”.
Created in 1972, Relación negra y blanca draws inspiration from Malevich’s work, notably his Black Square on White Background (1915) and White Square on White Background (1918), which the artist discovered during a trip to New York in 1965.
En Fr
Hall d’entrée de la Régie Renault à Boulogne-Billancourt, avec Carrés Vibrants de Jesús Rafael Soto, 1975

Jesús Rafael SOTO 1923-2005
Relación negra y blanca – 1972
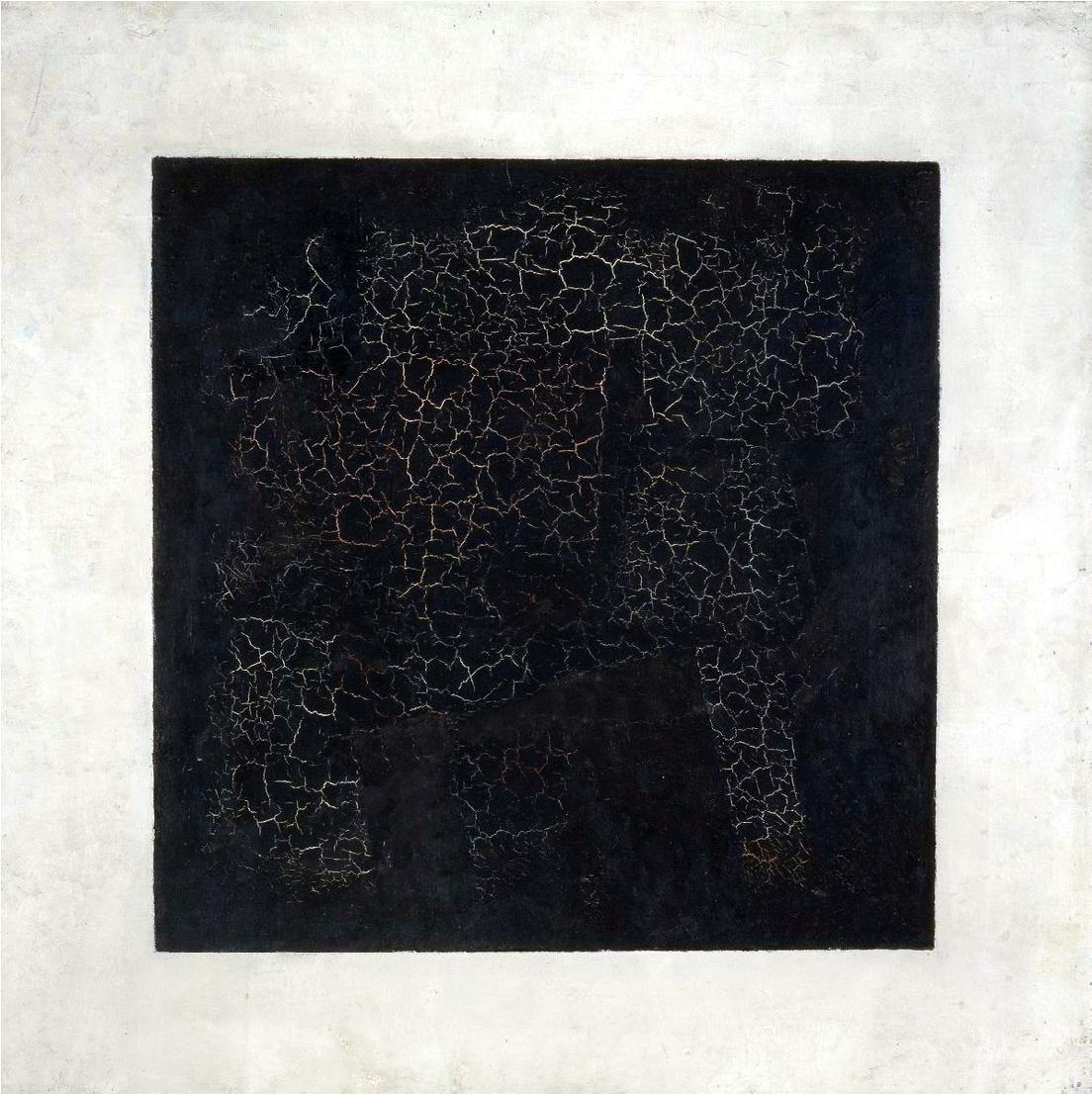
Réalisée en 1972, Relación negra y blanca s’inspire de l’œuvre de Malevitch, notamment de son Carré noir sur fond blanc (1915) et de son Carré blanc sur fond blanc (1918), que l’artiste découvre lors d’un voyage à New York en 1965.
L’œuvre proposée ici se compose d’un panneau vertical divisé en deux espaces symétriques, une partie supérieure blanche et une autre inférieure noire, l’ensemble régi par un équilibre parfait. Devant des carrés et rectangles en bois, peints en blanc, en noir ou striés en noir et blanc, sont disposés, à quelques centimètres de distance, 68 carrés blancs ou noirs, en métal. Dès les années 1950, Soto fonde ses premières recherches optiques sur l’opposition du noir et du
the interweaving of black and white lines: their superimposition produces a visual oscillation that gives the spectator the impression of a shifting, changing work, though the elements themselves remain motionless. Confronted with the work, the viewer can clearly distinguish the different forms, but as soon as they move, even imperceptibly, the forms blur and distort. Critic Jean Clay described this phenomenon as “a passage from the immutable to the unstable, arousing a subtle doubt about the solidity of reality”. Here, Soto reduces his visual vocabulary to the essentials: forms and colours are limited to simple, neutral elements, conceived solely to produce vibratory relationships. The work thus creates a fluid space 17
blanc, tirant parti de la persistance rétinienne et des interprétations du cerveau pour générer une illusion de mouvement au sein même de la composition. La répétition des carrés fait disparaître leur présence en tant que formes distinctes pour ne laisser apparaître qu’un mouvement pur. Dans la partie inférieure du panneau, l’effet moiré visible naît de l’entrelacement des lignes noires et blanches : leur superposition produit une oscillation visuelle qui donne au spectateur l’impression d’une œuvre changeante et mouvante, bien que les éléments eux-mêmes demeurent immobiles. Face à l’œuvre, le spectateur distingue nettement les différentes formes. Mais dès qu’il se déplace, même imperceptiblement, elles se
The work presented here consists of a vertical panel divided into two symmetrical areas, an upper white section and a lower black one, governed by perfect balance. In front of wooden squares and rectangles painted in white, black, or black-and-white stripes, Soto positioned, a few centimetres away, 68 white or black metal squares. As early as the 1950s, Soto based his first optical experiments on the opposition of black and white, exploiting retinal persistence and the brain’s interpretations to generate the illusion of movement within the composition itself. The repetition of squares makes them disappear as distinct forms, leaving only pure movement. In the lower section of the panel, the visible moiré effect arises from
Kasimir Malevitch, Carré noir sur fond blanc, 1915
En Fr
©
Galerie
Tretiakov,
Moscou
troublent et se déforment. Le critique Jean Clay décrit ce phénomène comme « un passage de l’immuable à l’instable, suscitant un doute subtil sur la solidité de la réalité ».
Soto réduit ici son vocabulaire plastique à l’essentiel : formes et couleurs sont limitées à des éléments simples et neutres, conçus uniquement pour engendrer des relations vibratoires. L’œuvre crée ainsi un espace fluide où les repères s’effacent, donnant l’impression d’une instabilité et d’une évaporation progressive des figures. Bois, métal et couleur interagissent dans une tension subtile entre statique et dynamique, engageant le spectateur dans une expérience à la fois sensorielle et mentale.
Soto transforme Relación negra y blanca en un véritable terrain d’expérimentation de la perception, où couleur, forme et mouvement, ne sont plus envisagés comme des objets fixes mais, par leur fusion, comme des phénomènes perceptifs. À travers cette œuvre, l’artiste invente un nouveau langage visuel : celui du mouvement virtuel et de la dématérialisation corporelle. Cette recherche préfigure l’art numérique, où l’interactivité devient essentielle à l’existence de l’œuvre. Par ce biais, Soto inaugure un tournant décisif dans l’histoire de l’art du XXe siècle, en imaginant une œuvre en trois dimensions qui se volatilise et se réinvente dans le regard de chacun.
where points of reference dissolve, giving the impression of instability and the gradual evaporation of figures. Wood, metal, and colour interact in a subtle tension between the static and the dynamic, engaging the viewer in an experience that is both sensory and mental.
Soto transforms Relación negra y blanca into a true field of experimentation in perception, where colour, form and movement are no longer considered fixed objects but, through their fusion, as perceptual phenomena. Through this work, the artist invents a new visual language: that of virtual movement and the dematerialization of the body. This research foreshadows digital art, where interactivity
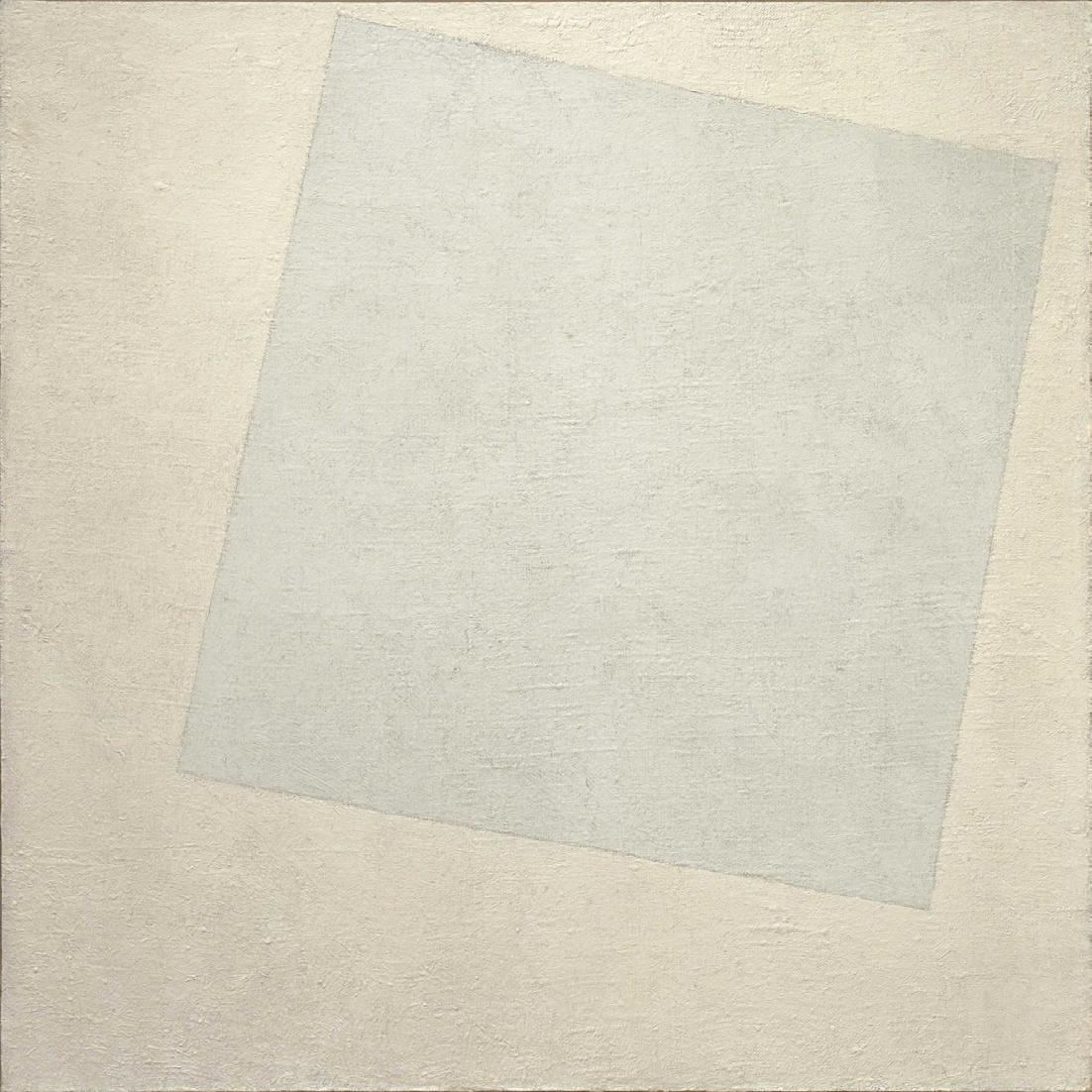
© MoMA, New York
becomes essential to the existence of the work. In this way, Soto marks a decisive turning point in the history of 20th century art, envisioning a three-dimensional work that vanishes and reinvents itself in the eye of each beholder.
Kasimir Malevitch, Carré blanc sur fond blanc, 1918
Serge POLIAKOFF
1900-1969
Composition abstraite – 1963
Huile sur toile
Signée en bas à droite
« Serge Poliakoff » 89 × 116 cm
Provenance :
Collection particulière, Europe (acquis directement auprès de l’artiste) À l’actuel propriétaire par descendance
Exposition :
St Gallen, Galerie Im Erker, Serge Poliakoff, février-avril 1962, n°14 Paris, Musée National d’Art Moderne, Salon Comparaisons - 10 ans d’art actuel, mars-avril 1964, reproduit en noir et blanc p. 100
St Gallen, Galerie Im Erker, Poliakoff, avril-juin 1965, hors catalogue
St Gallen, Kunstmuseum, Serge Poliakoff, juin-juillet 1966, hors catalogue
St Gallen, Kunstverein, Ostschweizer Privatbesitz, octobre-décembre 1977, n°34
St Gallen, Kunstverein, Sammlung I, août-octobre 1988, reproduit en couleur sous le n°61
Bibliographie :
Morgenbladet, 17 mars 1964, reproduit en noir et blanc p. 3
A. Poliakoff, Serge Poliakoff, Catalogue Raisonné, Volume IV, 1963-1965, Éditions Galerie Française, Munich, 2012, reproduit en couleur sous le n°63-51, p. 81
Cette œuvre est enregistrée dans les Archives de l’artiste sous le n°963054.
Oil on canvas; signed lower right; 35 × 45 ⅝ in.
180 000 - 280 000 €
« La couleur ou la tonalité de la couleur n’importent pas, seule importe la qualité de la couleur ».
— Serge Poliakoff

Serge POLIAKOFF 1900-1969
Composition abstraite – 1963
L’œuvre proposée ici témoigne de la maîtrise de l’abstraction intégrale par Serge Poliakoff, au travers des relations entre la ligne et la surface, le fond et la forme, la couleur et la lumière. Dans Composition abstraite (1963), les rouges côtoient les jaunes et noirs. La palette chromatique des primitifs italiens – on pense par exemple à la Madone et enfant de Duccio (1290-1300) – ressort avec netteté. En effet, Poliakoff découvre les Primitifs italiens à l’occasion d’une exposition au Petit Palais à Paris dans les années 1930 et cultive dès

lors son enthousiasme pour les grands maîtres. Quant aux formes, particulièrement anguleuses, elles se découpent harmonieusement.
Comme l’explique l’écrivain Charles Estienne : « Abstrait, Poliakoff l’est totalement : mais il ne se contente pas, non plus, d’être non figuratif : il nous propose des formes, mais de véritables formes […] qui nous troublent et nous émeuvent comme seuls peuvent le faire tous les signes qui font allusion à ce profond monde poétique enseveli en nous, telle une seconde nature ».
The work presented here demonstrates Serge Poliakoff’s mastery of complete abstraction through the relationships between line and surface, form and content, colour and light. In Abstract Composition (1963), reds are juxtaposed with yellows and blacks. The chromatic palette of the Italian Primitives –Duccio’s Madonna and Child (1290–1300) comes to mind– emerges with clarity. Poliakoff first discovered the Italian Primitives at an exhibition at the Petit Palais in Paris in the 1930s, and from then
on cultivated his admiration for the great masters. The forms, particularly angular, are delineated with harmony. As writer Charles Estienne explains: “Abstract, Poliakoff is completely so: but neither is he content with being merely non-figurative: he offers us forms, true forms […] that move and disturb us as only those signs can which allude to that profound poetic world buried within us, like a second nature”.
Duccio di Buoninsegna, Madone et enfant, 1290-1300
© Metropolitan Museum of Art, New York

Georges MATHIEU
1921-2012
Diapré – 1965
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche « Mathieu, 65 », signé au dos sur le châssis « Diapré » 162 × 97 cm
Provenance :
Galerie Charpentier, Paris Collection particulière, France À l’actuel propriétaire par descendance
Exposition :
Düsseldorf, Galerie Schmela, Mathieu, 14 neue Ölbilder, juin 1965, n°3 Paris, Galerie Charpentier, Mathieu, octobre-décembre 1965, reproduit en noir et blanc sous le n°103, non paginé
Bibliographie :
Vogue, Paris, novembre 1965, reproduit pp. 54 & 56
F. Mathey, Mathieu, Éditions Hachette-Fabbri, Milan-Paris, 1969, reproduit en couleur sous le n°201 Connaissance des Arts, n°212, octobre 1969, reproduit en couleur p. 100 M. Rowell, La peinture, le geste, l’action, Éditions Klincksieck, Paris, 1972 & 1985, reproduit, planche 16
Cette œuvre est référencée parmi les œuvres authentiques dans les Archives Jean-Marie Cusinberche sur Georges Mathieu.
Un avis d’inclusion aux Archives Jean-Marie Cusinberche sur Georges Mathieu sera remis à l’acquéreur.
Oil on canvas; signed and dated lower left, titled on the reverse on the stretcher; 63 ¾ × 38 ¼ in.
100 000 - 200 000 €
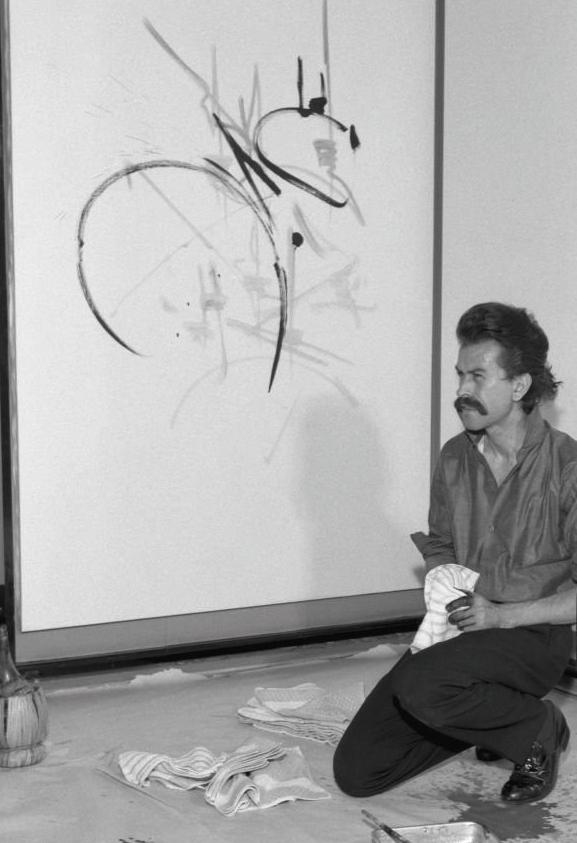
Georges Mathieu à la Galerie Cavallino, à Venise, en 1960

Diapré – 1965
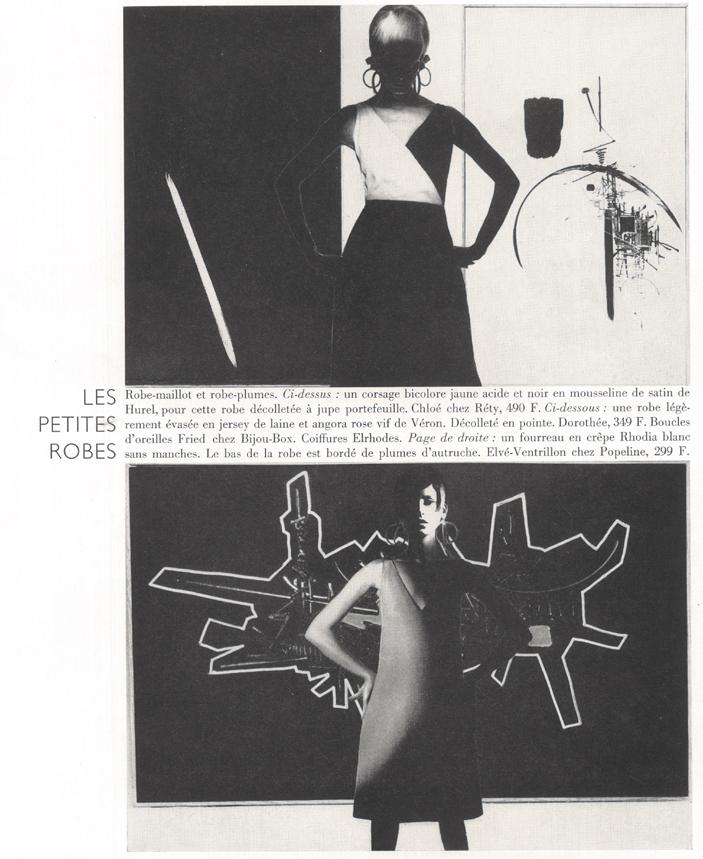
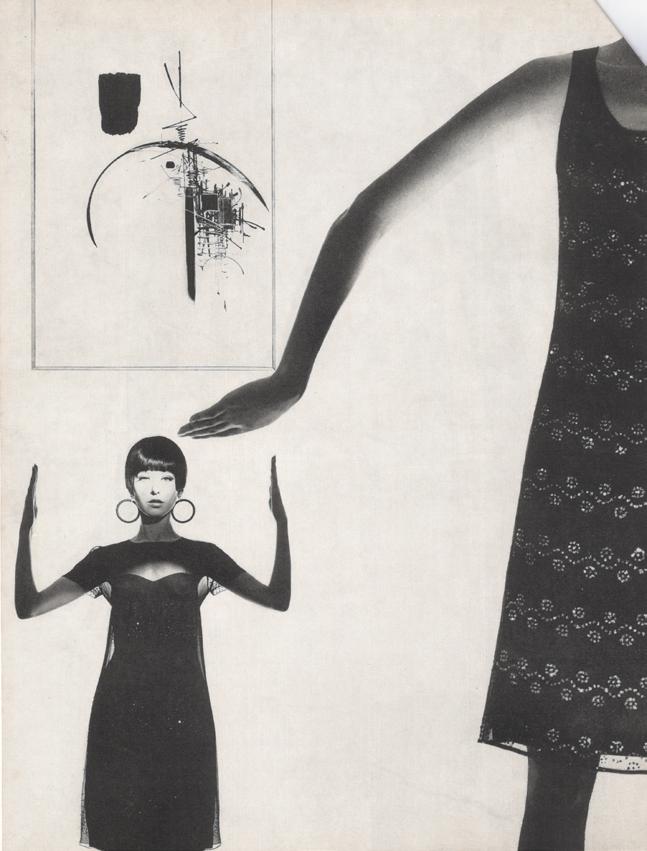
Lorsque le critique d’art et poète américain John Ashbery découvre L’écartèlement de François Ravaillac, toile monumentale que George Mathieu peint en 1960, il proclame : « Les nouvelles peintures de Georges Mathieu […] sont parmi les meilleures œuvres qu’il a faites jusqu’à présent et en font probablement le peintre abstrait le plus important en France. [… Elles] ont une richesse, une complétude, une vérité qu’on ne peut pas ignorer et, pour la première fois peut-être, elles ont cette sorte d’autorité évidente qu’ont les meilleures œuvres de Jackson Pollock. Elles devraient convaincre jusqu’aux plus tenaces détracteurs de l’art abstrait ». En effet, aujourd’hui encore, les œuvres du fondateur de l’Abstraction Lyrique datant des années 1960 sont reconnues comme représentant le paroxysme de son esthétique.
Ici, Diapré, réalisée en 1965, étonne par son format.
Sa verticalité impose une lecture différente, qui incarne la liberté inédite de Georges Mathieu pour le geste créatif et son énergie sans commune mesure. Sur un fond blanc largement présent, une zone rectangulaire rouge s’affirme sur la partie gauche du tableau. Géométrique mais inégale, elle contraste avec le reste de la toile qui déploie la calligraphie gestuelle du peintre français. La simplicité de la ligne noire qui vient heurter la toile avec autant de radicalité que de spontanéité, se confronte à une forme jaune semblable à un idéogramme ou encore à une cabane.
L’œuvre porte bien son titre : elle scintille, porte une réverbération particulière grâce au jeu de ses contrastes chromatiques. Elle se pare d’ornements dans l’intrication du signifiant. À la fois peinture et bijou, elle porte la fulgurance de la poésie du geste de Georges Mathieu.
When the American art critic and poet John Ashbery discovered The Dismemberment of François Ravaillac, the monumental canvas Georges Mathieu painted in 1960, he proclaimed: “Georges Mathieu’s new paintings […] are among the best works he has produced so far and probably make him the most important abstract painter in France. […] They have a richness, a completeness, a truth that cannot be ignored and, perhaps for the first time, they possess that kind of obvious authority that the best works of Jackson Pollock have. They should convince even the most stubborn detractors of abstract art”.
Indeed, even today, the works of the founder of Lyrical Abstraction from the 1960s are recognized as representing the climax of his aesthetic.
Here, Diapré, created in 1965, astonishes with its format. Its verticality imposes a different reading, embodying
Georges Mathieu’s unprecedented freedom in the creative gesture and his unparalleled energy. Against a largely white background, a red rectangular area asserts itself on the left side of the canvas. Geometric yet irregular, it contrasts with the rest of the painting, which unfolds with the French painter’s gestural calligraphy. The simplicity of the black line, striking the canvas with as much radicality as spontaneity, confronts a yellow form resembling either an ideogram or a hut.
The work lives up to its title: it shimmers, carrying a particular radiance through the play of chromatic contrasts. It is adorned with ornaments in the interweaving of meaning. At once painting and jewel, it bears the brilliance of Georges Mathieu’s poetic gesture.
Vogue, Paris, novembre 1965, lot 19 reproduit pp.54 & 56
© Guy Bourdin

Serge POLIAKOFF
1900-1969
Composition abstraite – 1967
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
« Serge Poliakoff »
73 × 92 cm
Provenance :
Galleria d’arte del Naviglio, Milan
Galerie Melki, Paris
Acquis directement auprès de cette dernière par l’actuel propriétaire
Bibliographie :
A. Poliakoff, Serge Poliakoff Catalogue Raisonné, Volume V, 1966-1969, Éditions Galerie Française, Munich, 2016, reproduit en couleur sous le n°67-80, p. 227
Cette œuvre est enregistrée dans les Archives de l’artiste sous le n°967034.
Un certificat de Marcelle Poliakoff sera remis à l’acquéreur.
Oil on canvas; signed lower left; 28 ¾ × 36 ¼ in.
130 000 - 180 000 €

Serge POLIAKOFF 1900-1969
Composition abstraite – 1967

« La peinture devrait être monumentale, autrement dit, plus grande que ses dimensions ». Pour Serge Poliakoff, une œuvre tend naturellement vers l’infini. Elle se conçoit comme une proposition à poursuivre, elle sort du cadre et s’imagine plus ample. En effet, l’artiste ne cesse à aucun moment sa quête de la perfection dans la vibration de la matière et l’abstraction : ses peintures sont donc autant de réponses à un même sujet.
Les deux œuvres présentées ici (lots 18 & 20) datent des années 1960, époque à laquelle l’artiste a atteint une reconnaissance mondiale. En outre, il travaille depuis 1952 avec la Galerie Bing, remporte le Prix Lissone en 1956, participe à la Documenta de Kassel en 1958, puis à la Biennale de Venise en 1962. Il reçoit dès lors plusieurs prix prestigieux, dont le Prix International de la Biennale de Tokyo en 1965. Ses œuvres sont présentées dans des musées internationaux, et une rétrospective majeure lui est consacrée en 1968 à la Maison de la Culture de Caen. Serge Poliakoff réalise l’œuvre présentée ici en 1967, intitulée Composition abstraite
Elle se distingue du lot 18 par une volonté de contrastes plus marqués. Les couleurs, tranchées, laissent la place aux bleus, blancs et roses. Les couleurs claires dévoilent la succession de couches que Poliakoff aime travailler. En effet, chaque toile résulte d’un réseau de lignes que l’artiste dessine au préalable et qui correspond selon lui « à son propre nombre d’or ». Il cherche ensuite des valeurs, et peint par couches – en général trois ou quatre. Il crée ses couleurs avec des poudres anglaises dont les quantités sont maintenues secrètes et les mélange sur une plaque de verre. Plus petite de taille, cette seconde œuvre observe une dynamique de formes différentes. Ces dernières semblent ici suivre une ascension verticale, poussées par la forme blanche placée dans le coin inférieur gauche de la toile, lui donnant une énergie particulière. Le « rêve des formes en soi qui est le grand mystère à élucider de “l’abstrait” », selon le poète Pierre Guégen, semble ici opérer pleinement et sereinement.
“Painting should be monumental, that is to say, larger than its dimensions”. For Serge Poliakoff, a work naturally tends toward infinity. It is conceived as an open proposal, one to be pursued beyond the canvas, imagined as vaster than its physical limits. Indeed, the artist never ceases his quest for perfection in the vibration of matter and abstraction: his paintings thus become multiple responses to the same essential question.
The two works presented here (lots 18 & 20) date from the 1960s, a period during which the artist had achieved worldwide recognition. Since 1952, he had been working with Galerie Bing, won the Lissone Prize in 1956, participated in Documenta in Kassel in 1958, and the Venice Biennale in 1962. He went on to receive several prestigious awards, including the International Prize of the Tokyo Biennale in 1965. His works were exhibited in international museums, and in 1968 a major retrospective was devoted to him at the Maison de la Culture in Caen.
Serge Poliakoff created the work presented here in 1967, which is
entitled Abstract Composition. It differs from lot 18 through its more pronounced contrasts. The colours are bold, giving way to blues, whites and pinks. The lighter tones reveal the succession of layers Poliakoff loved to work with. Indeed, each canvas results from a network of lines that the artist first sketches, corresponding, in his words, to his “own golden ratio”. He then sought tonal values, painting in successive layers –generally three or four. His colours were made from English pigments, the quantities of which he kept secret, mixing them on a glass plate.
Smaller in scale, this second work reveals a different dynamic of forms. They appear here to follow a vertical ascent, driven by the white shape placed in the lower left corner of the canvas, which imparts a distinctive energy. The “dream of forms in themselves, which is the great mystery to be unravelled in the ‘abstract’ ”, in the words of poet Pierre Gueguen, seems here to be fully and serenely at work.
Serge Poliakoff dans son atelier en 1950

Pierre SOULAGES
1919-2022
Bronze n°2 – 1976
Bronze à patine dorée
Signé et numéroté au dos
« Soulages, 4/5 » Fonte Blanchet 66 × 87 × 3,5 cm
Provenance :
Galerie de France, Paris
Collection particulière européenne Vente, Paris, Christie’s, 1er juin 2012, lot 97
Acquis au cours de cette vente par l’actuel propriétaire
Exposition :
Paris, Galerie de France, octobre 1977-janvier 1987 (un exemplaire similaire)
Saint-Cirq-Lapopie (Lot), Musée de Rignault, Soulages Eaux-fortes et bronzes, avril-juin 2002 (un exemplaire similaire)
Paris, Bibliothèque Nationale de France, Soulages l’œuvre imprimé, mai-août 2003 (un exemplaire similaire)
Bibliographie :
P. Encrevé, Soulages, L’œuvre complet, Peintures, Volume II, 1959-1978, Éditions du Seuil, Paris, 1995, reproduit en noir et blanc p. 274 (un exemplaire similaire)
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.
Un exemplaire similaire se trouve au Musée Soulages de Rodez.
Bronze with gold patina; signed and numbered on the reverse; Blanchet foundry; 26 × 34 ¼ × 1 ⅜ in.
300 000 - 500 000 €
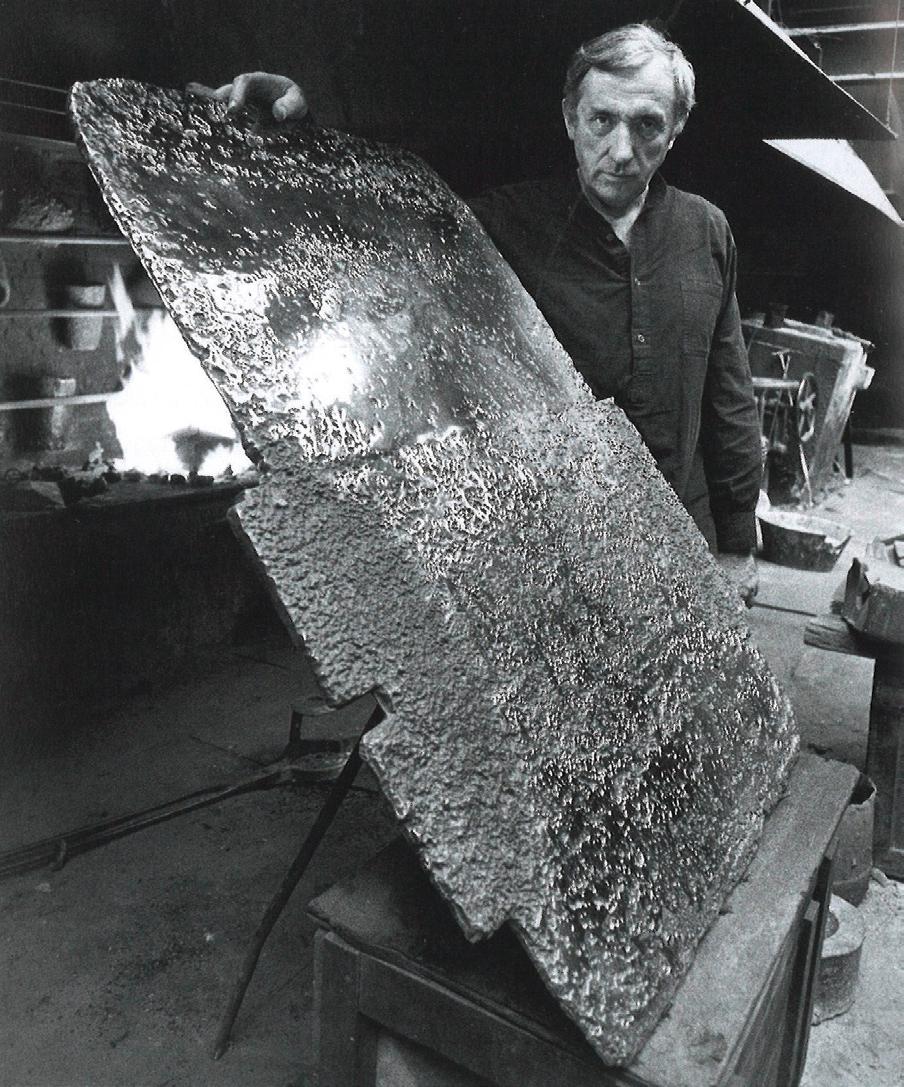
Pierre Soulages travaillant sur le Bronze n°3, 1977

Jean-Michel Le Lannou :
« Quelle est la place des bronzes dans votre œuvre ? »
Pierre Soulages :
« Ces bronzes dérivent tous trois de planches de gravure, plaques de cuivre découpées par l’acide, comme j’avais l’habitude de le faire, mais toujours corrodées jusqu’à être découpées et aussi gravées en fonction de l’empreinte qu’elles allaient laisser sur du papier, en fonction de l’encrage aussi. Elles étaient d’une planéité parfaite, avec bien sûr des creux qui correspondaient aux endroits qui devaient recevoir l’encre, creux produits par la corrosion de l’acide avec l’ensemble de hasards et de choses voulues intervenant dans l’élaboration. Ces plaques de cuivre bien planes ayant servi à imprimer mes estampes étaient depuis longtemps abandonnées contre un mur dans l’atelier ou sur une étagère, et beaucoup me disaient : « Mais ce sont des sculptures ! » Et toujours je me récriais : « Mais non, pas du tout, ce n’est pas du tout travaillé dans ce sens-là ». Et puis un jour, très longtemps après, c’était dans les années soixante-dix, et je travaillais ainsi mes gravures depuis les années cinquante, j’ai dans un premier temps fait agrandir ces plaques

d’une manière absolument mécanique et fidèle par quelqu’un dont c’est le métier : Haligon, qui utilise une sorte de pantographe dans les trois dimensions (c’est son père ou son grand-père qui l’ont créé et qui ont agrandi beaucoup d’œuvres dont, entre autres, le « Balzac » de Rodin). Une fois que j’ai eu cet objet qui n’était qu’une plaque de plâtre absolument plane, je l’ai fait fondre en bronze, espérant on ne sait quels accidents ou transformations. Lorsque les fontes sont sorties du moule, la chaleur avait commencé à en faire bouger la planéité.
Ce n’était plus aussi plane et c’était noirâtre, absolument mat, cela avait l’apparence du bronze tel qu’il sort de la fonderie. C’est alors que je me suis mis, en le polissant, à régler les mouvements de la lumière venus de l’inégalité de la surface. Je respectais l’organisation des creux que je laissais sombres, noirâtres. J’agissais seulement sur le mouvement de la lumière sur les parties lisses. Les creux provenant des parties gravées restaient sombres et fixes, sans variations.
Je n’ai produit que ces trois bronzes, j’aurais pu en faire d’autres, mais c’est un travail assez long, chaque pièce ne pouvant être qu’une épreuve originale.
Jean-Michel Le Lannou: “What place do the bronzes hold in your work?”
Pierre Soulages:
“These bronzes all derive from printing plates, copper plates etched by acid, as I used to do, but always corroded to the point of being cut through and also engraved with the imprint they would leave on paper in mind and depending also on the inking. They were perfectly flat, of course with recesses corresponding to the areas meant to receive the ink, recesses produced by the acid’s corrosion, with a mix of chance and intentional effects involved in the process. These perfectly flat copper plates, used to print my engravings, had long been abandoned leaning against a wall in the studio or on a shelf, and many people would say to me: “But these are sculptures!” And I would always protest: “No, not at all, they were not created with that intention at all”.
Then one day, much later, in the 1970s, although I had been working on engravings this way since the 1950s, I had these plates enlarged in a purely mechanical and faithful manner by someone who specializes in this work: Haligon, who uses a kind of three-
dimensional pantograph (his father or grandfather invented it and used it to enlarge many works, including Rodin’s Balzac). Once I had this object, which was just a completely flat plaster plate, I had it cast in bronze, hoping for who knows what kind of accidents or transformations. When the casts came out of the mold, the heat had already begun to warp the flatness. It was no longer as flat and it had a blackish, completely matte appearance, just as bronze looks when it comes out of the foundry. That’s when I began to polish it, to modulate how the light moved across the uneven surface. I kept the recessed areas dark and blackish. I worked only on how the light moved across the smooth areas. The recesses, resulting from the engraved parts, remained dark and fixed, without variation. I only produced those three bronzes, I could have made more, but it’s quite a long process, and each piece could only be an original. In sculpture, an “original” actually means a small series limited to a few strictly identical pieces. But given the kind of work I was doing, each bronze was different from the others. My intervention was such that you could say each piece is a unique work.
Pierre Soulages, Eau-forte XX, ayant servi de modèle au lot 21
En sculpture « un original » c’est en réalité une petite série limitée à quelques pièces rigoureusement semblables. Étant donné le travail que j’y faisais, chaque bronze était différent de l’autre. Mon intervention était telle que l’on peut dire que chaque pièce est une pièce unique.
J’avais oublié cette aventure des années 1975 à 1977. Deux ans après environ, ce qui m’est arrivé en peignant venait peut-être de cette expérience. Je ne sais pas, car je n’en ai jamais été conscient. Peut-être ai-je pensé par la suite que ce nouveau regard porté sur les surfaces noires, alors que je me croyais en pleine déroute, venait du travail fait avec les bronzes. Je pataugeais dans le noir, je me désespérais, je devais poursuivre une toile, voisine de celles déjà produites, mais après des heures de travail, j’ai senti que je faisais
peut-être autre chose… Et je suis allé dormir, et quand j’ai revu une heure et demie après ce que j’avais fait, j’ai compris que je faisais une autre peinture ! C’était le départ de cette période, encore actuelle et qui occupe la majorité de mes peintures depuis 1979 jusqu’à maintenant, fondée sur une lumière reflétée par les états de surface du noir. Mais je ne suis pas du tout sûr que ce que l’on rencontre avec les bronzes en soit l’origine – leur lumière n’a rien de l’émotion que crée une lumière émanant du noir, transformée par le noir qui la réfléchit ».
P. Soulages & J-M. Le Lannou, Entretien avec Pierre Soulages, Philosophique 2, 1999, pp. 89-97 (extrait)
I had forgotten about this adventure from 1975 to 1977. About two years later, what happened to me while painting perhaps came from that experience. I don’t know, because I was never fully aware of it. Maybe I later thought that this new way of seeing black surfaces, at a time when I felt completely lost, came from the work done with the bronzes. I was floundering in the dark, in despair; I was supposed to finish a painting similar to those I had already made, but after hours of work, I felt I might be doing something different… So I went to sleep, and when I looked at it again an hour and a half later, I realized I was making a different kind of painting! That was the beginning
of the period I’m still in now, which has been the foundation of most of my work since 1979: a painting based on light reflected off the surface states of black. But I’m not at all certain that what one encounters with the bronzes is the origin of this -their light does not have the same emotional power as light that emanates from black, transformed by the black that reflects it”.
P. Soulages & J.-M. Le Lannou, Interview with Pierre Soulages, Philosophique 2, 1999, pp. 89-97 (excerpt)


En 1977, la Galerie de France, prise de court par la crise du marché de l’art contemporain, se débat dans les difficultés financières.
[…] Une exposition de Soulages à la rentrée se présente comme l’unique solution. Soulages réalisait depuis le printemps des gouaches vinyliques sans destination précise. Il accepte alors le principe d’une exposition pour la Galerie de France comprenant ces gouaches et trois bronzes qui n’avaient pas encore été montrés, à la FIAC d’abord du 22 au 30 octobre, dans la galerie ensuite du 8 novembre au 30 décembre. Devant le succès remporté, l’exposition sera prolongée jusqu’au 25 janvier 1978, et la Galerie de France reprendra pied. […]
L’exposition donnait aussi à voir de grands bronzes :
Bronze n°1, 116 × 86 cm, 1955, Bronze n° 2, 68 × 88 cm, 1976, Bronze n° 3, 117 × 95 cm, 1977. À la suite de l’exposition de gravures de 1974, en effet, où la critique avait souligné la qualité plastique des plaques de cuivre elles-mêmes, Soulages avait réalisé, entre 1975 et 1976, trois bronzes, en partant de ces plaques. Deux avaient été agrandis mécaniquement par Haligon (plaque de l’Eau-forte XIII pour
le Bronze n° 1, plaque de l’Eauforte XX pour le Bronze n° 2) ; pour le Bronze n° 3, Soulages avait librement adapté la plaque de l’Eau-forte XXIX pour faire un relief en béton qui servit de matrice au bronze. Une fois les bronzes obtenus, il avait travaillé leurs surfaces. « L’idée de ces bronzes m’est venue des planches de cuivre que je grave à l’acide », déclarait-il à Frédéric Edelmann. « Cela fait très longtemps que j’y pense. Mais ce n’est qu’il y a trois ans que j’ai décidé de donner à ces formes une vie qui les fasse exister par elles-mêmes. J’ai alors agrandi la forme obtenue d’une plaque de cuivre ; j’en ai fait un bronze qu’à nouveau j’ai travaillé à l’acide. Puis je l’ai poli pour faire vivre la lumière. La surface de ces bronzes n’est en effet pas plane : elle a de faibles mouvements qui permettent à la lumière de bouger, de couler. Il y a donc deux niveaux : morsure par l’acide et travail de la surface. Le résultat de ce procédé, c’est une sorte de stèle. Mais pas une sculpture, car mon travail est celui d’un peintre. Contrairement aux bas-reliefs, qui créent leur propre espace, l’espace imaginaire propre aux trois dimensions de la sculpture, c’est ici la lumière qui joue le rôle de
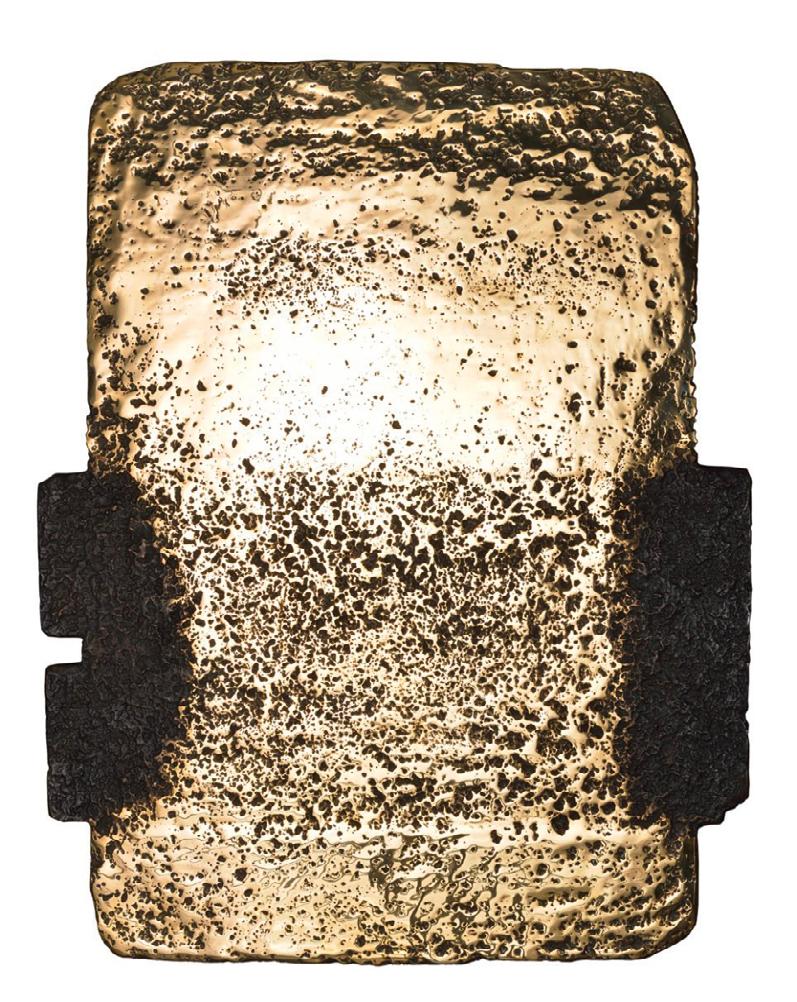
In 1977, the Galerie de France, caught off guard by the crisis in the contemporary art market, was struggling financially. […] An exhibition of Soulages’ work in the autumn emerged as the only viable solution. Since the spring, Soulages had been producing vinyl gouaches with no specific destination in mind. He then agreed to the idea of an exhibition at the Galerie de France, featuring these gouaches along with three bronzes that had not yet been shown, first at FIAC from October 22 to 30, and then at the gallery from November 8 to December 30. Given the success of the show, it was extended until January 25, 1978, allowing the Galerie de France to regain its footing. […]
The exhibition also featured large bronzes: Bronze n°1, 116 × 86 cm, 1955; Bronze n°2, 68 × 88 cm, 1976; Bronze n°3, 117 × 95 cm, 1977. Following the 1974 print exhibition, where critics had emphasized the visual and sculptural qualities of the copper plates themselves, Soulages created three bronzes between 1975 and 1976, based on those plates. Two had been mechanically enlarged by Haligon (the plate from Eau-forte XIII for Bronze n°1
and the plate from Eau-forte XX for Bronze n° 2); for Bronze n°3, Soulages freely adapted the plate from Eau-forte XXIX to create a concrete relief, which served as the mold for the bronze. Once the bronzes had been cast, he worked on their surfaces. “The idea for these bronzes came from the copper plates I etch with acid”, he told Frédéric Edelmann. “I’ve been thinking about it for a long time. But it was only three years ago that I decided to give these forms a life of their own. I then enlarged the form obtained from a copper plate; I made a bronze from it, which I worked again with acid. Then I polished it to bring the light to life. The surface of these bronzes is not flat: it has subtle movements that allow the light to shift and flow. There are therefore two levels: the acid etching and the surface work. The result of this process is a kind of stele. But not a sculpture, because my work is that of a painter. Unlike bas-reliefs, which create their own space, the imaginary space specific to sculpture’s three dimensions, here it is light that plays the role of the third dimension. The parts where the light moves are constantly changing and contrast
Pierre Soulages, Bronze n°3, 117 × 95 cm, 1977
Pierre Soulages, Bronze n°1, 116 × 86 cm, 1955
troisième dimension. Les parties sur lesquelles joue la lumière sont constamment changeantes et s’opposent à des parties sombres fixes ».
La peinture : « Ces bronzes, qui ne sont pas des sculptures, ne font que matérialiser autrement un des aspects importants de la problématique du peintre, en transposant les facteurs d’opacité et de transparence en facteurs d’ombre et de lumière ». Transition décisive, ces bronzes, on le sait
aujourd’hui : l’opposition du lisse et du strié, avec le mouvement de la lumière sur les surfaces polies, font de ces grandes stèles un moment essentiel dans le cheminement vers la nouvelle étape qui attend la peinture sur toile de Pierre Soulages, celle qui s’ouvrira en janvier 1979.
Pierre Encrevé, Soulages, L’œuvre complet, Peintures, Volume II, 1959–1978, pp. 273-275
with the fixed dark areas”. Critics recognized the connection to painting: “These bronzes, which are not sculptures, simply materialize in another way, one of the painter’s key concerns, transposing the elements of opacity and transparency into elements of shadow and light”. These bronzes, as we now know, were a decisive transition: the contrast between smooth and striated surfaces, together with
the movement of light on the polished areas, make these large steles a crucial moment in the path leading to the next stage of Pierre Soulages’ work on canvas, the one that would begin in January 1979.
Pierre Encrevé, Soulages, L’œuvre complet, Peintures, Volume II, 1959–1978, pp. 273-275
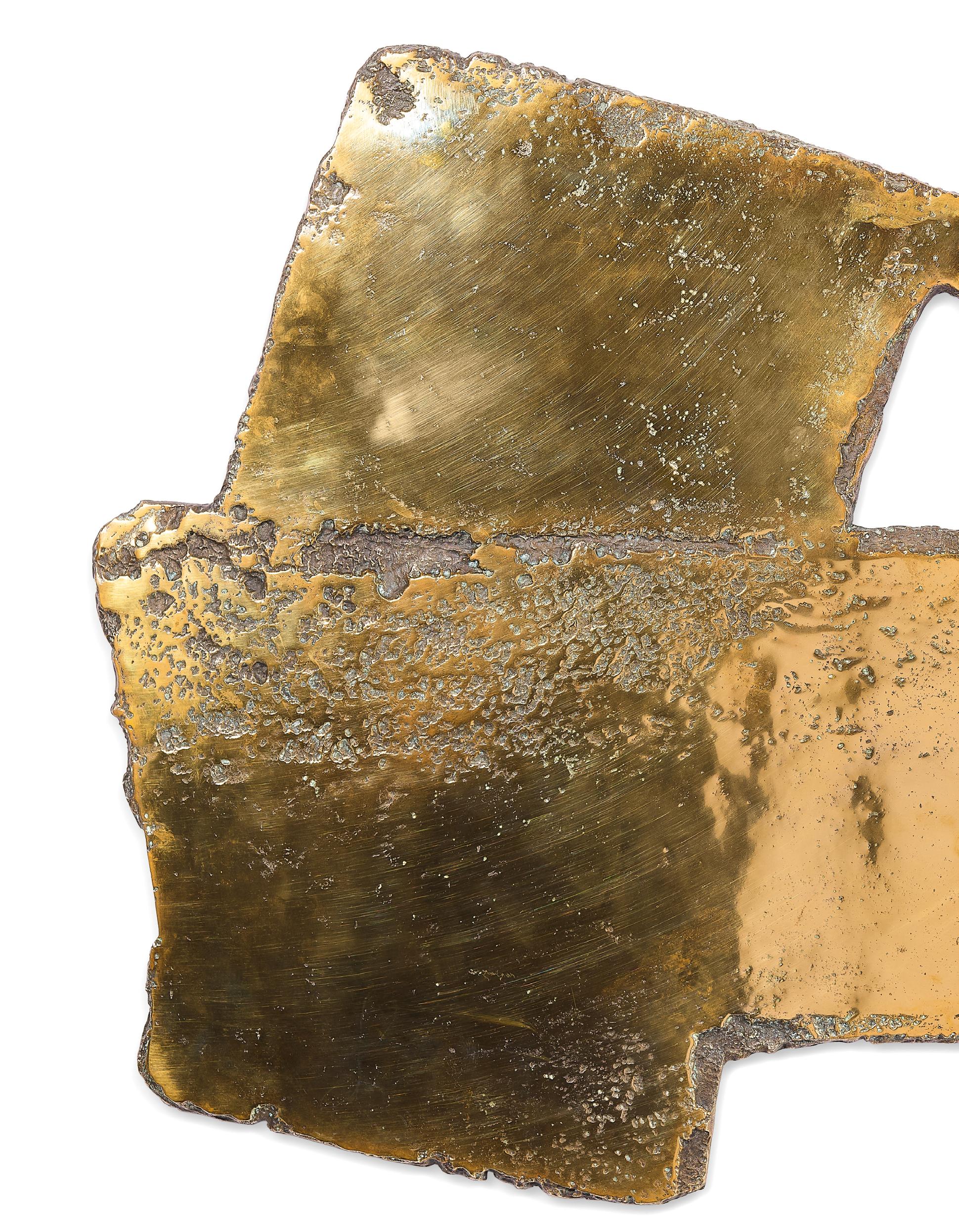
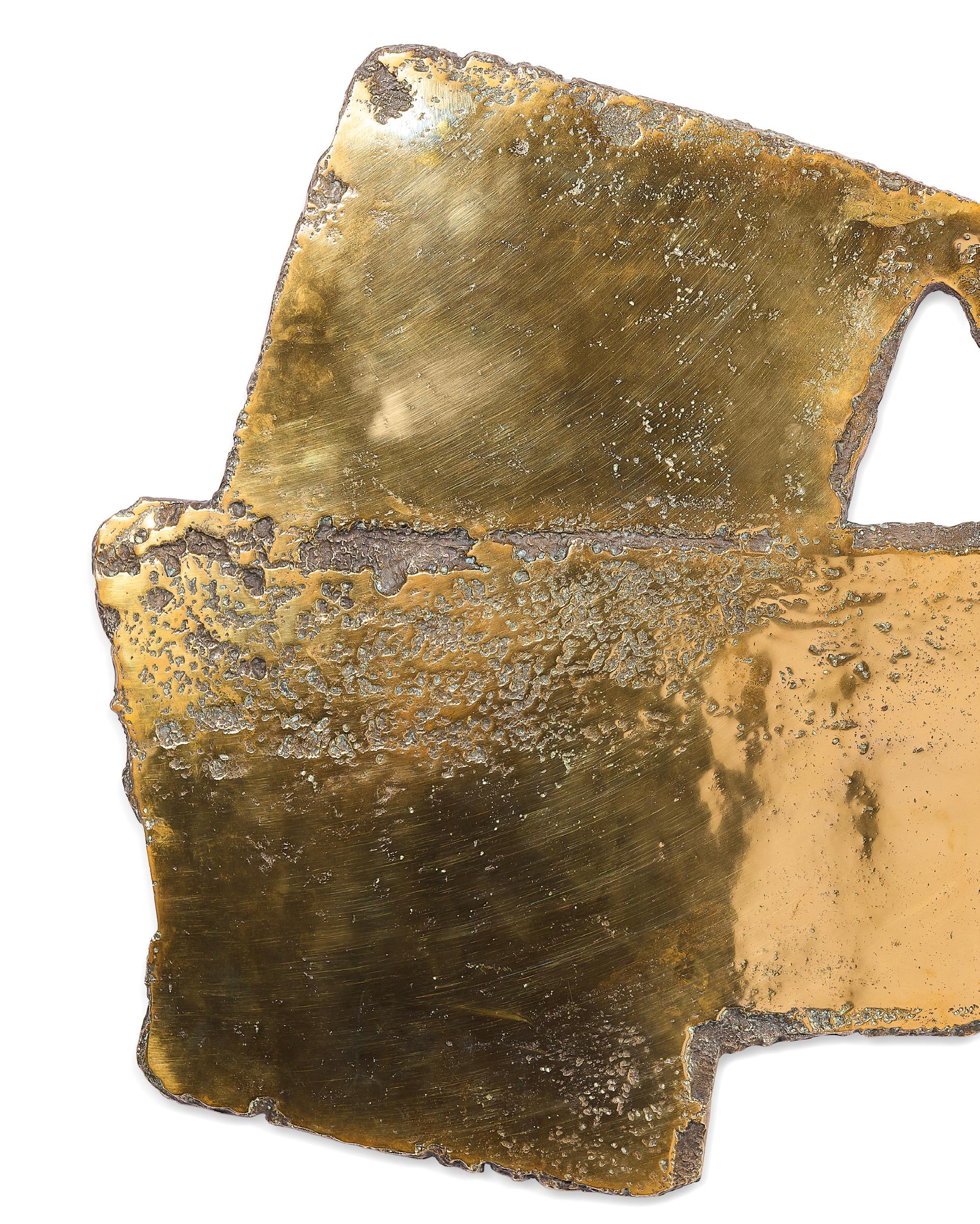
1935-2020
Le jet d’eau (Projet pour l’emballage du jet d’eau du lac de Genève) – 1975
Fusain et pastel sur papier dans un emboîtage en plexiglas
Signé et daté en bas à droite « Christo, 1975 », titré en bas à gauche « Le Jet d’Eau Wrapped (3 Parts Project For City of Geneva, Switzerland) »
245 × 108 × 3 cm
Provenance :
Collection Eric Beyersdorf (acquis directement auprès de l’artiste) Vente, Paris, Étude Catherine Charbonneaux, 20 novembre 1988, lot 34 Acquis au cours de cette vente par l’actuel propriétaire
Charcoal and pastel on paper in a plexiglas box; signed and dated lower right, titled lower left;
96 ½ × 42 ½ × 1 ¼ in.
100 000 - 150 000 €





CHRISTO 1935-2020
Le jet d’eau (Projet pour l’emballage du jet d’eau du lac de Genève) – 1975
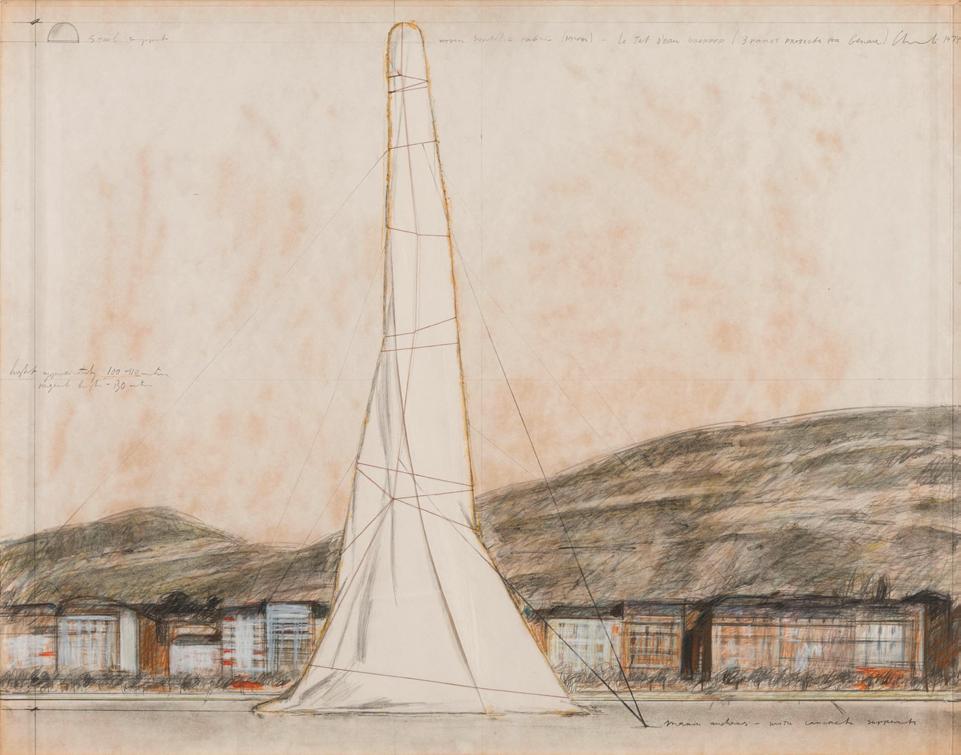
C’est en 1975 que Christo propose d’emballer et d’envelopper de toile des emblèmes de la ville de Genève, tels que la statue du général Dufour, le Mur des Réformateurs ou encore, le Jet d’eau. Ses projets n’aboutissent pas mais ses dessins témoignent aujourd’hui de la grandeur de son ambition. Concernant le Jet d’eau, seules trois études existent dont l’une se trouve dans les collections du MAMCO. Chacune offre un point de vue différent de la rade. Ici, le dessin est la troisième étude réalisée. Singulièrement grand (245 cm de hauteur), il permet de se figurer de l’importance du projet. Mêlant fusain et pastel, le dessin-maquette comporte des annotations de l’artiste qui se penche sur la difficulté de défier la propulsion de 140 mètres d’eau à la vitesse de 200 kilomètres par heure. Le fond figure la ville de Genève, sortant de la pénombre et laissant imaginer la
vision poétique du site aux yeux de Christo et de son épouse Jeanne-Claude. En effet, le duo d’artistes œuvre à métamorphoser les sites, révélant leurs formes autrement, translatant leur apparence pour les révéler sous un jour nouveau suggérant un rapport différent à l’espace. L’idée récurrente de traverser le vide, de « voir l’espace au-dedans », de « passer à travers un espace » rythme le propos des artistes et se manifeste ici par le choix de la matière à traverser. L’eau agrémentée d’une toile, entretient le rêve fou d’habiller une matière liquide. En dissimulant l’eau qui fait partie du paysage quotidien des genevois, Jeanne-Claude et Christo modifient l’appréhension visuelle et sonore de cette transparence, appelant à lui conférer une attention différente de ce que sous-entend sa réverbération naturelle.
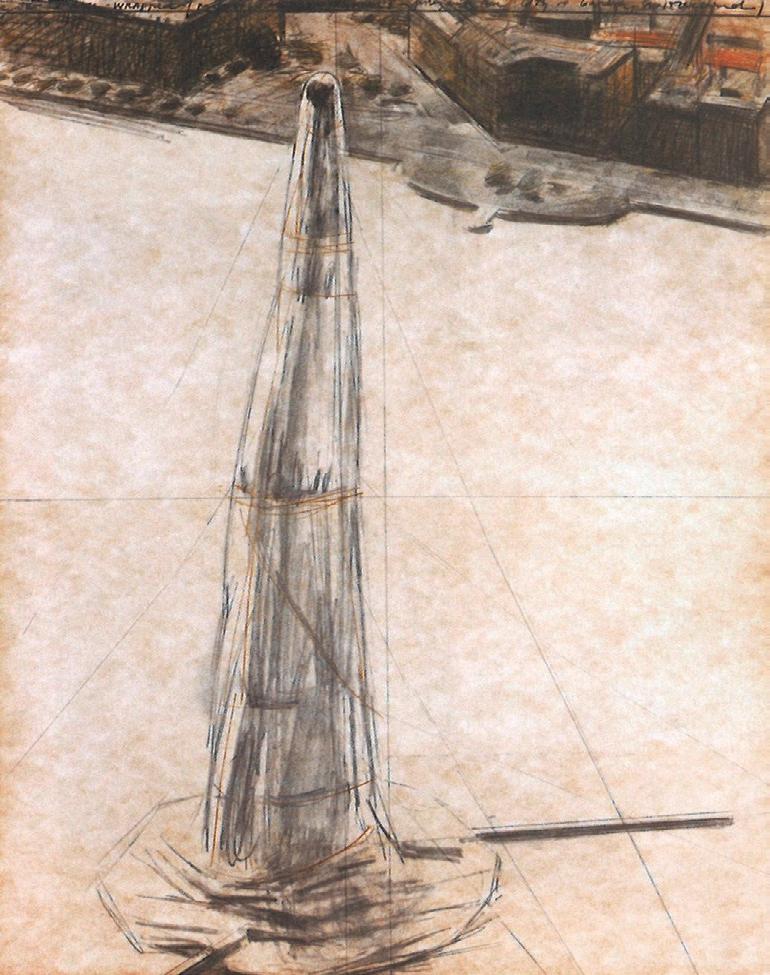
It was in 1975 that Christo proposed wrapping and draping in fabric several emblems of the city of Geneva, such as the statue of General Dufour, the Reformation Wall and even the Jet d’Eau. His projects are not successful, but his drawings today bear witness to the grandeur of his ambition. Regarding the Jet d’Eau, only three studies exist, one of which is held in the collections of MAMCO. Each offers a different perspective of the harbour.
Here, the drawing is the third study undertaken. Remarkably large (245 cm high), it conveys the scale of the project. Combining charcoal and pastel, the drawingmodel includes annotations by the artist, who reflects on the challenge of confronting a 140-meter-high jet of water propelled at 200 kilometres per hour. The background depicts the city of Geneva emerging from the shadows, allowing us to imagine
the poetic vision of the site as seen by Christo and his wife Jeanne-Claude.
Indeed, the artist duo sought to metamorphose sites, revealing their forms in new ways, transposing their appearance to present them in a fresh light and suggesting a different relationship to space. The recurring idea of crossing emptiness, of “seeing space from within,” of “passing through a space,” shapes their artistic approach and is embodied here in the choice of material to be traversed. Water, cloaked in fabric, sustains the audacious dream of dressing a liquid substance. By concealing the water that forms part of the Genevans’ everyday landscape, Jeanne-Claude and Christo altered the visual and acoustic perception of this transparency, urging the viewer to give it a different kind of attention than that suggested by its natural reflection.
Christo, Le jet d’eau wrapped, Part of 3 general proposals, (Project for the city of Geneva, Switzerland), 1974
Christo, Le jet d’eau wrapped, Part of 3 general proposals, (Project for the city of Geneva, Switzerland), 1974
En Fr

23
Ossip ZADKINE
1888-1967
La Force atomique – circa 1963-1966
Sculpture monumentale en bronze à patine vert nuancée
Signée et numérotée sur la tranche de la terrasse « O.ZADKINE 1/2, cachet du fondeur à l’arrière de la terrasse
« SUSSE FONDEUR.PARIS »
450 × 120 × 180 cm
Provenance :
Valentine Prax, Paris Acquis de celle-ci par Maurice Naessens, Président de la Banque de Paris et des Pays-Bas pour le siège anversois en décembre 1968
Bibliographie :
in Monumenta, Beelden en monumenten in de Stad Antwerpen, 1987, n°71 reproduit en noir et blanc p.48 (notre exemplaire)
S. Lecombre, Ossip Zadkine, L’œuvre sculpté, Éditions Paris Musée, Paris, 1994, n°532 reproduit en noir et blanc p.595 (un autre exemplaire)
Monumental bronze sculpture with nuanced green patina, signed and numbered on the edge of the base, foundry mark on the back of the base; 177 1/8 × 47 ¼ × 70 ⅞ in.
100 000 - 150 000 €

Zadkine dans son atelier, travaillant à la réalisation de La Force atomique, circa 1963-1966, Zadkine Reseach Center

Ossip ZADKINE
La Force atomique – circa 1963-1966
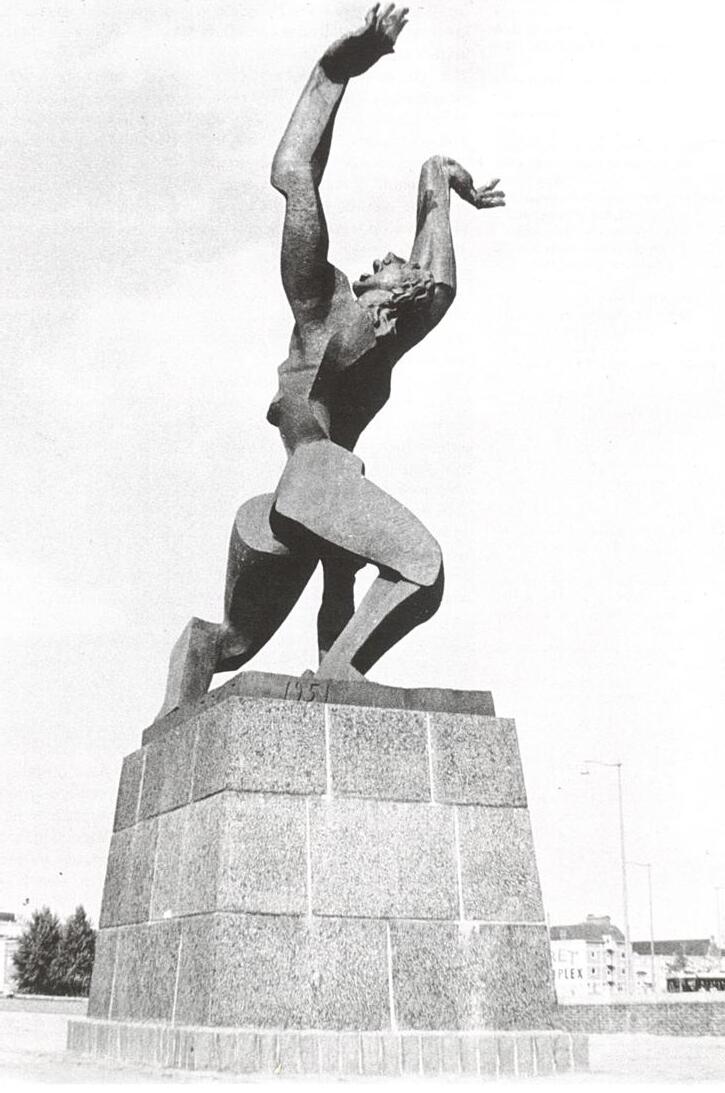

Au cours des dix dernières années de sa vie, de 1958 à 1967, jamais Ossip Zadkine n’aura déployé une aussi intense activité. Le sculpteur qui connaît alors la reconnaissance internationale, est sollicité de toute part. Son fameux monument La Ville détruite érigé à Rotterdam en 1953 a marqué les esprits et son image a fait le tour du monde. Après les années d’exil aux États-Unis pendant la seconde guerre mondiale et le spectacle déchirant des années de l’immédiate après-guerre en Europe, Zadkine se projette à corps perdu dans un travail à double sens, celui de l’hommage et celui de la reconstruction. La commande publique va occuper Zadkine une majeure partie de son temps ; elle convoquera toute son énergie créatrice. Citons par exemple en 1956 Le Monument à Van Gogh qui sera érigé à Auvers-sur-Oise en 1961 ; Le Messager pour la ville d’Anvers en 1957 ; La Forêt humaine en 1960-1961 pour la Fondation Van Leer de Jérusalem ; mais aussi Le Monument aux
frères Van Gogh pour la ville de Zundert en Hollande en 1963 ; puis la monumentale Demeure de 1963-1964 pour la Nederlansche Bank d’Amsterdam ; Le Prométhée de 1965 pour la Bibliothèque de Francfort et en 1966 pour la Ville de Laval le Monument à Alfred Jarry font partie de ses principales réalisations monumentales dans cette période. L’attention qu’Ossip Zadkine porte à l’inscription de la sculpture dans le tissu urbain en relation avec les créations architecturales de son temps, caractérise une grande partie de ses créations d’alors qui feront l’objet d’une exposition à Paris en juin-juillet 1967 à la Galerie Lucie Weill, peu de temps avant sa mort, sous le titre « Sculptures pour l’architecture ».
En octobre 1961, l’architecte René Egger qui est en charge de la construction de la future faculté des Sciences de Marseille-Luminy, fait part à Ossip Zadkine du souhait de Gaston Defferre, maire de Marseille, de le voir participer à la décoration du bâtiment. Le thème de l’atome est retenu par
Never was Ossip Zadkine’s activity as intense as during the last ten years of his life, from 1958 to 1967. The sculptor, who had risen to international fame by that time, received requests from all quarters. His famous monument, La Ville Détruite, unveiled in Rotterdam in 1953, had made an impression, and its image had travelled around the world. After his years of exile in the United States during the Second World War and the harrowing sight of the post-war years in Europe, Zadkine threw himself mind and body into a work that held a dual meaning: that of a tribute and that of reconstruction.
Public commissions would occupy most of Zadkine’s time and require all of his creative energy. For example, as of 1956 Le Monument à Van Gogh, erected in Auvers-sur-Oise in 1961; Le Messager, for the town of Antwerp in 1957; La Forêt Humaine in 1960-1961, for the Jerusalembased Van Leer Fondation; Le Monument aux Frères Van Gogh for the town of Zundert in
the Netherlands, in 1963; the monumental Demeurein 19631964 for Der Nederlandsche Bank in Amsterdam; Le Prométhée in 1965 for the Frankfurt Library; and in 1966, for the town of Laval the Monument à Alfred Jarry are some of his main monumental works from this period. The attention that Ossip Zadkine paid to integrating his sculptures in urban settings in accordance with the architectural creations of his time is inherent to a large part of his creative works, which would be the object of the Sculptures pour l’Architecture exhibition at the Galerie Lucie Weill in Paris in June-July 1967, shortly before he died.
In October 1961, architect René Egger, who was in charge of the construction of the future Marseille-Luminy Faculty of Sciences, told Ossip Zadkine that Gaston Defferre, the Mayor of Marseille, wanted him to participate in the building’s decoration. For this, Zadkine retained the theme of the atom. Three years before that, the
La ville détruite sur le Leuvehaven à Rotterdam (photographie prise en 1953)
Monument à Van Gogh, dans l’atelier de Zadkine
© Marc Vaux, Paris
Zadkine. Trois ans auparavant, l’Atomium à Bruxelles, gigantesque monument entre architecture et sculpture réalisé dans le cadre de l’Exposition Universelle de 1958, avait par sa construction et son sujet, le destin de l’humanité face aux découvertes scientifiques, fait forte impression. L’atome devenait le symbole d’une nouvelle ère de progrès et d’avancées scientifiques au bénéfice de l’humanité.
Les premières maquettes pour La Force atomique qui datent de 1962, montrent que Zadkine avait comme intention d’associer la forme en soleil en haut d’une longue tige à la représentation de l’atome. Dans la version de 1963 d’un mètre quarante environ, Zadkine va y associer au dessus de la forme solaire les symboles
scientifiques de l’atome. C’est cette version qui sera retenue par Gaston Defferre et René Egger en 1963. Mais Zadkine y retravaillera de nouveau en 1965, y apportant des modifications de surface. Il ne verra jamais l’installation de sa sculpture à la faculté des Sciences de Marseille-Luminy car la sculpture ne sera érigée qu’en 1971, soit quatre ans après la mort de l’artiste.
En 1968, le banquier et mécène belge Maurits Naessens (1908–1982) sollicite Valentine Prax, la veuve de Zadkine, pour la réalisation d’une version de 4,50 m de haut de La Force atomique, destinée au siège anversois de la Banque de Paris et des Pays-Bas (devenue Paribas, puis Belfius).
Atomium in Brussels, a gigantic monument midway between architecture and sculpture made for the 1958 Universal Exposition, with its construction and subject, the destiny of humanity in the face of scientific discoveries, had made a strong impression. The atom became the symbol of a new era of scientific progress and achievements for the benefit of humanity.
The first models for La Force atomique which dates from 1962, show that Zadkine intended to associate the sun shape at the top of a long step to the representation of an atom. In the 1963 version, which was approximately 1m40 in height, Zadkine would use the scientific forms used to represent atoms above the sun shape. It is this version that Gaston Defferre and René Egger would choose in 1963. However, Zadkine would work on it again in 1965, carrying out superficial modifications.


He would never see his sculpture erected at Marseille-Luminy Faculty of Sciences, as this 6-metre-high version would only be put in place in 1971, four years after the artist’s death.
In 1968, Belgian banker and patron Maurits Naessens (1908–1982) contacted Valentine Prax, Zadkine’s widow, regarding the production of a 4.5 m high version of La Force atomique for the Banque de Paris et des PaysBas (which later became Paribas and then Belfius) head office in Antwerp. The bronze cast that art founder Susse produced would be erected in 1969 on the bank’s forecourt.
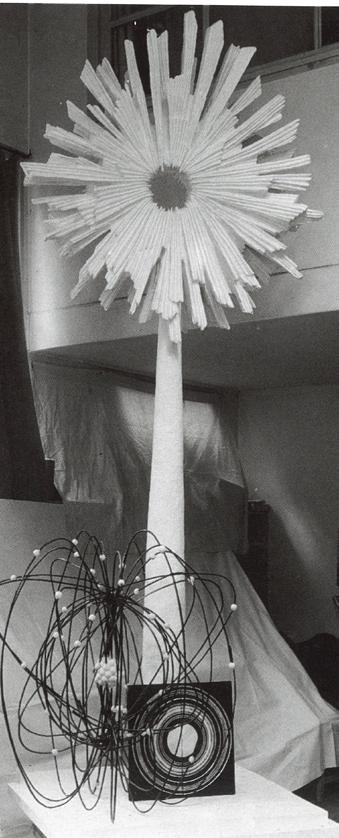
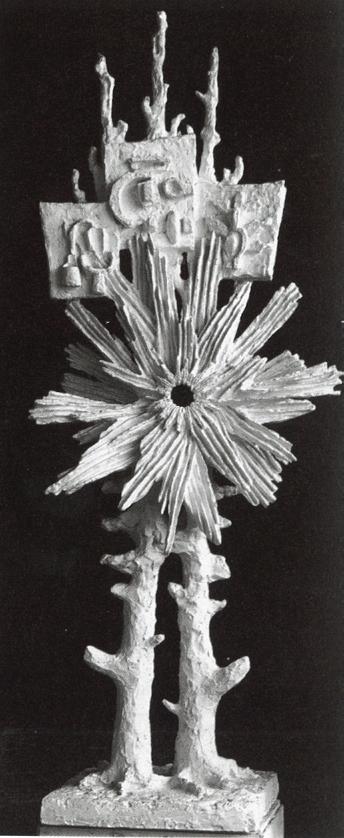
Projet pour la Force atomique ou l’Éclatement de l’atome 1962, Plâtre
La Force atomique devant le siège de la Banque Paribas, Anvers dans les années 1970
Ossip ZADKINE 1888-1967
La Force atomique – circa 1963-1966
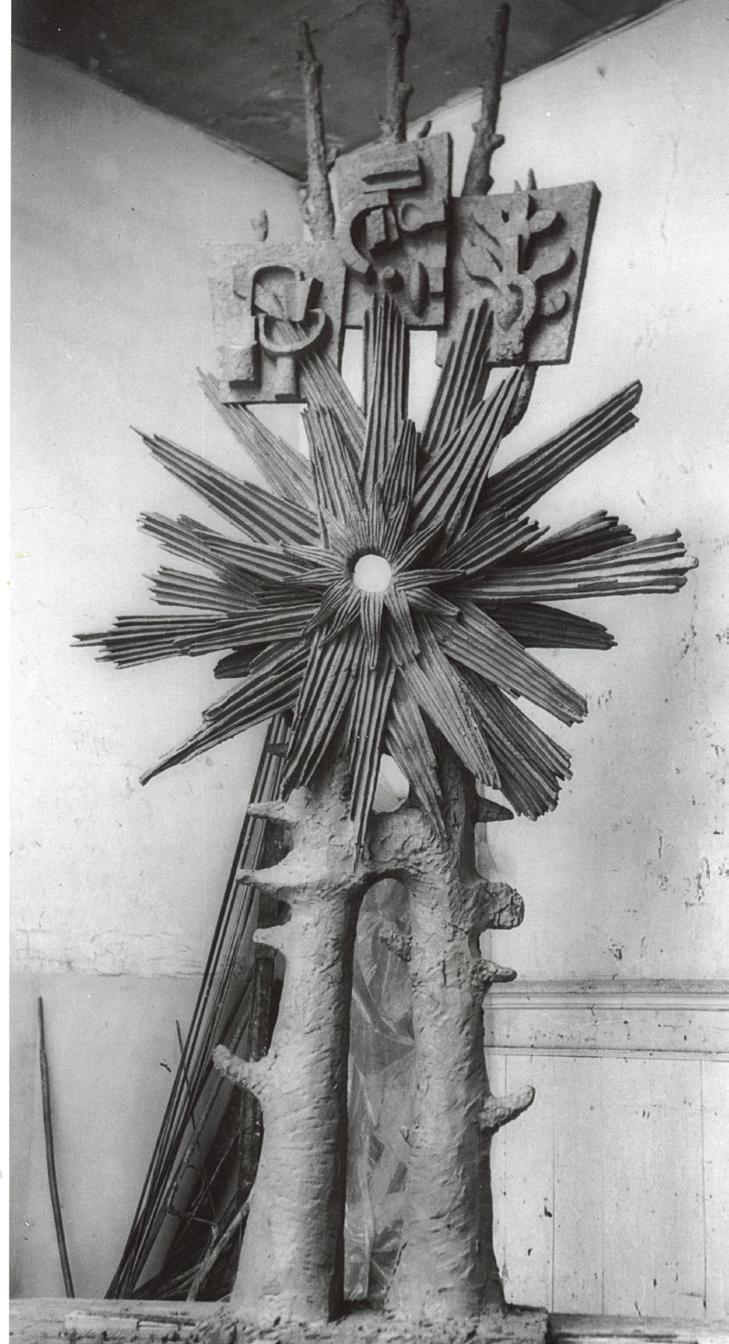
Le bronze réalisé par le fondeur Susse, sera installé en 1969 sur le parvis de la banque. Cette commande de Naessens illustre une nouvelle fois les liens de longues dates qui unissaient Ossip Zadkine et les collectionneurs et mécènes belges, flamands et hollandais, nombreux dès les années 1930 à soutenir l’artiste par des commandes et des achats privés. Ce ne fut pas un hasard si la première exposition personnelle de Zadkine en Europe à son retour d’exil aux États-Unis, se déroula au Palais des
Beaux-Arts de Bruxelles et au Stedelijk Museum d’Amsterdam de février à juin 1948. En ce sens Naessens a été un acteur majeur du mécénat artistique en Belgique dans le cadre de ses fonctions au sein de la Banque de Paris et des Pays-Bas. À titre personnel il collectionna les artistes du groupe de Laethem. L’attachement de Maurits Naessens à l’œuvre et au message humaniste d’Ossip Zadkine fut un relais important pour la reconnaissance du sculpteur.

This commission from Naessens further demonstrated the longstanding relationship between Ossip Zadkine and Belgian, Flemish, and Dutch collectors and patrons, many of who supported the artist with commissions and private purchases as of the 1930s. It wasn’t by chance that Zadkine’s first solo exhibition in Europe upon his return from exile in the United States took place at the Centre for Fine Arts in Brussels and the Stedelijk Museum in
Amsterdam from February to June 1948. In that sense, Naessens was a key figure in art patronage in Belgium thanks to his role within the Banque de Paris et des PaysBas. He personally collected works by artists from the Laethem-SaintMartin school. Maurits Naessens’ attachment to Ossip Zadkine’s works and humanist message was an important vector in the sculptor’s rise to fame.
En Fr
Maquette pour La Force atomique ou L’Éclatement de l’atome, 1963, Bronze
Ossip Zadkine devant La Demeure, 1963-1964
© Marc Vaux, Paris
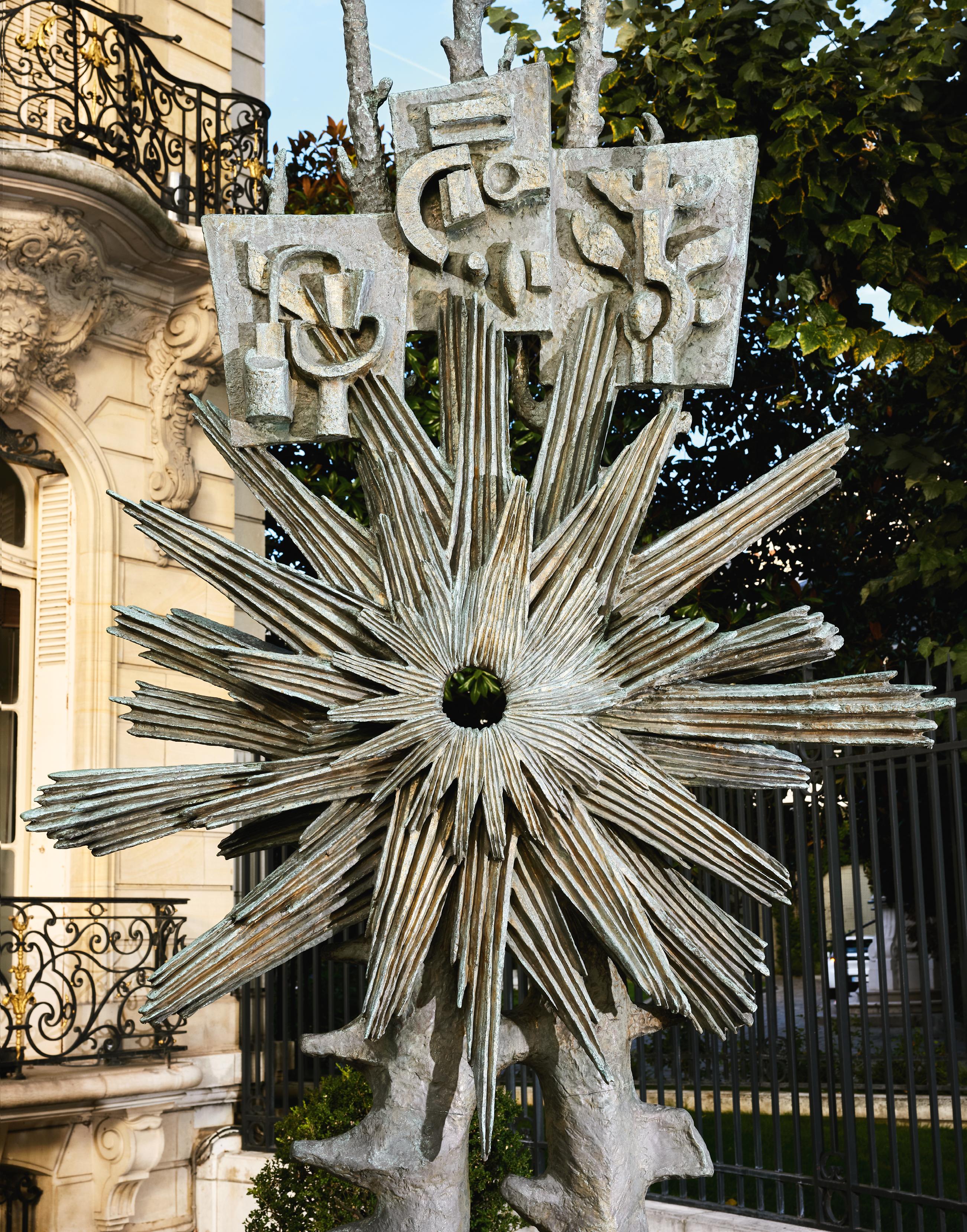
1921-1998
Odile – 1984-87
Bronze à patine brune
Signé et numéroté sur la terrasse « César, EA 2/2 » Édition de 8 exemplaires + 2 EA + 2 HC
Fonte Bocquel
85 × 57 × 85 cm
Provenance :
Galerie de Bellecour, Lyon Acquis directement auprès de cette dernière par l’actuel propriétaire en 1990
Bibliographie :
P. Restany, César, Éditions de La Différence, Paris, 1988, reproduit en couleur p. 315 (un exemplaire similaire)
J-C. Hachet, César ou Les métamorphoses d’un grand art, Éditions Varia, Paris, 1989, reproduit en noir blanc, figure 155, p. 77 (un exemplaire similaire)
Cette œuvre est enregistrée dans les Archives Denyse Durand-Ruel sous le n°3410.
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.
Bronze with brown patina; signed and numbered on the base; edition of 8 + 2 AP + 2 HC; Bocquel foundry; 33 ½ × 20 ½ × 33 ½ in.
80 000 - 120 000 €

1921-1998
Odile – 1984-87

À partir de 1977-78, les marchands de César l’incitent à réaliser les premiers tirages en bronze de ses œuvres en fer soudé. Cet alliage confère une dimension plus noble à toutes les disciplines qu’il a jusqu’alors explorées : modelage, soudure, collage et assemblage. Grâce au bronze, il peut démultiplier sa capacité de production et exécute, au cours de sa carrière, plus d’un millier de sculptures dans ce matériau, contre environ 800 seulement en fer soudé.
Très vite, l’artiste s’approprie cette nouvelle technique et ce procédé de transformation. Ses anciennes sculptures sont d’abord moulées en plâtre, puis, le cas échéant, agrandies grâce au pantographe. Perfectionniste, il retravaille ses pièces en profondeur : les modifie, les déconstruit et les reconstruit
jusqu’à obtenir des œuvres inédites qui ne conservent parfois qu’une lointaine ressemblance avec les sculptures en fer soudé d’origine. Comme avec le fer, il intervient jusqu’à la coulée, altérant inlassablement son modèle. César nous livre ainsi son processus de création : « Récemment, j’ai repris une poule que j’avais faite des années auparavant. Une fois le travail commencé, cela ne me plaisait plus... Je prends une masse. J’assène quelques coups et toutes les ailes partent. Le cul reste nu. Mais les morceaux tout d’un coup m’intéressent et je recommence avec une nouvelle idée. En détruisant, j’ai créé autre chose. Et comme j’avais dans mon bric-àbrac des patins à roulettes, j’ai posé la poule dessus. J’en ai fait cinq ou six comme ça, avec des variations. Il ne faut jamais avoir peur de faire ce dont on a envie ».
Starting in 1977–78, César’s dealers encouraged him to create the first bronze casts of his welded iron works. This alloy lends a more noble dimension to all the disciplines it has explored to date: modelling, welding, bonding and assembly. Thanks to bronze, he was able to expand his production capacity, executing over the course of his career more than a thousand sculptures in this medium, compared to only about 800 in welded iron.
The artist quickly embraced this new technique and transformation process. His early sculptures were first cast in plaster, then enlarged using a pantograph where necessary. A perfectionist, he reworked his pieces extensively, modifying, deconstructing and reconstructing them until he achieved entirely new works that sometimes bore only a distant
resemblance to the original welded iron sculptures. As with iron, he intervened up until the casting stage, tirelessly altering his model. In this way, César revealed his creative process: “Recently, I revisited a hen I had made years earlier. Once I started working on it, I no longer liked it… I grab a mallet. I strike a few blows and all the wings fall off. The rear is left bare. But suddenly the pieces interest me, and I begin again with a new idea. By destroying, I created something else. And since I had some roller skates lying around among my odds and ends, I placed the hen on them. I made five or six like that, with variations. You should never be afraid to do what you feel like doing”.
César, Césarine, 1987, 50 cm de haut
© DR
Fr En

1921-1998
Odile – 1984-87

Chaque bronze devient ainsi unique. Même les séries – comme ses gallinacés – présentent toujours des variantes : une tête différente, une posture nouvelle, une invention inattendue, qui témoignent de la liberté et de l’inventivité inépuisables de César.
C’est dans ce contexte que naît la série des « poules patineuses ».
La grande épreuve en bronze présentée ici (85 cm de haut), répondant au doux prénom d’Odile, représente une poule chaussée de patins à roulettes. Figure animalière récurrente dans l’œuvre de l’artiste, ce volatile sportif est constitué d’un assemblage hétéroclite de plaquettes, clous et boulons.
César s’intéresse à l’équilibre du corps, posé sur une ou deux pattes, équilibre rendu d’autant plus précaire par la présence des patins
à roulettes. Odile semble ainsi chercher sa stabilité à la manière d’un funambule, tentant de ne pas chuter grâce à ses deux petites ailes à lamelles, qui évoquent celles des Valentin. À l’inverse, d’autres poules comme Césarine ou Anna affichent une maîtrise parfaite de leur équilibre et une véritable virtuosité. L’artiste s’autorise de grandes libertés anatomiques avec ses sujets, réinventant sans cesse leurs formes. Remarquables par leur expressivité, ces gallinacés sont empreints d’esprit et d’humour, César excellant à leur conférer une allure malicieuse et un caractère joyeux qui préside à leur création. Dans le bestiaire de l’artiste, chaque animal révèle en filigrane une vision de l’homme –et parfois même une projection de l’artiste lui-même.
Each bronze thus became unique. Even the series – like his gallinaceous birds – always feature variations: a different head, a new posture, an unexpected invention, which testify to César’s inexhaustible freedom and inventiveness.
It was in this context that the series of “roller-skating hens” was born. The large bronze piece presented here (85 cm high), affectionately named Odile, depicts a hen wearing roller skates. A recurring animal figure in the artist’s œuvre, this sporty bird is composed of a heterogeneous assemblage of plates, nails and bolts.
César was fascinated by the balance of the body, poised on one or two legs, a balance rendered even more precarious by the roller skates.
Odile thus seems to seek her stability like a tightrope walker, trying not to fall with the help of her two small slatted wings, reminiscent of the Valentins By contrast, other hens such as Césarine or Anna display perfect mastery of balance and genuine virtuosity. The artist allowed himself great anatomical liberties with his subjects, endlessly reinventing their forms. Remarkable for their expressiveness, these gallinaceous birds are full of wit and humour, César excelling in endowing them with a mischievous look and a joyful character that presides over their creation. Within the artist’s bestiary, each animal subtly reveals a vision of humanity –and at times, even a projection of the artist himself.
César, Anna, 1987, 100 cm de haut
© DR
Fr En

Tom WESSELMANN
1931-2004
Monica lying down, one arm up (gray) 1986–90
Email sur acier découpé au laser
Signé, daté, titré et annoté au dos « Wesselmann, 90, N63, Tom Wesselmann, 1986/89, Monica lying down, one arm up (gray) » 64 × 110,50 cm
Provenance :
Collection particulière, France À l’actuel propriétaire par descendance
Cette œuvre est enregistrée dans les Archives de l’Estate Tom Wesselmann sous le n°N63G.
Enamel on laser-cut steel; signed, dated and titled on the reverse; 25 ¼ × 43 ½ in.
100 000 - 200 000 €

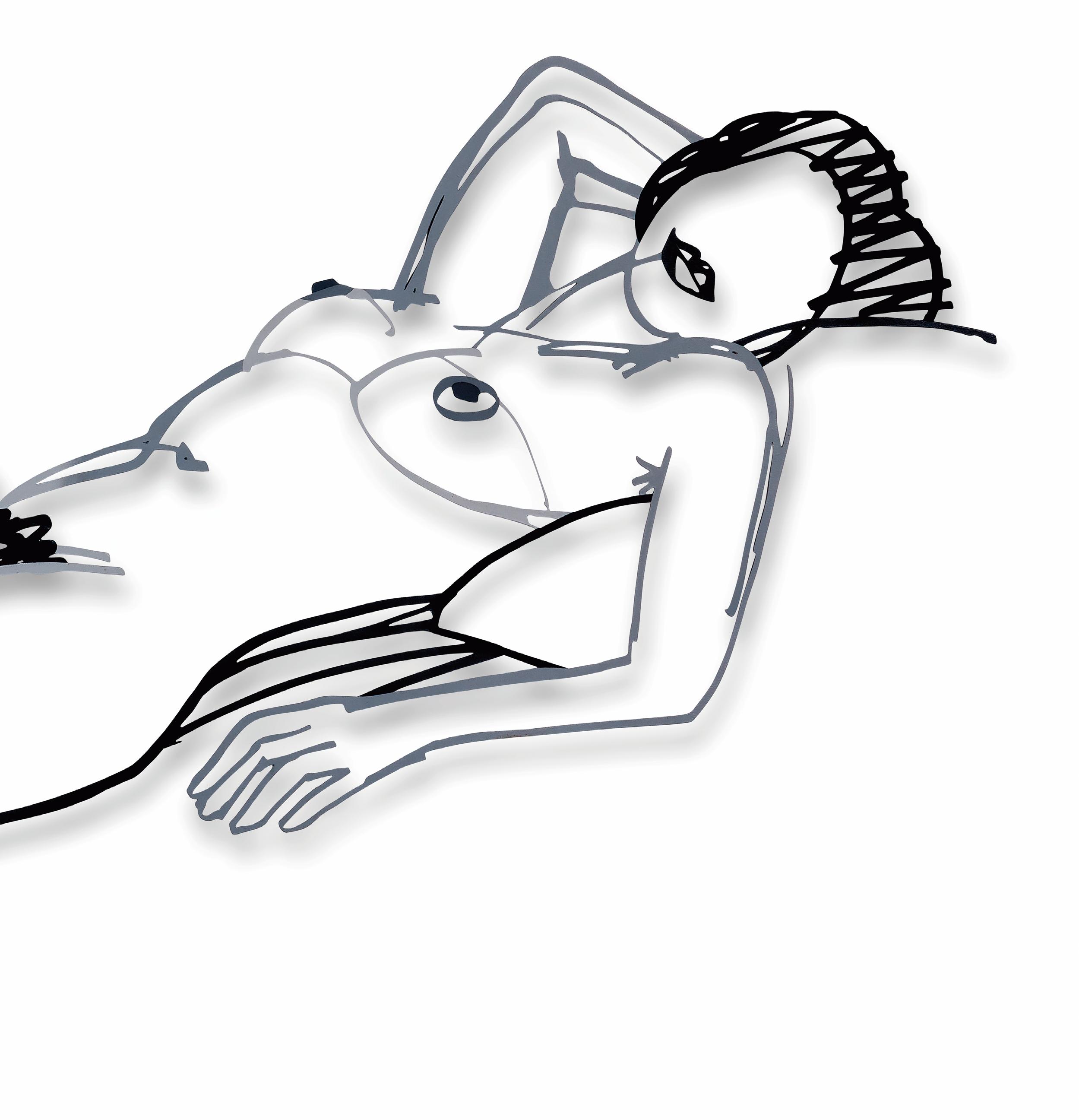
Tom WESSELMANN
1931-2004
Monica lying down, one arm up (gray) 1986–90
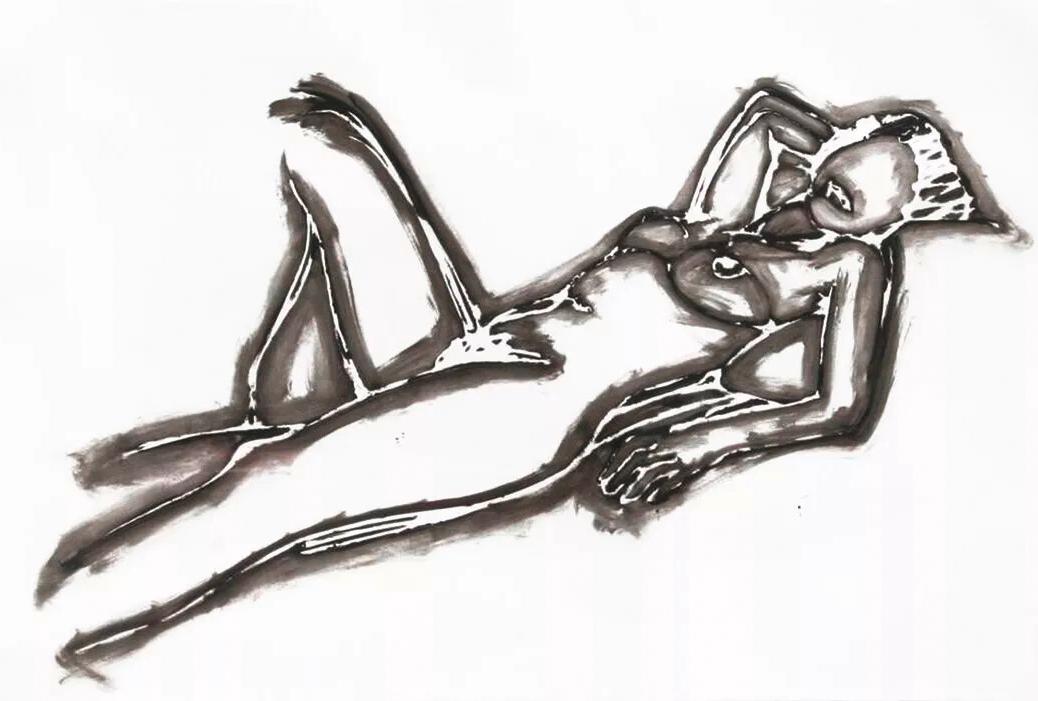

Tom Wesselmann (1931–2004) figure majeure du Pop Art, s’impose dans l’art du nu et ses représentations sensuelles du corps féminin. Sa série Great American Nude des années 1960 le propulse sur la scène artistique internationale.
Dans son œuvre, l’artiste américain accorde une place essentielle au dessin.
En 1983, il imagine une nouvelle approche « Mon idée de départ », explique-t-il, « était de préserver le processus et l’immédiateté de mes dessins d’après nature, avec les fausses lignes et les erreurs, et de les réaliser en acier. Comme si les lignes avaient été miraculeusement dessinées en acier ». Ces dessins en acier prennent naissance dans les esquisses exécutées au cours de séances de dessin intenses, d’après modèle. Ces croquis exigent une spontanéité totale, sans retouches possibles : « Il faut les tracer d’un seul jet », explique-t-il. Chaque ligne, pensée comme une surface aux contours nets, est conçue pour une transcription fidèle par
ordinateur. Pour obtenir un trait fluide et précis, il utilise un feutre noir sur du papier glacé, une technique exigeante qui, selon lui, impose une rigueur absolue : « Chaque coup de crayon devient un engagement majeur que l’on ne peut pas annuler ».
À cette époque, la technologie de découpe laser ne permettait pas encore d’atteindre la précision qu’il recherchait. Wesselmann consacre alors plus d’un an au développement d’une méthode adaptée, collaborant étroitement avec le fabricant de métaux Alfred Lippincott pour affiner une technique de découpe laser parfaitement fidèle à son tracé. L’année 1983 marque donc un tournant décisif : l’acte de dessiner devient le sujet même de ses œuvres.
Les premiers essais sont réalisés en aluminium découpé à la main, mais c’est avec l’acier découpé au laser que Wesselmann atteint pleinement son objectif. Lorsqu’il achève Amy Reclining en novembre 1984, son premier dessin en acier découpé au laser, il ressent une
Tom Wesselmann (1931–2004), a major figure in Pop Art, made his mark in the art of the nude and his sensual representations of the female body. His Great American Nude series of the 1960s propelled him onto the international art scene.
Drawing plays an essential role in the American artist’s work. In 1983, he came up with a new approach : “My initial idea”, he explains, “was to preserve the process and immediacy of my life drawings, with the false lines and mistakes, and to make them in steel. As if the lines had been miraculously drawn in steel”. These steel drawings originated from sketches made during intense life-drawing sessions. These sketches required total spontaneity, with no possibility of correction: “They must be drawn in a single stroke,” he explained. Each line, conceived as a sharply defined surface, was designed for faithful transcription by computer. To achieve a fluid and precise stroke, he used a black felt-tip pen on glossy paper, a demanding
technique that, according to him, required absolute rigor: “Each pencil stroke becomes a major commitment that cannot be undone”.
At the time, laser-cutting technology was not yet capable of achieving the precision he was looking for. Wesselmann spent more than a year developing a suitable method, working closely with the metal manufacturer Alfred Lippincott to refine a laser-cutting technique that was perfectly faithful to his line. The year 1983 marked a decisive turning point: the act of drawing became the very subject of his works.
The first attempts were made with hand-cut aluminium, but it was with laser-cut steel that Wesselmann fully achieved his objective. When he completed Amy Reclining in November 1984, his first drawing in laser-cut steel, he felt a real sense of exhilaration: “It was as if you could take a delicate line drawing from the paper and carry it with you”.
Tom Wesselmann, Dessin de nu, circa 1962 ©
by Cross River Press
Tom Wesselmann, Monica lying down with one arm up, 1990, lithographie
En Fr
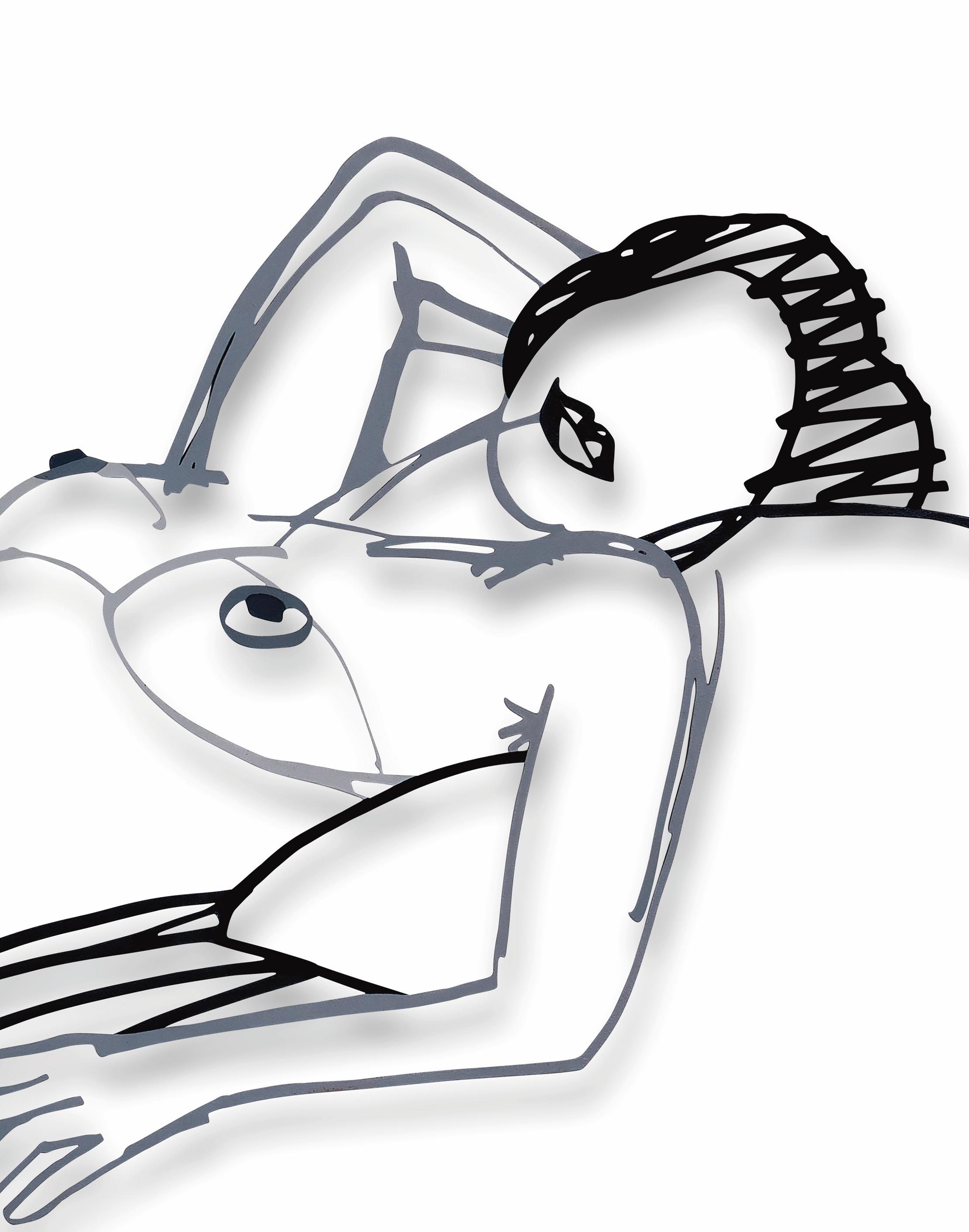
Tom WESSELMANN
1931-2004
Monica lying down, one arm up (gray) 1986-90


véritable exaltation : « C’est comme si on pouvait prélever du papier un délicat dessin au trait et l’emporter avec soi. »
Grâce à cette technique, Wesselmann a pu dépasser les limites du dessin traditionnel en transformant ses esquisses spontanées en œuvres métalliques. Ses lignes noires ou en couleur, désormais matérialisées dans l’acier, semblent flotter librement sur le mur, donnant l’illusion d’un dessin en trois dimensions. Cette approche préserve la fraîcheur et les imperfections du tracé original tout en le magnifiant à une échelle monumentale.
La technique unique de création de dessins en acier bouleverse à la fois la perception de l’œuvre et le système de classification de l’art : s’agit-il d’un dessin, d’un multiple, ou d’une sculpture ? Wesselmann tranche la question avec simplicité : « C’est un dessin parce que j’ai dessiné la chose ».
Par son approche visionnaire, il a anticipé une pratique devenue aujourd’hui courante avec l’essor des imprimantes 3D, qui permettent littéralement de matérialiser un croquis dans l’espace. L’innovation de Tom Wesselmann a élargi les possibilités techniques des artistes
et influencé l’essor de la découpe laser dans l’art. Ses dessins en acier marquent une avancée majeure dans l’histoire de l’art moderne, brouillant les frontières entre dessin, sculpture et technologie.
Dans Monica Lying Down, One Arm Up (Gray), Wesselmann représente une femme dénudée, allongée dans une pose suggestive : sa jambe droite pliée, sa main droite posée nonchalamment derrière la tête, et le visage tourné vers le spectateur, dépourvu de regard. L’artiste privilégie la simplicité des formes, esquissant uniquement la silhouette du personnage. Fidèle à son style, il omet volontairement les traits du visage, ne conservant que des lèvres pulpeuses et une chevelure noire comme seuls attributs identifiables.
Le jeu subtil de trois teintes — noir, gris foncé et gris clair — renforce l’aspect froid et désincarné de l’acier tout en accentuant la fluidité du trait. Cette approche minimaliste et la pose choisie ici met en valeur le corps féminin d’une manière à la fois stylisée et épurée. Pour accentuer l’énergie de l’œuvre, les zones pleines sont suggérées par des griffonnages ou des hachures rapides. Une autre caractéristique
Thanks to this technique, Wesselmann was able to push beyond the limits of traditional drawing by transforming his spontaneous sketches into metallic artworks. His black or coloured lines, now materialized in steel, seem to float freely on the wall, creating the illusion of a three-dimensional drawing. This approach preserves the freshness and imperfections of the original sketch while magnifying it on a monumental scale.
The unique technique of creating drawings in steel overturns both the perception of the work and the system of classifying art: is it a drawing, a multiple, or a sculpture? Wesselmann settles the question with simplicity: “It’s a drawing because I drew the thing”. With his visionary approach, he anticipated a practice that has now become commonplace with the rise of 3D printers, which can literally materialise a sketch in space. Tom Wesselmann’s innovation broadened the technical possibilities for artists and influenced the rise of laser cutting in art. His steel drawings mark a major advance in the history of modern art, blurring the boundaries between drawing,
sculpture and technology.
In Monica Lying Down, One Arm Up (Gray), Wesselmann depicts a nude woman lying in a suggestive pose: her right leg bent, her right hand resting nonchalantly behind her head, and her face turned toward the viewer, devoid of eyes. The artist prioritizes simplicity of form, sketching only the silhouette of the figure. True to his style, he deliberately omits facial features, retaining only full lips and black hair as identifiable attributes.
The subtle interplay of three tones –black, dark gray and light gray–reinforces the cold, disembodied aspect of the steel while enhancing the fluidity of the line.
This minimalist approach and the chosen pose highlight the female body in a manner that is both stylized and refined. To add dynamism to the piece, solid areas are suggested through scribbles or quick hatching. Another distinctive feature of this steel drawing is the complete elimination of the background. The figure, as if lifted from the sheet of paper, exists independently on the wall, free from any context. Finally, Monica, a recurring and recognizable model, is one of the artist’s iconic muses.
Francisco de Goya, La Maja nue, 1795-1800
Egon Schiele, Femme allongée, 1917
© Museo del Prado, Madrid © DR
En Fr
de ce dessin en acier est l’élimination totale de l’arrièreplan. La figure, comme détachée de la feuille de papier, existe par elle-même sur le mur, libérée de tout contexte. Enfin, Monica, modèle récurrent et identifiable, est l’une des muses emblématiques de l’artiste.
Cette œuvre a été dessinée en 1986, fabriquée et peinte en 1989, puis signée par l’artiste en 1990. Elle appartient à la Série noire, frottée et grise, un ensemble de trois œuvres identiques aux finitions distinctes : l’une est peinte en noir, une autre présente une peinture partiellement frottée pour créer des tonalités, et la troisième, mise en vente aujourd’hui, est réalisée en nuances de gris.
Belle et provoquante, cette œuvre s’inscrit dans une longue tradition du nu féminin allongé, pose iconique qui traverse l’histoire de l’art en évoluant avec les sensibilités artistiques et sociétales.
Dès la Renaissance, la représentation du nu féminin allongé s’affranchit du cadre religieux pour retrouver une sensualité assumée telle une déesse idéalisée, comme en témoignent La Vénus endormie (1508–12) de Giorgione et du Titien, ou Le Repos de Diane (1537) de Lucas Cranach. Au XVIIe et XVIIIe siècles, on trouve des formes voluptueuses et l’usage du clair-obscur dramatique
notamment dans La Maja nue (1795–1800) de Francisco de Goya. Le XIXe siècle marque un tournant, oscillant entre idéalisation classique et approche plus réaliste et provocatrice, incarnée par Rolla (1878) d’Henri Gervex. Et au XXe siècle, le nu allongé devient un espace d’expérimentation et de remise en question des canons esthétiques, comme en témoignent Femme allongée (1917) d’Egon Schiele, Reclining Nude (1929) d’Henry Moore, ou encore les nus couchés de Pablo Picasso (1942) et Nicolas de Staël (1954).
Cette pose lascive incarne tour à tour la beauté, la sensualité, la féminité, mais reflète aussi la perception du corps féminin dans l’art. Bien que reconnu plus tardivement en France que ses contemporains Roy Lichtenstein, Andy Warhol et Robert Rauschenberg, plusieurs rétrospectives ont été consacrées à Tom Wesselmann, notamment à la Fondation Cartier à Paris en 1994, au Musée Matisse de Nice en 2023 et à la Fondation Louis Vuitton à Paris jusqu’en février de cette année. Ses œuvres font aujourd’hui partie des collections de prestigieux musées à travers le monde, dont, entre autres, le MoMA de New York, la Tate Gallery de Londres, le ThyssenBornemisza de Madrid et le Musée Ludwig de Cologne.
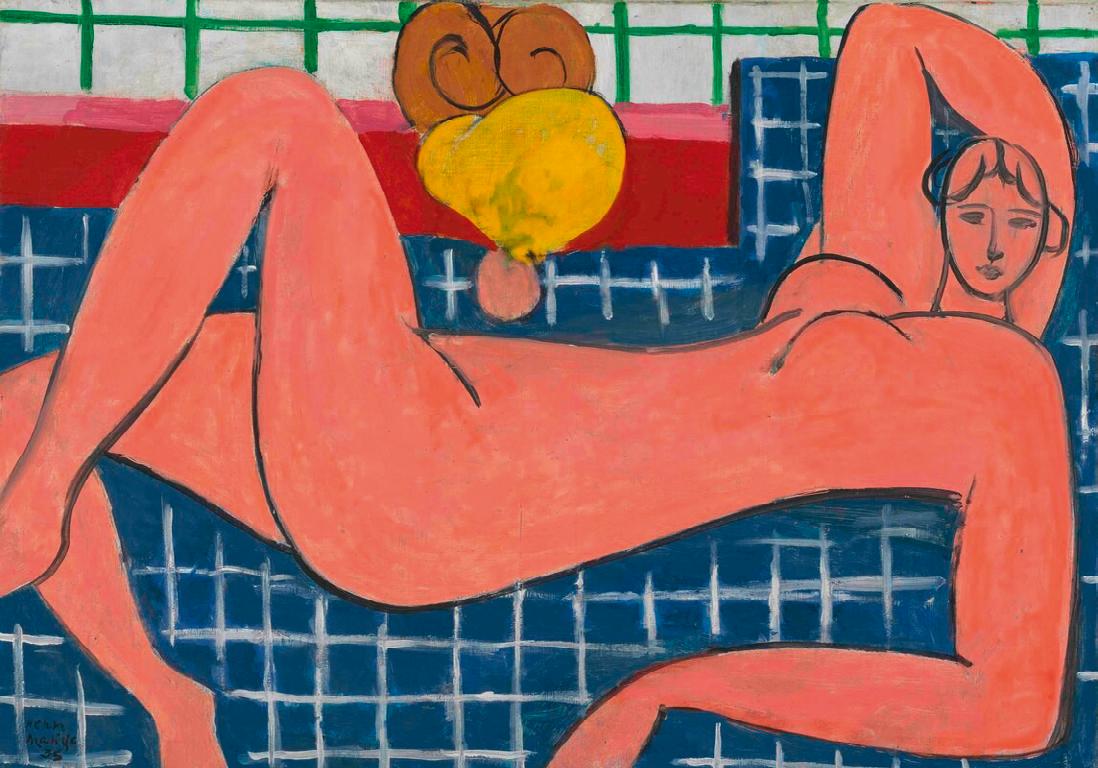
This work was drawn in 1986, fabricated and painted in 1989, and signed by the artist in 1990. It is part of the Black, Rubbed and Grey Series, a group of three identical works with distinct finishes: one is painted black, another features paint partially rubbed to create tonal variations, and the third, on sale today, is produced in shades of grey.
Beautiful and provocative, this work fits into a long tradition of reclining female nudes, an iconic pose that has evolved throughout art history in response to artistic and societal sensibilities.
As early as the Renaissance, the depiction of the reclining female nude broke free from religious contexts to embrace an assumed sensuality, portraying the subject as an idealized goddess, as seen in The Sleeping Venus (150–12) by Giorgione and Titian, or Diana at Rest (1537) by Lucas Cranach. In the 17th and 18th centuries, voluptuous forms and dramatic chiaroscuro effects emerged, notably in Francisco de Goya’s La Maja Desnuda (1795–1800). The 19th century marked a turning point, oscillating between classical idealization and a more realistic and provocative approach, exemplified by Henri Gervex’s Rolla (1878). In the 20th century, the reclining nude became a space for experimentation and a
challenge to aesthetic conventions, as seen in Egon Schiele’s Reclining Woman (1917), Henry Moore’s Reclining Nude (1929), and the reclining nudes of Pablo Picasso (1942) and Nicolas de Staël (1954). This languid pose has, over time, embodied beauty, sensuality and femininity, while also reflecting shifting perceptions of the female body in art.
Although Tom Wesselmann was not recognised in France until later than his contemporaries Roy Lichtenstein, Andy Warhol and Robert Rauschenberg, several retrospectives have been devoted to him, notably at the Fondation Cartier in Paris in 1994, at the Musée Matisse in Nice in 2023 and at the Fondation Louis Vuitton in Paris until February of this year. His work is now part of the collections of prestigious museums around the world, including the MoMA in New York, the Tate Gallery in London, the Thyssen-Bornemisza in Madrid and the Ludwig Museum in Cologne.

Henri Matisse, Nu allongé, 1935
Nicolas de Staël, Nu couché (NU), 1954
© DR
Robert COMBAS
Né en 1957
Le noyé affolé ne s’est pas aperçu qu’il avait pied – 1987
Acrylique sur drap marouflé sur toile
Signé et daté à la verticale en bas à droite « Combas, 87 »
210 × 222 cm
Provenance :
Collection particulière, France
Acquis directement auprès de cette dernière par l’actuel propriétaire en 2005
Cette œuvre est enregistrée dans les Archives de l’artiste.
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.
Titre complet : « Le noyé affolé ne s’est pas aperçu qu’il avait pied. Poissons et crustacés se partagent le paysage avec leur voisines, les plantes vertes d’eau. (Fin) ».
Acrylic on bed sheet laid down on canvas;
signed and dated vertically lower right; 82 ⅝ × 87 ⅜ in.
80 000 - 120 000 €




Robert COMBAS Né en 1957
Le noyé affolé ne s’est pas aperçu qu’il avait pied – 1987
« À la relative simplicité des premières compositions sur fond abstrait utilisant le procédé de l’illustration, fait suite un œuvre d’une prodigieuse richesse formelle et chromatique. Des personnages mythologiques aux natures mortes, des scènes du quotidien aux batailles, l’artiste utilise des références au confluent des cultures populaire et savante, revitalisant les sujets par des confrontations inattendues et une figuration prolifique aux couleurs éclatantes. Ses compositions résultent d’une imbrication et d’une contamination mutuelle des formes et des figures. La surface, ainsi recouverte jusqu’au moindre recoin, devient l’occasion de découvertes surprenantes » relate l’historienne de l’art Cristina Agostinelli à propos de l’évolution de la peinture de Robert Combas dans le catalogue Collection art contemporain – La collection du Centre Pompidou, Musée national d’art
Dans l’œuvre intitulée Le noyé affolé ne s’est pas aperçu qu’il avait pied, le chef de file de la Figuration Libre laisse libre cours à son sens de l’humour, présent à différents degrés dans chacune de ses compositions. Ici, on distingue un personnage tendant une main hors de l’eau alors que son corps succombe au peu de profondeur d’un bassin, empli d’algues et de poissons qui se gaussent. Le génie de Combas relève de sa façon de suggérer, à travers cette scène cocasse, les flux inconstants et incohérents de la vie moderne. En effet, l’artiste se plaît à rappeler qu’il est venu à l’art par sa liberté de l’aborder : « J’ai commencé à faire des toiles très libres, très colorées, assez violentes et avec beaucoup de personnages qui étaient souvent en train de se battre ou de se faire des farces. Je faisais de l’humour noir ».
“The relative simplicity of his early compositions on abstract backgrounds, using the illustration technique, was followed by works of prodigious formal and chromatic richness. From mythological characters to still lifes, from everyday scenes to battles, the artist uses references from the confluence of popular and scholarly cultures, revitalizing subjects through unexpected confrontations and prolific figuration in vibrant colours. His compositions are the result of an interweaving and mutual contamination of forms and figures. The surface, thus covered down to the smallest corner, becomes an opportunity for surprising discoveries”, says art historian Cristina Agostinelli about the evolution of Robert Combas’ painting in the catalogue Collection Art Contemporain – La collection du Centre Pompidou, Musée National d’Art
In the work entitled Le noyé affolé ne s’est pas aperçu qu’il avait pied (The panicked drowning man did not realize he could touch the bottom), the leader of the Figuration Libre movement gives free rein to his sense of humour, which is present to varying degrees in each of his compositions. Here, we see a character reaching out a hand from the water while his body succumbs to the shallow depths of a pool filled with algae and mocking fishes. Combas’ genius lies in his ability to suggest, through this comical scene, the inconsistent and incoherent flows of modern life. Indeed, the artist likes to remind us that he came to art through his freedom to approach it: “I started making very free, very colourful, quite violent paintings with lots of characters who were often fighting or playing pranks on each other. I was doing black humour”.
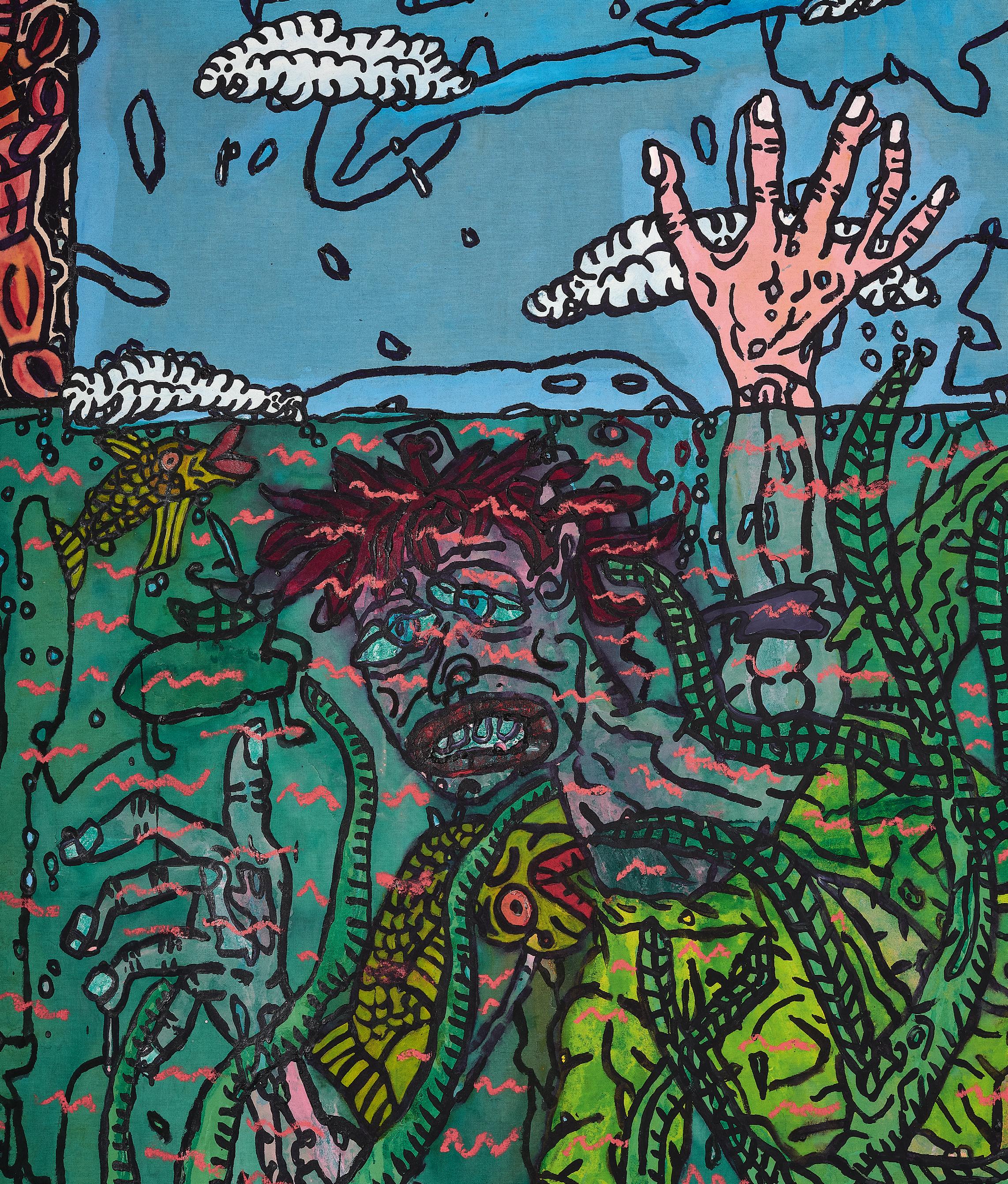
Robert MANGOLD Né en 1937
Column Structure XXI A – 2007
Acrylique et crayon sur toile
Signée, datée et titrée au dos « R. Mangold, 2007, Column Structure XXI A » 228,50 × 89 cm
Provenance :
Lisson Gallery, Londres (acquis directement auprès de l'artiste) Acquis directement auprès de cette dernière par l’actuel propriétaire en 2014
Acrylic and pencil on canvas; signed, dated and titled on the reverse; 90 × 35 in.
120 000 - 180 000 €


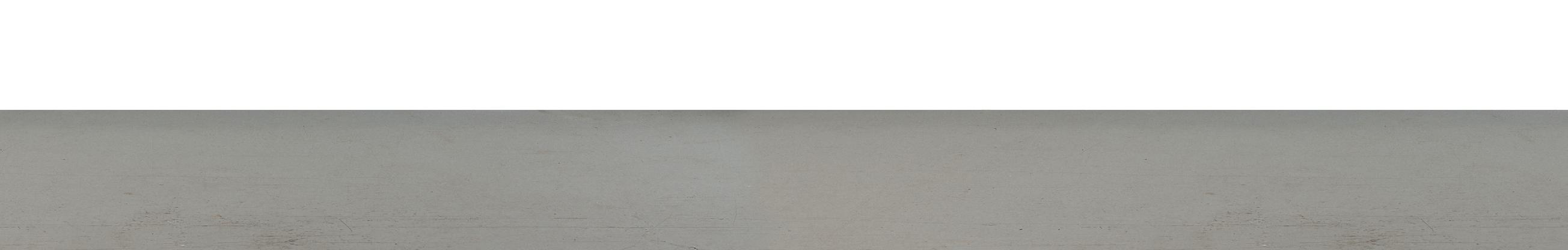
Robert MANGOLD
Dès les années 1960, Robert Mangold s’oriente vers l’abstraction géométrique et s’impose rapidement comme l’un des peintres minimalistes majeurs aux côtés de Robert Ryman, Elsworth Kelly, Frank Stella, Kenneth Noland et Sol LeWitt. Ce courant artistique, né aux États-Unis, se développe en rupture avec le lyrisme de l’Expressionnisme Abstrait et en opposition au Pop Art avec ses images issues de la culture populaire. Il cherche à réduire la peinture à ses éléments les plus essentiels : formes géométriques simples – cercles, carrés, triangles, lignes droites – et gammes chromatiques limitées, souvent restreintes à deux ou trois couleurs. Le geste et la matière sont délibérément effacés afin d’éliminer toute subjectivité. La simplicité s’impose dès lors comme principe fondateur : plutôt que de susciter l’émotion, l’artiste, à travers son œuvre, cherche à instaurer une relation directe entre structure, couleur et espace. Robert Mangold (né en 1937) a progressivement développé un vocabulaire plastique fondé sur la
géométrie et l’asymétrie des formes et des contours. Une grande partie de son œuvre explore la relation entre la partie et le tout, tout en jouant sur la perception de formes incomplètes, fréquemment inspirées par l’architecture. L’artiste explique en 1990 : « J’ai toujours eu le désir de créer une unité dans mon travail... de rendre tous les éléments – la ligne périphérique et la ligne interne, la surface, la couleur – égaux, totalement liés les uns aux autres ». Mangold donne à la plupart de ses châssis une forme irrégulière et insolite. Les titres de ses œuvres, strictement descriptifs, accompagnent ses toiles qui sont entièrement recouvertes de peinture acrylique sans marque d’application visible, uniquement traversée par des lignes au crayon tracées à la main.
Avec la série des Column Paintings (Peintures Colonnes) initiée en 2004, Robert Mangold réalise un ensemble de toiles toutes verticales contrastant fortement avec sa série précédente, Curled Figures, composée de formats horizontaux.

As early as the 1960s, Robert Mangold turned towards geometric abstraction and quickly established himself as one of the leading minimalist painters, alongside Robert Ryman, Elsworth Kelly, Frank Stella, Kenneth Noland and Sol LeWitt. This artistic movement, born in the United States, developed in opposition to the lyricism of Abstract Expressionism and in contrast to Pop Art, with its imagery drawn from popular culture. Minimalism sought to reduce painting to its most essential elements: simple geometric forms –circles, squares, triangles, straight lines– and limited colour palettes, often restricted to two or three hues. The gesture and the material are deliberately erased in order to eliminate all subjectivity. Simplicity thus became a founding principle: rather than evoke emotion, the artist aimed to establish a direct relationship between structure, colour and space.
Robert Mangold (born in 1937) gradually developed a visual
vocabulary based on geometry and the asymmetry of forms and contours. Much of his work explores the relationship between the part and the whole, while playing with the perception of incomplete shapes, often inspired by architecture. In 1990, the artist explained: “I have always had the desire to create a unity in my work… to make all the elements –the outer line and the inner line, the surface, the colour– equal, completely connected to one another”. Mangold gives most of his canvases irregular and unconventional shapes. The titles of his works, strictly descriptive, accompany paintings that are entirely covered in acrylic paint with no visible brushwork, only crossed by hand-drawn pencil lines.
With the Column Paintings series, initiated in 2004, Robert Mangold created a group of entirely vertical canvases, strongly contrasting with his previous Curled Figures series, composed of horizontal formats.
Les Atlantes du Nouvel Ermitage, Saint-Pétersbourg, 1842-51
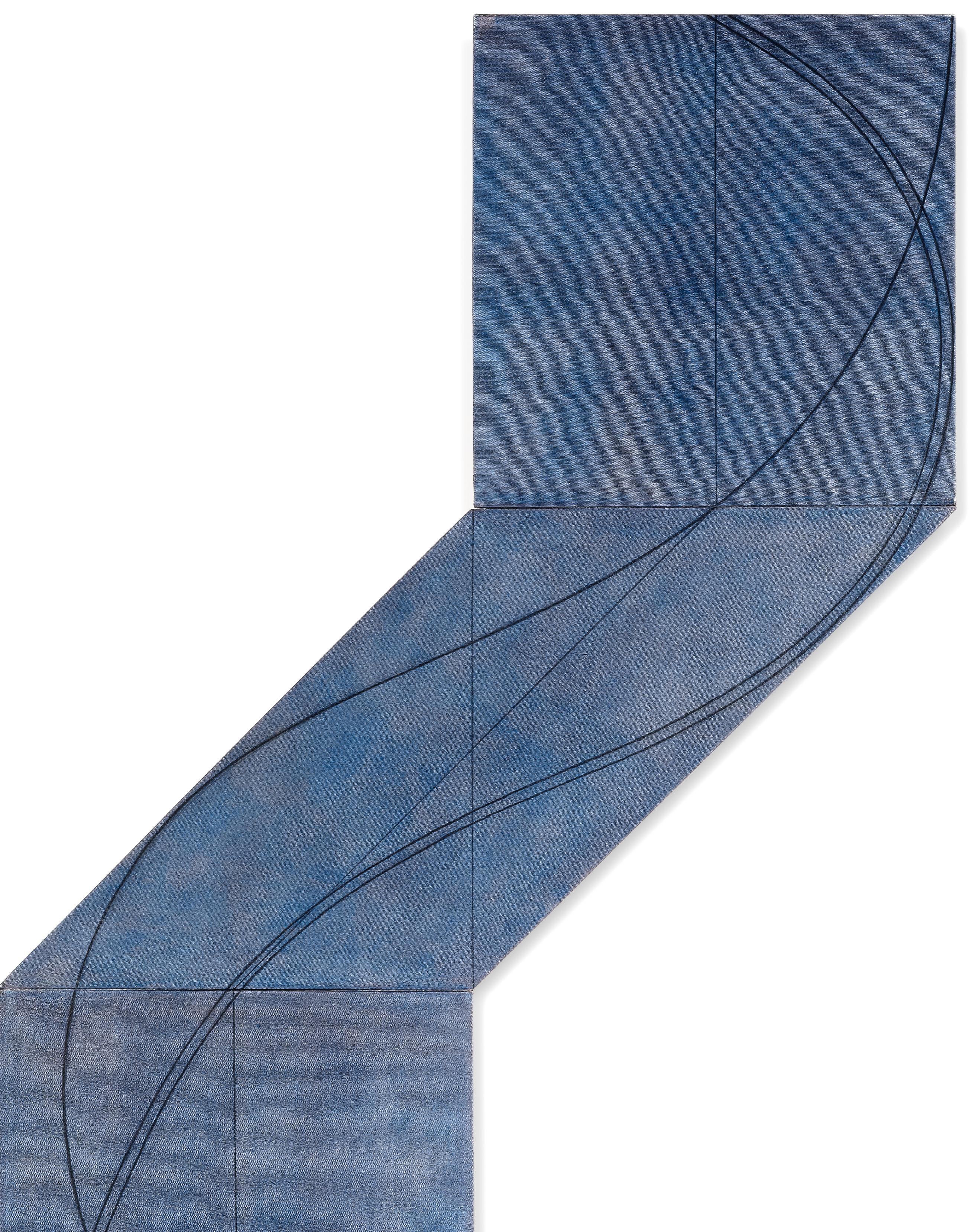

Robert MANGOLD Né en 1937
Column Structure XXI A – 2007

En renversant l’orientation traditionnelle de la peinture occidentale, historiquement horizontale, pour privilégier la verticalité, Mangold donne à ses toiles une dimension architecturale. La tradition picturale chinoise, avec ses rouleaux verticaux de paysages, nuages, cascades et montagnes, exploite également pleinement ce format. Le terme « column » (colonne) renvoie à un élément architectural rencontré surtout en sculpture dans l’histoire de l’art pour commémorer une victoire ou un personnage célèbre, telles la Colonne Trajane de Rome, la Colonne Vendôme de Paris ou la Colonne Nelson de Londres. Dans cette série, Mangold dissimule une composition conceptuelle
soigneusement élaborée, où chaque ligne, chaque couleur et chaque espace participent à une réflexion sur l’équilibre, la proportion et la perception.
Column Structure XXI A (2007) présente un châssis en deux parties aux formes originales, reprenant la posture d’un atlante. Sur un fond subtil de lavis d’acrylique bleu (couleur fréquemment utilisée par Mangold), des lignes dessinées s’entrecroisent sur toute la surface de la toile : sept lignes droites subdivisent chaque section qui se reflète l’une dans l’autre avec une exactitude géométrique créant ainsi une grille, tandis que trois lignes courbes unifient la composition. Ces dernières s’articulent avec élégance, comme deux danseurs tournoyants, venant croiser la

By reversing the traditional orientation of Western painting, historically horizontal, and privileging verticality, Mangold imparts an architectural dimension to his canvases. This vertical format is also fully exploited in the Chinese pictorial tradition, with its scrolls depicting landscapes, clouds, waterfalls and mountains. The term “column” refers to an architectural element most often seen in sculpture throughout art history, used to commemorate a victory or a famous figure, such as Trajan’s Column in Rome, the Vendôme Column in Paris, or Nelson’s Column in London. In this series, Mangold conceals a carefully crafted conceptual composition, where every line, colour and
space contributes to a reflection on balance, proportion and perception.
Column Structure XXI A (2007) features a two-part canvas with original forms, echoing the posture of an atlas figure. Against a subtle background of blue acrylic wash (a colour frequently used by Mangold), drawn lines intersect across the entire surface: seven straight lines subdivide each section, reflecting one another with geometric precision to create a grid, while three curved lines unify the composition. These curves interact elegantly, like two spinning dancers, crossing the grid and touching the edges of the canvas at nine points. Their complex, sinuous interplay, like a gentle, resonant oscillation,
Colonne Vendôme à Paris, 1810
© DR
Fr En
Constantin Brâncuși, La colonne sans fin, 1er version, 1918
grille et toucher les bords de la toile en neuf points de contact. Leur jeu complexe et sinueux, telle une oscillation douce et sonore, capte le regard du spectateur, évoquant un mouvement cinétique ou des ondes sinusoïdales. La grille structure la composition lui conférant une certaine clarté de lecture, comme une sorte de sous-texte qui impose à l’œuvre un principe d’ordre, tout en contrariant l’illusion suggérée par les courbes, lesquelles viennent troubler la symétrie de la colonne. Les courbes dessinées par Mangold, bien qu’ajustées aux limites de la toile, semblent pouvoir se prolonger au-delà, rappelant que l’infini ne peut être contenu dans un espace fini. Ce principe
se retrouve dans la Colonne sans fin (1918) de Constantin Brancusi, composée de modules répétitifs qui, tels des pulsations, pourraient se déployer indéfiniment dans les deux directions. Chez l’un comme chez l’autre, l’élan vertical confère à l’œuvre une dynamique ascendante qui guide irrésistiblement le regard vers le ciel.
L’impact direct de Column Structure XXI A – que l’artiste nomme « voir-regarder-vivre » – repose sur une composition exigeante subtilement dissimulée sous une apparente simplicité. Dépourvu de références explicites, ce « tableau-objet » trouve une résonance à la fois dans l’histoire de l’art et dans la démarche artistique de Robert Mangold.
draws the viewer’s eye, evoking kinetic movement or sinusoidal waves. The grid structures the composition, providing clarity of reading, like a kind of subtext that imposes order on the work, while the curves disrupt the column’s symmetry.
Although carefully adjusted to the edges of the canvas, Mangold’s drawn curves seem capable of extending beyond it, suggesting that infinity cannot be contained within a finite space. This principle recalls Constantin Brancusi’s Endless Column (1918), composed of repetitive modules that, like pulses, could extend indefinitely in the two directions. In both cases, the vertical thrust gives the work an ascending dynamic that
irresistibly guides the viewer’s gaze skyward.
The direct impact of Column Structure XXI A –which the artist calls “see-look-live”– is based on a demanding composition subtly concealed beneath an apparent simplicity. Devoid of explicit references, this “painting-object” resonates both within the history of art and in the artistic practice of Robert Mangold.

© Ellen Labenski
Exposition Robert Mangold à la Galerie Pace de New York en 2007


Joseph KOSUTH
Né en 1945
Clock (One and five) [Eng.-Fr.] – 1965
Quatre photographies contrecollées sur aluminium et horloge 100 × 100 cm chaque photographie Diamètre de l’horloge : 22 cm
Provenance :
Collection Alain Tarica, Genève (acquis directement auprès de l’artiste à la fin des années 60) Galerie Ghislaine Hussenot, Paris Acquis directement auprès de cette dernière l’actuel propriétaire
Exposition :
Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, L’Art et le temps : regards sur la quatrième dimension, novembre 1984-janvier 1985
Exposition itinérante :
Genève, Musée Rath, février-avril 1985 ; Humlebaek, Louisiana Museum of Modern Art, avril-juin 1985 ; Mannheim, Städtische Kunsthalle, juilletseptembre 1985; Vienne, Museum des XX Jahrhunderts, septembre-novembre 1985 ; Lyon, Institut d’Art Contemporain, décembre 1985-janvier 1986 ; Londres, Barbican Center, février-mars 1986 Vienne, Wiener Secession, Wittgenstein: eine Ausstellung der Wiener Secession, septembre-octobre 1989, reproduit p. 230
Exposition itinérante :
Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, décembre 1989-janvier 1990
Genève, MAMCO, Rudiments d’un musée possible 1, septembre 1994-janvier 1995
Genève, MAMCO, Rudiments d’un musée possible 2, février-mai 1995
Genève, MAMCO, Patchwork in Progress 6, juin-septembre 1999
Paris, Centre Georges Pompidou, Le temps vite, janvier-avril 2000, reproduit Exposition itinérante : Rome, Palais des Expositions, juillet-octobre 2000; Barcelone, CCCB, novembre 2000-février 2001
Genève, MAMCO, Mille et trois plateaux-5e épisode, Condensations, février-mai 2006
Genève, MAMCO, Mille et trois plateaux-6° épisode, Conjonctions, juin-septembre 2006
Genève, MAMCO, Mille et trois plateaux-7° et dernier épisode, Conjonctions, octobre 2006-janvier 2007
Genève, MAMCO, Futur antérieur, dans le leurre du seuil, février-mai 2010
Bibliographie :
B. Schnackenburg & W. Bojescul, Kunst der Sechziger Jahre in der neuen Galerie Kassel 38 Werkinterpretationen, Editions Thiele & Schwarz, Kassel, 1982, reproduit pp. 42-43
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.
Four photographs mounted on aluminium and a clock; 39 ⅜ × 39 ⅜ in. each panel, diameter of the clock: 8 ⅝ in.
50 000 - 70 000 €
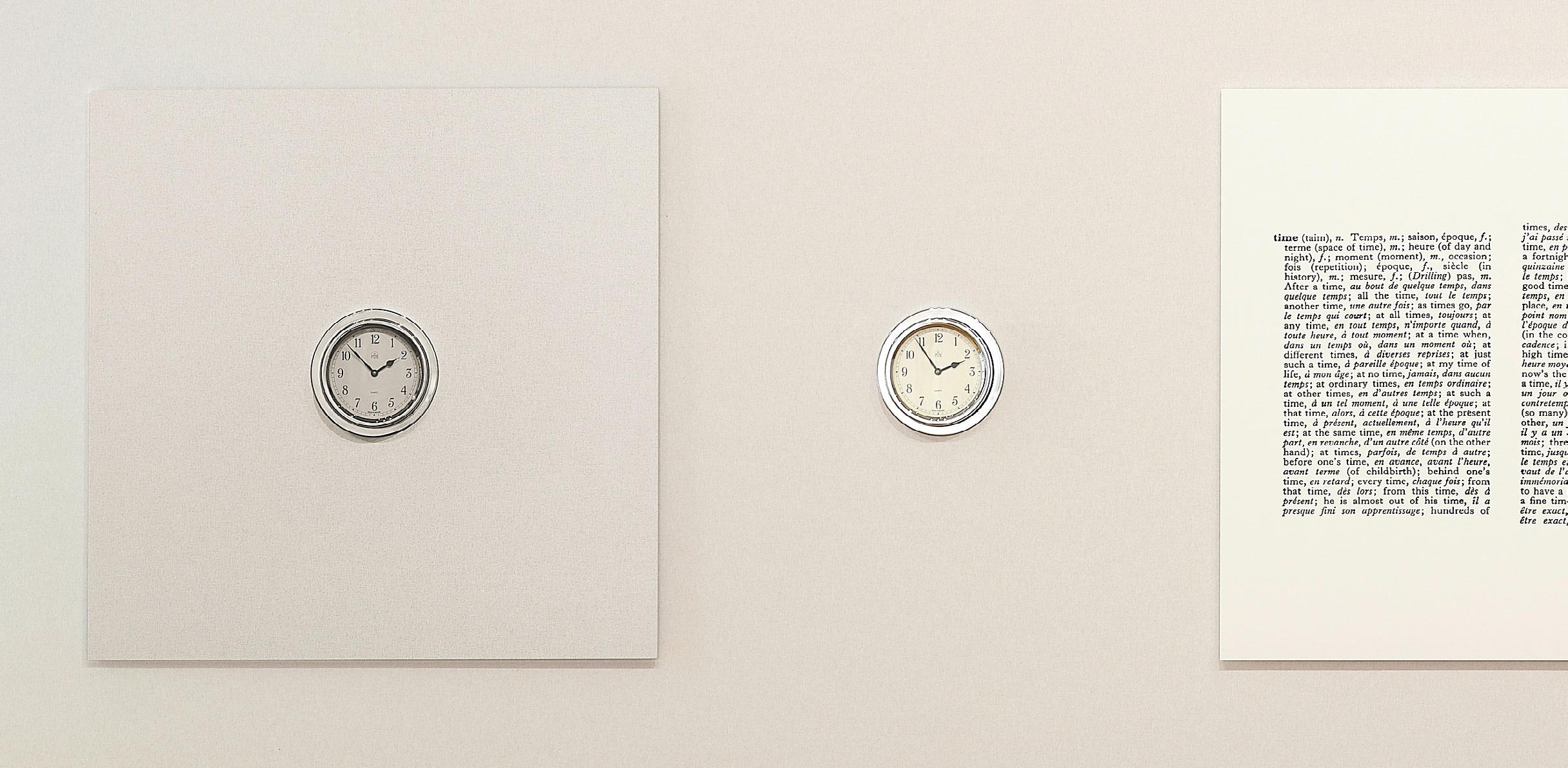
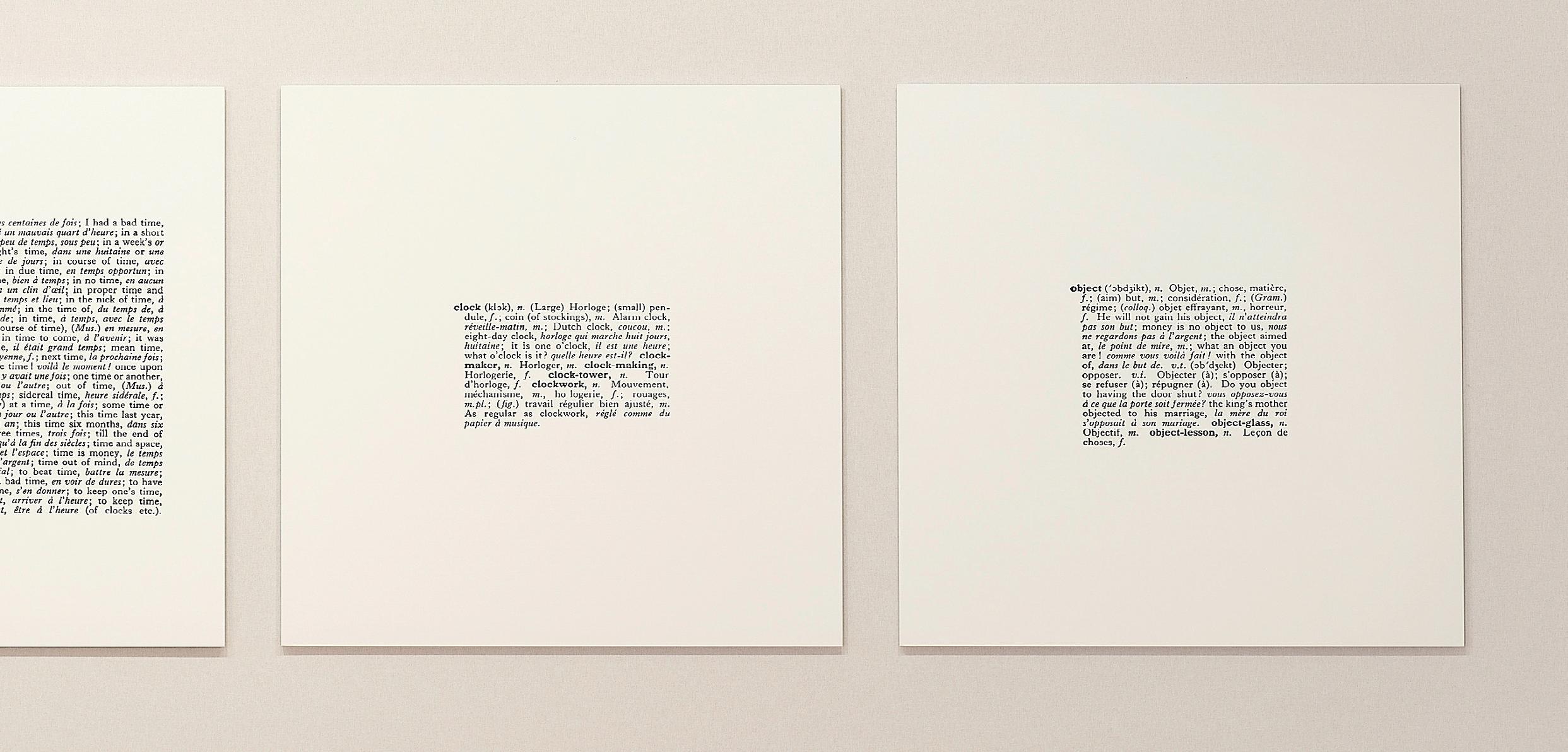
Joseph KOSUTH
Né en 1945
Clock (One and five) [Eng.-Fr.] – 1965
Joseph Kosuth, artiste américain né en 1945, est considéré comme l’un des pionniers de l’art conceptuel dans les années 1960. Son œuvre explore les liens entre langage, art et signification, remettant en question les fondements mêmes de ce que l’on appelle une œuvre d’art.
Dans la lignée de son œuvre
One and Three Chairs (1965) qui peut être admirée au Museum of Modern Art de New York, l’œuvre proposée ici est intitulée Clock (One and five) [Eng.-Fr.], datée de la même année, montrant une installation qui se compose de trois éléments : une horloge réelle, une photographie de cette même horloge et une définition du mot « horloge » extraite d’un dictionnaire. Ce type d’œuvre, que l’on pourrait qualifier d’œuvredéfinition, interroge la nature même de la représentation et du langage.
L’objectif de Kosuth dans ce type d’installation n’est pas de produire un objet esthétique traditionnel, mais de questionner le processus de signification : qu’est-ce qu’une horloge ? Est-ce l’objet physique ? Est-ce l’image que l’on en garde ? Ou est-ce la définition linguistique ?
Kosuth n’a pas fabriqué l’horloge, ni pris la photo, ni même rédigé la définition ; il les a simplement sélectionnées et assemblées. Mais s’agit-il là d’art ? Et quelle représentation de l’horloge est la
plus fidèle ? Ces questions ouvertes sont précisément celles auxquelles Kosuth souhaite nous inviter à réfléchir lorsqu’il affirme que « l’art donne du sens ». En assemblant ces trois représentations alternatives, Kosuth transforme une simple horloge en un objet de débat, une plateforme permettant d’explorer de nouvelles significations.
L’artiste utilise ici le langage non comme un outil de description, mais comme matière première de l’œuvre. Selon lui, l’art ne doit pas chercher à représenter le monde, mais à interroger ses propres mécanismes. Ainsi, ses œuvres ne cherchent pas à nous plaire ou à nous émouvoir, mais à nous faire penser.
Dans ses écrits, notamment dans Art after philosophy (1969), Kosuth affirme que « l’art, c’est la définition de l’art », soulignant que la réflexion conceptuelle est au cœur de la démarche artistique contemporaine. Son travail s’inscrit ainsi dans une rupture avec l’art traditionnel : ce n’est plus l’objet qui fait l’art, mais l’idée.
Les œuvres-définitions de Joseph Kosuth sont des expériences intellectuelles. Elles déplacent le regard de l’objet vers le concept, du visible vers le lisible. En confrontant langage, image et réalité, Kosuth redéfinit le rôle de l’artiste : il n’est plus un créateur de formes, mais un explorateur de significations.
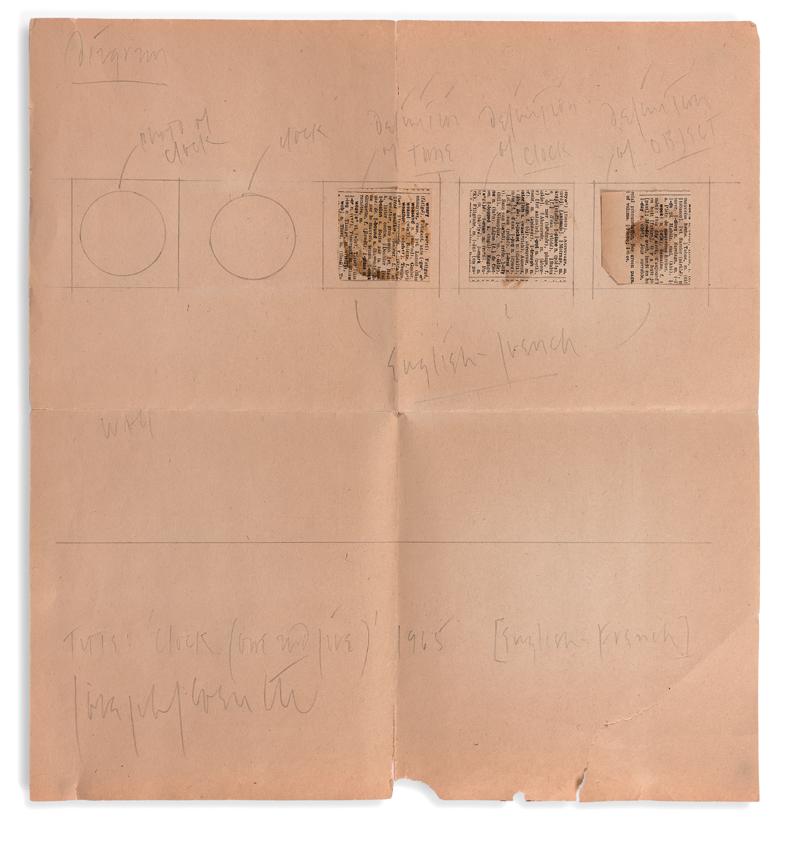
As early as the 1960s, Robert Joseph Kosuth, an American artist born in 1945, is considered one of the pioneers of Conceptual Art in the 1960s. His work explores the connections between language, art, and meaning, questioning the very foundations of what we call a work of art.
In line with his piece One and Three Chairs (1965), which can be admired at the Museum of Modern Art in New York, the work presented here is entitled Clock (One and Five) [Eng.-Fr.], also dated 1965. It consists of three elements: a real clock, a photograph of that same clock and a dictionary definition of the word “clock”. This type of work, which could be described as a definition piece, challenges the very nature of representation and language. Kosuth’s aim in such installations is not to produce a traditional aesthetic object, but to question the process of meaning itself: what is a clock? Is it the physical object? The image we retain of it? Or the linguistic definition? Kosuth neither manufactured the clock, nor took the photograph, nor wrote the definition; he simply selected and assembled them. But does that make it art? And which representation of the clock is the most accurate? These open questions are precisely those that Kosuth invites us to consider when he asserts that “art gives meaning”. By bringing together these three
alternative representations, Kosuth transforms a simple clock into an object of debate, a platform for exploring new meanings. Here, the artist uses language not as a tool for description, but as the very material of the work. In his view, art should not seek to represent the world, but rather to question its own mechanisms. Thus, his works are not meant to please or move us emotionally, but to make us think.
In his writings, notably Art After Philosophy (1969), Kosuth states that “art is the definition of art”, emphasizing that conceptual reflection lies at the core of contemporary artistic practice. His work thus represents a break with traditional art: it is no longer the object that constitutes art, but the idea.
Joseph Kosuth’s definition works are intellectual experiments. They shift our focus from the object to the concept, from the visible to the legible. By confronting language, image, and reality, Kosuth redefines the role of the artist: he is no longer a creator of forms, but an explorer of meanings.
Fr En
Certificat de l'œuvre
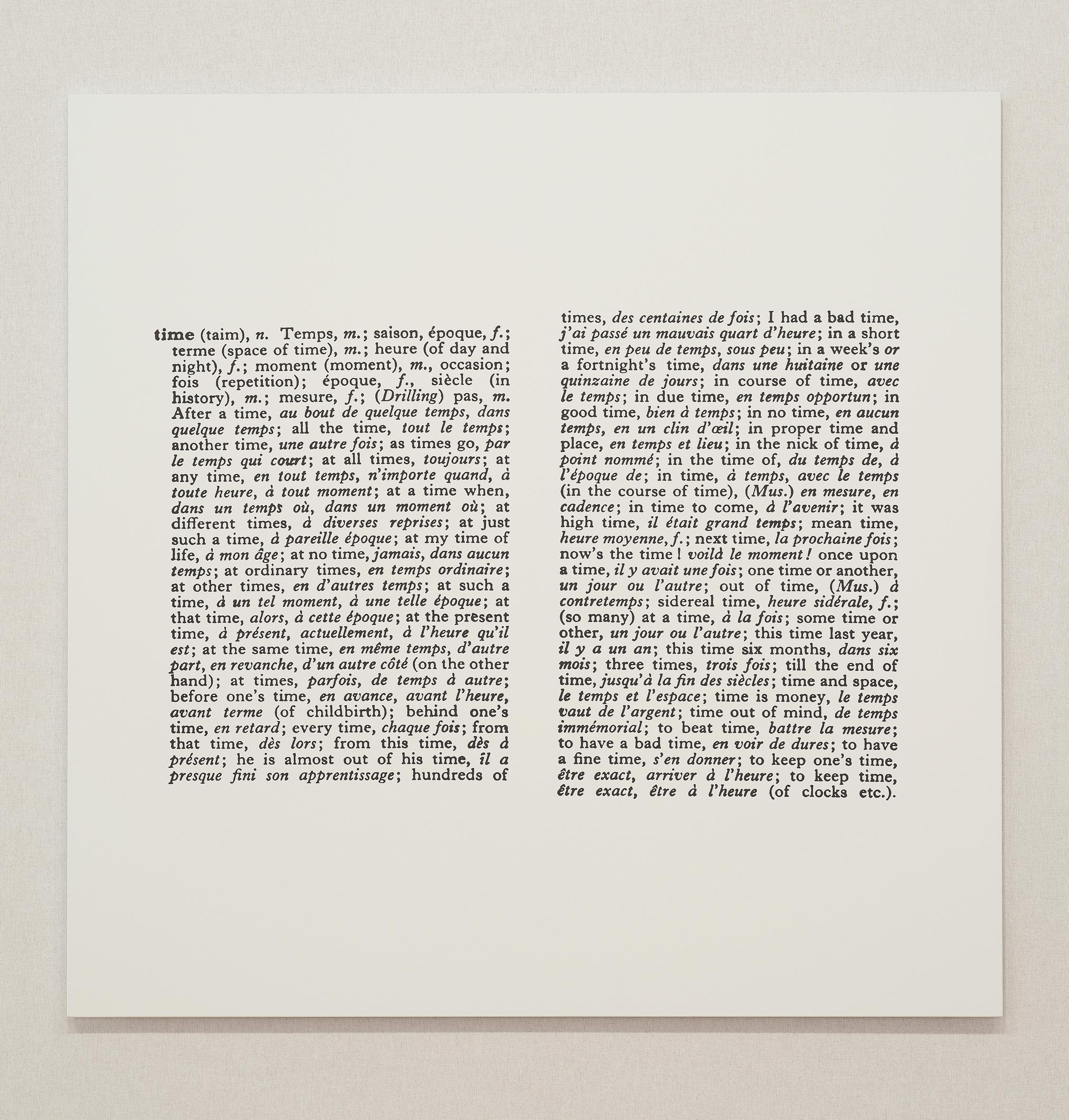
Gio PONTI (1891-1979)
Rare table basse - circa 1955
Un certificat des Archives Ponti sera remis à l’acquéreur.
Estimation : 60 000 - 80 000 €
Max INGRAND (1908-1969)
Lampadaire - circa 1960
Édition Fontana Arte
Estimation : 10 000 - 12 000 €
Vente Design Italien le 3 décembre 2025

Ventes en préparation
DESIGN
Ventes aux enchères :
Design Scandinave
Mercredi 19 novembre 2025 - 17h
Art Déco/Design Mardi 2 décembre 2025 - 16h
Design Italien
Mercredi 3 décembre 2025 - 16h
Contact : Sabrina Dolla sdolla@artcurial.com
+33 (0)1 42 99 16 40
www.artcurial.com

RAMMELLZEE (1960-2010)
The Coming of Zee - 1984
Gypse, résine, bois, peinture aérosol, pigments, billes et objets en plastique collés sur bois dans un cadre de l'artiste 110 × 313,6 cm
Estimation : 200 000 - 250 000 €
URBAN MASTERPIECES
Clôture du catalogue : Fin octobre
Vente aux enchères : Mercredi 26 novembre 2025 - 18h
7 rond-point des Champs-Élysées Marcel Dassault 75008 Paris
Contact : Arnaud Oliveux +33 (0)1 42 99 16 28 aoliveux@artcurial.com
www.artcurial.com

Fernando BOTERO (1932-2023)
Picnic - 2018
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite "Botéro 18" 117,50 × 185,50 cm
Estimation : 700 000 - 900 000 €
Vente en préparation
ART MODERNE & CONTEMPORAIN
Clôture du catalogue : Mi-octobre
Vente aux enchères : Mardi 9 décembre 2025 14h & 16h30
7 rond-point des Champs-Élysées Marcel Dassault 75008 Paris
Contact : Elodie Landais +33 (0)1 42 99 20 84
elandais@artcurial.com
www.artcurial.com

AUTOMOBILE LEGENDS
Clôture du catalogue : Fin décembre
En partenariat avec
Vente aux enchères : Mardi 27 janvier 2026
The Peninsula Paris
Contact : motorcars@artcurial.com +33 (0)1 42 99 20 73 www.artcurial.com

TO BE LIVED
Carlton Cannes invites you to live fully the French Riviera life! Located in the beating heart of the Cote d’Azur, this upper luxury resort is a destination in itself. From signature suites to stylish residences, luxuriant garden to exquisite restaurants, and legendary beach club to cuttingedge boxing ring, a festive collection of experiences awaits to create everlasting memories.


CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
ARTCURIAL SAS
Artcurial SAS est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régie par les articles L 321-4 et suivant du Code de commerce. En cette qualité Artcurial SAS agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Les rapports entre Artcurial SAS et l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou oraux avant la vente et qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.
En tant qu’opérateur de ventes volontaires, ARTCURIAL SAS est assujetti aux obligations listées aux articles L.561-2 14° et suivants du Code Monétaire et Financier relatifs à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
1 . LE BIEN MIS EN VENTE
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions. Artcurial SAS se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par Artcurial SAS de sa perception du lot, mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait.
c) Les indications données par Artcurial SAS sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement la mention de quelques défauts n’implique pas l’absence de tout autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; les conversions peuvent à cette occasion être arrondies différemment des arrondissements légaux.
e) Les biens d’occasion (tout ce qui n’est pas neuf) ne bénéficient pas de la garantie légale de conformité conformément à l’article L 217-2 du Code de la consommation.
2 . LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître auprès d’Artcurial SAS, avant la vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles. Artcurial SAS se réserve le droit de demander à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que de ses références bancaires et d’effectuer un déposit. Artcurial SAS se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de tout acquéreur potentiel pour justes motifs. Une enchère est acceptée au regard des informations transmises par l'encherisseur avant la vente. En conséquence, aucune modification du nom de l'adjudicataire ne pourra intervenir après la vente.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler personnellement et immédiatement le prix d’adjudication augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par Artcurial SAS.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de vente. Toutefois Artcurial SAS pourra accepter gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente. Artcurial SAS ne pourra engager sa responsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives à la réception des enchères par téléphone. À toutes fins utiles, Artcurial SAS se réserve le droit d’enregistrer les communications téléphoniques durant la vente. Les enregistrements seront conservés jusqu’au règlement du prix, sauf contestation.
d) Artcurial SAS pourra accepter gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente, pour lesquels elle se réserve le droit de demander un déposit de garantie et qu’elle aura acceptés. Si le lot n’est pas adjugé à cet enchérisseur, le déposit de garantie sera renvoyé sous 72h. Si Artcurial SAS reçoit plusieurs ordres pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré. Artcurial SAS ne pourra engager sa responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, Artcurial SAS se réserve le droit de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.En revanche le vendeur n’est pas autorisé à porter lui-même des enchères directement ou par le biais d’un mandataire.Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse figurant dans le catalogue ou modifié publiquement avant la vente.
f) Artcurial SAS dirigera la vente de façon discrétionnaire, en veillant à la liberté des enchères et à l’égalité entre l’ensemble des enchérisseurs, tout en respectant les usages établis.Artcurial SAS se réserve de refuser toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.En cas de contestation Artcurial SAS se réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour Artcurial SAS, l’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, éventuellement stipulé. Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu. L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement de l’intégralité du prix. en cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement. Artcurial SAS se réserve le droit de ne délivrer le lot qu’après encaissement du chèque. Le lot non adjugé pourra être vendu après la vente dans les conditions de la loi sous réserve que son prix soit d’au moins 1.500 euros.
h) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, Artcurial SAS pourra être conduit à utiliser à titre indicatif un système de conversion de devises. Néanmoins les enchères ne pourront être portées en devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager la responsabilité de Artcurial SAS.
3 . L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par lot et par tranche dégressive les commissions et taxes suivantes:
1) Lots en provenance de l’UE:
• De 1 à 850 000 euros: 27 % + TVA au taux en vigueur.
• De 850 001 à 6 000 000 euros: 21 % + TVA au taux en vigueur.
• Au-delà de 6 000 001 euros: 14,5 % + TVA au taux en vigueur.
2) Lots en provenance hors UE : (indiqués par un m): Œuvres d’art, antiquités et biens de collection: L’adjudication sera portée hors taxe. A cette adjudication sera ajoutée une TVA au taux réduit de 5,5% qui pourra être rétrocédée à l’adjudicataire sur présentation d'un justificatif d’exportation hors UE ou à l’adjudicataire UE justifiant d’un numéro de TVA intracommunautaire et d’un document prouvant la livraison dans son état membre. Les commissions et taxes indiquées au paragraphe 1) ci-dessus demeurent identiques.
3) Lots en provenance hors UE (indiqués par un m) Bijoux et Montres, Vins et Spiritueux, Multiples: Aux commissions et taxes indiquées au paragraphe 1) ci-dessus, il conviendra d’ajouter des frais liés à l’importation correspondant à 20% du prix d’adjudication.
4) Des frais additionnels seront facturés aux adjudicataires ayant enchérit en ligne par le biais de plateformes Internet autres qu’ARTCURIAL LIVE.
5) La TVA sur commissions et les frais liés à l’importation pourront être rétrocédés à l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation hors UE.L’adjudicataire UE justifiant d’un n° de TVA Intracommunautaire et d’un document prouvant la livraison dans son état membre pourra obtenir le remboursement de la TVA sur commissions.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants : - En espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants français et les personnes agissant pour le compte d’une entreprise, 15 000 euros frais et taxe compris pour les ressortissants étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité ; - Par chèque bancaire tiré sur une banque française sur présentation d’une pièce d’identité et, pour toute personne morale, d’un extrait KBis daté de moins de 3 mois (les chèques tirés sur une banque étrangère ne sont pas acceptés);
- Par virement bancaire ;
- Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD ou AMEX (en cas de règlement par carte American Express, une commission supplémentaire de 1,85 % correspondant aux frais d’encaissement sera perçue).
6) La répartition entre prix d’adjudication et commissions peut-être modifiée par convention particulière entre le vendeur et Artcurial sans conséquence pour l’adjudicataire.
b) Artcurial SAS sera autorisé à reproduire sur le procès-verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication engagera la responsabilité de l’adjudicataire. Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la vente, il devra communiquer les renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée. Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de Artcurial SAS dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données nominatives fournies à Artcurial SAS dans les conditions de la Loi du 6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre Artcurial SAS, dans l’hypothèse où par suite du vol, de la perte ou de la dégradation de son lot, après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de l’assureur de Artcurial SAS serait avérée insuffisante.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, des frais et des taxes. En cas de règlement par chèque, le lot ne sera délivré qu’après encaissement définitif du chèque, soit 8 jours ouvrables à compter du dépôt du chèque. A compter du lundi suivant le 90e jour après la vente, le lot acheté réglé ou non réglé restant dans l’entrepôt, fera l’objet d’une facturation de 50€ HT par semaine et par lot, toute semaine commencée étant due dans son intégralité au titre des frais d’entreposage et d’assurance.À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant. En outre, Artcurial SAS se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix : - Des intérêts au taux légal majoré de cinq points, - Le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance, - Le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
Artcurial SAS se réserve également de procéder à toute compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant. Artcurial SAS se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions générales d’achat.
e) Sous réserve de dispositions spécifiques à la présente vente, les achats qui n’auront pas été retirés dans les sept jours de la vente (samedi, dimanche et jours fériés compris), pourront être transportés dans un lieu de conservation aux frais de l’adjudicataire défaillant qui devra régler le coût correspondant pour pouvoir retirer le lot, en sus du prix, des frais et des taxes.
f) L’acquéreur pourra se faire délivrer à sa demande un certificat de vente qui lui sera facturé la somme de 60 euros TTC.
4 . LES INCIDENTS DE LA VENTE
En cas de contestation Artcurial SAS se réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors de ventes, Artcurial SAS pourra utiliser des moyens vidéos. en cas d’erreur de manipulation pouvant conduire pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur lequel les enchères sont portées, Artcurial SAS ne pourra engager sa responsabilité, et sera seul juge de la nécessité de recommencer les enchères.
5 . PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’état français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le représentant de l’état manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.
Artcurial SAS ne pourra être tenu pour responsable des conditions de la préemption par l’état français.
6 . PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE – REPRODUCTION DES ŒUVRES
Artcurial SAS est propriétaire du droit de reproduction de son catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre Artcurial SAS dispose d’une dérogation lui permettant de reproduire dans son catalogue les œuvres mises en vente, alors même que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de Artcurial SAS peut donc constituer une reproduction illicite d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en contrefaçon par le titulaire des droits sur l’œuvre. La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son propriétaire le droit de reproduction et de présentation de l’œuvre.
7. BIENS SOUMIS À UNE LÉGISLATION PARTICULIÈRE
La réglementation internationale du 3 mars 1973, dite Convention de Washington a pour effet la protection de specimens et d’espèces dits menacés d’extinction. Les termes de son application diffèrent d’un pays à l’autre. Il appartient à tout acheteur de vérifier, avant d’enchérir, la législation appliquée dans son pays à ce sujet. Tout lot contenant un élément en ivoire, en palissandre…quelle que soit sa date d’exécution ou son certificat d’origine, ne pourra être importé aux Etats-Unis, au regard de la législation qui y est appliquée. Il est indiqué par un (s).
8 . RETRAIT DES LOTS
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Artcurial SAS décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée. Toutes les formalités et transports restent à la charge exclusive de l’acquéreur.
9 . INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.
10 . COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat. Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par le tribunal judiciaire compétent du ressort de Paris (France).
Le Conseil des Ventes Volontaires, 19 avenue de l’Opéra – 75001 Paris peut recevoir des réclamations en ligne (www.conseildesventes.fr, rubrique « Réclamations en ligne »).
PROTECTION DES BIENS CULTURELS
Artcurial SAS participe à la protection des biens culturels et met tout en œuvre, dans la mesure de ses moyens, pour s’assurer de la provenance des lots mis en vente dans ce catalogue.
CONDITIONS OF PURCHASE IN VOLUNTARY AUCTION SALES
ARTCURIAL
Artcurial SAS is an operator of voluntary auction sales regulated by the law articles L321-4 and following of the Code de Commerce. In such capacity Artcurial SAS acts as the agent of the seller who contracts with the buyer. The relationships between Artcurial SAS and the buyer are subject to the present general conditions of purchase which can be modified by saleroom notices or oral indications before the sale, which will be recorded in the official sale record.
As a voluntary auction sales operator, ARTCURIAL SAS is subject to the obligations listed in articles L.561-2 14° and seq. of the French Monetary and Financial Code relating to the Anti Money Laundering regulation.
1. GOODS FOR AUCTION
a) The prospective buyers are invited to examine any goods in which they may be interested, before the auction takes place, and notably during the exhibitions. Artcurial SAS is at disposal of the prospective buyers to provide them with reports about the conditions of lots.
b) Description of the lots resulting from the catalogue, the reports, the labels and the verbal statements or announcements are only the expression by Artcurial SAS of their perception of the lot, but cannot constitute the proof of a fact.
c) The statements by made Artcurial SAS about any restoration, mishap or harm arisen concerning the lot are only made to facilitate the inspection thereof by the prospective buyer and remain subject to his own or to his expert’s appreciation. The absence of statements Artcurial SAS by relating to a restoration, mishap or harm, whether made in the catalogue, condition reports, on labels or orally, does not imply that the item is exempt from any current, past or repaired defect. Inversely, the indication of any defect whatsoever does not imply the absence of any other defects.
d) Estimates are provided for guidance only and cannot be considered as implying the certainty that the item will be sold for the estimated price or even within the bracket of estimates.
Estimates cannot constitute any warranty assurance whatsoever.
The estimations can be provided in several currencies ; the conversions may, in this case or, be rounded off differently than the legal rounding
e) Second-hand goods (anything that is not new) do not benefit from the legal guarantee of conformity in accordance with article L 217-2 of the Consumer Code.
2 . THE SALE
a) In order to assure the proper organisation of the sales, prospective buyers are invited to make themselves known to Artcurial SAS before the sale, so as to have their personal identity data recorded.
Artcurial SAS reserves the right to ask any prospective buyer to justify his identity as well as his bank references and to request a deposit.
Artcurial SAS reserves the right to refuse admission to the auction sales premises to any prospective buyer for legitimate reasons. A bid is accepted on the basis of the information provided by the bidder prior to the sale. Consequently, the name of the winning bidder cannot be changed after the sale.
b) Any person who is a bidder undertakes to pay personally and immediately the hammer price increased by the costs to be born by the buyer and any and all taxes or fees/expenses which could be due. Any bidder is deemed acting on his own behalf except when prior notification, accepted by Artcurial SAS, is given that he acts as an agent on behalf of a third party.
c) The usual way to bid consists in attending the sale on the premises. However, Artcurial SAS may graciously accept to receive some bids by telephone from a prospective buyer who has expressed such a request before the sale. Artcurial SAS will bear no liability / responsibility whatsoever, notably if the telephone contact is not made, or if it is made too late, or in case of mistakes or omissions relating to the reception of the telephone. For variety of purposes, Artcurial SAS reserves its right to record all the telephone communications during the auction. Such records shall be kept until the complete payment of the auction price, except claims.
d) Artcurial SAS may accept to execute orders to bid which will have been submitted before the sale and by Artcurial SAS which have been deemed acceptable. Artcurial SAS is entitled to request a deposit which will be refunded within 48hours after the sale if the lot id not sold to this buyer.
Should Artcurial SAS receive several instructions to bid for the same amounts, it is the instruction to bid first received which will be given preference.
Artcurial SAS will bear no liability/responsibility in case of mistakes or omission of performance of the written order.
e) In the event where a reserve price has been stipulated by the seller, Artcurial SAS reserves the right to bid on behalf of the seller until the reserve price is reached. The seller will not be admitted to bid himself directly or through an agent. The reserve price may not be higher than the low estimate for the lot printed in or publicly modified before the sale.
f) Artcurial SAS will conduct auction sales at their discretion, ensuring freedom auction and equality among all bidders, in accordance with established practices.
Artcurial SAS reserves the right to refuse any bid, to organise the bidding in such manner as may be the most appropriate, to move some lots in the course of the sale, to withdraw any lot in the course of the sale, to combine or to divide some lots in the course of the sale. In case of challenge or dispute, Artcurial SAS reserves the right to designate the successful bidder, to continue the bidding or to cancel it, or to put the lot back up for bidding.
g) Subject to the decision of the person conducting the bidding for Artcurial SAS, the successful bidder will be the bidder would will have made the highest bid provided the final bid is equal to or higher than the reserve price if such a reserve price has been stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance of the highest bid and the pronouncing of the word “adjugé” or any equivalent will amount to the conclusion of the purchase contract between the seller and the last bidder taken in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until full payment has been made.In case of payment by an ordinary draft/check, payment will be deemed made only when the check will have been cashed.
The lot not auctioned may be sold after the sale in accordance with the law, provided that its price is at least 1,500 euros.
h) So as to facilitate the price calculation for prospective buyers, a currency converter may be operated by Artcurial SAS as guidance. Nevertheless, the bidding cannot be made in foreign currency and Artcurial SAS will not be liable for errors of conversion.
3 . THE PERFORMANCE OF THE SALE
a) In addition of the lot’s hammer price, the buyer must pay the different stages of following costs and fees/taxes:
1) Lots from the EU:
• From 1 to 850,000 euros: 27 % + current VAT.
From 850,001 to 6,000,000 euros: 21 % + current VAT.
Over 6,000,001 euros: 14,5 % + current VAT.
2) Lots from outside the EU : (identified by an m). Works of art, Antiques and Collectors’items The hammer price will be VAT excluded to which should be added 5.5% VAT. Upon request, this VAT will be refunded to the purchaser on presentation of written proof of exportation outside the EU or to the EU purchaser who will submit his intracommunity VAT number and a proof of shipment of his purchase to his EU country home address. Commissions and taxes indicated in section 3.1) remain the same.
3) Lots from outside the EU (identified by an m): Jewelry and Watches, Wines and Spirits, Multiples In addition to the commissions and taxes specified in paragraph 1) above, an additional import VAT will be charged (20% of the hammer price).
4) Additional fees will be charged to bidders who bid online via Internet platforms other than ARTCURIAL LIVE.
5) VAT on commissions and importation expenses can be retroceded to the purchaser on presentation of written proof of exportation outside the EU.
An EU purchaser who will submit their intracommunity VAT number and a proof of shipment of their purchase to their EU country home address will be refunded of VAT on buyer’s premium.The payment of the lot will be made cash, for the whole of the price, costs and taxes, even when an export licence is required. The purchaser will be authorized to pay by the following means :
- In cash : up to 1 000 euros, costs and taxes included, for French citizens and people acting on behalf of a company, up to 15 000 euros, costs and taxes included, for foreign citizens on presentation of their identity papers ;
- By cheque drawn on a French bank on presentation of identity papers and for any company, a KBis dated less than 3 months (cheques drawn on a foreign bank are not accepted);
- By bank transfer;
- By credit card : VISA, MASTERCARD or AMEX (in case of payment by AMEX, a 1,85 % additional commission corresponding to cashing costs will be collected).
6)The distribution between the lot's hammer price and cost and fees can be modified by particular agreement between the seller and Artcurial SAS without consequence for the buyer.
b) Artcurial SAS will be authorized to reproduce in the official sale record and on the bid summary the information that the buyer will have provided before the sale. The buyer will be responsible for any false information given. Should the buyer have neglected to give his personal information before the sale, he will have to give the necessary information as soon as the sale of the lot has taken place.
Any person having been recorded by Artcurial SAS has a right of access and of rectification to the nominative data provided to Artcurial SAS pursuant to the provisions of Law of the 6 July 1978.
c) The lot must to be insured by the buyer immediately after the purchase. The buyer will have no recourse against Artcurial SAS, in the event where, due to a theft, a loss or a deterioration of his lot after the purchase, the compensation he will receive from the insurer of Artcurial SAS would prove insufficient.
d) The lot will be delivered to the buyer only after the entire payment of the price, costs and taxes. If payment is made by cheque, the lot will be delivered after cashing, eight working days after the cheque deposit. If the buyer has not settled his invoice yet or has not collected his purchase, a fee of 50€+VAT per lot, per week (each week is due in full) covering the costs of insurance and storage will be charged to the buyer, starting on the first Monday following the 90th day after the sale. Should the buyer fail to pay the amount due, and after notice to pay has been given by Artcurial SAS to the buyer without success, at the seller’s request, the lot is re-offered for sale, under the French procedure known as “procédure de folle enchère”. If the seller does not make this request within three months from the date of the sale, the sale will be automatically cancelled, without prejudice to any damages owed by the defaulting buyer.
In addition, Artcurial SAS reserves the right to claim against the defaulting buyer, at their option :
- interest at the legal rate increased by five points,
- the reimbursement of additional costs generated by the buyer’s default,
- the payment of the difference between the initial hammer price and the price of sale after “procédure de folle enchère” if it is inferior as well as the costs generated by the new auction.
Artcurial SAS also reserves the right to set off any amount Artcurial SAS may owe the defaulting buyer with the amounts to be paid by the defaulting buyer.
Artcurial SAS reserves the right to exclude from any future auction, any bidder who has been a defaulting buyer or who has not fulfilled these general conditions of purchase.
e) With reservation regarding the specific provisions of this sale, for items purchased which are not collected within seven days from after the sale (Saturdays, Sundays and public holidays included), Artcurial SAS will be authorized to move them into a storage place at the defaulting buyer’s expense, and to release them to same after payment of corresponding costs, in addition to the price, costs and taxes.
f) The buyer can obtain upon request a certificate of sale which will be invoiced € 60.
4. THE INCIDENTS OF THE SALE
In case of dispute, Artcurial SAS reserves the right to designate the successful bidder, to continue the sale or to cancel it or to put the lot up for sale.
a) In case two bidders have bidden vocally, by mean of gesture or by telephone for the same amount and both claim title to the lot, after the bidding the lot, will immediately be offered again for sale at the previous last bid, and all those attending will be entitled to bid again.
b) So as to facilitate the presentation of the items during the sales, Artcurial SAS will be able to use video technology. Should any error occur in operation of such, which may lead to show an item during the bidding which is not the one on which the bids have been made, Artcurial SAS shall bear no liability/responsibility whatsoever, and will have sole discretion to decide whether or not the bidding will take place again.
5 . PRE-EMPTION OF THE FRENCH STATE
The French state in entitled to use a right of pre-emption on works of art, pursuant to the rules of law in force.
The use of this right comes immediately after the hammer stroke, the representative of the French state expressing then the intention of the State to substitute for the last bidder, provided he confirms the pre-emption decision within fifteen days.
Artcurial SAS will not bear any liability/ responsibility for the conditions of the pre-emption by the French State.
6 . INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT - COPYRIGHT
The copyright in any and all parts of the catalogue is the property of Artcurial SAS. Any reproduction thereof is forbidden and will be considered as counterfeiting to their detriment.
Furthermore, Artcurial SAS benefits from a legal exception allowing them to reproduce the lots for auction sale in their catalogue, even though the copyright protection on an item has not lapsed.
Any reproduction of Artcurial SAS catalogue may therefore constitute an illegal reproduction of a work which may lead its perpetrator to be prosecuted for counterfeiting by the holder of copyright on the work.The sale of a work of art does not transfer to its buyer any reproduction or representation rights thereof.
7 . ITEMS FALLING WITHIN THE SCOPE OF SPECIFIC RULES
The International regulation dated March 3rd 1973, protects endangered species and specimen. Each country has its own lawmaking about it. Any potential buyer must check before bidding, if he is entitled to import this lot within his country of residence. Any lot which includes one element in ivory, rosewood…cannot be imported in the United States as its legislation bans its trade whatever its dating may be. It is indicated by a (s).
8. REMOVAL OF PURCHASES
The buyer has to insure its purchase, and Artcurial SAS assumes no liability for any damage items which may occur after the sale. All transportation arrangements are the sole responsibility of the buyer.
9. SEVERABILITY
The clauses of these general conditions of purchase are independant from each other. Should a clause whatsoever be found null and void, the others shall remain valid and applicable.
10. LAW AND JURISDICTION
In accordance with the law, it is added that all actions in public liability instituted on the occasion of valuation and of voluntary and court-ordered auction sales are barred at the end of five years from the hammer price or valuation.
These Conditions of purchase are governed by French law exclusively. Any dispute relating to their existence, their validity and their binding effect on any bidder or buyer shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts of France. The Conseil des Ventes Volontaires, 19 avenue de l’Opéra – 75001 Paris can receive online claims (www.conseildesventes.fr, section “Online claims”).
PROTECTION OF CULTURAL PROPERTY
Artcurial SAS applies a policy to prevent the sale of looted or stolen cultural property.
ARTS DES XXe & XXIe SIÈCLES
Directrice du pôle,
Vice-présidente : Isaure de Viel Castel
Art Contemporain Africain
Spécialiste : Margot Denis-Lutard, 16 44
Art-Déco / Design
Directrice : Sabrina Dolla, 16 40
Spécialiste :
Edouard Liron, 20 37
Administratrice senior :
Anne-Claire Drauge, 20 42
Administratrice : Domitilla Giordano
Expert :
Justine Despretz
Consultants :
Design Italien :
Design Scandinave : Aldric Speer
Bandes Dessinées
Expert : Éric Leroy
Administrateur junior : Alexandre Dalle
Estampes & Multiples
Directrice : Karine Castagna
Administrateur - catalogueur : Florent Sinnah, 16 54
Administrateur junior : Alexandre Dalle
Impressionniste & Moderne
Directeur : Bruno Jaubert
Spécialiste :
Florent Wanecq
Catalogueurs
Recherche et certificat :
Jessica Cavalero, Louise Eber
Administratrice - catalogueur:
Élodie Landais, 20 84
Administratrice junior : Alexandra Michel
Photographie
Catalogueur : Sara Bekhedda, 20 25
Post-War & Contemporain
Directeur : Hugues Sébilleau
Spécialiste : Sophie Cariguel
Catalogueurs
Recherche et certificat : Jessica Cavalero
Louise Eber
Catalogueur : Sara Bekhedda
Administratrice :
Beatrice Fantuzzi, 20 34
Urban Art
Directeur : Arnaud Oliveux
Administrateur - catalogueur: Florent Sinnah, 16 54
Administrateur junior : Alexandre Dalle
Expositions culturelles & ventes privées
Chef de projet : Vanessa Favre, 16 13
ARTS CLASSIQUES
Archéologie & Arts d’Orient
Spécialiste : Lamia Içame, 20 75
Administratrice sénior : Solène Carré
Expert Art de l’Islam : Romain Pingannaud
Art d’Asie
Expert : Qinghua Yin
Administratrice : Shenying Chen, 20 32
Livres & Manuscrits
Directeur : Frédéric Harnisch, 16 49
Administratrice : Émeline Duprat, 16 58
Maîtres anciens & du XIXe siècle : Tableaux, dessins, sculptures, cadres anciens et de collection
Vice-président : Matthieu Fournier, 20 26
Catalogueur : Blanche Llaurens
Spécialiste : Matthias Ambroselli
Administratrice sénior : Margaux Amiot, 20 07
Administratrice : Léa Pailler, 20 07
Mobilier & Objets d’Art
Directeur : Filippo Passadore
Clerc assistant : Barthélémy Kaniuk
Administratrice : Charlotte Norton, 20 68
Expert céramiques : Cyrille Froissart
Experts orfèvrerie :
S.A.S. Déchaut-Stetten & associés, Marie de Noblet
Thierry de la Chaise : Senior advisor - Spécialiste senior orfèvrerie 06 75 02 62 94
Orientalisme
Directeur : Olivier Berman, 20 67
Spécialiste junior : Florence Conan, 16 15
Souvenirs Historiques & Armes Anciennes
Expert armes : Arnaud de Gouvion Saint-Cyr
Contact : Maxence Miglioretti, 20 02
Numismatique / Philatélie / Objets de curiosités & Histoire naturelle
Expert numismatique : Cabinet Bourgey
Contact : Juliette Leroy-Prost, 17 10
ARTCURIAL MOTORCARS
Automobiles de Collection
Président : Matthieu Lamoure
Vice-président : Pierre Novikoff
Spécialiste sénior : Antoine Mahé, 20 62
Responsable des relations
clients Motorcars : Anne-Claire Mandine, 20 73
Responsable des opérations et de l’administration :
Sandra Fournet +33 (0)1 58 56 38 14
Administrateur junior : Jeremy Carvalho
Consultant : Frédéric Stoesser motorcars@artcurial.com
Automobilia
Aéronautique, Marine
Président : Matthieu Lamoure
Responsable : Sophie Peyrache, 20 41
LUXE & ART DE VIVRE
Horlogerie de Collection
Directeur : Romain Marsot
Expert : Geoffroy Ader
Administratrice junior : Charlotte Christien, 16 51
Joaillerie
Directrice : Valérie Goyer
Spécialiste junior : Antoinette Rousseau
Catalogueur : Pauline Hodée
Administratrice junior : Janelle Beau, 20 52
Mode & Accessoires de luxe
Catalogueur : Victoire Debreil
Administratrice : Emilie Martin, +33 1 58 56 38 12
Stylomania
Contact : Juliette Leroy-Prost, 17 10
Vins fins & Spiritueux
Expert : Laurie Matheson
Spécialiste : Marie Calzada, 20 24
Administratrice sénior : Solène Carré
Consultant : Luc Dabadie vins@artcurial.com
INVENTAIRES & COLLECTIONS
Vice-président :
Stéphane Aubert
Chargés d'inventaires, Commissaires-priseurs :
Juliette Leroy-Prost, 17 10
Maxence Miglioretti, 20 02
Elisa Borsik, 20 18
Administrateurs : Thomas Loiseaux, 16 55
Charline Monjanel, 20 33
Consultante : Catherine Heim
Directrice des partenariats : Marine de Miollis
COMMISSAIRESPRISEURS HABILITÉS
Stéphane Aubert
Elisa Borsik
Francis Briest
Matthieu Fournier
Juliette Leroy-Prost
Anne-Claire Mandine
Maxence Miglioretti
Arnaud Oliveux
Hervé Poulain
Florent Wanecq
FRANCE
Cannes - Alpes-Maritimes
Représentante : Eléonore Dauzet edauzet@artcurial.com +33 (0)6 65 26 03 39
Montpellier
Geneviève Salasc de Cambiaire +33 (0)6 09 78 31 45 gsalasc@artcurial.com
Région Aquitaine
Directrice : Julie Valade jvalade@artcurial.com
Région Rhône-Alpes
Représentant : François David +33 (0)6 95 48 92 75 fdavid@artcurial.com
Strasbourg
Frédéric Gasser +33 (0)6 88 26 97 09 fgasser@artcurial.com
Artcurial Toulouse
Jean-Louis Vedovato
Commissaire-priseur : Jean-Louis Vedovato
Clerc principal : Valérie Vedovato
8, rue Fermat – 31000 Toulouse +33 (0)5 62 88 65 66 v.vedovato@artcurialtoulouse.com
RTCURIAL
7, rond-point des Champs-Élysées Marcel Dassault 75008 Paris
T. +33 (0)1 42 99 20 20
F. +33 (0)1 42 99 20 21 contact@artcurial.com www.artcurial.com
SAS au capital de 1 797 000 € Agrément n° 2001-005
Tous les emails des collaborateurs d’Artcurial s’écrivent comme suit : initiale(s) du prénom et nom @artcurial.com, par exemple : Anne-Laure Guérin: alguerin@artcurial.com
Les numéros de téléphone des collaborateurs d’Artcurial se composent comme suit : +33 1 42 99 xx xx. Dans le cas contraire, les numéros sont mentionnés en entier.
INTERNATIONAL
International senior
advisor :
Martin Guesnet, 20 31
Allemagne
Directrice : Miriam Krohne
Assistante : Caroline Weber
Galeriestrasse 2b 80539 Munich
+49 89 1891 3987
Belgique
Directrice : Vinciane de Traux
Fine Art Business Developer: Simon van Oostende
Office ManagerPartnerships & Events: Magali Giunta 5, avenue Franklin Roosevelt 1050 Bruxelles +32 2 644 98 44
Chine
Consultante : Jiayi Li 798 Art District, No 4 Jiuxianqiao Lu Chaoyang District
Beijing 100015
+86 137 01 37 58 11 lijiayi7@gmail.com
Italie
Directrice : Emilie Volka
Assistante : Eleonora Ballista
Corso Venezia, 22 20121 Milano
+39 02 49 76 36 49
Artcurial Maroc
Directeur : Olivier Berman
Directrice administrative: Soraya Abid
Administratrices junior: Lamyae Belghiti
Widad Outmghart
Résidence AsmarAvenue Mohammed VI
Rue El Adarissa - Hivernage 40020 Marrakech
+212 524 20 78 20
Artcurial Monaco
Directrice : Olga de Marzio
Assistante administrative : Joëlle Iseli
Monte-Carlo Palace
3/9 boulevard des Moulins 98000 Monaco
+377 97 77 51 99
ARTCURIAL BEURRET BAILLY WIDMER
Bâle
Schwarzwaldallee 171 4058 Bâle
+41 61 312 32 00 info@bbw-auktionen.com
Saint-Gall
Unterstrasse 11
9001 Saint-Gall
+41 71 227 68 68 info@galeriewidmer.com
Zurich
Kirchgasse 33
8001 Zurich
+41 43 343 90 33 info@bbw-auktionen.com
COMITÉ EXÉCUTIF
Nicolas Orlowski
Matthieu Lamoure
Joséphine Dubois
Stéphane Aubert
Matthieu Fournier
Bruno Jaubert
Isaure de Viel Castel
ASSOCIÉS
Directeurs associés :
Stéphane Aubert
Olivier Berman
Sabrina Dolla
Matthieu Fournier
Bruno Jaubert
Matthieu Lamoure
Arnaud Oliveux
Hugues Sébilleau
Julie Valade
Conseiller scientifique et culturel :
Serge Lemoine
Commissaire-priseur, Co-fondateur
Francis Briest
GROUPE ARTCURIAL SA
Président directeur général : Nicolas Orlowski
Directrice générale adjointe : Joséphine Dubois
Président d’honneur : Hervé Poulain
Conseil d’administration : Francis Briest
Olivier Costa de Beauregard
Natacha Dassault
Thierry Dassault
Carole Fiquémont
Marie-Hélène Habert
Nicolas Orlowski
Hervé Poulain
JOHN TAYLOR
Président directeur général: Nicolas Orlowski
John Taylor Corporate, Europa Résidence, Place des Moulins, 98000 Monaco contact@john-taylor.com www.john-taylor.fr
ARQANA
Artcurial Deauville 32, avenue Hocquart de Turtot 14800 Deauville
+33 (0)2 31 81 81 00 info@arqana.com www.arqana.com
ADMINISTRATION ET GESTION
Directrice générale adjointe, administration et finances : Joséphine Dubois
Assistante : Emmanuelle Roncola
Responsable service juridique clients : Léonor Augier
Ordres d’achat, enchères par téléphone
Directrice : Kristina Vrzests, 20 51 Adjointe de la Directrice :
Marie Auvard
Administratrice : Maëlle Touminet
Administrateur junior : Théo-Paul Boulanger bids@artcurial.com
Comptabilité des ventes
Responsable : Nathalie Higueret
Comptable des ventes confirmée : Audrey Couturier
Comptables : Chloé Catherine
Mathilde Desforges
Jessica Sellahannadi Yugyeong Shon 20 71 ou 17 00
Gestionnaire de dossier : Melanie Joly
Transport et douane
Responsable : Marine Viet, 16 57
Adjointe : Marine Renault, 17 01 Assistantes spécialisées : Lou Dupont, Inès Tekirdaglioglu shipping@artcurial.com
Logistique et gestion des stocks
Directeur : Éric Pourchot
Responsables de stock : Lionel Lavergne
Joël Laviolette
Vincent Mauriol
Lal Sellahanadi
Adjoint : Clovis Cano
Coordinatrices logistique: Victoire de Latour
Magasiniers : Denis Chevallier
Adrien da Costa
Isaac Dalle
Floriane Joffre
Brayan Monteiro
Jason Tilot
Marketing
Directrice : Lorraine Calemard, 20 87
Chefs de projet : Domitilla Corti, 01 42 25 64 38
Ariane Gilain, 16 52
Daphné Perret, 16 23
Responsable Studio Graphique: Aline Meier, 20 88
Graphiste : Rose de La Chapelle, 20 10
Graphiste junior : Romane Marliot, 01 42 25 93 83
Responsable
CRM : Alexandra Cosson
Chargée CRM : Géraldine de Mortemart, 20 43
Analyste CRM junior : Colombine Santarelli
Relations Extérieures
Directrice : Anne-Laure Guérin, 20 86
Attachée de presse : Deborah Bensaid, 20 76
Community Manager : Maria Franco Baqueiro, 20 82
Comptabilité générale
Responsable : Sandra Margueritat Lefevre
Comptables :
Romane Herson
Jodie Hoang
Arméli Itoua
Aïcha Manet
Assistante de gestion : Solène Sapience
Responsable administrative des ressources humaines : Isabelle Chênais, 20 27
Assistante : Amandine Le Monnier 20 79
Bureau d’accueil
Responsable accueil, Clerc Live et PV : Denis Le Rue
Mizlie Bellevue
Théa Fayolle
Marie Peyroche
Services généraux
Responsable : Denis Le Rue
Service photographique des catalogues
Fanny Adler
Stéphanie Toussaint
Régisseur : Mehdi Bouchekout
ORDRE D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM
Selected 20/21 - Arts des XXe - XIXe siècles
Vente n°6195
Samedi 25 octobre 2025 – 16h Paris — 7, rond-point des Champs-Élysées Marcel Dassault
Ordre d’achat / Absentee bid
Ligne téléphonique / Telephone (Pour tout lot dont l’estimation est supérieure à 500 euros For lots estimated from € 500 onwards)
Téléphone pendant la vente / Phone at the time of the sale:
Nom / Name :
Prénom / First name : Société / Compagny : Adresse / Address :
Téléphone / Phone : Fax :
Email :
Lot Description du lot / Lot description
Les ordres d'achat et les demandes d'enchères téléphoniques doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente. Le service d'enchères téléphoniques est proposé pour les lots dont l’estimation basse est supérieure à 500€.
To allow time for processing, absentee bids and requests for telephone bidding should be received at least 24 hours before the sale begins. Telephone bidding is a service provided by Artcurial for lots with a low estimate above 500€.
À renvoyer / Please mail to :
Artcurial SAS 7 rond-point des Champs-Élysées Marcel Dassault - 75008 Paris Fax : +33 (0)1 42 99 20 60 bids@artcurial.com
Merci de bien vouloir joindre à ce formulaire une copie de votre pièce d’identité (passeport ou carte nationale d’identité), si vous enchérissez pour le compte d’une société, merci de joindre un extrait KBIS de moins de 3 mois. Could you please provide a copy of your id or passport? If you bid on behalf of a company, could you please provide an act of incorporation?
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (les limites ne comprenant pas les frais légaux).
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant your permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).
Limite en euros / Max. euros price
Date et signature obligatoire / Required dated signature
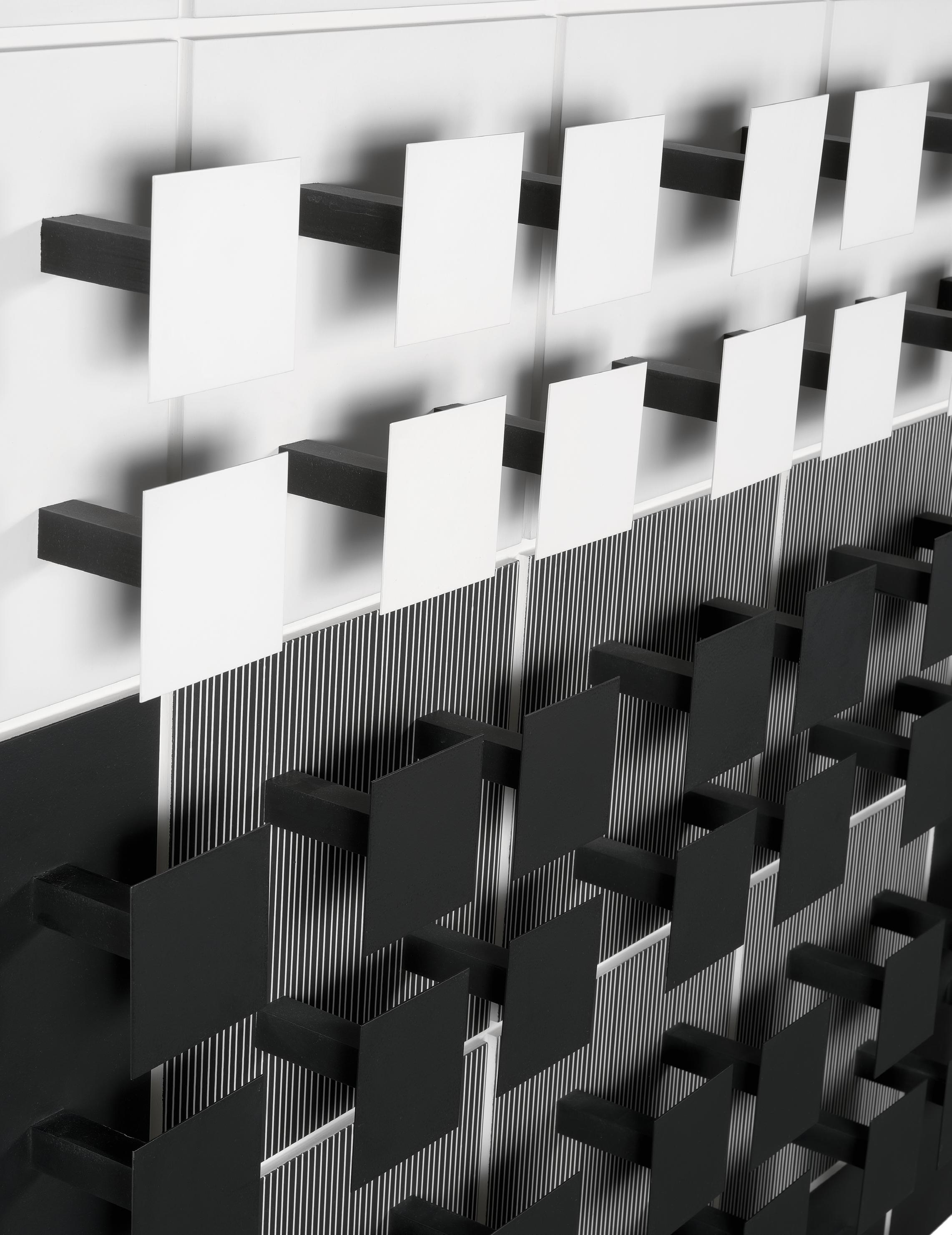
Lot 17, Jesús Rafael Soto, Relación negra y blanca, 1972 (détail), p.94
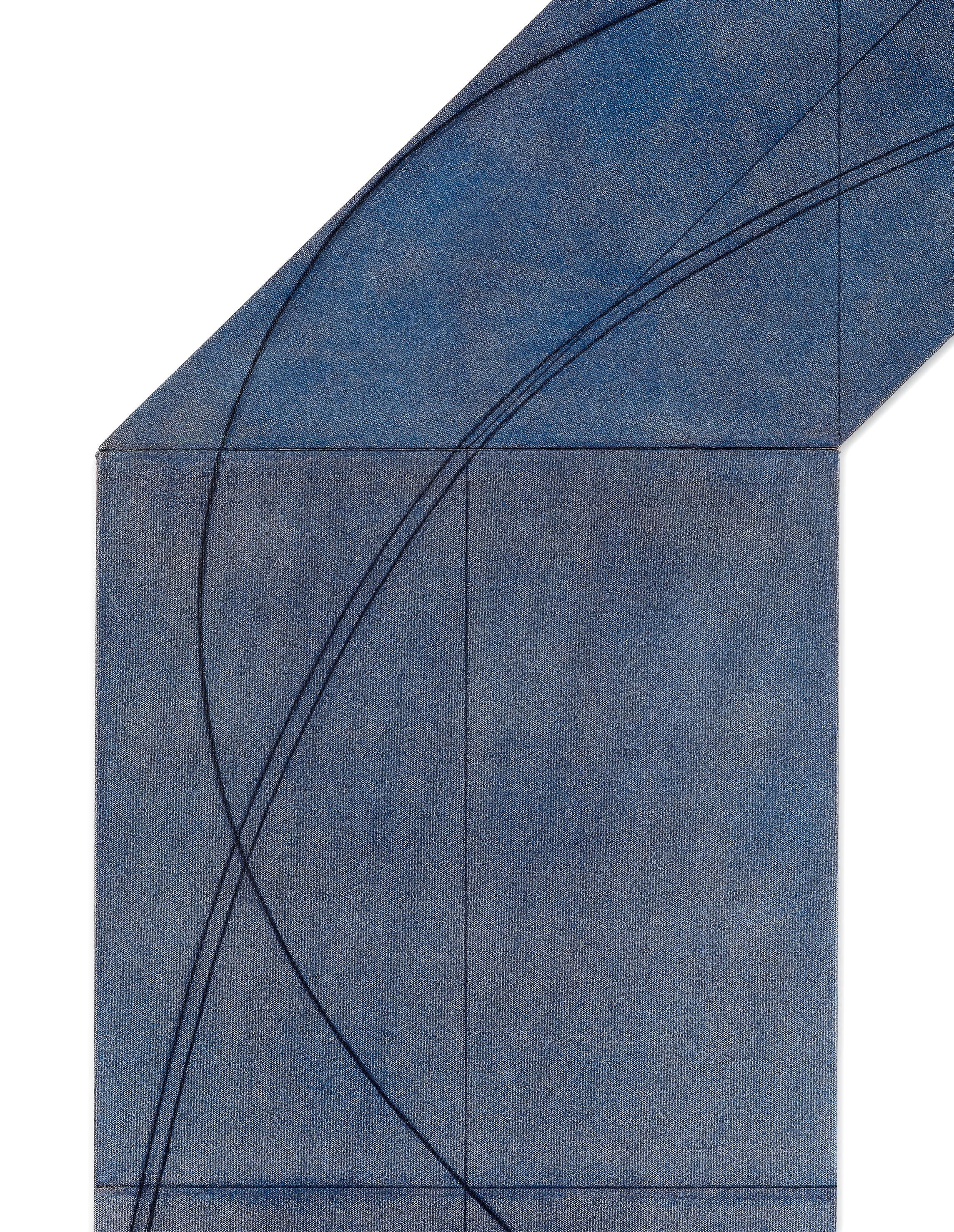
Lot 27, Robert Mangold, Column Structure XXI A, 2007 (détail), p. 144

Lot 14, Jean Hélion, Le jugement dernier des choses, circa 1978–1979 (détail), p. 76

Lot 19, Georges Mathieu, Diapré, 1965 (détail), p. 104

Lot 23, Ossip Zadkine, La Force atomique, circa 1963-1966 (détail), p. 122
Samedi 25 octobre 2025 – 16h artcurial.com