










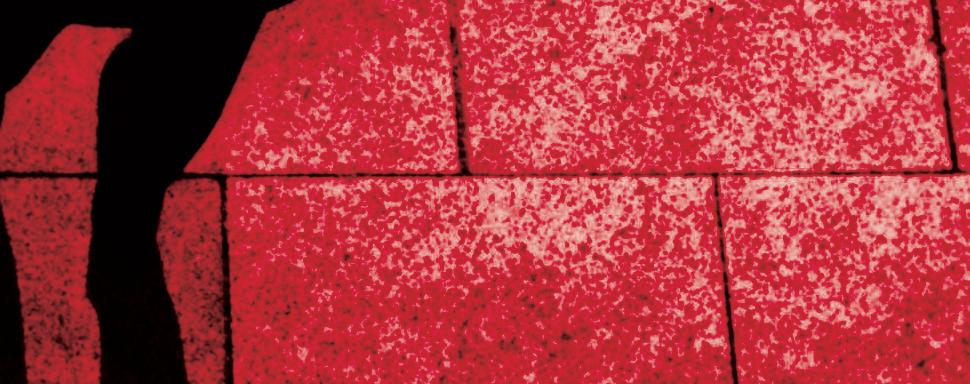



actes noirs
ACTES SUD
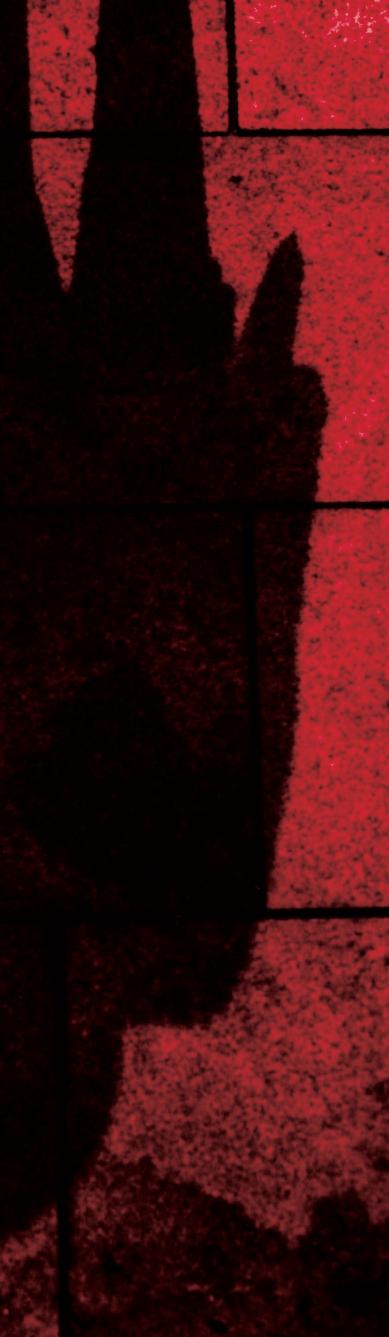

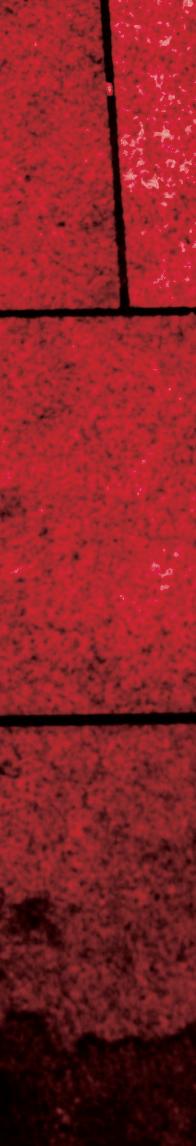

roman traduit de l’anglais par Laure Manceau
LA MAISON DES TOCARDS , Presses de la Cité, 2012 ; Babel noir no 166, 2016.
LES LIONS SONT MORTS , Actes Sud, 2017 ; Babel noir no 305, 2024. AGENT HOSTILE , Actes Sud, 2020.
Titre original : Real Tigers
Éditeur original : John Murray Publishers, Londres © Mick Herron, 2023
© ACTES SUD, 2024 pour la traduction française
ISBN 978‑2 330‑19072‑9
roman traduit de l’anglais par Laure Manceau
À EleanorComme souvent en cas de corruption, l’histoire commença avec des mecs en costume.
Matin de semaine aux abords de la City, humide, sombre, brumeux, pas encore cinq heures. Dans les tours voisines, vingt étages pour les plus hautes, quelques fenêtres allumées créaient des motifs aléatoires dans le quadrillage de verre et d’acier ; certaines de ces lumières signifiaient que les ban ‑ quiers lève‑tôt étaient à leur bureau pour devancer les mar‑ chés, mais la plupart indiquaient que les autres travailleurs de la City avaient pris leur poste, ceux qui enfilaient leur com‑ binaison dès le petit matin pour passer l’aspirateur, faire la poussière, vider les poubelles. Paul Lowell était solidaire de ces derniers. Soit on nettoyait derrière les autres, soit on ne le faisait pas – voilà à quoi se résumait purement et simple‑ ment la hiérarchie sociale.
Il risqua un œil en contrebas. Dix‑huit mètres, ce n’était pas rien, vu à la verticale. Il s’accroupit, sentit ses genoux cra‑ quer et ses cuisses tendre le tissu bas de gamme de manière inconfortable. Ce costume était trop petit. Lowell l’avait cru suffisamment extensible, mais en l’occurrence il se sentait tout comprimé et absolument pas investi des pouvoirs qu’il aurait dû lui conférer.
Ou alors il avait pris du poids.
Il se trouvait sur une plateforme, ce qui n’était probable‑ ment pas le terme correct en architecture, au‑dessus d’un pas‑ sage voûté à travers lequel passait London Wall, la quatre‑voies reliant St. Martin’s Le Grand à Moorgate. Au‑dessus de lui se 9
dressait une autre tour, dont la jumelle s’élevait à un angle légèrement décalé, abritant les principales banques d’investis‑ sement mondiales ainsi que l’une des plus célèbres franchises de pizza. À une centaine de mètres, sur une butte herbeuse en bordure de la route à laquelle il avait donné son nom, se tenait un morceau du Mur romain qui avait jadis encerclé la ville, toujours debout des siècles après que ses bâtisseurs y avaient abandonné leurs fantômes. Tout un symbole, songea Lowell. Certaines choses perduraient, survivaient au change‑ ment, et préserver ce qu’il en restait valait le coup de se battre. Les raisons de sa présence ici, autrement dit.
D’un coup d’épaules, il se débarrassa de son sac à dos, le coinça entre ses genoux et le vida de son contenu. Dans une heure environ, la circulation s’intensifierait, en direction de la City ou de l’est, une part importante passerait sous l’arche sur laquelle il était perché et tous ces gens en voiture, taxi, bus et vélo n’auraient d’autre choix que d’être témoins. Dans leur sillage débarqueraient les inévitables équipes de reportage dont les caméras transmettraient son message à tout le pays.
Tout ce qu’il voulait, c’était qu’on l’entende. Après des années de dénégation de ses droits, il était prêt à se battre, et comme d’autres avant lui, il avait choisi une méthode par‑ ticulière. C’est ainsi que naissaient les traditions. À aucun moment il n’a cru que son acte changerait quoi que ce soit, mais cela constituerait pour d’autres personnes dans sa situa‑ tion une démonstration, un enseignement, et peut‑être une incitation à agir. Et un jour, les choses bougeraient.
Il détecta un mouvement, et en se retournant aperçut une silhouette qui se hissait à l’autre bout de la plateforme, après avoir escaladé le bâtiment depuis le niveau de la rue comme il l’avait fait dix minutes plus tôt. Il mit un instant à comprendre de qui il s’agissait, mais éprouva alors un frisson d’excitation, comme s’il avait douze ans à nouveau. Parce que c’était exac‑ tement ce que tous les gamins de douze ans avaient envie de voir, se dit‑il en regardant le nouveau venu approcher. C’était l’étoffe même de leurs rêves.
Grand, carré et déterminé, Batman avançait droit vers lui à travers la nappe humide de brouillard.
“Hé, lança Lowell, pas mal.”
Il baissa les yeux sur son propre déguisement. Vu son âge, Spiderman n’était pas la tenue la plus appropriée, mais il n’allait pas à un défilé de mode : son but était de passer aux infos du soir, et les costumes de super‑héros étaient un appât à médias avéré. Ça avait déjà marché, ça marcherait à nou‑ veau. Il était donc l’Incroyable Spiderman, et le frère d’armes qu’il rencontrait pour la première fois, avec qui il avait tout planifié sur un forum anonyme, était Batman. Il leur suffisait d’incarner ce duo explosif l’espace d’une matinée pour mettre le feu aux journaux télévisés jusqu’à la fin de la semaine. Une main sur la toile enroulée qu’il avait sortie de son sac, il se redressa et tendit l’autre, car cela aussi faisait partie d’un récit ancestral : des hommes se rencontrant et se saluant, pactisant pour une cause commune.
Mais Batman ignora la main tendue de Spiderman et lui décocha une droite.
Lowell tomba à la renverse et le monde vacilla : les fenêtres de bureau éclairées tournoyèrent comme autant d’étoiles et son corps se vida de tout son air en heurtant la brique humide. Mais déjà son esprit était passé en ordre de marche ; il roula sur le côté, à l’opposé du bord, au moment où le pied de Batman s’abat‑ tait sur la plateforme, ratant son coude de peu. Il fallait qu’il se relève, parce que personne n’a jamais gagné un combat en posi‑ tion allongée, alors il s’y employa les secondes suivantes, au lieu de se demander pourquoi Batman voulait lui casser la gueule, et ses efforts portèrent presque leurs fruits car il avait réussi à se redresser sur ses genoux avant de se prendre un deuxième coup dans la tronche. Du sang imbiba son masque de Spiderman. Il essaya de parler mais n’émit qu’un gargouillis indistinct.
Puis il sentit qu’on le traînait vers le bord de la plateforme.
Il hurla, parce que la suite était claire. Batman le tenait par les épaules, impossible de s’échapper – ses mains semblaient moulées dans l’acier. En se débattant, Lowell donna un coup de pied dans la toile, qui se déroula. Il tenta un coup de poing dans l’entrejambe de Batman mais se heurta à une cuisse tout en muscles. Puis il se retrouva suspendu dans les airs, retenu par la seule poigne du justicier à la cape.
Un court instant, ils semblèrent figés dans une espèce d’étreinte, Batman droit comme un i et Spiderman dans le vide, comme pour une illustration de couverture.
“Pitié”, murmura Spiderman.
Mais Batman le lâcha.
La toile heurta le sol avant Paul Lowell mais ce n’était plus un rouleau : elle s’était dévidée sur le bitume pour devenir une bande de moquette au lieu de l’étendard qu’il avait eu en tête. Son cri de guerre peint à la main en lettres capitales, plus d’équité pour les pères, se brouilla lorsque le tissu absorba l’humidité du sol, ainsi qu’une certaine quantité de son propre sang, mais l’image conservait un intérêt média‑ tique certain et beaucoup d’émissions la diffuseraient avant la fin de la journée.
Mais Paul Lowell n’eut l’occasion d’en voir aucune.
Quant à Batman, il s’était envolé depuis longtemps.
Par une soirée caniculaire dans le quartier de Finsbury, une porte s’ouvre et une femme sort dans une cour. Pas celle de devant – il s’agit du Placard, et la porte principale du Pla‑ card est réputée ne jamais s’ouvrir ni se fermer – mais une cour qui reçoit peu de lumière naturelle et dont les murs sont donc hérissés de moisissures. L’odeur est celle de l’abandon, dont on peut discerner, avec un peu d’effort, les composantes olfactives : nourriture graisseuse du resto à emporter, tabac froid, flaques asséchées depuis longtemps et quelque chose émanant d’une canalisation qui glougloute dans un coin et qu’il ne vaut mieux pas examiner de trop près. Il ne fait pas encore noir – c’est l’heure violette – mais déjà la cour s’ombre de nuit. La femme ne s’arrête pas par ici. Il n’y a rien à voir. Mais supposons qu’elle soit elle‑même observée – supposons que le léger courant d’air qui l’effleure quand elle ferme la porte ne soit pas cette brise tant désirée qu’août semble avoir abju‑ rée, mais un esprit errant en quête d’un lieu de repos –, alors le moment précédant la fermeture complète de la porte consti‑ tue une mince brèche. Rapide comme l’éclair il s’y engouffre, et comme les esprits, en particulier les esprits errants, ne sont pas des fainéants, ce qui suit surviendrait en un clin d’œil ; un rapide survol de cette annexe à demi oubliée et totalement ignorée, cette “oubliette administrative”, comme elle fut bap‑ tisée un jour, des services de renseignements.
Notre esprit plane donc le long des marches, aucune autre option ne s’offrant à lui, et ce faisant remarque les traces lais‑ sées sur les murs de la cage d’escalier ; une éraflure marron, 15
semblable au contour d’un continent inachevé, indiquant le niveau d’humidité atteint ; un gribouillis sinueux qu’on pour‑ rait presque prendre, dans la pénombre, pour des vestiges de flammes. Une idée fantaisiste, mais renforcée par la chaleur et l’ambiance oppressante qui sature le bâtiment, comme si quelqu’un – quelque chose – exerçait une influence néfaste sur ceux qu’il tient sous sa coupe.
Sur le premier palier, deux portes de bureau. Choisissant au hasard, notre esprit se retrouve dans un espace délabré, mal rangé ; deux bureaux surmontés d’un ordinateur cha‑ cun, dont la lumière de veille clignote tranquillement dans le noir. Ici, ce qui a été renversé n’a pas été épongé, au point que les taches, ignorées elles aussi, ont fini par s’intégrer dans le spectre ambiant des couleurs. Tout est jaune ou gris, soit cassé, soit réparé. Une imprimante, coincée dans un espace pas tout à fait assez grand, affiche un capot fissuré, et l’abat‑ jour en papier censé dissimuler l’une des ampoules du pla‑ fond – l’autre est nue –, déchiré, pendouille de travers. Le mug sale sur un des bureaux n’a plus d’anse. Le verre sale sur l’autre est ébréché. La trace de lèvre sur le rebord est un bai‑ ser gothique, un rictus cireux.
Ce n’est pas un endroit pour un esprit errant ; le nôtre renifle, sans faire de bruit, avant de disparaître puis de réap‑ paraître dans le bureau d’à côté, puis dans ceux de l’étage du dessus, puis sur le palier encore au‑dessus, pour se faire une idée du bâtiment dans son ensemble… Idée ne s’avé ‑ rant pas particulièrement favorable. Ces pièces qui semblent vides sont en fait grouillantes, débordantes de frustration et de soucis majuscules ; elles empestent la torture de l’inertie forcée. Une seule – celle bénéficiant de l’équipement infor‑ matique le plus classe – semble relativement épargnée par les tourments de l’ennui éternel ; et une seule autre – le plus petit des bureaux occupant ce palier – montre des signes de tra‑ vail efficace. Dans les autres ronronne l’abattage répétitif des tâches absurdes ; le travail qu’on a trouvé aux mains oisives, qui consiste apparemment à traiter de l’information au kilo‑ mètre, des données brutes à peine différentes d’alphabets épar‑ pillés, assaisonnés de quelques chiffres aléatoires. Comme si
les tâches administratives d’une espèce de démon archiviste avaient été externalisées et confiées aux occupants de ces lieux, converties en corvées sans intérêt qu’ils sont censés accomplir sans fin, sans relâche, faute de quoi on les reléguera dans des recoins encore plus obscurs – condamnés quoi qu’ils fassent. S’il n’y a pas d’écriteau conseillant aux nouveaux venus d’aban‑ donner tout espoir, c’est parce que, comme tout employé de bureau le sait, ce n’est pas l’espoir qui tue.
C’est de savoir que c’est l’espoir qui tue qui vous tue.
Ces pièces, se dit notre esprit, mais il en reste une à visiter – la plus grande de ce dernier étage, qui, bien que plongée dans l’obscurité, n’est pas vide. Si notre esprit avait des oreilles, à peine aurait‑il besoin d’en coller une contre la porte pour s’en assurer, car le bruit qui émane de l’intérieur n’est pas discret : sonore, grondant, il pourrait provenir d’un animal de ferme. Notre esprit frissonne, imitant presque à la perfection l’hu‑ main en détresse, et avant que ce bruit, à la fois ronflement, rot et grognement, ne cesse tout à fait, il a redescendu les étages du Placard, filant devant les bureaux consternants des deuxième et premier étages puis survolant la dernière volée de marches qui est tout ce dont le bâtiment dispose en guise de rez‑de‑chaussée, coincé qu’il est entre un restaurant chinois et un marchand de journaux multifonctions ; il sort enfin dans la cour moisie et irrespirable au moment où le récit reprend ses droits, effaçant notre esprit errant comme un essuie‑glace balaie un insecte, de façon si soudaine qu’il laisse un petit pop derrière lui, mais avec tant de délicatesse que la femme ne l’entend pas. Elle tire sur la porte – pour s’assurer qu’elle est bien fermée, bien qu’elle soit à moitié convaincue d’avoir déjà vérifié – puis, avec la même efficacité qui caractérise le travail qu’elle effectue dans son bureau du dernier étage, sort dans la ruelle qui débouche sur Aldersgate Street, et elle prend à gauche. À peine a‑t‑elle marché cinq mètres qu’un bruit la surprend : pas un pop, ni un boum, ni même un rot explosif dont Jackson Lamb a le secret, mais son propre pré‑ nom, enveloppé dans une voix d’une autre époque, Cath…
“… erine ?”
Qui va là ? Ami ou ennemi ?
Comme si de telles subtilités faisaient une différence.
“Catherine Standish ?”
Cette fois elle frissonna, ça se précisait, dans sa tête elle plissa les yeux mais en façade son visage n’afficha aucune ride. Elle essayait de localiser un souvenir qui scintillait der‑ rière du verre dépoli. Le flou se dissipa, et l’épaisseur à tra‑ vers laquelle elle regardait était le fond d’un verre, vide, mais voilé d’un reste d’alcool.
“Sean Donovan, dit‑elle.
Tu n’as pas oublié.
Non. Comment le pourrais‑je.”
Car c’était un homme inoubliable, grand, large d’épaules, avec un nez cassé une fois ou deux – un chiffre pair, plaisantait ‑ il, sinon il serait encore plus de travers –, et si ses cheveux, qui comptaient désormais des mèches gris acier, étaient plus longs que dans son souvenir, ils étaient à peine moins ras qu’une coupe en brosse. Ses yeux, bien sûr, étaient toujours bleus, mais même dans le soir qui tombait elle dis‑ cerna qu’ils étaient du bleu tempête de ses moments plus sombres, et non couleur ciel de septembre. Grand et carré, ce qu’elle avait déjà remarqué, deux fois sa taille au moins, ils devaient faire un sacré couple planté là dans l’heure vio‑ lette ; lui qui transpirait le guerrier par tous les pores et elle dans une robe boutonnée jusqu’au cou avec des manches en dentelle et des chaussures à boucle.
Puisqu’il fallait bien aborder la question, elle dit : “Je ne savais pas que tu étais… Sorti ?”
Elle acquiesça.
“Ça fait un an. Treize mois.” La voix non plus n’était pas de celles qu’on oublie, avec sa touche d’irlandais. Elle n’avait jamais mis les pieds en Irlande, mais parfois, en l’écoutant, sa tête s’était emplie d’images vertes moelleuses.
Son alcoolisme avait joué, sûrement.
“Je pourrais te donner le nombre en jours, ajouta‑t‑il. Ça n’a pas dû être facile.
Dans le monde obscur du renseignement britannique, où les secrets sont des armes et les alliances fragiles, la Maison des Tocards est le dernier arrêt pour les agents en disgrâce. Dirigée par le cynique et charismatique Jackson Lamb, l’équipe est composée de marginaux et autres cas désespérés. Mais lorsque l’un des leurs est kidnappé et que la sécurité nationale est menacée, les Tocards vont devoir se réveiller.
En maître incontesté du thriller d’espionnage contemporain, Mick Herron tisse une toile complexe de trahison, de suspens et de noirceur. Avec son humour acéré, ses personnages inoubliables et une intrigue palpitante, il plonge le lecteur dans un monde où les tigres ne rugissent pas mais manigancent dans l’ombre, et où le destin de la nation repose sur les épaules de ceux que la société a rejetés.
Romancier britannique né en 1968, Mick Herron est notamment l’auteur de la série d’espionnage multiprimée Slough House dont les trois premières saisons sont désormais disponibles sur Canal + (Apple TV+) sous le titre Slow Horses, avec l’oscarisé Gary Oldman dans le rôle de Jackson Lamb. Mission Tigre est le troisième tome de la série après La Maison des Tocards (Babel Noir, 2016) et Les lions sont morts (Actes Noirs, 2017).