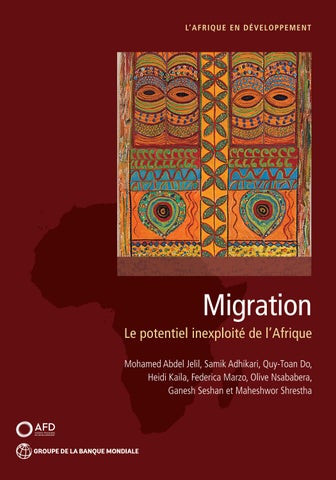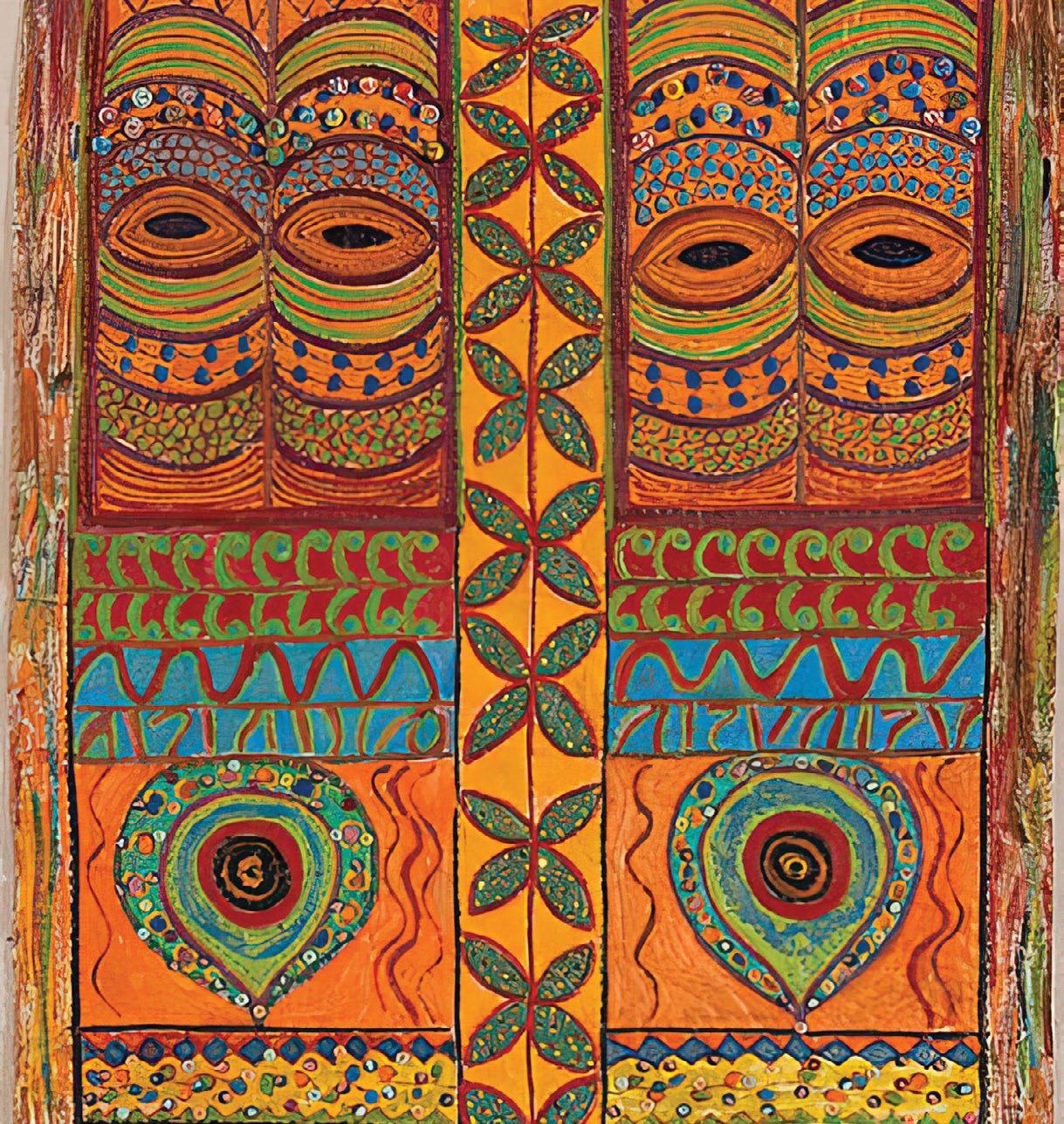
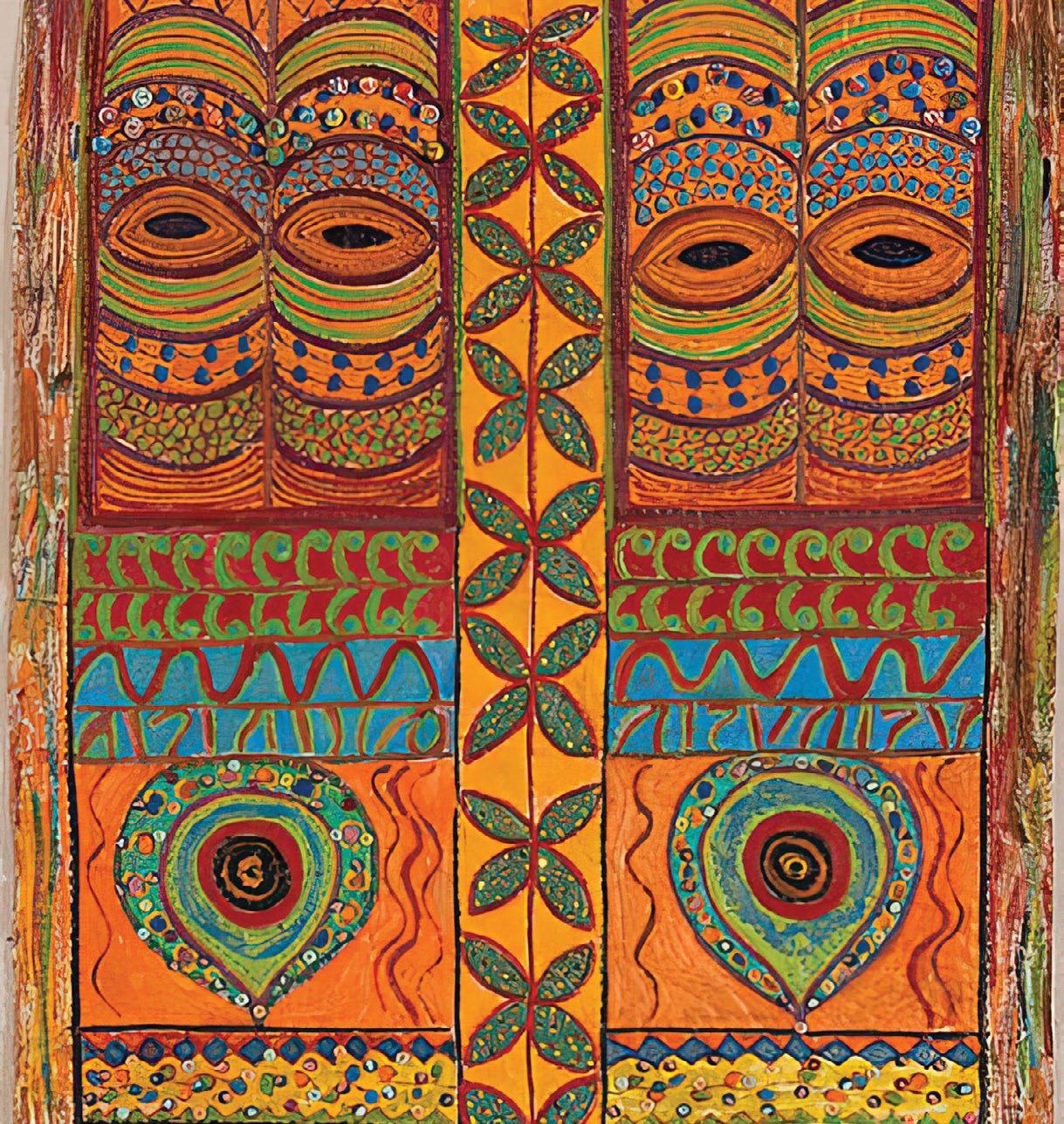
Migration
Le potentiel inexploité de l’Afrique
Mohamed Abdel Jelil, Samik Adhikari, Quy-Toan Do,
Heidi Kaila, Federica Marzo, Olive Nsababera, Ganesh Seshan et Maheshwor Shrestha
Migration
Cet ouvrage, ses contenus associés et ses mises à jour ultérieures sont disponibles sur le site : https://hdl.handle.net/10986/42534.
Scannez pour accéder à tous les ouvrages de la collection « L’Afrique en développement » publiée conjointement par l’Agence française de développement et la Banque mondiale.
L’AFRIQUE EN DÉVELOPPEMENT
Migration Le potentiel inexploité de l’Afrique
Mohamed Abdel Jelil, Samik Adhikari, Quy-Toan Do, Heidi Kaila, Federica Marzo, Olive Nsababera, Ganesh Seshan et Maheshwor Shrestha
Ouvrage publié conjointement par l’Agence française de développement et la Banque mondiale
© 2025 Banque internationale pour la reconstruction et le développement / La Banque mondiale 1818 H Street NW, Washington, DC 20433
Téléphone : 202-473-1000 ; Internet : www.worldbank.org
Certains droits réservés
1 2 3 4 28 27 26 25
Les analyses, interpretations et conclusions de ce livre sont formulees sous la responsabilite de leurs auteurs. Elles ne refletent pas necessairement le point de vue des administrateurs de la Banque mondiale ni des Etats qu’ils representent ni celui de l’Agence française de developpement.
La Banque mondiale et l’Agence française de developpement ne garantissent pas l’exactitude des donnees citees dans cet ouvrage. Les frontieres, les couleurs, les denominations et toute autre information figurant sur les cartes du present rapport n’impliquent de la part de la Banque mondiale ou de l’Agence française de developpement aucun jugement quant au statut juridique d’un territoire quelconque et ne signifient nullement que l’institution reconnait ou accepte ces frontieres.
Droits et autorisations

L’utilisation de cet ouvrage est soumise aux conditions de la licence Creative Commons Attribution 3.0 IGO (CC BY 3.0 IGO) http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo. Conformément aux termes de la licence Creative Commons Attribution (paternité), il est possible de copier, distribuer, transmettre et adapter le contenu de l’ouvrage, notamment à des fins commerciales, sous réserve du respect des conditions suivantes :
Mention de la source—L’ouvrage doit être cité de la manière suivante : Abdel Jelil, Mohamed, Samik Adhikari, Quy-Toan Do, Heidi Kaila, Federica Marzo, Olive Nsababera, Ganesh Seshan et Maheshwor Shrestha. 2025. Migration : le potentiel inexploité de l’Afrique. Collection « L’Afrique en développement ». Washington, DC : La Banque mondiale. doi:10.1596/978-1-4648-2209-4. Licence : Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO
Traductions—Si une traduction de cet ouvrage est produite, veuillez ajouter à la mention de la source de l’ouvrage le déni de responsabilité suivant : « Cette traduction n’a pas été réalisée par la Banque mondiale et ne doit pas être considérée comme une traduction officielle de cette dernière. La Banque mondiale ne saurait être tenue responsable du contenu de la traduction ni des erreurs qu’elle pourrait contenir. »
Adaptations—Si une adaptation de cet ouvrage est produite, veuillez ajouter à la mention de la source le déni de responsabilité suivant : « Cet ouvrage est une adaptation d’une œuvre originale de la Banque mondiale. Les idées et opinions exprimées dans cette adaptation n’engagent que l’auteur ou les auteurs de l’adaptation et ne sont pas validées par la Banque mondiale. »
Contenu tiers—La Banque mondiale n’est pas nécessairement propriétaire de chaque composante du contenu de cet ouvrage. Elle ne garantit donc pas que l’utilisation d’une composante ou d’une partie quelconque du contenu de l’ouvrage ne porte pas atteinte aux droits des tierces parties concernées. L’utilisateur du contenu assume seul le risque de réclamations ou de plaintes pour violation desdits droits. Pour réutiliser une composante de cet ouvrage, il vous appartient de juger si une autorisation est requise et de l’obtenir le cas échéant auprès du détenteur des droits d’auteur. Parmi les composantes, on citera, à titre d’exemple, les tableaux, les graphiques et les images.
Toute demande de renseignements sur les droits et licences doit être adressée à : World Bank Publications, The World Bank, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA ; courriel : pubrights@worldbank.org
ISBN (imprimé) : 978-1-4648-2209-4
ISBN (digital) : 978-1-4648-2210-0
DOI : 10.1596/978-1-4648-2209-4
Illustration de couverture : © Banque mondiale. Pacita Abad (1946–2004), « Call My Name », 1999. Peinture sur bois, 173 cm par 118 cm. Programme d’art de la Banque mondiale, objet 462096. Une autorisation supplémentaire est requise pour la réutilisation.
Conception de la page de couverture : Bill Pragluski, Critical Stages, LLC.
Numéro de contrôle de la Bibliothèque du Congrès : 2025904253
Collection « L’Afrique en développement »
Créée en 2009, la collection « L’Afrique en développement » s’intéresse aux grands enjeux sociaux et économiques du développement en Afrique subsaharienne. Chacun de ses numéros dresse l’état des lieux d’une problématique et contribue à alimenter la réflexion liée à l’élaboration des politiques locales, régionales et mondiales. Décideurs, chercheurs et étudiants y trouveront les résultats des travaux de recherche les plus récents, mettant en évidence les difficultés et les opportunités de développement du continent.
Cette collection est dirigée par l’Agence française de développement et la Banque mondiale. Pluridisciplinaires, les manuscrits sélectionnés émanent des travaux de recherche et des activités de terrain des deux institutions. Ils sont choisis pour leur pertinence au regard de l’actualité du développement. En travaillant ensemble sur cette collection, l’Agence française de développement et la Banque mondiale entendent renouveler les façons d’analyser et de comprendre le développement de l’Afrique subsaharienne.
Membres du comité consultatif
Agence française de développement
Thomas Mélonio, directeur exécutif, direction « Innovation, recherche et savoirs »
Hélène Djoufelkit, directrice, département « Diagnostics économiques et politiques publiques »
Adeline Laulanié, responsable, division « Publications »
Banque mondiale
Andrew Dabalen, chef économiste, région Afrique
Cesar Calderon, économiste spécialiste, région Afrique
Chorching Goh, économiste spécialiste, directrice de programme, région Afrique
Aparajita Goyal, économiste spécialiste, région Afrique
Titres de la collection « L’Afrique en développement »
2025
*Inequalities in Sub-Saharan Africa: Multidimensional Perspectives and Future Challenges (2025), Inégalités en Afrique subsaharienne: perspectives multidimensionnelles et enjeux futurs (2025), Anda David, Murray Leibbrandt, Vimal Ranchhod, Rawane Yasser (eds.)
*Migration: Africa’s Untapped Potential (2025), Migration : le potentiel inexploité de l’Afrique (2025), Mohamed Abdel Jelil, Samik Adhikari, Quy-Toan Do, Heidi Kaila, Federica Marzo, Olive Nsababera, Ganesh Seshan, Maheshwor Shrestha
2024
*Migrants, Markets, and Mayors: Rising above the Employment Challenge in Africa’s Secondary Cities (2024), Migrants, marchés et maires : répondre aux défis de l’emploi dans les villes secondaires africaines (2024), Luc Christiaensen, Nancy Lozano-Gracia (eds.)
2023
*Africa’s Resource Future: Harnessing Natural Resources for Economic Transformation during the Low-Carbon Transition (2023), Les ressources naturelles, un enjeu clé pour l’avenir de l’Afrique : ressources naturelles et transformation économique dans un contexte de transition vers des économies décarbonées (2023), James Cust, Albert Zeufack (eds.)
*L’Afrique en communs : tensions, mutations, perspectives (2023), The Commons: Drivers of Change and Opportunities for Africa (2023), Stéphanie Leyronas, Benjamin Coriat, Kako Nubukpo (eds.)
2021
Social Contracts for Development: Bargaining, Contention, and Social Inclusion in Sub-Saharan Africa (2021), Mathieu Clouthier, Bernard Harborne, Deborah Isser, Indhira Santos, Michael Watts
*Industrialization in Sub-Saharan Africa: Seizing Opportunities in Global Value Chains (2021), L’industrialisation en Afrique subsaharienne : Saisir les opportunités offertes par les chaînes de valeur mondiales (2022), Kaleb G. Abreha, Woubet Kassa, Emmanuel K. K. Lartey, Taye A. Mengistae, Solomon Owusu, Albert G. Zeufack
2020
*Les systèmes agroalimentaires en Afrique : repenser le rôle des marchés (2020), Food Systems in Africa: Rethinking the Role of Markets (2021), Gaëlle Balineau, Arthur Bauer, Martin Kessler, Nicole Madariaga
*The Future of Work in Africa: Harnessing the Potential of Digital Technologies for All (2020), L’avenir du travail en Afrique : exploiter le potentiel des technologies numériques pour un monde du travail plus inclusif (2021), Jieun Choi, Mark A. Dutz, Zainab Usman (eds.)
2019
All Hands on Deck: Reducing Stunting through Multisectoral Efforts in Sub-Saharan Africa (2019), Emmanuel Skoufias, Katja Vinha, Ryoko Sato
*The Skills Balancing Act in Sub-Saharan Africa: Investing in Skills for Productivity, Inclusivity, and Adaptability (2019), Le développement des compétences en Afrique subsaharienne, un exercice d’équilibre : Investir dans les compétences pour la productivité, l’inclusion et l’adaptabilité (2020), Omar Arias, David K. Evans, Indhira Santos
*Electricity Access in Sub-Saharan Africa: Uptake, Reliability, and Complementary Factors for Economic Impact (2019), Accès à l’électricité en Afrique subsaharienne : adoption, fiabilité et facteurs complémentaires d’impact économique (2020), Moussa P. Blimpo, Malcolm Cosgrove-Davies
2018
*Facing Forward: Schooling for Learning in Africa (2018), Perspectives : l’école au service de l’apprentissage en Afrique (2019), Sajitha Bashir, Marlaine Lockheed, Elizabeth Ninan, Jee-Peng Tan
Realizing the Full Potential of Social Safety Nets in Africa (2018), Kathleen Beegle, Aline Coudouel, Emma Monsalve (eds.)
2017
*Mining in Africa: Are Local Communities Better Off? (2017), L’exploitation minière en Afrique : les communautés locales en tirent-elles parti? (2020), Punam Chuhan-Pole, Andrew L. Dabalen, Bryan Christopher Land
*Reaping Richer Returns : Public Spending Priorities for African Agriculture Productivity Growth (2017), Obtenir de meilleurs résultats : priorités en matière de dépenses publiques pour les gains de productivité de l’agriculture africaine (2020), Aparajita Goyal, John Nash
2016
Confronting Drought in Africa’s Drylands: Opportunities for Enhancing Resilience (2016), Raffaello Cervigni, Michael Morris (eds.)
2015
*Africa’s Demographic Transition: Dividend or Disaster? (2015), La transition démographique de l’Afrique : dividende ou catastrophe ? (2016), David Canning, Sangeeta Raja, Abdo Yazbech
Highways to Success or Byways to Waste: Estimating the Economic Benefits of Roads in Africa (2015), Rubaba Ali, A. Federico Barra, Claudia Berg, Richard Damania, John Nash, Jason Russ
Enhancing the Climate Resilience of Africa’s Infrastructure: The Power and Water Sectors (2015), Raffaello Cervigni, Rikard Liden, James E. Neumann, Kenneth M. Strzepek (eds.)
The Challenge of Stability and Security in West Africa (2015), Alexandre Marc, Neelam Verjee, Stephen Mogaka
*Land Delivery Systems in West African Cities: The Example of Bamako, Mali (2015), Le système d’approvisionnement en terres dans les villes d’Afrique de l’Ouest : L’exemple de Bamako (2015), Alain Durand-Lasserve, Maÿlis Durand-Lasserve, Harris Selod
*Safety Nets in Africa: Effective Mechanisms to Reach the Poor and Most Vulnerable (2015), Les filets sociaux en Afrique : méthodes efficaces pour cibler les populations pauvres et vulnérables en Afrique (2015), Carlo del Ninno, Bradford Mills (eds.)
2014
Tourism in Africa: Harnessing Tourism for Growth and Improved Livelihoods (2014), Iain Christie, Eneida Fernandes, Hannah Messerli, Louise Twining-Ward
*Youth Employment in Sub-Saharan Africa (2014), L’emploi des jeunes en Afrique subsaharienne (2014), Deon Filmer, Louise Fox
2013
*Les marchés urbains du travail en Afrique subsaharienne (2013), Urban Labor Markets in Sub-Saharan Africa (2013), Philippe De Vreyer, François Roubaud (eds.)
Enterprising Women: Expanding Economic Opportunities in Africa (2013), Mary Hallward-Driemeier
Securing Africa’s Land for Shared Prosperity: A Program to Scale Up Reforms and Investments (2013), Frank F. K. Byamugisha
*The Political Economy of Decentralization in Sub-Saharan Africa: A New Implementation Model in Burkina Faso, Ghana, Kenya, and Senegal (2013), Bernard Dafflon, Thierry Madiès (eds.)
2012
Empowering Women: Legal Rights and Economic Opportunities in Africa (2012), Mary HallwardDriemeier, Tazeen Hasan
*Financing Africa’s Cities: The Imperative of Local Investment (2012), Financer les villes d’Afrique : l’enjeu de l’investissement local (2012), Thierry Paulais
*Structural Transformation and Rural Change Revisited: Challenges for Late Developing Countries in a Globalizing World (2012), Transformations rurales et développement : les défis du changement structurel dans un monde globalisé (2013), Bruno Losch, Sandrine Fréguin-Gresh, Eric Thomas White
*Light Manufacturing in Africa: Targeted Policies to Enhance Private Investment and Create Jobs (2012), L’industrie légère en Afrique : politiques ciblées pour susciter l’investissement privé et créer des emplois (2012), Hinh T. Dinh, Vincent Palmade, Vandana Chandra, Frances Cossar
*The Informal Sector in Francophone Africa: Firm Size, Productivity, and Institutions (2012), Les entreprises informelles de l’Afrique de l’ouest francophone : taille, productivité et institutions (2012), Nancy Benjamin, Ahmadou Aly Mbaye
2011
Contemporary Migration to South Africa: A Regional Development Issue (2011), Aurelia Segatti, Loren Landau (eds.)
Challenges for African Agriculture (2011), Jean-Claude Deveze (ed.)
L’économie politique de la décentralisation dans quatre pays d’Afrique subsaharienne : Burkina Faso, Sénégal, Ghana et Kenya (2011), Bernard Dafflon, Thierry Madiès (eds.)
2010
Gender Disparities in Africa’s Labor Market (2010), Jorge Saba Arbache, Alexandre Kolev, Ewa Filipiak (eds.)
*Africa’s Infrastructure: A Time for Transformation (2010), Infrastructures africaines : une transformation impérative (2010), Vivien Foster, Cecilia Briceño-Garmendia (eds.)
*Disponible en français
Tous les ouvrages de la collection L’Afrique en développement publiés conjointement par l’Agence française de développement et la Banque mondiale sont disponibles gratuitement sur le site : http://hdl.handle.net/10986/2150.
La croissance rapide de la population dans le centre géographique de l’Afrique s’opère sur fond de changement climatique
La migration a le potentiel de générer des retombées économiques plus importantes en Afrique
Des politiques volontaristes sont nécessaires pour libérer le potentiel de la migration en Afrique
L’Afrique doit exploiter le potentiel économique des migrants déplacés de force et en détresse tout en préservant leur dignité
4 Mettre en valeur le potentiel productif de la mobilité africaine
Utiliser les accords bilatéraux et multilatéraux propices à une meilleure migration
1.1
Dans les pays d’origine : maximiser les bénéfices avant, pendant et après la migration
les pays de destination : faciliter l’intégration
Que se passe-t-il lorsqu’un conflit éclate aux portes de l’Europe ?
1.1 Part des migrants restant dans leur région d’origine, 2020
1.2
1.3 Part des migrants originaires d’un pays membre de la CER, 2020
1.4 Nombre de migrants morts ou disparus, par région de l’incident, 2014-2023
1.5 Flux transfrontaliers irréguliers vers l’Europe
1.6 Les réfugiés représentent une part importante des flux migratoires en Afrique
B1.2.1 Un petit nombre de pays concentre la plupart des déplacements internes 18
2.1 La population africaine sera la plus importante du monde en 2050, grâce à des taux de fécondité élevés, une espérance de vie en hausse et des taux de mortalité en baisse.
24
2.2 En Afrique, l’augmentation du nombre de personnes en âge de travailler par rapport aux enfants et aux personnes âgées annonce un dividende démographique. 25
2.3 Dans les pays à revenu élevé et intermédiaire supérieur, la population en âge de travailler diminuera entre 2024 et 2050, tandis que la population âgée augmentera rapidement. 26
2.4 Le PIB par habitant dans le centre géographique de l’Afrique reste inférieur à un quart du PIB mondial 27
2.5 L’extrême pauvreté demeure élevée dans les pays du centre géographique de l’Afrique
2.6 La durée de scolarisation en Afrique est inférieure à la plupart des pays du monde, et la proportion de jeunes ni en emploi, ni en études, ni en formation est élevée
28
29
2.7 La proportion de citadins et le nombre de citadins augmentent en Afrique 30
2.8 Dans les pays du centre géographique de l’Afrique, où le secteur agricole emploie près de 50 % de la main-d’œuvre, le manque d’emplois salariés contraint de nombreuses personnes à exercer comme travailleur indépendant pour assurer leur subsistance
30
2.9 Les situations de conflit et de violence en Afrique ont augmenté dans la dernière décennie 31
3.1 Ratio entre les salaires des migrants (âgés de 15 à 35 ans) originaires du centre géographique de l’Afrique et les salaires des non-migrants, par région de destination
3.2 Les pays du centre géographique de l’Afrique reçoivent les plus faibles envois de fonds par émigrant
44
45
3.3 Le coût de transaction moyen des envois de fonds vers un pays africain est élevé 46
B3.1.1 Nombre de médecins, infirmiers et sages-femmes pour 10 000 habitants, 2018-2021 49
3.4 Les principaux pays de destination des migrants africains doivent opérer un arbitrage délicat entre une augmentation de l’immigration et un report de l’âge de la retraite. 54
3.5 Propension à migrer à l’étranger pour étudier, 2020 56
3.6 Effet des ABMMO sur les flux migratoires de main-d’œuvre
60
3.7 Part des réfugiés et demandeurs d’asile parmi les migrants transfrontaliers, 2020 63
3.8 Nombre de migrants morts ou disparus, par région d’origine, 2014-2023 64
4.1 Matrice adéquation-motivation du Rapport sur le développement dans le monde 2023 76
Cartes
1.1 Schémas de mobilité en Afrique, 2020 13
2.1 Confluence de facteurs en Afrique 22
2.2 L’Afrique devrait se réchauffer au cours des prochaines décennies 35
3.1 Nombre d’accords bilatéraux sur la migration de main-d’œuvre signée, 1927-2020 59
Avant-propos
La migration a toujours joué un rôle crucial dans la structuration du paysage social, économique et culturel africain. À la Banque mondiale, nous sommes conscients de l’immense potentiel de la migration en matière de développement économique, de réduction de la pauvreté et de renforcement de la cohésion sociale sur le continent. La migration est un puissant moteur de changement, propulsé par des individus et des familles en quête de perspectives économiques, de sécurité et de meilleures conditions de vie, aussi bien en Afrique qu’au-delà de ses frontières.
Malgré ce potentiel de transformation, les bénéfices de la migration pour le développement de l’Afrique demeurent largement inexploités. Il est fondamental de changer notre regard sur la migration, afin de ne plus la considérer comme un défi, mais comme une chance de mobiliser les vastes ressources humaines de l’Afrique pour faire croître et prospérer le continent, ainsi que la communauté mondiale.
L’Afrique se situe à un moment charnière de son développement, avec une population jeune en croissance rapide qui représentera bientôt une part importante de la main-d’œuvre mondiale. D’ici à 2050, un jeune en âge de travailler sur trois sera né en Afrique, ce qui offre une occasion sans précédent de stimuler la croissance économique et l’innovation. Pour exploiter pleinement ce potentiel, les pays africains, en partenariat avec la communauté mondiale, doivent créer des environnements qui favorisent et valorisent la contribution des migrants à la prospérité des pays d’origine et de destination.
Le présent rapport, qui vient compléter le Rapport sur le développement dans le monde 2023 : Migrants, réfugiés et sociétés, souligne la nécessité de mettre en place des politiques qui garantissent des migrations sûres, ordonnées et régulières, tout en assurant la protection des personnes déplacées de force. Ce rapport appelle à des efforts concertés de la part des décideurs politiques, des communautés et des parties prenantes dans les pays d’origine, de transit et de destination, afin de déployer des stratégies permettant de valoriser le potentiel économique des migrants et des réfugiés. Le rapport insiste également sur l’importance d’offrir des alternatives à la migration de détresse, trop souvent à l’origine de tragédies humaines pendant le transit.
La Banque mondiale s’engage à soutenir les pays africains dans cette démarche. Nous sommes convaincus qu’en investissant dans l’éducation, les infrastructures et la gouvernance, et en renforçant l’intégration régionale, l’Afrique peut libérer tout le potentiel de son capital humain.
Notre rôle est de fournir les ressources, les recherches et les partenariats nécessaires pour aider les pays africains à mettre les atouts de la migration au service de la croissance économique et du développement.
Ce rapport livre une analyse complète des tendances migratoires africaines et formule des recommandations concrètes à l’intention des décideurs politiques. Il souligne la nécessité de protéger les droits et la dignité des migrants et des réfugiés, en faisant de la migration un processus sûr et avantageux pour tous les acteurs concernés. En mobilisant le potentiel de la migration, l’Afrique peut relever les défis qui jalonnent son développement et offrir à ses habitants un avenir plus radieux.
La Banque mondiale reste un partenaire engagé dans cette voie, œuvrant aux côtés des gouvernements africains, des organismes régionaux et des partenaires internationaux pour construire un avenir où la migration sera le moteur d’un développement durable. Ensemble, nous pouvons transformer la promesse de la migration en une réalité qui profitera à l’Afrique et au monde entier.
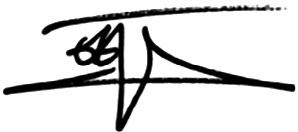
Ousmane Diagana
Vice-président
Afrique de l’Ouest et du Centre
Banque mondiale

Victoria Kwakwa Vice-présidente
Afrique de l’Est et Australe
Banque mondiale
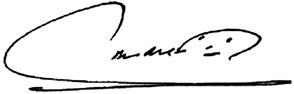
Ousmane Dione
Vice-président
Moyen-Orient et Afrique du Nord
Banque mondiale
remerciements
Le rapport Migration : le potentiel inexploité de l’Afrique a été rédigé par une équipe de la Banque mondiale composée de Mohamed Abdel Jelil, Samik Adhikari, Quy-Toan Do, Heidi Kaila, Federica Marzo, Olive Nsababera, Ganesh Seshan et Maheshwor Shrestha, sous la supervision d’Andrew Dabalen. Le rapport a été financé par le Bureau de l’économiste en chef pour la région Afrique. L’analyse livrée dans ce rapport se base sur les documents préliminaires et les études de cas suivants :
• « Do Bilateral Labor Agreements Increase Migration? Global Evidence from 1960 to 2020 », de Samik Adhikari, Narcisse Cha’ngom, Heidi Kaila et Maheshwor Shrestha.
• « A Profile of Migrants in North Africa: Background, Intentions, and Labor Market Outcomes », de Marian Atallah et Federica Marzo.
• « Effectiveness of Mass Regularization Policies in South Africa: Evidence from the Dispensation of Zimbabwean Project (DZP) », de Narcisse Cha’ngom.
• « Climate Change and Mobility », de Viviane Clement et Kanta Kumari Rigaud.
• « Migration to and through North Africa: An Overview », de Michele Di Maio, Valerio Leone Sciabolazza et Federica Marzo.
• « Population Aging and International Migration », de Toan Do, Andrei Levchenko, Sebastian Sotelo et Román D. Zárate.
• « Migration Policies in Africa’s Regional Economic Communities », de Blaise Gnimassoun et Assi Okara.
• « Overview of Methods for State Collaboration on African Migration beyond the Continent », de Michelle Leighton.
• « Forced Displacement in Sub-Saharan Africa: A Stocktaking of Evidence », de Zara Sarzin et Olive Nsababera.
Kèneth Omondi a assuré l’appui administratif. Narcisse Cha’ngom a assisté l’équipe dans ses recherches. Pascal Jaupart a contribué à l’encadré sur la migration des personnels de santé.
Sandra Gain a assuré le processus éditorial. Bruno Bonanséa, Brenan Gabriel Andre et Patricia Anne Janer de l’équipe Cartographie ont élaboré les cartes.
L’équipe a bénéficié des conseils et suggestions d’un comité consultatif interne composé de Patrick Barron, Himdat Bayusuf, Kathleen Beegle, Nazmul Chaudhury, Xavier Devictor,
Johannes (Hans) Hoogeveen, Manjula Luthria et Kanta Rigaud. Pablo Ariel Acosta, Tom Bundervoet, Aline Coudouel, Ugochi Daniels, Manuela Tomei et Jackie Wahba se sont chargés de l’évaluation par des pairs.
L’équipe exprime sa reconnaissance pour tous les éclairages reçus lors des consultations auprès des agences gouvernementales, des partenaires de développement, des ambassades, des organisations de la société civile, des universités et des groupes de réflexion en Algérie, en Belgique, aux Comores, en Côte d’Ivoire, en Éthiopie, en France, au Ghana, en Italie, au Kenya, au Maroc, en République arabe d’Égypte, au Saint-Siège, au Sénégal, en Suisse et au Royaume-Uni.
Cet ouvrage a été traduit en français par Cadenza Academic Translations à partir de l’édition originale en langue anglaise.
principaux points à retenir
Chapitre 1 : État des lieux de la mobilité en Afrique
1. Les Africains migrent rarement en dehors du continent.
Moins de 1 % de la population de la région quitte le continent, bien moins que la moyenne mondiale.
2. Les Africains qui quittent le continent vont de plus en plus en Amérique du Nord et dans les pays du Conseil de coopération du Golfe, et de moins en moins en Europe.
Les trois quarts des migrants africains qui quittaient le continent se rendaient en Europe, contre un peu plus de la moitié aujourd’hui.
3. De nombreux États africains deviennent des pays de destination des migrants.
Les pays d’Afrique du Nord s’affirment comme des pays de destination et non comme de simples zones de transit pour les personnes migrant vers l’Europe. La Côte d’Ivoire, le Kenya et l’Afrique du Sud accueillent au moins deux fois plus de migrants qu’ils n’en envoient.
4. La migration irrégulière dans tout le continent est la plus dangereuse au monde.
Près de 5 000 décès de migrants africains ont été recensés en 2023, un nombre plus de deux fois supérieur à celui des migrants asiatiques et environ quatre fois supérieur à celui des migrants d’Amérique latine.
5. L’Afrique accueille un quart de la population mondiale de réfugiés.
La plupart des réfugiés se sont déplacés vers un pays voisin. Dix pays accueillent près de 90 % d’entre eux.
Chapitre 2 : Les grandes tendances convergentes en Afrique
1. D’ici 2050, un jeune sur trois (âgé de 15 à 34 ans) sera africain.
Le nombre de personnes en âge de travailler devrait augmenter de 600 millions en Afrique, tandis qu’il devrait baisser de 200 millions dans les pays à revenu élevé et intermédiaire supérieur.
2. La croissance économique de l’Afrique stagne et ne parvient pas à créer assez d’emplois pour une population jeune en pleine expansion.
La croissance économique continue de progresser plus lentement que la croissance démographique, tandis que la pauvreté des apprentissages affecte neuf enfants sur dix en Afrique subsaharienne.
3. D’ici 2050, 1,3 milliard d’Africains devraient vivre dans des pays qui connaissent actuellement une situation de fragilité ou de conflit.
Près de la moitié de la population africaine vit dans des pays touchés par une fragilité persistante. Les cas de conflit, de violence et de déplacements forcés ont fortement augmenté depuis 2010.
4. Plus d’un demi-milliard d’Africains sont exposés à des phénomènes météorologiques extrêmes, dont des inondations, des sécheresses, des cyclones et des vagues de chaleur.
Les territoires ruraux agricoles et les zones côtières sont de plus en plus menacés par le changement climatique, tandis que les centres urbains tentent péniblement de faire face à l’augmentation de la population et à la pression exercée sur les services de base.
Chapitre 3 : Le potentiel inexploité de la migration
1. Le potentiel de prospérité de la migration africaine est largement inexploité.
Les Africains sont moins nombreux à migrer par rapport aux autres régions du monde. Seul un petit nombre d’entre eux migrent vers un pays où les gains salariaux potentiels sont importants.
2. La « Grande Divergence Démographique » offre à l’Afrique une conjoncture propice pour intégrer davantage la migration dans sa politique de développement.
Les principaux pays de destination non africains connaissent une baisse de leur population active. Pour maintenir le ratio actuel entre les personnes en âge de travailler et les personnes âgées, ils devront procéder à une augmentation de l’immigration équivalente à 14 à 77 % de leur population d’ici à 2050.
3. Une gestion stratégique de la migration permet aux pays d’origine et de destination de mettre la migration au service de leurs intérêts respectifs.
Les accords bilatéraux sur les migrations de main-d’œuvre permettent de faire coïncider le développement des compétences et les besoins des pays de destination. Bien que ces accords favorisent durablement les flux migratoires entre les pays, l’Afrique accuse toujours un retard quant à leur utilisation.
4. La mobilisation du potentiel économique des réfugiés et des personnes déplacées internes préserve leur dignité tout en réduisant les coûts pour les communautés d’accueil.
L’intégration économique, qui passe notamment par l’octroi de droits du travail et de la liberté de circulation, permet aux réfugiés et aux personnes déplacées internes d’être plus autonomes, ce qui réduit les coûts de leur accueil.
Chapitre 4 : Exploiter le potentiel productif de la mobilité africaine
1. Des murs plus hauts exigent des portes plus grandes.
Pour favoriser la migration régulière et décourager les mouvements irréguliers, le nombre de voies d’accès légales doit être accru.
2. Créer et renforcer des systèmes de migration dans les pays africains.
Il est nécessaire de mettre en place des politiques et des systèmes pour aider les migrants et leurs communautés d’origine et de destination au départ, pendant le transit, à l’arrivée et enfin, au retour.
3. Favoriser la mobilité régionale des Africains.
Les obstacles à la libre circulation au sein des communautés économiques régionales doivent être réduits, notamment pour les réfugiés, et l’efficacité des marchés du travail régionaux doit être améliorée en harmonisant l’acquisition et la reconnaissance des compétences.
4. Renforcer la capacité de l’Afrique à tirer parti de la « Grande Divergence Démographique ».
L’Afrique augmentera les bénéfices de la migration internationale en renforçant les mécanismes d’action collective et en investissant dans des compétences recherchées dans le monde, tant au niveau national qu’en coordination avec les pays de destination.
Glossaire
Ce glossaire présente des descriptions générales, et non des définitions juridiques précises, des termes utilisés dans le présent rapport. Toutefois, ces descriptions comportent des éléments juridiques et stratégiques relatifs à la façon dont ces termes sont compris et appliqués en pratique. Ce glossaire est adapté du Rapport sur le développement dans le monde 2023 : Migrants, réfugiés et sociétés.
apatride Personne qui n’est considérée comme ressortissante d’aucun pays.
asile ou statut de réfugié Statut juridique qu’un État accorde à un réfugié sur son territoire au terme d’une procédure judiciaire ou administrative. Ce statut confère aux individus concernés la protection internationale des réfugiés en empêchant leur renvoi (conformément au principe de non-refoulement), en régularisant leur séjour sur leur territoire d’accueil et en leur accordant certains droits pendant qu’ils s’y trouvent.
centre géographique de l’Afrique Pays situés à l’ouest, au centre et à l’est du continent : Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cap-Vert, Cameroun, Comores, Côte d’Ivoire, Djibouti, Guinée équatoriale, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Niger, Nigéria, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, République du Congo, Rwanda, São Tomé-et-Príncipe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe.
demandeur d’asile Ressortissant d’un pays tiers qui demande l’asile. À des fins statistiques, il s’agit d’une personne qui a présenté une demande d’asile sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement.
diaspora Population d’un pays donné, qui est dispersée dans des régions ou des pays distincts de son lieu géographique d’origine.
émigrant Personne qui quitte son pays de résidence habituelle pour s’établir dans un autre pays. Ce terme est utilisé du point de vue du pays d’origine de la personne concernée.
immigrant Personne qui déménage dans un pays pour y établir sa résidence habituelle. Ce terme est utilisé du point de vue du pays de destination de la personne concernée.
migrant Dans le présent rapport, personne qui quitte son pays de résidence habituelle pour s’installer dans un autre pays dont il n’a pas la citoyenneté. Ce changement de pays ne tient pas compte des déplacements de courte durée à des fins telles que les loisirs, les affaires, un traitement médical ou un pèlerinage religieux.
migrant économique Personne qui franchit une frontière internationale non pas par crainte de persécution ou d’éventuelles atteintes graves ou de la mort, mais pour d’autres raisons, telles que l’amélioration de ses conditions de vie en allant travailler ou retrouver sa famille à l’étranger. Ce terme englobe les migrants travailleurs ou travailleurs migrants qui se déplacent principalement pour travailler dans un autre pays.
migrant en détresse Personne qui émigre vers un autre pays dans des conditions de détresse, mais qui ne répond pas aux critères applicables pour obtenir le statut de réfugié. Cette migration est souvent irrégulière et dangereuse.
migrant en situation irrégulière Migrant qui n’est pas légalement autorisé à entrer ou à séjourner dans un pays donné (également appelé migrant sans papiers).
migrant en situation régulière Migrant qui est légalement autorisé à entrer ou à séjourner dans un pays donné.
non-refoulement Principe juridique interdisant aux États de renvoyer toute personne vers un pays ou un territoire où elle pourrait être exposée à des persécutions, à la torture ou à d’autres atteintes graves.
pays/société d’accueil Pays dans lequel un réfugié s’établit, temporairement ou définitivement.
pays/société de destination Pays vers lequel une personne émigre.
pays/société d’origine Pays que quitte un migrant ou un réfugié.
périphérie géographique de l’Afrique Pays situés au nord et au sud du continent : Afrique du Sud, Algérie, Botswana, Eswatini, Lesotho, Libye, Maroc, Maurice, Namibie, République arabe d’Égypte, Seychelles et Tunisie.
personne déplacée à l’intérieur de son propre pays (PDI) Personne qui a été déplacée à l’intérieur des frontières d’un État pour éviter la persécution, des atteintes graves ou la mort, notamment en raison d’un conflit armé, de situations de violence généralisée, de violations des droits humains ou de catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme.
protection (internationale) complémentaire Forme de protection internationale fournie par un pays ou une région à des personnes qui ne bénéficient pas du statut de réfugié, mais qui peuvent néanmoins avoir besoin d’une protection internationale. Les États utilisent divers mécanismes juridiques et directifs pour régulariser l’entrée ou le séjour de ces personnes sur leur territoire ou empêcher leur renvoi (conformément au principe de non-refoulement).
protection internationale Protection juridique accordée par des États à des réfugiés ou autres personnes déplacées sur leur territoire qui ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine
parce qu’ils y seraient en danger et parce que celui-ci ne peut ou ne veut pas les protéger. La protection internationale a un statut juridique qui, au minimum, empêche le renvoi de ces réfugiés ou autres personnes déplacées (conformément au principe de non-refoulement) et régularise leur séjour sur le territoire d’accueil.
réfugié Personne à qui un pays d’asile a accordé une protection internationale en raison d’une crainte de persécution, de conflit armé, de violence ou de troubles graves à l’ordre public dans son pays d’origine. La protection internationale que les pays accordent aux réfugiés a un statut juridique distinct (voir asile ou statut de réfugié) qui empêche que ces derniers soient renvoyés (conformément au principe de non-refoulement), en régularisant leur séjour sur leur territoire d’accueil et en leur accordant certains droits pendant qu’ils s’y trouvent, en application de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et de son Protocole de 1967 ou d’autres instruments juridiques internationaux, régionaux ou nationaux.
Sigles et acronymes
ABMMO accord bilatéral sur les migrations de main-d’œuvre
ABSS accord bilatéral de sécurité sociale
CCG Conseil de coopération du Golfe
CEA centre d’excellence africain
CEDEAO Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
CER communauté économique régionale
GSPM partenariat mondial sur les compétences et la migration
HCR Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
MoU mémorandum d’accord
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
OIM Organisation internationale pour les migrations
PARC prêt à remboursement contingent au revenu
PDI personne déplacée à l’intérieur de son propre pays
PIB produit intérieur brut
SADC Communauté de développement de l’Afrique australe
UE Union européenne
WHR Guichet pour les réfugiés et les communautés d’accueil
introduction
Présentation générale
La migration africaine est une histoire de mouvements guidés par la quête de perspectives économiques proches ou lointaines, la recherche de sécurité, le besoin urgent d’échapper à des conditions environnementales adverses, et la force des liens familiaux. Volontaire ou forcée, la migration révèle la résilience et la capacité d’adaptation de l’Afrique, en traçant des voies qui s’étendent sur tout le continent et qui atteignent des régions aussi éloignées que l’Europe, les Amériques ou le Moyen-Orient. Pourtant, le potentiel de transformation de la migration, qui pourrait permettre d’améliorer la vie des Africains, demeure largement inexploité. Pour que les avantages de la migration contribuent au développement de l’Afrique, les décideurs politiques et les communautés des pays d’origine, de transit et de destination doivent déployer des stratégies capables de mettre en valeur le potentiel économique de la mobilité, tout en préservant la dignité et les droits de tous les migrants et réfugiés.
La clé de l’avenir de l’Afrique réside dans sa capacité à préparer sa jeunesse en plein essor à relever les défis de développement du continent. La migration, une réponse en grande partie sous-employée, peut profiter à la région. Près de 60 % de la population africaine étant âgée de moins de 25 ans, la jeunesse se situe au cœur de la transformation économique, sociale et politique du continent. Pour pouvoir tirer parti de son dividende démographique, l’Afrique doit relever simultanément plusieurs défis qui freinent son développement : une transformation économique qui n’a pas encore permis d’obtenir les gains de productivité escomptés ; les effets du changement climatique ; et les problèmes persistants de fragilité, de conflit et de violence.
L’Afrique, et plus particulièrement l’Afrique subsaharienne, abritera bientôt une part importante de la population active mondiale. D’ici à 2050, une personne sur trois en âge de travailler (âgée de 15 à 34 ans) sera née sur le continent. Pour l’Afrique et pour le monde, l’enjeu est de créer des emplois viables en attirant des capitaux et d’autres ressources vers l’abondante main-d’œuvre africaine ou en facilitant la migration de cette main-d’œuvre vers des régions
disposant de ces ressources. Cette perspective nécessite de renforcer et de mobiliser le potentiel productif de la main-d’œuvre. La capacité à répondre à ces enjeux sera déterminante pour le développement de l’Afrique. Le présent rapport sur les migrations transfrontalières en Afrique examine comment le continent peut tirer profit du potentiel de la migration pour créer des opportunités économiques à l’intérieur et en dehors de l’Afrique.
État des lieux de la migration africaine
À ce jour, le taux d’émigration des Africains, notamment des ressortissants des pays d’Afrique de l’Ouest, du Centre et de l’Est, reste limité par rapport à celui d’autres régions du monde. Bien que les migrants africains représentent près de 15 % du stock international de migrants, moins de 1 % de la population d’Afrique subsaharienne migre vers un pays situé hors d’Afrique. La majeure partie de la migration en provenance d’Afrique subsaharienne s’effectue entre des pays appartenant aux mêmes communautés économiques régionales. Pour les pays d’Afrique du Nord, le taux de migration à l’extérieur de la sous-région est plus proche de 5 %.
De plus, quand elle a lieu, la migration apporte généralement peu d’avantages économiques aux migrants et à leurs sociétés d’origine. Puisque l’émigration s’effectue principalement vers un pays voisin, les pays d’Afrique de l’Ouest, du Centre et de l’Est reçoivent les plus faibles envois de fonds par habitant de toutes les régions du monde. En outre, en 2020, les déplacements forcés représentaient 30 % du total des flux migratoires transfrontaliers en Afrique. Les migrations irrégulières et de détresse placent les migrants, et plus particulièrement les femmes, dans des situations de vulnérabilité qui mettent à l’épreuve la résilience des communautés d’accueil. Bien que les traversées maritimes irrégulières vers l’Europe ne représentent qu’une faible part du total des entrées, leur coût humain en termes de décès en mer et de violations des droits humains au cours du trajet est considérable.
Toutefois, cette vision rétrospective de la migration africaine cache un phénomène dynamique, caractérisé par une évolution des destinations et de la composition des flux migratoires. Tandis que les migrants africains ont toujours migré vers d’autres pays du continent ou vers l’Europe, les pays de destination se diversifient de plus en plus, avec une augmentation des migrations vers les pays d’Amérique du Nord et du Conseil de coopération du Golfe. Le profil des migrants évolue également : leur niveau d’instruction est plus élevé et la proportion de femmes a augmenté, atteignant 45 % sur l’ensemble du continent. En parallèle, des pays comme le Kenya, le Maroc et la Tunisie suivent les traces d’autres pays, comme l’Afrique du Sud et la République arabe d’Égypte, en devenant des pays de destination pour un nombre croissant de migrants, principalement originaires d’autres pays africains.
Par ailleurs, le continent africain abrite plus d’un tiers des personnes déplacées de force dans le monde et plus d’un quart de la population mondiale de réfugiés. On estime à 32,6 millions le nombre de personnes déplacées internes (PDI), à 8,2 millions le nombre de réfugiés et à 1,1 million le nombre de demandeurs d’asile en Afrique. L’instabilité politique chronique et les effets du réchauffement climatique exposent un nombre croissant d’Africains au risque d’être déplacés de force, à l’intérieur ou à l’extérieur des frontières de leur pays. Il est essentiel d’avoir conscience que ces situations de déplacement sont vraisemblablement amenées à perdurer.
Il est donc nécessaire de tirer parti du potentiel économique des réfugiés et des PDI, en instaurant des systèmes de protection durables et en ouvrant des voies permettant une intégration plus rapide dans les sociétés d’accueil actuelles ou futures.
Migration : exploiter le potentiel de l’Afrique
L’Afrique se situe à la croisée de grandes tendances mondiales : une forte croissance de la jeunesse associée à des opportunités économiques limitées, une augmentation des risques climatiques et une fragilité étatique. Les conséquences de la Grande Divergence Démographique entre les pays d’Afrique de l’Ouest, du Centre et de l’Est et les pays à revenu élevé et intermédiaire supérieur sont exacerbées par la lenteur de la transformation structurelle, la gravité des effets du changement climatique et l’instabilité politique chronique qui affecte de nombreux États africains.
À l’inverse, les populations des pays à revenu élevé et intermédiaire supérieur vieillissent rapidement. Pour maintenir le ratio actuel entre la population en âge de travailler et les personnes âgées, plus de 130 millions d’actifs supplémentaires seront nécessaires dans l’Union européenne d’ici à 2050, sans quoi le produit intérieur brut pourrait perdre 12 %. Les autres mesures possibles, comme le relèvement de l’âge du départ à la retraite, l’augmentation de la participation des femmes au marché du travail et l’automatisation, ne permettront pas de combler entièrement le déficit, en particulier dans le secteur des services non exportateurs, où les possibilités d’automatisation et de délocalisation sont limitées.
Pourtant, les travailleurs africains se heurtent à des obstacles qui les empêchent de saisir les possibilités offertes par la Grande Divergence Démographique. Le principal obstacle est le niveau de compétences des jeunes africains, qui est nettement inférieur à celui des actifs qui partent à la retraite dans les pays à revenu élevé et intermédiaire supérieur. Par exemple, le nombre moyen d’années de scolarité ajustées à l’apprentissage dans les pays d’Afrique de l’Ouest, du Centre et de l’Est est de 4,8, contre 10,7 dans les principaux pays de destination européens. En outre, les migrants africains qui possèdent un haut niveau d’instruction et qui sont déjà présents dans des pays de l’OCDE à revenu élevé travaillent souvent dans des secteurs ou des métiers peu ou moyennement qualifiés, car leurs qualifications ne sont pas reconnues, ou, car leurs compétences linguistiques ou socio-comportementales font défaut.
De plus, dans de nombreux pays de destination, l’immigration suscite une forte opposition auprès d’une partie de l’électorat, en particulier lorsqu’elle est en provenance d’Afrique subsaharienne. L’immigration figure régulièrement en tête des préoccupations des citoyens. De récentes élections nationales ou européennes ont vu la montée en puissance de partis aux programmes résolument anti-immigration. Bien que le racisme et la xénophobie puissent susciter certaines attitudes à l’égard de l’immigration, les politiques des pays d’origine et de destination peuvent mettre la migration africaine au service des sociétés d’origine et de destination.
Des politiques propices à une meilleure migration : avant le départ, pendant le séjour migration et après le retour
Pour les pays d’origine et de destination, une meilleure migration suppose une forte adéquation entre les migrants et la société de destination. Les gains générés par la migration transfrontalière
sont maximisés lorsque les compétences des migrants répondent à la demande sur les marchés du travail des pays de destination. Non seulement les migrants doivent acquérir des compétences et des qualifications avant leur départ, mais celles-ci doivent être reconnues dans le pays de destination. Toutefois, des frictions informationnelles empêchent une mise en adéquation efficace entre l’offre et la demande. À cet égard, les agences de recrutement privées et d’autres intermédiaires jouent un rôle essentiel en veillant à la transparence de l’information, aussi bien auprès des travailleurs migrants que de leurs employeurs. En outre, dans les pays de destination, l’ouverture ou l’élargissement de voies légales d’accès correspondant aux besoins du marché du travail contribue à pallier la pénurie de compétences actuelle et anticipée. La migration estudiantine constitue une réponse à plusieurs enjeux de politiques publiques, dont la reconnaissance des compétences et l’intégration sociale.
La mise en adéquation peut être améliorée par l’existence d’alternatives à la migration. En proposant d’autres moyens de s’adapter et des débouchés sur le marché du travail, il est possible d’élargir les options des personnes qui envisagent de migrer à l’étranger, notamment en situation irrégulière. Bien que ce rapport n’ait pas pour objet d’identifier l’ensemble des politiques nationales de développement pouvant créer des perspectives alternatives à la migration, l’impact de ces politiques sur la composition des flux migratoires sera plus important si elles ciblent des groupes de population ou des zones spécifiques affichant des taux d’émigration élevés. De plus, les accords sur la mobilité de la main-d’œuvre, qui facilitent les mouvements entre pays membres d’une même communauté économique régionale, permettent aux migrants d’accéder à des pôles régionaux où les perspectives économiques offrent une alternative à la migration irrégulière.
Les politiques complémentaires sont essentielles pour que l’expérience de la migration soit gratifiante pour les migrants et bénéficie aux sociétés d’origine et de destination. Les avantages de la migration sont maximisés lorsque les migrants se voient accorder le droit de travailler, ne subissent aucune discrimination sur le marché du travail et bénéficient de conditions de travail et de salaires décents. Ces conditions permettent de mettre tout leur potentiel productif à contribution. Toutefois, l’intégration des migrants dans la société de destination entraîne certains coûts, qui peuvent être atténués par des politiques favorisant l’intégration et de la cohésion sociale et s’attaquant aux effets distributifs qui affectent les populations locales. Pour les pays d’origine, les bénéfices de la migration peuvent être amplifiés par la réduction des coûts des envois de fonds, par la création de mécanismes et de systèmes d’incitation à l’investissement auprès de la diaspora et par la mise en œuvre de politiques sociales qui aident les familles restées au pays et préparent le retour éventuel des migrants.
Pour que la migration génère des gains durables, il est nécessaire de créer un environnement politique qui favorise la réintégration et incite au retour. Les voies légales d’accès temporaires sont viables lorsque toutes les parties respectent les dispositions relatives au retour. Dans le cas contraire, les responsables politiques des pays de destination peuvent recourir à différents moyens, comme l’application des lois sur l’immigration et l’octroi d’incitations financières.
Pour favoriser la réintégration des rapatriés dans leurs communautés d’origine, les pays d’origine doivent reconnaître les compétences, qualifications et expériences acquises à l’étranger et apporter un soutien technique, administratif et financier afin de valoriser leur potentiel économique, favoriser la cohésion sociale et ainsi, encourager les retours.
Des politiques aux résultats : les systèmes nationaux et régionaux de migration
Construire des systèmes de migration est essentiel pour que les pays d’origine puissent collecter des informations, tout en élaborant et en instaurant des politiques afin d’encadrer les acteurs privés et publics. Des mécanismes de coordination s’imposent pour remédier à la fragmentation des compétences en matière de politique migratoire entre les différentes agences gouvernementales. Ces mécanismes permettent d’évaluer les besoins statistiques, financiers et en ressources humaines afin de proposer, d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques qui favorisent une meilleure migration.
De plus, pour permettre une régulation efficace des mouvements transfrontaliers, les pays d’origine et de destination doivent se coordonner par le biais d’instruments politiques tels que les accords bilatéraux sur les migrations de main-d’œuvre (ABMMO). Les politiques destinées à maximiser l’adéquation entre les migrants et leurs pays de destination et à pallier les éventuelles externalités négatives des mouvements transfrontaliers nécessitent des investissements spécifiques dans une offre de formation appropriée dans les pays d’origine, ou dans des politiques d’intégration sociale dans les pays de destination, par exemple. Ces démarches prendront du temps à produire leurs effets. Pour inciter les pays d’origine et de destination à entreprendre de tels investissements, des référentiels comme les ABMMO fournissent un cadre à ce type de coordination bilatérale. Pourtant, les pays de l’Afrique de l’Ouest, du Centre et de l’Est ont adopté peu de dispositifs de coordination de ce genre, nonobstant une augmentation récente.
Des mécanismes d’action collective permettent que les accords bilatéraux répartissent équitablement les bénéfices économiques de la migration entre les pays d’origine et de destination. En négociant collectivement, et non individuellement, les nations africaines évitent un nivellement par le bas. Elles obtiennent ainsi l’amélioration des salaires et des conditions de travail des travailleurs migrants, une plus grande participation des pays de destination au financement de l’éducation et de la formation dans les pays d’origine, et plus généralement, une aide accrue des pays de destination pour soutenir les objectifs de développement des pays d’origine. Ces mécanismes d’action collective peuvent être intégrés à des institutions régionales comme l’Union africaine et les communautés économiques régionales, ou formés à travers des coalitions ad hoc. Ils peuvent cibler un secteur spécifique, tel que la santé, ou avoir une portée plus globale. Bien qu’il s’agisse de mécanismes intergouvernementaux, ils devraient impliquer les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs, et bénéficier de l’assistance technique des partenaires de développement.
Déplacements forcés : exploiter le potentiel économique des réfugiés et des personnes déplacées internes (PDI)
L’Afrique a été pionnière dans l’adoption de cadres juridiques régissant la protection et l’assistance aux réfugiés et aux PDI. La convention de l’Organisation de l’unité africaine de 1969, premier instrument régional sur les réfugiés, a introduit plusieurs innovations importantes en droit international. Elle reste à ce jour le seul instrument régional juridiquement contraignant sur les réfugiés. De même, la convention de Kampala est le premier et l’unique instrument juridiquement contraignant portant sur les déplacements internes. Elle fournit un cadre
juridique complet encadrant les déplacements internes dans la région Afrique. Toutefois, dans les faits, l’accès des personnes déplacées aux possibilités sociales et économiques est faible. Environ 54 % des réfugiés en Afrique vivent encore dans des camps et plus de 80 % résident dans des zones rurales où l’accès aux marchés est limité et la mobilité restreinte.
Devant l’augmentation du nombre de réfugiés et de PDI de longue durée, et face à la diminution des ressources fournies par les pays d’accueil et la communauté internationale, une solution viable consiste à aider ces populations à subvenir à leurs propres besoins. Créer des conditions qui permettent de mobiliser le potentiel économique des personnes déplacées de force contribue à préserver leur dignité et à protéger leur bien-être, tout en leur permettant de contribuer à l’économie du pays d’accueil. Les politiques destinées à mettre en place des systèmes de protection viables s’efforcent de maximiser l’autonomie des réfugiés et des PDI, tout en répondant aux enjeux de sécurité et d’économie politique. L’aide humanitaire et l’aide au développement doivent encourager les communautés de réfugiés et de PDI à subvenir à leurs propres besoins. Cela suppose de développer les compétences de ces communautés afin de répondre aux besoins des marchés du travail des pays d’accueil, d’atténuer les impacts négatifs sur les travailleurs locaux, de créer les conditions permettant au secteur privé d’employer ces compétences localement, ou de permettre aux populations déplacées de force d’accéder à des débouchés ailleurs dans le pays, voire dans la région, à condition que des protections légales soient mises en place pour assurer leur sécurité.
Chapitre 1
État des lieux de la mobilité en Afrique
LA MOBILITÉ AFRICAINE EN CINQ FAITS
Fait n° 1. Les Africains migrent rarement en dehors du continent.
Moins de 1 % de la population de la région quitte le continent, bien moins que la moyenne mondiale.
Fait n° 2. Les Africains qui quittent le continent migrent de plus en plus vers l’Amérique du Nord et les pays du Conseil de coopération du Golfe, et de moins en moins vers l’Europe.
Les trois quarts des migrants africains qui quittaient le continent se rendaient en Europe, contre un peu plus de la moitié aujourd’hui.
Fait n° 3. De nombreux États africains deviennent des pays de destination des migrants.
Les pays d’Afrique du Nord s’imposent de plus en plus comme des pays de destination, et non comme de simples lieux de transit pour les personnes migrant vers l’Europe. La Côte d’Ivoire, le Kenya et l’Afrique du Sud reçoivent au moins deux fois plus de migrants qu’ils n’en envoient.
Fait n° 4. La migration irrégulière sur le continent est la plus dangereuse au monde.
Près de 5 000 décès de migrants africains ont été observés en 2023, un nombre plus de deux fois supérieur à celui des migrants originaires d’Asie et environ quatre fois supérieur à celui des migrants originaires d’Amérique latine.
Fait n° 5. L’Afrique accueille un quart de la population mondiale de réfugiés.
La plupart des réfugiés migrent vers un pays voisin. Dix pays seulement accueillent près de 90 % d’entre eux.
Les Africains migrent rarement en dehors du continent
La proportion d’Africains subsahariens qui migrent hors du continent est faible par rapport aux moyennes mondiales. Bien que l’Afrique subsaharienne concentre 85,3 % de la population du continent, moins de 1 % de ses résidents migrent en dehors de l’Afrique. Or, la moyenne
mondiale s’élève à 1,7 % pour la migration intercontinentale. Par comparaison, la région Amérique latine et Caraïbes et la région Asie du Sud affichent des taux plus élevés, avec respectivement 5 et 2 % de leur population qui s’établissent dans d’autres parties du monde. Les pays d’Afrique du Nord, contrairement au reste de l’Afrique, comptent environ 5 % de leur population à l’étranger, ce qui reflète la tendance historique des populations des pays méditerranéens à migrer vers les pays d’Europe et du Conseil de coopération du Golfe (CCG). En 2020, environ 60 % des migrants originaires d’Afrique du Nord résidaient dans un pays européen, environ 30 % dans un pays du CCG ou du Moyen-Orient, et environ 7 % en Amérique du Nord. Si dans l’ensemble, la migration intercontinentale en provenance d’Afrique subsaharienne est faible, elle masque une diversité considérable. Certaines petites nations insulaires ont connu une émigration importante au cours des dernières décennies. Au Cap-Vert, aux Comores et à São Tomé-et-Príncipe, les ratios entre les ressortissants vivant à l’étranger et ceux résidant dans le pays sont de 130 %, 22 % et 18 %, respectivement. Sur les 700 000 CapVerdiens vivant à l’étranger, la majorité se trouve aux États-Unis ou en Europe (OIM, 2024).
Bien que la migration en provenance d’Afrique subsaharienne ait évolué dans le temps, elle s’effectue toujours en grande majorité à l’intérieur du continent. En 2020, 66 % des personnes ayant quitté un pays d’Afrique subsaharienne ont migré vers un autre pays d’Afrique, les trois quarts d’entre elles ayant rejoint un pays voisin (graphique 1.1). Le degré de migration intracontinentale est nettement plus élevé en Afrique subsaharienne qu’en Afrique du Nord, où ce type de migration est pratiquement inexistante, et que dans d’autres régions du monde : seuls 26 % des migrations en Amérique latine et dans les Caraïbes et 20 % en Asie du Sud s’effectuent au sein même de la région. La mobilité intracontinentale en Afrique subsaharienne persiste malgré l’évolution des tendances migratoires, marquée par une augmentation de la part des migrants rejoignant un autre continent.
Graphique 1.1 Part des migrants restant dans leur région d’origine, 2020
Amérique latine et Caraïbes
Amérique du Nord Asie du Sud
Source : Calculs basés sur des données matricielles bilatérales publiées dans Banque mondiale 2023c.
Les Africains qui quittent le continent migrent de plus en plus vers l’Amérique du Nord et les pays du CCG, et de moins en moins vers l’Europe
Les trajectoires des Africains qui quittent le continent se diversifient ; leurs destinations ne se focalisent plus sur l’Europe. La part des migrants africains installés dans un pays européen a diminué, passant de 73 % en 1960 à 55 % en 2020 (graphique 1.2). Dans les années 1960 et 1970, les deux tiers des migrants africains intercontinentaux s’établissaient en Allemagne, en Belgique, en France et au Royaume-Uni. Cette part est tombée à moins de 40 % en 2020.
Parallèlement, la proportion de migrants africains en Amérique du Nord est passée de 2 à 17 % au cours de la même période. Cette évolution reflète une tendance plus large, marquée par l’émergence de nouvelles routes migratoires : entre 2010 et 2020, le nombre d’Africains migrant vers un pays du CCG a augmenté de 50 %, dépassant les 3,5 millions. Les pays du CCG accueillent aujourd’hui 20 % des Africains qui migrent hors du continent, notamment depuis l’Afrique de l’Est, et cette tendance est à la hausse. Par exemple, en 2020, les Éthiopiens représentaient 18 % du total des migrants originaires d’Afrique subsaharienne dans les pays du CCG, contre 7 % en 2000. L’ampleur de la migration vers les pays du CCG est probablement sous-estimée en raison de données limitées (encadré 1.1).
Migrants (millions)
Europe et Asie centrale Asie de l’Est et Pacifique Amérique du Nord Moyen-Orient
Source : Calculs basés sur des données matricielles bilatérales publiées dans Banque mondiale 2023c.
Graphique 1.2
Les données migratoires et leurs limites
Les principales données pour mesurer les stocks internationaux de migrants sont les recensements de population. Toutefois, leur efficacité est limitée par des problèmes d’actualité, de comparabilité et d’accessibilité. Dans les pays d’origine, les recensements sous-estiment souvent l’émigration, car ils ne comptabilisent pas les émigrants quand le ménage entier émigre. De plus, les recensements étant généralement effectués tous les dix ans, ils ne peuvent pas suivre les changements rapides des flux migratoires. Par ailleurs, les migrants en situation irrégulière et les réfugiés ne sont généralement pas recensés. Malgré ces difficultés, des bases de données sur la migration existent. Ainsi, la base de données de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), de la Banque mondiale et de l’Institut des migrations internationales porte sur les immigrants dans les pays membres et non membres de l’OCDE. Les estimations mondiales de l’Organisation internationale du travail, quant à elles, concernent les travailleurs migrants.a
Les divergences de méthodologie et de calendrier en matière de recensement empêchent d’obtenir des mesures précises. En Afrique subsaharienne, seuls 17 pays sur les 41 ayant participé à la vague de recensement de 2010 avaient intégré des questions sur l’émigration des ménages, et 30 avaient intégré une question sur le pays de naissanceb. Cela signifie que les migrants internationaux sont davantage enregistrés dans le pays de destination que dans le pays d’origine. En outre, certains recensements signalent le pays de naissance tandis que d’autres signalent le pays de citoyenneté. L’année de recensement peut également varier, ce qui complique les comparaisons entre les pays, en particulier lorsque des événements migratoires importants ont lieu. Par exemple, le Mozambique a effectué son recensement en 2007 tandis que l’Afrique du Sud l’a conduit en 2011, ce qui se traduit par des différences statistiques entre les données migratoires des deux pays. Néanmoins, de récents projets statistiques ont été menés à l’échelle régionale en Afrique de l’Est, de l’Ouest et australe afin d’harmoniser les données entre différents groupes de pays (Banque mondiale 2021, 2023a, 2023b).
Concernant les données sur la migration irrégulière et les populations réfugiées, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) apportent des sources complémentaires précieuses, ayant toutefois leurs propres limites. L’OIM utilise des « Matrices de suivi des déplacements » pour observer les mobilités irrégulières et de détresse, à des fins humanitaires. Mais ce dispositif ne collecte pas d’informations au niveau individuel et ne couvre pas suffisamment de nombreux pays, ce qui nuit à la représentativité des données. Certains pays comme la Libye disposent de plusieurs points de surveillance, contrairement à beaucoup d’autres. Le type d’informations collectées varie également selon le pays et la période. Le HCR recueille systématiquement des données sur les réfugiés et autres « personnes relevant de sa compétence », mais ne couvre pas les (suite page suivante)
Encadré 1.1 Les données migratoires et leurs limites (suite)
populations qui dépassent le cadre de son mandat. Enfin, le chevauchement de différentes sources de données rend la précision et la cohérence difficiles.
Il est difficile de confronter des données de sources différentes, quand elles sont disponibles. La plupart des pays ne disposent pas d’enquêtes spécifiques, en particulier d’enquêtes longitudinales et géolocalisées (Di Maio, Marzo et Sciabolazza, 2024). La région du Maghreb, en Afrique du Nord, qui connaît des schémas migratoires variés et en évolution rapide, illustre cette difficulté. La plupart des pays ont réalisé une nouvelle vague de recensements entre 2020 et 2024, mais les nouvelles données ne sont pas encore disponibles. La Tunisie organise actuellement un recensement. Bien que le Maroc ait fourni certaines informations sur les personnes nées à l’étranger, actuellement en libre accès, ce n’est pas le cas pour d’autres pays de la région. En outre, les données de la Matrice de suivi des déplacements ne sont disponibles qu’en Libye, ce qui complique l’estimation et le suivi dans le temps du nombre total de migrants dans la sous-région.
a. respectivement, Organisation de coopération et de développement économiques (OCDe) (https://www.oecd .org/migration/mig/oecdmigrationdatabases.htm) et Organisation internationale du travail (OiT) (https://www.ilo .org/publications/ilo-global-estimates-international-migrant-workers-results-and-methodology).
b. respectivement, Division des statistiques des Nations unies (uNSTAT) (https://unstats.un.org/unsd/demographic -social/sconcerns/migration/) et uNSTAT (consulté le 19 juin 2024, https://unstats.un.org/unsd/demographic-social /census/censusdates/).
De nombreux États africains deviennent des pays de destination des migrants
Jusqu’à récemment, les migrations au sein de l’Afrique avaient lieu principalement entre des pays liés par des liens économiques et des accords juridiques de libre circulation. En 2020, le continent comptait 22 millions de migrants africains, dont plus de 21 millions originaires d’Afrique subsaharienne. Près de 95 % d’entre eux migraient à l’intérieur de leur communauté économique régionale (CER). Les huit CER d’Afrique considèrent toutes que la libre circulation des ressortissants est un principe fondamental de l’intégration régionale. Cependant, sa mise en œuvre est limitée et la plupart des mouvements restent informels. Par exemple, en 2020, environ 7,6 millions de migrants internationaux résidaient dans la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), et plus de 89 % d’entre eux étaient originaires d’un pays de la CEDEAO (graphique 1.3). Ce nombre est probablement sous-estimé, car les données ne reflètent pas l’intégralité de la migration temporaire et saisonnière, qui affiche des niveaux élevés (encadré 1.1). Les principaux pays de destination sont la Côte d’Ivoire et le Nigéria, qui attirent des migrants originaires du Bénin, du Burkina Faso, du Ghana et du Mali (carte 1.1). Dans la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), les migrants empruntent de plus en plus des itinéraires informels et non réglementés, régularisant leur mouvement dans un second
temps, par le biais de diverses pratiques. Les migrants représentent 2,1 % de la population de la SADC, mais seulement 1 % si l’on considère uniquement les migrants originaires d’un pays membre de la SADC. L’Afrique du Sud (7,1 %), le Botswana (4,7 %) et la Namibie (4,2 %) comptabilisent le plus grand nombre d’immigrants par habitant.
Graphique 1.3 Part des migrants originaires d’un pays membre de la CER, 2020 0
Source : Calculs basés sur des données matricielles bilatérales publiées dans Banque mondiale 2023c.
Note : uMA = union du Maghreb arabe ; CeN-SAD = Communauté des états sahélo-sahariens ; COMeSA = Marché commun de l’Afrique orientale et australe ; CAe = Communauté de l’Afrique de l’est ; CeeAC = Communauté économique des états de l’Afrique centrale ; CeDeAO = Communauté économique des états de l’Afrique de l’Ouest ; iGAD = Autorité intergouvernementale pour le développement ; Cer = Communauté économique régionale ; SADC = Communauté de développement de l’Afrique australe.
De nombreux pays d’Afrique subsaharienne attirent déjà plus de migrants qu’ils n’en envoient. Aujourd’hui, le Kenya accueille deux fois plus de migrants qu’il n’en envoie. Ces immigrants proviennent majoritairement de pays voisins et comprennent un nombre important de réfugiés et demandeurs d’asile. De même, la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud attirent deux fois plus de migrants issus de pays voisins qu’elles n’en envoient. En Côte d’Ivoire, les migrants transfrontaliers composent 9,7 % de la population, l’un des taux les plus élevés du continent (ICMPD 2022). La part du stock de migrants intrarégionaux présents en Afrique du Sud est en augmentation, le pays accueillant environ 77 % des migrants namibiens. L’Afrique du Sud accueille aujourd’hui 60 % des migrants originaires des pays de la SADC, contre 31 % en 1995 (Crush et al. 2022). Par ailleurs, Djibouti se présente de plus en plus comme un pays de transit et de destination des flux migratoires qui traversent le golfe d’Aden et au-delà. En 2023, les mouvements migratoires y ont augmenté de 25 % par rapport à 2022 : au total, 278 272 mouvements migratoires ont été enregistrés dans ce pays de 1,12 million d’habitants, la majorité en provenance d’Éthiopie (OIM 2023).
UMA
CEN-SAD COMESA CAE
CEEAC
CEDEAO IGAD
SADC
Carte 1.1 Schémas de mobilité en Afrique, 2020
MAROC
SAHARA OCCIDENTAL

CAP-VERT
GAMBIE
GUINÉE-BISSAU
Stock de migrants
100 000–249 000
250 000–499 000
ALGÉRIE

SÉNÉGAL


SIERRA LEONE
LIBÉRIA

500 000–1 000 000
1 000 000–1 400 000
CEDEAO IGAD SADC


BURKINA FASO

CÔTE D'IVOIRE





RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE
GUINÉE ÉQUATORIALE
SÃO TOMÉ-ET-PRÍNCIPE
Total des migrations reçues par pays



Communautés économiques régionales
GUINÉE BOTSWANA TUNISIE
RÉP. ARABE D’ÉGYPTE





000
000
500 000

RÉP. DÉM. DU CONGO GHANA
RÉP. DU CONGO


ÉRYTHRÉE


RÉP. DU CONGO CENTRAFRICAINE ÉTHIOPIE



AFRIQUE DU SUD

SUD ÉTHIOPIE


SÉNÉGAL MALAWI NAMIBIE


SEYCHELLES
TANZANIE


IBRD 48186 | JUIN 2024
Source : Calculs basés sur des données matricielles bilatérales publiées dans Banque mondiale 2023c. Note : La carte reprend les données disponibles en 2020. en janvier 2024, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont annoncé leur retrait de la CeDeAO. CeDeAO = Communauté économique des états de l’Afrique de l’Ouest ; iGAD = Autorité intergouvernementale pour le développement ; SADC = Communauté de développement de l’Afrique australe.
L’Afrique du Nord est progressivement en train de passer de sous-région d’origine et de transit à sous-région de destination pour un nombre croissant de migrants. Ce territoire a toujours été une importante source d’émigration et le reste encore aujourd’hui. D’après certaines estimations, la République arabe d’Égypte hébergeait 9 millions d’immigrants en 2022 (8,7 % de la population), tout en comptant 10 à 14 millions de ressortissants à l’étranger (OIM 2022b). Bien que les estimations varient selon les sources (cf. encadré 1.1), l’Égypte accueille le plus grand nombre d’immigrants de la région, en raison de son ouverture notoire aux migrants. Les réfugiés du Soudan constituent une part importante de la population égyptienne née à l’étranger ; d’après les dernières estimations, ils représenteraient près de la moitié du nombre total d’immigrants. Dans les autres pays d’Afrique du Nord à l’exception de la Libye, le nombre d’immigrants représente une part beaucoup plus faible de la population. En 2020, le Maroc accueillait 103 000 migrants et réfugiés (0,3 % de la population), tandis que 8,8 % des Marocains étaient expatriés (ETF 2021a). La Tunisie comptait 7,6 % de sa population à l’étranger, alors que seulement 0,5 % de ses résidents étaient nés à l’étranger (ETF 2021b)1. Pourtant, entre 2015 et 2020,
le nombre de migrants internationaux en Afrique du Nord a augmenté de plus d’un million, atteignant un total de 3,2 millions (1,3 % de la population totale), dont 61 % en provenance du continent africain 2. L’économie de l’Afrique du Nord évolue et sa population jeune demeure importante ; ses marchés du travail seront donc plus segmentés à l’avenir, ce qui entraînera une augmentation de l’immigration et de l’émigration des ressortissants très qualifiés (De Haas 2006).
La migration irrégulière sur le continent est la plus dangereuse au monde
Les routes migratoires en Afrique évoluent rapidement et sont souvent empruntées par des migrants en situation irrégulière exposés à de forts risques de violence. Ces routes résultent des restrictions légales et des contrôles frontaliers imposés par les pays de transit et de destination. Plusieurs itinéraires qui relient l’Afrique subsaharienne à l’Afrique du Nord traversent le désert du Sahara depuis l’Afrique de l’Ouest ou de l’Est. Les migrants commencent souvent leur voyage par des moyens légaux, mais font appel à des passeurs quand la répression et les restrictions légales s’intensifient, ou quand les moyens de transport commerciaux manquent (Di Maio, Marzo et Sciabolazza 2024). Ces situations soumettent les migrants à de graves difficultés et à des violations des droits humains, y compris des cas d’enlèvements, de traite des êtres humains, de violences sexuelles et d’exploitation. Sur la base de 16 000 entretiens menés en 2018 et 2019, le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) fait état de graves abus et dénombre 1 395 décès, 2 008 incidents de v iolences sexuelles et sexistes impliquant plus de 6 000 personnes, et 4 468 incidents de v iolence physique le long des routes migratoires (HCR 2020).
Les traversées maritimes irrégulières sont particulièrement périlleuses et entraînent un nombre alarmant de pertes humaines. Il existe trois grandes routes maritimes entre l’Afrique du Nord et l’Europe : la route de la Méditerranée centrale, avec des points de départ en Libye et en Tunisie ; la route de la Méditerranée occidentale qui arrive en Espagne, principalement depuis le Maroc ; et la route des Canaries. L’importance relative de ces routes a évolué au fil du temps : certaines ont gagné en importance tandis que d’autres sont devenues plus difficiles ou dangereuses. Depuis 2014, près de 50 000 migrants en transit seraient morts dans le monde (OIM 2022a). Les données sur les migrants disparus montrent qu’en 2023, l’Afrique affichait le pire bilan de toutes les régions (graphique 1.4) : la moitié des décès était survenue lors de tentatives de traversée de la mer Méditerranée. De plus, environ 45 % des migrants arrivés en Italie en 2018 ont déclaré avoir subi des violences physiques lors de leur transit dans un pays africain (Black et Sigman 2022 ; Busetta et al. 2021 ; OIM 2020 ; Banque mondiale 2018).
Graphique 1.4 Nombre de migrants morts ou disparus, par région de l’incident, 2014-2023
01 0002 0003 0004 0005 000 Nombre de migrants morts ou disparus
Méditerranée Afrique Asie Europe Amérique latine et Caraïbes Amérique du Nord
Source : Données du projet « Migrants disparus » de l’Organisation internationale pour les migrations (https://missingmigrants.iom.int/data).
Cependant, la plupart des migrations africaines vers d’autres continents s’effectuent par des voies d’accès légales. Le nombre de franchissements non autorisé des frontières reste relativement stable et ne représente qu’une petite fraction du total des flux. En Union européenne, le nombre d’entrées irrégulières reste pratiquement constant depuis 2014, à l’exception du pic provoqué par le conflit syrien en 2015. Même si les données indiquent une légère augmentation des entrées irrégulières depuis 2020, avec une hausse de 29 % des traversées maritimes irrégulières pour la seule année 2022, ce type d’entrées (maritimes et terrestres) ne représentaient en 2021 et 2022 que 12,4 % du nombre total de passages frontaliers des migrants africains vers l’Europe. Les ressortissants d’Afrique du Nord sont surreprésentés chez les migrants en situation irrégulière : leur nombre équivaut à 1,8 fois celui des migrants en situation irrégulière originaires du reste de l’Afrique. Ils représentent 60,8 % du nombre total de franchissements non autorisés des frontières par des ressortissants africains, tous pays d’origine confondus (graphique 1.5).
Graphique 1.5 Flux transfrontaliers irréguliers vers l’Europe
a. Cumul des franchissements de frontière en provenance d’Afrique du Nord et d’Afrique subsaharienne, 2021 et 2022
Franchissements
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
Afrique du Nord
Afrique subsaharienne Réguliers Irréguliers
b. Total trimestriel des franchissements non autorisés des frontières, 2014-2023
Franchissements
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
2014-T12014-T32015-T12015-T32016-T12016-T32017-T12017-T32018-T12018-T32019-T12019-T32020-T12020-T32021-T12021-T32022-T12022-T32023-T12023-T3
Sources : Les données sur les entrées régulières (premiers titres de séjour) proviennent d’eurOSTAT ; les données sur le nombre d’entrées irrégulières en europe proviennent du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Note : L’Afrique du Nord comprend l’Algérie, la Libye, le Maroc, la république arabe d’égypte, le Soudan et la Tunisie ; l’Afrique subsaharienne englobe tous les autres pays africains.
L’Afrique abrite un quart de la population mondiale de réfugiés
Les pays africains accueillent plus de 41 millions de personnes déplacées de force, le nombre le plus élevé de toutes les régions du monde (graphique 1.6, partie a). Les réfugiés constituent une part importante des migrants en Afrique : ils représentent un tiers du stock de migrants du continent (graphique 1.6, partie b). À la fin de 2023, sur les 31,6 millions de réfugiés dans le monde relevant de la compétence du HCR, 8,2 millions se trouvaient en Afrique. Plus de 70 % des réfugiés actuels sont originaires de cinq pays : la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, la Somalie, le Soudan et le Soudan du Sud, comme l’indiquent Sarzin et Nsababera (2024). Les conflits affectent également quelque 32,6 millions de personnes déplacées internes qui sont confrontées à des problèmes spécifiques (encadré 1.2).
Près de 90 % des réfugiés en Afrique se concentrent dans dix pays. Près de la moitié d’entre eux se trouvent en Éthiopie, en Ouganda ou au Tchad. Plus de 60 % des réfugiés vivent dans des
Graphique 1.6 Les réfugiés représentent une part importante des flux migratoires en Afrique
a. Déplacements forcés, par région, 2023
Asiedel’EstetPacifique
b. Part des déplacements forcés dans le total des mouvements transfrontaliers, 2020
Réfugiés Demandeurs d’asile PDI
Source : Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et Département des affaires économiques et sociales des Nations unies (https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock).
Note : pDi = personnes déplacées internes.
zones en situation de fragilité ou de conflit (Sarzin et Nsababera 2024). Depuis 2010, les Africains subsahariens qui s’établissent en Afrique du Nord proviennent majoritairement de l’Érythrée, de l’Éthiopie et du Soudan du Sud. En 2021 et 2022, les principaux pays d’origine étaient le Mali, le Niger et le Tchad. En 2023, le HCR a enregistré 254 300 nouveaux demandeurs d’asile en Afrique du Nord, principalement originaires d’Érythrée, d’Éthiopie, du Mali, du Soudan et du Soudan du Sud (HCR 2024). La crise au Soudan a provoqué le déplacement de plus de 2 millions de personnes vers l’Égypte, le Soudan du Sud et le Tchad. L’Afrique subsaharienne compte une forte proportion d’enfants réfugiés, ce qui se répercute sur la protection de l’enfance, les services de santé et d’éducation, ainsi que sur les mesures pour favoriser l’autonomie des réfugiés (Sarzin et Nsababera 2024). Bien que de nombreux réfugiés en Afrique subsaharienne vivent dans des camps planifiés ou des installations spontanées, ils sont de plus en plus nombreux à résider dans des logements individuels (Sarzin et Nsababera 2024).
ENCADRÉ 1.2
De hauts niveaux de déplacements internes
Les personnes déplacées internes (PDI) constituent la majorité des personnes déplacées de force en Afrique, mais elles reçoivent souvent moins d’aide et d’attention que les réfugiés. Au cours de la dernière décennie, les PDI ont représenté entre 67 et 79 % de la population déplacée de force en Afrique subsaharienne. Près de 80 % des PDI dénombrées aujourd’hui ont été déplacées à cause d’un conflit touchant l’un des cinq
(suite page suivante)
ENCADRÉ 1.2 De hauts niveaux de déplacements internes (suite)
Érythrée
Cameroun
République centrafricaine
Burkina Faso
Éthiopie
Soudan du Sud
Nigéria
Somalie
Rép. dém. du Congo
Soudan
Graphique B1.2.1 Un petit nombre de pays concentre la plupart des déplacements internes 0 4
Personnes déplacées (millions)
Réfugiés Demandeurs d’asile PDI
Source : Sarzin et Nsababera 2024.
Note : Le graphique représente le nombre de pDi par pays d’origine. pDi = personnes déplacées internes.
pays suivants : l’Éthiopie, le Nigéria, la République démocratique du Congo, la Somalie et le Soudan (Sarzin et Nsababera 2024) (graphique B1.2.1). L’aide apportée à cette population vulnérable est entravée par plusieurs facteurs comme l’absence de statut juridique obligeant les gouvernements et organismes internationaux à protéger ces personnes, la réticence de certains gouvernements à reconnaître la présence des PDI, les difficultés d’accès aux régions touchées par les conflits où vivent de nombreuses PDI, un suivi insuffisant des mouvements de population rapides et une couverture médiatique limitée (Sarzin et Nsababera, 2024).
Les catastrophes climatiques sont devenues une nouvelle source de déplacement internea. En 2022, la sécheresse la plus longue et la plus intense jamais enregistrée a provoqué 2,1 millions de déplacements internes en Éthiopie, au Kenya et en Somalie, la Somalie dénombrant à elle seule 1,1 million de déplacementsb. En 2023, les inondations qui ont frappé la Corne de l’Afrique après des années de sécheresse ont provoqué 1,7 million de déplacements en Somalie et 550 000 déplacements en Éthiopie (IDMC 2023). Les inondations ont également touché d’autres pays, entraînant 2,4 millions de déplacements au Nigéria en 2022 et 640 000 au Kenya en 2023 (IDMC 2024). Les tempêtes tropicales en Afrique australe ont provoqué près de 700 000 déplacements à Madagascar, au Malawi, au Mozambique et au Zimbabwe en 2022 (IDMC 2023, 2024).
La survenue de plusieurs phénomènes météorologiques extrêmes consécutifs prolonge parfois les situations de déplacement. Par exemple, à la fin de l’année 2022, au Mozambique, environ 127 000 personnes ont dû se déplacer à la suite de trois cyclones tropicaux et de deux tempêtes tropicales qui avaient frappé l’Afrique australe plus tôt
(suite page suivante)
ENCADRÉ 1.2 De hauts niveaux de déplacements internes (suite)
dans l’année. Certaines de ces personnes avaient déjà dû migrer à cause des cyclones Idai en 2019 et Éloise en 2021 (IDMC 2023).
a. Bien que les déplacements causés par les conflits recoupent des phénomènes démographiques et économiques, l’Observatoire des situations de déplacement interne (iDMC) estime qu’en 2023, les conflits et les catastrophes étaient à l’origine de 13,5 millions et 6,2 millions de déplacements internes, respectivement (iDMC 2023).
b. Les « déplacements internes » correspondent au nombre estimé de mouvements sur une période donnée. Les estimations ne représentent ainsi pas le nombre total de personnes, car les mêmes personnes peuvent avoir été déplacées plusieurs fois.
Notes
1. Selon le Conseil supérieur des Tunisiens à l’étranger, la part des Tunisiens enregistrés vivant hors de Tunisie s’élevait à 12,8 % en 2022.
2. https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock.
Bibliographie
Black, J., and Z. Sigman. 2022. “50,000 Lives Lost during Migration: Analysis of Missing Migrants Project Data 2014–2022.” Global Migration Data Analysis Centre, International Organization for Migration, Geneva.
Busetta, A., D. Mendola, B. Wilson, and V. Cetorelli. 2021. “Measuring Vulnerability of Asylum Seekers and Refugees in Italy.” Journal of Ethnic and Migration Studies 47 (3): 596–615.
Crush, J., V. Williams, A. Dakhal, and S. Ramachandran. 2022. Labour Migration in the Southern African Region: A Stocktaking. Southern African Migration Management Project. Pretoria, South Africa: International Labour Organization, Pretoria.
De Haas, H. 2006. “Trans-Saharan Migration to North Africa and the EU: Historical Roots and Current Trends.” Migration Policy Institute, Washington, DC. https://www.migrationpolicy.org/article/trans -saharan-migration-north-africa-and-eu-historical-roots-and-current-trends.
Di Maio, M., F. Marzo, and L. Sciabolazza. 2024. “Migration to and through North Africa: An Overview.” Background paper prepared for this report. World Bank, Washington, DC.
ETF (European Training Foundation). 2021a. “Skills and Migration Country Fiche Morocco.” ETF, Torino, Italy. https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2022-05/ETF%20Skills%20and%20Migration%20 Country%20Fiche%20MOROCCO_2021_EN%20Final.pdf
ETF (European Training Foundation). 2021b. “Skills and Migration Country Fiche Tunisia.” ETF, Torino, Italy. https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2021-11/etf_fiche_pays_competences_et _migration_tunisie_2021_fr.pdf.
ICMPD (International Centre for Migration Policy Development). 2022. “Migration Outlook 2022 : West Africa.” ICMPD, Vienna. https://www.icmpd.org/file/download/57218/file/ICMPD_Migration_Outlook _WestAfrica_2022.pdf
IDMC (Internal Displacement Monitoring Centre). 2023. “2023 Global Report on Internal Displacement (GRID).” IDMC, Geneva. https://www.internal-displacement.org/publications/2023-global-report-on -internal-displacement-grid/
IDMC (Internal Displacement Monitoring Centre). 2024. “2024 Global Report on Internal Displacement (GRID).” IDMC, Geneva. https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2024/
IOM (International Organization for Migration). 2020. “Calculating ‘Death Rates’ in the Context of Migration Journeys: Focus on the Central Mediterranean.” GMDAC Briefing Series: Towards Safer Migration in Africa: Migration and Data in Northern and Western Africa. IOM, Geneva.
IOM (International Organization for Migration). 2022a. “IOM Decries 50,000 Documented Deaths during Migration Worldwide.” IOM, Geneva. https://www.iom.int/news/ iom-decries-50000-documented-deaths-during-migration-worldwide.
IOM (International Organization for Migration). 2022b. “Triangulation of Migrants Stock in Egypt.” IOM, Geneva. https://egypt.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1021/files/documents/Migration%20Stock%20in%20 Egypt%20July%202022%20EN_Salma%20HASSAN.pdf
IOM (International Organization for Migration). 2023. “Djibouti, Country Overview.” IOM, Geneva.
IOM (International Organization for Migration). 2024. “Cabo Verde, Country Overview.” IOM, Geneva. Sarzin, Z., and O. Nsababera. 2024. “Forced Displacement: A Stocktaking of Evidence.” Background paper prepared for this report. World Bank, Washington, DC.
UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees). 2020. “On This Journey, No One Cares If You Live or Die: Abuse, Protection, and Justice along Routes between East and West Africa and Africa’s Mediterranean.” HCR, Genève. https://mixedmigration.org/wp-content/uploads/2020/07/127 _UNHCR_MMC_report-on-this-journey-no-one-cares-if-you-live-or-die.pdf
UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees). 2024. “Cartographie des services de protection : l’approche basée sur les routes pour les services de protection le long des routes de mouvements mixtes.” UNHCR, Geneva.
World Bank. 2018. “Asylum Seekers in the European Union: Building Evidence to Inform Policy Making.” World Bank, Washington, DC.
World Bank. 2021. “Eastern Africa Regional Statistics Program-for-Results.” Report P176371, World Bank, Washington, DC.
World Bank. 2023a. “Harmonizing and Improving Statistics in West and Central Africa.” Project Appraisal Document PAD5154, World Bank, Washington, DC.
World Bank. 2023b. “SADC Regional Statistics.” Project Appraisal Document PAD5178, World Bank, Washington, DC.
World Bank. 2023c. World Development Report 2023: Migrants, Refugees, and Societies. Washington, DC : World Bank.
Chapitre 2
Les grandes tendances convergentes en Afrique
Introduction
L’Afrique se trouve à un moment charnière : les enjeux démographiques se conjuguent à une faible croissance économique, à des conflits et à des risques climatiques, autant de facteurs propices à la migration1. La population du continent devrait passer de 1,5 milliard en 2024 à 2,5 milliards en 2050, avec une augmentation de la population en âge de travailler de plus de 600 millions de personnes. Cette rapide évolution démographique contraste avec la situation des pays à revenu élevé et intermédiaire supérieur du monde entier, où la population en âge de travailler perdra 200 millions d’individus. Toutefois, l’Afrique pâtit d’une faible croissance de la productivité et d’une baisse des revenus relatifs. À moins que les stratégies de réduction de la pauvreté ne modifient la trajectoire actuelle, 89 millions de personnes supplémentaires tomberont dans l’extrême pauvreté au cours des trente prochaines années. Environ 760 millions de personnes résident dans un pays confronté à une situation de fragilité chronique depuis plus d’une décennie, un nombre qui pourrait presque doubler d’ici 2050. De plus, deux personnes sur cinq sur le continent pourraient être exposées à un risque de chaleur extrême d’ici 2050.
Les grandes tendances en Afrique : une histoire de deux sous-régions
La situation varie considérablement au sein même du continent. Des taux de fécondité parmi les plus élevés au monde se trouvent en Afrique, notamment dans les pays d’Afrique de l’Est, du Centre et de l’Ouest (carte 2.1, partie a). La plupart de ces pays connaissent un faible niveau de développement (carte 2.1, partie b). Ils font partie des pays les plus exposés au changement climatique (carte 2.1, partie c). Un grand nombre d’entre eux se caractérisent par une instabilité politique chronique (carte 2.1, partie d). Inversement, les pays d’Afrique du Nord et d’Afrique australe, plus avancés dans leur transition démographique, disposent de revenus plus élevés. Ils sont relativement moins exposés à certaines manifestations du changement climatique. À l’exception de la Libye, ils ne subissent pas de conflits. Le présent rapport, tout en reconnaissant le caractère unique de chaque pays, se réfère ci-après au centre géographique de l’Afrique, qui englobe les pays des sous-régions Ouest, Centre et Est. Ces pays abritent 80 % de la population du continent. Les 20 % restants vivent en Afrique du Nord et en Afrique australe, qui forment la périphérie géographique de l’Afrique.
Carte 2.1 Confluence de facteurs en Afrique
a. Indice synthétique de fécondité
Projections du nombre d’enfants par femme
1,11
6,95 Pas de données
IBRD 46666 | FÉVRIER 2025
b. PIB par habitant
PIB par habitant (PPA en USD internationaux constants de 2017)
115 683,5
705,03 Pas de données
IBRD 46668 | FÉVRIER 2025
(suite page suivante)
Carte 2.1 Confluence de facteurs en Afrique (suite)
c. Vulnérabilité climatique
Score d’exposition
ND-GAIN (un score plus élevé indique une exposition plus importante)
0,25

0,72
Pas de données
d. Fragilité des États
IBRD 46667 | FÉVRIER 2025
Zones de fragilité et de conflit
Conflit de haute intensité
Conflit d’intensité moyenne
Grande fragilité institutionnelle et sociale
Pas de données
IBRD 46669 | FÉVRIER 2025
Sources : partie a : perspectives de la population mondiale des Nations unies, projections pour 2015-2020. partie b : indicateurs du développement mondial, Banque mondiale, 2021. partie c : ND-GAiN (Notre Dame Global Adaptation initiative), indice des pays 2019. partie d : Banque mondiale, Liste des situations de fragilité et de conflit 2022.
Note : piB = produit intérieur brut ; ppA = parité de pouvoir d’achat.
La croissance fulgurante de la jeunesse en Afrique annonce la Grande Divergence
Démographique
L’Afrique connaît la croissance démographique la plus rapide au monde. Sa population devrait dépasser les autres régions avant le milieu du siècle. Avant la fin du millénaire, la population du continent devrait fortement diverger de celle du reste du monde. La population africaine, qui totalise près de 1,5 milliard d’habitants en 2024, devrait atteindre 2,5 milliards au cours des trente prochaines années, tandis que la croissance démographique ralentit ailleurs. Au sein de l’Afrique, ce sont les pays du centre géographique qui atteignent aujourd’hui le taux de fécondité le plus élevé, avec 4,6 enfants par femme. Malgré une tendance à la baisse au cours des cinquante dernières années, ce taux restera le plus élevé au monde en 2050. En parallèle, toutes les autres régions du monde, y compris les pays de la périphérie géographique de l’Afrique, passeront sous le seuil du taux de remplacement. Le niveau élevé des taux de fécondité, conjugué à la baisse des taux de mortalité et à l’augmentation de l’espérance de vie, contribue à expliquer la trajectoire démographique unique du continent (graphique 2.1). Les pays du centre de l’Afrique abritent les quatre cinquièmes de sa population et sont les principaux moteurs de cet essor. D’ici à 2050, ces pays devraient englober 85 % de la population totale de l’Afrique.
Graphique 2.1 La population africaine sera la plus importante du monde en 2050, grâce à des taux de fécondité élevés, une espérance de vie en hausse et des taux de mortalité en baisse.
Population totale (milliards)
Reste du monde Afrique
Source : Calculs de l’équipe sur la base du scénario « moyen » des Nations unies 2022. Note : La projection du scénario « moyen » correspond à la moyenne de la fécondité et de la mortalité et à la médiane de la migration nette de plusieurs milliers de trajectoires différentes de chaque composante démographique, dérivées d’un modèle probabiliste de la variabilité des changements dans le temps.
La jeunesse africaine connaît une croissance démographique fulgurante. D’ici 2050, près d’un jeune sur trois dans le monde sera originaire d’Afrique. Le nombre de jeunes (âgés de 15 à 34 ans) en Afrique va presque doubler, passant de 499 millions en 2024 à 846 millions au milieu du siècle. Dans le même temps, la population en âge de travailler (âgée de 20 à 64 ans) devrait presque doubler, pour atteindre 1,3 milliard de personnes. Le dividende démographique dont pourrait bénéficier l’Afrique tient à l’augmentation du nombre de personnes en âge de travailler dans les pays du centre géographique, pouvant subvenir aux besoins des jeunes à charge et des personnes âgées. Or, cette tendance est en déclin ou en stagnation dans toutes les autres régions du monde (graphique 2.2). Les projections démographiques à long terme indiquent que ce ratio continuera d’augmenter au cours des soixante prochaines années, offrant ainsi des possibilités susceptibles de perdurer jusqu’au siècle prochain2.
Graphique 2.2 En Afrique, l’augmentation du nombre de personnes en âge de travailler par rapport aux enfants et aux personnes âgées annonce un dividende démographique.
Ratio entre la population en âge de travailler et le nombre d’enfants et de personnes âgées
Centre géographique de l’Afrique
Europe et Asie centrale
Asie du Sud
Amérique latine et Caraïbes
Périphérie géographique de l’Afrique
Moyen-Orient
Amérique du Nord
Asie de l’Est et Pacifique
Source : Calculs de l’équipe sur la base du scénario de fécondité « moyen » des Nations unies 2022.
Note : Les personnes en âge de travailler sont âgées de 20 à 64 ans ; les enfants sont âgés de 14 ans et moins ; et les personnes âgées sont âgées de 65 ans et plus.
Graphique 2.3 Dans les pays à revenu élevé et intermédiaire supérieur, la population en âge de travailler diminuera entre 2024 et 2050, tandis que la population âgée augmentera rapidement.
ans
ans et plus
Afrique PRE et PRITS hors Afrique
Source : Calculs de l’équipe sur la base du scénario de fécondité « moyen » des Nations unies 2022. Note : pre = pays à revenu élevé ; priTS = pays à revenu intermédiaire supérieur.
Hors d’Afrique, les pays à revenu élevé et intermédiaire supérieur connaissent une diminution de leur population en âge de travailler, causée par une accélération du vieillissement. Dans ces régions, le nombre de personnes âgées de 20 à 64 ans devrait baisser de 207 millions d’ici à 2050, tandis qu’il devrait augmenter de 622 millions en Afrique (graphique 2.3). La proportion de personnes âgées de 65 ans et plus dans les pays hors d’Afrique est passée de 8 % en 1950 à 19 % en 2023, et devrait atteindre près de 32 % en 2050. Dans les deux prochaines décennies, la population globale des pays à revenu intermédiaire supérieur devrait diminuer, et les pays plus riches devraient suivre cette tendance à partir du milieu du XXIe siècle. Cette évolution met en évidence la Grande Divergence Démographique entre l’Afrique et le reste du monde.
L’augmentation lente de la productivité et la stagnation du marché du travail limitent les possibilités offertes par la croissance démographique
La divergence démographique croissante offre une chance unique au continent, mais sa concrétisation est entravée par un retard persistant de la croissance économique par rapport à la croissance démographique3. Malgré certaines avancées en matière de réduction de la pauvreté, les revenus demeurent faibles par rapport au reste du monde. Même si les niveaux de produit intérieur brut (PIB) dans le monde tendent à converger depuis le début du siècle (la plupart des pays à faible revenu se rapprochent des pays à revenu plus élevé), les revenus des pays du centre
géographique de l’Afrique stagnent à moins de 21 % de la moyenne mondiale. Ils ont même diminué dans la dernière décennie (graphique 2.4, partie a)4. Le ralentissement économique observé après 2015 pourrait s’expliquer par plusieurs facteurs, dont des chocs provoqués par une résurgence des conflits dans divers pays, le poids considérable de la dette, les pénuries d’énergie et les pressions monétaires (Banque mondiale, à paraître a). Les disparités au sein du continent persistent également, avec un écart de niveau de vie important entre les pays de la périphérie et ceux du centre géographique du continent (graphique 2.4).
Si le taux de pauvreté en Afrique a diminué au cours des vingt dernières années, le nombre absolu d’individus pauvres a augmenté sous l’effet de la croissance rapide de la population. Dans les pays du centre de l’Afrique, l’extrême pauvreté, définie comme le fait de vivre avec moins de 2,15 dollars par personne et par jour (en parité de pouvoir d’achat de 2017), est passée de 55 % en 2003 à environ 40 % en 2014. Néanmoins, cette diminution s’est ralentie : le taux de pauvreté était de 38 % en 20225 Malgré cette baisse du taux de pauvreté, le nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté a augmenté, passant de 367 millions en 2003 à 434 millions en 2022. Par comparaison, dans les pays de la périphérie de l’Afrique, le nombre de personnes extrêmement pauvres est resté relativement faible et a diminué régulièrement, passant de 26 millions en 2003 à 16 millions en 2022 (graphique 2.5). La faible croissance économique et les fortes contraintes budgétaires entravent la réduction de la pauvreté. Sur les 42 pays qui composent le centre de l’Afrique, 19 présentaient un risque élevé de surendettement ou se trouvaient déjà en situation de surendettement en 2023 (Banque mondiale 2023a, 2024, à paraître a)6. Si aucune action n’est prise pour infléchir cette tendance, l’extrême pauvreté pourrait concerner jusqu’à 549 millions de personnes sur le continent d’ici 20507
Graphique 2.4 Le PIB par habitant dans le centre géographique de l’Afrique reste inférieur à un quart du PIB mondial
a. PIB par habitant dans le centre de l’Afrique par rapport au monde, 1990-2022
PIB par habitant (indice)
Centre géographique de l’Afrique
b. PIB par habitant dans la périphérie de l’Afrique par rapport au monde, 1990-2022
PIB par habitant (indice)
Périphérie géographique de l’Afrique
Sources : Calculs de l’équipe sur la base de Banque mondiale 2024 ; indicateurs du développement dans le monde (piB par habitant, ppA [uSD constants de 2017] et statistiques démographiques).
Note : piB mondial moyen par habitant = 100. piB = produit intérieur brut ; ppA = parité de pouvoir d’achat.
Graphique 2.5 L’extrême pauvreté demeure élevée dans les pays du centre géographique de l’Afrique
Population en situation d’extrême pauvreté (millions)
Périphérie géographique de l’Afrique Centre géographique de l’Afrique
Source : Calculs de l’équipe basés sur les données de la plateforme « pauvreté et inégalités » de la Banque mondiale (version 20240326_2017_01_02_prOD) [jeu de données], pip.worldbank.org.
Note : Le seuil d’extrême pauvreté est de 2,15 dollars par personne et par jour (parité de pouvoir d’achat de 2017). La Guinée équatoriale, l’érythrée, la Libye et la Somalie ne sont pas prises en compte dans les pays du centre géographique.
Le continent souffre d’un socle de compétences restreint et d’une forte proportion de jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation (graphique 2.6, partie b). La faiblesse du capital humain constitue un obstacle important à l’exploitation du dividende démographique. Malgré les progrès réalisés en matière de scolarisation, les indicateurs du niveau d’instruction, en particulier dans les pays du centre du continent, restent faibles par rapport aux moyennes mondiales. Dans la plupart des pays à l’exception de ceux d’Afrique du Nord, l’espérance de scolarisation est inférieure à 10 ans, en raison de taux d’abandon des études élevés, en particulier dans l’enseignement secondaire. La pauvreté des apprentissages, c’est-à-dire l’incapacité des enfants à lire et comprendre un texte simple à la fin de l’enseignement primaire, atteint 89 % dans les pays d’Afrique subsaharienne (Banque mondiale 2022). En 2020, les enfants des pays du centre n’avaient, en moyenne, que 4,7 années de scolarité ajustées à l’apprentissage. Bien que cet indicateur soit légèrement supérieur dans les pays de la périphérie, l’apprentissage et la scolarisation sont faibles sur l’ensemble du continent (graphique 2.6, partie a).
La transition démographique de l’Afrique entraîne une augmentation de la population urbaine, mais la croissance économique des zones urbaines reste modérée. Bien que la population du centre géographique de l’Afrique reste majoritairement rurale, le continent connaît à la fois une croissance urbaine (augmentation de la population urbaine) et une urbanisation (augmentation de la part de la population vivant en ville) (graphique 2.7). Toutefois, l’urbanisation ne se traduit ni par de meilleurs emplois ni par une croissance économique, en particulier dans les villes du centre riches en ressources naturelles, où l’activité économique repose davantage sur la consommation que sur la production. Ces villes, qui produisent principalement des services non exportables, sont isolées des marchés mondiaux (Lall, Henderson et Venables 2017)8. Les zones urbaines sont mal équipées pour faire face à l’exode rural : la planification et l’aménagement du territoire sont
Graphique 2.6 La durée de scolarisation en Afrique est inférieure à la plupart des pays du monde, et la proportion de jeunes ni en emploi, ni en études, ni en formation est élevée
a. Durée de scolarisation, 2011-2022
b. Parts de NEET, 2000-2021
de l’Est et
Années de scolarité ajustées à l’apprentissage Espérance de scolarisation
géographique de l’Afrique
géographique de l’Afrique
Sources : Calculs de l’équipe basés sur la méthodologie de Filmer et al 2020 ; OiT 2024.
Note : La durée de scolarisation et le NeeT sont basés sur les données de la dernière année disponible, entre 2011 et 2022 pour le niveau de scolarisation et entre 2000 et 2021 pour le NeeT. NeeT = ni en emploi, ni en études, ni en formation.
lacunaires, les politiques de développement économique sont inadéquates et les infrastructures publiques sont insuffisantes ou vieillissantes. Ces lacunes limitent l’accès aux services de base, notamment aux transports, au logement, à l’eau et à l’assainissement (Roberts et Anyumba 2022).
La progression actuelle de la productivité ne permettra pas d’offrir à la population suffisamment de débouchés au niveau national. Le continent a réalisé de faibles gains de productivité depuis les années 1960, en particulier dans le secteur agricole qui emploie la majeure partie de la population9. Bien que les taux d’emploi soient élevés (64,4 % dans le centre et 55,6 % dans la périphérie), la part de l’emploi salarié, qui génère des revenus moyens plus élevés, est faible dans les pays du centre (graphique 2.8, partie a)10. Seuls 23 % des travailleurs des pays du centre sont salariés, tandis que 55 % sont travailleurs indépendants. Bien que la part de l’emploi salarié soit plus élevée dans les pays de la périphérie, à hauteur de 70,5 % (graphique 2.8, partie b), plus de la moitié des travailleurs occupent un emploi dans des services non exportables et faiblement rémunérés. Dans l’ensemble, les emplois productifs ne progressent pas plus vite que la croissance démographique : entre 1991 et 2019, le ratio entre les emplois salariés et la population en âge de travailler s’est maintenu autour de 0,3 dans la périphérie et de 0,1 dans le centre. En effet, dans les pays du centre et en Afrique australe, le taux de création d’emplois est également faible par rapport à la croissance économique : pour chaque hausse d’un point de pourcentage de la croissance économique, la proportion de travailleurs salariés augmente de 0,04 % en moyenne11. Par conséquent, les actifs se tournent par défaut vers des activités indépendantes peu productives et
(Banque mondiale 2023b).
Graphique 2.7 La proportion de citadins et le nombre de citadins augmentent en Afrique
a. Part de la population dans les zones urbaines, 1990-2022
b. Population rurale et urbaine, 1990-2022
Population (millions)
Centre géographique de l’Afrique
Périphérie géographique de l’Afrique
Rurale Urbaine
Source : Calculs de l’équipe sur la base des indicateurs de développement mondial 2024 de la Banque mondiale (https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators).
Graphique 2.8 Dans les pays du centre géographique de l’Afrique, où le secteur agricole emploie près de 50 % de la main-d’œuvre, le manque d’emplois salariés contraint de nombreuses personnes à exercer comme travailleur indépendant pour assurer leur subsistance
a. Pays du centre : Type d’emploi, part dans l’emploi total, 1991-2019
b. Pays de la périphérie : Type d’emploi, part dans l’emploi total, 1991-2019
Source : Calculs de l’équipe sur la base des indicateurs macro-économiques mondiaux de la Banque mondiale.
Les situations de fragilité, de conflit et de violence menacent l’avenir d’une population jeune en pleine expansion
La fragilité chronique de nombreux pays africains freine la croissance et les perspectives économiques. La plupart des pays du centre géographique de l’Afrique vivent une situation de fragilité ou de conflit, caractérisée par une instabilité économique et politique et une faible gouvernance. Ces conditions nuisent à la cohésion sociale et à la croissance économique (Akanbi et al. 2021 ; Collier 2021). En 2023, sur les 37 pays en situation de fragilité, de conflit et de violence dans le monde, 20 se trouvaient en Afrique, presque tous dans le centre du continent12. Le fait que la hausse de la population jeune ne s’accompagne pas de créations d’emploi constitue un facteur majeur d’instabilité et de violence (Cincotta et Leahy 2006 ; Flückiger et Ludwig 2018 ; Urdal 2006). Environ 760 millions de personnes, soit près de la moitié de la population africaine, vivent dans des pays où les situations de fragilité persistent. Ce nombre devrait atteindre 1,34 milliard en 2050. Les conflits et la violence ont fortement augmenté depuis 2010. Après une stabilisation aux alentours de 2015, ces phénomènes sont repartis à la hausse en 2019, en particulier en Afrique de l’Est et de l’Ouest (graphique 2.9).
L’émergence et la résurgence des conflits, la contestation des élections et la concurrence pour les ressources ont aggravé l’instabilité en Éthiopie, en République démocratique du Congo, en Somalie et au Soudan. Entre 2020 et 2023, neuf coups d’État militaires et cinq tentatives avortées se sont produits en Afrique. Les pays concernés comprennent 159 millions de personnes, soit 11 % de la population du continent13
Graphique 2.9 Les situations de conflit et de violence en Afrique ont augmenté dans la dernière décennie
a. Conflits et violences, par type, 2000-2023
Nombre de cas (milliers)
(suite page suivante)
Graphique 2.9 Les situations de conflit et de violence en Afrique ont augmenté dans la dernière décennie (suite)
b. Conflits et violence, par sous-région et nombre de morts, 2000-2023
Nombre de cas (milliers)
Nombre de morts (milliers)
Afrique de l’Est
Afrique du Centre
Afrique de l’Ouest
Afrique australe
Afrique du Nord
Nombre total de morts (axe de droite)
Source : Calculs de l’équipe basés sur le projet de données sur la localisation et les événements des conflits armés (ACLeD) (https://acleddata.com/).
Note : Le Cap-vert, les Comores, Maurice, São Tomé-et-príncipe et les Seychelles ne sont pas pris en compte dans le graphique, aucune donnée antérieure à 2020 n’étant disponible pour ces pays.
Les cas de violence et de conflit sont de plus en plus fréquents. Ce phénomène se reflète dans la hausse rapide du nombre de personnes déplacées de force au cours de la dernière décennie. Le continent compte désormais plus de 41 millions de personnes déplacées, et une poignée de conflits a provoqué des déplacements (cf. chapitre 1)14. De même, cinq pays seulement concentrent actuellement près de 80 % des personnes déplacées internes (encadré 1.2, chapitre 1)15. Les situations de fragilité et de violence ont également eu un impact sur les flux migratoires extracontinentaux, avec des conséquences politiques et économiques pour les pays de destination européens (encadré 2.1).
Que se passe-t-il lorsqu’un conflit éclate aux portes de l’Europe ?
Depuis les années 1970, la Libye a été une destination clé de la migration internationale Sud-Sud, avec des pics dans les années 1970 et 2000 (Centre sur les politiques migratoires 2013). Les flux migratoires vers la Libye se sont poursuivis jusqu’en 2007, année durant laquelle le pays a mis fin à sa politique migratoire de libre admission pour les pays d’Afrique subsaharienne, mise en place après l’embargo des Nations Unies de 1992. La Libye a alors instauré des obligations de visa pour freiner la migration irrégulière (OIM 2017).
Après la chute du régime Kadhafi, la longue période d’instabilité et de conflit traversée par le pays a eu un impact sur les flux migratoires, avec des répercussions politiques et économiques pour les pays de destination européens et pour les pays voisins d’Afrique du Nord (Cummings et al. 2015 ; Commission européenne 2017). En 2011, année de la révolution libyenne, les immigrants représentaient plus de 50 % de la main-d’œuvre du pays (Elgazzar et al. 2015). Cette année-là, 768 372 migrants ont fui la Libye (Centre sur les politiques migratoires 2013). Un conflit armé a éclaté en 2014, laissant place à l’insécurité jusqu’en 2020, caractérisée par une forte violence liée au conflit, avec des pics en 2014, 2016 et 2018-2019 (Council on Foreign Relations 2019 ; Rahman et Di Maio 2020). Avec 12 % de sa population née à l’étranger (en 2018), la Libye demeure un important pays de destination des migrants. Néanmoins, en raison de son instabilité sécuritaire et de la détérioration de ses conditions d’accueil des immigrants, la Libye est devenue un pays de transit pour les migrants cherchant à rejoindre l’Europe (Di Maio, Sciabolazza et Molini 2023 ; les données sur les personnes nées à l’étranger proviennent du DAES de l’ONU [2018]). En 2017, 43 % des demandeurs d’asile arrivant en Italie par bateau étaient des migrants préalablement installés en Libye, qui fuyaient la violence (Abdel Jelil et al. 2018). Si les départs ont drastiquement diminué depuis 2018, la Libye est restée le principal point de départ des traversées maritimes irrégulières jusqu’en 2023, bien qu’un nombre variable de migrants transitent par son territoire pour atteindre d’autres pays du Maghreb (Di Maio, Sciabolazza, et Molini 2023). Seule une part minime des migrants qui entre en Afrique du Nord décide d’entreprendre une traversée (OIM 2017).
Entre mai et juin 2023, le programme « Matrice de suivi des déplacements » de l’Organisation internationale pour les migrations a enregistré un total de 704 369 migrants. Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés a dénombré plus de 65 000 réfugiés et demandeurs d’asile en juin 2024.
Les personnes déplacées de force résident souvent dans des zones rurales sous-développées où les possibilités de subsistance, l’accès au marché et les services sont limités, ce qui aggrave leur situation. Les déplacements provoquent des traumatismes, la séparation des proches, la perte de biens, des perturbations dans l’acquisition du capital humain et des restrictions légales qui limitent les chances de reconstruction des personnes déplacées16. La population réfugiée compte une forte
proportion d’enfants (53 %) et une faible proportion d’hommes en âge de travailler (20 %)17. Plus de 80 % des réfugiés enregistrés vivent dans des zones rurales, une part relativement constante depuis plus de dix ans18. Par ailleurs, 54 % des réfugiés vivent encore dans des camps19. La présence de réfugiés accroît la demande en biens et services, et augmente l’offre de main-d’œuvre dans les communautés d’accueil. Ce choc se répercute sur les salaires, l’emploi, la consommation et la santé dans les communautés d’accueil, profitant à certains et nuisant à d’autres (Sarzin et Nsababera 2024). La présence de réfugiés peut générer de nouveaux débouchés économiques. Toutefois, les réfugiés sont confinés dans des zones où les perspectives économiques sont faibles, l’accès au marché restreint, les infrastructures déficientes et l’accès aux services limité. Ces facteurs peuvent conduire au déplacement de certains travailleurs et ainsi détériorer les conditions de vie dans des zones déjà dégradées (Maystadt et Verwimp 2014 ; Ruiz et Vargas-Silva 2015, 2016).
La croissance rapide de la population dans le centre géographique de l’Afrique s’opère sur fond de changement climatique
L’Afrique se réchauffe plus vite que les autres continents, ce qui pourrait avoir des répercussions importantes sur la mobilité20. D’ici à 2050, deux personnes sur cinq sur le continent pourraient être exposées à un risque de plus en plus élevé de chaleur extrême (Clément et Rigaud 2024) (carte 2.2). Avec un réchauffement planétaire qui pourrait dépasser les 1,5 °C au XXIe siècle, la probable intensification de risques climatiques simultanés sur l’ensemble du continent, notamment des fortes précipitations et des inondations, augmentera les incitations à migrer (Trisos et al. 2022).
À l’heure actuelle, on estime que plus de 540 millions de personnes en Afrique sont exposées à des phénomènes météorologiques extrêmes, comme des inondations, des sécheresses, des cyclones et des vagues de chaleur21. Les phénomènes météorologiques extrêmes seraient déjà à l’origine du déplacement interne de plus de 35 millions de personnes sur le continent au cours des 15 dernières années (calculs basés sur IDMC [2024]). En 2022, dans les pays du centre géographique, les personnes déplacées internes en raison de catastrophes se chiffreraient à 7,3 millions. Il s’agit du nombre le plus élevé jamais rapporté pour la région (calculs basés sur IDMC [2024]).
Dans les zones rurales, les effets néfastes du changement climatique sur la productivité et les revenus seront exacerbés par la croissance démographique. Le changement climatique menace la productivité et les revenus de l’agriculture rurale, en raison de la réduction de la disponibilité en eau, de l’évolution des températures, des phénomènes météorologiques extrêmes et de la dégradation des sols (Clement et Rigaud 2024). Dans les zones rurales, plus le nombre d’habitants augmente, plus la surface agricole par travailleur diminue, ce qui entraîne une réduction de la taille des parcelles agricoles et une fragmentation des terres (Masters et al. 2013)22. La faible capacité du secteur rural non agricole à absorber la main-d’œuvre croissante renforce la dépendance à l’égard de la terre, ce qui intensifie la concurrence et la fragmentation (Masters et al. 2013). Au niveau mondial, à l’horizon 2100, la croissance démographique devrait avoir plus d’impact sur le PIB par habitant que le changement climatique (Henderson et al. 2024). Les pays du centre du continent sont affectés de manière disproportionnée par les effets combinés du changement climatique et de la croissance démographique, ce qui augmente le recours à la migration comme stratégie d’adaptation par les populations touchées (Clement et al. 2021).
Carte 2.2 L’Afrique devrait se réchauffer au cours des prochaines décennies
a. Conditions passées, 1995-2014
b. Projections, 2040-2059
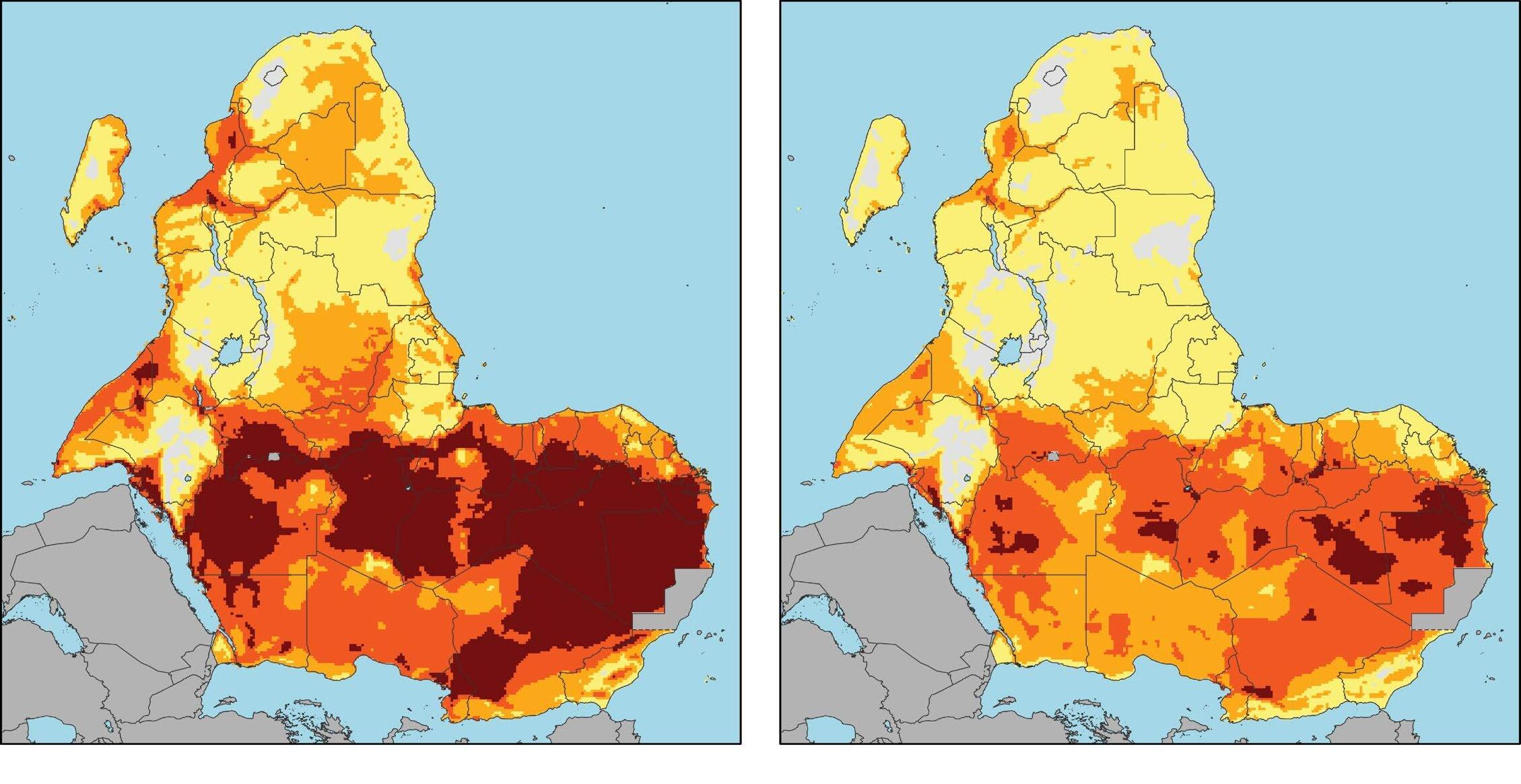
Catégorisation du risque de chaleur
Faible
Modéré
Élevé
Extrême
Catégorisation du risque de chaleur
Faible
Modéré Élevé
Extrême
Source : portail de connaissances sur le changement climatique de la Banque mondiale (https://climateknowledgeportal.worldbank.org/).
Note : La carte représente les zones exposées à des risques de chaleur faibles, modérés, élevés et extrêmes au cours de la période de référence (1995-2014, partie a) et au milieu du xxie siècle (2040-2059, partie b), en se basant sur les scénarios socio-économiques de référence (« scénarios SSp »). pour la seconde période (milieu du xxie siècle), c’est le 50e percentile de l’ensemble multimodèle pour un scénario moyen (SSp2-4.5) qui est représenté : les émissions de dioxyde de carbone restent à peu près aux niveaux actuels avant de commencer à diminuer au milieu du siècle, sans toutefois atteindre un niveau net nul d’ici 2100, et les températures mondiales augmentent d’environ 2,7 °C d’ici la fin du siècle. Les catégories de risques de chaleur représentent le niveau de risque moyen relatif à trois indicateurs de chaleur. Chaque composante reflète le seuil le plus élevé atteint : température maximale journalière (30°C, 35°C, 40°C et 45°C) ; température minimale nocturne (20°C, 23°C, 26°C et 29°C) ; et indice de chaleur (35°C, 37°C, 39°C et 41°C). Si au moins un jour de l’année atteint le seuil le plus élevé pour un indicateur donné, la catégorie de risque la plus élevée est utilisée pour cet indicateur. La catégorisation combinée du risque correspond ainsi à la moyenne des différentes catégories et est exprimée par « faible », « modéré », « élevé » ou « extrême ». °C = degrés Celsius.
De plus en plus de résidants des zones côtières seront exposés à différents risques climatiques. En Afrique, d’ici 2030, plus de 100 millions de personnes pourraient être confrontées à une élévation du niveau de la mer dans les zones basses du littoral, et plus de 200 millions d’ici le milieu du siècle (Cissé et al. 2023). Les cyclones et les tempêtes tropicales affectent principalement la côte sud-est, notamment Madagascar, le Mozambique et les îles de l’océan Indien, avec une fréquence accrue des inondations côtières (Clement et Rigaud 2024).
L’insuffisance des revenus en zone rurale incite les populations à s’installer en zone urbaine. Or, sans une planification urbaine adaptée, les risques climatiques limiteront de plus en plus la capacité des zones urbaines à accueillir une population toujours plus nombreuse. La baisse de la productivité agricole causée par un climat plus chaud et plus sec accroît les incitations à quitter les zones rurales, bien que les migrations soient limitées par des contraintes de ressources dans les économies pauvres23. La planification et la gouvernance sont toutefois insuffisantes dans les aires urbaines du continent, où prolifèrent des zones d’installation informelles et dépourvues de services adéquats (Roberts et Anyumba 2022). En effet, les migrants et les citadins pauvres s’établissent souvent dans des lieux présentant un risque élevé d’inondation. Entre 1985 et 2015, l’expansion urbaine s’est produite principalement dans des zones présentant un risque élevé d’inondation, ou susceptibles d’être affectées par des conditions de chaleur extrême. (Pour une analyse détaillée, voir Clement et Rigaud [2024] ; Mukim et Roberts [2023].) Dans un contexte de croissance démographique, la concentration de chaleur en zone urbaine aggravera les effets des vagues de chaleur, avec des risques pour la santé des travailleurs et une réduction des heures travaillées qui affectera la productivité (OIT 2019). On estime que 2,3 % du nombre total d’heures travaillées pourraient être perdus à cause du stress thermique en 2030, soit l’équivalent de 14 millions d’emplois à temps plein ; l’Afrique de l’Ouest pourrait être la plus touchée (OIT 2019). Les populations urbaines croissantes et leurs possessions seront de plus en plus soumises aux effets du climat, notamment aux conditions météorologiques extrêmes, aux pénuries d’eau et aux pressions sur les infrastructures. (Pour une analyse détaillée, voir Clement et Rigaud [2024] et Mukim et Roberts [2023].)
Notes
1. Les raisons qui motivent les personnes à migrer sont étudiées au moins depuis Ravenstein (1885) et Stewart (1947). Le lien entre climat et migration est identifié au moins depuis 1991 (GIEC 1991).
2. Le scénario de fécondité « moyen » des Nations Unies (2022) prévoit que le ratio entre la population en âge de travailler et les personnes dépendantes dans le cœur géographique culminera en 2086 à environ 1,7 personne en âge de travailler pour chaque enfant et personne âgée.
3. Beegle et Christiaensen (2019) ; Canning, Jobanputra et Yazbeck (2015) ; Hasan, Loevinsohn et al. (2019) ; Hasan, Moucheraud et al. (2019) ; Banque mondiale (2015a, 2015b, 2023a, 2023b).
4. La tendance mondiale à la convergence est plus marquée lorsque l’Afrique subsaharienne est exclue (Kremer, Willis et You 2022).
5. La Guinée équatoriale, l’Érythrée, la Libye et la Somalie ont été exclues du calcul du taux de pauvreté moyen pondéré par la population pour les pays du centre géographique par manque de données. Les calculs se basent sur les données de la plateforme « Pauvreté et inégalités » de la Banque mondiale.
6. L’augmentation de la dette affecte également les pays de la périphérie géographique, notamment les pays importateurs de pétrole d’Afrique du Nord (Gatti et al. 2024).
7. D’après les travaux de Yonzan, Mahler et Lakner (2023), mis à jour à l’aide des données de la plateforme « Pauvreté et inégalités » de la Banque mondiale (v 20240326_2017_01_02_PROD). Les projections sont établies à partir de la croissance annuelle moyenne par habitant de la décennie précédant la pandémie (2010-2019) appliquée aux revenus ou à la consommation des individus, sur la base du scénario « moyen » des projections démographiques des Nations Unies et en supposant la neutralité de la distribution.
8. Sur l’essor des « villes de consommation », voir Castells-Quintana et Wenban-Smith (2020) ; Fay et Opal (2000) ; Gollin, Jedwab et Vollrath (2016).
9. Dans les pays du centre géographique, 48 % de la main-d’œuvre travaille dans l’agriculture. Toutefois, le secteur contribue à la valeur ajoutée du PIB à hauteur de 25 %, un niveau stable depuis le début des années 1990. Dans les pays de la périphérie géographique, la part des emplois dans l’agriculture est plus faible (20 %), mais elle reste supérieure à leur contribution à la valeur ajoutée (9,5 %). La part de l’industrie manufacturière dans la production de valeur ajoutée réelle a quant à elle peu évolué et demeure inférieure à 10 % dans les pays du centre et inférieure à 20 % dans ceux de la périphérie
10. L’emploi salarié formel tend à offrir des revenus plus élevés et davantage de protection que l’emploi indépendant ou l’emploi salarié informel (Fields et al. 2023). En outre, le secteur tertiaire a tendance à offrir des revenus plus faibles en raison de la petite taille des entreprises (Banque mondiale, à paraître).
11. Cela représente la moitié de l’élasticité de l’emploi salarié par rapport à la croissance des pays d’Asie de l’Est, qui produisent environ 0,08 emploi pour chaque point de pourcentage de la croissance supplémentaire (Banque mondiale 2023b).
12. Dans le centre géographique de l’Afrique et en Afrique australe, la pauvreté est plus élevée dans les pays touchés par des situations de fragilité ou de conflit. Entre 2010 et 2019, dans les pays en situation de conflit ou ayant connu un conflit, l’extrême pauvreté était en moyenne de 40,1 %, contre 31,8 % dans les pays n’ayant jamais été en conflit. Le lien entre croissance économique et réduction de la pauvreté est également moins fort dans les pays en situation de fragilité ou de conflit (Banque mondiale, à paraître).
13. Des gouvernements ont été renversés au Burkina Faso (deux fois), au Gabon, en Guinée, au Mali (deux fois), au Niger, au Soudan et au Tchad ; des tentatives ont échoué en Guinée-Bissau, au Niger, à São Tomé-et-Príncipe et au Soudan (deux fois).
14. Les pays concernés sont la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, la Somalie, le Soudan et le Soudan du Sud (Sarzin et Nsababera 2024).
15. L’Éthiopie, le Nigéria, la République démocratique du Congo, la Somalie et le Soudan.
16. Blackmore et al. (2020) ; Bogic, Njoku, et Priebe (2015) ; Fazel, Wheeler, et Danesh (2005) ; Gargiulo et al. (2021) ; Ginn et al. (2022) ; Hanewald et al. (2020) ; Lindert et al. (2009) ; Pape, Petrini et Iqbal (2018) ; Peconga et Thøgersen (2020) ; Porter et Haslam (2005) ; Steel et al. (2009) ; Banque mondiale (à paraître b).
17. Calculs basés sur les données du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Les données couvrent presque tous les réfugiés enregistrés en Afrique et au Moyen-Orient, mais sont incomplètes dans d’autres régions (Sarzin et Nsababera 2024).
18. Calculs basés sur les données du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.
19. Calculs basés sur les données du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.
20. Le continent a enregistré en moyenne +0,3 °C par décennie entre 1991 et 2022, une tendance au réchauffement plus rapide que la moyenne mondiale, située à environ +0,2 °C par décennie (OMM 2023).
21. Calculs basés sur les données de Doan et al. (2023), qui excluent la Guinée équatoriale, l’Érythrée, la Libye, São Tomé-et-Príncipe et la Somalie, pays pour lesquels les estimations ne sont pas disponibles. Doan et al. (2023) constatent également que les ménages pauvres sont particulièrement vulnérables aux chocs climatiques et d’autres natures, car ils dépendent des travaux agricoles. Cette dépendance freine les perspectives de croissance des revenus des ménages et de réduction de la pauvreté sur le continent. Parmi les personnes exposées à ces phénomènes extrêmes en Afrique, 34 % sont extrêmement pauvres, vivant sous le seuil de pauvreté fixé à 2,15 dollars par personne et par jour.
22. L’éventail des tailles d’exploitations agricoles examinées en Afrique est trop restreint pour que l’on puisse établir avec certitude le lien entre la taille des exploitations et la productivité (Jayne et al. 2019 ; Jayne et al. 2022). Bien que certaines données suggèrent une relation en forme de U (Foster et Rosenzweig 2022 ; Muyanga et Jayne 2019), les chocs météorologiques et parasitaires ainsi que l’hétérogénéité de la qualité des terres expliquent également une grande partie des différences de productivité agricole (Gollin et Udry 2021).
23. Cattaneo et Peri (2016) ; Henderson, Storeygard et Deichmann (2017) ; Marchiori, Maystadt et Schumacher (2012) ; Zaveri et al. (2021).
Bibliographie
Abdel Jelil, M., P. A. Corral Rodas, A. Dahmani Scuitti, M. E. Davalos, G. Demarchi, N. N. Demirel, Q.-T. Do, R. N. Hanna, D. J. M. Houeix, S. Lenehan, and H. K. Mugera. 2018. “Asylum Seekers in the European Union: Building Evidence to Inform Policy Making.” Working Paper 127818, World Bank, Washington, DC. http://documents.worldbank.org/curated/en/832501530296269142/Asylum -seekers-in-the-European-Union-building-evidence-to-inform-policy-making.
Akanbi, O. A., N. Gueorguiev, M. J. Honda, P. Mehta, M. K. Moriyama, K. Primus, and M. Sy. 2021. “Avoid a Fall or Fly Again: Turning Points of State Fragility.” Working Paper No. 2021/133, International Monetary Fund, Washington, DC.
Beegle, K., and L. Christiaensen. 2019. Accelerating Poverty Reduction in Africa. Washington, DC : World Bank. http://hdl.handle.net/10986/32354
Blackmore, R., J. A. Boyle, M. Fazel, S. Ranasinha, K. M. Gray, G. Fitzgerald, M. Misso, and M. GibsonHelm. 2020. “The Prevalence of Mental Illness in Refugees and Asylum Seekers: A Systematic Review and Meta-Analysis.” PLOS Medicine 17 (9): e1003337. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003337.
Bogic, M., A. Njoku, and S. Priebe. 2015. “Long-Term Mental Health of War-Refugees: A Systematic Literature Review.” BMC International Health and Human Rights 15 (1) : 29. https://doi.org/10.1186 /s12914-015-0064-9
Canning, D. J., S. R. Jobanputra, and A. S. Yazbeck, eds. 2015. Africa’s Demographic Transition: Dividend or Disaster? Africa Development Forum. Washington, DC : World Bank.
Castells-Quintana, D., and H. Wenban-Smith. 2020. “Population Dynamics, Urbanisation without Growth, and the Rise of Megacities.” Journal of Development Studies 56 (9) : 1663-82.
Cattaneo, C., and G. Peri. 2016. “The Migration Response to Increasing Temperatures.” Journal of Development Economics 122: 127–46.
Cincotta, R. P., and E. Leahy. 2006. “Population Age Structure and Its Relation to Civil Conflict: A Graphic Metric.” Environmental Change and Security Program Report 12: 55.
Cissé, G., H. Adams, P. Aldunce, K. Bowen, K. Campbell-Lendrum, S. Clayton, K. L. Ebi, and J. Hess. 2023. “Health, Wellbeing and the Changing Structure of Communities.” Cambridge, UK : Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009325844.
Clement, V., and K. K. Rigaud. 2024. “Climate Change and Mobility.” Background paper prepared for this report. World Bank, Washington, DC.
Clement, V., K. K. Rigaud, A. de Sherbinin, B. Jones, S. Adamo, J. Schewe, N. Sadiq, and E. Shabahat. 2021. Groundswell Part 2: Acting on Internal Climate Migration. Washington, DC: World Bank. http://hdl .handle.net/10986/36248.
Collier, P. 2021. “Transition Programs: A Theory of the Scaffolding Needed to Build out of Fragility.” In Macroeconomic Policy in Fragile States, edited by R. Chami, R. Espinoza, and P. J. Montiel, 58–81. Oxford, UK : Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780198853091.003.0003.
Council on Foreign Relations. 2019. “Global Conflict Tracker.” Council on Foreign Relations, New York. https://www.cfr.org/interactive/global-conflict-tracker/conflict/civil-war-libya
Cummings, C., J. Pacitto, D. Lauro, and M. Foresti. 2015. “Why People Move: Understanding the Drivers and Trends of Migration to Europe.” Working Paper 430, Overseas Development Institute, London. Di Maio, M., V. L. Sciabolazza, and V. Molini. 2023. “Migration in Libya: A Spatial Network Analysis.” World Development 163: 106139.
Doan, M. K., R. Hill, S. Hallegatte, P. Corral, B. Brunckhorst, M. Nguyen, S. Freije-Rodriguez, and E. Naikal. 2023. “Counting People Exposed to, Vulnerable to, or at High Risk from Climate Shocks: A Methodology.” Policy Research Working Paper 10619, World Bank, Washington, DC.
Elgazzar, H., A. R. Lahga, M. B. N. Quota, F. U. Rother, and L. Hargreaves. 2015. Labor Market Dynamics in Libya: Reintegration for Recovery. Washington, DC: World Bank. http://documents.worldbank.org /curated/en/967931468189558835/Labor-market-dynamics-in-Libya-reintegration-for-recovery. EU Commission (European Union Commission). 2017. “Migration on the Central Mediterranean: Managing Flows, Saving Lives.” Joint Communication to the European Parliament. The European Council, January 25. EU Commission, Brussels, Belgium.
Fay, M., and C. Opal. 2000. “Urbanization without Growth: A Not-So-Uncommon Phenomenon.” Policy Research Working Paper 2412, World Bank, Washington, DC.
Fazel, M., J. Wheeler, and J. Danesh. 2005. “Prevalence of Serious Mental Disorder in 7000 Refugees Resettled in Western Countries: A Systematic Review.” The Lancet 365 (9467): 1309–14. https://doi .org/10.1016/S0140-6736(05)61027-6.
Fields, G. S., T. H. Gindling, K. Sen, M. Danquah, and S. Schotte. 2023. The Job Ladder: Transforming Informal Work and Livelihoods in Developing Countries. Oxford, UK : Oxford University Press.
Filmer, D., H. Rogers, N. Angrist, and S. Sabarwal. 2020. “Learning-Adjusted Years of Schooling (LAYS): Defining a New Macro Measure of Education.” Economics of Education Review 77: 101971.
Flückiger, M., and M. Ludwig. 2018. “Youth Bulges and Civil Conflict: Causal Evidence from Sub-Saharan Africa.” Journal of Conflict Resolution 62 (9): 1932–62.
Foster, A. D., and M. R. Rosenzweig. 2022. “Are There Too Many Farms in the World? Labor Market Transaction Costs, Machine Capacities, and Optimal Farm Size.” Journal of Political Economy 130 (3): 636–80.
Gargiulo, A., F. Tessitore, F. Le Grottaglie, and G. Margherita. 2021. “Self-Harming Behaviours of Asylum Seekers and Refugees in Europe: A Systematic Review.” International Journal of Psychology 56 (2) : 189–98. https://doi.org/10.1002/ijop.12697.
Gatti, R., F. Bennett, H. Assem, R. Lotfi, G. Mele, I. Suvanov, and A. M. Islam. 2024. “Conflict and Debt in the Middle East and North Africa.” Middle East and North Africa Economic Update (April). Washington, DC : World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-2098-4.
Ginn, T., R. Resstack, H. Dempster, E. Arnold-Fernández, S. Miller, M. Guerrero Ble, and B. Kanyamanza. 2022. “2022 Global Refugee Work Rights Report.” Center for Global Development, Asylum Access, and Refugees International, Washington, DC. https://www.cgdev.org/publication/2022-global-refugee-work-rights-report
Gollin, D., R. Jedwab, and D. Vollrath. 2016. “Urbanization with and without Industrialization.” Journal of Economic Growth 21: 35–70.
Gollin, D., and C. Udry. 2021. “Heterogeneity, Measurement Error, and Misallocation: Evidence from African Agriculture.” Journal of Political Economy 129 (1): 1–80.
Hanewald, B., M. Knipper, W. Fleck, J. Pons-Kühnemann, E. Hahn, T. M. T. Ta, B. Brosig, B. Gallhofer, C. Mulert, and M. Stingl. 2020. “Different Patterns of Mental Health Problems in Unaccompanied Refugee Minors (URM): A Sequential Mixed Method Study.” Frontiers in Psychiatry 11: 324. https://doi .org/10.3389/fpsyt.2020.00324
Hasan, R. A., B. P. Loevinsohn, C. Moucheraud, S. A. Ahmed, I. Osorio-Rodarte, E. Suzuki, E. Pradhan, S. Madhavan, S. Troiano, M. Sexton, F. A. Mustapha, A. O. Odutolu, and O. O. Okunola. 2019. “Nigeria’s Demographic Dividend.” Policy Note in Support of Nigeria’s Economic Recovery and Growth Plan 2017–2020. World Bank, Washington, DC.
Hasan, R. A., C. Moucheraud, H. N. Samaha, S. Troiano, S. A. Ahmed, I. Osorio-Rodarte, E. Suzuki, M. Sexton, E. Pradhan, S. Madhavan, and C. B. Habib. 2019. “Demographic Dividend in DRC: Catalyzing Economic Growth through Demographic Opportunities.” Working Paper, World Bank, Washington, DC. Henderson, J. V., B. Y. Jang, A. Storeygard, and D. N. Weil. 2024. “Climate Change, Population Growth, and Population Pressure.” Working Paper 32145, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA. Henderson, J. V., A. Storeygard, and U. Deichmann. 2017. “Has Climate Change Driven Urbanization in Africa?” Journal of Development Economics 124: 60–82. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2016.09.001
IDMC (Internal Displacement Monitoring Center). 2024. “IDMC Data Portal.” IDMC, Geneva. https://www.internal-displacement.org/database/displacement-data/
ILO (International Labour Organization). 2019. Working on a Warmer Planet: The Impact of Heat Stress on Labour Productivity and Decent Work. Geneva : ILO.
ILO (International Labour Organization). 2024. “ILO Modelled Estimates and Projections Database (ILOEST).” ILOSTAT, ILO, Geneva (accessed February 6, 2024), https://ilostat.ilo.org/data/
IOM (International Organization for Migration). 2017. Irregular Migration from West Africa to the Maghreb and the European Union: An Overview of Recent Trends. Migration Research Series No. 32. Geneva : IOM. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 1991. Climate Change : The IPCC Scientific Assessment. Cambridge, UK : Cambridge University Press.
Jayne, T. S., M. Muyanga, A. Wineman, H. Ghebru, C. Stevens, M. Stickler, A. Chapoto, W. Anseeuw, D. van der Westhuizen, and D. Nyange. 2019. “Are Medium-Scale Farms Driving Agricultural Transformation in Sub-Saharan Africa?” Agricultural Economics 50 (S1): 75–95.
Jayne, T. S., A. Wineman, J. Chamberlin, M. Muyanga, and F. K. Yeboah. 2022. “Changing Farm Size Distributions and Agricultural Transformation in Sub-Saharan Africa.” Annual Review of Resource Economics 14: 109–30.
Kremer, M., J. Willis, and Y. You. 2022. “Converging to Convergence.” NBER Macroeconomics Annual 36 (1) : 337-412.
Lall, S. V., J. V. Henderson, and A. J. Venables. 2017. Africa’s Cities: Opening Doors to the World. Washington, DC : World Bank.
Lindert, J., O. S. von Ehrenstein, S. Priebe, A. Mielck, and E. Brähler. 2009. “Depression and Anxiety in Labor Migrants and Refugees—A Systematic Review and Meta-Analysis.” Social Science & Medicine 69 (2): 246–57. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2009.04.032
Marchiori, L., J. F. Maystadt, and I. Schumacher. 2012. “The Impact of Weather Anomalies on Migration in Sub-Saharan Africa.” Journal of Environmental Economics and Management 63 (3) : 355-74.
Masters, W. A., A. A. Djurfeldt, C. De Haan, P. Hazell, T. Jayne, M. Jirström, and T. Reardon. 2013. “Urbanization and Farm Size in Asia and Africa: Implications for Food Security and Agricultural Research.” Global Food Security 2 (3): 156–65.
Maystadt, J.-F., and P. Verwimp. 2014. “Winners and Losers among a Refugee-Hosting Population.” Economic Development and Cultural Change 62 (4): 769–809. https://doi.org/10.1086/676458.
Migration Policy Centre. 2013. “MPC Migration Profile : Libya.” Migration Policy Centre, Washington, DC. https://migrationpolicycentre.eu.docs/migration_profiles/Libya.pdf
Mukim, M., and M. Roberts, eds. 2023. Thriving: Making Cities Green, Resilient, and Inclusive in a Changing Climate. Washington, DC : World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/entities /publication/7d290fa9-da18-53b6-a1a4-be6f7421d937.
Muyanga, M., and T. S. Jayne. 2019. “Revisiting the Farm Size‐Productivity Relationship Based on a Relatively Wide Range of Farm Sizes: Evidence from Kenya.” American Journal of Agricultural Economics 101 (4): 1140–63.
Pape, U. J., B. Petrini, and S. A. Iqbal. 2018. “Informing Durable Solutions by Micro-Data : A Skills Survey for Refugees in Ethiopia.” Working Paper 128185, World Bank, Washington, DC. https://documents .worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/996221531249711200/Informing -durable-solutions-by-micro-data-a-skills-survey-for-refugees-in-Ethiopia
Peconga, E. K., and M. H. Thøgersen. 2020. “Post-Traumatic Stress Disorder, Depression, and Anxiety in Adult Syrian Refugees: What Do We Know?” Scandinavian Journal of Public Health 48 (7): 677–87. https://doi.org/10.1177/1403494819882137.
Porter, M., and N. Haslam. 2005. “Predisplacement and Postdisplacement Factors Associated with Mental Health of Refugees and Internally Displaced Persons: A Meta-Analysis.” JAMA 294 (5): 602–12. https://doi.org/10.1001/jama.294.5.602.
Rahman, A., and M. Di Maio. 2020. The Private Sector amid Conflict: The Case of Libya. Washington, DC : World Bank.
Ravenstein, E. G. 1885. “The Laws of Migration.” Journal of the Statistical Society of London 48 : 167–227. https://doi.org/10.2307/2979181
Roberts, B. H., and G. O. Anyumba, eds. 2022. The Dynamics of Systems of Secondary Cities in Africa: Urbanisation, Migration and Development. Abidjan, Côte d’Ivoire : Cities Alliance, African Development Bank.
Ruiz, I., and C. Vargas-Silva. 2015. “The Labor Market Impacts of Forced Migration.” American Economic Review 105 (5): 581–86. https://doi.org/10.1257/aer.p20151110
Ruiz, I., and C. Vargas-Silva. 2016. “The Labour Market Consequences of Hosting Refugees.” Journal of Economic Geography 16 (3): 667–94. https://doi.org/10.1093/jeg/lbv019
Sarzin, Z., and O. Nsababera. 2024. “Forced Displacement: A Stocktaking of Evidence.” Background paper prepared for this report. World Bank, Washington, DC.
Steel, Z., T. Chey, D. Silove, C. Marnane, R. A. Bryant, and M. van Ommeren. 2009. “Association of Torture and Other Potentially Traumatic Events with Mental Health Outcomes among Populations Exposed to Mass Conflict and Displacement: A Systematic Review and Meta-Analysis.” JAMA 302 (5): 537–49. https://doi.org/10.1001/jama.2009.1132
Stewart, J. Q. 1947. “Empirical Mathematical Rules Concerning the Distribution and Equilibrium of Population.” Geographical Review 37 (3) : 461–85. https://doi.org/10.2307/211132
Trisos, C. H., I. O. Adelekan, E. Totin, A. Ayanlade, J. Efitre, A. Gemeda, K. Kalaba, C. Lennard, C. Masao, Y. Mgaya, G. Ngaruiya, D. Olago, N. P. Simpson, and S. Zakieldeen. 2022. “Africa.” In Climate Change 2022 : Impacts, Adaptation and Vulnerability, edited by H.-O. Pörtner, D. C. Roberts, M. Tignor, E. S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, and B. Rama, 1285–1455. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, UK, and New York: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781009325844.011.
UN DESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs). 2018. “International Migrants Stock Database.” UN DESA, New York.
United Nations. 2022. World Population Prospects 2022. New York: Population Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations.
Urdal, H. 2006. “A Clash of Generations? Youth Bulges and Political Violence.” International Studies Quarterly 50 (3): 607–29.
WMO (World Meteorological Organization). 2023. State of the Climate in Africa 2022. Geneva : WMO.
World Bank. 2015a. Global Monitoring Report 2015/2016 : Development Goals in an Era of Demographic Change. Washington, DC: World Bank.
World Bank. 2015b. South Africa Economic Update: Jobs and South Africa’s Changing Demographics. Issue No. 7. Washington, DC: World Bank.
World Bank. 2022. “The State of Global Learning Poverty: 2022 Update.” World Bank, Washington, DC. https://thedocs.worldbank.org/en/doc/34035a49acb5700ce8b118aeda81a5cb-0510022023/original /TheStateOfLearningPoverty-Feb2023Update-03-08-23.pdf.
World Bank. 2023a. “Debt Sustainability Analysis (DSA) 2023.” World Bank, Washington, DC. https://www.worldbank.org/en/programs/debt-toolkit/dsa
World Bank. 2023b. “Delivering Growth to People through Better Jobs.” Africa’s Pulse 28 (October). World Bank, Washington, DC. doi:10.1596/978-1-4648-2043-4.
World Bank. 2024. The Great Reversal: Prospects, Risks, and Policies in International Development Association (IDA) Countries. Washington, DC: World Bank.
World Bank. Forthcoming a. Africa Poverty and Inequality Report. Washington, DC: World Bank.
World Bank. Forthcoming b. “Kenya Longitudinal Survey of Refugees and Host Communities: Building the Evidence Base on Self-Reliance in Kenya.” World Bank, Washington, DC.
Yonzan, N., D. M. Mahler, and C. Lakner. 2023. “Projecting Global Extreme Poverty: Updated Using PIP.” World Bank, Washington, DC.
Zaveri, E., J. Russ, A. Khan, R. Damania, E. Borgomeo, and A. Jägerskog. 2021. Ebb and Flow, Volume 1: Water, Migration, and Development. Washington, DC : World Bank. https://doi.org/10.1596/978 -1-4648-1745-8.
Chapitre 3
Le potentiel inexploité de la migration
Introduction
Face aux grandes tendances mondiales et aux schémas migratoires africains, il est indispensable de se doter de politiques pertinentes en matière de migration et de déplacements forcés, pour le présent comme pour l’avenir. Compte tenu de la Grande Divergence Démographique et des déséquilibres économiques entre l’Afrique et le reste du monde, la migration offre aux migrants et à leurs familles des avantages inexploités1. Par ailleurs, dans un contexte de fragilité chronique et de vulnérabilité climatique, la migration procure un mécanisme d’adaptation essentiel. À mesure que la pénurie de main-d’œuvre s’intensifiera dans les pays à revenu élevé et intermédiaire supérieur, la demande d’immigration en provenance d’Afrique et d’ailleurs augmentera. Des politiques volontaristes seront nécessaires pour exploiter ce potentiel tout en atténuant ses répercussions. Les situations de fragilité, de conflit et de violence en Afrique soulignent l’urgence et la nécessité de renforcer les systèmes d’accueil des réfugiés et des personnes déplacées internes. L’Afrique peut bénéficier des possibilités offertes par la migration pour son développement, tout en protégeant et en valorisant le potentiel économique des réfugiés et des personnes déplacées internes.
La migration a le potentiel de générer des retombées économiques plus importantes en Afrique
La migration hors d’Afrique est relativement faible (comme le montre le chapitre 1 de ce rapport) : les migrants se rendant dans les destinations offrant les gains salariaux les moins importants. Le graphique 3.1 illustre, dans différentes régions de destination, les ratios entre le salaire des migrants (âgés de 15 à 35 ans) originaires des pays du centre géographique de l’Afrique, et le salaire des non-migrants possédant un niveau de compétences comparable dans les pays d’origine. Par exemple, par rapport aux salaires de son pays d’origine, un migrant peu qualifié du centre gagne deux fois plus dans la périphérie géographique de l’Afrique, trois fois plus dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et quatre fois et demie plus aux États-Unis2. Les gains salariaux sont similaires pour les migrants moyennement qualifiés, et légèrement inférieurs pour les migrants hautement qualifiés, en particulier dans les pays de la périphérie de l’Afrique et du CCG. Le graphique 3.1 montre également le nombre
Graphique 3.1 Ratio entre les salaires des migrants (âgés de 15 à 35 ans) originaires du centre géographique de l’Afrique et les salaires des non-migrants, par région de destination
Ratio des salaires
Du centre de l’Afrique vers le centre de l’Afrique
Du centre de l’Afrique vers la périphérie de l’Afrique
Du centre de l’Afrique vers le CGG
Nombre de migrants
Du centre de l’Afrique vers l’Amérique du Nord
Peu qualifiés Moyennement qualifiés Hautement qualifiés Nombre de migrants (axe de droite)
Sources : American Community Survey (2016-2020) ; recensement de l’Afrique du Sud 2011 ; enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages 2018/2019 (Sénégal) ; enquêtes 2015 sur les coûts de la migration réalisées par l’Alliance mondiale pour le savoir sur les migrations et le développement (KNOMAD) et l’Organisation internationale du travail (OiT).
Note : « Du centre de l’Afrique vers le centre de l’Afrique » représente les salaires des migrants originaires de la Communauté économique des états de l’Afrique de l’Ouest (CeDeAO) au Sénégal. « Du centre de l’Afrique vers la périphérie de l’Afrique » représente les salaires des migrants originaires de la CeDeAO en Afrique du Sud. « Du centre de l’Afrique vers le CCG » représente les salaires des migrants éthiopiens en Arabie Saoudite. « Du centre de l’Afrique vers l’Amérique du Nord » représente les salaires des migrants originaires de la CeDeAO aux états-unis. « Peu qualifiés » désigne les migrants ayant suivi un enseignement primaire, « moyennement qualifiés » ceux ayant suivi un enseignement secondaire et « hautement qualifiés » ceux ayant suivi un enseignement supérieur.
CCG = Conseil de coopération du Golfe.
de migrants originaires du centre de l’Afrique dans quatre régions de destination en 2020. Environ 10 millions de migrants internationaux originaires d’un pays du centre de l’Afrique se concentrent dans d’autres pays du centre, tandis qu’environ 2 millions se trouvent dans la périphérie de l’Afrique, un peu plus de 2 millions en Amérique du Nord et moins de 1 million dans les pays du CCG3
Le rendement modeste de la migration se manifeste par le faible montant des remises migratoires reçues par les pays africains, en particulier ceux du centre du continent. En 2021, sur un flux mondial de 781 milliards de dollars d’envois de fonds, chacun des 41 pays du centre de l’Afrique a reçu en moyenne 1,2 milliard de dollars, contre 3,7 milliards par pays dans la périphérie de l’Afrique, 2,9 milliards en Amérique latine et dans les Caraïbes, et 19,6 milliards en Asie du Sud4. Le graphique 3.2 montre que le faible volume des remises migratoires reçues par les pays du centre de l’Afrique n’est pas nécessairement dû au petit
nombre d’émigrants originaires de la région. Il illustre qu’en moyenne, le centre de l’Afrique a reçu 1 429 dollars par émigrant en 2020, contre 2 543 en Amérique latine et dans les Caraïbes, 3 497 en Asie du Sud et 3 707 dans la périphérie de l’Afrique. Dans l’ensemble, les graphiques 3.1 et 3.2 montrent que la plupart des migrants originaires du centre de l’Afrique se trouvent dans des régions de destination où les gains salariaux sont limités. De ce fait, les fonds envoyés aux communautés du pays d’origine sont inférieurs à ceux envoyés par les migrants originaires d’autres régions.
De plus, le coût des envois de fonds vers l’Afrique reste le plus élevé au monde, ce qui réduit les bénéfices que l’Afrique peut tirer de la migration. Les envois de fonds constituent l’un des moyens les plus concrets pour les pays d’origine de percevoir les effets bénéfiques de la migration sur leur développement. Malgré les avancées technologiques des dernières décennies, le coût des envois de fonds demeurait à 6,2 % au niveau mondial au deuxième trimestre 2023, soit plus du double de l’objectif de 3 % fixé dans les Objectifs de développement durable. Ce coût tient en grande partie aux frais et aux marges de change que les migrants et leurs familles doivent payer dans les pays d’origine et de destination. L’Afrique subsaharienne est la région où le coût des envois de fonds était le plus élevé en 2023 (7,9 %), tandis qu’il était le plus faible en Asie du Sud (4,3 %). Le graphique 3.3 montre que le coût des envois de fonds est plus élevé que la moyenne mondiale dans 18 pays du centre de l’Afrique sur 29 et 7 pays de la périphérie sur 9 pour lesquels des données sont disponibles.
Graphique 3.2 Les pays du centre géographique de l’Afrique reçoivent les plus faibles envois de fonds par émigrant
Envois de fonds par émigrant (USD)
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
Centre de l’Afrique
Périphérie de l’Afrique
Asie de l’Est et Pacifique
Asie du Sud Europe de l’Est et Asie centrale
Amérique latine et Caraïbes
Amérique du Nord
MoyenOrient –autres
Pays à revenu faible et intermédiaire inférieur
Sources : Matrice 2021 des envois de fonds bilatéraux de la Banque mondiale, décembre 2022 ; Nations unies, Département des affaires économiques et sociales, Stock international de migrants 2020.
Note : Le nombre de réfugiés est soustrait du stock international de migrants déclaré.
Graphique 3.3 Le coût de transaction moyen des envois de fonds vers un pays africain est élevé
Coût d’envoi de 100 USD (USD)
AngolaBéninMalawiZambieMozambiqueOugandaZimbabweRwandaSierraLeoneMadagascarTanzanieGambieSoudanduSudSoudanRép.dém.duCongoSomalieKenyaCap-VertÉrythréeGhanaNigériaÉthiopieTogoCôted’IvoireComoresSénégalLibériaMaliCamerounBotswanaNamibieAlgérieTunisieEswatiniAfriqueduSudLesothoMarocRép.arabed’ÉgypteMondialAfrique
Centre géographique de l’Afrique
Objectif fixé par les ODD
Périphérie géographique de l’AfriqueTotaux
Source : Banque mondiale 2023a.
Note : ODD = Objectif de développement durable.
Des politiques volontaristes sont nécessaires pour libérer le potentiel de la migration en Afrique
Aujourd’hui et, a fortiori, dans les décennies à venir, les migrants sont incités à rechercher de meilleures perspectives à l’étranger. Face à l’ampleur des bienfaits potentiels pour les migrants et leurs pays d’origine et de destination, et compte tenu des coûts induits, les pays d’origine et de destination peuvent élaborer des politiques et coordonner leurs actions, afin de maximiser les bénéfices et réduire les coûts engendrés par l’exploitation du potentiel de la migration.
La migration peut générer des gains importants pour les migrants et leur pays d’origine
Plusieurs études récentes ont révélé que les migrants et leurs foyers ne sont pas les seuls à bénéficier de la migration et des envois de fonds : les effets s’étendent aux communautés et aux régions d’origine. Les fonds envoyés par les migrants peuvent constituer un capital pour des activités entrepreneuriales dans le pays d’origine et augmenter la demande de biens et services produits localement. Cette dynamique permet de générer des revenus susceptibles d’améliorer le niveau de vie de tous les habitants des communautés et régions d’origine. En effet, il a été
démontré que les régions qui connaissent une forte émigration ont un taux de pauvreté plus faible et une plus grande résilience pour surmonter les chocs5.
Des données récentes recueillies en Afrique confirment ces effets et montrent qu’une émigration plus importante peut accélérer la transformation des économies rurales et la sortie progressive de l’agriculture. Ainsi, un épisode ponctuel de migration du Malawi vers l’Afrique du Sud — qui a concerné des travailleurs du secteur minier peu qualifiés entre 1967 et 1974 — a permis une transition hors de l’agriculture dans les districts d’origine. Les districts où l’émigration temporaire était la plus importante ont enregistré des entrées de capitaux plus élevées grâce aux envois de fonds, ce qui a augmenté le nombre d’entreprises non agricoles dans ces districts et accéléré l’évolution des marchés du travail de l’agriculture aux services (Dinkelman, Kumchulesi et Mariotti 2024). Au Burkina Faso, la sortie progressive de l’agriculture a réduit le besoin de main-d’œuvre agricole familiale (travail des enfants) et entraîné une diminution du taux de fécondité dans des villages qui connaissaient jusque-là de hauts niveaux de migration circulaire peu qualifiée vers la Côte d’Ivoire (Dupas et al. 2023). De même, il a été constaté que les communes marocaines qui connaissaient des taux d’émigration élevés vers la France s’urbanisaient plus rapidement (Salem et Seck 2022).
Au-delà des remises migratoires, les pays d’Afrique peuvent bénéficier des effets positifs de l’émigration sur la formation de capital humain. Tout d’abord, les remises migratoires sont souvent utilisées pour améliorer la scolarisation et la santé des enfants restés au pays, à court et à long terme6. Au-delà de la famille proche des migrants, c’est toute la communauté qui peut percevoir ces effets sur le capital humain. Par exemple, dans les communautés du Malawi dont l’accès au travail dans les mines sud-africaines a été facilité entre 1967 et 1974, les enfants ont atteint un niveau de scolarisation plus élevé à court et à long terme (20 ans plus tard) (Dinkelman et Mariotti 2016). Ces gains peuvent être encore plus importants si les possibilités de migration perdurent, comme dans le cas des Philippines (Khanna et al. 2022).
La migration, ou plutôt la perspective d’une future migration, peut également inciter les migrants potentiels à acquérir des compétences recherchées à l’étranger. Des études récentes ont montré que ce type de motivation peut accroître le capital humain dans les pays d’origine, même chez les personnes qui n’émigrent jamais. Au Cap-Vert, une plus grande probabilité de migration future augmente le taux d’achèvement de l’enseignement secondaire des jeunes (Batista, Lacuesta et Vicente 2012). De même, la perspective d’être recruté par l’armée britannique augmente de plus de 1,1 an le niveau d’instruction général des hommes népalais, même chez ceux qui n’émigrent finalement jamais (S. A. Shrestha 2017). L’essor du secteur des technologies de l’information en Inde est notamment attribué à l’augmentation des investissements effectués par les Indiens dans l’apprentissage de ces technologies. Or ces investissements sont motivés par la perspective d’émigrer aux États-Unis (Khanna et Morales 2021). Dans la même veine, une étude récente a montré qu’aux Philippines, une plus grande
probabilité d’émigrer aux États-Unis avait augmenté le nombre d’inscriptions et de diplômes en soins infirmiers. Pour chaque infirmier qui a émigré, sept ont obtenu un diplôme et sont restés aux Philippines (Abarcar et Theoharides, 2024).
Des politiques sont nécessaires pour permettre les effets incitatifs de l’émigration sur l’acquisition de compétences. Puisque la perspective de l’émigration augmente le rendement de l’acquisition de compétences, l’offre d’établissements d’enseignement et de formation de qualité doit se développer en conséquence. Par exemple, une étude a constaté que les effets positifs de l’émigration sur le capital humain au Sénégal se concentraient dans les zones ayant un meilleur accès aux écoles (Bocquier et al. 2023). Si les établissements d’enseignement ou de formation sont incapables de répondre à la demande accrue par les perspectives d’émigration, les effets positifs sur les pays d’origine, qui perdent du capital humain, peuvent être atténués ou inversés. Cet enjeu est particulièrement important dans des secteurs comme les soins de santé (encadré 3.1).
ENCADRÉ 3.1
Migration des personnels de santé africains
Le secteur africain des soins de santé en chiffres
En 2018, l’Afrique comptait en moyenne 29 travailleurs de la santé pour 10 000 habitants, bien en deçà de l’objectif de 44,5 fixé par les Objectifs de développement durable (OMS 2021a). La « Liste OMS d’appui et de sauvegarde pour les personnels de santé » dénombre 55 pays confrontés à un manque critique de personnels de santé pour pouvoir atteindre la couverture santé universelle en 2023. Parmi ces pays, 37 se trouvent en Afrique (OMS 2023a). Le graphique B3.1.1 montre que les pays du centre géographique de l’Afrique comptent en moyenne 10 infirmiers et sages-femmes et 2 médecins pour 10 000 habitants. La répartition des professionnels de santé souffre d’un déséquilibre en faveur d’un petit nombre de villes, entraînant une pénurie dans les zones rurales et reculées (OMS 2023b). Les différences de salaires entre le public et le privé, avec un avantage marqué pour le secteur public, et les choix de carrière que ces différences favorisent, ont aggravé les inégalités géographiques. La migration internationale des personnels de santé a rendu plus visibles les enjeux liés à l’offre nationale et mondiale de ces professionnels, tout comme les enjeux d’équité dans l’accès aux soinsb. Il est difficile de trouver des données sur la part de professionnels de santé qui migrent, mais les estimations disponibles suggèrent qu’environ 10 à 20 % des médecins et environ 10 % des infirmiers migrent à l’étrangerc
(suite page suivante)
Encadré 3.1 Migration des personnels de santé africains (suite)
Graphique B3.1.1 Nombre de médecins, infirmiers et sages-femmes pour 10 000 habitants, 2018-2021
Régions hors Afrique
Périphérie
Professionnels de santé pour 10 000 habitants
Infirmiers et sages-femmes Médecins
Source : estimations basées sur les données de la base « Comptes nationaux du personnel de santé », Organisation mondiale de la santé, Genève (https://apps.who.int/nhwaportal, https://www.who.int/activities /improving-health-workforce-data-and-evidence).
Note : Les données proviennent d’un échantillon de 148 pays pour lesquels des informations sur les médecins, les infirmiers et les sages-femmes étaient disponibles entre 2018 et 2021. Les autres professionnels de santé ne sont pas inclus dans le graphique. pour chaque région, le graphique présente la moyenne simple des densités de l’ensemble des pays. Aep = Asie de l’est et pacifique ; eAC = europe et Asie centrale ; ALC = Amérique latine et Caraïbes ; MO = Moyen-Orient ; AN = Amérique du Nord ; AS = Asie du Sud.
Le marché mondial des personnels de santé
Dans les pays de destination, les systèmes de santé des pays à revenu élevé emploient de plus en plus d’immigrants. En 2021, dans les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), un médecin sur cinq et près d’un infirmier sur dix avaient été formés à l’étranger (OCDE 2023). Bien que des pays comme l’Inde et les Philippines aient toujours été les plus gros pourvoyeurs, les pays africains sont devenus une source importante de personnels de santé. Par exemple, le Ghana, le Nigéria et le Zimbabwe figurent parmi les cinq premières sources de migrants dans le secteur de la santé au Royaume-Uni ces dernières années (statistiques du gouvernement britannique citées dans Dempster et Crawfurd, 2024). La demande de travailleurs de la santé étrangers devrait augmenter avec le vieillissement de la population et de la main-d’œuvre
(suite page suivante)
Encadré
3.1 Migration
des personnels de santé africains (suite)
dans les pays à revenu élevé. On estime que, d’ici à 2030, les pays de l’OCDE auront besoin de 400 000 médecins et 2,5 millions d’infirmiers supplémentaires pour compléter l’offre intérieure (Scheffler et Arnold 2019).
Les salaires relativement plus élevés dans les pays à revenu élevé, ainsi que le volume et l’augmentation de la demande en travailleurs de la santé étrangers constituent pour les professionnels africains de fortes incitations à migrer à l’étranger. Ces incitations sont amplifiées par les mauvaises conditions de travail dans les pays d’origine, notamment le manque de ressources complémentaires (équipements et appui administratif), et par la faible capacité d’absorption du secteur public. Plus généralement, les incitations sont exacerbées par les situations de conflit et d’insécurité (Chikezie et al. 2023 ; Eastwood et al. 2005).
Dans les pays d’origine, de telles incitations à la migration, caractérisées par un rendement économique élevé, peuvent également motiver les individus à investir pour se former aux professions de santé, comme le montre le cas des Philippines (Abarcar et Theoharides 2024). De même, des données préliminaires récoltées au Nigéria suggèrent que les inscriptions dans les cursus en soins infirmiers augmentent rapidement, car les perspectives d’émigration des infirmiers se sont renforcées ces dernières années (Dempster et Crawfurd 2024). La demande mondiale en personnel de santé ne cesse de croître et l’offre devra augmenter en conséquence. Les hausses respectives de l’offre et de la demande mondiale proviendront probablement de pays différents – avec l’Afrique comme fournisseur potentiel. Dans ce contexte, une action politique volontariste est nécessaire pour garantir que les compétences développées correspondent à la demande, que les effets d’entraînement sont limités et que les bénéfices sont partagés de manière équitable (Dia 2022, 62-63).
Le problème pour la politique migratoire et sa résolution
L’émigration « non gérée » des personnels de santé, bien qu’elle suive les forces du marché, peut être améliorée. Les pays de destination sont confrontés à la lourde tâche de sélectionner les professionnels de santé et à l’incertitude de trouver une main-d’œuvre qui correspond à leurs besoins dans un contexte de pénuries aiguës et croissantes. Les migrants risquent de ne pas voir leurs qualifications reconnues par le pays de destination et de devoir occuper des emplois inférieurs à leurs compétencesd. Les pays d’origine considèrent en outre que ce type d’émigration exerce une pression sur leurs systèmes de santé déjà en tension.
Jusqu’à présent, l’orientation de la politique migratoire des pays d’origine a consisté à contenir l’émigration des professionnels de santé en imposant des quotas ou des taxes sur les migrants. Certains dispositifs prévoient notamment que les professionnels de santé
(suite page suivante)
Encadré 3.1 Migration des personnels de santé africains (suite)
effectuent un nombre minimum d’années de service dans leur pays d’origine avant d’être autorisés à émigrer (aussi appelés « contrats d’engagement de service »). Ces pratiques produisent des résultats mitigés. Leur efficacité dépend de la capacité du système de santé publique à absorber les jeunes diplômés, de la capacité du pays d’origine à faire respecter les clauses d’engagement, et de la volonté des recruteurs étrangers à racheter les obligations financières ou d’engagement des diplômés qualifiés (Hongoro et McPake 2004). De plus, de telles contraintes réduisent les avantages liés au choix d’une profession de santé et risquent de réduire l’offre globale de personnels de santé. Ces restrictions ex post peuvent être complétées par des incitations ex ante, comme des bourses d’études pour compenser l’effet dissuasif des futures contraintes sur la mobilité, comme cela se pratique en Thaïlande (Wibulpolprasert et Pengpaibon 2003). Certains pays d’Europe, notamment les Pays-Bas et le Royaume-Uni, ont mis en place des prêts à remboursement contingent au revenu (PARC) pour les étudiants en médecine, en vertu desquels les étudiants commencent à rembourser leur prêt lorsqu’ils perçoivent un revenu supérieur à un certain seuil. Des clauses de remboursement spécifiques ont été prévues pour les étudiants qui exercent à l’étranger après leurs études. Des dispositifs PARC pourraient également être instaurés dans les pays africains à forte émigration : les jeunes médecins migrant vers un autre pays après avoir terminé leurs études verraient alors les remboursements du PARC être prélevés sur leurs salaires mensuels par le gouvernement du pays d’accueil, qui les reverserait ensuite au gouvernement du pays d’origine. Les revenus générés par le dispositif PARC pourraient servir à financer le coût élevé de l’enseignement supérieur des futurs étudiants en médecine (Ivins et al. 2022).
En lieu et place des politiques unilatérales instaurées par les pays d’origine, des partenariats de gestion de la migration entre les pays d’origine et de destination pourraient profiter aux deux parties, ainsi qu’aux migrants. Ces dispositifs bilatéraux permettraient de prévoir les flux de personnels de santé qualifiés pour répondre à la demande. Ces partenariats offrent aux travailleurs migrants un accès au marché des soins de santé dans les pays de destination sans perte de qualifications ni de compétences. Ils fournissent aux pays d’origine en Afrique un cadre pour gérer l’émigration des travailleurs de la santé, par exemple, depuis les investissements dans la formation en amont jusqu’à l’application, en aval, des clauses d’engagement de service, le cas échéant.
Au cœur de ces partenariats se trouve également la question du partage des coûts et des bénéfices de la migration des travailleurs de la santé entre les pays d’origine et de destination. Les partenariats de gestion de la migration peuvent ainsi inclure une clause sur le partage des bénéfices entre les pays d’origine et de destination, qui pourrait prendre la forme d’une assistance technique et financière, et d’un renforcement des capacités. Bien que cette aide ne doive pas, en théorie, s’appliquer exclusivement au
(suite page suivante)
Encadré 3.1 Migration des personnels de santé africains (suite)
secteur de la santé, les orientations récemment publiées par l’Organisation mondiale de la santé recommandent que tout accord de ce type prenne en compte les besoins spécifiques des systèmes de santé des pays d’origine et de destination (OMS 2024). Par exemple, les besoins en médecins spécialistes peuvent être plus importants dans les pays de destination, tandis que les pays d’origine peuvent avoir davantage besoin de médecins généralistes, d’infirmiers voire de personnel chargé des soins primaires. Les accords de partenariat peuvent ainsi préciser comment le pays de destination peut répondre aux besoins du système de santé du pays d’origine en échange de la mise à disposition d’un personnel de santé qualifié. Dans le cas particulier où les pays d’origine et de destination auraient besoin des mêmes compétences, les partenariats mondiaux sur les compétences (PMC) peuvent constituer un bon outil pour cibler spécifiquement ces compétences (Clemens 2015). Les PMC déterminent comment les coûts sont répartis entre les pays d’origine, les pays de destination, et les autres parties du partenariat tels que les acteurs du secteur privé. Par exemple, les Philippines et l’Allemagne ont récemment mis en place un PMC pour les soins infirmiers, qui prévoit un modèle de formation à deux volets : un volet « national » adapté aux besoins du marché philippin et un volet « extérieur » comprenant des cours spécialisés adaptés au marché allemand (Centre pour le développement mondial 2021).
Ces partenariats et politiques de gestion de la migration destinés à réguler l’émigration des professionnels de santé ne résoudront pas les problèmes structurels plus profonds à l’origine des pénuries de personnel de santé en Afrique. Ces mesures devront être complétées par d’autres dispositifs pour s’attaquer aux problèmes, notamment en matière de gestion du personnel de santé et de répartition géographique dans de nombreux pays africains.
a. Cet indicateur concerne l’ensemble des personnels de santé (13 catégories : médecins généralistes, médecins spécialistes, infirmiers professionnels et assimilés, sages-femmes professionnelles et assimilées, dentistes et techniciens, pharmaciens et techniciens, laborantins, techniciens en imagerie et équipements médicaux, professionnels de l’environnement et de la santé publique, gestionnaires des services de santé, professionnels de la santé communautaire, médecine traditionnelle et complémentaire, et autres professionnels de santé).
b. Les pays africains ne forment pas suffisamment de personnel de santé pour leurs propres marchés. Par exemple, l’Afrique du Sud forme moins d’infirmiers que le Mexique ou la Turquie (Ivins et al. 2022).
c. Bhargava et Docquier (2008) estiment qu’environ 10 % des médecins des pays d’Afrique subsaharienne émigrent à l’étranger. Clemens et Pettersson (2008), qui utilisent une autre méthode pour dénombrer les émigrants, estiment que 19 % des médecins et 8 % des infirmiers nés en Afrique se trouvaient à l’étranger en 2000.
d. La sous-utilisation de la main-d’œuvre de santé qualifiée est un phénomène courant dans les pays à revenu élevé. Par exemple, Batalova, Fix et Pierce (2020) estiment qu’aux États-Unis, plus de 263 000 immigrants qualifiés dans le domaine des soins de santé sont sous-utilisés.
La Grande Divergence Démographique est une chance pour l’Afrique
Les dynamiques et les prévisions démographiques montrent que l’Afrique abritera une part de plus en plus importante de la jeunesse au cours des trente prochaines années. Comme indiqué au chapitre 2 du présent rapport, un jeune sur trois (âgé de 15 à 34 ans) dans le monde sera originaire d’Afrique d’ici 2050. Cette situation sera due à la conjugaison de l’explosion de la jeunesse en Afrique et du vieillissement rapide de la population dans le reste du monde, en particulier dans les pays à revenu élevé. D’ici à 2050, la population en âge de travailler dans les pays non africains à revenu élevé et intermédiaire supérieur diminuera de 207 millions de personnes. En 2050, pour chaque personne âgée, il y aura seulement 2,4 personnes en âge de travailler dans les pays non africains à revenu élevé et intermédiaire supérieur, contre 11 en Afrique.
Les dynamiques démographiques se répercutent sur la demande de main-d’œuvre immigrée dans les pays à revenu élevé. Premièrement, la population en âge de travailler diminue dans les pays à revenu élevé. Ces pays ont donc besoin de plus de travailleurs pour maintenir leurs niveaux de production et leurs conditions de vie actuelles. La baisse de la population active, si elle n’est pas contenue, devrait réduire le produit intérieur brut de l’Union européenne de 12 % d’ici 2050, soit un montant annuel de 1 700 milliards de dollars, après prise en compte des gains estimés de productivité de la main-d’œuvre réalisés d’ici là7. Pour maintenir jusqu’en 2050 le ratio actuel de 2,59 personnes en âge de travailler par personne âgée, les modélisations réalisées dans le cadre de ce rapport montrent que les 27 pays de l’Union européenne devraient augmenter l’immigration extra-européenne de 131 millions de personnes (graphique 3.4, partie a). Pour les principaux pays de destination, la baisse de la population active par rapport à la population âgée impliquerait des hausses de l’immigration de l’ordre de 14 à 52 % de leur population actuelle (graphique 3.4, partie b). Cette augmentation se chiffrerait à 11 millions d’immigrants en France, 97 millions aux États-Unis et 17 millions au Royaume-Uni.
Parallèlement à la réduction de la population active, la population en âge de travailler devrait également se composer de travailleurs plus âgés dans les pays à revenu élevé. La part des jeunes actifs (15-39 ans) dans la population en âge de travailler (15-64 ans) devrait perdre 7,4 points de pourcentage en Europe et en Amérique du Nord8. Cette tendance crée une demande supplémentaire pour les jeunes actifs dans l’économie, dont l’avantage comparatif repose, entre autres facteurs, sur des compétences liées à leur jeunesse. La capacité à effectuer des travaux manuels physiques et d’autres tâches physiquement exigeantes deviendra relativement rare au sein de la population active. Quant aux politiques publiques, les options pour les pays à revenu élevé, telles que le relèvement de l’âge de la retraite ou l’accroissement de la participation des femmes au marché du travail, sont limitées. L’Union européenne pourrait maintenir le même ratio sans augmenter l’immigration en contrepartie d’un report de l’âge de la retraite d’environ 7 ans (graphique 3.4, partie a). Cela reviendrait à repousser l’âge de la retraite d’une durée comprise entre 3 ans (en Suède) et 10 ans (en Espagne) pour les principaux pays de destination des migrants africains (graphique 3.4, partie b). Dans les pays à revenu élevé d’Europe et d’Amérique du Nord, la participation des femmes au marché du travail est déjà proche de celle des hommes, et ne constitue vraisemblablement pas une alternative politique viable pour augmenter la taille de la main-d’œuvre.
Graphique 3.4 Les principaux pays de destination des migrants africains doivent opérer un arbitrage délicat entre une augmentation de l’immigration et un report de l’âge de la retraite.
a. Arbitrage à opérer en Union européenne
Immigration supplémentaire (millions)
Augmentation de l’âge de la retraite (années)
Ratio en 2050 : 1,61 Ratio : 1,93 Ratio : 2,26 Ratio en 2024 : 2,59
b. Principaux pays de destination des migrants africains (hors Afrique et Moyen-Orient)
Augmentation de l’immigration (% de la population actuelle)
Augmentation équivalente de l’âge de la retraite (années)
Principaux pays de destination des migrants africains (hors Afrique et Moyen-Orient)
Augmentation de l’immigration (% de la population actuelle) (axe de gauche)
Augmentation de l’âge de la retraite (années) (axe de droite)
Source : Calculs basés sur les estimations et projections (médiane-variante) démographiques du DAeS de l’ONu 2022. Note : Dans la partie a, les points le long de chaque ligne montrent les combinaisons possibles d’augmentation de l’immigration et de relèvement de l’âge de la retraite pour maintenir le ratio entre la population en âge de travailler et la population âgée. La partie b représente l’augmentation de l’immigration qui sera nécessaire d’ici 2050 pour maintenir le ratio actuel entre la population en âge de travailler et la population âgée, exprimée en pourcentage de la population actuelle sur l’axe de gauche (en jaune). Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre équivalent d’immigrants (en millions) nécessaires. L’axe de droite (en rouge) représente l’augmentation équivalente de l’âge de la retraite nécessaire pour maintenir le ratio en l’absence d’immigration supplémentaire.
Les pays à revenu élevé peuvent en partie soulager cette tension en misant sur l’automatisation, mais cette option présente certaines limites. Les économies vieillissantes investissent déjà de manière disproportionnée dans les technologies d’automatisation pour compenser le besoin de main-d’œuvre9. Les récents progrès technologiques, notamment en robotique et en intelligence artificielle, ont modifié notre perception du type d’activités pouvant être automatisées. Bien que ces innovations puissent contribuer à réduire le besoin de main-d’œuvre (immigrée), et malgré les progrès actuels, il est peu probable que la technologie génère des gains de productivité importants. En effet, la technologie ne parvient pas à remplacer totalement les êtres humains dans les tâches physiques et interpersonnelles complexes, en particulier dans le secteur des soins et des services à la personne (Acemoglu, 2024). Dans ces secteurs, la demande devrait augmenter avec l’accroissement de la part des personnes âgées dans la population. Par exemple, les projections du Bureau américain des statistiques du travail indiquent que les aides à domicile et les aides-soignants font partie des deux professions affichant la plus forte prévision de croissance de l’emploi entre 2022 et 2032 aux États-Unis (Bureau américain des statistiques du travail 2024).
Le niveau de qualification des migrants africains augmente avec la distance de la migration : les migrants plus qualifiés migrent plus loin. En Afrique du Sud, moins de 40 % des migrants originaires des pays voisins de la Communauté de développement de l’Afrique australe ont achevé leurs études secondaires, contrairement à plus de 50 % des migrants originaires de pays africains plus éloignés, dont 25 % sont titulaires d’un diplôme du supérieur (Crush et Dodson, 2017). De même, plus de 35 % des personnes originaires du centre géographique de l’Afrique qui migrent vers un pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sont titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur ; ce taux atteint 55 % chez les migrants originaires des pays d’Afrique australe. Toutefois, de nombreux migrants possédant un haut niveau d’instruction travaillent dans des secteurs ou des professions peu ou moyennement qualifiés. Environ 48 % des migrants très qualifiés originaires de pays non membres de l’UE occupent un emploi peu ou moyennement qualifié dans l’UE (EPRS 2021). De même, 41 % des migrants zimbabwéens en Afrique du Sud travaillent dans des secteurs peu qualifiés (Cha’ngom 2024). Il est donc nécessaire de mettre en place des politiques pour reconnaître les compétences et les qualifications des migrants dans les pays de destination, ainsi que des structures facilitant l’adéquation entre l’offre de compétences et les besoins sur les marchés. Pour bénéficier des possibilités offertes par la Grande Divergence Démographique tout en s’assurant que les économies nationales disposent de suffisamment de travailleurs qualifiés, l’Afrique doit renforcer ses compétences. Le nombre moyen d’années de scolarité ajustées à l’apprentissage dans le centre de l’Afrique est de 4,8, contre 10,7 dans les principales destinations européennes (Filmer et al. 2020). Cet écart est dû à des problèmes de qualité et de quantité de l’enseignement en Afrique, qui empêchent le continent de répondre à la demande mondiale de travailleurs hautement qualifiés, notamment dans les secteurs des technologies de l’information et de la santé. Pour recueillir les fruits de la migration tout en veillant à ce que les économies nationales continuent à bénéficier de travailleurs qualifiés, l’Afrique doit renforcer son niveau général de compétences, ainsi que les compétences ciblées sur les secteurs en forte demande
dans le monde. Par ailleurs, pour exploiter pleinement ces possibilités, en particulier dans les secteurs très demandés comme les soins ou les services à la personne, l’acquisition de compétences doit aller au-delà de l’instruction et inclure la langue, la communication, le sens du service, l’intelligence sociale, la pensée critique, la fiabilité et d’autres compétences relationnelles10.
Alors que les discussions sur les politiques migratoires sont souvent centrées sur la migration de main-d’œuvre, la migration à des fins d’éducation ou de formation, largement sous-utilisée, peut en partie répondre aux enjeux de la migration de main-d’œuvre, tels que l’intégration sociale. Le fait de recevoir un enseignement et une formation dans le pays de destination permet de résoudre les problèmes liés à la reconnaissance des compétences et des qualifications sur le marché du travail. Une reconnaissance mutuelle des qualifications faciliterait également un retour productif des migrants dans leur pays d’origine, sachant que deux étudiants internationaux sur trois quittent les pays de l’OCDE à l’expiration de leur visa (OCDE 2022).
De plus, les étudiants et les bénéficiaires de formations sont plus longtemps immergés dans la langue, la culture et le système politique de la société de destination, et ce à un âge plus jeune. Cette expérience prolongée facilite l’intégration sur les marchés du travail, et dans la société en général (Banque mondiale 2023b, chapitre 6).
Le nombre d’étudiants africains poursuivant des études après le secondaire en dehors de leur pays d’origine a presque triplé au cours des deux dernières décennies, passant de moins de 280 000 à plus de 624 000 (Carnegie Endowment 2023). Cependant, le graphique 3.5 montre que la propension des jeunes (âgés de 15 à 24 ans) à migrer à l’étranger pour y étudier reste plus faible dans les pays du centre géographique de l’Afrique, où seulement 1,8 jeune sur 1 000 poursuit des études supérieures à l’étranger. Ce chiffre est à comparer aux 4,7 ‰ dans les pays de la périphérie
Graphique 3.5 Propension à migrer à l’étranger pour étudier, 2020
Étudiants internationaux pour 1 000 jeunes (15-24 ans) dans les régions d’origine
Europe et Asie centrale
Moyen-OrientAsie de l’Est et Pacifique
Périphérie géographique de l’Afrique
Amérique latine et Caraïbes
Asie du Sud Centre géographique de l’Afrique
Sources : Calculs basés sur les données de l’institut de statistique de l’uNeSCO et des perspectives de la population mondiale des Nations unies.
géographique de l’Afrique et aux 13,1 ‰ en Europe et Asie centrale11. Les pays africains, en particulier ceux de l’Afrique subsaharienne, affichent des taux d’inscription dans l’enseignement supérieur parmi les plus faibles au monde. Face à l’accroissement de la demande d’enseignement supérieur en Afrique, la mobilité internationale des étudiants peut contribuer à répondre à la demande intérieure non satisfaite, tout en augmentant les retombées de l’éducation. À l’image des tendances migratoires globales, les étudiants africains migrent de plus en plus vers d’autres destinations que l’Amérique du Nord ou l’Europe occidentale ; en 2020, l’Arabie saoudite, la Chine, les Émirats arabes unis et la Turquie ont été d’importantes destinations pour les étudiants internationaux originaires d’Afrique (Carnegie Endowment 2023).
Une stratégie de gestion de la migration est une condition essentielle
Comme le souligne le Rapport sur le développement dans le monde 2023, la gestion stratégique de la migration permet aux pays d’origine et de destination de maximiser ses avantages et de minimiser ses coûts (Banque mondiale 2023b, chapitre 9). En gérant la migration de manière stratégique, les pays d’origine et de destination peuvent planifier et organiser le type de migration qui les intéresse le plus et maximiser les gains qu’ils retirent de la migration actuelle. Pour les pays d’origine en Afrique, cette démarche peut consister à : identifier les pays de destination potentiels des migrants ; évaluer et développer les compétences — techniques, cognitives et non cognitives — qui correspondent à la demande ou complètent la force de travail dans les pays de destination ; veiller à ce que les personnes migrent avec les compétences et les papiers nécessaires ; améliorer la protection sociale des migrants quand ils sont à l’étranger ; faciliter les flux de fonds, de connaissances et d’investissements envoyés par la diaspora ; et faciliter les conditions de retour des migrants qui choisissent de rentrer.
L’un des moyens utilisés par les pays pour gérer la migration de main-d’œuvre est la signature de traités bilatéraux, d’accords de travail et de mémorandums d’accord. Les accords bilatéraux sur la migration de main-d’œuvre (ABMMO) permettent aux pays d’origine et de destination de gérer les flux de main-d’œuvre d’une manière qui profite aux deux parties. Étant donné que la plupart des politiques évoquées précédemment ont besoin de temps pour porter leurs fruits, les deux pays doivent avoir une visibilité sur l’offre ou la demande future de travailleurs pour entreprendre des investissements à long terme. En outre, l’application de certaines clauses — par exemple, le droit à des conditions de travail minimales ou l’obligation de respecter les permis de séjour de courte durée — nécessite la coopération des pays d’origine et de destination. Les ABMMO peuvent servir à en préciser les termes.
Ce type d’instrument peut également aider les migrants quand ils sont à l’étranger, en particulier lorsqu’ils se trouvent dans des secteurs ou des situations vulnérables. Les ABMMO peuvent jouer un rôle important dans l’instauration de mesures de protection juridique adéquates pour les travailleurs migrants. Les ABMMO, quand ils sont complétés par des mesures qui réglementent les intermédiaires, peuvent jouer un rôle essentiel auprès des travailleurs évoluant dans des secteurs ou des situations qui les rendent
intrinsèquement vulnérables, comme les travailleurs domestiques (Fernando et Singh, à paraître). Les femmes migrantes, qui sont surreprésentées dans ces secteurs, ont plus de risques d’être exposées à la violence et à l’exploitation sexiste et sexuelle. Les Africaines qui migrent pour travailler sont particulièrement vulnérables à la violence physique et sexuelle et au harcèlement (Atong, Maya et Odigie 2018 ; Blaydes 2023). Il est essentiel de leur permettre d’accéder à des procédures adaptées de réparation des préjudices, ainsi qu’à d’autres dispositifs d’accompagnement et de recours. La gestion de ces risques par des leviers politiques peut être une meilleure alternative aux mesures drastiques des politiques de restriction de la migration, qui peuvent nuire involontairement aux migrants potentiels et à leurs familles12. Malgré les mesures prises par certains pays africains pour éliminer les obstacles à la mobilité des femmes, des restrictions subsistent. Ces barrières se traduisent souvent par l’absence de politiques de transport répondant aux besoins spécifiques des femmes ou par des formalités spécifiques pour obtenir un passeport, comme fournir le nom d’un époux ou un certificat de mariage. En Libye, les maris peuvent faire figurer leurs épouses et leurs enfants de moins de 18 ans sur leur passeport, ce qui empêche ces derniers d’obtenir leur propre passeport 13. Les femmes voyageant seules doivent également justifier leurs raisons et fournir le détail de leurs précédents voyages. En République arabe d’Égypte, les femmes se voient toujours imposer des restrictions pour quitter le domicile conjugal sans l’autorisation de leur mari 14,15
Les pays d’Afrique, notamment les pays du centre géographique, ont moins recours aux ABMMO et aux autres outils stratégiques de gestion de la migration que le reste du monde. Une base de données répertoriant tous les ABMMO depuis 1927 montre clairement que les pays d’Afrique, et surtout les pays du centre de l’Afrique, sont en retard en ce qui concerne le nombre d’ABMMO signés (Chilton et Woda 2022) (carte 3.1). Ce décalage s’est accru depuis 1990. Entre 1990 et 2020, le nombre d’ABMMO signés par les pays d’Asie de l’Est et du Pacifique et d’Asie du Sud a été multiplié par un facteur compris entre 7 et 10, tandis que les ABMMO signés par les pays d’Afrique n’ont été multipliés que par 2. Si la signature d’ABMMO n’est qu’un seul indicateur de la gestion stratégique de la migration, ce n’est pas le seul domaine où l’Afrique se laisse distancer par d’autres régions. Un rapport récent de l’Organisation internationale pour les migrations montre, à partir des données des Indicateurs de gouvernance des migrations, que certaines questions sont absentes ou commencent seulement à émerger en Afrique, en particulier dans les pays du centre de l’Afrique. Ces questions concernent le développement d’une stratégie nationale de migration et de ses liens avec la stratégie de développement plus générale, la mise en place d’un mécanisme de coordination interministérielle sur les questions de migration ou la participation à des discussions bilatérales sur la migration16,17
Carte 3.1 Nombre d’accords bilatéraux sur la migration de main-d’œuvre signée, 1927-2020
Nombre d’accords bilatéraux sur la migration de main-d’œuvre
Pas de données
48497 | JANVIER 2025
Sources : Chilton et Woda 2022 ; Base de données sur les accords bilatéraux sur la migration de main-d’œuvre, version 2 (2022), https://www.law.uchicago.edu/bilateral-labor-agreements-dataset
Les éléments disponibles à ce jour indiquent que les ABMMO jouent un rôle clé dans le renforcement de la migration entre pays signataires. Si l’on pouvait s’attendre à ce que les ABMMO augmentent les flux migratoires entre les pays, les données empiriques montrent également leur efficacité à accroître le stock de migrants dans les pays de destination, y compris dans le CCG (Adhikari et al. 2024) (encadré 3.2). Les ABMMO augmentent le stock de migrants dans les pays de destination de plus de 77 %, et les effets d’un seul de ces accords peuvent durer jusqu’à trente ans. Toutefois, comme le montre le graphique 3.6, cet effet positif des ABMMO sur l’augmentation de la migration est pratiquement inexistant dans les pays africains. L’absence d’effets durables sur la migration africaine s’observe surtout dans les pays caractérisés par une faiblesse des institutions (mesurée par l’efficacité gouvernementale), ce qui souligne la nécessité de renforcer les capacités pour mettre en œuvre ce type d’accords. Pour un pays d’Afrique subsaharienne, un seul ABMMO permettrait d’augmenter les revenus des migrants d’environ 2,4 millions de dollars par an18. L’impact pourrait être beaucoup plus important si davantage d’investissements étaient engagés dans les capacités et les systèmes de migration pour mettre en œuvre ce type d’accords. Si les pays d’Afrique subsaharienne obtenaient les mêmes effets d’un ABMMO sur la migration que les autres pays à revenu faible et intermédiaire inférieur, les gains de revenu supplémentaires pourraient s’élever à 48,6 millions de dollars par an.
IBRD
Graphique 3.6 Effet des ABMMO sur les flux migratoires de main-d’œuvre
a. Pays africains
Réponse migratoire aux ABMMO (points de pourcentage)
b. Pays hors Afrique
Réponse migratoire aux ABMMO (points de pourcentage)
Décennies à partir de la signature d’un ABMMO (décennie de signature = 0)
Décennies à partir de la signature d’un ABMMO (décennie de signature = 0)
Effet Intervalle de confiance à 95 %
Source : Adhikari et al. 2024.
Note : ABMMO = Accords bilatéraux sur la migration de main-d’œuvre.
Les politiques mises en œuvre aujourd’hui vont ainsi déterminer si l’Afrique pourra bénéficier du potentiel de la migration économique demain. Les pays à revenu élevé doivent agir dès maintenant pour maintenir leur niveau de prospérité actuel au cours des prochaines décennies.
Si des mesures comme le report de l’âge de la retraite et l’accélération de l’automatisation peuvent en partie compenser la réduction de la main-d’œuvre dans les pays à revenu élevé, il sera probablement nécessaire de compléter ces mesures par une augmentation de l’immigration afin de répondre à la demande croissante de jeunes travailleurs et de personnel soignant.
De même, pour pouvoir tirer parti de cette perspective, les pays africains doivent investir dès maintenant dans l’acquisition des compétences qui seront en forte demande dans les pays à revenu élevé vieillissants. Outre l’amélioration du système éducatif, il pourrait être nécessaire de développer les compétences relationnelles et comportementales, qui s’annoncent importantes dans les pays de destination à revenu élevé. De nombreux pays africains peuvent profiter des possibilités offertes à l’étranger pour améliorer également les compétences de leurs populations et leurs propres marchés du travail.
Migration temporaire vers les pays du CCG
Les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) sont devenus une destination privilégiée des travailleurs migrants. En 2020, les six pays du CCG ont accueilli au total 11 % des migrants du monde, soit environ 30 millions de personnesa. Si les pays d’Asie du Sud, notamment le Bangladesh, l’Inde et le Pakistan, ont toujours été les plus grands fournisseurs de travailleurs migrants, des pays africains comme l’Éthiopie, la République arabe d’Égypte et le Soudan deviennent des sources de plus en plus importantes. Les migrants constituent une part notable de la population des pays du CCG : 37 % en Arabie saoudite et jusqu’à 85 % dans les Émirats arabes unis. Par conséquent, les pays du CCG constituent une source majeure d’envois de fonds : en 2022, plus de 120 milliards de dollars américains ont été envoyés par les émigrants dans leur pays d’origine, soit 28 % des flux mondiaux de remises migratoires cette année-là (Ratha et al. 2024).
Ces envois de fonds jouent un rôle crucial dans le développement de nombreux pays d’origine des migrants et dans la réduction de la pauvretéb
Cette migration d’ampleur en direction du CCG se caractérise par sa nature temporaire et par le fait qu’elle est principalement motivée par l’emploi. La plupart des travailleurs migrants, en particulier ceux qui occupent des emplois peu qualifiés, échangent leur travail contre un salaire (souvent accompagné du logement et de la nourriture) pour une période prédéfinie, mais n’ont accès ni au statut de résident de longue durée, ni à la nationalité, ni aux aides sociales publiquesc. Le plus souvent, le contrat d’un travailleur peu qualifié est à durée déterminée, de deux ou trois ans, avec possibilité de renouvellement. Les membres de la famille ne sont généralement pas autorisés à accompagner le migrant, sauf si les revenus du travailleur dépassent un certain seuil. Les lois sur l’immigration qui encadrent cette migration temporaire sont complétées par un système de parrainage par l’employeur (le système de la kafala) qui lie un immigrant à son employeur pour les questions d’entrée, de sortie, de séjour et d’emploid
Toutefois, le système de la kafala confère aux employeurs « parrains » un pouvoir important sur les travailleurs migrants en matière de rémunération, de conditions de vie et de travail, ainsi que de possibilité de changer d’emploi. Ce système suscité de vives inquiétudes en matière de restriction de la mobilité et de précarité des conditions de vie des travailleurs migrants, qui ont peu de voies de recours et de procédures de réparation des préjudicese. Les femmes, qui représentaient plus de 40 % des 5,5 millions de travailleurs domestiques dans les pays du CCG en 2021, subissent particulièrement ce déséquilibre des pouvoirsf. Des rapports faisant état de cas de maltraitance et d’exploitation au domicile des employeurs ont conduit certains pays d’origine, dont le Ghana, le Kenya et les Philippines, à imposer des interdictions temporaires de recrutement de leurs travailleurs domestiquesg
(suite page suivante)
Encadré
3.2 Migration temporaire vers les pays du CCG (suite)
Ces dernières années, les Émirats arabes unis, le Qatar et, plus récemment, l’Arabie saoudite ont pris des mesures législatives pour améliorer les conditions de vie et de travail, notamment en réformant le système de la kafala. Ces réformes interdisent à l’employeur de confisquer le passeport des travailleurs domestiques, limitent le nombre d’heures de travail quotidiennes et introduisent des droits à des congés payés hebdomadaires et annuelsh. Un rapport de l’Organisation internationale pour les migrations note des évolutions prometteuses en matière de réglementation des migrations, mais d’autres voies restent à concrétiser, notamment dans la mise en œuvre de ces réglementations (OIM 2023). De leur côté, les pays d’origine peuvent profiter des (re)négociations des accords bilatéraux sur les migrations de main-d’œuvre pour obtenir de meilleures conditions pour leurs citoyens. Le renforcement de la protection consulaire, et éventuellement de la protection conjointe impliquant plusieurs pays d’origine, permettrait aux travailleurs de bénéficier d’une aide en cas de violation de leur contrat de travail.
a. D’après les données sur les migrations bilatérales compilées par le DAES de l’ONU (2020).
b. Par exemple, M. Shrestha (2017) estime que l’augmentation de la migration vers le CCG explique un tiers de la réduction de la pauvreté au Népal entre 2001 et 2011.
c. La naturalisation est possible, mais dans des conditions très restrictives qui excluent la plupart des migrants. Le Koweït, par exemple, exige de résider dans le pays pendant 20 années consécutives (15 si le demandeur est d’origine arabe), de connaître la langue arabe, d’être musulman et de subvenir à ses propres besoins ou de fournir des services nécessaires au pays ; article 4 du décret Amiri n° 5/1959 relatif à la loi sur la nationalité koweïtienne (Base de données « La migration et le droit », KNOMAD 2022).
d. Les pays du CCG prévoient des sanctions en cas de migration irrégulière, qui comprennent un mélange d’expulsions, d’amendes et de peines d’emprisonnement (Zahra 2014).
e. Les réformes autorisant une plus grande mobilité de la main-d’œuvre aux Émirats arabes unis ont entraîné une hausse des revenus des travailleurs migrants en exercice, mais il y a eu moins d’embauches de nouveaux arrivants et des salaires de départ plus bas (Naidu, Nyarko et Wang 2016). L’absence de juridiction du travail en Arabie saoudite et de services d’assistance juridique abordables pour les travailleurs migrants temporaires à faibles revenus contribue également à créer un environnement qui permet aux employeurs d’abuser du système de parrainage (Almutairi 2018). f. Oman est exclu de ces estimations. Les femmes représentent 32 % de l’ensemble des travailleurs domestiques en Arabie saoudite et plus de 70 % au Bahreïn et dans les Émirats arabes unis (OIT 2021).
g. Le Ghana a interdit la délivrance de visas pour ses travailleurs domestiques dans le CCG à compter de juin 2017 en réponse à des cas de maltraitance (OIM 2019). De 2014 à 2017, le Kenya a interdit l’envoi de travailleurs au Moyen-Orient, et une autre interdiction temporaire pour les travailleurs domestiques a été proposée en 2022 par le ministère des Affaires étrangères et de la Diaspora, avant d’être rejetée par le ministère du Travail (https://kippra.or.ke/measures-to-ensurethe-safety-of-kenyan-domestic-workers-in-the-middle-east/#:~:text=The%20Ministry%20of%20 Foreign%20and,not%20accommodate%20all%20new%20workers). Les Philippines ont instauré des interdictions temporaires pour les travailleurs domestiques à destination du Koweït (de janvier à mai 2018, puis en 2023, interdiction levée en juin 2024) et de l’Arabie saoudite (en 2021-2022).
h. Voir la loi qatarienne n° 15 de 2017 sur les travailleurs domestiques et le décret-loi fédéral n° 9 de 2022 des Émirats arabes unis relatif aux travailleurs domestiques, ainsi que ses amendements. L’Arabie saoudite a également introduit de nouvelles lois régissant le travail domestique (décision ministérielle n° 40676).
L’Afrique doit exploiter le potentiel économique des migrants déplacés de force et en détresse tout en préservant leur dignité
Les déplacements forcés et les migrations de détresse à destination des pays voisins constituent une grande part des migrations transfrontalières actuelles en provenance du centre géographique de l’Afrique. Le graphique 3.7 montre la part de migrants transfrontaliers qui étaient réfugiés ou demandeurs d’asile en 2020. Les réfugiés et les demandeurs d’asile composent près de 30 % des flux migratoires internationaux en provenance des pays du centre de l’Afrique, contre 8 % des flux en provenance d’Asie du Sud, 5 % d’Asie de l’Est et du Pacifique, 5 % d’Amérique latine et des Caraïbes et 1 % des pays de la périphérie géographique de l’Afrique. Le Moyen-Orient (hors Afrique du Nord) est la seule région du monde où la proportion de réfugiés et de demandeurs d’asile parmi les migrants transfrontaliers était plus élevée que dans le centre de l’Afrique en 2020, principalement en raison d’importants déplacements transfrontaliers depuis l’Irak et la République arabe syrienne. Plus de 85 % des réfugiés africains restent sur le continent (OIM 2024).
Le manque d’alternatives viables à la migration de détresse a entraîné d’énormes souffrances en Afrique. Au cours de la dernière décennie, plus de 25 000 Africains sont morts (ou portés disparus) suite à une migration de détresse. Bien que la migration de détresse ne représente qu’une petite partie des flux migratoires réguliers en provenance d’Afrique, la douleur et la souffrance causées par les décès de migrants et la violence et la discrimination à leur égard représentent un échec de la politique migratoire. Le graphique 3.8 montre que 2023 a été l’année la plus meurtrière jamais enregistrée pour les migrants empruntant des itinéraires irréguliers pour atteindre les pays de destination. Après plus de 8 000 décès de migrants enregistrés en 2016, le nombre de migrants morts ou disparus a progressivement diminué au cours des années de pandémie de COVID-19, avant d’augmenter à nouveau en 2021. L’année 2023 a été
Graphique 3.7 Part des réfugiés et demandeurs d’asile parmi les migrants transfrontaliers, 2020
Centre géographique de l’Afrique Périphérie géographique de l’Afrique
Asie de l’Est et Pacifique
Asie du Sud Europe de l’Est et Asie centrale
Amérique latine et Caraïbes
Amérique du Nord MoyenOrient –autres
Sources : Base de données sur les réfugiés (refugee Data Finder), Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (2020) ; DAeS de l’ONu 2020.
Graphique 3.8 Nombre de migrants morts ou disparus, par région d’origine, 2014-2023
Nombre de migrants morts ou disparus
Inconnue Afrique Mixte AsieEurope Amérique latine et Caraïbes
Source : projet « Migrants disparus » de l’OiM, https://missingmigrants.iom.int/data
la pire année jamais enregistrée pour les migrants d’Afrique en situation irrégulière19. Plus de 3 784 migrants africains ont péri au cours d’une migration irrégulière. La plupart de ces décès ont eu lieu en Méditerranée, entre l’Afrique du Nord et l’Europe. Mais des migrants meurent également à de nombreux endroits du continent lors de la traversée terrestre avant d’atteindre l’Afrique du Nord20
Il est primordial de garantir la sécurité des migrants
Certaines régions de l’Afrique, par exemple l’Afrique du Sud, accueillent de plus en plus de migrants économiques en provenance d’autres zones du continent, mais les droits et la sécurité des migrants soulèvent de plus en plus d’inquiétudes. Bien que la plupart des migrants originaires d’un pays du centre géographique de l’Afrique restent dans le centre, la part qu’ils occupent dans les pays de la périphérie est en augmentation. Entre 1990 et 2020, la part des migrants originaires du centre de l’Afrique en Afrique australe a été multipliée par 2,7, contre 1,4 dans les autres pays du centre21 . Plus la transition démographique des pays d’Afrique australe avancera, plus ces pays auront besoin de main-d’œuvre immigrée pour pallier la pénurie dans les secteurs clés. Toutefois, en Afrique du Sud, les migrants sont souvent confrontés à la xénophobie et à la discrimination (Crush 2022 ; Nations Unies 2022). Il est essentiel de garantir les droits et la protection juridique des migrants pour qu’ils puissent participer et contribuer pleinement à la société d’accueil. Il sera tout aussi important d’améliorer la cohésion sociale en s’attaquant au problème chronique du chômage chez les jeunes Sud-Africains. Les données montrent en effet que les jeunes immigrants s’en sortent mieux que les jeunes qui ne migrent pas en matière d’emploi (OCDE 2018).
L’Afrique du Nord se retrouve en première ligne, car elle abrite des pays de transit pour les migrants en situation irrégulière qui vont du centre de l’Afrique vers l’Europe.
L’Algérie, par exemple, possède la deuxième plus grande frontière terrestre d’Afrique (6 343 km ou 3 941 miles). Le renforcement des contrôles aux frontières en Europe et les politiques ciblant les migrants en Afrique du Nord continuent de menacer les droits et la sécurité des migrants, de manière directe ou indirecte. Les traversées irrégulières de la Méditerranée depuis le Maghreb ont commencé au milieu des années 1990, lorsque l’Italie et l’Espagne ont introduit une obligation de visa. Les migrants originaires du centre de l’Afrique se sont joints aux Nord-Africains dans les années 2000, surtout après la guerre civile en Libye. Les contrôles aux frontières se sont alors intensifiés, y compris sous une forme externalisée. Les migrants en situation irrégulière sont exposés à un risque accru de trafic, d’exploitation et de maltraitance aux mains de milices et d’organisations criminelles, devenant des cibles de la xénophobie (Nations unies 2021, 2023).
La viabilité de l’accueil des réfugiés et des PDI passe par la protection et la mise en valeur de leur potentiel économique
Les pays du centre géographique de l’Afrique accueillent des personnes déplacées de force à cause de conflits et du changement climatique, mais aussi des personnes qui ont besoin d’une protection juridique ou de débouchés économiques. L’Afrique abrite un quart de la population mondiale de réfugiés, et la plupart se concentrent dans un petit nombre de zones touchées par les conflits et les crises climatiques (OIM 2024). Environ 91 % des réfugiés et demandeurs d’asile en Afrique résident dans des pays du centre. Ils présentent des caractéristiques distinctives par rapport à d’autres régions du monde. Une caractéristique notable est la tendance à s’établir en milieu rural : moins de 15 % des réfugiés en Afrique vivent en zone urbaine. Ce chiffre est à comparer avec celui de l’Asie du Sud (plus de 15 %), de l’Amérique latine et des Caraïbes (27 %) et du Moyen-Orient (44 %)22. Comme la plupart des réfugiés vivent dans des zones rurales peu développées offrant un accès limité aux services, ils sont particulièrement vulnérables en cas de choc supplémentaire.
Pour pouvoir gérer efficacement la situation des réfugiés en Afrique, l’intégration économique dans les sociétés d’accueil doit être renforcée, au profit des réfugiés comme des populations d’accueil. L’intégration suppose d’accorder aux réfugiés le droit de travailler. De nombreuses études montrent que l’accès légal au travail améliore les revenus tout en générant des retombées positives pour les communautés d’accueil (Sarzin et Nsababera 2024 ; Banque mondiale et HCR 2023). Par exemple, les camps de réfugiés de Kakuma au Kenya ont bénéficié à l’économie locale en créant des activités génératrices de revenus supplémentaires, tandis que les entreprises appartenant à des réfugiés en Ouganda ont créé des emplois pour la population locale (Alix-Garcia et al. 2018 ; d’Errico et al. 2022 ; Sanghi, Onder et Vemuru 2016 ; Banque mondiale 2019). L’intégration économique permet aux réfugiés d’être plus autonomes, ce qui réduit les coûts d’accueil23. En outre, la liberté de circulation des réfugiés dans le pays d’accueil leur permet d’accéder à des zones présentant de meilleurs débouchés économiques, ce qui leur permet de mobiliser leurs compétences et de renforcer leur autonomie (Banque mondiale et HCR, à paraître). Le fait d’étendre la liberté de circulation aux communautés économiques régionales par le biais d’instruments juridiques adaptés assure la continuité de
la protection juridique. Le renforcement des droits des réfugiés à travailler et à se déplacer représente une solution viable dans un contexte de pénurie des financements humanitaires, en particulier en Afrique24
Les droits au travail des immigrés sont toutefois hétérogènes. Les écarts entre les politiques et leur mise en œuvre ne permettent pas une intégration du marché du travail qui soit de nature à soutenir durablement les populations vulnérables (Ibáñez et al. 2024). Une enquête mondiale de 2021 sur les droits du travail des réfugiés a révélé des disparités dans les réglementations, de jure et de facto. Par exemple, le Rwanda et l’Ouganda ont levé les restrictions sur le droit des réfugiés à travailler, bien que des obstacles subsistent dans les camps. Inversement, la Tanzanie est considérée comme le pays le plus restrictif, avec un recours à des pratiques répressives (Ginn et al. 2022). Il est donc essentiel de garantir, de jure et de facto, le droit des réfugiés à travailler et à se déplacer afin de pouvoir libérer leur potentiel économique et réduire la charge qui pèse sur les communautés d’accueil et les organismes internationaux.
Notes
1. Des études d’impact ont montré que les revenus après une migration sont multipliés par 2 à 4 (Clemens 2019 ; Clemens et Tiongson 2017 ; Gaikwad, Hanson et Tóth 2022 ; McKenzie, Stillman et Gibson 2010 ; Mobarak, Sharif et Shrestha 2023). En outre, les gains sont comparables aux ratios des salaires des migrants et des non-migrants, qui sont identiques d’un point de vue observationnel (Clemens, Montenegro et Pritchett 2019).
2. Les données et le détail établis par l’Union européenne ne sont pas disponibles par niveau de qualification et pays d’origine.
3. Ces dynamiques ne s’observent pas dans tous les pays du centre géographique de l’Afrique. Par exemple, les migrants internationaux en provenance du Kenya se rendent principalement dans des pays à revenu élevé. D’après les données du DAES de l’ONU (2020), plus de 70 % des quelque 540 000 immigrants kenyans se trouvaient en Europe et en Amérique du Nord en 2020, en particulier au Royaume-Uni et aux États-Unis. On observe un schéma de migration extracontinentale similaire dans le cas du Ghana, du Nigéria et du Sénégal, dans une moindre proportion toutefois que dans le cas du Kenya.
4. Matrice 2021 des envois de fonds bilatéraux de la Banque mondiale (2022).
5. Voir M. Shrestha (2017) pour la réduction de la pauvreté et Yang (2008) pour la réponse aux chocs économiques.
6. Toutefois, des études montrent également l’existence d’effets négatifs sur les enfants restés au pays (par exemple, Ivlevs, Nikolova et Graham 2019), surtout en cas de séparation prolongée. C’est souvent le cas lorsque la migration s’effectue en situation irrégulière ou de détresse et que les migrants ne peuvent pas se rendre régulièrement dans leur pays d’origine.
7. L’analyse quantitative de Do et al. (2024) vient étayer l’impact estimé du vieillissement sur le produit intérieur brut.
8. D’après les estimations démographiques et les données de projection du DAES de l’ONU (2022).
9. Acemoglu et Restrepo (2022) apportent des explications théoriques et des éléments empiriques.
10. Par exemple, pour les compétences, connaissances et aptitudes requises pour les aides-soignants aux États-Unis, consulter https://www.onetonline.org/link/summary/31-1122.00.
11. En pourcentage des étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur, les Africains émigrent à des niveaux similaires (environ 4 %) à ceux des autres pays à faible revenu (https://data.uis.unesco.org /index.aspx?queryid=3810).
12. Le Ghana a suspendu la délivrance de visas de travail pour ses travailleurs domestiques dans les pays du CCG à compter de juin 2017, à la suite de cas de maltraitance. Cette décision a involontairement conduit certains Ghanéens à se déplacer en situation irrégulière dans les pays voisins ou à recourir à des agences de recrutement non autorisées (OIM 2019). De même, en Ouganda, une interdiction de déplacement vers certains pays du Golfe a entraîné des mouvements irréguliers (Bisong 2021). Une étude portant sur l’interdiction de la migration des artistes de spectacle philippines au Japon a révélé que l’interdiction avait réduit les revenus des migrantes potentielles et augmenté le travail des enfants (Theoharides 2020).
13. Règlement exécutif de la loi n° 4 de 1985.
14. L’article 1 de la loi n° 25/1929 relative au statut personnel, tel que modifié par l’article 2 de la loi n° 100/1985, énonce que « Une épouse ne perd pas son droit à l’entretien si elle quitte le domicile conjugal sans l’autorisation de son mari, à condition qu’elle le fasse pour des raisons de nécessité, dans des situations autorisées conformes à la charia ou aux normes, ou pour travailler, à condition qu’elle n’abuse pas de son droit au travail, que son travail n’entre pas en conflit avec les intérêts de la famille et que son mari ne lui ait pas demandé de s’abstenir de travailler ».
15. Pour plus d’informations sur les obstacles juridiques à la mobilité, consulter la base de données Les Femmes, l’Entreprise et le Droit, https://wbl.worldbank.org/en/data/exploretopics/wbl_gp
16. Par exemple, les données tirées des Indicateurs de gouvernance des migrations montrent que 54 % des pays d’Afrique de l’Ouest sont engagés dans des négociations bilatérales sur les questions migratoires, contre 83 % au niveau mondial et 100 % dans la périphérie géographique de l’Afrique.
17. OIM (2024). Certains pays, comme le Kenya, ont récemment signé des ABMMO pour la migration des professionnels de santé et sont en train de mettre à jour ou de renouveler les ABMMO existants avec l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar et la République de Corée.
18. D’après les calculs d’Adhikari et al. (2024). Le calcul présuppose une augmentation de 227 % des revenus, conformément à l’impact de la migration sur les revenus qui ressort de la littérature.
19. D’après les données du projet « Migrants disparus » de l’Organisation internationale pour les migrations, 60 % des décès de migrants dans le monde en 2023 ont eu lieu en Afrique ou en Méditerranée.
20. Par exemple, l’Organisation internationale pour les migrations a annoncé la mort de 27 migrants dans le désert tchadien : https://www.iom.int/news/iom-deeply-saddened-deaths-27-migrants-including -children-chadian-desert
21. Calculs basés sur les données du DAES de l’ONU (2020).
22. Estimations basées sur les statistiques démographiques du HCR : https://www.unhcr.org /refugee-statistics/
23. Au Tchad, le coût initial à l’arrivée est estimé à 691 dollars par an. Avec une plus grande inclusion des réfugiés, ce montant tombe à 155 et 245 dollars par an, selon que les réfugiés peuvent gagner leur vie comme les personnes qui vivent dans les communautés d’accueil ou comme le Tchadien moyen (Coulibaly, Hoogeveen et Savadogo, à paraître ; Banque mondiale et HCR, à paraître).
24. En 2023, le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, qui joue un rôle central dans la protection et l’assistance aux personnes déplacées de force, a indiqué que seulement 52 % du coût total, estimé à 10,9 milliards de dollars, était financé (HCR 2023). Parmi les treize principales opérations sous-financées au monde, pour lesquelles les réductions d’aide pourraient avoir des conséquences dévastatrices, huit se trouvent en Afrique.
Bibliographie
Abarcar, P., and C. Theoharides. 2024. “Medical Worker Migration and Origin-Country Human Capital: Evidence from U.S. Visa Policy.” Review of Economics and Statistics 106 (1): 20–35. https://doi.org /10.1162/rest_a_01131
Acemoglu, D. 2024. “The Simple Macroeconomics of AI.” Working Paper No. 32487, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
Acemoglu, D., and P. Restrepo. 2022. “Demographics and Automation.” Review of Economic Studies 89 (1): 1–44. https://doi.org/10.1093/restud/rdab031
Adhikari, S., N. Cha’ngom, H. Kaila, and M. Shrestha. 2024. « Do Bilateral Labor Agreements Increase Migration? Global Evidence from 1960 to 2020.” Background paper prepared for this report. Policy Research Working Paper 11000, World Bank, Washington, DC.
Alix-Garcia, J., S. Walker, A. Bartlett, H. Onder, and A. Sanghi. 2018. “Do Refugee Camps Help or Hurt Hosts? The Case of Kakuma, Kenya.” Journal of Development Economics 130: 66–83.
Almutairi, A. 2018. “Labour Dispute Resolution Process and Its Impact on the Rights of Low-Skilled Temporary Foreign Workers in the Absence of a Labour Court in Saudi Legal System: A Critique.” International Law Research 7 (1): 199–212.
Atong, K., E. Mayah, and A. Odigie. 2018. “Africa Labour Migration to the GCC States: The Case of Ghana, Kenya, Nigeria and Uganda.” African Regional Organisation of the International Trade Union Confederation, Lomé, Togo. https://www.ituc-africa.org/IMG/pdf/ituc-africa_study-africa_labour migration_to_the_gcc_states.pdf.
Batalova, J., M. Fix, and S. Pierce. 2020. “Brain Waste among US Immigrants with Health Degrees: A Multi-State Profile.” Fact Sheet. Migration Policy Institute, Washington, DC.
Batista, C., A. Lacuesta, and P. C. Vicente. 2012. “Testing the ‘Brain Gain’ Hypothesis: Micro Evidence from Cape Verde.” Journal of Development Economics 97 (1) : 32–45. https://doi.org/10.1016 /j.jdeveco.2011.01.005
Bhargava, A., and F. Docquier. 2008. “HIV Pandemic, Medical Brain Drain, and Economic Development in Sub-Saharan Africa.” World Bank Economic Review 22 (2): 345–66. https://doi.org/10.1093/wber /lhn005.
Bisong, A. 2021. “Regional Solutions: Regulating Recruitment and Protection of African Migrant Workers in the Gulf and the Middle East.” Discussion Paper 8, European Centre for Development Policy Management, Maastricht, Netherlands. https://ecdpm.org/application/files/2916/5546/8585/Regional -Solutions-Regulating-Recruitment-Protection-African-Migrant-Workers-Gulf-Middle-East-ECDPM -Discussion-Paper-292-2020.pdf
Blaydes, L. 2023. “Assessing the Labor Conditions of Migrant Domestic Workers in the Arab Gulf States.” Industrial and Labor Relations Review 76 (4): 724–47.
Bocquier, P., N. Cha’ngom, F. Docquier, and J. Machado. 2023. “The Within-Country Distribution of Brain Drain and Brain Gain Effects: A Case Study on Senegal.” Journal of Demographic Economics. doi:10.1017/dem.2023.27.
Carnegie Endowment. 2023. “What Are the Top Global Destinations for Higher Education for African Students?” Carnegie Endowment, Washington, DC. https://carnegieendowment.org/posts/2023/07 /what-are-the-top-global-destinations-for-higher-education-for-african-students?lang=en
Center for Global Development. 2021. “Global Skills Partnership Nursing in the Philippines.” Center for Global Development, Washington, DC.
Cha’ngom, N. 2024. “Effectiveness of Mass Regularization Policies in South Africa: The Case of Dispensation of Zimbabwean Project (DZP).” Background paper prepared for this report. World Bank, Washington, DC.
Chikezie, N. C., D. O. Shomuyiwa, E. A. Okoli, I. M. Onah, O. O. Adekoya, G. A. Owhor, and A. A. Abdulwahab. 2023. “Addressing the Issue of a Depleting Health Workforce in Sub-Saharan Africa.” The Lancet 401 (10389): 1649–50.
Chilton, A., and B. Woda. 2022. “The Expanding Universe of Bilateral Labor Agreements.” Theoretical Inquiries in Law 23 (2): 1–64.
Clemens, M. A. 2015. “Global Skill Partnerships : A Proposal for Technical Training in a Mobile World.” IZA Journal of Labor Policy 4 (1) : 1–18.
Clemens, M. A. 2019. “Measuring the Spatial Misallocation of Labor: The Returns to India-Gulf Guest Work in a Natural Experiment.” SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3390083.
Clemens, M. A., C. E. Montenegro, and L. Pritchett. 2019. “The Place Premium: Bounding the Price Equivalent of Migration Barriers.” Review of Economics and Statistics 101 (2): 201–13. https://doi .org/10.1162/rest_a_00776
Clemens, M. A., and G. Pettersson. 2008. “New Data on African Health Professionals Abroad.” Human Resources for Health 6 (1): 1. https://doi.org/10.1186/1478-4491-6-1
Clemens, M. A., and E. R. Tiongson. 2017. “Split Decisions: Household Finance When a Policy Discontinuity Allocates Overseas Work.” Review of Economics and Statistics 99 (3): 531–43. https://doi .org/10.1162/REST_a_00657.
Coulibaly, M., J. Hoogeveen, and A. Savadogo. Forthcoming. “Fiscal Cost of Refugee Inclusion in Chad.” World Bank, Washington, DC.
Crush, J. 2022. “Xenophobia Denialism and the Global Compact for Migration in South Africa.” In Governing Migration for Development from the Global Souths, edited by D. E. Degila and V. M. Valle, 133–58. Leiden, Netherlands: Brill.
Crush, J., and B. Dodson. 2017. Harnessing Migration for Inclusive Growth and Development in Southern Africa. Ontario, Canada : Southern African Migration Programme.
d’Errico, M., D. M. Rama, R. Pietrelli, and F. C. Rosati. 2022. “Refugee-Host Proximity and Market Creation in Uganda.” Journal of Development Studies 58 (2): 213–33. https://doi.org/10.1080/00220388 .2021.1961749
Dempster, H., and L. Crawfurd. 2024. “UK Recruitment of Nigerian Nurses Can Be Win-Win.” Center for Global Development, Washington, DC. https://www.cgdev.org/blog/uk-recruitment-nigerian-nurses -can-be-win-win
Dia, I. A. 2022. “African Health Practitioner Migration and Mobility Study.” International Labour Organization, Geneva.
Dinkelman, T., G. Kumchulesi, and M. Mariotti. 2024. “Labor Migration, Capital Accumulation, and the Structure of Rural Labor Markets.” Review of Economics and Statistics (February): 1–46. https://doi.org /10.1162/rest_a_01419.
Dinkelman, T., and M. Mariotti. 2016. “The Long-Run Effects of Labor Migration on Human Capital Formation in Communities of Origin.” American Economic Journal: Applied Economics 8 (4): 1–35. https://doi.org/10.1257/app.20150405
Do, Q. T., A. A. Levchenko, S. Sotelo, and R. D. Zarate. 2024. “Population Aging and International Migration.” Background paper prepared for this report. World Bank, Washington, DC.
Dupas, P., C. Falezan, M. C. Mabeu, and P. Rossi. 2023. “Long-Run Impacts of Forced Labor Migration on Fertility Behaviors: Evidence from Colonial West Africa.” Working Paper 31993, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
Eastwood, J. B., R. E. Conroy, S. Naicker, P. A. West, R. C. Tutt, and J. Plange-Rhule. 2005. “Loss of Health Professionals from Sub-Saharan Africa: The Pivotal Role of the UK.” The Lancet 365 (9474): 1893–1900.
EPRS (European Parliamentary Research Service). 2021. “Legal Migration Policy and Law: Annex I to the European Value Added Assessment.” EPRS, Brussels, Belgium. https://www.europarl.europa.eu /RegData/etudes/STUD/2021/694211/EPRS_STU(2021)694211(ANN1)_EN.pdf.
Fernando, N., and N. Singh. Forthcoming. “Regulation by Reputation? Intermediaries, Labor Abuses, and International Migration.” Review of Economics and Statistics. Filmer, D., H. Rogers, N. Angrist, and S. Sabarwal. 2020. “Learning-Adjusted Years of Schooling (LAYS): Defining a New Macro Measure of Education.” Economics of Education Review 77: 101971.
Gaikwad, N., K. Hanson, and A. Tóth. 2022. “How Overseas Opportunities Shape Political Preferences: A Field Experiment on International Migration.” Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3816464 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3816464
Ginn, T., R. Resstack, H. Dempster, E. Arnold-Fernández, S. Miller, M. Guerrero Ble, and B. Kanyamanza. 2022. “2022 Global Refugee Work Rights Report.” Center for Global Development, Asylum Access, and Refugees International, Washington, DC. https://www.cgdev.org/publication/2022-global-refugee -work-rights-report.
Hongoro, C., and B. McPake. 2004. “How to Bridge the Gap in Human Resources for Health.” The Lancet 364 (9443): 1451–56.
Ibáñez, A. M., A. Moya, M. A. Ortega, S. V. Rozo, and M. J. Urbina. 2024. “Life out of the Shadows: The Impacts of Regularization Programs on the Lives of Forced Migrants.” Journal of the European Economic Association https://doi.org/10.1093/jeea/jvae044
ILO (International Labour Organization). 2021. Making Decent Work a Reality for Domestic Workers: Progress and Prospects Ten Years after the Adoption of the Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189). Geneva : ILO. https://www.ilo.org/media/384766/download.
IOM (International Organization for Migration). 2019. “Ghanaian Domestic Workers in the Middle East— Summary Report.” IOM, Geneva. https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/country/docs /ghana/iom_ghana_domestic_workers_report_summary-finr.pdf
IOM (International Organization for Migration). 2023. Region on the Move: Regional Mobility Report for the Middle East and North Africa 2021–2022. Cairo: IOM. https://publications.iom.int/books/region -move-regional-mobility-report-middle-east-and-north-africa-2021-2022
IOM (International Organization for Migration). 2024. Africa Migration Report. 2nd ed. Geneva : IOM. https://publications.iom.int/books/africa-migration-report-second-edition.
Ivins, C. P., A. Liang, N. D. Serfontein, P. H. Schneider, and T. C. Matsebula. 2022. “The Future of Medical Work in Southern Africa.” Health, Nutrition, and Population Discussion Paper, World Bank, Washington, DC.
Ivlevs, A., M. Nikolova, and C. Graham. 2019. “Emigration, Remittances, and the Subjective Well-Being of Those Staying Behind.” Journal of Population Economics 32: 113–51.
Khanna, G., and N. Morales. 2021. “The IT Boom and Other Unintended Consequences of Chasing the American Dream.” Working Paper, Center for Global Development, Washington, DC. http://www -personal.umich.edu/~moralesn/Khanna%20Morales.pdf.
Khanna, G., E. Murathanoglu, C. B. Theoharides, and D. Yang. 2022. “Abundance from Abroad: Migrant Income and Long-Run Economic Development.” Working Paper 29862, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA. http://www.nber.org/papers/w29862
KNOMAD (Global Knowledge Partnership on Migration and Development). 2022. “Migration and the Law Project: From Immigration to Integration.” World Bank, Washington, DC.
McKenzie, D., S. Stillman, and J. Gibson. 2010. “How Important Is Selection? Experimental vs. NonExperimental Measures of the Income Gains from Migration.” Journal of the European Economic Association 8 (4): 913–45. https://doi.org/10.1111/j.1542-4774.2010.tb00544.x.
Mobarak, A. M., I. Sharif, and M. Shrestha. 2023. “Returns to International Migration: Evidence from a Bangladesh-Malaysia Visa Lottery.” American Economic Journal: Applied Economics 15 (4): 353–88. https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/app.20220258.
Naidu, S., Y. Nyarko, and S.-Y. Wang. 2016. “Monopsony Power in Migrant Labor Markets: Evidence from the United Arab Emirates.” Journal of Political Economy 124 (6): 1735–92. https://doi.org/10.1086 /688877
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2018. “How Immigrants Contribute to South Africa’s Economy.” OECD, Paris. https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264085398-en. pdf?expires=1714346104&id=id&accname=ocid195787&checksum=8BD1180F8AA3418758A845D098 C496F4.
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2022. International Migration Outlook. 46th ed. Paris : OECD. https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/30fe16d2-en.pdf? expires=1718824593&id=id&accname=ocid195787&checksum=E43062F81A69E543CC306E 9265A601B
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2023. “Health at a Glance 2023: OECD Indicators.” OECD, Paris. https://www.oecd-ilibrary.org/content/publication/7a7afb35-en
Ratha, D., V. Chandra, E. J. Kim, S. Plaza, and A. Mahmood. 2024. “Remittances Slowed in 2023, Expected to Grow Faster in 2024.” KNOMAD-World Bank, Washington, DC. https://knomad.org/sites/default /files/publication-doc/migration-and-development-brief-40_2.pdf.
Salem, A., and A. A. Seck. 2022. “En Route : The French Colonial Army, Emigration, and Development in Morocco.” Harvard University, Cambridge, MA.
Sanghi, A., H. Onder, and V. Vemuru. 2016. “Yes in My Backyard: The Economics of Refugees and Their Social Dynamics in Kakuma, Kenya.” World Bank, Washington, DC.
Sarzin, Z., and O. Nsababera. 2024. “Forced Displacement: A Stocktaking of Evidence.” Background paper for World Development Report 2023: Migrants, Refugees, and Societies. World Bank, Washington, DC.
Scheffler, R. M., and D. R. Arnold. 2019. “Projecting Shortages and Surpluses of Doctors and Nurses in the OECD: What Looms Ahead.” Health Economics, Policy and Law 14 (2): 274–90. https://doi.org/10.1017 /S174413311700055X.
Shrestha, M. 2017. “The Impact of Large-Scale Migration on Poverty, Expenditures, and Labor Market Outcomes in Nepal.” Policy Research Working Paper 8232, World Bank, Washington, DC.
Shrestha, S. A. 2017. “No Man Left Behind: Effects of Emigration Prospects on Educational and Labour Outcomes of Non‐Migrants.” Economic Journal 127 (600): 495–521. https://doi.org/10.1111/ecoj.12306
Theoharides, C. 2020. “The Unintended Consequences of Migration Policy on Origin-Country Labor Market Decisions.” Special Issue on Papers from 10th AFD–World Bank Development Conference, Centre d’Etudes et de Recherches sur le Développement International, Clermont-Ferrand, France, June 30–July 1, 2017, 142 (January): 102 271. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2018.07.012.
UN DESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division). 2020. “International Migrant Stock 2020.” UN DESA, New York. https://www.un.org/development/desa/pd /content/international-migrant-stock
UN DESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division). 2022. “World Population Prospects 2022.” UN DESA, New York. https://population.un.org/wpp/ UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees). 2023. “Funding UNHCR’s Programmes.” Global Report 2023. UNHCR, Geneva. https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/2024-09 /Global%20Report%202023%20-%20Funding%20Overview.pdf.
United Nations. 2021. “Tunisia and Libya: UN Experts Condemn Collective Expulsion and Deplorable Living Conditions of Migrants.” United Nations, New York. https://www.ohchr.org/en/press -releases/2021/11/tunisia-and-libya-un-experts-condemn-collective-expulsion-and-deplorable
United Nations. 2022. “South Africa ‘on the Precipice of Explosive Xenophobic Violence,’ UN Experts Warn.” United Nations, New York. https://news.un.org/en/story/2022/07/1122612
United Nations. 2023. “Libya: Urgent Action Needed to Remedy Deteriorating Human Rights Situation, UN Fact-Finding Mission Warns in Final Report.” United Nations, New York. https://www.ohchr.org /en/press-releases/2023/03/libya-urgent-action-needed-remedy-deteriorating-human-rights -situation-un.
US BLS (United States Bureau of Labor Statistics). 2024. “Employment Projections 2022–32.” US BLS, Washington, DC. https://www.bls.gov/emp/tables/fastest-growing-occupations.htm.
WHO (World Health Organization). 2021. The State of the Health Workforce in the WHO African Region, 2021. Brazzaville, Republic of Congo: WHO Regional Office for Africa.
WHO (World Health Organization). 2023a. WHO Health Workforce Support and Safeguards List 2023 Geneva : WHO.
WHO (World Health Organization). 2023b. WHO Report on Global Health Worker Mobility. Geneva : WHO.
WHO (World Health Organization). 2024. “Bilateral Agreements on Health Worker Migration and Mobility: Maximizing Health System Benefits and Safeguarding Health Workforce Rights and Welfare through Fair and Ethical International Recruitment.” WHO, Geneva.
Wibulpolprasert, S., and P. Pengpaibon. 2003. “Integrated Strategies to Tackle the Inequitable Distribution of Doctors in Thailand: Four Decades of Experience.” Human Resources for Health 1: 12.
World Bank. 2019. “Informing the Refugee Policy Response in Uganda.” World Bank, Washington, DC. https://doi.org/10.1596/32511.
World Bank. 2023a. “Remittance Prices Worldwide.” World Bank, Washington, DC. http://remittanceprices.worldbank.org.
World Bank. 2023b. World Development Report 2023: Migrants, Refugees, and Societies. Washington, DC: World Bank.
World Bank and UNHCR (World Bank and United Nations High Commissioner for Refugees). 2023. Labor Market Access and Outcomes for Refugees. JDC Quarterly Digest, Seventh Issue, January. https:// www.jointdatacenter.org/wp-content/uploads/2023/02/JDC-Quarterly-Digest_January-2023.pdf
World Bank and UNHCR (World Bank and United Nations High Commissioner for Refugees). Forthcoming. “Economic Participation and the Global Cost of International Assistance in Support of Refugee Subsistence Needs.” World Bank, Washington, DC.
Yang, D. 2008. “International Migration, Remittances and Household Investment: Evidence from Philippine Migrants’ Exchange Rate Shocks.” Economic Journal 118 (528) : 591–630.
Zahra, M. 2014. “The Legal Framework of the Sponsorship Systems of Qatar, Saudi Arabia and Kuwait: A Comparative Examination.” Technical Report, GLMM, Explanatory note, Migration Policy Centre, Fiesole, Italy. https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/32250/GLMM_ExpNote_07-2014 .pdf?sequence=1&isAllowed=y
Chapitre 4
Mettre en valeur le potentiel productif de la mobilité africaine
Introduction
La matrice adéquation-motivation du Rapport sur le développement dans le monde 2023 propose un cadre analytique associant deux perspectives complémentaires pour évaluer des mouvements transfrontaliers complexes (Banque mondiale 2023c, chapitre 1). D’une part, la perspective économique considère la migration comme un phénomène qui génère des coûts et des bénéfices pour le pays de destination. L’adéquation est plus forte lorsque les migrants possèdent des compétences recherchées sur le marché du travail du pays de destination, et lorsque les coûts associés à leur intégration sociale et économique sont faibles (axe vertical du graphique 4.1). D’autre part, la perspective juridique découle de la Convention de Genève de 1951 et considère l’accueil des réfugiés (les personnes qui craignent pour leur vie dans leur pays d’origine) comme une obligation légale pour les pays de destination, indépendamment des coûts et bénéfices que cela induit. Dans les autres cas, par exemple lorsqu’une personne franchit une frontière parce qu’elle recherche des possibilités d’emploi, et non une protection internationale, les pays de destination ont le pouvoir discrétionnaire de l’accueillir ou non (axe horizontal du graphique 4.1).
La matrice adéquation-motivation identifie trois types de mouvements transfrontaliers qui correspondent à trois objectifs politiques distincts (Banque mondiale 2023c, chapitre 9). Pour les réfugiés, l’objectif est de garantir l’application pérenne du régime de protection internationale dans les pays d’accueil, et de partager les coûts au niveau régional ou international. Pour les migrants en bonne adéquation avec le pays de destination, les politiques doivent œuvrer à une meilleure migration, c’est-à-dire une migration qui maximise les avantages pour les migrants et pour les pays d’origine et de destination. Enfin, les migrants en détresse présentent une adéquation plus faible et ne remplissent pas les conditions pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ; ils doivent donc être absorbés par leur pays de transit ou de destination, ou renvoyés dans leur pays d’origine dans des conditions humaines. En parallèle, l’enjeu pour les décideurs politiques des pays d’origine, de transit et de destination est de réduire la nécessité de ces mouvements.
Graphique 4.1 Matrice adéquation-motivation du Rapport sur le développement dans le monde 2023
Plus forte adéquation
Bénéfices supérieurs aux coûts
ADÉQUATION
Coûts supérieurs aux bénéfices
Beaucoup de migrants économiques
Réfugiés possédant des compétences recherchées dans leur pays de destination
Plus faible adéquation
Opportunités dans le pays de destination
Source : Banque mondiale 2023c.
Migrants en détresse, principalement en situation irrégulière
Choix d’accepter ou non
MOTIVATION
Beaucoup de réfugiés
Peur dans le pays d’origine
Obligation d’accueillir
Les politiques proposées dans ce chapitre visent à canaliser le potentiel économique de tous les Africains qui cherchent de meilleures perspectives dans une société de destination ou qui sont déplacés de force. Compte tenu des grandes tendances actuelles (chapitre 2) et de l’état actuel de la migration africaine (chapitre 1), il est possible d’élaborer des politiques qui favorisent une meilleure migration (bénéfique pour les migrants et pour les pays d’origine et de destination), et qui valorisent le potentiel économique des réfugiés et des personnes déplacées internes (PDI). Ces politiques œuvrent en faveur du respect de la dignité, tout en renforçant la pérennité des systèmes de protection juridique (chapitre 3). Dans ce chapitre, l’examen de la question des politiques n’a pas pour but de répertorier tous les enjeux possibles qui mériteraient d’être abordés (pour cela, se référer à Banque mondiale 2023c, chapitre 9). Il s’agit plutôt de présenter des actions concrètes jugées pertinentes dans le contexte africain.
Utiliser les accords bilatéraux et multilatéraux propices à une meilleure migration transfrontalière
Les accords bilatéraux sur les migrations de main-d’œuvre (ABMMO), ainsi que d’autres cadres juridiques similaires, permettent aux pays d’origine et de destination de se coordonner sur les questions de migration. Ces cadres délimitent la portée et l’ampleur de la migration, définissent les conditions de travail et de rémunération des travailleurs immigrés, et orientent les investissements vers des compétences qui correspondent aux besoins des marchés du travail des pays de destination. Ils encadrent également l’application de clauses telles que les politiques de retour après expiration des visas. Compte tenu du manque relatif d’ABMMO en Afrique, les organisations régionales ou internationales peuvent jouer un rôle essentiel en aidant les gouvernements à rédiger, négocier, mettre en œuvre, contrôler et réviser les conditions de ces accords. L’outil d’évaluation des ABMMO 2019, élaboré conjointement par l’Organisation internationale du travail et l’Organisation internationale pour les migrations, a été employé pour évaluer la migration de main-d’œuvre entre la République arabe d’Égypte et l’Italie, et au sein de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC)1. Cet outil permet d’identifier plusieurs rôles et responsabilités des gouvernements nationaux dans le cycle d’élaboration des ABMMO : (1) désigner les pays de destination intéressés par la négociation d’ABMMO ou de MOU ; (2) répertorier les compétences recherchées et les opportunités professionnelles à l’étranger ; (3) réglementer les procédures prémigratoires concernant la formation, les formalités de voyage et l’intermédiation ; (4) examiner les conditions relatives au droit du travail et aux droits humains, y compris les clauses de non-discrimination fondée sur le sexe ; (5) choisir les mesures de protection sociale adaptées ; (6) mettre en place des mécanismes de suivi et d’évaluation ; (7) définir les conditions de l’épargne et des envois de fonds ; et (8) définir le calendrier et les procédures appropriées pour les retours, en coopération avec les pays de destination (OIT et OIM 2019).
En plus de coordonner les politiques, les ABMMO permettent aux pays d’origine et de destination de se partager équitablement l’excédent économique généré par la migration. Mais si la migration sert les intérêts des migrants, des communautés d’accueil et des communautés d’origine, elle entraîne aussi des coûts. Les accords bilatéraux permettent aux pays d’origine et de destination d’encadrer le partage des bénéfices et des coûts, en veillant à ce que la migration demeure avantageuse pour les deux parties, tout en atténuant les coûts et les répercussions négatives. Les enjeux concernent l’amélioration de la rémunération et des conditions de travail des travailleurs migrants, le cofinancement de l’éducation et de la formation dans les secteurs stratégiques par le biais d’initiatives comme les Partenariats mondiaux pour les compétences, et la plus grande participation des pays de destination aux objectifs de développement des pays d’origine, à travers des transferts financiers, un renforcement des capacités et une assistance technique (dans le chapitre 3 du présent rapport, l’encadré 3.1 traite de la migration des personnels de santé).
En négociant les accords de travail de manière collective, et non individuelle, les pays africains peuvent renforcer leur position dans les pourparlers. Les mécanismes qui privilégient la coordination à la concurrence entre pays africains renforceront collectivement leur pouvoir de négociation. À la suite de la première Conférence sur les migrations de main-d’œuvre qui s’est tenue en octobre 2023 à Abidjan en Côte d’Ivoire, l’Union africaine, les communautés économiques régionales et quinze pays africains ont adopté un communiqué soulignant la nécessité d’une action collective pour « être les fers de lance de l’élaboration de positions communes et de dénominateurs minimaux sur le contenu des Accords Bilatéraux de Travail afin d’éviter un nivellement par le bas ». Au minimum, l’action collective peut veiller à ce que les ABMMO adhèrent aux conventions garantissant l’égalité de traitement entre les travailleurs migrants et les ressortissants nationaux en matière de rémunération, de sécurité et d’autres conditions de travail (pour plus de détails, voir Leighton 2024). In fine, ces accords permettront aux pays d’origine de capter une plus grande part de l’excédent économique global de la migration, estimé à 1 700 milliards de dollars par an pour les 27 pays de l’Union européenne (Do et al. 2024).
Ce type de mécanismes de coordination a été adopté en Afrique dans le domaine de la santé publique avec les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, et dans le domaine du commerce avec la zone de libre-échange continentale africaine2. Avec le soutien de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), des processus consultatifs régionaux sur la migration de main-d’œuvre ont également vu le jour et pourraient se développer, comme le Forum ministériel régional sur les migrations en Afrique orientale et dans la Corne de l’Afrique, auquel participent des pays de la Communauté de l’Afrique de l’Est et de l’Autorité intergouvernementale pour le développement3. Toutefois, face à des problèmes nécessitant une action collective, les pays doivent adopter des mécanismes de coordination contraignants au niveau régional ou dans un secteur donné. La négociation collective peut se faire au prix d’une baisse de la demande de main-d’œuvre immigrée dans les pays de destination. Les pays peuvent donc être tentés d’adapter individuellement leur stratégie pour profiter de ces déficits de la demande et engager des négociations bilatérales, affaiblissant ainsi l’objectif des négociations collectives. La coopération entre les pays d’origine est donc plus facile à obtenir dans les secteurs qui, toutes choses égales par ailleurs, sont caractérisés par une demande plus inélastique de la main-d’œuvre immigrée, ou qui sont soumis à une pénurie mondiale de l’offre, comme c’est le cas pour la santé. Dans le cas contraire, des mécanismes de coordination contraignants, à même de dépister et de dissuader toute tentative de s’écarter de l’action collective, pourraient s’avérer nécessaires. Par exemple, dans le domaine de l’aide au développement, les banques multilatérales de développement peuvent être considérées comme des mécanismes par lesquels les pays délèguent certains aspects de leur politique d’aide à une organisation régionale ou internationale afin de résoudre un problème nécessitant une action collective (Svensson 2000).
Créer et renforcer les systèmes de migration
Avant de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux, les gouvernements doivent être capables de déterminer la portée de leur politique migratoire. Une gouvernance efficace
de la migration exige de renforcer les capacités et de fournir une assistance technique aux agences concernées afin qu’elles disposent des outils statistiques, des ressources humaines et financières, et de l’autorité administrative appropriée. Des pays comme le Ghana, le Kenya, le Nigéria et l’Ouganda disposent de politiques nationales régissant la migration de main-d’œuvre, même si elles sont parfois obsolètes ou incomplètes. Or, ces politiques ne sont pas présentes partout en Afrique. Tandis que la régulation des flux migratoires prend une importance cruciale, les efforts de renforcement des capacités et d’assistance technique doivent s’intensifier en conséquence. Des initiatives telles que le « Projet de gestion des migrations en Afrique australe », financé par l’Union européenne, et le programme « Pour une approche globale de la gouvernance de la migration et de la mobilité de main-d’œuvre en Afrique du Nord » visent à renforcer les systèmes de migration dans les pays de la SADC et de l’Afrique du Nord4. En outre, des initiatives statistiques régionales, telles que le « Projet d’harmonisation et d’amélioration des statistiques en Afrique de l’Ouest et du Centre » et le « Projet régional de statistiques de la SADC », visent à améliorer la qualité des données et à faciliter la coordination régionale, l’apprentissage par les pairs et le partage des connaissances (Banque mondiale 2023a, 2023b).
Les pays africains doivent développer et renforcer les systèmes de gestion de la migration afin de mettre efficacement en œuvre les accords bilatéraux et multilatéraux conformément aux politiques nationales et internationales. Ces systèmes accompagnent les migrants à toutes les étapes de la migration : avant la décision, avant le départ, pendant le séjour à l’étranger et au retour. Ils leur garantissent un accès à l’information, aux papiers, aux permis, aux droits et aux recours. De nombreux pays d’Asie de l’Est et du Sud, dont le Bangladesh, le Népal, le Pakistan, les Philippines et le Sri Lanka, disposent d’organismes spécialisés qui protègent les travailleurs migrants, encadrent leur recrutement et émettent des données pouvant orienter l’action politique 5. En revanche, moins de quatre pays africains sur les dix qui figurent dans les indicateurs de gouvernance des migrations de l’OIM disposent de ce type de mécanismes de coordination (OIM 2024). Ainsi le Nigéria, premier pays d’origine des migrants africains, ne possède aucun organisme dédié à la gestion de sa main-d’œuvre émigrante. Pour améliorer leurs systèmes de gestion de la migration, les pays africains peuvent bénéficier d’un partage d’expériences et de connaissances avec les pays d’Asie de l’Est et du Sud.
Dans les pays d’origine : maximiser les bénéfices avant, pendant et après la migration
Investir dans les compétences recherchées dans les pays de destination et améliorer les pratiques de recrutement
Comme l’illustre la matrice adéquation-motivation, les pays d’origine maximisent les bénéfices générés par la migration lorsque les migrants ont des compétences qui correspondent à la demande dans les pays de destination. L’augmentation du niveau d’instruction général de la population est l’un des principaux objectifs de développement des pays africains, dans leur
propre intérêt et pour améliorer les perspectives de leur main-d’œuvre à l’étranger. En plus d’augmenter le niveau de compétences de la population dans son ensemble, les pays d’Afrique peuvent réaliser des investissements sectoriels dans les compétences recherchées au niveau mondial, unilatéralement ou en partenariat avec les pays de destination.
En France, par exemple, les ministères de l’Intérieur et du Travail, en concertation avec les partenaires sociaux, ont établi pour chaque région une liste de métiers confrontés à une pénurie de main-d’œuvre, qui font donc l’objet d’un parcours d’immigration légale pour les travailleurs qualifiés. On y trouve notamment les métiers d’ingénieur du bâtiment, d’infirmier et de géomètre, mais aussi de couvreur, chauffeur routier, maçon et boucher6. De même, le Bureau américain des statistiques du travail publie régulièrement des prévisions sur dix ans concernant les professions qui devraient connaître la plus forte croissance d’emploi aux États-Unis (les aides à domicile et aides-soignants et les développeurs de logiciels figurent parmi les principales) (Bureau américain des statistiques du travail 2024). Une récente enquête sur les petites et moyennes entreprises de l’Union européenne a révélé que les techniciens et les chargés de service à la clientèle sont les plus recherchés (Union européenne 2023). Les pays africains peuvent investir unilatéralement et stratégiquement dans des compétences spécifiques afin d’accroître leur main-d’œuvre dans ces secteurs. Ils peuvent également se montrer proactifs en nouant avec les pays de destination des partenariats destinés à attirer les talents, portant sur la production, le financement et le placement de la nouvelle main-d’œuvre qualifiée.
L’augmentation de la demande étrangère dans le secteur des soins et des services à la personne crée des gisements d’emploi pour les Africains. Partout dans le monde, ces secteurs sont essentiels pour l’emploi des femmes. Par exemple, en 2021, les femmes représentaient 79 % des aides-soignants et des aides à la personne dans les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE 2023). La demande considérable et toujours croissante de travailleurs dans ces secteurs, en particulier dans les pays de destination à revenu élevé, peut créer des emplois productifs et rémunérateurs pour la main-d’œuvre africaine sous-employée, notamment les femmes. Cela peut également donner des moyens d’action à un plus grand nombre de femmes africaines, grâce à des emplois rémunérés, tant à l’étranger que dans leur propre pays7. Toutefois, pour pouvoir explorer pleinement ces possibilités, l’acquisition de compétences doit s’étendre aux langues, à la communication, au sens du service, à l’intelligence sociale, à la pensée critique, à la fiabilité et à d’autres compétences relationnelles8.
L’accès aux possibilités de migration et les efforts de développement des compétences pourraient davantage cibler les zones et les communautés où les effets attendus sont les plus importants. Sur le plan géographique, ces zones peuvent être celles qui connaissent déjà des départs de migrants, comme Brong-Ahafo, la région d’origine de la majorité des migrants du Ghana, afin de s’appuyer sur les réseaux de migrants et de réduire les coûts de la migration (OIM 2016, 2019). Ces zones peuvent aussi être les régions où il serait possible d’investir dans des compétences complémentaires aux compétences existantes afin de créer un avantage comparatif, ou encore les régions affichant des taux de chômage ou de pauvreté élevés. Associées à d’autres initiatives de réduction des coûts de la migration, ces actions peuvent également
cibler les groupes défavorisés pour lesquels l’impact de la migration et du développement des compétences devrait être plus important. Par exemple, le projet « Promouvoir la mobilité de la main-d’œuvre de Papouasie-Nouvelle Guinée » cible les possibilités de migration et de développement des compétences associées dans des zones où les débouchés économiques sont limités et parmi des groupes défavorisés (Banque mondiale 2022b).
Les agences de recrutement jouent un rôle important en mettant en relation les employeurs et les travailleurs de différents continents, faisant ainsi tomber les barrières physiques, linguistiques et culturelles. Toutefois, les mauvaises pratiques de recrutement et la diffusion d’informations inexactes ou trompeuses sur le travail, la rémunération et les conditions de travail sont très répandues (Fabbri et al. 2023 ; ONUDC 2015). Bien que ce problème soit difficile à résoudre, plusieurs interventions politiques semblent prometteuses. Par exemple, dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), les audits et les évaluations des agences de recrutement menés par le gouvernement sri-lankais ont permis aux travailleurs migrants d’être placés auprès d’employeurs qui rémunèrent mieux et abusent moins de leur pouvoir (Fernando et Singh, à paraître). Le fait d’informer les candidats à la migration sur la qualité des intermédiaires en Indonésie a amélioré leur situation avant le départ et leur expérience pendant la migration (Bazzi et al. 2021). De même, le fait d’informer les candidats à la migration sur les salaires réels et les risques de mortalité à l’étranger influe sur la décision de migrer (Shrestha 2020). Par ailleurs, les gouvernements jouent parfois un rôle d’intermédiaire sur le marché du travail au-delà de leur fonction réglementaire. Dans le programme intergouvernemental Bangladesh-Malaisie piloté en 2013-2014, l’implication des gouvernements dans l’intermédiation a fait baisser les coûts de la migration à un sixième des coûts de l’intermédiation privée, réduit l’endettement, augmenté les bénéfices nets de la migration et amélioré la situation des migrants avant le départ (Mobarak, Sharif et Shrestha 2023).
Mobiliser les ressources financières de la diaspora
La migration bénéficie davantage aux pays d’origine dont le coût des envois de fonds est moindre. Les pays africains sont confrontés à des coûts d’envoi de fonds parmi les plus élevés. Les opérateurs de téléphonie mobile offrent une alternative moins coûteuse que les canaux informels ou les virements bancaires (Banque mondiale 2023c, chapitre 5). Le Conseil de stabilité financière, dans sa Feuille de route du G20 pour l’amélioration des paiements transfrontaliers, énumère les thèmes prioritaires pour atteindre l’objectif du Groupe des 20 de ramener les frais d’envoi à moins de 5 % pour tous les corridors de transferts de fonds (CSF 2023). L’un de ces thèmes concerne la meilleure intégration des systèmes de paiement grâce à une interopérabilité accrue et l’harmonisation des messages transfrontaliers. Une autre priorité consiste à uniformiser les règles entre les acteurs bancaires et non bancaires chargés des transferts de fonds, tout en respectant les exigences de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces mesures renforceraient la concurrence entre les opérateurs, faisant ainsi bénéficier les consommateurs d’une baisse des prix, de services plus accessibles et de meilleure qualité, et d’une plus grande transparence.
Des alternatives aux envois de fonds, telles que les émissions obligataires de la diaspora (diaspora bonds), consistent à offrir des possibilités d’investissement et d’épargne aux communautés de la diaspora. Par exemple, en 2017, le Nigéria a réussi à lever 300 millions de dollars sous forme de diaspora bonds, qui ont été sursouscrites à hauteur de 130 % (Ratha et al. 2023)9. Toutefois, le succès de ces programmes repose sur la confiance entre la diaspora et l’organisme gestionnaire10. Les subventions paritaires représentent une variante de ces dispositifs, comme dans le cas du programme de la Bosnie-Herzégovine soutenu par une subvention de 2 millions de dollars de l’Agence américaine pour le développement international, qui a attiré 22 millions de dollars de capitaux de la diaspora (Banque mondiale 2024). L’implication d’agences de développement peut renforcer la confiance et la participation. Les communautés locales peuvent également explorer les obligations communautaires de la diaspora ou les participations au capital, qui bénéficient directement aux familles et aux communautés des migrants. Par exemple, plus de 10 000 Indiens résidant dans 30 pays étrangers ont investi dans le premier aéroport international de l’Inde, construit dans le cadre d’un partenariat public-privé11. Certains pays peuvent avoir besoin d’une assistance technique pour renforcer l’engagement de la diaspora. Par exemple, la Banque africaine de développement, la Commission de l’Union africaine et l’OIM accordent à huit pays des subventions pour les aider à identifier les méthodes les plus efficaces pour mobiliser le capital humain et financier de la diaspora afin d’aider au redressement après une crise politique ou humanitaire et soutenir la résilience climatique12
Faciliter les retours
Créer les conditions d’un retour réussi dans le pays d’origine prolonge les bénéfices de la migration et augmente les incitations au retour. Une mesure clé consiste à élargir la portabilité de la Sécurité sociale, en permettant aux travailleurs migrants de transférer dans leur pays d’origine les cotisations versées dans les pays de destination. Ainsi, les rapatriés disposent de ressources financières qui leur permettent d’emprunter, d’investir et de dépenser, ce qui encourage les retours. Ces accords, généralement des accords bilatéraux de sécurité sociale (ABSS), existent par exemple entre la Belgique et le Maroc : les travailleurs marocains en Belgique peuvent accéder aux prestations à leur retour (Holzmann 2016)13. Cependant, tous les pays de l’UE ne disposent pas de clause de portabilité ; par exemple, cette disposition est absente de l’ABSS passé entre la Suède et le Maroc (Réseau européen des migrations 2014). En outre, la reconnaissance des compétences et des qualifications acquises à l’étranger aide les rapatriés à trouver un emploi adapté. La réintégration peut également être favorisée par des dispositifs d’information, d’accompagnement administratif et d’aide financière aux rapatriés, comme le Projet de relance et de promotion de l’emploi dans le secteur informel au Bangladesh14. Si l’objectif premier de ces mesures est de favoriser la (ré)intégration des rapatriés, comme cela a été le cas au Bangladesh lorsque les pays du CCG étaient confinés pendant la pandémie de COVID-19, elles les incitent également à rentrer.
Dans les pays de destination : faciliter l’intégration
L’intégration régionale s’intensifie en Afrique, et de plus en plus d’Africains recherchent des perspectives à l’étranger. Pour permettre une meilleure migration, les pays de destination
doivent intégrer les migrants dans le marché du travail, tout en favorisant leur intégration dans la société pour renforcer la cohésion sociale et en leur permettant de réaliser leur potentiel économique (Banque mondiale 2023c, chapitre 6). Les huit communautés économiques régionales d’Afrique sont engagées à promouvoir la migration intrarégionale. La majorité d’entre elles disposent de protocoles relatifs à la libre circulation de leurs ressortissants. Si le protocole de l’Union africaine relatif à la libre circulation des personnes, au droit de résidence et au droit d’établissement a été adopté en 2018, il n’a été ratifié à ce jour que par un petit nombre d’États membres15. La ratification devrait être une priorité, car la liberté de circulation est l’un des principes fondamentaux de l’accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine.
Les pays africains deviennent des destinations de premier plan pour les migrants. Ils peuvent donc s’inspirer des nations expérimentées dans l’accueil d’importantes populations immigrées, comme la Colombie, l’Égypte, les membres de l’UE et les pays du CCG. Parmi les politiques notables en matière d’intégration des migrants, on peut citer le statut de protection temporaire délivré par la Colombie aux Vénézuéliens ayant fui la crise économique de leur pays. Ce statut leur permet de résider et travailler légalement en Colombie pendant une période pouvant aller jusqu’à 10 ans, et d’avoir accès aux systèmes de santé, d’éducation et à d’autres services sociaux (Rossiasco et de Narváez 2023 ; Banque mondiale 2018c). L’Égypte offre aux migrants et aux réfugiés de la plupart des nationalités le même accès à l’éducation et aux soins qu’à ses propres citoyens (Nations Unies 2022)16. L’Algérie est l’un des rares pays où l’accès au système de santé publique et à l’éducation de base est gratuit pour les immigrants et les réfugiés, bien qu’ils n’aient pas accès aux permis de séjour et de travail17. Depuis des décennies, les pays du CCG accueillent un nombre de migrants économiques qui excède leurs propres populations (ce phénomène est abordé dans l’encadré 3.2, au chapitre 3 du présent rapport). Au Portugal, le Haut-commissariat pour les migrations a instauré des formations linguistiques gratuites et certifiantes pour les nouveaux arrivants, ainsi que des guichets uniques pour les services aux immigrants, ce qui facilite la coopération entre organismes gouvernementaux et renforce la cohérence des mesures, au-delà du côté pratique de l’accès à plusieurs services au même endroit18. Pour faciliter l’intégration, un petit nombre de pays a opté pour des politiques de répartition géographique, pour opérer un arbitrage entre les répercussions négatives de la concentration et de la ségrégation ethniques et les effets positifs du réseautage social. Par exemple, l’Allemagne et la Suède ont mis en œuvre des politiques de répartition (aléatoire) pour empêcher la concentration de réfugiés dans des enclaves ethniques. Toutefois, ces politiques ont souvent sous-estimé le potentiel économique des individus ainsi que les effets positifs des réseaux solidaires de personnes de la même ethnie, ce qui a abouti à des résultats économiques décevants (voir BAMF [2022] pour l’Allemagne et Andersson [2020] pour la Suède). Des améliorations pourraient être obtenues grâce à une répartition qui accorde mieux les compétences des réfugiés avec les besoins du marché du travail local (Bansak et al. 2018). Bien que ces politiques aient été conçues à l’origine pour répondre à des arrivées soudaines et massives de réfugiés, des arbitrages similaires pourraient être effectués dans le cas des migrants, en modulant les politiques sociales de manière à soutenir également le développement et la planification territoriale des pays de destination.
En outre, grâce à l’augmentation du nombre de nouveaux visas d’études délivrés par les pays de l’OCDE, de 1,2 million en 2012 à 1,9 million en 2022, les pays de destination peuvent tenter de répondre aux futures pénuries de main-d’œuvre et gérer plusieurs aspects de l’intégration économique et sociale des migrants. Le fait de recevoir une formation et un enseignement dans le pays de destination permet de résoudre le problème de la reconnaissance des compétences et des qualifications sur le marché du travail. La reconnaissance mutuelle des qualifications faciliterait également un retour productif des migrants dans leur pays d’origine, sachant que deux étudiants internationaux sur trois quittent les pays de l’OCDE à l’expiration de leur visa (OCDE 2022). Par exemple, l’Italie a ouvert une nouvelle voie d’accès légale à des formations professionnelles, linguistiques et civiques, afin de compenser les pénuries de main-d’œuvre dans des secteurs stratégiques. Cette voie est accessible aux ressortissants de pays tiers, ainsi qu’aux réfugiés présents dans les pays de premier asile ou de transit (gouvernement italien, ministère du Travail et des Politiques sociales, 2023). Les pays de destination peuvent ensuite offrir aux nouveaux diplômés des voies d’accès à des séjours de plus longue durée. Par exemple, le programme « formation pratique facultative » aux États-Unis permet aux étudiants diplômés d’une université américaine d’acquérir une année d’expérience professionnelle. À l’issue de cette période, les étudiants doivent changer de statut et obtenir un visa de travail, ou bien retourner dans leur pays d’origine. Bien que la migration étudiante constitue une alternative prometteuse à la migration de main-d’œuvre, seuls deux pays africains (le Maroc et le Nigéria) figuraient parmi les vingt premiers pays d’origine pour lesquels des visas étudiants avaient été délivrés en 2022 (OCDE 2022).
En tant que pays de destination des migrants, l’Égypte et le Maroc accueillent également un nombre important d’étudiants étrangers, avec respectivement 69 800 et 23 600 étudiants étrangers inscrits en 202219. En Afrique de l’Ouest, les Centres d’excellence de l’enseignement supérieur en Afrique (CEA) pour l’impact sur le développement ont été lancés en 2014. Cette initiative comprend 22 centres d’excellence répartis dans 11 pays. Elle vise à promouvoir la spécialisation régionale des universités participantes afin de répondre à des défis communs spécifiques de développement régional20. Son but est de renforcer la capacité de ces universités à dispenser une formation et à mener une recherche de haute qualité, de répondre à la demande de compétences et d’attirer des talents de tout le continent. Une deuxième phase (CEA II) a été lancée en Afrique de l’Est et en Afrique australe, avec la création de 24 centres supplémentaires dans huit pays : l’Éthiopie, le Kenya, le Malawi, le Mozambique, l’Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie et la Zambie. Enfin, les écoles de statistique d’Afrique de l’Ouest (Cameroun, Côte d’Ivoire et Sénégal) attirent également des étudiants de toute la région, grâce à la qualité de l’enseignement dispensé. Toutefois, le taux d’inscription des étudiants étrangers y reste faible par rapport aux moyennes mondiales21.
Préserver la dignité de chacun, partout
La sauvegarde de la dignité des migrants et des réfugiés, indépendamment de leur degré d’adéquation avec les sociétés d’accueil et les raisons qui motivent leur migration, doit guider les décisions politiques. Les pays de destination peuvent tenir un discours et mettre en œuvre
des politiques qui protègent les migrants et les réfugiés contre le racisme, la xénophobie et la discrimination à l’emploi, au logement, dans la fourniture de services sociaux et dans les communautés d’accueil (Banque mondiale 2023c, Gros plan 6). Les perceptions et les attitudes du public à l’égard des migrants et des réfugiés sont influencées par la manière dont le discours public souligne les points communs et les différences entre les groupes (Bloemraad et al. 2023).
En outre, le droit des demandeurs d’asile à une procédure régulière est un principe fondamental du système juridique de protection internationale. L’externalisation des obligations en matière d’asile, comme le prévoit le partenariat entre le Royaume-Uni et Rwanda en matière d’asile, « pose de sérieux risques pour la sécurité des réfugiés » (HCR 2024).
Concernant la migration de détresse, le Rapport sur le développement dans le monde 2023 propose une série de mesures visant à décourager la migration irrégulière, notamment en multipliant les voies légales (Banque mondiale 2023c). De nouvelles voies légales venant « concurrencer » les réseaux de passeurs pourraient réduire l’attrait des itinéraires irréguliers. Elles impliquent de renforcer l’éducation et la formation professionnelle, en ciblant les migrants peu ou moyennement qualifiés. Les enquêtes menées en Grèce et en Italie lors du pic migratoire de 2015-2016 suggèrent que les demandeurs d’asile dans les centres d’accueil affichaient des niveaux de qualification similaires à ceux des précédentes vagues de migrants vers l’Union européenne (Banque mondiale 2018a). Les voies humanitaires pourraient s’inspirer des mesures prises par le gouvernement américain après l’expiration de l’ordonnance temporaire du Titre 4222. Ces mesures ont consisté à augmenter le nombre de réfugiés ou de personnes pouvant bénéficier de formes complémentaires de protection internationale, à simplifier et accélérer les procédures administratives de demande d’asile depuis le pays d’origine, et à imposer des sanctions plus sévères en cas de franchissement illégal des frontières, telles que des interdictions temporaires ou permanentes de toute nouvelle demande de visa23
En plus de protéger les droits et la dignité des migrants, la réduction des incitations à la migration de détresse suppose d’améliorer la situation socio-économique et la résilience des pays d’origine, en particulier dans le centre géographique de l’Afrique. L’Afrique continuant à s’urbaniser, les villes seront amenées à jouer un rôle central dans l’accueil des migrants internes, en réponse aux difficultés ou aux chocs économiques et climatiques. Par conséquent, des plans de développement urbain prévoyant des logements à l’épreuve du climat, des investissements dans les infrastructures, et des réseaux de connectivité urbaine permettront d’offrir des alternatives nationales à la migration internationale de détresse (Clement et al. 2021). Djibouti, par exemple, accueille des réfugiés, des demandeurs d’asile, des migrants en transit et des migrants économiques de longue durée. Les chocs climatiques ont un impact non seulement sur les flux de migrants et de réfugiés (RCCC 2023), mais aussi sur la capacité du pays à les intégrer, alors que la ville de Djibouti souffre de pénuries d’eau, de températures extrêmes, d’inondations, de cyclones et de tempêtes (GCA 2024).
À long terme, le développement économique, la planification urbaine et les mesures d’adaptation au climat peuvent influencer les incitations à migrer et modifier les schémas migratoires. À court terme, les effets de ces mesures peuvent être limités, à moins qu’elles ne
ciblent spécifiquement les groupes de population et les localités présentant des taux de chômage, des niveaux de pauvreté et des flux migratoires élevés (Banque mondiale 2023c, Gros plan 8). Par exemple, une enquête de 2016 sur les demandeurs d’asile dans les centres d’accueil italiens a révélé que 84 % des Nigérians interrogés étaient originaires de la région Sud-Sud du Nigéria (Banque mondiale 2018a). Ainsi, des projets de développement centrés sur l’agriculture ou les marchés du travail urbains dans des zones comme Benin City pourraient peser davantage sur la migration en provenance de cette région. Une autre option consiste à exploiter les dispositions relatives à la mobilité au sein des communautés économiques régionales. Une expérience menée en Gambie auprès de 3 641 jeunes hommes a montré que les intentions de migrer en situation irrégulière vers l’Europe diminuaient chez ceux qui recevaient des informations et une assistance pour migrer vers Dakar, au Sénégal (Bah et al. 2023).
Concernant les migrants en détresse qui se trouvent déjà dans un pays de transit ou de destination, les autorités peuvent choisir de les renvoyer dans des conditions humaines ou bien les intégrer à la société d’accueil. Deux grandes campagnes de régularisation ont eu lieu au Maroc en 2014 et 2017 au profit de quelque 51 000 migrants en situation irrégulière, dont 80 % étaient originaires des pays du centre de l’Afrique, leur donnant accès à des possibilités d’emploi formel. De même, l’Afrique du Sud a mené en 2010 une campagne de régularisation qui a bénéficié à 242 000 immigrants zimbabwéens, produisant des effets positifs sur le marché du travail, aussi bien pour les immigrants que pour les populations locales (Cha’ngom 2024). Outre les campagnes de régularisation de masse, certains pays confrontés à des pénuries de maind’œuvre ouvrent des voies de régularisation aux migrants en situation irrégulière qui occupent un emploi. Jusqu’à récemment, le Portugal permettait aux immigrants employés depuis plus d’un an et cotisant à la Sécurité sociale d’obtenir un statut légal24. En Allemagne, les demandeurs d’asile qui se voient refuser la protection internationale sont obligés de quitter le pays ; mais ils peuvent bénéficier d’une tolérance (« Duldung ») sous certaines conditions, notamment s’ils suivent une formation professionnelle ou occupent un emploi, ce qui leur permet d’obtenir un titre de séjour25.
À l’inverse, au Maghreb, des milliers de migrants originaires d’Afrique subsaharienne en situation irrégulière auraient été expulsés vers des régions désertiques et arides, ou soumis à des conditions de détention inhumaines, notamment à des violences physiques et sexuelles, des extorsions et des tortures. Ces pratiques ont entraîné de nouvelles crises humanitaires et de graves violations des droits (Soto-Mayor 2024 ; Nations Unies 2021 ; ambassade des États-Unis en Algérie 2023 ; Washington Post 2024).
Renforcer la viabilité des systèmes de protection juridique des réfugiés et des PDI
Dans un contexte de réduction des budgets humanitaires, il est d’autant plus important de valoriser le potentiel économique des réfugiés et des PDI, afin d’assurer la viabilité des systèmes de protection juridique. Des initiatives comme Jobs Compact en Éthiopie cherchent à créer des emplois par le biais d’engagements politiques qui instaurent des mesures pérennes pour faire face à la question des réfugiés. Ces mesures consistent notamment à garantir la liberté de circulation des réfugiés, à leur délivrer des permis de travail et à leur réserver des quotas
d’embauche, ou bien à subventionner de manière équivalente les entreprises qui les embauchent (Banque mondiale 2018b). Bien que cette initiative n’ait pas encore atteint ses objectifs de développement, elle a entraîné des changements législatifs importants qui posent un préalable à l’intégration et à l’autonomie des réfugiés. De plus, l’initiative met en évidence le rôle essentiel joué par le secteur privé pour mobiliser de manière productive le capital humain des réfugiés et des PDI. Des initiatives comme le fonds de développement Kakuma/Kalobeyei sont conçues pour attirer des entreprises privées et des entreprises sociales dans les zones d’accueil des réfugiés. En soutenant la croissance des entreprises, ces actions aident à créer un environnement économique favorable et contribuent ainsi à l’intégration économique et à l’autonomisation des réfugiés et des PDI (IFC 2024).
Diversifier les options de mobilité, à l’intérieur et à l’extérieur d’un pays, en tenant compte des enjeux de sécurité peut permettre aux réfugiés et aux PDI de rejoindre des zones offrant de meilleures possibilités d’emploi et de mettre à profit leurs avantages comparatifs. Le modèle d’accueil des réfugiés en Ouganda permet aux réfugiés de travailler, de se déplacer librement et d’accéder à la terre. Il se traduit par des revenus plus élevés et fait baisser le coût d’assistance d’environ 225 millions de dollars par an (Atamanov, Hoogeveen et Reese 2024 ; Betts et al. 2019)26. La dispersion géographique des réfugiés les aide à accéder aux emplois, réduit le déplacement des travailleurs locaux et répartit les besoins en logement, en infrastructures et en services dans les régions mal desservies (voir Clemens, Huang et Graham [2018] et la discussion dans Sarzin et Nsababera [2024]). Au Danemark, les réfugiés étaient répartis dans différentes municipalités au prorata de la population locale, de manière à partager les efforts d’intégration. Les réfugiés affectés dans des villes plus importantes avaient plus de chances de trouver un emploi et de voir leur salaire augmenter plus rapidement (Eckert, Hejlesen et Walsh, 2022). Lorsque les travailleurs locaux confrontés à une concurrence accrue des réfugiés sont évincés du marché du travail, des programmes de formation professionnelle et de protection sociale, tels que des aides financières combinées à un accompagnement à la recherche d’emploi, leur offrent la possibilité d’améliorer leurs compétences plutôt que de se retrouver au chômage (Baird, McKenzie et Özler 2018 ; Clemens, Huang et Graham 2018 ; Maitra et Mani 2017).
La particularité de l’Afrique tient à ses multiples protocoles régionaux de libre circulation, qui permettent de renforcer la mobilité régionale des personnes déplacées de force, de partager la responsabilité de la protection des réfugiés et d’apporter des solutions durables. La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la SADC et le Marché commun de l’Afrique orientale et australe ont établi des protocoles de libre circulation pour faciliter la circulation des biens, des services et des personnes entre États membres, en vue de favoriser l’intégration économique. Ces protocoles garantissent la liberté d’entrer, de résider, de chercher un emploi et de créer des entreprises, des droits qui pourraient être étendus aux réfugiés originaires des pays membres pour régulariser leur statut. Le Nigéria donne un exemple notable d’application des protocoles de libre circulation de la CEDEAO : le gouvernement a délivré des permis de séjour et de travail renouvelables aux Libériens et aux Sierra-Léonais en possession d’un passeport de leur pays d’origine, leur retirant ainsi leur statut de réfugié (Banque mondiale 2017). Ce type d’initiatives régionales permet d’apporter des solutions
durables aux populations assujetties à un statut d’apatride prolongé27. Ces mesures peuvent être mises en œuvre parallèlement aux efforts déployés dans les pays d’origine pour remédier aux causes des déplacements et créer des conditions propices au retour et à la réintégration.
La réduction des budgets humanitaires nécessite de passer sans tarder des mesures d’urgence aux mesures de développement à moyen terme. Cette transition consiste à intégrer la gouvernance des réfugiés dans les structures nationales et infranationales, en veillant à ce que l’aide internationale prenne la forme d’un soutien financier aux budgets centraux et locaux. Le financement des systèmes de protection peut recourir à des outils comme le Guichet pour les communautés d’accueil et les réfugiés (WHR), qui favorisent des actions de développement à long terme pour les réfugiés et les communautés d’accueil (Banque mondiale 2021b). Par exemple, au Tchad, l’appui du WHR permet d’augmenter la productivité et la sécurité alimentaire des réfugiés et des rapatriés venant de République centrafricaine (Banque mondiale 2022a). Au Soudan du Sud, les fonds du WHR ont été utilisés pour distribuer de l’eau potable ou dispenser des soins de base et des enseignements aux réfugiés et aux communautés d’accueil (Banque mondiale 2022a). Au Kenya, le WHR a joué un rôle clé dans la création du Plan Shirika du gouvernement, qui vise à transformer les camps de réfugiés de Dadaab et Kakuma en établissements intégrés favorisant l’inclusion socio-économique des réfugiés et des communautés d’accueil (Ginn et Dempster 2024).
Notes
1. Le terme ABMMO est utilisé pour désigner différents types d’accords sur la migration de maind’œuvre, dont les ABMMO (juridiquement contraignants), les mémorandums d’accord (MoU, qui peuvent ne pas être juridiquement contraignants) ou d’autres types d’accords-cadres sur la migration de main-d’œuvre (OIT et OIM 2019).
2. https://africacdc.org/ et https://au-afcfta.org/
3. https://www.iom.int/regional-ministerial-forum-migration-east-and-horn-africa-rmfm
4. https://www.eeas.europa.eu/delegations/botswana/southern-africa-migration-management-project -samm-%E2%80%93-2021-2024_el ; https://trust-fund-for-africa.europa.eu/our-programmes /towards-holistic-approach-labour-migration-governance-and-labour-mobility-north-africa_en
5. Le Bangladesh dispose d’un ministère du bien-être des expatriés et de l’emploi à l’étranger, qui est l’homologue du département de l’emploi à l’étranger du Népal, du bureau de l’émigration et de l’emploi à l’étranger du Pakistan, du département des travailleurs migrants des Philippines ou du bureau de l’emploi à l’étranger du Sri Lanka.
6. https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043317444/2024-06-11/. La réforme a permis de réduire les pénuries et d’augmenter l’embauche de migrants, sans nuire à l’emploi de la population locale (Signorelli 2024).
7. Par exemple, de Brauw, Kramer et Murphy (2021) étudient l’impact de la migration de certaines femmes sur les autres femmes appartenant à la même communauté au Bangladesh. Ils constatent que lorsqu’une femme part, la probabilité que les femmes interrogées se donnent les moyens de se prendre en charge est supérieure de 20 points de pourcentage à celle de leurs pairs.
8. Par exemple, pour les compétences, connaissances et aptitudes requises pour les aides-soignants aux États-Unis, consulter https://www.onetonline.org/link/summary/31-1122.00
9. En avril 2024, le gouvernement nigérian a annoncé son intention d’émettre un fonds d’obligations de la diaspora d’une valeur de 10 milliards de dollars.
10. Les diaspora bonds émises en 2009 puis en 2011 par l’Éthiopie pour financer un barrage hydroélectrique n’ont pas eu le succès escompté, sans doute en raison des risques perçus du projet et du mécontentement de la diaspora à l’égard du gouvernement. Pour parvenir à mobiliser l’épargne de la diaspora, il faut notamment consulter préalablement la diaspora pour mieux comprendre ses attentes, nouer un lien de confiance, instaurer des garanties multilatérales, et avoir une entité offshore dédiée à un objectif spécifique pour garantir que les fonds sont bien dirigés vers cet objectif (Ratha et al. 2023 ; Banque mondiale 2013).
11. L’aéroport international de Cochin se trouve dans le Kerala, en Inde, et est détenu par une société anonyme. Les informations proviennent du site web de l’Association des opérateurs aéroportuaires privés d’Inde, qui a publié un entretien de V. J. Kurien, ancien haut fonctionnaire qui aurait eu l’idée de faire investir la diaspora indienne dans le projet.
12. Ces pays sont la Gambie, le Liberia, Madagascar, le Mali, la Somalie, le Soudan du Sud, le Togo et le Zimbabwe (BAD 2023).
13. La France a conclu un accord de sécurité sociale de ce type avec la Tunisie (OIT 2021).
14. La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest a adopté une convention sur la reconnaissance mutuelle des diplômes dans les États membres en 2003, mais elle a rencontré des difficultés de mise en œuvre dues aux barrières linguistiques et à l’absence de référentiel commun et de politiques nationales de migration (Ibourk 2020). Des informations sur le Projet de relance et de promotion de l’emploi dans le secteur informel au Bangladesh sont disponibles dans Banque Mondiale 2021a.
15. Selon la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, seuls quatre pays membres ont ratifié le protocole, moins que les quinze requis pour son entrée en vigueur.
16. Les migrants et réfugiés originaires de la République arabe syrienne, de la République du Yémen, du Soudan et du Soudan du Sud ont accès à l’école publique au même titre que les ressortissants égyptiens. Les réfugiés syriens bénéficient en plus d’un accès gratuit aux universités publiques. Les réfugiés originaires d’Érythrée, d’Éthiopie, d’Irak et de Somalie n’ont accès qu’au système scolaire privé égyptien.
17. HCR en Algérie : https://help.unhcr.org/algeria/unhcr-in-algeria/ et https://reporting.unhcr.org /operational/operations/algeria#toc-populations
18. https://www.acm.gov.pt/ru/-/como-posso-frequentar-um-curso-de-lingua-portuguesa-para -estrangeiros et https://www.acm.gov.pt/-/projeto-one-stop-shop
19. Les données ont été extraites de data.uis.unesco.org le 20 juin 2024.
20. De plus amples informations sur le projet ACE sont disponibles à l’adresse : https://ace.aau.org/about -ace-impact/
21. La part des étudiants étrangers entrants dans le total des inscriptions (moyenne pour 2016, 2017 et 2018) était de 1,9 % au Maroc, 1,8 % en Égypte et 0,5 % en Algérie, contre une moyenne mondiale de 2,4 % (Banque mondiale 2020).
22. Le Titre 42 était une ordonnance de santé publique invoquée lors de la pandémie de COVID-19, qui permettait aux autorités américaines d’expulser les migrants à la frontière au motif de problèmes de santé publique. L’ordonnance a été en vigueur de mars 2020 jusqu’à son expiration en mai 2023.
Pour plus d’informations : https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2011-title42/html /USCODE-2011-title42-chap6A-subchapII-partG-sec265.htm
23. Pour plus d’informations : https://www.dhs.gov/news/2023/04/27/fact-sheet-us-government -announces-sweeping-new-actions-manage-regional-migration ; https://www.govinfo.gov/content /pkg/USCODE-2011-title42/html/USCODE-2011-title42-chap6A-subchapII-partG-sec265.htm
24. Les articles 81, 88 et 89 de la loi portugaise sur l’immigration 59/2017 ont été abrogés par décret le 3 juin 2024.
25. Alinéa 60d de la loi allemande sur la résidence : https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg _2004/__60d.html.
26. La petite taille des parcelles et les difficultés d’accès au crédit, aux produits et équipements agricoles, et aux marchés empêchent encore les réfugiés d’atteindre leur pleine capacité de production (Atamanov, Hoogeveen et Reese 2024).
27. Plus d’un million de personnes sur le continent (HCR 2022).
Bibliographie
AfDB (African Development Bank). 2023. “Project Appraisal Report: Streamlining Diaspora Engagement to Catalyze Private Investments & Entrepreneurship for Enhanced Resilience (SDE4R).” AfDB, Abidjan, Côte d’Ivoire. https://www.afdb.org/en/documents/multinational-streamlining-diaspora-engagement -catalyze-private-investments-entrepreneurship-enhanced-resilience-sde4r-project-appraisal-report.
Andersson, H. 2020. “Ethnic Enclaves, Self-Employment, and the Economic Performance of Refugees: Evidence from a Swedish Dispersal Policy.” International Migration Review 55 (1): 58–83.
Atamanov, A., J. Hoogeveen, and B. Reese. 2024. “The Costs Come before the Benefits.” Policy Research Working Paper 10679, World Bank, Washington, DC.
Bah, T., C. Batista, F. Gubert, and D. McKenzie. 2023. “Can Information and Alternatives to Irregular Migration Reduce ‘Backway’ Migration from The Gambia?” Journal of Development Economics 165: 103153. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2023.103153.
Baird, S., D. McKenzie, and B. Özler. 2018. “The Effects of Cash Transfers on Adult Labor Market Outcomes.” IZA Journal of Development and Migration 8: 1–20.
BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Federal Office for Migration and Refugees, Germany). 2022. “Initial Distribution of Asylum-Seekers (EASY).” Asylum and Refugee Protection. BAMF, Nuremberg, Germany. https://www.bamf.de/EN/Themen/AsylFluechtlings schutz/Ablauf Asylverfahrens/Erstverteilung/erstver teilung-node.html
Bansak, K., J. Ferwerda, J. Hainmueller, A. Dillon, D. Hangartner, D. Lawrence, and J. Weinstein. 2018. “Improving Refugee Integration through Data-Driven Algorithmic Assignment.” Science 359 (6373): 325–29.
Bazzi, S., L. Cameron, S. G. Schaner, and F. Witoelar. 2021. “Information, Intermediaries, and International Migration.” Working Paper No. 29588, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA. https:// doi.org/10.3386/w29588
Betts, A., I. Chaara, N. Omata, and O. Sterck. 2019. “Refugee Economies in Uganda: What Difference Does the Self-Reliance Model Make?” Refugee Studies Centre, University of Oxford, UK.
Bloemraad, I., V. M. Esses, W. Kymlicka, and Y. Y. Zhou. 2023. “Unpacking Immigrant Integration: Concepts, Mechanisms, and Context.” Background paper for World Development Report 2023: Migrants, Refugees, and Societies. World Bank, Washington, DC.
Cha’ngom, N. 2024. “Effectiveness of Mass Regularization Policies in South Africa: Evidence from the Dispensation of Zimbabwean Project (DZP).” Background paper prepared for this report. World Bank, Washington, DC.
Clemens, M., C. Huang, and J. Graham. 2018. “The Economic and Fiscal Effects of Granting Refugees Formal Labor Market Access.” Working Paper 496, Center for Global Development, Washington, DC.
Clement, V., K. K. Rigaud, A. de Sherbinin, B. Jones, S. Adamo, J. Schewe, N. Sadiq, and E. Shabahat. 2021. Groundswell Part 2: Acting on Internal Climate Migration. Washington, DC : World Bank. http://hdl .handle.net/10986/36248
de Brauw, A., B. Kramer, and M. Murphy. 2021. “Migration, Labor and Women’s Empowerment: Evidence from an Agricultural Value Chain in Bangladesh.” World Development 142: 105445.
Do, Q.-T., A. Levchenko, S. Sotelo, and R. D. Zarate. 2024. “Population Aging and Immigration.”
Background paper prepared for this report. World Bank, Washington, DC.
Eckert, F., M. Hejlesen, and C. Walsh. 2022. “The Return to Big-City Experience: Evidence from Refugees in Denmark.” Journal of Urban Economics 130: 103454. https://doi.org/10.1016/j.jue.2022.103454
European Migration Network. 2014. “Synthesis Report—Migrant Access to Social Security and Healthcare: Policies and Practice.” European Migration Network, European Commission, Brussels, Belgium. https:// emn.ie/files/p_201407070444042014_synthesis_report_migrant_access_to_social_security.pdf
European Union. 2023. “SMEs and Skills Shortages.” European Union, Brussels, Belgium. https://europa. eu/eurobarometer/surveys/detail/2961.
Fabbri, C., H. Stöckl, K. Jones, H. Cook, C. Galez-Davis, N. Grant, Y. Lo, and C. Zimmerman. 2023. “Labor Recruitment and Human Trafficking: Analysis of a Global Trafficking Survivor Database.”
International Migration Review 57 (2): 629–51.
Fernando, N., and N. Singh. Forthcoming. “Regulation by Reputation? Intermediaries, Labor Abuses, and International Migration.” Review of Economics and Statistics
FSB (Financial Stability Board). 2023. G20 Roadmap for Enhancing Cross-border Payments. Consolidated Progress Report for 2023. Basel, Switzerland: FSB. https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P091023-2 .pdf.
GCA (Global Center on Adaptation). 2024. “Rapid Climate Risk Assessment : Djibouti City, Djibouti.” GCA, Rotterdam, Netherlands.
Ginn, T., and H. Dempster. 2024. “Will the Window for Host Communities and Refugees Survive ‘SimplifIDA’?” Center for Global Development, Washington, DC. https://www.cgdev.org/blog/will -window-host-communities-and-refugees-survive-simplifida
Government of Italy, Ministry of Labor and Social Policies. 2023. Implementation Modalities for Vocational and Civil-Linguistic Training Programs and Criteria for Their Evaluation. Rome : Government of Italy. https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita-immigrazione/focus/linee-guida-programmi-di -formazione-professionale-civico.
Holzmann, R. 2016. “Bilateral Social Security Agreements and Pensions Portability: A Study of Four Migrant Corridors between EU and Non-EU Countries.” International Social Security Review 69 (3–4): 109–30.
Ibourk, A. 2020. “Exploring the Potential for Skills Partnerships on Migration in West Africa and Sahel.” International Labour Organization, Geneva.
IFC (International Finance Corporation). 2024. “The Kakuma Kalobeyei Challenge Fund.” IFC, Washington, DC. https://kkcfke.org/.
ILO (International Labour Organization). 2021. “Extending Social Protection to Migrant Workers, Refugees and Their Families: A Guide for Policymakers and Practitioners.” ILO, Geneva.
ILO and IOM (International Labour Organization and International Organization for Migration). 2019. “Tool for the Assessment of Bilateral Labour Migration Agreements: Pilot-Tested in the African Region.” ILO/IOM Project Towards Comprehensive Global Guidance on Developing and Implementing Bilateral Labour Migration Arrangements (BLMAs): Unpacking Key Obstacles to Implementation in the African Region. ILO, Geneva. https://www.ilo.org/publications/tool-assessment-bilateral-labour -migration-agreements-pilot-tested-african
IOM (International Organization for Migration). 2016. Migration Information Centre Opens in Ghana’s Brong Ahafo Region. Geneva : IOM. https://www.iom.int/news/migration-information-centre-opens -ghanas-brong-ahafo-region.
IOM (International Organization for Migration). 2019. 10,000 Ghanaian Youth Learn about Pitfalls of Irregular Migration. Geneva : IOM. https://www.iom.int/news/10000-ghanaian-youth-learn-about -pitfalls-irregular-migration
IOM (International Organization for Migration). 2024. Africa Migration Report. 2nd ed. Geneva : IOM. https://publications.iom.int/books/africa-migration-report-second-edition
Leighton, M. 2024. “Overview of Methods of Collaboration on African Migration beyond the Continent.” Background paper prepared for this report. World Bank, Washington, DC.
Maitra, P., and S. Mani. 2017. “Learning and Earning: Evidence from a Randomized Evaluation in India.” Labour Economics 45: 116–30.
Mobarak, A. M., I. Sharif, and M. Shrestha. 2023. “Returns to International Migration: Evidence from a Bangladesh-Malaysia Visa Lottery.” American Economic Journal: Applied Economics 15 (4): 353–88. https://doi.org/10.1257/app.20220258
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2022. International Migration Outlook. 46th ed. Paris : OECD. https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/30fe16d2-en.pdf? expires=1718824593&id=id&accname=ocid195787&checksum=E43062F81A69E543CC306E 9265A601B.
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2023. “Health at a Glance 2023: OECD Indicators.” OECD, Paris. https://www.oecd-ilibrary.org/content/publication/7a7afb35-en. Ratha, D., V. Candra, E. Kim, S. Plaza, and W. Shaw. 2023. “Migration and Development Brief 39: Leveraging Diaspora Finances for Private Capital Mobilization.” World Bank, Washington, DC.
RCCC (Red Cross Climate Center). 2023. “Climate Crisis and Conflict Push More People to Drought -Stricken Djibouti.” RCCC, The Hague, Netherlands. Rossiasco, P., and P. de Narváez. 2023. “Adapting Public Policies in Responses to an Unprecedented Influx of Refugees and Migrants: Colombia Case Study of Migration from Venezuela.” Background paper for World Development Report 2023: Migrants, Refugees, and Societies. World Bank, Washington, DC.
Sarzin, Z., and O. Nsababera. 2024. “Forced Displacement: A Stocktaking of Evidence.” Background paper prepared for this report. World Bank, Washington, DC.
Shrestha, M. 2020. “‘Get Rich or Die Tryin’: Perceived Earnings, Perceived Mortality Rates, and Migration Decisions of Potential Work Migrants from Nepal.” World Bank Economic Review 34 (1): 1–27. https:// doi.org/10.1093/wber/lhz023
Signorelli, S. 2024. “Do Skilled Migrants Compete with Native Workers? Analysis of a Selective Immigration Policy.” Journal of Human Resources 59 (5): 0922-12535R3. https://doi.org/10.3368/jhr .0922-12535R3.
Soto-Mayor, G. 2024. “Libya, Tunisia, and Niger as Case Studies for Counter-Productive Anti-Migration Policies.” Middle East Institute, Washington, DC.
Svensson, J. 2000. “Foreign Aid and Rent-Seeking.” Journal of International Economics 51 (2): 437–61.
UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees). 2022. Global Report. Geneva : UNHCR.
UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees). 2024. “UNHCR Response to Media Inquiries Related to the UK-Rwanda Asylum Partnership.” UNHCR, Geneva. https://www.unhcr.org/africa/news /press-releases/unhcr-response-media-inquiries-related-uk-rwanda-asylum-partnership#:~:text =UNHCR%20has%20been%20consistently%20clear,decisions%20and%20for%20protecting%20 refugees.
United Nations. 2021. “Tunisia and Libya: UN Experts Condemn Collective Expulsion and Deplorable Living Conditions of Migrants.” United Nations, New York. https://www.ohchr.org/en/press-releases /2021/11/tunisia-and-libya-un-experts-condemn-collective-expulsion-and-deplorable#:~:text=UN%20 human%20rights%20experts*%20today,to%20dangerous%20conditions%20in%20Libya
United Nations. 2022. “Common Situational Analysis—Education and Health Services for Migrants and Refugees in Egypt.” Joint Platform for Migrants and Refugees in Egypt, United Nations, Cairo, Egypt.
UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). 2015. “The Role of Recruitment Fees and Abusive and Fraudulent Recruitment Practices of Recruitment Agencies in Trafficking in Persons.” UNODC, Vienna, Austria.
US BLS (US Bureau of Labor Statistics). 2024. “Employment Projections 2022–32.” US BLS, Washington, DC. https://www.bls.gov/emp/tables/fastest-growing-occupations.htm
US Embassy in Algeria. 2023. “2023 Trafficking in Persons Report: Algeria.” US Embassy in Algeria, El Biar, Algeria. https://dz.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/236/2023-Trafficking-in-Persons -Report-Algeria.pdf
Washington Post. 2024. “With Europe’s Support, North African Nations Push Migrants to the Desert.” Washington Post, May 20. https://www.washingtonpost.com/world/interactive/2024/eu-migrant -north-africa-mediterranean/.
World Bank. 2013. “Ethiopia Economic Update II: Laying the Foundation for Achieving Middle Income Status.” World Bank, Washington, DC.
World Bank. 2017. Forcibly Displaced: Toward a Development Approach Supporting Refugees, the Internally Displaced, and Their Hosts. Washington, DC: World Bank. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0938-5
World Bank. 2018a. Asylum Seekers in the European Union: Building Evidence to Inform Policy Making. Washington, DC : World Bank.
World Bank. 2018b.“Ethiopia Program-For-Results/Investment Project Financing Economic Opportunities Program.” Program-for-Results Information Document Appraisal Stage Report No. PIDA 0151612, World Bank, Washington, DC.
World Bank. 2018c. “Migration from Venezuela to Colombia: Short- and Medium-Term Impact and Response Strategy.” World Bank, Bogotá, Colombia. https://openknowledge.worldbank.org/handle /10986/30651
World Bank. 2020. “Internationalisation de l’enseignement supérieur dans la région Moyen-Orient Afrique du Nord.” World Bank, Washington, DC. https://www.cmimarseille.org/sites/default/files/newsite /updated_french_online_tertiary_education_report_2_0.pdf.
World Bank. 2021a. “Recovery and Advancement of Informal Sector Employment.” International Development Association Project Appraisal Document PAD4065. World Bank, Washington, DC.
World Bank. 2021b. “Window for Host Communities and Refugees.” World Bank, Washington, DC. https://ida.worldbank.org/en/replenishments/ida19-replenishment/windows-host-communities -refugees
World Bank. 2022a. “10 Things to Know about the Window for Host Communities and Refugees.” World Bank, Washington, DC. https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2022/10/28/10-things-to-know -about-the-window-for-host-communities-and-refugees.
World Bank. 2022b. “Enhancing Labor Mobility from Papua New Guinea.” International Development Association Project Appraisal Document PAD4342. World Bank, Washington, DC.
World Bank. 2023a. “Harmonizing and Improving Statistics in West and Central Africa.” HISWACA—SOP 1 Project Appraisal Document PAD5154 (SADC) Regional Statistics Project Appraisal Document PAD5178. World Bank, Washington, DC.
World Bank. 2023b. “SADC Regional Statistics Project Appraisal Document.” PAD5178. World Bank, Washington, DC.
World Bank. 2023c. World Development Report 2023: Migrants, Refugees, and Societies. Washington, DC: World Bank.
World Bank. 2024. “International Mobility as a Development Strategy: Bosnia and Herzegovina Country Report.” World Bank, Washington, DC.
ECO-AUDIT
Déclaration des avantages environnementaux
Le Groupe de la Banque mondiale s’est engagé à réduire son empreinte environnementale. À l’appui de cet engagement, nous exploitons des moyens d’édition électronique et des outils d’impression à la demande installés dans des centres régionaux à travers le monde. Ensemble, ces initiatives permettent une réduction des tirages et des distances de transport, ce qui se traduit par une baisse de la consommation de papier, de l’utilisation de produits chimiques, des émissions de gaz à effet de serre et des déchets.
Nous suivons les normes relatives à l’utilisation du papier recommandées par l’Initiative Green Press. La plupart de nos livres sont imprimés sur du papier certifié par le Forest Stewardship Council (FSC) et contenant entre 50 et 100 % de fibre recyclée dans la quasi-totalité des cas. Cette fibre est soit écrue, soit blanchie à l’aide d’un procédé totalement sans chlore (TCF), d’un traitement sans chlore (PCF) ou d’un blanchiment sans chlore élémentaire amélioré (EECF).
D’autres informations sur les principes environnementaux de la Banque sont disponibles sur le site http://www.worldbank.org/corporateresponsibility

La migration en Afrique est essentiellement motivée par la quête de nouvelles perspectives économiques, par la recherche de conditions de sureté et de sécurité, y compris face aux difficultés environnementales. Pourtant, la migration peut améliorer les conditions de vie des Africains, mais ce potentiel reste largement inexploité. Alors que près de 15 % de la population mondiale de migrants provient d’Afrique subsaharienne, deux tiers de ces migrants restent sur le continent africain, dont la majorité restent principalement à l’intérieur de leur communautés économique régionales. Les pays d’Afrique accueillent également un quart des réfugiés du monde, venant principalement des pays voisins.
L’Afrique se trouve aujourd’hui à un tournant. L’explosion démographique de la jeunesse se produit sur fond de stagnation économique, de conflits et de changement climatique. D’ici à 2050, le continent pourrait compter 600 millions de travailleurs supplémentaires et englober un tiers de la jeunesse mondiale. Inversement, la population active des pays à revenu élevé et intermédiaire supérieur devrait baisser de 200 millions de personnes. Cette divergence démographique offre à l’Afrique une occasion unique d’améliorer ses systèmes de gestion de la migration. Exploiter le potentiel de la migration nécessite des politiques volontaristes pour relever les défis et maximiser les bénéfices de la migration pour les pays d’origine, les pays de destination ainsi que pour les migrants eux-mêmes. Investir dans les systèmes migratoires permet de mieux accompagner les migrants tout au long du cycle migratoire, en développant des compétences recherchées sur les marchés nationaux, régionaux et mondiaux, en préservant la dignité, et en assurant la sécurité dans les pays de transit et de destination. Augmenter le nombre de voies légales de migration est essentiel pour décourager les mouvements irréguliers et favoriser une migration sûre et ordonnée. Une gestion efficace de la migration suppose également de favoriser l’intégration dans les sociétés d’accueil et de faciliter les retours volontaires. Cela peut être réalisé au moyen d’instruments comme les accords bilatéraux sur les migrations de main-d’œuvre avec les pays de destination. En passant ces accords de manière collective, les pays pourraient renforcer leur pouvoir de négociation, améliorer les conditions des migrants et maximiser les bénéfices économiques de la migration. L’autonomisation et l’autosuffisance des réfugiés et des personnes déplacées nécessitent également une collaboration accrue entre les nations africaines.
« À contre-courant des idées reçues, et conformément à sa vocation de banque pour la reconstruction et le développement, la Banque Mondiale adopte une posture optimiste et plaide pour une migration-atout faisant l’objet d’une gestion stratégique conjointe par les pays de départ et par les pays d’accueil. Le jour n’est plus loin où l’Afrique proposera des contingents de travailleurs migrants qualifiés, acteurs du développement des pays d’origine et contributeurs importants de la croissance économique et de la stabilité du monde. »
—Tiébilé Dramé, ancien Ministre des Maliens de l’Extérieur
« Un examen avisé du potentiel inexploité de la migration africaine et des enjeux pour les politiques migratoires. »
—Christian Dustmann, Professeur d’économie à l’University College de Londres et Directeur de la Fondation ROCKWOOL Berlin (RFBerlin)
ISBN 978-1-4648-2209-4