




Pour ce numéro, nous sommes partis à la recherche d’hommes et de femmes de science personnellement concernées par leur objet d’étude. C’est le cas notamment d’une chercheuse en sciences de l’éducation qui a une histoire familiale algérienne: elle étudie le racisme anti-musulman qu’elle a elle-même vécu dans sa chair. Quatre autres scientifiques et elle évoquent ouvertement leur rapport à cette confluence, à partir de la page 16. Initialement, nous nous étions tournés vers d’autres personnes dont les travaux actuels portent sur des expériences difficiles de leur vie. Certaines réponses étaient pleines de reproches. En résumé: la rédaction d’Horizons serait implicitement partie du principe que la recherche est moins objective dans le Sud global. Celle-ci stigmatiserait des individus déjà discriminés par la société.
Parmi toutes nos demandes d’interview, une seule concernait une personne originaire du Sud global et qui y fait de la recherche – elle faisait dès lors office d’exception. L’hypothèse selon laquelle nous soupçonnions en particulier les scientifiques de cette région de partialité a donc rapidement été réfutée. En revanche, nous avons bel et bien présupposé que la question de la distanciation professionnelle et des partis pris inconscients occupe intensément quiconque étudie des groupes discriminés et en fait partie. Pour nous, il s’agit d’un atout. Les réactions le montrent: il faut éviter bien des pièges si l’on veut comprendre le vécu lié au sujet de recherche à l’aune de l’exigence d’objectivité. Cela commence par la notion d’implication, telle qu’expliquée par l’historien Tobias Urech en page 18. Et cela continue avec l’objectivité tant évoquée, mais plurielle, comme l’enseigne le philosophe Jan Sprenger en page 24.
Le public accorde d’ailleurs un crédit particulier aux recherches teintées d’une touche personnelle lorsqu’il approuve fondamentalement le sujet, comme on peut le lire en page 22. Il se méfie par contre davantage lorsque les résultats diffèrent de ses propres convictions. En bref: nos propres partis pris influencent notre jugement sur la recherche. Quoi qu’il en soit, une compétence clé de la science contribue heureusement à en venir à bout: la réflexion transparente.

4 En image
Témoin géant du passé
6 Nouvelles de politique scientifique
De l’importance de Wikipédia, d’un magazine radio et de la fuite des cerveaux aux Etats-Unis
10 Actualités de la recherche
Perles de verre à prix d’or, explosion révèlant le cœur d’une comète, parents transmetteurs d’esprit d’initiative
13 Comment ça marche?
Endométriose atténuée en douceur
32 Reportage
Le jeu feuille-cailloux-ciseaux révèle la pensée sociale

36 Fossile contre électrique
La course de l’essence et du diesel à travers les décennies
38 Avis d’experte sur la situation aux USA Claudia Brühwiler explique l’hostilité de Donald Trump envers la science
40 Sur le marché du désir d’enfant Qui correspond à la norme peut avoir des bébés
42 A propos d’ancêtres unicellulaires Les archées d’Asgard bousculent l’histoire de l’évolution
43 Matériau pour la biodiversité Des trous dans le béton réduisent le bruit urbain et attirent de petits animaux
44 Echec d’une étude à cause de l’embargo En Iran, la recherche sur l’effet des édulcorants ne fonctionne pas
Dossier: Recherche et implication personnelle
16 Cinq témoignages
Récits de scientifiques qui étudient leur propre vécu
21 Tournant subjectif
Les études de genre ont rendu la dimension personnelle acceptable
24 A propos de toutes les objectivités
Entretien sur les pièges de l’acquisition impartiale de connaissances
28 Et les méthodes ont pris corps
De l’acquisition d’un savoir fiable aux possibilités de vérifications
A gauche: Qu’est-ce qui n’appartient qu’à moi? Que puis-je vraiment percevoir de façon objective?
En couverture: des fragments d’identité s’immiscent aussi dans la recherche. Photos: Angelika Annen
46 Portrait
Comment l’étudiante
Margot Romelli est devenue cheffe d’expédition

48 Les pages des éditeurs
50 Vos réactions/ Impressum
51 Débat
Faut-il davantage de règles pour la recherche sur les virus dangereux en laboratoire?
Face à cette structure à la fois futuriste et marquée par le temps, une certaine désorientation. A y regarder de plus près, on discerne du béton, mais comme repeint par les herbes et des graffitis. Deux personnes, toutes petites, en haut à droite dans l’image, révèlent la taille de la construction: large et haute. Il s’agit d’une tour de refroidissement d’une ancienne centrale thermique quasi centenaire de Charleroi, en Belgique.
Cette vue d’en haut a été soumise au concours FNS d’images scientifiques 2025. Son auteure, la géographe Aude Le Gallou, consacre depuis bientôt dix ans ses recherches aux lieux abandonnés en Europe et aux EtatsUnis, et à leur réappropriation par des touristes d’un autre genre: les adeptes d’urbex, ou l’exploration urbaine de ces zones en friche et souvent oubliées. «En interrogeant des urbexeurs pour mon travail, je me suis aperçue que ces ruines leur offraient des expériences sensorielles et émotionnelles très fortes. Grâce à sa popularisation sur les réseaux sociaux, cette fascination donne à ces vestiges une visibilité nouvelle et met en lumière des espaces par ailleurs délaissés et marginalisés.»
Aude Le Gallou, enseignante et chercheuse à l’Université de Genève, a élargi son champ scientifique pour s’intéresser au concept de fantôme. «Ces endroits manifestent un enchevêtrement des temps. On y trouve la trace d’un passé qui n’existe plus que sous forme de fragments, qui continuent néanmoins de hanter les sociétés actuelles», résume-t-elle.
Ces espaces déchus, qui sont aussi devenus des havres de biodiversité, posent des questions difficiles. Faut-il les préserver intouchés, comme des témoins géants, pour le plaisir des voyageurs et des scientifiques? Ou les transformer, voire les raser pour créer une nouvelle strate historique ou la prochaine aventure industrielle? «S’il n’y a pas de réponse absolue, il s’agit parfois de lieux de mémoire collective importants que les projets futurs ne doivent pas ignorer.»
Christophe Giovannini (texte), Aude Le Gallou (image)


«Il n’y a guère plus de lieux tel Wikipédia, où l’échange d’informations est possible au-delà des frontières partisanes.»

Pendant des années, la physicienne Jess Wade (GB) a publié un article par jour sur une chercheuse des disciplines STEM sur Wikipédia. L’encyclopédie en ligne permet à tous de consulter et d’ajouter du contenu librement Dans Nature, Jess Wade compare les pages de discussion de Wikipédia, où les membres de la rédaction débattent librement, à la révision scientifique par les pairs. Elle souligne que les articles consacrés aux femmes présentent de grandes lacunes. jho

En 2008 déjà, les robots de laboratoire Adam et Eve testaient de nouvelles substances actives dans des cellules de levure, évaluaient les résultats et décidaient seuls quelle substance tester ensuite. Google veut franchir un nouveau cap et générer des hypothèses pour toutes sortes de questions scientifiques. L’entreprise a annoncé Co-scientist, son nouveau système d’IA correspondant, au printemps 2025.
Elle a éprouvé son concept sur une vieille question de recherche sur les virus qui infectent les bactéries. La plupart des virus possèdent une queue qui injecte leur ADN. Or, certains qui en sont dépourvus y parviennent aussi. On ignorait comment jusqu’à récemment.
quels nous sommes arrivés après des années.» Co-scientist ne pouvait pas connaître ces résultats, gardés confidentiels jusqu’à la publication en raison d’une demande de brevet.
«L'hypothèse principale reflétait exactement nos résultats.»
Tiago Dias da Costa de l’Imperial College London a résolu le mystère – les virus utilisent les queues d’autres virus – peu avant que Co-scientist ne soit chargé de le faire. Le chercheur a partagé son enthousiasme pour le travail de l’IA à la BBC: «Nous avons été très surpris, car l’hypothèse principale correspondait aux résultats aux-
vous informe quatre fois par an sur le monde suisse de la recherche scientifique. Abonnez-vous ou offrez un abonnement à vos amis et à vos amies – c’est gratuit.
Le nouveau système d'IA repose sur l’interaction de plusieurs modèles linguistiques, spécialisés dans diverses tâches comme la génération et l’évaluation d’idées ou l’établissement de classements. Les modèles n’avaient reçu que la question de recherche de Tiago Dias da Costa, avec son introduction et sa liste de références. Maria Liakata, professeure en traitement du langage naturel à l’Université Queen Mary de Londres, dit ne pas être surprise que l’IA parvienne à combiner des informations déjà connues pour en créer de nouvelles. Elle a néanmoins appelé à la retenue. L’étude de Google serait plutôt destinée à faire sensation, contenant peu d’informations techniques. «Vu que le système est aussi gourmand en ressources, les scientifiques devront collaborer avec Google afin de pouvoir l’utiliser.» ff
Pour vous abonner à l’édition papier, c’est ici: revue-horizons.ch/abo

Point de vue
L’émission «Wissenschaftsmagazin» de la radio publique alémanique SRF 2 sera supprimée fin 2025. Début février, l’annonce a mené à deux pétitions, dont une colancée par Otfried Jarren, professeur émérite en sciences de la communication (UZH) et ex-président de la Commission fédérale des médias.
Otfried Jarren, pourquoi vous battez-vous pour l’émission scientifique phare de la SRF?
Une case horaire consacrée à la science va disparaître. Cela comporte le risque d’une réduction des ressources. La structure de la rédaction scientifique ne doit pas en souffrir, ni la qualité de l’offre.
Vaut-il la peine de se battre pour un format en perte d’audience?
C’est en effet ambivalent. Comme le dit à raison la SSR, l’engagement à la radio se fait à travers la musique. Les auditeurs changent de chaîne lors de longs passages parlés. Et c’est vrai que la science n’est pas un sujet facile. Toutefois, lorsqu’un format disparaît, on ne sait plus où trouver des informations sur la science et la communauté se réduit. Cela ne doit pas arriver.
Vous avez discuté avec Nathalie Wappler, directrice de la SRF, au sein du comité de pétition. Qu’en est-il ressorti?
Je dois reconnaître que la SRF a une grande sensibilité pour les thèmes scientifiques. Les

«La SSR devrait collaborer davantage avec les institutions scientifiques», dit Otfried Jarren de l’Université de Zurich. Photo: Christian Beutler / Keystone
compétences spécialisées doivent être maintenues et regroupées et les produits diffusés dans de nombreux formats. C’est compréhensible du point de vue de la direction, mais risque de nuire à la spécialisation et à la diversité des thèmes. Il devient plus difficile pour

les journalistes de choisir elles-mêmes les sujets. En tant que fournisseuses de contenu, elles devront davantage réagir à l’actualité. Or, c’est insuffisant pour assurer une bonne couverture de l’actualité scientifique.
Les rédactions scientifiques sont de plus en plus rares et petites. Comment la SSR peut-elle maintenir la qualité? La SSR devrait collaborer davantage avec les institutions de recherche, les hautes écoles, le FNS, les académies. Elle pourrait mettre en place une communauté de scientifiques pour être informée tôt de projets innovants et recevoir des suggestions de sujets. Elle pourrait tester de nouveaux formats.
Les institutions de recherche devraientelles financer une fondation pour sauver le journalisme scientifique suisse? L’idée, ancienne, n’est pas mauvaise en soi. Or, même les produits soutenus par une telle fondation doivent pouvoir être publiés. Si cela fonctionnait pour la Wochenzeitung, la NZZ suivrait-elle? La science occupe toujours moins de place dans la presse. Et pourquoi une fondation, de plus alimentée par de l’argent public, devrait-elle financer, voire subventionner des éditeurs? Les contenus payés par des fondations seraient-ils perçus comme une prestation journalistique indépendante? Il faut rappeler ses obligations à la SSR et la soutenir dans son rôle de service public. Florian Fisch
Dans la revue Nature, Eric Reinhart, chercheur indépendant à Chicago, a vivement contesté l’opinion selon laquelle les scientifiques devraient être politiquement neutres. Au vu de l’espérance de vie moyenne très faible aux Etats-Unis et des dépenses de santé par habitant de loin les plus élevées au monde, les spécialistes en santé du pays ne devraient pas rester indifférents à la pauvreté et aux lacunes du système social. Pour le psychanalyste clinicien, leur critique justifiée des coupes sombres de Donald Trump semble désormais partisane, car ils ont manqué de mettre Joe Biden face à ses responsabilités. «Une médecine qui se concentre sur le traitement des maladies plutôt que sur leur prévention par des politiques publiques se plaint maintenant d’une ingérence supposée de la politique dans la santé.» ff
«Les universités américaines et leurs scientifiques sont les principales victimes de l’ingérence politique et idéologique», explique Jan Danckaert, recteur de la Vrije Universiteit Brussel, dans The Guardian britannique. Son université a donc créé douze postes pour les postdocs internationaux. «Nous considérons de notre devoir d’aider nos collègues américains.»
Yasmine Belkaid, directrice générale de l’Institut Pasteur à Paris, l’exprime de façon plus pragmatique. Elle reçoit au quotidien des demandes de personnes – de France, d’Europe, voire des Etats-Unis – qui veulent rentrer. «On pourrait parler de triste opportunité, c’est néanmoins une opportunité.» La ruée sur les élites de la science américaine est lancée, clament des voix de la politique. Les Pays-Bas veulent ainsi saisir l’occasion par un fonds pour les scientifiques internationaux. La demande mondiale de personnes de haut niveau est forte, note le ministre de l’Education, Eppo
Bruins: «Simultanément, le climat géopolitique change, ce qui accroît la mobilité des scientifiques.» Divers pays d’Europe s’efforcent désormais d’attirer des talents du monde entier. «Les Pays-Bas doivent continuer à jouer un rôle de pionnier dans ce domaine.»
L’Allemagne abonde dans ce sens, selon le Tagesspiegel: Ulrike Malmendier, conseillère politique, parle d’opportunité énorme. «Les Etats-Unis constituent un nouveau vivier de talents pour nous», dit Patrick Cramer, président de la Max-Planck-Gesellschaft. Dans cette atmosphère de ruée vers l’or, Jan-Martin Wiarda, auteur de l’article du Tagesspiegel, avertit toutefois: «Le débat de politique scientifique devrait se concentrer sur la façon d’aider les nombreux scientifiques qui souhaitent rester aux Etats-Unis. Une fois qu’ils seront partis, la lutte pour la démocratie et la liberté de la science deviendra plus vaine encore.» jho
scientifique et le journaliste
Cette étonnante découverte approfondira nos connaissances de l’ADN des dinosaures. alors, Jurassic Park devient une réalité ?
Non !
Hébergeur à but non lucratif pour les prépublications
Les archives gratuites de prépublications Biorxiv et Medrxiv sont réorganisées, annonce Science. Créées en 2013 et 2019, elles ont depuis publié ensemble plus de preprints que n’importe quelle autre archive de biologie. Le trafic de données a fait un bond durant la pandémie de covid, car les scientifiques ont soudainement déposé pléthore de manuscrits, pour notamment accélérer les traitements médicaux. Après un net recul post-pandémique, les chiffres sont presque revenus au même niveau en 2024. L’organisation à but non lucratif Openrxiv va prendre le relais de l’ancien exploitant des plateformes, Cold Spring Harbor Laboratory. Selon John Inglis, cofondateur des sites Internet, ce transfert vise à garantir l’indépendance: «Il s’agit de contribuer à améliorer les possibilités technologiques et les interfaces utilisateurs ainsi que la collecte de fonds et le marketing.» jho

Vous voulez dire « peut-être » ?
Je veux dire « non ».
J’ai une super idée de gros titre avec Jurassic Park...
Ce
n’est que de la fiction. Ça n’arrivera pas. Ouais.
Vous allez quand même faire cette une, n’est-ce pas ? Oui !
L’opinion de la relève

Dans ma recherche, nous développons des outils d’intelligence artificielle et d’imagerie de cellules et de tissus pour améliorer le diagnostic des tumeurs. Ce secteur exige une expertise hautement spécialisée et rare. En tant que scientifique venant du Liban, un pays étranger non membre de l’UE et l’AELE (pays tiers), travailler en Suisse est une opportunité précieuse, mais semée d’embûches, même après un parcours académique dans une institution fédérale. Mon permis de travail est lié à mon employeur, rendant chaque transition professionnelle incertaine. Au-delà des qualifications requises, il faut naviguer à travers une bureaucratie complexe qui fait de chaque évolution de carrière un véritable défi.
Si les instituts de recherche recrutent plus volontiers des scientifiques de pays tiers, les hôpitaux, pourtant à la pointe de la recherche et de la médecine de précision, hésitent à s’engager dans ces démarches. Pour l’employeur, prouver qu’aucun candidat suisse ou européen ne peut occuper le poste est un processus long et dissuasif. Au-delà des barrières formelles, être une chercheuse de pays tiers en Suisse signifie aussi évoluer sous une pression constante liée à ce statut. La précarité administrative s’accompagne d’un sentiment latent de discrimination, renforcé par l’attitude de certains services RH et administratifs. On nous rappelle trop souvent que notre situation représente un «effort supplémentaire» pour l’institution, comme si notre présence relevait d’une faveur plutôt que de notre contribution légitime.
Les restrictions en Suisse pour les chercheuses et chercheurs issus de pays tiers empêchent le marché du travail de les orienter vers les entreprises qui ont besoin de leurs compétences. Et génèrent une inégalité dans les chances d’évolution. Face à ces obstacles, plusieurs de mes anciens collègues ont renoncé à poursuivre leur carrière ici, malgré des opportunités scientifiques. Ainsi, ces régulations inadaptées aux besoins réels du secteur limitent la diversité, freinent l’innovation et compliquent l’intégration des avancées technologiques en milieu hospitalier. Si la Suisse veut rester un pôle d’excellence compétitif, elle doit assouplir les critères d’embauche pour les scientifiques de pays tiers.
Rita Sarkis travaille en pathologie digitale et transcriptomique spatiale à l’Institut universitaire de pathologie du CHUV. Elle a présidé l'ELSA de l’EPFL jusqu'en 2023.
Le chiffre
des articles médicaux contiennent des découvertes sur une autre catégorie de maladies que celle envisagée au départ L’étude sur les découvertes inattendues publiée dans Research Policy a comparé les catégories de plus de 1,2 million d’articles avec plus de 90 000 demandes de financement qui ont été soumises aux National Institutes of Health US entre 2008 et 2016. En recherche appliquée, il y a eu un peu moins de résultats imprévus qu’en recherche fondamentale, mais davantage dans les appels à projets sur des thèmes spécifiques que dans les appels ouverts. ff
Le concept
Qui était jeune en Suisse dans les années 1990 pense au Platzspitz à Zurich et aux héroïnomanes quand on évoque les drogues. Pourtant, selon l’OMS, ce mot désigne simplement toute «substance capable de perturber le fonctionnement d’un organisme vivant et qui n’est pas un aliment». Dans le langage courant, il renvoie plutôt aux agents «provoquant un état d’ivresse», écrit le Bundestag allemand. Le concept se circonscrit souvent autour des substances illégales, alcool et nicotine exceptés.
Des substances psychoactives telles que la psilocybine, la MDMA et le LSD en font partie. Elles faisaient l’objet d'environ 60 études cliniques dans le monde en 2023, comme l’écrivait le Bulletin des médecins suisses. Elles portaient notamment sur le traitement de dépressions et des troubles de stress post-traumatique. La Suisse joue un rôle important sur ce plan, notamment à cause de sa politique pragmatique en matière de drogues. Depuis 2007, on y mène des recherches sur des substances illicites Depuis 2014, des applications médicales limitées sont admises. ll est peut-être temps d’abandonner le concept connoté de «drogue». jho
Les conditions extérieures déterminent souvent le comportement d’un animal dans une situation donnée: dans quel état se trouve un individu? Son comportement est-il influencé par ses congénères? Tom Ratz, biologiste de l’évolution à l’Université de Zurich, a étudié l’impact de tels facteurs sociaux et environnementaux sur le comportement de veuves noires. Bien que venimeuses, ces araignées originaires d’Amérique du Nord ne sont pas aggressives, selon le chercheur. On peut donc bien travailler avec elles.
Les femelles veuves noires tissent des toiles complexes: certains fils servent à la capture des proies, tandis que d’autres sécurisent la toile contre les prédateurs. Tom Ratz a laissé des veuves noires tisser leur toile chacune dans sa boîte, mais a donné deux fois moins à manger à la moitié d’entre elles. Le biologiste a comparé deux comportements chez les araignées affamées et celles bien nourries: leur agressivité face à une potentielle proie prise dans la toile et le nombre de fils protecteurs tissés. Le chercheur a également installé une rivale dans la boîte de certaines araignées de laboratoire.
Toutes les araignées, affamées ou non, ont tissé plus de fils protecteurs en présence d’une rivale. «La toile a une grande valeur pour l’araignée, note Tom Ratz. Elle doit la défendre, même physiquement affaiblie.» Il en va autrement dans le test de la proie: en présence d’une rivale, les spécimens bien nourris étaient plus agressifs face à un stimulus vibratoire imitant un insecte pris dans la toile. Les araignées mal nourries sont, elles, restées à l’écart. «Une veuve noire peut rester des mois sans manger, dit-il. Ne prendre aucun risque en présence d’une rivale pourrait s’avérer la meilleure option pour une araignée affaiblie.» Les divers comportements ont révélé des avantages au cours de l’évolution, note le chercheur. Des expériences telles que la sienne pourraient donc permettre de déterminer quel facteur de sélection évolutif –la compétition ou l’état nutritionnel – joue un rôle prépondérant. Simon Koechlin


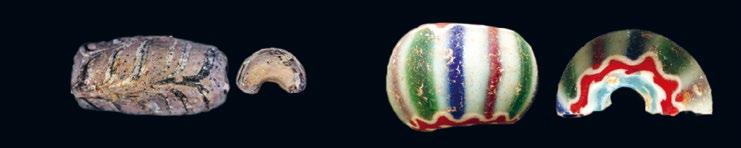
Les objets sont d’excellents conteurs d’histoire. Encore faut-il les faire parler. Dans le cadre de son doctorat réalisé à l’Université de Genève, Miriam Truffa Giachet a analysé près d’un millier de perles de verre collectées en Afrique de l’Ouest. Son étude éclaire d’un jour nouveau les liens commerciaux entre cette région et l’Europe à l’époque coloniale.
A partir du XVe siècle, début des grandes découvertes, les perles de verre sont «massivement» manufacturées sur le Vieux Continent, à Venise puis en Europe centrale et du Nord, explique Miriam Truffa Giachet. Ces biens sont exportés en Afrique de l’Ouest, où ils sont prisés, car le verre y est considéré comme une matière exotique de choix. Chaque type de perles (monochromes, striées, à ocelles, etc.) a sa valeur propre. «Certaines étaient échan-
gées contre de l’or et des peaux, d’autres contre des esclaves», illustre la chercheuse. Miriam Truffa Giachet s’est servie d’une technique à échantillonnage laser afin d’identifier les matières premières utilisées pour la fabrication du verre. Pour déterminer l’origine des perles, les résultats ont été croisés avec des données archéologiques et historiques, comme des catalogues avec des échantillons conçus par les fabricants. «La spécificité de l’étude tient au nombre élevé de perles examinées, à son caractère systématique», souligne la spécialiste. La base de données qu’elle a établie pourra servir à d’autres chercheuses et chercheurs. Benjamin Keller
M. Truffa Giachet et al.: The systematic techno-stylistic and chemical study of glass beads from post-15th century West African sites. Plos One (2025)

Une équipe de l’ETH Zurich a introduit dans les capillaires d’une oreille de souris ces micro-robots en forme de fleur, recouverts de nanoparticules de fer et de colorant fluorescent. Contrôlés magnétiquement, ils sont suivis par une combinaison de lumière et d’ultrasons. Cela permet de visualiser les vaisseaux en détail et, un jour, de diffuser précisément des médicaments, espère le premier auteur. yv
Manger plus sainement grâce à sa carte client
Présenter sa carte de fidélité en caisse lors de l’achat de produits alimentaires est courant en Suisse. Une application développée par des scientifiques de l’Université de Saint-Gall utilise les données recueillies sur la carte pour prodiguer des conseils nutritionnels personnalisés. La teneur en calories et la composition des aliments achetés y sont analysées. Un algorithme, élaboré en collaboration avec des nutritionnistes de l’Université et de l’Hôpital de l’Ile de Berne, soumet ensuite automatiquement des recommandations, comme de réduire la quantité de sucre dans les céréales. «Il suffit d’associer une fois la carte de fidélité et le reste se fait tout seul», explique la doctorante Jing Wu. Selon elle, c’est important, car d’autres apps nutritionnelles échouent en raison de l’obligation de consigner ses repas. Cette méthode est sujette aux erreurs, et les utilisatrices et utilisateurs abandonnent rapidement. Reste encore à résoudre un problème: l’application suppose que dans un ménage de plusieurs personnes, toutes mangent à peu près la même chose. yv
J. Wu et al.: FoodCoach: Fully Automated Diet Counseling.
Journal of Biomedical and Health Informatics (2025)



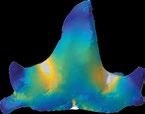




Le Ctenacanthus était un superprédateur des mers préhistoriques il y a 370 millions d’années. Ce grand requin ancestral saisissait sa proie et en arrachait de gros morceaux en secouant la tête, a révélé l’analyse mécanique d’une dent fossile soumise à une pression simulée (flèches): mordre (a) et secouer (b) ne sollicite la dent que localement. Tandis qu’en cas de saisie (c, d), la pression se répartit défavorablement. L’équipe de l’Université de Zurich en conclut donc que la proie n’était pas immobilisée et mâchée. yv
Des explosions dans des cavités souterraines livrent des informations sur la vie intérieure de comètes nées il y a des milliards d’années à l’extrémité du système solaire. «Ces capsules temporelles renferment des matériaux des débuts du système solaire et elles peuvent nous en apprendre beaucoup sur sa formation et son évolution», note Daniel Müller, chercheur dans le domaine spatial à l’Université de Berne. Or, l’intérieur des comètes reste majoritairement inaccessible lors d’observations par télescope ou sonde spatiale, qui permettent uniquement d’analyser la surface, la queue et la coma. Des explosions à la surface pourraient fournir des indices sur l’intérieur.
«Les comètes ressemblent donc plutôt à de l’emmental.»
«On en avait déjà observé sur certaines comètes, note le chercheur. Or, les données étaient jusqu’à présent trop imprécises pour comprendre ce qui se passe lors d’un tel phénomène.» La mission Rosetta a offert l’unique occasion d’étudier de près la surface explosive. Des caméras et des spectromètres de masse ont enregistré une trentaine d’éruptions pendant que la sonde spatiale accompagnait la comète 67P/Tschurjumow-Gerassimenko en 2025, lors de sa phase la plus proche du Soleil. «Nous avons pu mesurer les changements dans la composition de gaz dans la coma.» Ces événements étaient parfois dus à l’évaporation de glace, plus souvent au
dioxyde de carbone. «Il se pourrait que des cavités souterraines sous haute pression éclatent et projettent de la matière dans l’espace», dit-il. La taille potentielle des cavités sur 67P a été évaluée à 500 000 mètres cubes –environ un cinquième de la pyramide de Khéops. «Les comètes ressemblent donc plutôt à de l’emmental», dit le chercheur. Reste à comprendre comment se forment les trous. «Cela pourrait être lié aux fortes variations de température sous la surface.» On espère que des expériences en laboratoire et la mission Comet Interceptor de l’ESA, prévue en 2029, permettront d’en savoir plus. Florian Wüstholz
D. R. Müller et al.: Land of gas and dust – exploring bursting cavities on comet 67P. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (2025)
La clé égarée, la montre disparue: un test de démence validé par le Centre de la mémoire des Hôpitaux universitaires de Genève est très proche de la réalité du quotidien. Trois objets sont cachés à trois endroits différents sous les yeux d’une personne qui doit ensuite les nommer et les retrouver. L’étude a comparé les résultats des tests de plus de 2000 patientes et patients aux résultats d’examens neuropsychologiques et de scanners cérébraux diagnostiques. Le test détecte la démence avec une précision de plus de 90%. «Il se prête donc à un dépistage rapide, par exemple en télémédecine ou dans des régions à l’accès limité aux services spécialisés», note Federica Ribaldi, première auteure. Elle souligne l’importance du diagnostic précoce pour améliorer l’efficacité de la prévention. yv
F. Ribaldi et al.: Three-Objects-Three-Places Episodic Memory Test to Screen Mild Cognitive Impairment and Mild Dementia: Validation in a Memory Clinic Population. European Journal of Neurology (2025)

Une découverte fortuite dans la mer de Barents, au nord de la Norvège: des chercheurs ont repéré un volcan de boue qui crache de la boue, de l’eau et des gaz tel le méthane à 390 mètres de profondeur. Les couches de microbes qui s’y développent sont la base de nourriture d’une rare variété d’organismes, dont des poissons menacés. «Ce site mérite absolument d’être protégé», dit Inés Barrenechea Angeles, biologiste moléculaire soutenue par le FNS, qui a aidé à identifier des espèces d’organismes unicellulaires. Depuis, l’équipe a découvert d’autres de ces volcans dans la région. ff
G. Panieri et al.: Sanctuary for vulnerable Arctic species at the Borealis Mud Volcano. Nature Communications (2025)
En Suisse, le protège-dents est obligatoire pour la boxe et fortement conseillé pour de nombreux autres sports. Or, les produits standards sont inconfortables et le surmesure onéreux. Une variante développée à l’EPFL et au CHUV à Lausanne s’adapte parfaitement grâce à un scan et est peu coûteuse à produire en impression 3D. Elle se compose d’un plastique souple et d’un plastique dur: la partie avant, rigide, peut être changée selon la discipline et remplacée en cas de dommage. yv

N. Nasrollahzadeh et al.: A new approach to the design and fabrication of customized multi-material mouthguards to maximize athletes’ safety and comfort. Journal of Manufacturing Processes (2025)
Au travail, comment choisit-on d’être celui qui exécute des tâches ou celle qui s’organise par elle-même? Longtemps, on a supposé que c’étaient surtout les parents qui transmettaient ce type de comportement à leurs enfants. Une étude empirique longitudinale vient de le confirmer: les mères et pères qui aiment travailler en toute autonomie inculquent cela à leurs enfants, lesquels exercent généralement plus tard aussi des professions offrant un haut degré d’autodétermination.
A cet effet, plus de 1100 jeunes originaires des Etats-Unis et leurs parents ont été interviewés dès 1988 et durant plus de vingt ans au sujet de leur conception du travail. Les scientifiques ont constaté une nette corrélation entre les générations quant à l’importance de l’autonomie au travail. Elles ont recensé trois aspects du travail autonome ou autodirigé: la diversité des tâches, le degré de supervision par des supérieurs hiérarchiques et s’il s’agissait d’un travail plutôt routinier ou qui impliquait également des décisions propres.
L’étude s’est aussi penchée sur le comportement privilégié au sein de la famille: plutôt
conformiste ou autonome. «L’analyse des données a révélé que ces conceptions émanaient des parents», explique Kaspar Burger, sociologue de l’éducation à l’Université de Potsdam et à l’Université de Zurich. Pour que le travail autonome soit perçu comme positif, il est décisif que les parents incarnent certaines valeurs et attitudes à la maison, telles que l’indépendance, la prise de responsabilités et la flexibilité intellectuelle, souligne-t-il. Cela se produit généralement de manière subtile, dans le cadre d’un processus à long terme. Autre résultat: qui apprécie le travail autonome va plus loin dans ses études que celui qui est uniquement prêt à exécuter des tâches prédéfinies. Kaspar Burger présume qu’une posture autodirigée peut accroître la satisfaction au travail et se révéler bénéfique même en temps de crise: «Quiconque a appris à travailler en toute autonomie trouve plus facilement les moyens de progresser dans le monde professionnel.» Christoph Dieffenbacher
K. Burger et al.: The intergenerational reproduction of self-direction at work: Revisiting Class and Conformity. Social Forces (2025)
Comment ça marche?
Un anticorps aide à guérir le tissu muqueux enflammé en dehors de l’utérus: comment la start-up zurichoise Fimmcyte s’attaque aux lésions et aux cicatrices dues à l’endométriose.
Texte Judith Hochstrasser Illustration Ikonaut
1 — Maladie ancienne, approche nouvelle
Bien que citée dès 1900, le public ne connaît l’endométriose que depuis quelques années. On estime que 6 à 10% des femmes souffrent de cette maladie, dans laquelle des cellules de la muqueuse utérine (endomètre) se propagent aussi en dehors de l’utérus. Les femmes touchées ont souvent de fortes douleurs pendant la menstruation et risquent l’infertilité. Les traitements actuels, dont l’aspirine, des hormones ou l’ablation de l’utérus, n’agissent que momentanément ou sont très invasifs.
2 — Lésions dans tout l’abdomen Les cellules égarées de l’endomètre continuent à croître et provoquent des inflammations entraînant des lésions et des cicatrices persistantes des tissus dans toute la cavité abdomino-pelvienne, parfois jusqu’aux poumons.
3 — Tuer les cellules malades Fimmcyte, un spin-off de l’Université et de l’Hôpital universitaire de Zurich, développe un traitement de l’endométriose par immunothérapie. L’entreprise a identifié une protéine cible (A), présente uniquement sur certaines cellules du tissu lésé: les myofibroblastes (B), qui se forment lors de la cicatrisation. L’anticorps (C) correspondant à la protéine cible est injecté. Sur son chemin à travers les vaisseaux sanguins, il recrute des cellules immunitaires, les phagocytes (D) et les cellules tueuses (E), qui sont en nombre insuffisant dans les lésions de la cavité abdominale. L’anticorps y reconnaît les protéines cibles, les lie et se fixe aux récepteurs des deux types de cellules. Cela déclenche la mort cellulaire. Ainsi, les lésions et cicatrices sont atténuées, voire éliminées.
4 — Un traitement à répéter L’anticorps du spin-off est injecté sous la peau du haut du bras. Ces injections devraient être dispensées hebdomadairement durant six à huit semaines et faire disparaître les symptômes pendant environ un an. Le traitement devra ensuite probablement être répété.
Dans le miroir, son propre regard Comment mes expériences individuelles influencent-elles ma vision du monde?
Les scientifiques doivent analyser leur pensée de manière critique afin d’obtenir des résultats fiables. Pour notre galerie d’images, la photographe Angelika Annen a mis en scène l’équilibre entre introspection et confusion.
Photos: Angelika Annen

Sonder sa propre histoire ou sa maladie: cinq scientifiques racontent comment leur vécu personnel influence leur travail de recherche – ou justement pas.
Textes Martine Brocard et Katharina Rilling Photos Anoush Abrar
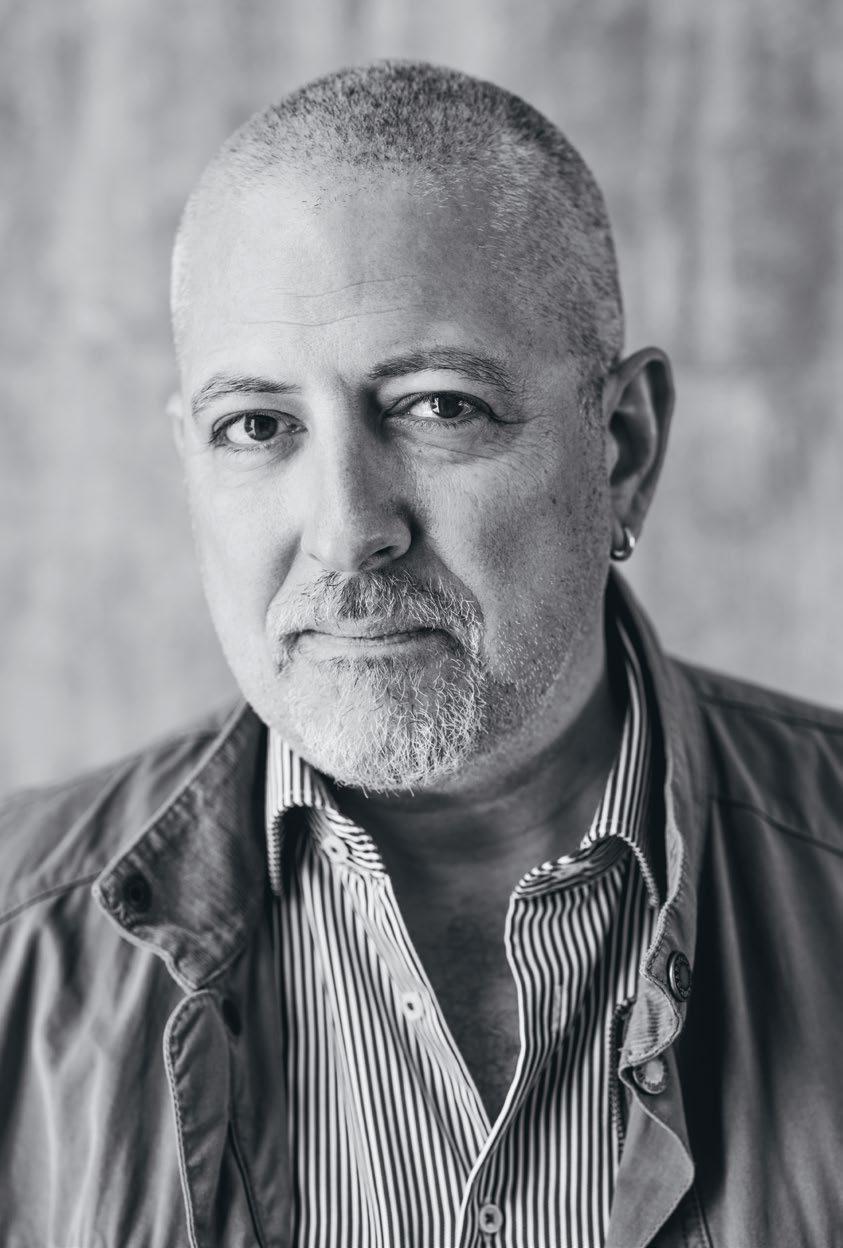
«Me joindre au gang était une stratégie de survie.»
Dennis Rodgers, ex-membre d’un gang au Nicaragua, étudie la violence à l’ IHEID à Genève.
«Je suis parti pour le Nicaragua en 1996 dans le cadre d’un doctorat en anthropologie sociale afin d’étudier les stratégies de survie solidaires des pauvres dans un contexte post-révolutionnaire. J’avais 23 ans. Arrivé à Managua, la capitale, j’ai subi deux chocs: premièrement, la révolution appartenait clairement au passé pour la majorité des gens, tout comme la solidarité. Deuxièmement, je me suis fait tabasser dans la rue par un gang, trois jours après mon atterrissage. C’était assez traumatisant. J’essayais de trouver un quartier pauvre où habiter. J’ai pris la mauvaise habitude de me faire passer à tabac par des gangs lors de mes tours en ville. Il s’agissait de gangs territoriaux qui protégeaient leur quartier et en interdisaient l’entrée aux étrangers. J’ai bien entendu voulu quitter le Nicaragua, mais je craignais que mon université considère que j’étais en échec. Je suis donc resté, mais aujourd’hui je dis à tous mes doctorants et doctorantes qu’il arrive de devoir changer de terrain et que la recherche est toujours quelque chose d’aléatoire. J’ai finalement pu m’établir dans un quartier pauvre, réputé pour son gang féroce. J’ai essayé de développer des relations amicales avec ses membres. Bien que mort de peur, je me suis assis dans la rue pour rencontrer des gens. Un membre du gang est venu me demander une cigarette. On a discuté. Le lendemain, il est revenu avec un groupe. Pendant deux semaines, j’ai eu des interactions plus ou moins anodines avec eux, puis ils ont commencé par me tester. Un jour, ils m’ont demandé de les aider à voler au marché. J’ai refusé. «Tu vas juste attirer l’attention du vendeur, c’est nous qui allons voler», ont-ils précisé. J’ai accepté. Ils ont volé huit culottes qu’ils m’ont chargé de revendre à des femmes du quartier. C’était un peu leur genre d’humour.
Une fois, j’ai dû me défendre quand un membre du gang m’a menacé avec un couteau. Ils ont alors déclaré que j’étais un des leurs et
m’ont proposé de les rejoindre. J’ai accepté. C’était une stratégie de survie, pas une stratégie de recherche.
J’ai demandé un statut de membre observateur et annoncé que je ne voulais ni utiliser d’arme à feu, ni attaquer d’autres quartiers, ni tabasser des gens. En revanche, je me suis défendu et j’ai protégé les gens de mon quartier lors d’attaques de gangs rivaux. Appartenir au gang m’a toujours plongé dans un dilemme éthique. J’ai fait des choses dont je ne suis pas très fier et j’ai vu des choses illégales. Mais je peux toujours me regarder dans un miroir. Cela m’a appris que l’éthique dépend souvent beaucoup de la situation, mais qu’il est important de s’en tenir à certains principes fondamentaux.
J’ai dû développer des techniques pour protéger l’identité de mes interlocuteurs, que j’utilise encore aujourd’hui. Je m’assure que mes notes de terrain sont inutilisables pour d’autres que moi, au cas où elles seraient réquisitionnées par la police, par exemple. Je change les noms, je mélange français, anglais et espagnol et j’utilise des codes. Il y a aussi des choses que je ne note pas, ce qui limite mes recherches, mais ma première responsabilité est envers ceux qui m’ont ouvert leur vie sans demander de contrepartie. Après avoir trouvé ma place, j’ai pu suivre l’évolution du gang. Les nouveaux arrivants sont toujours prêts à me parler en tant que «vieux de la vieille». Cette possibilité de mener de la recherche longitudinale m’a permis de comprendre à quel point les gangs pouvaient être un prisme à travers lequel il est possible de comprendre l’évolution de la société nicaraguayenne. Cela m’a aussi poussé à développer de la recherche comparative. Mon expérience m’a été très utile et m’a offert une base à partir de laquelle poser des questions d’un point de vue «différent» lors de mes recherches actuelles sur les gangs à Marseille. Elle m’a également permis de développer des interprétations alternatives à celles, souvent très sensationnalistes, qui prédominent.» mb

«Je l’ai découvert uniquement grâce à mes propres échantillons de sang.»
Jasmin Barman-Aksözen souffre de protoporphyrie érythropoïétique (PPE). A l’Université de Zurich, elle mène des recherches sur les traitements possibles.
«La probabilité de naître avec une PPE est aussi faible que cela: 1 sur 100 000. En Suisse, seules quelque 70 personnes souffrent de ce trouble métabolique. J’en suis atteinte et c’est mon domaine de recherche. Sans médicament, je suis extrêmement sensible à la lumière. Depuis l’enfance, chaque rayon de soleil, chaque reflet sur l’eau, voire certaines lampes déclenchent de fortes douleurs – comme si mes veines brûlaient de l’intérieur. Aujourd’hui, je le sais: des produits métaboliques s’accumulent dans mes veines, réagissent à la lumière et provoquent des brûlures de la peau au deuxième degré. Comme cela ne se voit pas, la maladie a mis du temps à être détectée. Jusqu’à l’âge de 27 ans, j’ignorais ce dont je souffrais. Que j’aie étudié la biologie n’avait rien à voir avec ma maladie. Je m’étais d’abord intéressée à la génétique des plantes. J’avais renoncé à trouver une réponse à mes douleurs. Ce n’est qu’en fin d’études que j’ai rencontré une autre personne concernée qui décrivait exactement ma vie. L’illumination! Elle m’a invitée à un symposium scientifique où j’ai rencontré ma future directrice de thèse et je me suis lancée dans la recherche sur la PPE. D’abord, j’ai craint que cela me touche de trop près. Mais ce que je fais est très abstrait. Je travaille dans un laboratoire, sur des cultures cellulaires. Etre concerné amène peut-être aussi à approfondir encore davantage le sujet. De plus, en tant que patiente et représentante des patients atteints de maladies rares, je dispose d’un bon réseau et recueille d’importantes informations sur les données. C’est ainsi que j’ai découvert un facteur primordial dans le métabolisme du fer dans la PPE. Cela uniquement parce que j’ai prélevé des échantillons de mon propre sang alors que j’étais sous traitement à base de fer et que j’ai pu les contrôler de très près. De plus, d’autres patients avaient remarqué des détériorations dues au fer. Beaucoup de médecins sont passés à côté. Waouh!! On se réjouit encore plus quand on est touché. Mon implication personnelle n’est pas source de conflit: finalement c’est moi, en tant que patiente, qui ai le plus grand intérêt à ce que les données soient objectives. kr
Tobias Urech est homosexuel et mène des recherches en histoire du genre à l’Université de Bâle.
«Je suis gay et mène des recherches sur des thèmes tels que l’histoire queer, l’histoire de la sexualité et l’histoire du genre. L’expression «implication personnelle dans la recherche» me paraît un peu inappropriée. Mon homosexualité ne m’affecte pas négativement. J’ai bien sûr un rapport personnel à mon champ d’études et il imprègne mon travail. Cette proximité me semble très positive. Je m’intéresse actuellement à l’amitié comme espace des possibles pour le désir homoérotique au XXe siècle. J’étudie quatre couples d’amis et d’amies et utilise des sources telles que des lettres, des journaux intimes ou des autobiographies. Un exemple: deux femmes, mariées à des hommes, sont tombées amoureuses l’une de l’autre dans les années 1930. Elles ont pu vivre leur histoire d’amour sous forme de relation amicale sans être sanctionnées par la société. Dans la sexologie des années 1900, je trouve parfois des affirmations qui paraissent étranges aujourd’hui. Je suis alors plus fasciné qu’affecté personnellement. Je m’intéresse aux mentalités qui se cachent derrière ce type de déclarations. Ma directrice de thèse a dit un jour que, dans ce type de situations, elle se sentait telle une botaniste étonnée d’avoir découvert une plante si particulière.
Je me produis aussi comme drag-queen Mona Gamie et intègre des histoires, chansons et anecdotes de mes recherches dans mon spectacle. C’est une forme de militantisme queer. J’ai aussi été membre de la Milchjugend (organisation de jeunesse LGBTIQ*, ndlr) et étais engagé dans la politique de parti. Aujourd’hui, je me concentre sur la science et partage l’avis de Virginia Woolf: «Thinking is my Fighting.» Adopter une démarche de recherche honnête est important, mais croire que la science est fondamentalement neutre et objective est illusoire. Tout le monde est imprégné par ses représentations. J’affiche donc mon rapport personnel avec mon champ d’études sur le site Internet de l’université. Je veux souligner ainsi que quiconque fait de la recherche est aussi une personne privée – c’est indissociable.» kr


«Je peux plus facilement faire face à des situations de racisme.»
«Je suis plus fasciné qu’affecté à titre
personnel.»
Asmaa Dehbi a une histoire familiale algérienne et fait de la recherche sur le racisme anti-musulman à l’Université de Fribourg.
«Je me suis intéressée au racisme anti-musulman pour mieux comprendre comment, après le 11 septembre 2001 et l’initiative anti-minarets en Suisse, le mot «migration» a été associé à «islam», et que «l’Autre» est devenu «le musulman». En grandissant en Suisse, avec une histoire migratoire algérienne, j’ai personnellement vécu cette transition. Je n’ai plus été perçue principalement comme «Arabe», mais comme musulmane, indépendamment du fait que je sois pratiquante ou non. J’ai aussi subi ce racisme, par exemple plus jeune, quand les adultes me demandaient constamment si j’allais devoir porter le voile ou si je me distanciais des événements violents à l’étranger. Etre ainsi marginalisée et réduite à mon identité religieuse m’attristait et me fâchait. Ma réaction a été d’aller dans le monde académique. Je savais qu’en tant que femme perçue comme musulmane, j’allais devoir en faire plus pour être considérée comme une experte. La position d’«outsider within» m’a permis de remettre en question les normalités appa-

rentes et elle m’a fait prendre conscience du manque de représentation des musulmanes et musulmans dans la science. J’adhère à la théorie du point de vue féministe qui valorise l’implication personnelle dans la recherche et argumente que tout savoir se situe dans un contexte, et que tout le monde a des biais, même et surtout les personnes non marginalisées croyant penser de manière objective. Il s’agit alors de rendre son positionnement transparent et d’y réfléchir de manière critique.
Comme je travaille sur la discrimination, il est essentiel de la réduire autant que possible dans ma recherche. Mon travail ne doit pas être dirigé contre d’autres groupes marginalisés et j’essaie d’être consciente des risques d’essentialiser et d’absolutiser l’identité.
Ma recherche impacte ma vie. Je commence à détecter le racisme partout, ce qui me fatigue parfois, mais je peux aussi plus facilement affronter de telles situations car je me pose en tant qu’observatrice et les convertis en matière première sur laquelle travailler. Pouvoir reconnaître le racisme anti-musulman, l’analyser et le critiquer nous rend plus fortes et forts et nous fournit des données susceptibles de faire changer les choses.» mb
Nathalie Herren souffre d’épisodes dépressifs et mène des recherches sur les conséquences politiques de la dépression à l’Université de Berne.
«Je fais de la recherche en psychologie politique et souffre de phases dépressives. Je suis incapable de travailler durant les épisodes aigus – cela arrive toutefois rarement désormais. Actuellement, mon état est relativement stable, bien contrôlé sur le plan médicamenteux et je bénéficie d’un accompagnement thérapeutique. Mes recherches m’ont appris que les facteurs psychologiques influencent notre façon de penser et d’agir politiquement. Nous étudions actuellement les conséquences politiques des symptômes dépressifs. Le stress psychologique est toujours plus fréquent. Il faudrait donc en apprendre plus sur son rôle dans notre démocratie. Les travaux existants montrent que les personnes présentant des symptômes dépressifs participent plus rarement à la vie politique. Nos premières analyses indiquent qu’elles tendent plus à soutenir des idées et des partis populistes. Je ne vote pas pendant mes épisodes dépressifs graves. Je n’en ai pas la force. Je n’observe toutefois aucun penchant au populisme chez moi. Cela me montre que nous n’étudions pas de relations déterministes. J’évoque ouvertement ma maladie avec mes collègues et mes étudiantes et étudiants, ce que beaucoup apprécient. Or, je remarque que de nombreuses personnes se sentent encore un peu gênées d’en parler – souvent par peur de dire un mot de travers. Ma franchise contribue à lever le tabou sur les problèmes psychiques et me permet de faire activement profiter la recherche de ma perspective. Je suis par exemple particulièrement sensibilisée à la nécessité de prévenir toute utilisation abusive ou interprétation erronée de nos résultats. J’estime important de ne pas stigmatiser encore davantage des groupes déjà vulnérables. Nous ne voulons pas servir des récits qui présentent les personnes psychologiquement fragilisées comme dangereuses ou antidémocratiques en soi. Chaque individu apporte bien entendu ses empreintes et préjugés. Cela ne devient problématique que lorsque l’on n’en a pas conscience et que l’on ne se confronte pas à d’autres perspectives.» kr

«Nous ne voulons pas présenter les groupes vulnérables comme antidémocratiques.»

Les féministes ont réussi à faire accepter l’implication personnelle dans la recherche. Aujourd’hui, celle-ci est admise lorsqu’elle est rendue transparente et analysée. Le pour et le contre de cette approche.
Texte Santina Russo
Depuis quelques années, l’implication personnelle est acceptée dans la recherche. L’anthropologue Brigitte Boenisch-Brednich parle d’un «tournant subjectif»: «Cela a commencé avec le féminisme des années 1970 et 1980. Le privé est alors devenu politique et on a commencé à prendre au sérieux le vécu des gens ordinaires, explique la spécialiste des méthodes de recherche en ethnographie à l’Université Victoria de Wellington (NZ). Cela a eu pour conséquence que la science accepte également la recherche motivée par des raisons personnelles.» En sciences sociales et humaines ainsi qu’en médecine, bon nombre de scientifiques sont directement concernés par l’objet de leurs travaux de recherche.
«Une implication personnelle peut mener à des gains de connaissance précieux, pour autant qu’elle soit reconnue et analysée», indique la chercheuse. Son groupe comprend des gens menant des recherches dont l’objet est clairement issu de leur propre vécu. La chercheuse d’origine afghane Naz Karim étudie ainsi les violences faites aux femmes par les talibans, des années après en avoir subi elle-même. En Afghanistan, elle a mené des entretiens avec ces femmes. Etablir un contact et gagner leur confiance était naturellement plus facile pour elle: de nombreuses Afghanes n’auraient pas parlé à un homme occidental, ou n’y auraient pas été autorisées.
Accès à un savoir intime
Dans le cadre de ses recherches, Naz Karim analyse ses propres réactions, telles que le retour de cauchemars angoissants, liés à son passé. Son expérience l’a aussi aidée à identifier des éléments culturels communs: les femmes interviewées sont nombreuses à décrire leurs états anxieux comme un esprit qui s’empare d’elles et se pose sur leur poitrine.
Dans un autre projet du groupe de recherche de Brigitte Boenisch-Brednich, on utilise plus directement encore l’histoire personnelle: une chercheuse souffrant de boulimie y effectue une introspection intime pour analyser les stratégies qu’elle emploie afin de dissimuler sa maladie. Dont la préparation minutieuse de ses rendez-vous médicaux, les mensonges qu’elle invente ou encore les drogues et médicaments qu’elle prend pour arriver à tenir le coup. «Elle complète ainsi l’état des connaissances
actuelles avec toutes ces astuces et manipulations utilisées par des personnes boulimiques envers elles-mêmes ainsi que leur entourage», souligne Brigitte Boenisch-Brednich. Des informations utiles pour les thérapeutes et qui n’auraient pu émerger sans analyse personnelle.
L’auto-ethnographie est la méthode employée par les scientifiques pour décrire et analyser leurs propres perspectives et expériences. Elle a été développée spécialement pour les thèmes avec lesquels ils ont une relation directe. Les textes auto-ethnographiques ne ressemblent pas à des publications scientifiques classiques. Ils sont narratifs et écrits à la première personne. Dans les travaux de qualité, les expériences personnelles sont reliées au contexte culturel, social ou politique, afin de générer de nouvelles connaissances.
Le criminologue Ahmed Ajil recourt lui aussi à l’autoethnographie, en complément à ses études quantitatives et qualitatives. Il mène notamment des recherches sur le terrorisme ou – comme il le nuance lui-même – sur la violence à motivation politico-idéologique. Cela, aux universités de Lucerne et de Lausanne. Il s’intéresse à la manière dont sont mobilisés les membres d’organisations terroristes et a mené des entretiens avec des hommes condamnés pour des délits terroristes en Suisse ainsi qu’avec des membres d’organisations violentes au Liban. Le scientifique est lui-même de religion musulmane et de langue maternelle arabe. A l’aide de l’auto-ethnographie et de la comparaison avec des collègues de religion chrétienne occidentale, il a analysé quelle influence sa proximité linguistique et culturelle avec les interviewés avait sur sa recherche.
Sa conclusion: cette proximité lui permet en partie d’instaurer un climat de confiance et de mieux comprendre les nuances dans les propos recueillis. Ses origines ont parfois joué un rôle décisif pour qu’un entretien puisse avoir lieu, mais il s’est rendu compte qu’elles pouvaient aussi lui porter préjudice. Par exemple, lorsque son interlocuteur part du principe qu’il comprend certaines choses sans qu’elles doivent être formulées. «Il est important que je reconnaisse ces angles morts et que j’y réagisse en posant des questions plus précises», souligne Ahmed Ajil. Il aimerait
d’ailleurs que davantage de ses collègues réfléchissent systématiquement à leur rôle et à leur influence, peut-être involontaire, sur leurs interlocutrices. Ils sont loin de tous le faire. «Or, si ce n’est pas le cas, cela nuit au travail de recherche.»
Lors de l’analyse de leur propre rôle, les scientifiques parlent de leur positionnalité. L’anthropologue Brigitte Boenisch-Brednich dit ainsi avoir pris conscience qu’elle s’était trop appuyée sur sa propre perspective lors de la conception de ses recherches sur la migration universitaire. Elle-même n’avait pas dû passer d’un poste temporaire à l’autre dans divers pays, comme c’est souvent le cas pendant le postdoctorat. Et elle a émigré en Nouvelle-Zélande en tant que professeure bien établie. Son passeport allemand lui facilite aussi les voyages, contrairement aux universitaires kazakhes ou biélorusses qu’elle a interrogées. «Au début, je n’avais pas du tout pensé aux problèmes que cela pouvait créer pour leur carrière», confie la chercheuse. Elle a alors réfléchi de façon critique à sa positionnalité et adapté le catalogue de questions de son projet.
«C’est humain; nous voulons tous voir notre vision du monde confirmée.»
La sensibilisation à l’importance d’une réflexion sur son propre rôle est particulièrement développée en sciences sociales, car de nombreux thèmes de recherche sont liés aux rapports de pouvoir, note Wiebke Wiesigel. Anthropologue à l’Université de Neuchâtel, elle copréside aussi la commission d’éthique et de déontologie de la Société suisse d’ethnologie. «L’objectif des sciences sociales est justement de porter un regard critique sur la société, afin d’interpréter de manière différente ce qui est qualifié de normal.» Les scientifiques doivent être en mesure de défendre ces connaissances de manière sérieuse. A cette fin, elles doivent réfléchir à leur propre rapport au thème de recherche et le rendre transparent.
Marlene Altenmüller
Digne de confiance si on est déjà d’accord Jusque-là, tout va bien, pourrait-on penser. Seulement voilà: aux yeux du public, cette autoréflexion ne rend pas forcément la recherche plus crédible. Des études ont plutôt montré le contraire: les situations dans lesquelles des scientifiques ont un lien personnel avec leur objet de recherche peuvent être perçues tant positivement que négativement – tout dépend de l’opinion de départ des personnes sur le sujet. Une enquête de 2021 sur l’alimentation végétalienne et sur les thèmes LGBTQ+ montre ainsi que les personnes interrogées perçoivent les scientifiques personnellement concernés comme plus dignes de confiance et leurs résultats comme plus crédibles dans le cas où elles-mêmes avaient une attitude positive vis-à-vis du thème de recherche. A l’inverse, les gens qui avaient d’emblée une vision critique de l’alimentation végétalienne étaient alors encore plus critiques.
«C’est humain. Nous voulons tous voir notre vision du monde confirmée», analyse Marlene Altenmüller. Première auteure de l’étude, la professeure mène des recherches à
l’Institut Leibniz de psychologie à Trèves (D) et s’intéresse à l’acceptation de la science par le public. «Le public valorise ou dévalorise donc les résultats de la recherche en fonction de la manière dont ils correspondent à sa propre vision. Et ce, davantage encore si les scientifiques sont personnellement concernés», note-t-elle. Une étude américaine a examiné de plus près cette façon de penser. Les personnes interrogées dans ce cadre ont attribué davantage d’expertise, mais aussi un intérêt personnel plus marqué aux scientifiques concernés. La première interprétation renforce la confiance accordée et la légitimité, alors que la seconde nourrit les soupçons de partialité. Selon le point de vue de chacun, l’une ou l’autre de ces attributions est alors dominante. Le public réagit d’ailleurs de manière similaire quand la science devient politique. Cela apparaît par exemple dans la recherche sur le climat, l’égalité des sexes, l’éducation ou encore les mesures liées au Covid-19. Une étude de Marlene Altenmüller a ainsi montré que le public est fortement influencé par la position qu’il prête aux scientifiques. Les personnes de la droite conservatrice sont plus sceptiques lorsqu’elles perçoivent un chercheur comme appartenant à la gauche libérale. A l’inverse, les libéraux de gauche sont plus dubitatifs quand ils soupçonnent une attitude conservatrice chez une chercheuse. Mais qu’est-ce que cela signifie? Comment les chercheurs et chercheuses peuvent-elles préserver leur crédibilité? «La question n’a pas de réponse simple», reconnaît Marlene Altenmüller. Les sondages révèlent toujours une ambivalence intéressante: d’une part, les gens apprécient le côté personnel des scientifiques et souhaitent les entendre s’exprimer sur des questions politiques ou les voir s’opposer à une présentation fallacieuse des faits. De l’autre, ils disent que la science ne devrait pas faire de politique, par exemple ne pas prendre parti pour ou contre des mesures décidées par le gouvernement. Entre ces deux pôles, la frontière est ténue.
Indépendamment de l’opinion publique, il n’existe toutefois à ce jour pratiquement aucune étude sur la fiabilité réelle des travaux menés par des scientifiques impliqués sur un plan personnel ou politique. «Cette forme de recherche est extrêmement fastidieuse et elle n’en est qu’à ses débuts. Mais elle prend toujours plus d’ampleur», constate Marlene Altenmüller. Au moins, un résultat allant dans ce sens peut être annoncé: une équipe américaine a examiné près de 200 études de psychologie dont les résultats contenaient un jugement politique. Leur but était de voir si ces études auraient été confirmées par des travaux ultérieurs moins fréquemment que celles exemptes de jugement politique. La réponse fut négative.
Santina
Russo est journaliste scientifique indépendante à Zurich.

En fin de compte, est-ce au résultat d’être objectif ou surtout au processus pour y parvenir?
Le philosophe des sciences Jan Sprenger explique les principes fondamentaux de l’objectivité dans la recherche. Et pourquoi cela est plus simple en sciences naturelles.
Texte Judith Hochstrasser Photo Bea De Giacomo
Jan Sprenger, vous vous intéressez à l’objectivité et à la subjectivité dans la recherche d’un point de vue philosophique: à quoi devrait prêter attention quelqu’un qui a une expérience personnelle avec l’objet de sa recherche?
Nous distinguons deux dimensions en philosophie des sciences: les expériences ou les perspectives personnelles sont admissibles lors de la formulation d’une hypothèse. L’évaluation de cette dernière à l’aune des preuves fournies doit toutefois se faire selon les standards usuels de la discipline. De plus, le vécu personnel ne doit pas servir de preuve pour confirmer certaines théories. Et il faut, bien sûr, veiller à ce qu’il n’obscurcisse pas le jugement.
Tout dépend donc du stade auquel l’expérience personnelle intervient dans l’acquisition des connaissances. Oui. Cela vaut d’ailleurs également pour notre propre conception du monde.
A quel point pensezvous être objectif dans vos réflexions sur l’objectivité?
Eh bien, pour nous, philosophes, tester empiriquement nos hypothèses n’est évidemment pas facile. Nous essayons plutôt d’expliquer des notions telles que l’objectivité justement en décrivant leurs fonctions dans le discours scientifique. Ensuite, nous argumentons pourquoi telle ou telle approche est plus prometteuse.
Comment l’objectivité fonctionnetelle en sciences sociales et en sciences naturelles?
Les sciences naturelles ont la tâche plus facile, car elles disposent de théories quantitatives plus nombreuses et plus fructueuses. Celles-ci leur permettent de faire des prédictions précises qu’elles peuvent à leur tour tester avec exactitude. Voici un exemple récurrent dans
les manuels de physique: grâce aux déviations orbitales de la planète Uranus, la position de Neptune a pu être prédite avec succès. En cas de doute, les sciences naturelles disposent par ailleurs d’un laboratoire où elles peuvent réaliser une expérience donnée – en thermodynamique par exemple – sans influences extérieures pertinentes. Cela s’avère beaucoup plus difficile en sciences sociales, car il s’agit de systèmes complexes avec un réseau d’influences causales qui ne se laissent pas isoler si facilement.
Par exemple?
Comment le racisme apparaît-il? On ne peut guère le tester en laboratoire. De très nombreuses influences entrent en jeu. Il va de soi que les sciences sociales réalisent également des expériences en laboratoire sur des questions spécifiques, telles que: à quel point les personnes se font-elles confiance lorsqu’il s’agit d’argent? Mais la question de savoir comment ces idéalisations peuvent ensuite être transposées dans la société reste ouverte.
Concrètement, comment l’objectivité estelle donc produite dans le travail de recherche?
C’est complexe. Toutefois, deux idées fondamentales prédominent: les uns invoquent le produit du travail de recherche. Par exemple, le résultat d’une expérience est considéré comme objectif s’il peut être reproduit indépendamment par différents chercheurs et chercheuses à divers moments et lieux. D’autres mettent l’accent sur le processus qui permet de tenir à l’écart du travail empirique les partis pris personnels. Lorsque nous parlons d’objectivité en science, sans donner davantage de précisions, nous faisons généralement référence à une objectivité où ces deux idées se recoupent. J’estime toutefois qu’il est important de faire la distinction entre l’objectivité du produit et l’objectivité du processus.
Tout cela est assez abstrait.
C’est vrai. Mais ce qui m’intéresse particulièrement dans le concept d’objectivité, c’est comment il peut être utile dans la pratique quotidienne de la recherche. Pour cela, restons-en à l’aspect du processus. Quand il est impossible d’exclure la présence de valeurs dans l’argumentation scientifique ou l’analyse de données, les chercheuses devraient les rendre transparentes. Cela peut concerner par exemple le choix des hypothèses testées ou les probabilités qu’on leur attribue. Les scientifiques peuvent aussi montrer en quoi les conclusions d’une expérience auraient été différentes s’ils avaient posé d’autres conditions.
Vu ainsi, peuton éviter la subjectivité? Il est impossible, par exemple, d’analyser un jeu de données sans émettre certaines hypothèses, par exemple à propos des facteurs qui influencent ou non la confiance des gens les uns envers les autres. Le jugement subjectif s’avère donc indispensable. C’est pourquoi ces éléments subjectifs font explicitement partie du raisonnement scientifique en statistique bayésienne: des probabilités subjectives sont attribuées à des hypothèses, et leur valeur peut éventuellement changer à la lumière des résultats expérimentaux. Par contre, la question de la probabilité d’une hypothèse n’entre absolument pas en ligne de compte en statistique classique. Il s’agit simplement de savoir dans quelle mesure l’hypothèse nulle – le standard qui sert de point de départ sans effectuer d’enquête – d’une absence de relation causale explique bien ou mal les données. Tout jugement subjectif est écarté comme n’appartenant pas à la science.
En quoi estce un problème?
L’une des conséquences de cette standardisation en matière de recherche statistique est que seuls les résultats dits significatifs finissent par être publiés, soit ceux qui correspondent à

une valeur-p donnée. Or, ces indicateurs permettent uniquement d’affirmer que des données ne sont probablement pas le fruit du hasard. Si, par exemple, un médicament fait ne serait-ce qu’un peu mieux qu’un placebo dans le cadre d’une large expérience menée sur 100 000 patients, le résultat est presque certainement statistiquement significatif en raison du très grand échantillon. Mais cela ne dit rien sur la capacité réelle de ce médicament à lutter contre la maladie. C’est pourquoi, depuis quelques années, un mouvement scientifique œuvre pour que l’on ne se fie plus aux seules valeurs-p. Mais cette approche a dominé pendant des décennies et a fait beaucoup de dégâts.
L’objectivité estelle réellement une bonne chose?
Aussi objectif que possible
Jan Sprenger est professeur de logique et de philosophie des sciences à l’Université de Turin. Spécialisé dans les questions épistémologiques, il a dirigé le projet de recherche européen «Making Scientific Inferences More Objective» jusqu’en 2021. Ce dernier visait à mieux comprendre l’objectivité des conclusions statistiques, causales et explicatives. jho
C’est grâce à elle que l’on fait confiance à la science et qu’elle est pertinente dans le discours sociétal. Si l’on prend l’objectivité du processus comme point de départ, à savoir que l’objectif premier est d’écarter le plus possible les partis pris personnels, l’idée n’est pas non plus synonyme d’attentes trop élevées. Mais si l’on entend par objectivité une conformité à la réalité, la science n’est pas toujours en mesure de la garantir. Elle est bien trop complexe pour cela.
Cette exigence seraitelle une nouvelle dimension de l’objectivité? Outre l’objectivité du processus et celle du produit?
L’objectivité en tant que conformité à la réalité est une vieille idée. Elle transparaît dans la notion d’objectivité du produit. Mais il est difficile de mesurer directement cette conformité.
En résumé, quelles sont les conditions à remplir pour une combinaison pratique entre objectivité du produit et objectivité du processus?
Cela repose sur un travail expérimental et implique un haut degré de reproductibilité et une évaluation des théories davantage guidée par des preuves que par des convictions personnelles.
Cela convient bien aux sciences naturelles et sociales. Mais qu’en estil en sciences humaines? Une historienne peut sciemment examiner une source du point de vue d’un groupe marginal donné. Dans ce cas, le parti pris est pour ainsi dire une méthode.
Cette approche peut s’avérer tout à fait judicieuse, car on développe ainsi une perspective jusqu’alors inconnue. Il est toutefois important de la signaler. Et d’avoir suffisamment d’autres approches qui réinterprètent la source selon une perspective différente. Les sciences humaines progressent précisément grâce à la confrontation.
Dans quelle mesure?
En sciences naturelles, on accepte un paradigme en y travaillant. Dans les sciences humaines, on cherche plutôt à approfondir la compréhension d’un phénomène donné à l’aide d’approches d’interprétation contraires. Dans de tels cas, un consensus scientifique constitue un résultat objectif. Les sciences humaines ne disposent guère de théories générales, comme les lois de Newton en physique, qui puissent guider la recherche. Elles dépendent bien plus de l’étude de cas individuels concrets.
Judith Hochstrasser est codirectrice de la rédaction d’Horizons.


De la quête de l’alchimiste de la cour princière à l’étude randomisée: l’histoire de la méthode scientifique est faite de chaos et de contrôle.
Texte Johannes Giesler Illustration Bunterhund
Philipp Sömmering fut exécuté en 1575. Pendant des années, il avait vainement tenté de fabriquer de l’or. Il avait pourtant assuré en être capable, ce qui lui avait valu un emploi lucratif et un laboratoire bien équipé à la cour princière de Brunswick-Wolfenbüttel. Il était alchimiste; aujourd’hui, on le considérerait comme un pseudoscientifique, mais à ce moment-là, son savoir magique était convoité.
«C’était une époque passionnante, raconte Ion-Gabriel Mihailescu, historien des sciences à l’Université de Neuchâtel. D’un côté, il y avait la philosophie naturelle développée dans les universités et établie depuis des siècles. Elle proposait une vision cohérente du monde, capable de tout expliquer, du mouvement des étoiles au comportement de la matière sur Terre.» De l’autre côté, des alchimistes comme Philippe Sömmering, mais aussi des artistes et des artisans faisaient des déclarations extravagantes qui contredisaient cette vision. «Ils prétendaient pouvoir manipuler la nature au moyen de vérités secrètes qu’ils auraient découvertes. Oui, on pourrait dire que le chaos intellectuel régnait à l’époque», note l’historien. De quoi soulever des questions fondamentales. Comment un savoir fiable prend-il forme? Et comment peut-il être vérifié? La révolution scientifique a apporté une réponse à ces questions. Elle a débuté au XVIe siècle et a fait naître l’idée que le savoir devait être indépendant des procédés employés, ce qui débouchera sur le développement des méthodes scientifiques. Voici quatre exemples qui illustrent comment ces méthodes ont transformé la recherche.
Les gentlemen de la Royal Society sont les témoins de l’expérience.
La Royal Society britannique a joué un rôle important dans l’évolution de l’acquisition et de la vérification des connaissances scientifiques. Fondée à Londres en 1660, elle était imprégnée des idéaux empiriques

du «Novum Organum» de Francis Bacon – l’un des premiers ouvrages méthodologiques de l’histoire des sciences. Si le philosophe n’y présentait pas de protocole méticuleux, il mettait l’accent sur l’observation systématique et la recherche pratique, faisant de l’expérimentation une méthode de choix. L’huile sur toile «Une expérience sur un oiseau dans une pompe à air» de Joseph Wright of Derby en est un exemple. Elle représente une expérience réalisée par Robert Boyle, l’un des fondateurs de la Royal Society. On y voit des hommes, des femmes et des enfants rassemblés autour d’une cloche en verre, reliée à une pompe, dans laquelle est retenu un cacatoès. La question de l’expérience: l’air est-il nécessaire à la vie?
«La Royal Society menait des expériences pour produire des connaissances, raconte Ion-Gabriel Mihailescu. Mais il était tout aussi important que ces essais soient attestés et vérifiés par d’autres membres de la société.» Ainsi, l’historien Steven Shapin a montré qu’à cette époque, la crédibilité des déclarations scientifiques dépendait des personnes qui les avaient observées. «C’est pourquoi les membres de la Society étaient des gentlemen, financièrement indépendants et donc crédibles aux yeux du public», explique Ion-Gabriel Mihailescu.
L’institution londonienne développa des moyens de diffuser les connaissances scientifiques, notamment par le biais de sa publication Philosophical Transactions. Celle-ci se limitait souvent à publier les résultats des expériences. En l’absence de standards uniformisés, cela nourrissait davantage les controverses que le consensus. La célèbre expérience sur la lumière réalisée par Isaac Newton l’illustre bien. Il avait fait passer de la lumière blanche à travers un prisme en verre et l’avait décomposée en son spectre de couleurs. Mais d’autres scientifiques européens avaient échoué les uns après les autres à reproduire son résultat. Newton leur avait alors suggéré que les prismes qu’ils employaient étaient «incorrects». Cela lui valut d’être accusé de ne définir comme «corrects» que les prismes qui confirmaient ses résultats. Il s’est avéré par la suite que les autres scientifiques avaient tous
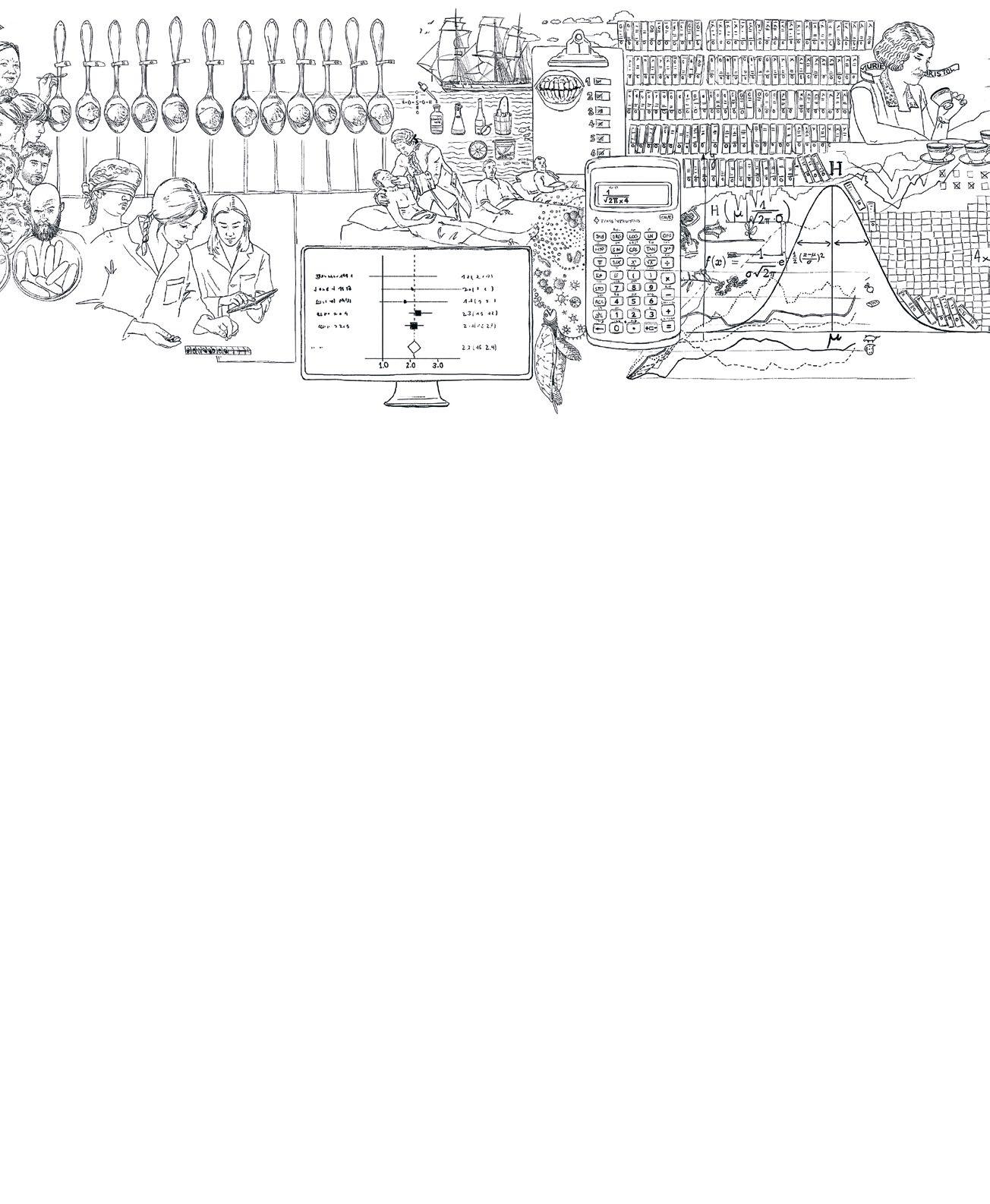
utilisé du verre vénitien. Or, même lorsqu’il est travaillé de manière artistique, celui-ci ne se prête pas aux expériences d’optique.
L’idée que toute affirmation doit être vérifiée et confirmée par une communauté est aujourd’hui un principe fondamental de la science moderne. Ce qui a commencé au XVIIe siècle a marqué le début d’une lente institutionnalisation et professionnalisation de la recherche et a conduit à un changement de paradigme dans la manière dont le savoir s’impose.
Un médecin de bord écossais fait un test comparatif de la vitamine C.
Peu de méthodes scientifiques ont changé la recherche médicale aussi profondément que l’essai contrôlé randomisé (abrégé «RCT» en anglais). Il constitue aujourd’hui une référence incontournable pour l’évaluation de nouveaux traitements. «Sa force est d’estimer l’efficacité d’un médicament en éliminant systématiquement les biais», explique Erik von Elm. Ce médecin et épidémiologiste a cofondé en 2011 l’antenne suisse de Cochrane. Depuis plus de trente ans, ce réseau international résume dans des revues systématiques l’état actuel des connaissances issues de recherches en médecine et en santé. «Un RCT divise les sujets en un groupe expérimental et un autre de contrôle», explique l’épidémiologiste. Le premier reçoit un médicament, le second un placebo. L’idée: si après le traitement apparaissent des différences entre les groupes, elles sont probablement dues au médicament. Le principe d’une «comparaison équitable» est central dans les RCT. Un exemple historique de cette approche remonte à 1747. Lors d’un voyage en bateau de plusieurs mois, le médecin de bord James Lind tente de soigner des marins souffrant du scorbut. On savait à l’époque que la maladie pouvait provoquer la perte des dents –symptôme le plus connu – et entraîner la mort, mais on ignorait qu’elle était due à un manque de vitamine C. Le médecin écossais cherche un traitement de façon systématique et décide de répartir les malades en différents groupes – une première. Il prescrit le même régime, mais donne à chaque groupe un aliment supplémentaire différent. Après quelques jours, les marins qui avaient mangé quotidiennement des agrumes (riches en vitamine C) se portaient mieux.
«Le deuxième principe du RCT est la randomisation, à savoir que la répartition dans les groupes se fait au hasard», poursuit Erik von Elm. Cela permet d’avoir des échantillons comparables, en excluant par
exemple une sélection délibérée. La première répartition des sujets par tirage au sort remonte au XIXe siècle. «Le troisième principe est ce qu’on appelle la mise en aveugle, explique l’épidémiologiste. Idéalement, ni les sujets, ni les thérapeutes ne savent qui a reçu le nouveau médicament ou le placebo.» Ce procédé empêche que les médecins adoptent un comportement différent selon le groupe, par exemple en étant plus attentionnés envers les personnes ayant reçu la thérapie testée. Les premières études en aveugle datent du début du XXe siècle. Au fil des siècles, l’essai contrôlé randomisé est devenu un ensemble complexe de méthodes et il constitue désormais une norme légale. Cela s’explique en partie par la gravité des conséquences d’une commercialisation de médicaments insuffisamment testés. Un exemple est le scandale du thalidomide dans les années 1950. Cette substance présente dans le somnifère Contergan a provoqué des malformations chez des milliers de nouveau-nés. Depuis, les médicaments doivent être non seulement efficaces, mais aussi sûrs.
Les statistiques quantifient le hasard et généralisent les cas individuels. «J’interviens lorsqu’on se demande comment identifier des effets de causalité à partir de résultats expérimentaux.» C’est ainsi que le statisticien Servan Grüninger décrit son travail. Chercheur à l’Université de Zurich, il se concentre sur la planification d’expériences. La question qui l’intéresse: quand un effet observé est-il le résultat d’une intervention et quand ne l’est-il pas? De son avis, il existe en statistique une longue tradition qui consiste à «vérifier la fiabilité des énoncés scientifiques». Aujourd’hui, la statistique est à la base de la recherche quantitative dans presque toutes les disciplines et elle a profondément modifié la conception de l’objectivité scientifique. Un exemple classique de l’importance des statistiques est l’expérience de dégustation de thé réalisée par le statisticien Ronald Fisher dans les années 1920, raconte Servan Grüninger. Une de ses amies, Muriel Bristol, affirmait, comme toute bonne Britannique, être capable de distinguer si le lait avait été versé avant le thé ou après. Ronald Fisher en doute et la met à l’épreuve: il lui présente huit tasses disposées au hasard. Quatre avaient d’abord été remplies de lait et quatre d’eau, sans qu’elle le sache.
«Je peux alors calculer la probabilité que Muriel Bristol parvienne à identifier toutes les tasses par hasard, explique Servan Grüninger. Pour chaque récipient, celle-ci est de 50%. Les chances de deviner cor-
rectement huit fois de suite ne sont alors que de 1,4%.» Et c’est ce que fait Muriel Bristol, qui réussit le test. Faut-il y voir la preuve de son fin palais ou l’interpréter comme un heureux hasard? Cela dépend si l’on considère 1,4% comme suffisamment improbable, ou non. Cette approche peut s’appliquer à des tests de médicaments ainsi qu’à pratiquement tout autre type d’études. «La statistique associe ainsi la probabilité d’erreur à des affirmations causales», résume Servan Grüninger.
Une deuxième application importante de la statistique est de reconnaître des schémas dans les données – de «séparer le bruit du signal», comme le dit le chercheur. L’étude sociologique «Le Suicide» d’Emile Durkheim, publiée en 1897, illustre bien ce concept. Il a pu montrer que les taux de suicides étaient corrélés à des facteurs tels que le sexe, la situation familiale et l’appartenance religieuse. Les statistiques ont rendu visible ce qui était auparavant caché. Ce fut un tournant pour le travail scientifique: au lieu d’interpréter des cas particuliers, la statistique permet de tirer des conclusions généralisables. Mais seulement si elle est utilisée correctement, souligne Servan Grüninger: «La statistique ne peut être utile que si elle s’intègre dans un programme de recherche explicitant clairement ce qui doit être quantifié. Si cela n’est pas défini, il s’agit de pseudoscience.»
Ne pas prouver, mais comprendre
La critique des sources apporte des normes contraignantes à l’histoire. «Je travaille avec des témoignages du passé: textes, images et artefacts, ou même des formes de paysage», indique Dania Achermann, professeure d’histoire des sciences. Elle fait de la recherche et enseigne à l’Université de Saint-Gall. Son approche de la connaissance diffère fondamentalement de la plupart des procédés en sciences naturelles: «Les sources historiques ne constituent jamais des informations neutres ou objectives. Derrière elles se trouvent toujours un auteur ou une auteure ainsi que des intentions et un public cible.» La chercheuse emploie la méthode historique qui place la critique des sources au centre de ses préoccupations. Celle-ci s’est développée en parallèle de la professionnalisation des sciences historiques. Si la première chaire de cette discipline fut créée en 1759 et suivie par un institut sept ans plus tard, tous deux à Göttingen, le métier d’historienne n’est apparu qu’au XIXe siècle. Depuis, la méthode historique suit également des critères clairs afin que les témoignages historiques ne soient pas repris sans réflexion, mais puissent être remis en question systématiquement: qui a rédigé
la source? Quelle langue est utilisée? Quelles autres sources sont disponibles et lesquelles manquent? «Auteur, destinataire, langue, contexte: on les passe consciencieusement en revue durant les études. Plus tard, cela devient un automatisme presque intuitif», explique Dania Achermann. C’est pourquoi la méthode historique prend une place particulière. Elle n’est souvent pas explicitement mentionnée dans les travaux, ce qui vaut parfois à la profession le reproche de ne pas travailler selon les standards scientifiques, même dans ses propres rangs: pour l’historien français Marc Bloch, la critique des sources est un art qui requiert «un certain doigté» et pour lequel il ne peut donc y avoir de livre de recettes.
Contrairement aux études quantitatives, il ne s’agit pas ici de formuler des lois de causalité, mais de saisir les liens de sens et de rendre les interprétations transparentes. «Mon objectif n’est pas de démontrer quelque chose, mais de le comprendre et de le reconstruire, et de reconnaître les intentions», explique Dania Achermann. L’article d’histoire des sciences «The Image of Objectivity» de Lorraine Daston et Peter Galison l’illustre en pratique. Ils y expliquent comment la notion d’objectivité a évolué au fil du temps, influençant notamment les images de recherche: au XVIIIe siècle, le «typique» était considéré comme objectif. L’interprétation par les scientifiques était non seulement autorisée, mais souhaitée. C’est ce qu’on appelle l’idéal du «Truthto-Nature». La tendance s’est inversée au XIXe siècle avec «l’objectivité mécanique» comme statu quo: caméras et machines doivent documenter les observations de manière neutre et non falsifiée. Quiconque analyse des images scientifiques anciennes, comme le fait Dania Achermann, se doit de connaître l’idéal qui a présidé à leur création.
La méthodologie scientifique est le résultat d’un processus ouvert et jamais achevé. Elle ne garantit pas de savoir définitif et n’exclut pas la subjectivité, car celle-ci fait partie intégrante du processus scientifique, par exemple dans le choix des questions ou des intérêts des chercheuses et des chercheurs. Et même si les méthodes sont importantes, la force de la science réside dans le recoupement collectif – dans son application reproductible par un grand nombre.

Johannes Giesler est journaliste indépendant à Leipzig.

Au Laboratoire de recherche de l’Hôpital universitaire de Zurich, des scientifiques tentent de comprendre le raisonnement social d’une personne. Entre autres par le jeu feuille-cailloux-ciseaux. Nous avons participé au jeu.
Texte Atlant Bieri Photos Markus Bertschi







Le sous-sol de l’Hôpital universitaire de Zurich est un labyrinthe de longs couloirs stériles. Un parfum de désinfectant flotte dans l’air. La haute porte en chêne plaqué détonne dans ce décor. Elle s’ouvre sur un laboratoire digne d’un hôtel de montagne – sans la vue grandiose. «Nous voulons étudier le comportement social. Pour cela, nous ne pouvons pas enfermer les gens dans une cave sombre», explique Christian Ruff. Professeur en neuroéconomie et sciences de la décision à l’Université de Zurich, il est également directeur du Laboratoire de recherche sur les systèmes sociaux et neuronaux (SNS), créé en 2007. Sa mission: plonger dans le cerveau de la société. «Nous cherchons à comprendre le fonctionnement des individus afin de pouvoir appréhender nos décisions et la société dans son ensemble», précise Christian Ruff. C’est ce qu’on appelle l’économie comportementale. «Pendant des décennies, nous avons émis des hypothèses peut-être complètement fausses sur la société», note le chercheur. Par exemple: il y aurait automatiquement plus de fraudeurs si l’Etat tolérait la fraude fiscale. Car pourquoi être honnête si ce n’est pas exigé? A l’heure actuelle, personne ne sait si notre cer-
1 Observer le cerveau pendant la prise de décision: pour cela, on mesure en temps réel, en laboratoire, les ondes cérébrales à l’aide d’un EEG pour explorer les systèmes sociaux et neuronaux.
2 Le scanner IRM est le cœur du laboratoire. La patiente participe à un jeu décisionnel tandis que les scientifiques observent l’activité des différentes zones du cerveau.
3 Le neuroéconomiste Christian Ruff (à gauche) et le chef de laboratoire Marius Moisa ont pour fonction de définir des «empreintes digitales» de la prise de décision dans le cerveau.
4 Le 3 bat le 2, le 2 bat le 1 et le 1 bat le 3. Comme dans le jeu enfantin «feuillecaillouxciseaux», les participantes élaborent des stratégies.
5 Les participants à l’expérience jouent mieux lorsqu’ils peuvent bien «lire» leur adversaire et comprendre les stratégies qu’il utilise.
veau fonctionne réellement ainsi. «C’est pourquoi nous explorons les processus cérébraux responsables de nos actions. Notre objectif est d’établir des faits et de fournir un vocabulaire clair. Ainsi, nous découvrirons peut-être aussi ce que la politique, les organisations et les autorités peuvent faire pour que les gens se comportent différemment», explique Christian Ruff. Pour une étude systématique du comportement social, il faut une action sociale. Quelque chose de simple et qui peut être répété à volonté. Dans l’expérience prévue ce matin, le choix surprend: le jeu feuille-cailloux-ciseaux. Gökhan Aydogan, directeur de l’essai, vient de préparer un nouveau tour du jeu et a fait asseoir individuellement six jeunes femmes et hommes devant un écran. La plupart des sujets recrutés étudient à Zurich. «Appuyez tous sur S, s’il vous plaît», demande-t-il. Les chiffres 1, 2 et 3 viennent remplacer les notions de feuille, cailloux et ciseaux. Le 3 bat le 2, le 2 le 1 et le 1 le 3. «Vous pouvez commencer à jouer.»
Comprendre les autres pour gagner N’est-ce pas un peu puéril? «Non, estime Gökhan Aydogan, la partie en dit même long, car de nombreuses facultés particulières de raisonnement entrent en jeu. La plupart des personnes suivent une certaine stratégie ou des habitudes. L’une a par exemple une préférence pour le 1. Une autre joue surtout le chiffre qui l’a fait gagner la fois précédente. Ou elle joue systématiquement le chiffre suivant.» Le fait que les sujets doivent se mettre à la place de leur adversaire pour gagner est décisif. «Ils doivent comprendre comment fonctionne l’autre – une capacité essentielle. Nous en avons un besoin constant dans notre société – dans une relation de couple par exemple, mais aussi en politique, à l’école ou lors de négociations», explique Gökhan Aydogan. Les gens incapables de «lire» les autres perdent plus souvent. Il existe deux catégories de personnes: celles dont la capacité d’analyser les autres est excellente et celles qui en sont incapables. Ce dispositif expérimental permet de reproduire artificiellement cette configuration. Une bobine magnétique est maintenant placée sur la tête des sujets. Elle émet des ondes électromagnétiques à une fréquence spécifique. En fonction de son positionnement sur le crâne pendant le jeu, elle stimule différentes zones du cerveau – par exemple le cortex frontal, responsable de la pensée logique et analytique. «Lorsque nous le stimulons, les gens sont capables de réfléchir plus vite et de mieux s’identifier aux autres, relève Marius Moisa, technicien et responsable de labora-
toire. Ils gagnent alors plus souvent.» Autrement dit: ils deviennent un supercerveau social. Mais l’inverse est également vrai. La zone du cerveau concernée se fatigue si on modifie la cadence de stimulation. «Ces sujets perdent de leur capacité à ‹lire› leur adversaire et finissent par perdre», explique-t-il.
Visualiser les zones cérébrales actives Or, quel que soit le nombre de tours de jeu avec la bobine magnétique sur la tête, une chose manque toujours: la vue directe dans le cerveau. C’est ici qu’intervient la pièce maîtresse du laboratoire: un appareil flambant neuf d’imagerie par résonance magnétique (IRM). «Nous avons dû abattre quelques murs pour le faire entrer», raconte Christian Ruff. A travers la vitre du centre de contrôle, le professeur jouit d’une vue directe sur l’IRM dans la pièce voisine. Allongée sur une table roulante, une jeune femme est poussée dans le tube, tête en avant. Peu après, son cerveau apparaît sur les écrans de contrôle sous forme de vues colorées, prises de face et de côté. Un écran fixé juste devant son visage lui permet de participer au jeu. D’une main, elle peut manier un curseur. «Le scanner mesure en temps réel les besoins en oxygène des diverses zones cérébrales. Cela nous permet de voir où exactement son cerveau est actif lorsqu’elle prend des décisions», explique Christian Ruff.
Les images font ensuite l’objet d’analyses statistiques. Les données disponibles sont désormais suffisamment nombreuses pour être en mesure de dégager un profil. «Nous disposons quasiment d’une empreinte digitale de la pensée sociale.» Le chercheur sait donc quelles zones sont actives lorsqu’une personne se met à la place d’une autre. «A partir de son profil d’activité, nous pouvons même prédire ses résultats au jeu.» Le taux de réussite atteint un fier 80%. A l’avenir, Christian Ruff aimerait utiliser ce type de prédictions en particulier chez les enfants pour identifier des troubles de l’apprentissage, mais aussi, entre autres, dans le spectre autistique.
La recherche sur le stress est un autre domaine d’application. Le Laboratoire SNS est en contact avec plusieurs réseaux de recherche en Suisse et dans le monde. «Nous aimerions un jour pouvoir mesurer directement, à l’aide d’un scanner cérébral, la résilience au stress d’une personne. On pourrait alors déterminer, dès le choix d’un métier, si quelqu’un est apte à devenir pompier ou policier.» La recherche n’en est toutefois pas encore là, note Christian Ruff: «Nous devons d’abord comprendre comment le cerveau fonctionne sous stress. Cer-
taines choses fonctionnent-elles mieux ou sommes-nous victimes du redoutable effet tunnel, soudain incapables de réfléchir?»
Les scientifiques ont recours à une astuce simple pour stresser les sujets: les mathématiques. La femme allongée dans l’IRM voit maintenant apparaître sur l’écran des exercices de calcul mental: 7 fois 9, le résultat divisé par 3, moins 4. Elle déplace le curseur sur le nombre 17 – et réussit de justesse! Trois secondes à peine et le calcul suivant apparaît déjà. Après quelques minutes, on a l’impression d’avoir passé toute une journée avec une cheffe râleuse sur le dos, qui veut à tout prix que l’on traite une tonne de dossiers avant minuit. Ainsi conditionnée, la participante reprend le jeu «feuille-cailloux-ciseaux».
Mieux comprendre la corruption
Malgré ses images en haute résolution, l’IRM est moins rapide que le cerveau humain: les scans ont toujours quelques secondes de retard. «Nous pouvons bien mesurer les zones d’activité cérébrale lors de la prise de décisions, mais la méthode n’est pas si précise en termes de temps», note Christian Ruff. C’est là qu’intervient le troisième élément clé du laboratoire: l’électroencéphalographie (EEG) qui mesure les ondes cérébrales en temps réel, à la milliseconde près à travers la boîte crânienne. Il manque certes de précision spatiale, mais combinées aux images de l’IRM, celles de l’EEG fournissent une représentation très précise des processus cérébraux.
«Notre recherche peut contribuer à rendre les processus sociaux plus efficaces.» Christian Ruff en est convaincu. Outre le choix professionnel, elle pourrait permettre d’améliorer les comportements éthiques en matière de consommation, de pollution ou de corruption. Sans oublier la dimension pathologique. «Dépression, troubles anxieux, borderline: ces étiquettes sont beaucoup trop imprécises.» Là encore, il faudrait comprendre les mécanismes cérébraux fondamentaux. «J’espère que nous pourrons alors proposer des thérapies efficaces et améliorer la vie des personnes concernées.» Un premier jalon a déjà été posé au sous-sol de l’hôpital, grâce à l’alliance entre atmosphère hôtelière et technologie de pointe.

Atlant Bieri est journaliste scientifique indépendant à Pfäffikon (ZH).

«Nous cherchons à comprendre le fonctionnement des individus afin de pouvoir appréhender nos décisions et la société dans son ensemble.»
Christian Ruff




6 Le bonnet EEG fait partie des accessoires importants du laboratoire de recherche sur les systèmes sociaux et neuronaux.
7 Les scanners cérébraux réalisés à l’aide de l’imagerie par résonance magnétique complètent l’image des processus qui se déroulent dans le cerveau des sujets.
8 Les bobines magnétiques stimulent diverses zones du cerveau pendant le jeu. D’où une meilleure ou une moins bonne compréhension de l’autre par les participantes.
9 Le sujet reçoit des instructions sur la façon dont il doit utiliser le curseur dans le tomographe.
10 La stimulation par la bobine magnétique peut modifier le raisonnement social des sujets.
11 Les effets personnels sont placés en toute sécurité dans des casiers pendant les tests.

Dans la course face à l’électrique, la victoire de l’essence, du diesel et Cie n’a pas toujours semblé aussi évidente. Mais à l’époque, les combustibles fossiles faisaient figure de référence dans l’industrie de la mobilité. Il en va autrement de nos jours. Quelle voie se dessine pour les carburants dans l’automobile et l’aviation?
Texte Hubert Filser
Durant l’été 1888, Bertha Benz part de Mannheim pour rendre visite à sa mère à Pforzheim à bord de la Motorwagen no 3 de son mari, Carl. Un seul plein ne suffit pas pour un si long trajet, ni les bouteilles d’essence légère qu’elle a emportées: le réservoir est vide peu avant d’arriver à Wiesloch. Mme Benz et ses deux fils doivent pousser la voiture sur les 100 derniers mètres, jusqu’à la pharmacie de la place du Marché. Elle y achète 3 litres de ligroïne, un solvant de nettoyage pouvant servir de carburant, et fait ainsi du lieu la première station-service du monde.
L’histoire des combustibles fossiles démarre donc de manière cahoteuse et au beau
milieu d’une querelle de systèmes toujours pas tranchée: moteur électrique versus moteur Otto. Les batteries concurrentes souffraient d’une faible autonomie et l’électricité n’était pas disponible partout. «Au début, la question de la source de carburant était encore ouverte», souligne Peter Affolter, responsable Ingénierie automobile à la Haute école spécialisée bernoise (BFH). «Ce n’est qu’avec l’invention du démarreur, en 1911, que la marche triomphale des carburants liquides et fossiles est devenue inarrêtable.»
L’histoire semble s’inverser désormais. L’électrification à large échelle, basée sur les énergies renouvelables, est considérée comme
une solution prometteuse et les carburants fossiles sont critiqués pour leur rôle dans le changement climatique. Sur toute la planète, des scientifiques cherchent des alternatives. Les carburants et combustibles fossiles relativement bon marché se prêtent toutefois à un usage universel: du modeste cyclomoteur aux hélicoptères, jets militaires et long-courriers, en passant par tous types de véhicules, bateaux et installations de production de chaleur et d’électricité.
«L’énergie fossile, qui a largement contribué à la croissance économique, est aussi à l’origine du changement climatique», souligne Christian Bach, directeur du laboratoire En-
ergies chimiques et systèmes automobiles au Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (Empa).
La tâche s’avère donc colossale: trouver des carburants alternatifs et climatiquement neutres pour divers secteurs industriels. Les candidats les plus prometteurs doivent attester d’une densité énergétique élevée et être faciles à transporter et à stocker. «En fin de compte, il s’agira de trouver un équilibre entre efficacité énergétique, coûts, sécurité et impact environnemental, tout en tenant compte des défis propres à chaque secteur», note Corsin Battaglia, spécialiste de la conversion de l’énergie à l’Empa.
Il n’est donc pas étonnant que l’abandon des combustibles fossiles s’avère difficile, compte tenu de l’énorme infrastructure en place, avec ses raffineries, pipelines et stations-service. La transition pourrait être plus facile dans certains secteurs, tel celui des chauffages stationnaires. «La chaleur, en tant que forme d’énergie de faible valeur, peut être produite sans problème à partir de toutes les sources d’énergie», explique Peter Affolter. Cependant, non seulement tous les véhicules – avions, bateaux et camions compris –ont besoin de sources d’énergie plus efficaces, mais ils doivent encore pouvoir transporter leur carburant. Pour Peter Affolter, plus cette autonomie (leur rayon d’action) est grande, plus la puissance requise du véhicule est importante: il faut plus d’énergie à un engin de chantier qu’à une petite voiture. Et plus le fonctionnement de l’engin dépend de son poids total – à l’instar des avions ou des bateaux –, plus le choix de carburants alternatifs est restreint. Il est par exemple difficile de remplacer des moteurs à kérosène utilisés par les avions par des moteurs électriques, faute d’une poussée suffisante.
E-fuels: compatibles, mais inefficients
Dans le trafic individuel, la part de voitures électriques augmente grâce aux nouvelles batteries lithium-ion. Lesquelles ont ouvert la voie à une mobilité similaire à celle des moteurs à combustion. Mais une résistance à la transition persiste: la décision de l’UE d’interdire les véhicules à combustion dès 2035 a suscité la controverse. Des personnalités politiques ont même vanté les mérites des «e-fuels» (e pour «fabriqués électriquement») et d’autres carburants de synthèse comme alternatives. Liquide, leur production est climatiquement neutre grâce au recours à l’électricité renouvelable lors de processus complexes en plusieurs étapes et en général très énergivores.
Idem avec les carburants synthétiques issus de déchets végétaux: la biomasse, telle que l’huile de cuisson usagée, est transformée en diesel à l’aide d’hydrogène. Ces biodiesels, déjà vendus sous la désignation HVO, ont pour atout d’être compatibles avec les chaînes de transport existantes et l’infrastructure de stockage.
De prime abord, le concept semble évident. Or, le rendement de ces e-fuels est loin de celui de l’électrique. Et ils sont plus chers que l’essence fossile, également parce que les structures chimiques des matières de départ – l’eau et le CO2 – sont très éloignées de la bonne vieille essence. Des spécialistes, dont Peter Affolter, appellent à un usage prudent de la nouvelle ressource: «Les carburants liquides, produits à partir de sources renouvelables ou fossiles, sont précieux. Ce serait du gâchis d’y recourir là où il y a déjà de bonnes alternatives.»
Les carburants artificiels peuvent être très utiles dans les techniques de climatisation, faute d’alternatives. Les véhicules utilitaires et les voitures de tourisme à haut kilométrage, parfois difficiles à électrifier, s’y prêtent ainsi bien, selon Christian Bach. Il faudrait également de tels e-fuels pour le transport aérien, les processus industriels à haute température ainsi que le transport maritime international, estime-t-il. Dans le cadre du consortium reFuel.ch, l’Empa et une vingtaine de partenaires industriels et économiques de Suisse et d’Oman évaluent actuellement la possibilité de produire des carburants et combustibles durables à partir d’énergie renouvelable dans des régions désertiques.
Les spécialistes envisagent encore une autre application importante: utiliser les e-fuels durant l’été pour stocker l’énergie excédentaire issue de sources renouvelables. L’hiver, si besoin, les carburants seraient alors brûlés, par exemple dans des turbines à gaz, pour produire de l’électricité. Ce double usage est possible, car des substances telles que l’hydrogène, le méthanol, le méthane ou l’ammoniac sont de bons accumulateurs d’énergie. Sous forme gazeuse, il faut toutefois les stocker et les transporter sous haute pression ou sous forme liquéfiée, afin que leur utilisation reste rentable. Une partie de l’énergie est alors forcément perdue.
A y regarder de près, la situation se complique. Facteurs écologiques et économiques déterminent la formule la plus rentable: utiliser l’énergie excédentaire en été pour l’industrie ou la mobilité longue distance des camions, ou la stocker pour produire de l’électricité en hiver. Il va de soi que la majeure par-
tie doit être importée de pays qui disposent d’une grande quantité d’énergie éolienne ou solaire inutilisée, explique Christian Bach. Pour de nombreux spécialistes, il ne faut donc pas mettre les alternatives en concurrence, mais se tourner vers les différents carburants pour les emplois auxquels ils sont adaptés. C’est là qu’intervient un ancien espoir de la transition énergétique: l’hydrogène, longtemps vu comme grand concurrent de l’électromobilité. Son emploi dans les piles à combustible fait encore l’objet de recherches. Son rendement, d’environ 31%, est bien inférieur à celui des voitures électriques, mais supérieur à celui des e-fuels. L’hydrogène pourrait toutefois jouer un rôle important dans la transition énergétique: comme carburant alternatif pour les poids lourds, les bus ou le trafic aérien et dans la propulsion de grands navires (sous forme d’un mélange avec de l’ammoniac) ou encore dans des processus à haute température tels ceux de l’industrie sidérurgique.
L’avenir repose sur le bon mélange «L’hydrogène est un pilier central du futur système énergétique, surtout en ce qui concerne l’électricité», considère Mirko Bothien de la ZHAW School of Engineering de Winterthour. Le stockage chimique sous forme d’hydrogène représente un bon moyen de compenser les fluctuations saisonnières. En hiver, l’hydrogène peut être transformé en électricité dans des turbines à gaz. Dans le cadre de projets de recherche européens, le chercheur travaille sur une meilleure conversion de l’hydrogène en électricité, ainsi que sur le développement de nouveaux brûleurs pour l’hydrogène et les mélanges. «Nous devrions rester ouverts à toutes les possibilités, estime le chercheur de l’Empa Corsin Battaglia. A l’avenir, il y aura probablement un mélange de diverses technologies.» Et son collègue Christian Bach est convaincu que de nombreuses innovations verront encore le jour. Comme celle de la recharge dynamique par induction des véhicules pendant qu’ils roulent sur les autoroutes. «C’est une vision qui me plaît beaucoup», reconnaît-il. Ce type de système de chargement intégré dans les revêtements routiers permettrait de parcourir de longues distances, même avec de petites batteries. Dès lors, le problème d’antan de Bertha Benz de trouver une station-service ne serait plus qu’un mauvais souvenir, puisque celle-ci serait omniprésente.
Hubert Filser est journaliste scientifique indépendant à Munich.
La science est sous le feu des critiques aux Etats-Unis. Claudia Brühwiler, professeure à l’Université de Saint-Gall et experte en conservatisme, explique les raisons de la politique anti-scientifique de l’administration Trump
Texte Emiliano Feresin Photo Ladina Bischof
Claudia Brühwiler, des agences fédérales sont démantelées, des fonds alloués à la recherche réduits et des institutions comme l’Université de Columbia attaquées. Dans votre podcast «Grüezi Amerika», vous avez réagi à l’hostilité à l’égard de la science aux Etats-Unis. Que s’y passe-t-il?
C’est presque comme un rêve fiévreux du mouvement conservateur.
Quel est donc le lien entre conservatisme et antiscience?
On observe différentes attitudes à l’égard du progrès scientifique et de son rôle sociétal aux Etats-Unis. Le libéralisme américain s’appuie sur une conception technocratique de la société. Le gouvernement idéal est guidé par l’expertise. Les conservateurs, par contre, se ferment à certaines découvertes scientifiques depuis le début du XXe siècle.
Par exemple?
Cela a débuté avec le procès Scopes en 1925, lorsqu’un professeur de biologie a tenté de contester l’interdiction de la théorie de l’évolution dans les écoles du Tennesse. Il a perdu, mais l’affaire a entraîné un éveil politique de la tranche de population appelée «Bible Belt». Le mouvement conservateur, qui s’est renforcé après la Seconde Guerre mondiale, valorise davantage la tradition et la foi que la science. Cela se traduit par une opposition à l’enseignement de la théorie de l’évolution ou par la présence relativement importante d’écoles confessionnelles. Dans le conservatisme, les universités d’élite sont perçues comme des adversaires des Etats-Unis.
Quelle est l’erreur de ces institutions à leurs yeux?
Des conservateurs critiquent la composition des facultés, surtout en sciences sociales et humaines. Sur le plan idéologique, le milieu universitaire aux Etats-Unis ne serait pas

diversifié. Il est vrai que, jusqu’à la fin des années 1990, des enquêtes montraient que moins de 50% du corps enseignant se considérait comme progressiste ou très progressiste. Dans un sondage actuel de l’Université Harvard, cette part dépasse les 75%, et moins de 3% se disent conservateurs. Cela entraîne une ségrégation des thèmes et des personnes. Dans mon domaine, la théorie politique, j’ai moins de chances de publier dans de prestigieuses revues si j’aborde des sujets conservateurs. Un de mes amis a été harcelé au sein de sa faculté parce qu’il était le dernier conservateur, très modéré, de l’établissement. Les gens aux opinions conservatrices se regroupent donc dans certaines universités telles que le Hillsdale College chrétien, l’Université évangélique Liberty et l’Université mormone Brigham Young.
C’était donc une erreur d’exclure les conservateurs?
La diversité importe à tous égards, y compris l’idéologie qui devrait aussi être représentée dans les universités. La tendance décrite n’est pas totalement nouvelle et existe aussi en Europe, mais la situation est plus explosive aux Etats-Unis et touche des institutions au statut plus élevé, considérées comme des tremplins vers le pouvoir, telles Harvard, Yale, Princeton et Columbia. Ces dernières années, deux facteurs ont contribué à l’hostilité envers les universités: la liberté d’expression et les politiques de diversité, d’égalité et d’inclusion, dites DEI.
Pourquoi?
Au cours des dernières décennies, les universités d’élite en particulier ont restreint les possibilités d’exprimer et de débattre des idées conservatrices. Les étudiants et étudiantes doivent pouvoir se sentir psychiquement et
Claudia Franziska Brühwiler (43), professeure de pensée et culture politiques américaines à l’Université de Saint-Gall, a lancé le podcast Grüezi Amerika peu après les dernières élections présidentielles aux Etats-Unis. Elle a effectué divers séjours de recherche dans différentes universités américaines et enseigne la politique, l’histoire et la culture des Etats-Unis. Elle est très prisée en tant que commentatrice des développements actuels.
physiquement en sécurité, y compris en ce qui concerne les idées. La censure de certains a aussi été attisée par des étudiants qui ne voulaient pas se sentir mal à l’aise. Ce fut le cas de Linda Thomas-Greenfield, l’ambassadrice des Etats-Unis auprès de l’ONU, qui a mis son veto à trois résolutions appelant à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, ce qui lui a valu de nombreuses annulations d’invitations.
Cela touche à la liberté de pensée. Qu’en est-il des politiques DEI?
Nous avons le devoir de créer des conditions égales pour tous. Certaines mesures de protection sont nécessaires, comme celles destinées à la protection des personnes en situation de handicap ou neurodiverses ou à la prévention du suicide. Bien des mesures sont toutefois allées au-delà. L’Université de Virginie a engagé six personnes DEI pour 100 membres du corps enseignant pour 20 millions de dollars. C’était soit un mauvais investissement, soit un investissement idéologique – aujourd’hui, elle réduit drastiquement ce budget.
Vous approuvez donc la politique de l’actuel gouvernement Trump?
Non, non, non! Mon devoir est de comprendre et d’expliquer les phénomènes, car ce n’est qu’ainsi qu’on peut trouver des solutions. Une adaptation du système universitaire des EtatsUnis était nécessaire à mon avis, mais cela va trop loin. Les agissements radicaux préoccupent également beaucoup d’intellectuelles conservatrices. Elles ne s’attendaient par exemple pas à des attaques contre les sciences naturelles et la recherche médicale.
Ces décisions imposées d’en haut affectent aussi la liberté académique. Oui. Avant cette présidence, la liberté d’expression était déjà restreinte, mais cela émanait d’un consensus au sein de la communauté universitaire. Cela n’était pas imposé par des mesures aussi brutales et il était possible de critiquer ouvertement les restrictions. C’est là que réside l’ironie majeure de l’action du gouvernement: au nom de la liberté d’expression, il a restreint la liberté d’expression, d’idées et de recherche, et ce, avec des mesures pires encore que celles qu’il reproche à l’autre camp.
Quel est l’impact de cette politique sur place?
Elle est destructrice et contre-productive. La jeune relève, en particulier en sciences naturelles et en médecine, dépend du financement fédéral. De nombreux projets sont gelés parce
qu’ils utilisent des mots-clés qui ne sont plus en vogue. Comme de nombreux accords de financement ne sont pas respectés, le gouvernement est aujourd’hui le partenaire le moins fiable qui soit. Des scientifiques de renom quittent le système américain ou prévoient de le faire. La dominance scientifique américaine est menacée. Elle représente la majeure partie du soft power du pays, la possibilité de fixer des thèmes de recherche.
La situation actuelle impacte-t-elle également votre travail?
Je n’ai pas de projets avec des collègues américains. Cela ne m’affecte qu’indirectement, car je m’exprime beaucoup sur la politique étatsunienne. Je dis très ouvertement que je considère cette attaque contre la science comme grave et illégale, même si je comprends d’où elle vient. Si je rappelle la longue histoire dans laquelle elle s’inscrit, les gens pensent que j’approuve ces mesures. Ce n’est pas le cas. Mes collègues ne choisissent pas simplement de partir: ils travaillent, observent et commentent ce qui se passe. Cela devient problématique lorsqu’ils dépendent de fonds fédéraux.
Quatre professeurs américains n’ont pas souhaité donner une interview au sujet de l’antiscience aux Etats-Unis. Certains commentateurs affirment que la science s’arrange avec le nouveau gouvernement. Devraient-ils faire plus de bruit?
Beaucoup d’entre eux attendent certainement encore. On sait que l’administration Trump se montre souvent d’abord radicale, mais que des compromis sont possibles par la suite. Et le silence n’est pas total. Je vois beaucoup de mouvements et de commentaires, aussi de la part de hautes écoles conservatrices. Dans les institutions, nombreux sont ceux qui considèrent plus judicieux de s’adapter quelque peu.
Dans votre podcast «Grüezi Amerika», vous tirez des parallèles entre les démocraties américaine et suisse. La crise va-t-elle aussi toucher notre pays?
Je ne le pense pas. Le fossé entre le peuple suisse et les universités n’est pas si grand, et la méfiance et l’animosité envers le monde académique, moindre. Les Suisses s’identifient plus, avec fierté, à leurs institutions fédérales et à leurs hautes écoles.
Emiliano Feresin est journaliste scientifique indépendant à Genève.
Pouvoir accéder facilement à la procréation médicalement assistée dépend de ses ressources financières, mais aussi de sa conformité aux normes sociales. Aperçu des nombreuses inégalités d’un marché florissant.
Texte Samuel Schlaefli
La qualité du sperme baisse et les grossesses surviennent toujours plus tard. Conséquence: les risques d’un désir d’enfant inassouvi, notamment dû à l’âge, augmentent. En Suisse, entre 6000 et 7000 couples recourent chaque année à la procréation médicalement assistée qui inclut la stimulation hormonale de l’ovulation, l’insémination artificielle (spermatozoïdes placés à proximité immédiate des trompes de Fallope), des méthodes de fécondation in vitro (FIV), ainsi que la congélation de sperme et d’ovules. Rien qu’en Suisse, une trentaine de centres de procréation médicalement assistée proposent diverses techniques de reproduction, et il en existe des milliers dans le monde. «Le désir d’enfant est devenu un marché florissant, note Carolin Schurr, professeure de géographie sociale et culturelle à l’Université de Berne. Des consortiums transnationaux gagnent beaucoup d’argent avec le sperme, les ovules, la FIV et les technologies reprogénétiques.» On estime que le marché mondial de la fertilité atteindra entre 40 et 80 milliards de dollars d’ici à 2030.
Don d’ovules rarement altruiste
En Suisse, la réglementation de la médecine reproductive est stricte par rapport à d’autres pays d’Europe: outre la maternité de substitution, le don d’ovules y est interdit. En 2019, 500 couples ou personnes seules sont allés à l’étranger pour accéder à des techniques de reproduction, selon une étude menée par l’équipe de la chercheuse en collaboration avec le Centre interdisciplinaire pour la recherche en études de genre de l’Université de Berne. C’est une approximation, les auteures estimant que le tourisme reproductif est nettement plus fréquent. Le don d’ovules concernait quelque 80% des cas, avec le plus souvent un voyage
en Espagne, considérée comme première destination européenne dans ce contexte. Carolin Schurr déplore que la perspective des personnes souhaitant avoir un enfant domine le débat public sur le don d’ovules. Son équipe s’intéresse donc aux expériences des donneuses et en a interrogé 30 en Espagne. «Le don altruiste est une illusion. Le don d’ovocytes a presque toujours des motifs économiques.» Parmi les interviewées figuraient des femmes touchées par la précarité, mais aussi des femmes issues de la classe moyenne qui utilisaient cet argent pour payer des études ou subvenir aux besoins d’un proche. En Espagne, les donneuses d’ovocytes ne reçoivent pas de salaire, mais une compensation de 1000 euros environ par don. «Certaines ont fait jusqu’à 20 prélèvements d’ovules, raconte la géographe. Pour elles, c’était un simple travail.» Un travail très risqué: selon une expertise de l’ONG allemande Gen-ethisches Netzwerk, le don d’ovules peut entraîner un syndrome d’hyperstimulation ovarienne potentiellement mortel, l’infertilité et des troubles psychosociaux.
Selon Carolin Schurr, la notion de don suit aussi le stéréotype de genre selon lequel les femmes fournissent des prestations reproductives par amour: «Médecins et laborantines gagnent de l’argent avec ces procédures. Pourquoi pas les donneuses?» De nombreuses féministes rejettent aujourd’hui catégoriquement le don d’ovules: les personnes précarisées du sud ou de l’est de l’Europe et dans les pays du Sud seraient exploitées pour satisfaire le désir reproductif des riches. En Suisse, on discute aussi actuellement de la forme que pourrait prendre un don d’ovules équitable. La Confédération a réagi à la demande croissante et a fixé, fin janvier, les grandes lignes pour une autorisation à partir de 2026.
Les sciences sociales s’intéressent de longue date à l’équité en matière de procréation, de contraception et d’avortement qu’elles considèrent comme autant de facettes d’un même thème complexe. Aux Etats-Unis, dans les années 1990, des femmes afro-américaines ont élaboré le concept militant de justice reproductive. Pour elles, pouvoir disposer de son propre corps et décider librement d’avoir un enfant ou non dépend aussi de facteurs socioéconomiques et de l’accès aux ressources. Carolin Schurr s’y réfère dans sa recherche. Avec une équipe de huit personnes, elle examine comment la procréation est guidée de manière ciblée sur le plan politique et quelle reproduction est souhaitée et à qui elle est refusée.
Trop pauvres pour la contraception
De telles inégalités apparaissent de manière exemplaire dans un projet de Milena Wegelin. L’anthropologue de la Haute école spécialisée bernoise étudie avec sa collègue Laura Perler la situation des femmes enceintes dans les centres d’asile. A cette fin, elle a notamment mené des entretiens avec des femmes arabophones dans le canton de Berne. Malgré un désir d’enfant, elles sont nombreuses à renoncer à la grossesse une fois arrivées dans un centre. «La situation des femmes enceintes est particulièrement précaire dans les centres d’asile fédéraux, note la chercheuse. Elles sont nombreuses à ne pas manger assez, n’ayant pas la possibilité de satisfaire les besoins alimentaires spécifiques d’une grossesse et de cuisiner.» Et il manque parfois des lits d’accouchement et des espaces pour allaiter. «Simultanément, il leur est difficile de ne pas tomber enceintes, n’ayant souvent pas accès à la contraception.» L’aide sociale ne suffit pas à payer la pilule, par ex-emple. D’où une situa-

aussi semée d’embûches et d’inégalités.
«Les groupes dominants dans la société sont souvent encouragés à la procréation.»
Nicole Bourbonnais
tion paradoxale: les requérantes d’asile tombent enceintes malgré elles ou sont privées de conditions adéquates pour mener une grossesse dans les hébergements collectifs. En parallèle, des Suissesses dépensent des fortunes pour réaliser leur désir d’enfant à l’étranger. Les injustices dans le domaine de la procréation ont une longue histoire, note Nicole Bourbonnais, chercheuse au Geneva Graduate Institute. Elle a publié au printemps un ouvrage sur la politique de la reproduction au XXe siècle. «Les politiques eugéniques ont promu la stérilisation forcée dans une série de pays au début du XXe siècle, comme plus tard des programmes de contrôle de la démographie», note l’historienne canadienne. Des cas de stérilisation forcée se produisent tou-
jours, ciblant en général des groupes marginalisés et des minorités ethniques ainsi que des personnes indigentes ou atteintes d’un handicap. «Les groupes dominants sont souvent encouragés à procréer, tandis que les minorités sont soumises à des pressions ou délibérément empêchées de le faire.» Cette politique a aussi touché les personnes trans en Suisse jusqu’en 2017. Lors d’une opération de réassignation sexuelle, les femmes biologiques devaient se faire stériliser afin que leur nouveau sexe soit officiellement reconnu. «La société voulait absolument éviter qu’il y ait des hommes enceints ou des femmes qui fécondent», note Tanja Krones, spécialiste en éthique clinique à l’Hôpital universitaire de Zurich. La société majoritaire partait de plus
aveuglément du principe que les personnes trans ne veulent pas d’enfants. «Toute une génération n’a jamais pu procréer en raison de stérilisations forcées.» Celles-ci n’ont été abolies en Suisse qu’en 2017, grâce à une décision de la Cour européenne des droits de l’homme.
La Suisse en queue de peloton européen Tanja Krones codirige le Pôle de recherche Human Reproduction Reloaded à l’Université de Zurich, qui met l’accent sur les technologies médicales de procréation et leurs conséquences sociologiques, éthiques et juridiques. Le Special Interest Group Transgender and Gender Diversity, créé en 2024, regroupera aussi les recherches dans ce domaine. Le savoir acquis sera ultérieurement intégré dans la formation des médecins.
Pour Tanja Krones, la Suisse a un grand retard en matière de justice reproductive. Selon l’Organisation mondiale de la santé, l’absence involontaire d’enfant après un an de rapports sexuels non protégés est par exemple considérée comme maladie. L’OMS recommande donc aux Etats de considérer la fécondation in vitro comme partie intégrante de la santé reproductive. De nombreux pays européens –dont la France, la Belgique, la Suède et le Danemark – prennent déjà en charge les coûts de la FIV, en général aussi pour les couples lesbiens et les femmes célibataires. Mais pas la Suisse. Une injustice, estime Tanja Krones: «La question se pose inévitablement: qui peut se permettre d’avoir des enfants en Suisse?» Car la recherche le montre clairement: le marché mondial de la reproduction connaît de profondes inégalités.
Samuel Schläfli est journaliste indépendant à Bâle.
Semblables aux bactéries en apparence, mais plus proches des cellules humaines par leur fonctionnement, les archées alimentent les débats évolutionnistes.
D’après la théorie dominante depuis 2015, nous descendons de ces organismes sans noyau.
Texte Sophie Rivara
L’arbre universel de la vie permet de remonter au dernier ancêtre commun de deux espèces. Il retrace l’évolution du vivant. On y trouve, d’un côté, les bactéries et, de l’autre, un embranchement menant aux cellules dotées d’un noyau – les eucaryotes – qui ont donné naissance aux animaux, plantes et champignons. Mais un troisième groupe d’organismes est venu semer le trouble dans les classifications: les archées, identifiées en 1977. Car malgré leur apparente similitude avec les bactéries, ces cellules pourtant dépourvues de noyau ont un fonctionnement plus proche de celui des eucaryotes.
Le débat a longtemps fait rage pour savoir si les eucaryotes – et donc les humains – n’étaient qu’une sorte d’archées parmi d’autres ou si les deux groupes étaient séparés et distincts. En 2015, la découverte des archées d’Asgard, proposées comme le maillon manquant de l’évolution, a rebattu les cartes. Leur proximité avec les eucaryotes leur a valu d’être rapidement admises par la grande majorité des biologistes comme nos ancêtres, corroborant un modèle dans lequel nous apparaîtrions au beau milieu des archées.
Un consensus auquel l’évolutionniste Patrick Forterre, professeur émérite à l’Université Paris-Sarclay et à l’Institut Pasteur, n’adhère pas. «Pour reconstituer l’arbre de l’évolution, on compare des protéines conservées au sein du vivant. Or, selon la protéine utilisée, on obtient différents arbres, qui nous placent tantôt au sein des Asgards, tantôt

fait que l’organisme unicellulaire dispose d’un squelette cellulaire – à l’instar des cellules humaines.
hors des archées», détaille le chercheur. Pour lui, ces résultats ne s’expliquent que si les ancêtres des eucaryotes se sont effectivement séparés des archées, mais ont ensuite évolué en association avec des Asgards, échangeant certains gènes au gré de leur cohabitation. «Notre apparentement direct aux Asgards est un artefact qui apparaît lorsque l’on compare toutes les protéines simultanément. Mais dans les deux cas, les Asgards sont intéressantes et ont joué un rôle lors de l’évolution des eucaryotes.»
Modèle pour les cellules humaines
Si elle partage cet intérêt pour ces archées, l’évolutionniste et microbiologiste Anja Spang n’est pas convaincue de la théorie de Patrick Forterre. «En construisant des arbres sur une seule protéine à la fois, on n’obtient pas la puissance statistique nécessaire pour remonter 2 milliards d’années d’évolution», explique la professeure à l’Université d’Amsterdam. Spécialiste des archées, elle a contribué à découvrir les Asgards avec Thijs Ettema et des collègues. «Les débats sont bons pour la science, mais il est important de se focaliser sur les preuves existantes, continue-t-elle. Les modèles phylogénétiques les plus réalistes combinés à un ensemble non biaisé de protéines ont apporté un soutien statistique à l’émergence des eucaryotes au sein des Asgards.» Pour elle, le nouveau débat a trait au niveau de complexité de l’ancêtre asgardien des eucaryotes.
«Les biologistes de l’évolution aiment proposer des hypothèses contradictoires, ça rend le débat intéressant», relève Martin Pilhofer, professeur de l’ETH Zurich. Lui-même microbiologiste et spécialiste de microscopie à haute résolution, il étudie l’armature cellulaire, appelée «cytosquelette». Cette structure essentielle pour la division ou le déplacement de nos cellules est par exemple la cible de nombreuses chimiothérapies. La découverte des archées d’Asgard en 2015 a éveillé l’intérêt de Martin Pilhofer. «Je guettais le premier groupe capable de les cultiver qui voudrait bien collaborer avec moi!» se souvient-il. Un projet concrétisé avec la microbiologiste Christa Schleper, de l’Université de Vienne. Leurs collaborations ont mis en avant des cytosquelettes déjà très développés chez les archées d’Asgard, «un élément crucial pour permettre leur complexification vers les eucaryotes», selon le chercheur. Des découvertes qui dépassent la quête de nos origines: «Les versions asgardiennes des microtubules peuvent aussi directement servir d’outils pour étudier les nôtres. Avec de potentielles applications en oncologie.»

Les pores du béton absorbent les fréquences plus basses du trafic routier. Lorsque des plantes y poussent, les fréquences plus hautes encore audibles peuvent également être filtrées.
Diminuer le bruit des villes – un postdoc a imaginé un matériau adapté à cette mission et a fondé une start-up pour concrétiser son projet.
Texte Lionel Pousaz
Un béton acoustique tout en cavités, qui absorbe les bruits urbains et œuvre en même temps en faveur de la biodiversité en fournissant un habitat à de petites espèces végétales et animales. C’est le projet de Vasily Sitnikov, postdoc à l’ETH Zurich. Pour ce faire, il coule du béton autour d’une forme en glace. En fondant, la glace laisse la place à une structure creuse dans le béton. Le chercheur en matériaux vient de lancer la start-up Ice Formwork pour développer cette technique. Pour l’heure, il en teste le potentiel commercial avec des acteurs privés dans le domaine de la construction, de l’urbanisme et de la protection de l’environnement.
C’est en Suède, à l’Ecole royale polytechnique de Stockholm, qu’il a eu pour la première fois l’idée d’utiliser la glace pour obtenir une structure creuse dans le béton. Les pro-
cédés conventionnels se prêtaient mal à son projet. L’injection de gaz dans le béton liquide génère des cavités trop petites pour absorber les sons de basse et moyenne fréquence, particulièrement typiques des milieux urbains. L’impression 3D, quant à elle, ne permet pas de produire en masse.
«A l’époque, certains de mes collègues expérimentaient la cire synthétique pour créer des creux dans le béton, explique Vasily Sitnikov. Je me suis demandé si nous pouvions utiliser quelque chose de plus écologique que ces matériaux pétrochimiques, et j’ai pensé à l’eau. C’était un pari un peu fou.»
Réduire la température de solidification
Le principal défi était d’obtenir un matériau capable de durcir au-dessous du point de congélation. Les bétons conventionnels se
solidifient à un minimum de 5 °C: à cette température, la structure provisoire en glace fondrait avant que le matériau n’ait le temps de s’affermir. Le postdoc a donc dû développer une série d’additifs chimiques qui permettent au béton de durcir à des températures comprises entre -10 °C et -5 °C.
Pour moduler les propriétés acoustiques du matériau, le chercheur a joué sur la taille des creux obtenus dans le béton final. Il a ciblé les ondes sonores de moyenne à basse fréquence, entre 250 Hz et 4 kHz. «C’est typiquement la gamme de fréquences produites par le trafic automobile, par exemple le bruit d’un pneu sur la route.» Mesurant 1 mètre de côté pour une profondeur de 20 centimètres, les panneaux sont testés acoustiquement avec un ensemble de microphones qui enregistrent l’absorption et les réflexions des ondes sonores sur le matériau.
Ce béton ne permettant pas de filtrer les sons de plus haute fréquence, toujours audibles pour l’humain, Vasily Sitnikov a imaginé utiliser les creux du matériau pour y faire pousser de la végétation, à la manière d’un jardin vertical. En effet, la verdure a précisément comme propriété d’absorber ce type de bruits. Ce faisant, il allait découvrir une seconde application pour son béton, complémentaire ou totalement distincte: un espace pour la biodiversité. Outre les plantes, les petits animaux peuvent aussi prospérer dans les trous du matériau. Une propriété intéressante en ville, et plus encore dans les écosystèmes marins. «Nous travaillons aussi avec des biologistes sur un concept de récifs artificiels», se réjouit le chercheur.
Si le procédé est avant tout destiné à occuper une niche, des dires mêmes de son inventeur, le potentiel industriel est réel. Il est déployable à grande échelle, en usine et aussi directement sur les chantiers – à condition que l’on dispose d’assez d’espace pour installer un container réfrigérant, explique Vasily Sitnikov. «Il suffit de déployer des équipements destinés au transport réfrigéré et d’y installer les lignes de production.»
Lionel Pousaz est journaliste scientifique indépendant à New York.
Le sucre rend malade. Une équipe irano-suisse voulait clarifier l’impact des édulcorants sur la santé à l’aide d’une étude clinique. Celle-ci n’a pas pu être menée, victime des sanctions économiques contre l’Iran. Récit d’un périple scientifique.
Texte Florian Fisch
Pour Hamidreza Raeisi-Dehkordi, décembre 2022 fut un mois difficile. Il avait consacré deux ans à préparer une étude clinique, pour finalement assister à son enterrement. Auparavant, le jeune chercheur iranien avait obtenu un Master en sciences de la nutrition dans la ville de Yazd, à quelque 250 kilomètres au sudest d’Ispahan. Il voulait étudier l’effet des édulcorants chez les femmes souffrant d’obésité durant la ménopause. Avec l’aide de son directeur de thèse de master, il avait rédigé sa demande de subvention au programme Spirit du Fonds national suisse, qui soutient des collaborations de recherche avec le Sud global et met un accent particulier sur la sensibilisation aux questions de genre.
Le plan était de venir à Berne en février 2021 pour y effectuer l’analyse scientifique. Mais la pandémie de covid l’empêcha d’obtenir un visa. «C’était une situation difficile, raconte le chercheur. Je travaillais sans salaire, vivais chez mes parents et devais faire le service militaire obligatoire parce que je n’avais pas trouvé d’emploi immédiatement après mes études.»
En décembre de la même année, tout s’arrangea enfin. Pendant deux ans, il s’occupa de tout préparer en Iran et en Suisse: le protocole d’étude, les autorisations de la commission d’éthique et de l’Université de Yazd. Mais il ne devait pas en être ainsi.
Pourtant, l’étude aurait été très importante pour plusieurs raisons: la surconsommation mondiale de sucre provoque des caries, l’obésité et toute une série de maladies chroniques dont le diabète de type 2. L’industrie alimentaire et la population misent donc sur des édulcorants tels que l’aspartame, la saccharine et la stévia. Mais leurs effets sur la santé sont controversés. En 2024, l’OMS a même classé l’aspartame comme «potentiellement cancérigène». Cela avait suscité une vive polémique. Les connaissances scientifiques à ce sujet sont insuffisantes: les mécanismes du métabolisme sont avant tout connus grâce à des études menées sur des animaux, et ne peuvent être transposés à l’être humain que de manière limitée.
En outre, les études d’observation réalisées chez les humains ne permettent pas de stinguer clairement entre les causes et les effets. «Nous savons que l’obésité est associée au diabète de type 2», explique Angéline Chatelan, professeure d’épidémiologie nutritionnelle à la Haute école de santé de Genève. Par contre, on ne sait pas exactement quel rôle précis joue le sucre, ni si les édulcorants sont vraiment meilleurs. C’est pourquoi elle a conçu l’étude clinique avec le doctorant Hamidreza Raeisi Dehkordi et une équipe de recherche. L’objectif était de tester les effets de l’aspartame, de la saccharine, de la stévia et du sucre de table
«Il faut différencier les effets de l’édulcorant de ceux du cycle menstruel.»
Angéline Chatelan
sur les bactéries intestinales, ainsi que sur le poids, la glycémie, les marqueurs de la santé cardiovasculaire et les hormones sexuelles. Au total, 160 Iraniennes ménopausées et souffrant d’obésité ont reçu chaque jour un flacon d’une solution aqueuse contenant l’édulcorant qui leur avait été attribué, raconte la chercheuse.
La ville iranienne de Yazd – terrain idéal Les femmes sont globalement sous-représentées dans les études cliniques, car se baser sur des hommes est souvent plus facile. Cela est également lié aux hormones, explique Angéline Chatelan en prenant l’exemple de sa propre étude qui a échoué: «Il faut différencier les effets de l’édulcorant de ceux du cycle menstruel. De plus, de nombreuses femmes prennent la pilule contraceptive.» Coordonner les prélèvements de sang, d’urine et de selles avec le cycle de chaque participante – comme
prévu dans l’étude – aurait représenté un trop grand défi pour le personnel hospitalier. Une option intéressante était donc de travailler avec des femmes ménopausées, qui ont cessé d’avoir leurs règles. Elles consomment certes moins d’édulcorants que les femmes jeunes –les principales consommatrices –, mais elles présentent un risque accru de développer une surcharge pondérale.
L’étude devait être menée en Iran, car «les pays du Moyen-Orient font partie des plus touchés par les problèmes de surpoids», dit l’épidémiologiste. A Yazd, environ la moitié des femmes ménopausées souffrent d’obésité. De plus, les édulcorants n’y sont pas encore aussi répandus qu’en Suisse, par exemple. C’est donc un terrain propice pour étudier de petits effets sur les bactéries intestinales. Les sciences de la nutrition sont aussi très développées en Iran. Amin Salehi-Abargouei, partenaire iranien du projet et professeur à l’Université des sciences médicales Shahid Sadoughi à Yazd, le confirme: «Les sciences nutritionnelles sont enseignées en Iran depuis 1961.» Il parle de 46 départements, 23 centres de recherche et 2100 publications par an sur le sujet.
Les conditions auraient donc été idéales. Les sanctions économiques internationales ont cependant fait capoter le projet: il n’existait aucun moyen légal de transférer de Suisse en Iran les 20 000 francs destinés aux salaires du personnel de l’étude clinique. Ce fut une grande déception pour Amin SalehiAbargouei: «Je suis d’avis que les questions politiques et l’embargo ne devraient pas affecter la recherche, et en particulier les collaborations scientifiques portant sur la santé.»
Pour le doctorant Hamidreza Raeisi-Dehkordi, il y allait aussi de son emploi. Après deux ans de préparation, il se trouvait désormais bloqué à Berne, sans projet de recherche. L’équipe qui l’encadre – Angéline Chatelan, Amin Salehi-Abargouei et Oscar H. Franco, professeur de santé publique à l’Institut de médecine sociale et préventive de l’Université de Berne – lui en a donc proposé un autre qui

porte sur les hormones sexuelles ainsi que sur la santé cardiovasculaire chez les femmes. Pour le jeune Iranien, l’étude sur les édulcorants devenait secondaire. L’équipe, elle, ne l’a pas abandonnée et a décidé de se concentrer sur deux projets dérivés. Dans le premier, un travail de synthèse des études existantes a été effectué pour rassembler les connaissances disponibles sur les liens entre édulcorants et maladies. Résultat: les édulcorants puissants sont bel et bien associés à un risque plus grand de diabète, de maladies cardiovasculaires et de divers cancers. «Il faut toutefois noter que ces corrélations ne sont pas de grande ampleur», écrit l’équipe. Angéline Chatelan souligne qu’«on ne sait pas ce qui vient d’abord: les gens qui consomment le plus d’édulcorants sont probablement déjà en surpoids».
L’étude aurait été si importante C’est précisément pour éviter de telles corrélations trompeuses que l’étude clinique en Iran aurait été nécessaire. Analyser les données des cohortes existantes était désormais la solution la plus proche. Le second sous-projet tire ainsi parti d’une étude qui documente systématiquement depuis 2011 le mode de vie et la santé de près de 25 000 personnes vivant à Ams-
terdam. Avec son directeur de thèse Oscar Franco, Hamidreza Raeisi-Dehkordi a déménagé de Suisse aux Pays-Bas, notamment pour se rapprocher de la cohorte.
La cohorte d’Amsterdam était la seule dont le groupe pouvait obtenir les données dans un délai raisonnable. «L’open science n’est pas toujours très open», explique Angéline Chatelan. Selon elle, les responsables de ce type d’études souhaitent souvent publier d’abord leurs propres résultats. Et la protection de la sphère privée des patientes et des patients rend les procédures fastidieuses. A cela s’ajoute une pénurie de spécialistes pour l’analyse des bactéries intestinales en Europe. L’étude réalisée avec les données des Pays-Bas n’a pas encore été publiée, mais l’épidémiologiste confie néanmoins son impression: «Mon intuition me dit que nous ne pouvons pas affirmer que le microbiome intestinal est influencé par les édulcorants.» Mais même si cela était clair, il faudrait encore démontrer que les bactéries intestinales sont réellement responsables de l’augmentation du risque pour la santé. Ce n’est qu’alors que le lien de causalité serait complet», indique-t-elle.
Tirer une conclusion définitive exigerait de mener une étude clinique comme celle initia-
lement prévue. «En réalité, il faudrait étudier les effets de chaque édulcorant, à court terme, immédiatement après l’ingestion, mais aussi à long terme», note Anne Christin MeyerGerspach, codirectrice de la recherche sur l’obésité, le diabète et le métabolisme au Claraspital de Bâle. Elle estime que «le projet en Iran aurait été formidable. Il aurait enfin permis de mener une étude d’intervention auprès du groupe qui nous intéresse précisément.» Elle souligne toutefois que le sucre reste nettement plus nocif que les édulcorants courants. L’OMS fixe des exigences de sécurité très strictes pour ces derniers. Elle en est donc convaincue: «Il faudrait tout d’abord réduire de façon générale la saveur sucrée des produits. Ensuite, nous pourrions remplacer dans des proportions moindres le sucre restant par des alternatives comme les édulcorants.»
Seul Hamidreza Raeisi-Dehkordi s’occupe encore de la dernière partie du projet, liée à la cohorte restante d’Amsterdam. A cause des retards dus aux problèmes de visa, il a encore le temps de la finaliser et de la publier. Elle constituera au moins une partie de sa thèse.
Florian Fisch est codirecteur de la rédaction d’Horizons.

Etudiante, navigatrice et écrivaine
Margot Camus-Romelli a entamé en 2019, à l’âge de 17 ans, ses études à l’EPFL, où elle poursuit un Master en sciences de la vie. Elle y a fondé et présidé l’association estudiantine Sailowtech, qui développe des instruments scientifiques avec des technologies simples et mène des campagnes scientifiques lacustres et marines. Elle a dirigé une expédition de quatorze mois dans l’Atlantique Nord et achève actuellement l’écriture de son premier livre. Elle est née à Tunis et a grandi en Bretagne. Son grandpère était marin et son arrièregrandpère aviateur.
Margot Camus-Romelli a obtenu son baccalauréat à 15 ans, a fugué à 16 ans et organisé deux ans plus tard une expédition scientifique dans l’Atlantique Nord. Elle déborde d’idées, mais aussi de questions sur le sens de la vie.
Texte Daniel Saraga Photos Sébastien Agnetti / 13Photo
«Ma phobie, c’est d’être derrière un bureau. Et c’est compliqué d’éviter ça quand on est ingénieure. Enfin, pour faire simple.» Compliqué contre simple: un premier contraste qui en annonce tant d’autres. En une heure et demie d’entretien, Margot Camus-Romelli virevolte entre biologie marine et mélancolie, désert et apnée, littérature et expérience de mort imminente. A 22 ans, l’étudiante en master à l’EPFL a dans la tête autant de projets que de questionnements. Une fonceuse qui ralentit une fois sur les flots, une performeuse pleine de doutes à la personnalité tourbillonnante.
A la fin du covid, à 19 ans, elle lance à l’EPFL une association estudiantine pour monter des expéditions scientifiques maritimes et lacustres. Elle est alors en deuxième année de bachelor. Sailowtech veut contribuer à préserver les océans en récoltant des données scientifiques sur les planctons et leur environnement. Il s’agit aussi de démocratiser la science et d’amener ses collègues à faire l’expérience des écosystèmes aquatiques. La jeune femme gère un budget de 180 000 francs, trouve des sponsors et tisse des collaborations avec des instituts de recherche océaniques.
Le «low-tech» caché dans le nom de l’association l’indique: il s’agit aussi de créer une science plus frugale. Etudiants et chercheuses fabriquent trois des instruments embarqués, dont une caméra d’observation sous-marine et un capteur mesurant la température de l’eau, sa conductivité électrique et sa profondeur. «J’ai voulu montrer qu’on peut faire de la recherche de bonne qualité de manière économique, tout en réduisant son impact environnemental, explique Margot Camus-Romelli. La science est encore trop souvent élitiste, pécuniaire et peu respectueuse de l’environnement.»
En mer, toutes les certitudes sont bouleversées
Le premier projet se nomme Atlantea: quatorze mois en mer, 25 000 km parcourus dans l’Atlantique Nord, et des centaines d’analyses et d’échantillons comprenant l’observation de plus de 300 espèces de planctons. L’équipage se compose d’un skipper, de six étudiantes et étudiants, dont deux changent tous les trois ou quatre mois. La vie à bord est rythmée par les prises d’échantillons d’eau quotidiennes et les analyses, les tâches courantes et la navigation. Les journées au port sont passées à transmettre les données, envoyer des échantillons pour des analyses génétiques et se coordonner avec les équipes de recherche partenaires. Margot Camus-Romelli est l’une des coordinatrices scientifiques, elle identifie les planctons au microscope, gère l’intendance, cuisine.
D’un côté, «la vie est facile sur un bateau», dit la jeune Française. «Car même si les conditions sont dures, sans confort et qu’on n’a pas d’espace, on doit se laisser aller. On n’a pas de téléphone, pas d’internet, on va d’un point A à un point B. Ce sont la météo et le rythme des jours et des nuits qui dictent notre itinéraire.» De l’autre, l’expérience déclenche chez elle une profonde remise en question: «J’avais porté le projet à bout de bras sur terre, mais une fois en mer, mes certitudes se sont effondrées. C’est l’effet qu’ont eu sur moi l’immensité de l’océan et le froid intense vécu au Groenland à la fin de la mission. Je me suis rendu compte que les tâches de recherche à bord m’intéressaient moins que prévu, que j’avais de la peine à gérer le quotidien. Je me suis sentie vide, comme une imposteure qui aurait laissé tomber son équipe.» Elle passe beaucoup de temps à réfléchir, à s’immerger dans le paysage marin, à plonger avec bouteilles ou sans, en apnée.
Le retour à terre en août 2024 est rude: «Il m’a fallu plusieurs mois pour réaliser tout ce que l’expédition m’avait apporté. On revient de la mer totalement transformée, mais il semble que rien n’a changé sur
terre. On se trouve en décalage total.» Pour digérer cette étape, elle rédige un livre sur son expérience, qu’elle s’apprête à envoyer aux maisons d’édition. Il mêle réflexions personnelles, souvenirs d’enfance, poésies et dessins à l’aquarelle.
Elle a depuis quitté l’association et repris des études en master à l’EPFL, troquant la biologie marine contre la physiologie de la plongée – elle planifie un séjour aux Etats-Unis de huit mois pour étudier l’évolution de l’azote dans le corps humain à 100 mètres de profondeur. Une première motivation est de contribuer à la démocratisation de la plongée, qui permet de récolter des données scientifiques précieuses pour la protection des milieux marins. Une autre est que «cette activité est un vecteur d’émerveillement qui peut conduire à l’éveil des consciences. Il faut connaître cette expérience sensible absolument magnifique: être sous l’eau, rencontrer les êtres vivants qui peuplent la mer, voir un corail qui blanchit, ou un requin pris dans des filets.»
Elle insiste: «Sans l’océan, l’humain meurt.»
Recherche de sens après des expériences extrêmes
Née en Tunisie, Margot Camus-Romelli vit au Maroc jusqu’à l’âge de 6 ans, avant que sa famille ne s’installe en Bretagne. Elle retourne au Maghreb chaque année et, à 10 ans, elle fait l’expérience du désert: au sommet d’une dune, elle découvre un océan de sable s’étendant à l’infini. «Une chance inouïe», mais aussi «une expérience presque trop violente» qui lui imposera le besoin d’être constamment connectée à la nature. «A ce moment s’est ouvert quelque chose qui ne s’est jamais refermé. Toute ma vie, je me suis sentie comme une étrangère, à évoluer dans un monde que je ne comprends pas, trop brutal et trop déconnecté d’une temporalité plus douce» – un paradoxe pour celle qui court d’un projet à l’autre, et qui dit avoir énormément de difficultés à se poser.
Elle passe son bac par correspondance, à 15 ans. Elle fugue l’année suivante pour éviter les coups d’un père violent – il lui importe autant de ne pas cacher cet épisode de sa vie que de souligner l’importance de pardonner et d’avancer. Elle raconte encore une expérience de mort imminente, lorsqu’une investigation d’un problème cardiaque tourne mal à l’hôpital. Elle frôlera la mort une fois de plus lorsqu’elle pousse trop loin un entraînement d’apnée lors de l’expédition Atlantea.
Sa quête de sens semble loin d’être achevée. Elle travaille comme monitrice de voile, a rejoint un club d’apnée, participe à un concours d’éloquence et se forme au coaching – pas pour coacher les autres, mais elle-même. Son master inclut également un mineur en management: «Nous avons besoin des contributions des gens qui font de la science pour la science, mais ce n’est pas pour moi. Je veux contribuer à une science sur le terrain et peut-être moins ethnocentrée. Cela veut dire se frotter à des enjeux politiques, sociaux, sanitaires et économiques. J’ai aussi un grand rêve: travailler pour le CICR.»
Elle dit avoir une grande reconnaissance envers l’EPFL – qui lui a accordé une bourse à l’âge de 17 ans – et se sentir bien en Suisse. «Les gens ici ne sont pas les pantouflards qu’on décrit parfois. Ils sont entreprenants et ouverts à l’aventure.» La Suisse pourrait donc devenir un lieu d’ancrage permanent pour elle.
Daniel Saraga est journaliste scientifique indépendant à Bâle.

Bernardi, vice-présidente du Conseil de la recherche du FNS.
Des vents politiques inquiétants soufflent sur le monde académique et le rôle de la diversité dans l’excellence scientifique est à nouveau menacé. En mars 2025, le gouvernement américain a mis en place des restrictions au financement de la recherche et au recrutement dans des domaines qu’il juge politiquement sensibles, de la violence sexiste à la climatologie, en passant par la recherche sur les vaccins. Une collègue éminente professeure de sociologie qui occupe des postes des deux côtés de l’Atlantique écrit qu’aux Etats-Unis, elle et ses pairs ressentent de la «consternation, de la colère et de la peur», mais «se mobilisent» aussi par des dons ou «en œuvrant au nom de la résistance». Les scientifiques peuvent protester à travers la science, en soulignant la contribution inestimable de la recherche dans des domaines ciblés tels que la santé publique, la cohésion sociale et la sécurité.
Cette résistance n’est pas seulement politique, elle est épistémique. Elle défend un principe fondamental: une recherche rigoureuse et qui de l’impact exige la liberté intellectuelle et le pluralisme, et non des contraintes idéologiques. Il est bien entendu alarmant de voir les EtatsUnis, puissance scientifique mondiale, rejoindre des pays tels que la Hongrie, qui a interdit en 2019 les masters en études de genre pour marginaliser les recherches sur la diversité. Hélas, ce n’est pas sans précédent.
Il ne s’agit pas seulement de savoir qui peut poser des questions scientifiques, mais aussi quelles questions peuvent être posées. La diversité –en termes de sujets, de méthodes, de perspectives et de personnes –n’est pas un luxe en science. C’est une nécessité. Le savoir se nourrit de l’interaction entre discipline et rupture, entre précision analytique et ouverture à la complexité. Une recherche qui s’homogénéise sous la pression politique cesse d’être scientifique et devient tout autre chose.
Que ce soit par le retrait du financement de domaines spécifiques, la censure de sujets controversés ou la remise en cause des pratiques d’embauche et d’évaluation inclusives, les attaques contre la diversité dans la recherche atteignent sa qualité même. Le Fonds national suisse (FNS) défend ce principe avec conviction: l’excellence est indissociable de la diversité. Notre mandat est clair: soutenir la recherche de plus haut niveau dans tous les domaines avec intégrité, compétence et une confiance inébranlable dans la méthode scientifique.
Limiter arbitrairement la diversité dans la recherche préfigure un avenir de connaissances sélectives plutôt que d’excellence inclusive. Au FNS, nous choisissons cette dernière.
Save the date: ScienceComm25, les 3 et 4 septembre
Cette année, la ScienceComm25 aura lieu les 3 et 4 septembre au Square de l’Université de Saint-Gall. Placé sous la devise «Attention! Engage!» le congrès annuel de la communication scientifique suisse se penchera sur le défi d’attirer et retenir l’attention face à une surabondance d’informations. Organisé par la fondation Science et Cité, il constitue une plateforme de dialogue professionnel et de mise en réseau. Il met l’accent sur le réseautage, l’interaction et la participation. sciencecomm.ch
Dans l’objectif

Le concours FNS d’images scientifiques 2025 a récompensé 19 scientifiques. Allant des salons de coiffure au Lesotho au site archéologique de Teniky à Madagascar, en passant par les sous-sols lausannois habités par les vers de terre, les œuvres lauréates illustrent la diversité et l’évolution de la recherche, et reflètent les multiples perspectives des personnes qui la mènent. Les 400 travaux soumis sont à découvrir sur flickr.com, sous «SNSF Scientific Image Competition».
Près de 6000 projets encouragés
En 2024, le FNS a, à nouveau, alloué plus d’un milliard de francs à de nouveaux projets de recherche. Il a investi 960 millions dans l’encouragement ordinaire et 189 millions dans des mesures transitoires afin de pallier l’exclusion de la Suisse de certaines parties du programme européen Horizon Europe. La deuxième phase des pôles de recherche nationaux, dont les travaux se poursuivent depuis 2020, a par ailleurs commencé avec un financement reconduit à hauteur de 120 millions de francs. Fin 2024, près de 6000 projets qui impliquent 22 000 chercheuses et chercheurs étaient encouragés par le FNS dans les hautes écoles et autres institutions.
Au terme des négociations entre la Suisse et l’UE, les chercheurs et chercheuses suisses peuvent à nouveau participer à pratiquement tous les appels à projets d’Horizon Europe pour le programme de l’année 2025. Elles peuvent notamment postuler aux appels du Conseil européen de la recherche et aux actions Marie Sklodowska-Curie. Le FNS ne lancera plus d’appels à projets de remplacement. L’objectif reste une association complète à Horizon Europe, qui est essentielle pour la place scientifique et économique suisse.
Le Conseil fédéral veut réduire sa contribution au FNS d’environ 10%, soit de 270 millions de francs au total, pour 2027 et 2028. Le FNS s’y oppose et a pris position en conséquence dans le cadre de la procédure de consultation. La question de savoir si les coupures concerneront aussi l’année 2026 n’est pas encore claire. La décision est attendue pour le début de l’été. Si les allégements prévus pour 2027 et 2028 entraient en vigueur, le FNS devrait refuser 500 excellents projets supplémentaires. Il ne pourrait plus non plus soutenir près de 1500 postes dans les hautes écoles et autres institutions cantonales. Les conséquences affecteraient gravement l’économie, la société et la place scientifique suisses.
Le Conseil de la recherche est entré dans une nouvelle ère
Une étape majeure a été franchie le 1er avril dernier avec l’entrée en fonction du nouveau Conseil de la recherche du FNS, dirigé par son Comité et présidé par Torsten Schwede. Désormais structuré en cinq comités de programme et un comité pour la politique d’encouragement, le Conseil de la recherche compte 73 membres. Les quelque 1000 expertes et experts actifs dans ses comités d’évaluation soutiennent l’excellence scientifique suisse.
Photo: Ruben Hollinger

Le FNS a pris congé d’Angelika Kalt, partie à la retraite fin mars après dix-sept ans au sein de l’organisation. Œuvrant à différents postes, puis en tant que directrice à partir de 2016, elle a joué un rôle essentiel dans la professionnalisation et le développement du FNS. Ce dernier soutient aujourd’hui quelque 6000 projets et des dizaines de milliers de scientifiques. Aux côtés de son personnel, Angelika Kalt s’est engagée pour des instruments d’encouragement orientés vers l’avenir, des processus d’évaluation efficaces et une recherche d’excellence. Elle a en outre contribué à la réorganisation du Conseil de la recherche et du Conseil de fondation. Katrin Milzow et Thomas Werder Schläpfer lui ont succédé le 1er avril dernier, se partageant la codirection du FNS.
Le FNS propose un nouveau programme de leadership destiné aux bénéficiaires de subsides SNSF Starting Grant, Eccellenza et Prima. Ce programme offre aux chercheuses et chercheurs en début de carrière l’opportunité de renforcer leurs compétences pour mener des équipes diversifiées. Il vise à leur fournir des outils concrets pour créer un environnement de travail inclusif, comprendre le fonctionnement des hautes écoles et trouver un équilibre face aux défis d’une carrière scientifique et académique.
Poursuite du programme spécial de doctorat destiné aux médecins
Depuis 1992, l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) attribue chaque année un nombre limité de bourses compétitives dites MD-PhD en collaboration avec des fondations privées. Jusqu’en 2024, le FNS soutenait aussi ce programme. Aujourd’hui, plusieurs fondations ainsi que toutes les grandes facultés de médecine et l’EPFL mettent des fonds à disposition pour lancer au moins deux autres appels à projets en 2025 et 2026. Ces bourses offrent aux jeunes médecins qui s’intéressent à la recherche la possibilité de réaliser un doctorat en sciences naturelles, en santé publique, en recherche clinique ou en éthique biomédicale. samw.ch/fr/
La Jeune Académie suisse lance un podcast
La nouvelle série de podcasts Spark: Stories from Advocates for Global Change propose des entretiens menés par des étudiantes et étudiants avec un ou une experte sur des problématiques mondiales comme l’IA, les médias sociaux, les droits humains et le changement climatique. Lancé par la Jeune Académie suisse, ce podcast s’adresse aux 16-23 ans et offre un aperçu de la recherche trans- et interdisciplinaire. Spark vise à stimuler l’intérêt du public pour la science, à sensibiliser les jeunes aux thématiques internationales et à les inciter à embrasser une carrière scientifique qui réponde aux défis de demain. go.swissyoungacademy.ch/the-spark-podcast
Horizons 144, p. 16:
«Le vide qui n’est pas»
Source d’inspiration
Ce numéro m’a captivé durant quelques jours. La lecture des articles du dossier «Aux tréfonds du néant» a fait écho à mes propres manières d’aborder cette thématique existentielle. Dans ce contexte, les photographies de Jojakim Cortis et Adrian Sonderegger sont puissantes et stimulantes. Les illustrations pertinentes de Michael Raaflaub donnent à l’article de Daniel Saraga des contours saisissants. Les propos du philosophe de la physique Baptiste Le Bihan rapportés dans ce texte m’ont inspiré une réflexion approfondie, que je compte publier dans le magazine «Anzeiger für die Seelsorge».
Stephan Schmid-Keiser, théologien, Niklausen (LU)
Horizons 144, p. 19:
«Les multiples visages du zéro»
Un trop-plein de zéros
La chimère – un monstre des légendes grecques, une illusion composée d’un lion, d’une chèvre et d’un serpent – ne signifie rien d’autre que «rien». Et pendant longtemps, il n’existait également pas de chiffre pour zéro. Mais la numérisation a engendré une surabondance de zéros. Le zéro est employé aujourd’hui de manière inutile et superflue. Je peux en-
Horizons
Le magazine suisse de la recherche paraît 4 fois par an en français et en allemand. La version en ligne paraît également en anglais.
38e année, no 145, juin 2025. revue-horizons.ch redaction@ revue-horizons.ch
L’abonnement est gratuit: www.revue-horizons.ch/ abonner
En cas de question ou de souhaits de modification d’abonnement: abo@revue-horizons.ch
core accepter son utilisation dans un tableau, mais d’autres symboles seraient là aussi possibles. Une absurdité totale est l’usage du zéro pour des dates ou des heures dans une lettre, comme «09.03.2025» ou «14h00–15h00». Supprimer des zéros inutiles apporte finalement aussi une amélioration esthétique: «9.3.2025», «14h–15h».
René Gauch, ancien directeur d’une école professionnelle et graphiste, Rümlang (ZH)
Horizons 144, p. 7: «La fin de carrière académique peut être humiliante»
Réseau pour professeures et professeurs émérites
L’interview sur les dernières années de carrière académique décrit avec une grande justesse la situation dans la plupart des universités d’Europe occidentale. J’ai bien connu de l’intérieur ce milieu en tant que président d’un réseau de l’Agence universitaire de la francophonie, qui regroupe plus d’un millier d’universités dans le monde. Il y a encore deux décennies, la situation était la même à l’Université de Namur, où je suis professeur émérite: on était mis à la retraite de force à 65 ans, et on restait pour ainsi dire toléré jusqu’à 70 ans. Depuis, les choses ont changé. J’ai créé avec quelques collègues un réseau pour les pro-
Rédaction
Florian Fisch (ff), codirection
Judith Hochstrasser (jho), codirection
Astrid Tomczak-Plewka (ato)
Sophie Rivara (sr) Yvonne Vahlensieck (yv)
Ellen Weigand (ew), édition française
Graphisme et rédaction photo Bodara GmbH, Büro für Gebrauchsgrafik 13 Photo AG
Traduction arrow-traduction.ch
Daniel Saraga
Correction Lepetitcorrecteur.com
fesseurs émérites de l’université. Il est reconnu comme un partenaire à part entière et partiellement financé par l’institution.Les membres conservent leur adresse électronique professionnelle jusqu’à la fin de leur vie et sont invités aux événements. Cela pourrait être une piste intéressante pour les hautes écoles suisses. Manfred Peters, professeur de linguistique émérite de l’Université de Namur, Belgique
Faites-nous part de votre avis! Vous souhaitez réagir à un article? Nous nous réjouissons de vos commentaires sur: @horizons-en.bsky.social ou par courriel à: redaction@revue -horizons.ch. A envoyer jusqu’au 30 juin 2025 au plus tard.
Horizons rend compte du paysage de la recherche suisse 4 fois par an. Abonnez-vous gratuitement ou offrez un abonnement à vos amies et amis.
Avez-vous une nouvelle adresse ou des questions au sujet de votre abonnement? Dès lors, veuillez vous adresser à abo@revue-horizons.ch
Vous pouvez vous abonner à l’édition papier ici: horizonte-magazin.ch/abo

Rédaction en chef
Christophe Giovannini (cgi)
Editeurs
Fonds national suisse (FNS) Wildhainweg 3
Case postale
CH-3001 Berne
Tél. 031 308 22 22 com@snf.ch
Les Académies suisses des sciences
Maison des Académies Laupenstrasse 7
Case postale
CH-3001 Berne
Tél. 031 306 92 20 info@academies-suisse.ch
Le Fonds national suisse encourage sur mandat de la Confédération la recherche dans toutes les disciplines scientifiques. Il investit chaque année environ 1 milliard de francs. Actuellement, près de 6000 projets sont en cours, avec la participation de plus de 22 000 scientifiques.
Les Académies suisses des sciences s’engagent sur mandat de la Confédération pour un dialogue équitable entre science et société. Elles représentent la science de manière interinstitutionnelle et interdisciplinaire.


Impression et litho
Stämpfli SA, Berne/ Zurich
Impression climatiquement neutre, myclimate.org
Papier: Munken Kristall
Smooth Brilliant White, Magno Star
Typographie: Caslon Doric, Sole Serif
Tirage
13 200 français 28 700 allemand
© Tous droits réservés. Reproduction des textes autorisée sous licence Creative Commons BY-NC-ND. ISSN 1663 2710
Les articles ne reflètent pas forcément l’opinion des éditeurs – le FNS et les Académies.
Nous aspirons à un langage non sexiste et utilisons donc les deux formes génériques ainsi que des termes neutres tels que «scientifiques».
Les textes d’Horizons respectent les standards journalistiques. L’intelligence artificielle peut être utilisée pour certaines étapes (comme l’aide à la recherche, la transcription), mais les autrices et auteurs rédigent les textes eux-mêmes et se portent garants de leur contenu.
OUILa recherche virologique a connu d’indéniables succès. Des vaccins contre la polio, la rougeole et – en un temps record – contre le Covid-19 ont sauvé des millions de vies. Des percées impossibles sans le dévouement de scientifiques qui manipulent des agents pathogènes dangereux en laboratoire de haute sécurité. Mais la recherche qui sauve des vies peut simultanément en menacer d’autres. Entre 2000 et 2021, huit décès et plus de 300 infections de laboratoire avec 51 agents pathogènes différents ont été documentés à l’échelle mondiale. Et, faute de statistique systématique, beaucoup de ces accidents ne sont pas recensés. Certaines expériences de «gain de fonction», qui visent à rendre des virus plus virulents encore, sont particulièrement inquiétantes. Et on ignore si le variant le plus menaçant apparaîtra un jour dans la nature, alors que ce risque très élevé existe toujours. La dissémination d’un tel virus de la grippe pourrait tuer entre 2 millions et 1,4 milliard de personnes, selon Marc Lipsitch, professeur à Harvard.

«La recherche qui sauve des vies peut aussi en mettre en péril.»
Laurent Bächler est responsable du programme de biosécurité du think tank Pour Demain. Il met à disposition des propositions basées sur des preuves pour une société résiliente, à la croisée des chemins entre science et politique.
Avec la biologie synthétique et l’IA, la biotechnologie devient de l’ingénierie. Même des virus éradiqués tel celui de la variole peuvent être reconstitués, selon l’OMS. En parallèle, il arrive que des laboratoires de haute sécurité ne soient pas contrôlés pendant des années en Suisse. Les autorités cantonales effectuent un travail considérable à cette fin, mais manquent souvent de ressources. Que faire? Premièrement: des cours obligatoires pour tous les responsables de la biosécurité. Deuxièmement: un système de notification sans sanctions et assorti de statistiques transparentes, comme au Canada. Troisièmement: un service national indépendant d’inspection de la biosécurité, comme dans le domaine nucléaire. Ces mesures, qui existent déjà dans d’autres domaines à risque, donnent confiance dans la recherche virale. Le personnel de l’aéroport de Zurich fait ainsi l’objet d’un contrôle de fiabilité.
Sécurité et recherche ne sont pas contradictoires. Pourquoi troquer la sécurité contre les progrès de la recherche alors que les deux vont de pair? Un seul accident peut détruire la confiance et empêcher de futurs succès de la recherche virale.
NONLes débats parfois très simplifiés et polarisés – par exemple sur les expériences de gain de fonction – donnent vite l’impression que les virologues travaillent sans trop de discernement avec des agents pathogènes très virulents en cherchant à les rendre plus dangereux encore. Or, ces expériences sont précieuses pour la recherche au quotidien. Elles fournissent par exemple des connaissances sur l’effet pathogène de virus rendus artificiellement résistants aux médicaments. «Comment un virus s’adaptet-il à un nouvel hôte et, le cas échéant, sera-t-il alors toujours aussi dangereux?» constitue une question importante au début d’une nouvelle pandémie. Des expériences réalisées avec des agents pathogènes moins dangereux –au comportement souvent différent –et des modèles informatiques ne fournissent que des réponses partielles. Cela ne signifie évidemment pas que la recherche virologique se fait comme au Far West. En Suisse, les travaux de recherche sur des agents hautement pathogènes sont soumis à une autorisation, délivrée après une évaluation approfondie des risques par un groupe indépendant d’experts et d’expertes. La procédure est centralisée au niveau national, permettant l’harmonisation des normes de sécurité dans toute la Suisse – un avantage par rapport à des comités de biosécurité internes aux institutions, comme aux Etats-Unis. Une évaluation détaillée des risques est exigée dès la demande d’autorisation. Les laboratoires doivent être équipés et standardiser les procédures afin de minimiser le risque de dissémination accidentelle ou d’infection du personnel. Les éléments liés à la sécurité d’un laboratoire de haute sécurité font l’objet de contrôles indépendants réguliers. Par exemple de la filtration de l’air ou des stérilisateurs pour traiter les déchets.

«La recherche virologique ne se fait pas comme au Far West.»
Mirco Schmolke est professeur de virologie à l’Université de Genève. Il a travaillé sur des virus hautement pathogènes en Suisse, en Allemagne et aux Etats-Unis.
Le personnel de laboratoire suit une formation supervisée avant d’être autorisé à mener des expériences de manière autonome et bénéficie régulièrement de formations continues. J’en suis convaincu: le cadre réglementaire et la surveillance combinée par la Confédération, les cantons et les exploitants permettent une recherche sûre. Une recherche qui, au final, sert à la sécurité de la population.
Asmaa Dehbi, chercheuse en sciences de l’éducation à l’Université de Fribourg, Page 18