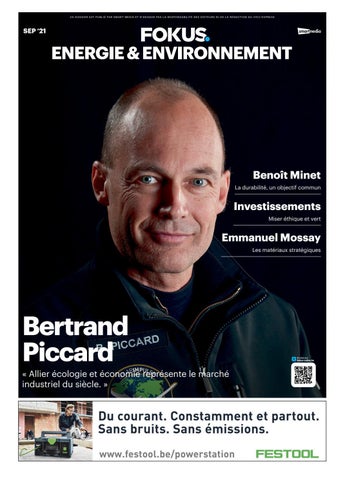14 minute read
La croissance des bioénergies
De plus en plus bioénergétique
La consommation énergétique mondiale devrait grimper en flèche au cours des prochaines années. Même si les combustibles fossiles resteront une importante source d’énergie, les énergies renouvelables gagneront aussi en importance. Notamment dans les villes…
Advertisement
Gérée de façon durable, la bioénergie, entre autres issue des plantes, peut être considérée comme une source renouvelable. Car, entre autres, une nouvelle végétation peut remplacer celle qui a été transformée en énergie. Son bénéfice net en termes d’atténuation du changement climatique dépend de l’équilibre entre le CO2 capturé durant la croissance des plantes et le CO2 libéré lorsque le combustible est produit, traité, transporté et brûlé.
Et plus globalement, qu’en est-il de l’utilisation de la bioénergie? «Elle représente aujourd’hui trois quarts du mix énergétique des énergies renouvelables en Wallonie, mélange qui occupe, au total, 12 % du total des énergies dépensées dans cette même région», explique Pierre-Louis Bombeck, chef de projet Bois & Énergie de l’ASBL ValBiom, pour la valorisation de la biomasse. «Le frein principal à l’utilisation des bioénergies tient souvent au coût des infrastructures à installer, comme les chaudières, par exemple. Mais l’économie d’énergie qui sera réalisée grâce à ces nouvelles installations permettra d’amortir l’investissement à moyen terme. Notre objectif est que les particuliers, comme les institutions publiques, fassent le pas vers les bioénergies lorsqu’elles doivent de toute façon remplacer leurs installations.»
Et puis, on le sait moins, mais c’est de plus en plus souvent le cas : les bioénergies fonctionnent aussi de manière croissante en circuit court. Puisqu’il y a, par exemple, moyen de se chauffer en Wallonie avec du bois d’origine wallonne. «Et le phénomène est le même question biométhanisation», poursuit P.-L. Bombeck. «Aujourd’hui, les déchets ramassés dans une ville peuvent être transformés en biogaz, et servirent à chauffer les bâtiments de cette même ville. Difficile de faire plus court comme circuit.» Même si la hausse de l’offre en énergie provient principalement des combustibles fossiles, les sources d’énergies renouvelables gagneront du terrain en raison des inquiétudes liées aux prix élevés des combustibles fossiles, aux émissions croissantes de gaz à effet de serre et à la dépendance aux importations d’énergie. Dans ce contexte, les bioénergies constitueront indéniablement une part importante de l’offre énergétique provenant de sources renouvelables. Même si la demande future en bioénergie dépendra des mesures politiques adoptées, les indicateurs sont porteurs d’optimisme. «La bioénergie a tout le potentiel pour jouer un rôle clé dans le mix énergétique mondial», explique Dolf Gielen, le directeur de l’IRENA, Agence internationale de l’énergie renouvelable, section innovation et technologie.
«La biomasse provenant de sources durables peut démultiplier la production d’énergie, en réduisant simultanément la pollution de l’air, et sauver des vies. Concernant plus spécifiquement les villes, ces énergies vont bien entendu aussi s’y déployer. D’autant plus que les centres urbains vont voir toutes leurs composantes modifiées, en passant tout doucement au statut de smart city. Et l’énergie fera naturellement partie intégrante de cette modification de nos habitudes.»
Et, bonne nouvelle : nous avons encore de la marge question ressources! Car même si la demande de bioénergie explose, aucun souci à l’horizon! «Auparavant, les déchets de bois de scierie finissaient à la décharge. Mais maintenant, ils sont utilisés comme combustible. Et il y en a des tonnes», conclut P.L. Bombeck. «Et puis, les bioénergies sont stockables, et pourront donc être utilisées uniquement à la demande. Ce qui ouvre des perspectives gigantesques.»
— Dolf Gielen, directeur de l’IRENA

Produire de l’électricité verte par tous les moyens

Si l’avenir de la transition énergétique passe en grande partie par l’électricité, il ne faut cependant pas oublier deux choses. D’abord, la production de cette énergie doit être « verte ». Ensuite, des panneaux photovoltaïques posés sur le toit de la maison d’habitation ne suffiront pas. Mais des solutions complémentaires voient le jour.
La transition énergétique louperait fondamentalement sa cible si l’électricité que l’on venait à utiliser était produite par… de l’énergie fossile. « Ce serait fondamentalement stupide, en effet », réagit Gaëtan Sonck, Administrateur de la société du même nom, spécialisée, dans les solutions énergétiques globales. « Pour que cette transition énergétique soit cohérente en termes d’impact environnemental et attractive financièrement, il est essentiel de traiter la question de la production de l’électricité qui sera nécessaire à ces pompes à chaleurs et véhicules électriques. On passerait totalement à côté du but recherché si cette électricité devait être produite à partir de pétrole ou autres carburants à forte émission de CO2. Il faut donc s’orienter vers le photovoltaïque. »
Par ailleurs, cette production photovoltaïque devra tenir compte de besoins énergétiques conséquents. Notre expert reprend, et met des chiffres sur cette fameuse transition, à l’échelle familiale : « De base, la quantité d’énergie se mesure en kWh, donc en kilowattheure. Comme son nom l’indique, 1 kWh, c’est la quantité d’énergie qu’on a dépensée (ou stockée) avec une puissance de 1 kW, et qu’on a laissée travailler pendant une heure. Pour faire simple, on peut retenir qu’il faut 3 kWh d’électricité à une pompe à chaleur pour produire la chaleur qui serait créée en brûlant un litre de mazout dans une chaudière. Et il faut également 3 kWh d’électricité à une voiture électrique pour remplacer un litre de diesel dans une voiture classique. »
Pour donner une image simple, mais parlante et fiable, prenons donc le cas d’une famille moyenne, qui consommerait : 5 000 kWh/ an d’électricité (à raison de 100 € par mois) pour ses besoins classiques, 2 000 litres par an de mazout pour se chauffer. Elle disposerait aussi de deux voitures, qui roulent chacune 20 000 km par an, avec une consommation de 6 litres aux 100 kilomètres, soit 1 200 litres par voiture et par an. Et si cette même famille fait la transition vers les énergies renouvelables, et s’équipe d’une pompe à chaleur et d’une voiture électrique. Le besoin en électricité devient le suivant : 5 000 kWh/an d’électricité pour les besoins classiques. Mais aussi 6 000 kWh par an d’électricité pour la pompe à chaleur, en remplacement des 2 000 litres de mazout de chauffage annuels. Et 3 600 kWh par an d’électricité pour la voiture électrique, en remplacement des 1 200 litres par an de diesel, l’autre voiture reste actuellement au diesel. Donc : « Le besoin en électricité de cette famille avoisinera les 15 000 kWh par an. Cette augmentation du besoin en électricité est énorme. Elle doit être accompagnée d’une augmentation significative de la production d’électricité verte, et autant que possible d’un étalement de la production d’électricité verte tout au long de la journée et de l’année. »
Bref, il va falloir produire « bien », mais aussi « plus ». « Au niveau des particuliers et des entreprises, c’est la production d’électricité photovoltaïque qui est de loin la plus accessible et la plus simple à mettre en œuvre. Comme la pose des panneaux sur les toits n’est pas toujours possible ou pas toujours suffisante, il faut innover en développant, par exemple, un concept de toiture photovoltaïque étanche associée à des petits bâtiments en bois, que nous produisons en Belgique. Il est ainsi possible de décliner ce concept en “car-port”, “pool house”, abris de jardin, abris à animaux et autres… Le concept permet d’intégrer facilement les bornes de recharges des véhicules électriques via le même branchement que celui des panneaux photovoltaïques. D’autre part, il représente une solution plus économique que la construction d’un bâtiment équipé de sa toiture, par-dessus laquelle on vient replacer une installation photovoltaïque. Enfin, esthétiquement, on arrive à quelque chose de beaucoup plus léger et épuré qu’une installation photovoltaïque en surimposition. » L’électricité étant le vecteur le plus polyvalent en matière d’énergie verte, toutes les solutions sont donc bonnes à prendre et à assembler. Et celle-ci ne fait pas exception à la règle.
Il faut innover en développant un concept de toiture photovoltaïque étanche associée à des petits bâtiments en bois, comme des “car-port”, “pool house”, abris de jardin, abris à animaux et autres…
Gaetan Sonck
Administrateur
Sonck est à la fois un bureau d’étude et un installateur-intégrateur de projets liés à la production ou la gestion d’énergie. Depuis bientôt 10 ans, Sonck a réalisé un large éventail de projets, ce qui lui a permis d’affiner son expertise et d’offrir un panel de solutions : hydroélectricité, photovoltaïque, pompes à chaleur, stockage d’énergie… Depuis un an, la société réalise aussi petites constructions en bois (« car-port », « pool house »…) avec toiture photovoltaïque intégrée.
Il n’y a pas que l’électrique dans la mobilité durable !

Une des pistes d’avenir pour une mobilité plus verte passe par l’électrique, c’est indéniable. Mais cette solution ne doit pas nous faire oublier qu’il existe aussi d’autres options. Dont celle du « CNG » ou « Gaz Naturel Comprimé ». Bref, rouler au gaz n’a plus rien d’une usine… à gaz !
Le «plan air climat énergie» adopté par le Gouvernement wallon est pour le moins ambitieux dans ses objectifs. Puisqu’à l’horizon 2030, il se donne pour mission que 25 % des véhicules utilitaires, c’est-à-dire un camion sur quatre empruntant les routes wallonnes, soient alimentés au CNG. «Face à ces objectifs, il était urgent d’agir!» explique Olivier Bontems, Directeur des Énergies et des Projets Spéciaux chez Ideta, l’Agence de Développement Territorial pour la Wallonie Picarde. «Le CNG représente aujourd’hui une alternative très intéressante pour les entreprises qui souhaitent décarboner progressivement l’impact de leur mobilité régionale, surtout pour les véhicules d’une masse supérieure à 3,5 tonnes. Encore faut-il bien entendu que les stations soient prévues pour ravitailler ce type de véhicules pour des livraisons de 200 kilos par plein. En partenariat avec ENORA, nous avons ainsi pu déployer sur Leuze-Europe et Péruwelz des stations dites “NGV2”, qui permettent un remplissage des véhicules à une vitesse de 30 kilos/minute, tout à fait adaptée au charroi lourd. Cela représente une vitesse de remplissage quatre fois supérieure à ce que l’on peut avoir dans une station “retail” classique.»
Par contre, attention à ne pas confondre CNG et LPG! Le second, aussi appelé «Liquid petroleum Gas», issu du raffinage du pétrole, est un mélange de propane et de butane compressé entre 5 à 7 bars. Le CNG, lui, est identique au gaz naturel que nous utilisons, par exemple, pour nous chauffer. Essentiellement constitué de méthane, il peut parfois provenir de la biométhanisation des déchets, et prend alors le nom de «bioCNG». Dernier détail, le CNG est un gaz plus léger que l’air. Les véhicules qui utilisent ce carburant ne sont donc pas soumis à l’interdiction d’accès dans les parkings souterrains qui frappe les véhicules au LPG.
Carburant plus économique et plus respectueux de l’environnement, le CNG est donc une véritable solution alternative pour les transports de marchandises régionaux et nationaux, mais aussi bien sûr pour les véhicules particuliers. «Le CNG est en effet un carburant plus propre, avec jusqu’à 15 % de CO2 en moins et une réduction significative des émissions de particules fines (77 %) et d’oxyde d’azote (90 %).»
Et puis, un argument économique non négligeable pointe également le bout de son nez. Olivier Bontems poursuit : «Le prix du CNG au kilomètre peut se révéler jusqu’à deux fois moins élevé que celui d’un moteur diesel ou à essence. Grâce à une technologie éprouvée et simple ne nécessitant pas de filtre à particules onéreux ni l’ajout d’Ad-Blue, le véhicule au CNG coûte moins cher à l’usage.»
Pour passer au gaz, deux solutions. Modifier des camions existants et roulant au diesel pour rendre leur réservoir compatible avec un approvisionnement gazier. «Mais surtout», précise Olivier Bontems, «penser à acquérir des camions ou des véhicules qui roulent au gaz naturel lors d’un renouvellement de flotte. Car mettre à niveau d’anciens camions a un coût. À la fois pour les adapter, mais aussi parce qu’ils sont, par définition, déjà âgés et rouleront moins longtemps que des neufs.»
Et le secteur du transport semble se laisser de plus en plus tenter. Notre interlocuteur en témoigne : «Le milieu est prêt à agir aujourd’hui, et nous le vérifions chaque jour un peu plus. Le partenariat que nous avons avec les Transports Fockedey à Leuze est à cet égard exemplaire. Et si on veut prendre rapidement une initiative rendant le transport plus vert, le CNG est la seule option qui le permet aujourd’hui. Certes, il réduit les rejets et ne les élimine pas totalement. Dès lors, on pourrait aussi attendre passivement une solution-miracle dont on ne sait même pas si elle existera un jour, ce qui équivaudrait surtout à reporter le problème.» Or, s’il n’est pas trop tard pour agir, il est plus que grand temps! Et le gaz, au même titre que l’électricité, fera partie de la solution pour évoluer vers des transports plus verts.
Olivier Bontems
Directeur des Énergies et des Projets Spéciaux
De quartiers durables et respectueux à une ville intelligente et moderne

L’intérêt porté à son propre quartier n’a jamais été aussi pertinent qu’aujourd’hui. Le coronavirus nous a fait prendre conscience que nous avons plus que jamais besoin d’un ancrage local dans un monde individualisé à l’extrême. Et la technologie pourrait bien avoir un rôle important en la matière.
Mieux vaut un voisin proche qu’un frère éloigné, dit le proverbe. Pourtant, il est fréquent de ne pas vraiment connaître son voisin, surtout en ville. Et les administrations locales, dans cette continuité, peinent toujours plus à entrer en contact avec leurs administrés.
C’est en grande partie la conséquence des développements technologiques en général, des réseaux sociaux en tête, qui synchronisent toujours mieux les sphères de vie personnelles et les préférences individuelles. Les gens vivent de plus en plus dans des chambres d’écho se limitant à leurs propres amis, centres d’intérêt et philosophie. Un repli qui menace le sentiment d’appartenance à son propre quartier.
Ce même virage technologique a simultanément engendré un contre-mouvement de plus en plus marqué. Comme Hoplr, par exemple. Cette start-up tech flamande offre la possibilité de tisser un réseau social de quartier à des administrations locales ou partenaires sans vocation commerciale comme des CPAS. « Commencée en 2014, notre histoire découle de la quête idéaliste de renforcer la connexion avec le voisinage », explique le fondateur Jennick Scheerlinck.
Cette plateforme vous permet entre autres de vous renseigner au sujet de travaux routiers ou de projets participatifs locaux. Vous pouvez tout autant y chercher une foreuse à emprunter qu’y trouver de l’aide. Les voisins disposent ainsi d’un outil de qualité pour renforcer la cohésion sociale. « Dans une social smart city, la technologie est au service des habitants et non l’inverse. Ce n’est qu’alors que les données deviennent vraiment intéressantes », précise M. Scheerlinck.
Contrairement à d’autres réseaux sociaux comme Facebook, par exemple, chaque communauté sur Hoplr peut gérer et modérer elle-même sa messagerie. Autrement dit, chaque message négatif incitant au racisme ou à la haine peut tout simplement être filtré, essentiel pour une cohésion sociale saine. Selon Jennick Scheerlinck, la petite taille de chaque communauté limite de toute façon la négativité. « Il est important d’être positif d’entrée de jeu. Une plateforme comme la nôtre rapproche des gens qui n’ont rien d’autre en commun que leur lieu de résidence. Ce qui est justement propice à de belles et nouvelles opportunités. »
M. Scheerlinck explique qu’une plateforme de quartier trouve avant tout son utilité dans les grandes villes. « Une certaine cohésion sociale règne dans les régions rurales, donc une plateforme de quartier y permet surtout de s’exprimer. Dans les villes, où cohabitent en grand nombre nouveaux résidents et personnes aux profils très différents, nous constatons que le réseautage de voisinage est avant tout un instrument très fonctionnel. » Pour les administrations publiques, il fonctionne plutôt comme un outil de médiation. « Il tisse un lien supplémentaire entre les gens et l’administration, leur permettant de bâtir la confiance dans les deux sens. Les réseaux ne sont pas des instruments hiérarchisés, qui renforceraient l’image de Big Brother de la ville. »
En fait, cette tendance mène plutôt la ville ou la commune à perdre en partie le contrôle. Ce qui n’est pas du goût des décideurs politiques. C’est aussi pour convaincre ces sceptiques qu’il est très important de mettre en œuvre une gestion communautaire constructive et positive. Concernant la vie privée, la plateforme est totalement conforme à la législation RGPD et collabore en outre avec des hackers éthiques afin d’améliorer en permanence la sécurité du réseau.
Ces efforts portent clairement leurs fruits. Les administrations locales de Malines, Olen, Ranst, Saint-Nicolas et Bornem ont été les premières à emboîter le pas en 2017. L’initiative s’est répandue comme une traînée de poudre, grâce également au soutien des fonds d’investissement externes de Belfius, Matexi et Carevolution. Le bateau a eu le vent en poupe pendant la crise du corona et a gagné trois prix internationaux. Jennick Scheerlinck : « La pertinence d’une telle plateforme n’a jamais été aussi manifeste que pendant les confinements. Les gens ne pouvant se rencontrer physiquement, ils ont fait appel au numérique pour s’organiser. »
Autrement dit, une bonne cohésion sociale ne se limite pas au coin de la rue : elle étend tout simplement ses ramifications en ligne. Une connexion véritable et sûre avec son quartier est devenue un aspect très important du paysage urbain moderne.
Jennick Scheerlinck
Fondateur
Hoplr (prononcez hopler) propose un réseau social gratuit et délimité (hoplr.com, iOS, Android) pour les quartiers et se concentre sur l’interaction sociale entre les habitants et leur engagement au sein de leur quartier. Hoplr cherche ainsi à renforcer le capital social et à développer les communautés locales, leur permettant de mieux faire face aux défis sociétaux de demain. Il accorde des licences à des entités actives dans le secteur public et gère actuellement environ 2 500 communautés réparties entre 100 villes et communes.