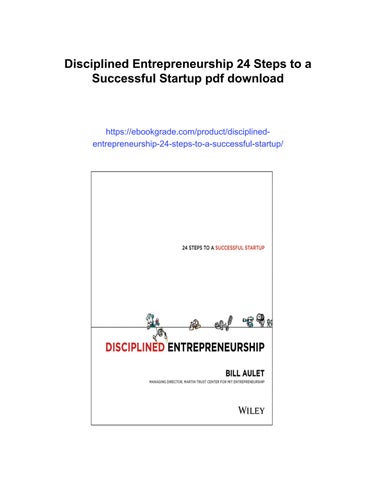Other documents randomly have different content
s'unir aux puissances alliées, et de tenter un suprême et dernier effort pour arracher l'Europe à la domination de Napoléon.
Ce qu'on s'était promis actuellement, en conséquence de ces vues, c'était, de la part de la Russie, de ne pas se laisser séduire par l'appât d'un arrangement direct, de la part de l'Autriche, de déclarer la guerre au jour indiqué, si les conditions de la médiation n'étaient pas acceptées par la France. M. de Metternich, profitant du voisinage de Prague, y avait rappelé M. de Bubna pour vingt-quatre heures, lui avait bien expliqué la position, lui avait positivement affirmé qu'on n'était pas encore engagé avec les belligérants, l'avait autorisé à donner à l'appui de ce fait la parole d'honneur de l'empereur François, mais l'avait autorisé aussi à signifier de la manière la plus expresse qu'on finirait par s'engager, si la durée de l'armistice n'était pas employée à négocier sincèrement une paix modérée. Il l'avait en même temps chargé d'annoncer au cabinet français, que la médiation de l'Autriche était formellement acceptée par la Prusse et par la Russie, ce qui obligeait dès lors le médiateur à demander à chacun ses conditions, et notamment à la France qui était instamment priée de faire connaître les siennes. M. de Bubna devait à cette occasion témoigner le désir de M. de Metternich de venir un moment à Dresde, pour tout terminer sur les lieux, dans un entretien cordial avec Napoléon. Là, en effet, on pouvait finir en quelques heures, car si M. de Metternich parvenait à persuader Napoléon, tout serait dit, les coalisés étant dans l'impossibilité de refuser les conditions que l'Autriche déclarerait acceptables.
Double déclaration en ce sens que M. de Bubna est chargé de porter à Dresde.
Note de M. de Bubna, constituant pour le cabinet français une vraie mise en demeure.
Telles sont les choses, fort importantes comme on le voit, que M. de Bubna, revenu à Dresde, voulait communiquer à Napoléon, et dont il ne disait qu'une partie à M. de Bassano, sachant l'inutilité des explications avec ce ministre, qui recevait les opinions de son maître et ne les faisait pas. Napoléon étant arrivé le 10 juin, M. de Bubna
avait remis le 11 une note pour déclarer que la Russie et la Prusse avaient officiellement accepté la médiation de l'Autriche, que celle-ci était occupée à leur demander leurs conditions de paix, et qu'on attendait que la France voulût bien énoncer les siennes. Ce n'était là qu'une mise en demeure, ayant pour but non d'amener une entière et immédiate énonciation des conditions de la France, mais de provoquer les pourparlers préliminaires, les épanchements confidentiels, préalable indispensable et plus ou moins long, suivant le temps dont on dispose, des déclarations officielles et définitives.
Si Napoléon avait voulu la paix, celle du moins qui était possible et dont il connaissait les conditions, il n'aurait pas perdu de temps, quarante jours au plus lui restant pour la négocier. On était en effet au 10 juin, et l'armistice expirait au 20 juillet. Avec son ardeur accoutumée, il aurait appelé M. de Metternich à Dresde, aurait tâché de lui arracher quelque modification aux propositions de l'Autriche, ce qui était très-possible avec le désir qu'elle avait d'en finir pacifiquement, et aurait renvoyé ce ministre, une, deux et trois fois, au quartier général des puissances alliées, pour aplanir les difficultés de détail toujours nombreuses dans tout traité, mais devant l'être bien davantage dans un traité qui allait embrasser les intérêts du monde entier. Mais la preuve évidente qu'il ne la voulait pas (indépendamment des preuves irréfragables contenues dans sa correspondance), c'était le temps qu'il perdait et qu'il allait perdre encore. Son projet, comme nous l'avons dit, c'était de différer le moment de s'expliquer, de multiplier pour cela les questions de forme, puis de paraître s'amender tout à coup lorsque la suspension d'armes serait près d'expirer, de se montrer alors disposé à céder, d'obtenir à la faveur de ces manifestations pacifiques une prolongation d'armistice, de se donner ainsi jusqu'au 1{er} septembre pour terminer ses préparatifs militaires, de rompre à cette époque sur un motif bien choisi qui pût faire illusion au public, et de tomber soudainement avec toutes ses forces sur la coalition, de la dissoudre et de rétablir plus puissante que jamais sa
Preuve évidente que Napoléon ne voulait pas la paix, résultant de plusieurs pertes de temps volontaires.
Napoléon prend quelques jours pour répondre à la note remise le 11 juin par M. de Bubna.
domination actuellement contestée, calcul pardonnable assurément, et dont l'histoire des princes conquérants n'est que trop remplie, s'il avait été fondé sur la réalité des choses! Avec de telles vues il n'était pas temps encore de recevoir M. de Bubna, et de lui répondre par oui ou par non, sur des conditions qui se réduisaient à un petit nombre de points dont aucun ne prêtait à l'équivoque. Aussi Napoléon prit-il la résolution de laisser passer quatre ou cinq jours avant d'admettre auprès de lui M. de Bubna et de répondre à sa note, ajournement fort concevable si aucun terme n'avait été fixé aux négociations, et si, comme lors du traité de Westphalie, on avait eu pour négocier des mois et même des années. Mais perdre quatre ou cinq jours sur quarante pour une première question de forme, qui en supposait encore mille autres, c'était trop dire ce qu'on voulait, ou plutôt ce qu'on ne voulait pas.
Toutefois Napoléon venait d'arriver à Dresde, fatigué sans doute, accablé de soins de tout genre, et à la rigueur on pouvait comprendre qu'il ne reçût point M. de Bubna le jour même. Il n'y avait pas d'ailleurs de souverain au monde qui fût plus dispensé que lui de se plier aux convenances d'autrui, et qui s'y pliât moins. Ces retards envers M. de Bubna n'avaient donc encore rien de bien significatif. Seulement Napoléon prouvait ainsi qu'il n'était pas pressé, car lorsqu'il l'était, les jours, les nuits, la fatigue, le repos, tout devenait égal pour lui, et n'être pas pressé de la paix en ce moment, c'était ne pas la désirer. M. de Bassano reçut la dépêche de M. de Bubna, affecta de la trouver infiniment grave, dit que sous trois ou quatre jours on répondrait, et que sous trois ou quatre jours aussi Napoléon donnerait audience à M. de Bubna, et s'expliquerait avec lui sur le contenu de sa note.
Nombreuses chicanes de forme.
Dans cet intervalle la réponse fut préparée et rédigée. Elle était de nature, plus encore que le temps volontairement perdu, à révéler les dispositions véritables du gouvernement français.
On conteste d'abord à M. de Bubna le caractère nécessaire pour remettre une note.
On objecta d'abord à M. de Bubna qu'il n'avait aucun caractère pour remettre une note. Cet agent, en effet, reçu officieusement par Napoléon, et envoyé auprès de lui comme lui étant plus agréable qu'un autre, et comme plus spirituel notamment que le prince de Schwarzenberg qui l'était peu, n'avait jamais été formellement accrédité, ni à titre de plénipotentiaire ni à titre d'ambassadeur; il n'avait donc pas qualité pour remettre une note. C'était là une difficulté bien mesquine, car on avait déjà échangé avec ce personnage les communications les plus importantes. Néanmoins on rédigea une première réponse à M. de Bubna, dans laquelle on soutint qu'il fallait que la note qu'il avait présentée fût signée de M. de Metternich, pour prendre place dans les archives du cabinet français, car il n'avait quant à lui aucun titre qui pût donner à cette note un caractère d'authenticité. Après cette difficulté de forme, on éleva des difficultés de fond. La première était relative à la médiation elle-même. Sans doute, disait-on, la France avait paru disposée à admettre la médiation de l'Autriche, avait même promis de l'accepter, mais une résolution si importante ne pouvait pas se supposer, se déduire d'un simple entretien, et il fallait un acte officiel, dans lequel on déterminerait le but, la forme, la portée, la durée de cette médiation. Ce n'était pas tout: cette médiation comment se concilierait-elle avec le traité d'alliance? le cabinet autrichien serait-il médiateur, c'est-à-dire arbitre, arbitre prêt à se prononcer contre l'une ou l'autre partie, et à se prononcer les armes à la main, comme il était d'usage que le fît un médiateur armé? alors que devenait le traité d'alliance de l'Autriche avec la France? Il fallait s'expliquer sur ce point. Enfin, quelle que fût la portée de la médiation, il y avait une question de forme sur laquelle l'honneur ne permettait pas de garder le silence. Ainsi le médiateur se saisissant si brusquement, et on peut dire si cavalièrement, de son rôle, annonçait déjà une manière de traiter qui ne pouvait convenir à la France. Il paraissait en effet vouloir
On élève ensuite des objections sur la prétention du cabinet autrichien, de réunir la double qualité de médiateur et d'allié.
On s'oppose formellement à une autre prétention de l'Autriche, celle d'être l'intermédiaire unique entre les parties contractantes.
On répond d'une manière presque négative au désir de venir à Dresde exprimé s'entremettre entre toutes les parties belligérantes, porter lui seul la parole de celles-ci à celles-là, et ne les jamais placer en présence les unes des autres (ce qui était effectivement le secret désir de l'Autriche, afin d'empêcher l'arrangement direct).
Une telle manière de négocier n'était pas admissible. La France ne reconnaissait à personne le droit de traiter pour elle ses propres affaires. S'y prendre de la sorte, c'était lui imposer une paix concertée avec d'autres, et la France si longtemps victorieuse, au point de dicter des conditions à l'Europe, n'en était pas réduite, surtout quand la victoire lui était revenue, à accepter les conditions de qui que ce soit. Elle voulait bien, pour parvenir à la paix dont tout le monde avait besoin, renoncer à dicter des conditions; jamais elle ne consentirait à s'en laisser dicter, l'Europe fût-elle réunie tout entière pour lui faire la loi.--
On remplit plusieurs notes de ces chicanes, et Napoléon en remplit lui-même un long entretien avec M. de Bubna. Il lui accorda cet entretien le 14 juin, et les notes furent signées et remises le 15. M. de Bassano les accompagna d'une lettre personnelle pour M. de Metternich, dont le ton était même contraire au but qu'on se proposait d'atteindre, car Napoléon voulait qu'on gagnât du temps, et la hauteur de langage n'était pas un moyen d'y réussir. Dans cette lettre, il imputait le temps perdu à M. de Metternich, se plaignait maladroitement de ce que l'armistice ayant été signé le 4 juin, on fût si peu avancé le 15, comme si M. de Bubna n'avait pas été dès les derniers jours de mai au quartier général français, demandant une entrevue sans pouvoir l'obtenir, comme si l'Autriche sur tous les points ne se fût pas montrée impatiente de provoquer et de donner des explications. Enfin, quant au désir exprimé par M. de Metternich de venir à Dresde, M. de Bassano, sans même éluder, répondait d'une manière à peine polie que les questions étaient encore trop peu mûries pour qu'une entrevue de M. de Metternich, soit avec le ministre des affaires
par M. de Metternich.
étrangères, soit avec Napoléon lui-même, pût avoir l'utilité qu'on en attendait, et qu'on en espérait plus tard.
Telles furent les réponses dont M. de Bubna dut se contenter, et qui furent expédiées à M. de Metternich à Prague. Il fallait un jour pour se rendre dans cette capitale de la Bohême, un jour pour en revenir, et si M. de Metternich et son maître mettaient trois ou quatre jours pour se résoudre, on devait atteindre le 20 juin avant d'être obligé de parler de nouveau. De son côté il serait bien permis à la diplomatie française d'employer quelques jours à se décider sur le texte de la convention par laquelle on accepterait la médiation, d'employer quelques jours encore pour réunir les plénipotentiaires, et on aurait ainsi gagné le 1er juillet sans s'être abouché avec la diplomatie européenne. Il suffirait alors de se montrer conciliant un moment, du 1er au 10 juillet, par exemple, pour être fondé à demander que l'expiration de l'armistice fût reportée du 20 juillet au 20 août, ce qui, avec six jours pour la dénonciation des hostilités, conduirait au 26 août, fort près de ce 1er septembre, terme désiré par Napoléon. Tels étaient ses calculs et les moyens employés pour en obtenir le succès.
Napoléon se flatte par ces divers ajournements de faire proroger l'armistice jusqu'au 1er septembre.
Pendant qu'il ne visait qu'à perdre le temps dans les négociations, il ne visait au contraire qu'à le bien employer dans l'accomplissement de ses vastes conceptions militaires. Le premier projet de Napoléon, lorsqu'il comptait sur l'alliance ou la neutralité de l'Autriche, était de s'avancer jusqu'à l'Oder et à la Vistule, pour rejeter les Russes sur le Niémen, et les ramener chez eux vaincus et séparés des Prussiens. Tous les préparatifs actuels étant faits dans la supposition de la guerre avec l'Autriche, les plans ne pouvaient plus être les mêmes, car en s'avançant seulement jusqu'à l'Oder, il eût laissé les armées autrichiennes sur ses flancs et ses derrières. Il n'avait donc à choisir
Vastes projets militaires de Napoléon, pour lesquels il avait besoin d'un délai de trois mois.
Napoléon, comptant par ses refus avoir la guerre avec l'Autriche, choisit le cours de l'Elbe pour sa ligne d'opération.
pour future ligne défensive qu'entre l'Elbe et le Rhin, ou le Main tout au plus. Il préféra l'Elbe pour des raisons profondes, généralement peu connues et mal appréciées. (Voir la carte no 28.) Disons d'abord que se porter sur le Rhin ou sur le Main revenait à peu près au même, car la petite rivière du Main, en décrivant plusieurs contours à travers le pays montueux de la Franconie, et venant après un cours de peu d'étendue tomber dans le Rhin à Mayence, pouvait bien servir à défendre les approches du Rhin, quand on se battait avec des armées de soixante ou quatre-vingt mille hommes, mais ne pouvait plus avoir cet avantage depuis qu'on se battait avec des masses de cinq à six cent mille, et eût été débordée par la droite ou par la gauche avant quinze jours. On devait donc ne considérer le Main que comme une annexe de la ligne du Rhin, c'est-à-dire comme le Rhin lui-même, et il n'y avait à choisir qu'entre le Rhin et l'Elbe. Poser ainsi la question, c'était presque la résoudre. Se retirer tout de suite sur le Rhin, c'était faire à l'Europe un abandon de territoire plus humiliant cent fois que les sacrifices qu'elle demandait pour accorder la paix. C'était abandonner non-seulement les alliances de la Saxe, de la Bavière, du Wurtemberg, de Bade, etc., mais les villes anséatiques qui nous étaient si vivement disputées, mais la Westphalie et la Hollande qui ne l'étaient pas, car la Hollande elle-même n'est plus couverte quand on est sur le Rhin. Et comment exiger dans un traité le protectorat de la Confédération du Rhin, qu'on déclarait en rétrogradant sur le Rhin ne pouvoir plus défendre? comment prétendre aux villes anséatiques, à la Westphalie, à la Hollande qu'on reconnaissait ne pouvoir plus occuper? À prendre ce terrain pour champ de bataille, il eût été bien plus simple d'accepter tout de suite les conditions de paix de l'Autriche, car en renonçant à la Confédération du Rhin et aux villes anséatiques, on eût conservé au moins sans contestation la Westphalie et la Hollande, et soustrait définitivement à tous les
Nécessité d'adopter cette ligne, puisqu'il continuait la guerre pour ne pas abandonner les villes anséatiques et
la Confédération du Rhin.
hasards le trône de Napoléon, et, ce qui valait mieux, la grandeur territoriale de la France. Indépendamment de ces raisons, qui politiquement étaient décisives, il y en avait une autre, qui moralement et patriotiquement était tout aussi forte, c'est que rétrograder sur le Rhin, c'était consentir à transporter en France le théâtre de la guerre. Sans doute tant que le Rhin n'était point franchi par l'ennemi, on pouvait considérer la guerre comme se faisant hors de France; mais le voisinage était tel, que pour les provinces frontières la souffrance était presque la même. De plus en obtenant des victoires sur le haut Rhin, entre Strasbourg et Mayence, par exemple, Napoléon n'était pas assuré qu'un de ses lieutenants ne laisserait pas forcer sa position au-dessous de lui, et alors la guerre se trouverait transportée en France, et ce ne serait plus la situation d'un conquérant se battant pour la domination du monde, ce serait celle d'un envahi réduit à se battre pour la conservation de ses propres foyers. Mieux eût valu, nous le répétons, accepter la paix tout de suite, car outre qu'elle n'était pas humiliante, qu'elle était même infiniment glorieuse, elle n'exigeait pas de Napoléon un sacrifice comparable à celui que lui eût infligé la retraite volontaire sur le Rhin. Ceux donc qui le blâment d'avoir adopté la ligne de l'Elbe, feraient mieux de lui adresser le reproche de n'avoir pas accepté la paix, car cette paix entraînait cent fois moins de sacrifices de tout genre que la retraite immédiate sur le Rhin. La déplorable idée de continuer la guerre pour les villes anséatiques, et pour la Confédération du Rhin, étant admise, il n'y avait évidemment qu'une conduite à tenir, c'était d'occuper et de défendre la ligne de l'Elbe.
Avantage qu'avait la ligne de l'Elbe d'éloigner les hostilités de la frontière de France.
Le grand esprit de Napoléon ne pouvait pas se tromper à cet égard, et planant comme l'aigle sur la carte de l'Europe, il s'était abattu sur Dresde, comme sur le roc d'où il tiendrait tête à tous ses ennemis. Le récit des événements prouvera bientôt que s'il y fut forcé, ce fut, non point par le vice de la position elle-même, mais par suite de l'extension extraordinaire donnée à ses combinaisons, de
l'épuisement de son armée, et des passions patriotiques excitées contre lui dans toute l'Europe. Six ans plus tôt, avec l'armée de Friedland, il y aurait tenu contre le monde entier.
La ligne de l'Elbe, quoique présentant dans sa partie supérieure un obstacle moins considérable que le Rhin, avait cependant l'avantage d'être moins longue, moins accidentée, plus facile à parcourir intérieurement pour porter secours d'un point à un autre, et, depuis les montagnes de la Bohême jusqu'à la mer, semée de solides appuis, tels que Kœnigstein, Dresde, Torgau, Wittenberg, Magdebourg, Hambourg. Quelques-uns de ces appuis exigeaient des travaux, et c'est pour ce motif que Napoléon dans ses calculs militaires, qui étaient plus profonds que ses calculs politiques, voulait sans cesse allonger l'armistice, pour réparer la faute de l'avoir signé. Il s'agissait de savoir si la ligne de l'Elbe s'appuyant à son extrême droite aux montagnes de la Bohême, et si la Bohême donnant à l'Autriche le moyen de déboucher sur les derrières de cette position, il était possible de se défendre contre un mouvement tournant de l'ennemi. C'était la question que s'adressaient beaucoup d'esprits éclairés, et qu'ils s'adressaient tout haut. Mais Napoléon qui, à mesure que son malheur commençait à délier certaines langues timides, permettait ces objections, Napoléon faisait des gestes de dédain quand on lui disait que sa position de Dresde pourrait être tournée par une descente des Autrichiens sur Freyberg ou sur Chemnitz. (Voir les cartes nos 28 et 58.) Ce n'était pas, en effet, au général de l'armée d'Italie, qui retrouvait agrandie la position qu'il avait si longtemps occupée autour de Vérone, qui retrouvait dans l'Elbe l'Adige, dans la Bohême le Tyrol, dans Dresde Vérone ellemême, et qui fortement établi jadis au débouché des Alpes, avait fondu tour à tour sur ceux qui se présentaient ou devant lui ou derrière lui, et les avait plus maltraitée encore lorsqu'ils s'aventuraient sur ses derrières, ce n'était pas au général de l'armée d'Italie qu'on pouvait faire peur d'une position semblable. Il répondait avec raison que ce qu'il demanderait au ciel de plus
Propriétés militaires de la ligne de l'Elbe.
Danger d'y être tourné par la Bohême.
heureux, c'était que la principale masse ennemie voulût bien, tandis qu'il serait posté sur l'Elbe, déboucher en arrière de ce fleuve, qu'il courrait sur elle, et la prendrait tout entière entre l'Elbe et la forêt de Thuringe. Le prochain désastre des coalisés à Dresde prouva bientôt la justesse de ses prévisions, et si plus tard, comme on le verra, il fut forcé sur l'Elbe, ce ne fut point par la Bohême, mais par l'Elbe inférieur, que ses lieutenants n'avaient pas su défendre, et après plusieurs accidents qui l'avaient prodigieusement affaibli. Sa pensée, toujours profonde et d'une portée sans égale lorsqu'il s'agissait des hautes combinaisons de la guerre, était donc de s'établir fortement sur les divers points de l'Elbe, de manière à pouvoir s'en éloigner quelques jours sans crainte, soit qu'il fallût prévenir la masse qui s'avancerait de front, soit qu'il fallût revenir rapidement sur celle qui aurait par la Bohême débouché sur ses derrières, en un mot de recommencer avec 500 mille hommes contre 700 mille, ce qu'il avait accompli dans sa jeunesse avec 50 mille Français contre 80 mille Autrichiens, et les résultats prouveront qu'avec des éléments moins usés, la supériorité incomparable de ses conceptions eût triomphé cette seconde fois comme la première.
Mais la gloire de réaliser sur une échelle si vaste les prodiges de sa jeunesse ne devait pas lui être accordée, pour le punir d'avoir trop abusé des hommes et des choses, des corps et des âmes!
Pour que la ligne de l'Elbe pût avoir toute sa valeur, il fallait employer le temps de la suspension d'armes à en fortifier les points principaux, et se hâter, soit qu'on réussît ou non à prolonger la durée de l'armistice. Le premier point était celui de Kœnigstein, à l'endroit même où l'Elbe sort des montagnes de la Bohême pour entrer en Saxe. (Voir la carte no 58.)
Moyens de parer à ce danger. Nombreux points d'appui qui devaient rendre la ligne de l'Elbe formidable. Kœnigstein et Lilienstein.
Deux rochers, ceux de Kœnigstein et de Lilienstein, placés comme deux sentinelles avancées, l'une à gauche, l'autre à droite du fleuve, resserrent l'Elbe à son entrée dans les plaines germaniques, et en commandent le cours fort étroit en cette partie. Sur le rocher de Kœnigstein, situé
de notre côté, c'est-à-dire sur la gauche du fleuve, se trouvait la forteresse de ce nom, laquelle domine le célèbre camp de Pirna, illustré par les guerres du grand Frédéric. Il n'y avait rien à ajouter aux ouvrages de cette citadelle; seulement la garnison étant saxonne, Napoléon prit soin de la renouveler peu à peu et sans affectation par des troupes françaises. Il ordonna d'y rassembler dix mille quintaux de farine et d'y construire des fours, afin de pouvoir y nourrir une centaine de mille hommes pendant neuf ou dix jours, on va voir dans quelle intention. Sur le rocher opposé situé à la rive droite, celui de Lilienstein, presque tout était à créer. Napoléon commanda des travaux rapides qui permissent d'y loger deux mille hommes en sûreté, et en chargea le général Roguet, l'un des généraux distingués de sa garde. Puis il fit ramasser le nombre de bateaux nécessaires pour y jeter un pont spacieux et solide, capable de donner passage à une armée considérable, et qui, protégé par ces deux forts de Lilienstein et de Kœnigstein, fût à l'abri de toute attaque. Dans sa profonde prévoyance, Napoléon calculait que si une armée ennemie, réalisant les pronostics de plus d'un esprit alarmé, débouchait de la Bohême sur ses derrières, pour attaquer Dresde pendant qu'il serait sur Bautzen par exemple, il pourrait passer l'Elbe à Kœnigstein, et prendre à revers cette armée imprudente. On reconnaîtra bientôt quelle vue pénétrante de l'avenir supposait une telle précaution.
Après Kœnigstein et Lilienstein, placés au débouché des montagnes, venait Dresde, centre des prochaines opérations, Dresde, qui allait devenir, comme nous l'avons déjà dit, ce que Vérone avait été dans les guerres d'Italie. Pendant sa dernière campagne d'Autriche, ne voulant pas exposer Dresde à être le but des opérations de l'ennemi, et désirant épargner à son placide allié le roi de Saxe l'épreuve d'un siége, Napoléon avait conseillé aux ministres saxons de démolir les fortifications de Dresde, et de les remplacer par celles de Torgau. Par une négligence trop ordinaire, on avait démoli Dresde sans édifier Torgau, dont les ouvrages étaient à peine commencés. C'était chose fort regrettable, mais
Dresde.
État de cette place.
Napoléon s'occupe de suppléer aux fortifications détruites.
Napoléon y pourvut par des travaux qui bien qu'improvisés devaient suffire à leur objet. De l'enceinte de Dresde il restait les bastions, qu'il fit réparer et armer. Il suppléa aux courtines par des fossés remplis d'eau et par de fortes palissades. En avant de Dresde, comme dans toutes les villes déjà anciennes, il existait de grands faubourgs, dont la défense importait autant que celle de la ville elle-même. Napoléon les fit envelopper de palissades, et, en avant de toutes les parties saillantes de leur pourtour, il ordonna de construire des redoutes bien armées, se flanquant les unes les autres, et offrant une première ligne d'ouvrages difficile à forcer. Sur la rive droite, c'est-à-dire dans la Neustadt (ville neuve), il décida la construction d'une suite d'ouvrages plus serrés, qui devinrent bientôt une vaste tête de pont presque complétement fortifiée. Deux ponts en charpente, établis l'un au-dessus, l'autre au-dessous du pont de pierre, servaient avec celui-ci aux communications de la ville et de l'armée. Les choses ainsi disposées, trente mille hommes devaient se soutenir dans Dresde environ quinze jours contre deux cent mille hommes, si un chef de grand caractère était chargé du commandement. À ces moyens de défense Napoléon ajouta d'immenses magasins, dont nous ferons bientôt connaître le mode d'approvisionnement, ainsi que de vastes hôpitaux suffisants pour l'armée la plus nombreuse. Il y avait déjà seize mille malades ou blessés dans Dresde; il en prépara l'évacuation, afin d'avoir à sa disposition les seize mille lits qui deviendraient vacants, outre tous ceux qu'il allait établir encore. Avec les toiles de la Silésie il avait de quoi se procurer le principal matériel de ces hôpitaux.
Vaste établissement militaire à Dresde.
Torgau et Wittenberg: travaux ordonnés sur ces deux points.
Après Dresde Napoléon s'occupa de Torgau et de Wittenberg. Il avait pour principe qu'avec du bois on pouvait tout, et que des ouvrages en terre pourvus de fortes palissades étaient capables d'opposer la plus longue résistance. C'est ainsi qu'il résolut de suppléer à ce qui manquait aux
Magdebourg.
fortifications de Torgau et de Wittenberg, et il donna les ordres nécessaires pour que ces travaux fussent achevés en six ou sept semaines. Des milliers de paysans saxons bien payés travaillaient jour et nuit à Kœnigstein, à Dresde, à Torgau, à Wittenberg. Sur ces deux derniers points comme sur les autres, l'établissement des magasins et des hôpitaux accompagnait la construction des ouvrages défensifs. À Magdebourg, l'une des plus fortes places de l'Europe, il n'y avait rien ou presque rien à ajouter en fait de murailles; il suffisait d'en terminer l'armement et d'en composer la garnison. Napoléon résolut d'y consacrer un corps d'armée, qui sans être entièrement immobilisé, pût tout à la fois servir de garnison et rayonner autour de la place, de manière à lier entre elles nos deux principales masses agissantes, celle du haut Elbe et celle du bas Elbe. Dans cette vue, il imagina de transférer à Magdebourg la presque totalité de ses blessés, et de plus le dépôt de cavalerie du général Bourcier. D'abord il importait que nos blessés et le dépôt de nos remontes en Allemagne fussent à l'abri de toute attaque, et dans un emplacement qui ne gênât pas le mouvement de nos forces actives. Sous ces divers rapports Magdebourg présentait tous les avantages nécessaires, car à des remparts presque invincibles cette place joignait de nombreux bâtiments pour hôpitaux, et des espaces libres pour y construire des écuries en planches. Elle était en outre située à une distance presque égale de Hambourg et de Dresde, ce qui en faisait un dépôt précieux entre les deux points extrêmes de notre ligne de bataille. Napoléon après y avoir nommé pour gouverneur son aide de camp le général Lemarois, officier intelligent et vigoureux, lui donna pour instructions sommaires de convertir Magdebourg tout entier en écuries et en hôpitaux. Il calculait qu'en faisant descendre par eau à Magdebourg tous les blessés et malades qui le gênaient à Dresde, qu'en y transportant le dépôt de cavalerie du général Bourcier actuellement en Hanovre, il aurait toujours sur quinze ou dix-huit mille blessés ou convalescents, sur dix ou douze mille cavaliers démontés, trois à quatre mille convalescents guéris, trois à quatre mille cavaliers en état de servir à pied, et pouvant fournir à la défense un fond de
Vaste dépôt préparé à Magdebourg.
garnison de sept à huit mille hommes constamment assuré. Dès lors un corps mobile d'une vingtaine de mille hommes, établi à Magdebourg pour y lier entre elles nos armées du haut et du bas Elbe, pourrait en laissant
Garnison mobile de cette place.
cinq à six mille hommes au dedans, en porter quinze mille au dehors, et rayonner même à une grande distance sans que la place fût compromise. On voit avec quel art subtil et profond il savait combiner ses ressources, et les faire concourir à l'accomplissement de ses vastes desseins.
De Magdebourg à Hambourg le cours de l'Elbe restait sans défense, car de l'une à l'autre de ces villes il n'y avait pas un seul point fortifié. Ce sujet avait occupé Napoléon dès le jour de la signature de l'armistice, et après avoir conçu divers projets, il avait envoyé le général Haxo pour vérifier sur les lieux mêmes quel était celui qui vaudrait le mieux. À la suite d'un long examen, il s'était arrêté à l'idée de construire à Werben, plus près de Magdebourg que de Hambourg, au sommet du coude que l'Elbe forme en tournant du nord à l'ouest, et à son point le plus rapproché de Berlin, une espèce de citadelle faite avec de la terre et des palissades, munie de baraques et de magasins, et dans laquelle trois mille hommes pourraient se maintenir assez longtemps. Enfin Hambourg fut le dernier et le plus important objet de sa sollicitude.
Manière de remplir la lacune de Magdebourg à Hambourg.
Travaux ordonnés à Hambourg pour assurer la défense de cette ville importante.
Il fallait bien que cette grande place de commerce, qui était l'un des principaux motifs pour lesquels il se refusait à une paix nécessaire, fût non pas seulement défendue en paroles contre les négociateurs, mais en fait contre les armées coalisées. Le temps manquait malheureusement, et là comme ailleurs on ne pouvait exécuter que des travaux d'urgence. Il eût fallu dix ans et quarante millions pour faire de Hambourg une place qui comme Dantzig, Magdebourg ou Metz, pût soutenir un long siége. Napoléon, en faisant relever et armer les bastions de l'ancienne enceinte, en faisant creuser et inonder ses
fossés, remplacer ses murailles par des palissades, et lier entre elles les différentes îles qui entourent Hambourg, y prépara un vaste établissement militaire, moitié place forte, moitié camp retranché, où un homme ferme, comme le prouva bientôt l'illustre maréchal Davout, pouvait opposer une longue résistance. Restait au-dessous de Hambourg, à l'embouchure même de l'Elbe, le fort de Gluckstadt, dont la garde fut confiée aux Danois, réduits alors par d'indignes traitements à vaincre ou à succomber avec nous.
Ainsi des montagnes de la Bohême jusqu'à l'Océan du nord, la ligne de l'Elbe devait se trouver jalonnée d'une suite de points fortifiés, d'une valeur proportionnée au rôle de chacun d'eux, et pourvue de ponts qui nous appartiendraient exclusivement, de telle sorte qu'on pût à volonté se porter au delà, revenir en deçà, manœuvrer en un mot dans tous les sens, offensivement et défensivement. La maxime de Napoléon, qu'on ne devait défendre le cours d'un fleuve qu'offensivement, c'est-à-dire en s'assurant de tous ses passages, et en se ménageant toujours le moyen de le franchir, cette maxime allait recevoir ici sa plus savante application.
Ensemble de la ligne de l'Elbe.
Après avoir assuré la défense de cette ligne, Napoléon s'occupe d'en assurer l'approvisionne ment.
Il fallait toutefois suffire à la dépense de ces travaux, qui pour s'exécuter avec rapidité devaient être soldés comptant. Il fallait joindre aux établissements militaires qui viennent d'être énumérés d'immenses approvisionnements, afin que les masses d'hommes qui allaient se mouvoir sur cette ligne y fussent pourvues de tout ce qui leur serait nécessaire. Ici l'esprit ingénieux de Napoléon ne lui fit pas plus défaut que son impitoyable volonté pour faire subir aux peuples les lourdes charges de la guerre.
Premiers ordres rigoureux donnés à l'égard de Hambourg.
On a vu qu'il avait ordonné au maréchal Davout de tirer une cruelle vengeance de la révolte des habitants de Hambourg, de Lubeck et de Brême, de faire fusiller immédiatement les anciens
sénateurs, les officiers ou soldats de la légion anséatique, les fonctionnaires de l'insurrection qui n'auraient pas eu le temps de s'évader, et puis de dresser une liste des cinq cents principaux négociants pour prendre leurs biens, et déplacerlapropriété, avait-il dit. Il avait compté en donnant ces ordres sur l'inexorable rigueur du maréchal Davout, mais aussi, pour l'honneur de tous deux, sur le bon sens et la probité de ce maréchal. Celui-ci était arrivé quelques jours après le général Vandamme, n'avait pas trouvé un seul délinquant à fusiller, et s'y était pris du reste de manière à n'en trouver aucun. La frontière du Danemark placée aux portes mêmes de la ville, l'avait aidé à sauver tout le monde. Quelques exécutions regrettables avaient eu lieu antérieurement, mais c'était lors du premier mouvement insurrectionnel du mois de février, et en punition des indignes traitements exercés contre les fonctionnaires français.
Le maréchal fut donc assez heureux pour n'avoir personne à fusiller. Il restait à dresser des listes de proscription, qui n'entraîneraient pas la perte de la vie, mais celle des biens, et cette mesure ne lui semblait pas plus sage que l'autre. Les Hambourgeois coupables, ou supposés tels, étaient en masse dans la petite ville d'Altona, véritable faubourg de la ville de Hambourg, demandant à revenir dans leurs demeures, à charge au Danemark qui ne voulait pas être compromis avec la France, et faisant faute à celle-ci, qui désirait et pouvait tirer d'eux de grandes ressources, ce qui était plus profitable que d'en tirer des vengeances. Le maréchal Davout représenta à Napoléon qu'il valait mieux pardonner à ceux qui rentreraient dans un temps prochain, leur imposer pour unique châtiment une forte contribution, qu'ils se diraient d'abord incapables de payer, qu'ils payeraient ensuite, se borner ainsi à leur faire peur, et les punir par un côté très-sensible pour eux, très-utile pour l'armée, l'argent. Pas de sang et de grandes ressources, fut le résumé de la politique qu'il conseilla à l'Empereur.
Ces ordres convertis en punitions pécuniaires.
Napoléon qui avait le goût des grandes ressources et pas du tout celui du sang, accepta cette transaction.--Si le lendemain de votre entrée, écrivit-il au maréchal Davout, vous en eussiez fait fusiller quelques-uns, c'eût été bien, maintenant c'est trop tard. Les punitionspécuniaires valentmieux.--C'est ainsi que le despotisme et la guerre habituent les hommes à parler, même ceux qui n'ont aucune cruauté dans le cœur. Il fut donc décidé
Contribution de cinquante millions frappée sur les Hambourgeois, et acquittable en argent ou en matières.
que tout Hambourgeois rentré dans quinze jours serait pardonné, que les autres seraient frappés de séquestre, et que la ville de Hambourg acquitterait en argent ou en matières une contribution de cinquante millions. Une petite partie de cette contribution dut peser sur Lubeck, Brême, et les campagnes de la 32e division militaire. Dix millions durent être soldés comptant, vingt en bons à échéance. Quant au surplus, il fut ouvert un compte pour payer les chevaux, les blés, les riz, les vins, les viandes salées, le bétail, les bois, qu'on allait exiger de Hambourg, de Lubeck et de Brême. Sur le même compte devait être porté le prix de toutes les maisons qu'on allait démolir pour élever les ouvrages défensifs de Hambourg. Les Hambourgeois se plaignirent beaucoup, voulurent présenter leurs doléances à Napoléon, qui refusa de les recevoir, et cette fois trouvèrent inflexible le maréchal qu'ils avaient eu pour défenseur quelques jours auparavant. Ils acquittèrent néanmoins la partie de la contribution qui devait être soldée sur-le-champ, soit en argent, soit en matières. C'était ce qui importait le plus aux besoins de l'armée. Dix millions environ furent envoyés à Dresde; de grandes quantités de grains, de bétail, de spiritueux furent embarqués sur l'Elbe pour le remonter.
Immenses approvisionnem ents remontant de Hambourg sur tous les points fortifiés de l'Elbe.
Dès que Napoléon se vit en possession de ces ressources, il en disposa de manière à se procurer sur tous les points du fleuve et particulièrement à Dresde, de quoi nourrir les nombreuses troupes qu'il allait y concentrer. Il voulait avoir à Dresde, centre principal de ses opérations, de quoi entretenir trois cent mille hommes pendant deux
mois, et notamment une suffisante réserve de biscuit, laquelle portée sur le dos des soldats permettrait de manœuvrer sept ou huit jours de suite sans être retenu par la considération des vivres. Il fallait pour cela cent mille quintaux de grains ou de farine à Dresde, huit ou dix mille à Kœnigstein. Il s'en trouvait environ soixante-dix mille à Magdebourg, qu'on avait mis tout l'hiver à réunir dans cette place, soit pour l'approvisionnement de siége, soit pour suffire à l'entretien des troupes de passage. Napoléon ordonna que ces soixante-dix mille quintaux fussent transportés par l'Elbe à Dresde, et remplacés immédiatement par une quantité égale tirée de Hambourg. Grâce à cette combinaison, ces masses immenses de denrées n'avaient que la moitié du chemin à parcourir. On s'était aperçu que la chaleur et la fatigue donnaient la dyssenterie à nos jeunes soldats, et qu'une ration de riz les guérissait très-vite. On s'empara de tout ce qu'il y avait de riz à Hambourg, à Brême, à Lubeck; on prit de même les spiritueux, les viandes salées, le bétail, les chevaux, les cuirs, les draps, les toiles. Ces matières furent embarquées sur l'Elbe, en suivant le procédé que nous venons d'indiquer, de prendre à Magdebourg ce qui s'y trouvait déjà, et de le remplacer par des envois de Hambourg. Tous les bateliers du fleuve requis et payés avec des bons sur Hambourg, furent mis en mouvement dès les premiers jours de juin, dans le moment même où sous prétexte de fatigue, Napoléon refusait de recevoir M. de Bubna. Ainsi dans les mains de Napoléon l'Elbe était tout à la fois une puissante ligne de défense, et une source inépuisable d'approvisionnements.
Mais il ne borna pas ses précautions à cette ligne seule. Au delà de Dresde à Liegnitz, et en deçà de Dresde à Erfurt, il voulait avoir aussi des magasins bien fournis. Profitant de la richesse de la basse Silésie, sur laquelle était campée l'armée qui avait combattu à Bautzen, et n'ayant guère à ménager cette province, il ordonna qu'on employât les deux mois de l'armistice à réunir une réserve de vingt jours de vivres pour chaque corps, en confectionnant tous les jours beaucoup plus que le nécessaire. En arrière de Dresde, à Erfurt, à Weimar, à Leipzig, à Nuremberg, à Wurzbourg, pays saxons
Autres approvisionnem ents tirés de la Silésie et de la Saxe.
ou franconiens, il était chez des alliés, et il n'usa de l'abondance du pays qu'en payant ce qu'il prenait. Il y ordonna la formation à prix d'argent de très-grands approvisionnements. Toutefois il s'écarta de ces ménagements à l'égard de la ville de Leipzig, qui s'était montrée ouvertement hostile. Il prit les tissus de toile et de laine, les grains, les spiritueux, dont les magasins de Leipzig étaient abondamment pourvus, et de plus fit occuper les établissements publics pour y créer des hôpitaux. Il y joignit la menace de faire brûler la ville au premier mouvement insurrectionnel. Les villes d'Erfurt, de Naumbourg, de Weimar, de Wurzbourg, furent également remplies d'hôpitaux. Erfurt dont il s'était toujours réservé la possession depuis 1809, Wurzbourg, qui était la capitale du grand-duché de Wurzbourg, places qui l'une et l'autre étaient susceptibles d'une certaine résistance, furent armées, afin d'avoir une suite de points fortifiés sur la route de Mayence, si des événements qu'on ne prévoyait pas alors rendaient une retraite nécessaire, car, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, Napoléon, qui, dans ses calculs politiques ne voulait jamais admettre la possibilité des revers, l'admettait toujours dans ses calculs militaires.
Enfin ne pouvant trouver qu'en France les armes, les munitions de guerre, et certains objets d'équipement, tandis que les vivres il les trouvait partout, il conclut avec des compagnies allemandes, des marchés, soldés comptant, pour transporter de Mayence à Dresde, par les trois routes de Cassel, d'Eisenach et de Hof, les objets d'armement et d'équipement qu'il était impossible de se procurer en Saxe.
Telles furent les mesures imaginées par Napoléon pour qu'à la reprise des opérations sa ligne de bataille fût tout à la fois fortement défendue, et largement approvisionnée. Restait un dernier soin à prendre, celui de proportionner le nombre des soldats à l'étendue que la guerre allait acquérir, et Napoléon ne l'avait pas négligé, car dans son vaste esprit toutes les mesures allaient ensemble, sans attendre que l'une fît naître la pensée de l'autre. Toutes étaient
conçues simultanément, avec un accord parfait, et ordonnées sans perte d'une heure.
On a déjà vu qu'en se flattant de l'idée que l'Autriche accéderait peut-être à ses plans, il avait pourtant pris ses mesures dans une hypothèse contraire, et qu'il avait préparé en Westphalie, sur le Rhin, en Italie, trois armées de réserve capables d'entrer prochainement en ligne. Les deux mois de l'armistice, qu'il voulait étendre à trois mois, étaient destinés à terminer vers le commencement d'août cette œuvre commencée en mars.
En Westphalie c'étaient, comme nous l'avons dit, les régiments réorganisés de la grande armée de Russie qui devaient composer deux grands corps sous les maréchaux Victor et Davout, celui-ci de seize régiments, celui-là de douze. Les autres régiments de la grande armée avaient été renvoyés en Italie d'où ils étaient originaires. Les bataillons de chaque régiment ne pouvant être réorganisés tous à la fois, on avait d'abord reconstitué les seconds bataillons, puis les quatrièmes, enfin les premiers, selon l'époque du retour des cadres, et on avait successivement composé les divisions de seconds, de quatrièmes et de premiers bataillons, de manière que chaque régiment était réparti en trois divisions. Napoléon pressé de faire cesser un état de choses vicieux, voulut réunir les trois bataillons déjà prêts, et former les divisions par régiments, non plus par bataillons. Il ne manquait que les troisièmes bataillons, qui allaient être bientôt disponibles à leur tour, et alors tous les régiments devaient être portés à quatre bataillons. Le maréchal Davout forma avec les siens quatre belles divisions, et le maréchal Victor trois. Tandis que ces organisations s'achevaient, Napoléon arrêta l'emplacement et l'emploi de ces deux corps d'armée. Celui du maréchal Victor resté en arrière jusqu'ici, fut acheminé sur la ligne frontière de l'armistice, et cantonné le long de l'Oder, aux environs de Crossen, pour achever de s'y instruire, et pour s'y
Nouveaux corps d'armée préparés dans la supposition de la guerre avec l'Autriche. Corps du maréchal Victor.
approvisionner conformément aux prescriptions adressées à tous les autres corps.
Napoléon pensant que pour garder les départements anséatiques et le bas Elbe, le maréchal Davout, renforcé par les Danois, aurait trop de quatre divisions, car d'après toutes les vraisemblances les grands coups devaient se porter sur l'Elbe supérieur, imagina de partager le corps de ce maréchal, de lui laisser deux divisions, d'en confier deux au général Vandamme, et de placer celles-ci à Wittenberg, d'où il pourrait les attirer à lui, s'il en avait besoin, ou les renvoyer sur le bas Elbe, si elles devenaient nécessaires au maréchal Davout.
Corps du général Vandamme.
Corps du maréchal SaintCyr.
Les autres corps destinés à renforcer la masse des troupes actives s'organisaient à Mayence. Là, comme on doit s'en souvenir, se rendaient les cadres tirés de France ou d'Espagne, qu'on remplissait sur les bords du Rhin de conscrits rapidement instruits, et qu'on réunissait ensuite dès qu'on avait pu se procurer deux bataillons du même régiment, afin d'éviter autant que possible la formation vicieuse en régiments provisoires. Il y avait à Mayence quatre divisions dont l'organisation était presque achevée, et qui dans deux mois seraient en aussi bon état qu'on pouvait l'espérer dans la situation des choses. Napoléon les destinait au maréchal Saint-Cyr, blessé en 1812 sur la Dwina, mais actuellement remis de ses fatigues et de sa blessure. C'étaient par conséquent trois corps d'armée, ceux du maréchal Victor, du général Vandamme, du maréchal Saint-Cyr, comprenant environ 80 mille hommes d'infanterie, sans les armes spéciales, dont Napoléon allait accroître ses forces en Saxe contre l'apparition éventuelle de l'Autriche sur le théâtre de la guerre. Ce puissant renfort était indépendant de l'augmentation que devaient recevoir les corps avec lesquels il avait ouvert la campagne. Outre les quatre divisions déjà prêtes à Mayence, Napoléon avait encore rassemblé les éléments de deux autres, qui allaient
Corps du maréchal
se former sous le maréchal Augereau, et être rejointes par deux divisions bavaroises. La cour de Bavière un moment attirée, comme la Saxe, à la politique médiatrice de l'Autriche, s'était subitement rejetée en arrière, dès qu'on lui avait demandé sur les bords de l'Inn des sacrifices sans compensation. Elle s'était hâtée de renouveler ses armements, et on pouvait compter de sa part sur deux bonnes divisions, à la condition toutefois que la victoire viendrait contenir l'esprit de son peuple, et encourager la fidélité de son roi. Ces quatre divisions, deux françaises et deux bavaroises, devaient menacer l'Autriche vers le haut Palatinat.
Augereau. Armée d'Italie.
Enfin Napoléon avait suivi avec son attention accoutumée l'exécution des ordres donnés au prince Eugène, pour qu'avec les cadres revenus de Russie, avec ceux qui revenaient chaque jour d'Espagne, on refît en Italie une armée de soixante mille hommes, à laquelle il voulait joindre vingt mille Napolitains. Murat, toujours flottant entre les sentiments les plus contraires, blessé par les traitements de Napoléon, mais voulant avant tout sauver sa couronne, ne sachant avec qui elle serait sauvée plus sûrement, ou avec l'Autriche, ou avec la France, faisait encore attendre l'envoi de son contingent. Napoléon à peine rentré à Dresde l'avait sommé de se décider, et avait enjoint à M. Durand de Mareuil, ministre de France à Naples, de se retirer si les ordres de marche n'étaient donnés immédiatement au corps napolitain. Il restait dans les dépôts de quoi fournir six à sept mille hommes de cavalerie légère à la future armée d'Italie, ce qui suffisait dans cette contrée, où la cavalerie, trouvant peu l'occasion de charger en ligne, n'était qu'un moyen de s'éclairer. Les arsenaux et les dépôts d'Italie contenaient encore les éléments d'une belle artillerie. Napoléon se flattait donc d'avoir en Italie au 1er août une armée de 80 mille hommes, pourvue de 200 bouches à feu, menaçant d'envahir l'Autriche par l'Illyrie, et ayant pour but Vienne elle-même. Il calculait que l'Autriche, eût-elle armé trois cent mille hommes, ce qui était beaucoup dans l'état de ses finances et avec le temps dont elle disposait, n'en pourrait pas tirer plus de deux cent mille combattants
présents au feu, dont il faudrait qu'elle détournât cinquante mille pour tenir tête au prince Eugène en Italie, trente mille pour faire face au maréchal Augereau en Bavière, ce qui ne lui laisserait pas plus de cent vingt mille hommes à ajouter à la masse des troupes coalisées sur l'Elbe.
Les trois corps de Victor, de Vandamme, de Saint-Cyr (sans compter celui d'Augereau, qui n'était pas destiné à agir sur l'Elbe), lui semblaient déjà une ressource presque suffisante contre l'apparition de l'Autriche sur le terrain de cette lutte formidable. Mais le corps de Poniatowski, après bien des vicissitudes, amené à travers la Gallicie et la Bohême à Zittau, sur la ligne où campaient nos corps de Silésie, était une nouvelle ressource d'une véritable importance, bien moins par la quantité que par la qualité des soldats. Il n'y en avait pas de plus braves, de plus aguerris, de plus dévoués à la France. De leur patrie, il ne leur restait que le souvenir, et le désir de la venger. Napoléon résolut de leur en donner une, en les faisant Français, et en les prenant au service de la France. En attendant leur annexion définitive à l'armée française, il les plaça sous l'administration directe de M. de Bassano, et prescrivit à ce ministre de leur payer leur solde arriérée, de les pourvoir de vêtements, d'armes, de tout ce qui leur manquait, de leur faire en un mot passer ces deux mois dans une véritable abondance. Ils pouvaient, en recueillant quelques débris de troupes polonaises épars çà et là, mais sans toucher ni à la division Dombrowski, ni à divers détachements de leur nation répandus dans les places, réunir environ douze mille hommes d'infanterie et trois mille de cavalerie. C'était une nouvelle force ajoutée à celles qui avaient combattu à Lutzen et à Bautzen.
Corps du prince Poniatowski, amené par la Bohême en Silésie.
L'organisation de la garde complétée.
Enfin, au nombre des ressources créées pour la campagne d'automne, et pour l'éventualité de la guerre avec l'Autriche, il fallait compter le développement donné à la garde impériale. Elle n'avait eu que deux divisions à l'entrée en campagne, une de vieille,
l'autre de jeune garde. Une troisième division avait rejoint au moment de l'armistice, une quatrième venait d'arriver, une cinquième était en marche, ce qui avec douze mille hommes de cavalerie et deux cents bouches à feu, devait composer un corps de près de cinquante mille hommes, dont trente mille de jeune infanterie, que Napoléon entendait ne pas ménager comme la vieille garde, mais employer dans toutes les grandes batailles, qui malheureusement allaient être nombreuses et sanglantes.
Restait la cavalerie, qui avait manqué au commencement de la campagne, et qui avait été l'un des motifs de Napoléon pour signer l'armistice. Une cavalerie insuffisante équivaut à peu près à une cavalerie nulle, car elle n'ose pas s'engager de peur d'être accablée, et demeure cachée derrière l'infanterie qu'elle ne sert pas même à éclairer. C'est ce qu'on avait vu à Lutzen et à Bautzen. Les deux corps de Latour-Maubourg et de Sébastiani ne montaient pas au 1er juin à plus de huit mille cavaliers. On pouvait en tirer quatre mille des dépôts du général Bourcier, et environ vingthuit mille de France, les uns amenés par le duc de Plaisance, les autres en marche sous le duc de Padoue, ce qui devait porter à quarante mille hommes les forces de l'armée d'Allemagne en troupes à cheval, sans compter la cavalerie de la garde impériale et des alliés, Saxons, Wurtembergeois et Bavarois. Seulement dans les vingt-huit mille cavaliers tirés de France, il y en avait quelques mille venant à pied, et auxquels il fallait fournir des chevaux. Les troubles survenus sur la gauche de l'Elbe par suite de l'insurrection des villes anséatiques, avaient singulièrement nui aux remontes. Napoléon ordonna de les reprendre, et fit insérer sur cet objet un article dans le traité d'alliance par lequel le Danemark s'était définitivement rattaché à la France. Par ce traité la France promettait d'entretenir toujours vingt mille hommes de troupes actives à Hambourg, afin de concourir à la défense des provinces danoises, et le Danemark s'engageait en retour à fournir à la France dix mille hommes d'infanterie, deux mille de cavalerie, les uns et les autres soldés par le trésor français, et à procurer dix mille chevaux à condition qu'ils
La cavalerie de l'armée portée à une force suffisante.
seraient payés comptant. C'était, indépendamment des achats recommencés en Hanovre, une nouvelle ressource pour monter les cavaliers qui venaient de France à pied. On avait donc la presque certitude de réunir sous deux ou trois mois près de quarante mille cavaliers de toutes armes, non compris dix à douze mille de la garde, et huit à dix mille des alliés, ce qui devait composer une force totale de soixante mille hommes à cheval. Napoléon attribua deux mille hommes environ de cavalerie légère ou de ligne à chaque corps d'armée pour s'éclairer. Le reste il le forma suivant son usage en divers corps de réserve, destinés à combattre en ligne. Les généraux
Latour-Maubourg et Sébastiani en commandaient déjà deux, qui avaient fait la campagne du printemps. Le duc de Padoue commandait le troisième, qui venait d'arriver et était occupé à châtier les Cosaques. Le comte de Valmy, fils du vieux duc de Valmy, fut placé à la tête du quatrième. Napoléon en voulut créer un cinquième avec des régiments nouvellement tirés d'Espagne. Depuis qu'il avait donné l'ordre d'évacuer Madrid, et de concentrer toutes les forces françaises dans le nord de la Péninsule, la cavalerie qui avait eu pour mission principale de lier entre eux les divers corps d'occupation, était beaucoup moins nécessaire. Il y avait encore trente-six régiments de cavalerie dans la Péninsule, dont vingt de dragons, onze de chasseurs, cinq de hussards. Napoléon crut que c'était assez de vingt, surtout en ne prenant que les cadres, et en laissant la plus grande partie des hommes en Espagne. Il ordonna donc le départ de dix régiments de dragons, quatre de chasseurs, deux de hussards. Il en destina deux à l'Italie, quatorze à l'Allemagne, et recommanda de transporter tout de suite ces cadres à Mayence, où ils allaient se remplir de sujets empruntés aux dernières conscriptions et déjà passablement instruits. Les chevaux requis en France, et payés comptant, devaient servir à les monter. Napoléon se promettait encore quatorze ou quinze mille cavaliers, provenant de cette origine, et enfermés tous dans des cadres excellents. C'était un dernier supplément qui à l'automne devait porter à soixante-quinze mille hommes au moins le total de sa cavalerie. À ces préparatifs pour l'infanterie et la
Nouveaux cadres de cavalerie tirés d'Espagne.
cavalerie, Napoléon ajouta ceux qui concernaient l'artillerie, et il fit ses dispositions pour qu'elle pût mettre en mouvement mille bouches à feu de campagne.
Ainsi établi sur la ligne de l'Elbe, qu'il avait rendue formidable par les appuis qu'il s'y était ménagés, Napoléon se flattait d'avoir sans les garnisons 400 mille combattants, plus 20 mille en Bavière et 80 mille en Italie, ce qui porterait la totalité de ses ressources à 500 mille hommes de troupes actives, et à 700 mille en y comprenant les non présents sous les armes. C'était pour atteindre à ces nombres énormes, suffisants dans sa puissante main pour battre la coalition même accrue de l'Autriche, qu'il avait consenti à un armistice qui donnait aux coalisés le temps d'échapper à ses poursuites, et malheureusement aussi celui d'augmenter considérablement leurs forces. La question était de savoir si en fait de création de ressources, le temps profiterait aux coalisés autant qu'à Napoléon. Les coalisés, il est vrai, n'avaient pas son génie, et c'est sur quoi il fondait ses espérances, mais ils avaient la passion, seule chose qui puisse suppléer au génie, surtout quand elle est ardente et sincère. Napoléon, ne tenant guère compte de la passion, avait supposé que le temps lui servirait plus qu'à ses ennemis, et c'est dans cet espoir qu'il mettait tant d'art à le bien employer en fait de préparatifs militaires, et à le perdre en fait de négociations.
Totalité des forces dont Napoléon se flattait de disposer pour soutenir la guerre contre l'Europe entière.
Effet produit par la réponse de Napoléon sur l'empereur François et sur M. de Metternich.
La réponse envoyée à M. de Metternich le 15 juin avait été interprétée comme elle devait l'être, et l'habile ministre autrichien avait parfaitement compris que lorsque sur quarante jours restant pour négocier la paix générale, on en perdait d'abord cinq pour répondre à la note constitutive de la médiation, indépendamment de ceux qu'on allait perdre encore pour résoudre les questions de forme, il fallait en conclure qu'on était peu pressé d'arriver à une solution pacifique. Il se pouvait, à la vérité, que Napoléon ne voulût dire sa véritable
M. de Metternich se rend à Oppontschna auprès des souverains coalisés.
Traité de subsides entre l'Angleterre et pensée que dans les derniers moments; il se pouvait aussi que dans les difficultés qu'il avait soulevées, il y en eût quelqu'une qui lui tînt sérieusement à cœur, et par ces considérations M. de Metternich ne désespérait pas complétement de la paix, soit aux conditions proposées par l'Autriche, soit à des conditions qui s'en approcheraient. Dans l'un et l'autre cas, il avait pensé qu'il fallait à son tour attendre Napoléon, en employant toutefois un moyen de le stimuler. Les deux souverains de Prusse et de Russie insistaient vivement pour voir l'empereur François, dans l'espérance de l'attacher définitivement à ce qu'ils appelaient la cause européenne. Mais l'empereur François, croyant devoir à sa qualité de père et de médiateur, d'observer une extrême réserve à l'égard de deux souverains devenus ennemis implacables de la France, ne voulait pas, tant qu'il n'aurait pas été contraint à nous déclarer la guerre, s'aboucher avec eux. Les mêmes raisons de réserve n'existaient pas pour M. de Metternich, et ce ministre s'était rendu à Oppontschna afin de conférer avec les deux monarques coalisés. Son intention était de profiter de cette occasion pour les amener à ses idées, chose plus facile sans doute que d'y amener Napoléon, mais difficile aussi, et exigeant bien des soins et des efforts, car ils voulaient la guerre tout de suite, à tout prix, et jusqu'au renversement de Napoléon, ce qui n'était pas encore, du moins alors, le point de vue de l'Autriche. M. de Metternich était donc parti ostensiblement, certain que lorsque Napoléon le saurait en conférence avec les deux souverains, il en éprouverait une vive jalousie, et au lieu de lui refuser de venir à Dresde, lui en adresserait la pressante invitation. Cette vue, bientôt confirmée par l'événement, avait paru aussi fine que juste à l'empereur François, qui par ce motif avait approuvé le voyage de M. de Metternich à Oppontschna.
Tandis que ce ministre était en route pour s'y rendre, la Prusse et la Russie venaient de se lier par un traité de subsides avec l'Angleterre. Par ce traité, conclu le 15 juin et revêtu de la signature de
les puissances coalisées.
lord Cathcart, de M. de Nesselrode et de M. de Hardenberg, l'Angleterre s'engageait à fournir immédiatement 2 millions sterling à la Russie et à la Prusse, et à prendre à sa charge la moitié d'une émission de papier-monnaie, intitulé papier fédératif, et destiné à circuler dans tous les États alliés. La somme émise devait être de 5 millions sterling. C'étaient donc 4 millions ½ sterling (112 millions 500 mille francs) que l'Angleterre fournissait aux deux puissances, à condition qu'elles tiendraient sur pied, en troupes actives, la Russie 160 mille hommes, la Prusse 80 mille, qu'elles feraient à l'ennemi commun de l'Europe une guerre à outrance, et qu'elles ne traiteraient pas sans l'Angleterre, ou du moins sans se concerter avec elle. Les souverains de Russie et de Prusse ayant informé lord Cathcart qu'ils étaient sommés d'accepter la médiation de l'Autriche, et qu'ils y étaient disposés, sauf les conditions de paix qui seraient déterminées d'accord avec le cabinet britannique, lord Cathcart n'avait pas vu là une infraction au traité de subsides, et il avait reconnu lui-même qu'il fallait se prêter à tous les désirs de l'Autriche, car probablement les conditions que cette puissance regardait comme indispensables ne seraient pas admises par Napoléon, et l'on entraînerait ainsi cette puissance à la guerre par la voie toute pacifique de la médiation.
Condition imposée par ce traité de ne pas faire la paix sans l'Angleterre.
Efforts des souverains et de leurs ministres pour décider M. de Metternich en faveur de la coalition.
Raisons qu'ils font valoir auprès de M. de Metternich.
M. de Metternich arrivé à Oppontschna avait été accablé de caresses et de sollicitations par les souverains et leurs ministres. Les uns et les autres, pour le décider, disaient leurs forces immenses, irrésistibles même si l'Autriche se joignait à eux, et dans ce cas Napoléon perdu, l'Europe sauvée. Ils disaient encore la paix impossible avec lui, car évidemment il ne la voulait pas, et en outre peu sûre, car si on laissait échapper l'occasion de l'accabler pendant qu'il était affaibli, il reprendrait les armes dès qu'il aurait recouvré ses forces, et la lutte avec lui serait éternelle. Ces points de vue
Manière de penser de l'Autriche en ce moment. n'étaient pas, ne pouvaient pas être ceux de l'Autriche. Cette puissance n'était pas comme la Russie enivrée du rôle de libératrice de l'Europe, comme la Prusse réduite à vaincre ou à périr, comme l'Angleterre à l'abri de toutes les conséquences d'une guerre malheureuse; elle avait de plus des liens avec Napoléon, que la décence, et chez l'empereur François l'affection pour sa fille, ne permettaient pas de rompre sans les plus graves motifs. Elle rêvait d'ailleurs la possibilité de rétablir l'indépendance de l'Europe sans une guerre qu'elle regardait comme pleine de périls, même contre Napoléon affaibli. Elle était donc d'avis que si on pouvait conclure une paix avantageuse et qui offrît des sûretés, il fallait en saisir l'occasion, et ne pas tout compromettre pour vouloir tout regagner d'un seul coup. Si par exemple Napoléon renonçait à sa chimère polonaise (c'est ainsi qu'on qualifiait le grand-duché de Varsovie), s'il consentait à reconstituer la Prusse, à rendre à l'Allemagne son indépendance par l'abolition de la Confédération du Rhin, à lui rendre son commerce par la restitution des villes anséatiques, il valait mieux accepter cette paix que s'exposer aux dangers d'une guerre formidable, qui à côté de bonnes chances en présentait d'effrayantes. Si l'Angleterre n'inclinait pas vers cette manière de penser, il fallait l'y amener forcément, en lui signifiant qu'on la laisserait seule. Pour elle d'ailleurs le point le plus important était obtenu, car il était facile de voir que Napoléon allait renoncer à l'Espagne, puisqu'il admettait au congrès les représentants de l'insurrection de Cadix, ce qu'il n'avait jamais accordé. Il fallait donc imposer la paix à l'Angleterre comme à Napoléon, car cette paix était un besoin urgent pour le monde entier, et on avait le moyen de l'obtenir, en menaçant l'Angleterre de traiter sans elle, et Napoléon de l'accabler sous les forces réunies de l'Europe. Telles étaient les idées de l'Autriche, que les deux souverains de Prusse et de Russie, dominés par les passions du moment, étaient loin de partager. Ils auraient voulu une paix beaucoup plus rigoureuse pour la France, et par exemple la Westphalie, la Hollande ne leur semblaient pas devoir être concédées à Napoléon. Ils parlaient de lui ôter une partie au moins de l'Italie, pour la rendre à l'Autriche, qui n'avait pas besoin
Résolutions formelles exprimées par M. de Metternich.
qu'on éveillât en elle ce genre d'appétit, mais chez laquelle la prudence faisait taire l'ambition. M. de Metternich, tout en trouvant ces vœux fort légitimes, avait déclaré que l'Autriche, dans l'espoir d'une conclusion pacifique, se bornerait à demander l'abandon du duché de Varsovie, la reconstitution de la Prusse, l'abolition de la Confédération du Rhin, la restitution des villes anséatiques, et ne ferait la guerre que si ces conditions étaient refusées par la France. On lui avait répondu qu'elles le seraient inévitablement, à quoi le ministre autrichien avait facilement répliqué que si elles étaient refusées, alors son maître pourrait honorablement devenir membre de l'alliance, et le deviendrait résolûment.
Il suffisait que l'Autriche posât des conditions d'une manière formelle, pour qu'on fût obligé de les admettre, car sans elle la guerre à Napoléon ne présentait aucune chance. Dictant la loi à la Prusse et à la Russie, elle la dictait par suite à l'Angleterre, qui bientôt se verrait contrainte de traiter si le continent finissait luimême par traiter. On devait donc subir les volontés de l'Autriche, mais on les subissait sans répugnance, car on était convaincu que les conditions par elle imaginées seraient rejetées par Napoléon, et on croyait en lui cédant la tenir bien plus qu'être tenu par elle. Le résultat de ces conférences avait été qu'on accepterait la médiation autrichienne, qu'on s'aboucherait avec Napoléon par l'intermédiaire de l'Autriche, que celle-ci lui proposerait les conditions précitées, qu'elle ne lui déclarerait la guerre qu'en cas de refus, que jusque-là elle demeurerait neutre, que relativement à l'Angleterre, en l'informant de cette situation, on ajournerait la paix avec elle pour simplifier la question: toutefois l'opinion était que la paix continentale devait entraîner prochainement et inévitablement la paix maritime.
Les monarques coalisés adhèrent aux vues de l'Autriche, convaincus que, par la faute de Napoléon, elle sera bientôt ramenée vers eux.
Retour de M. de Metternich à Gitschin.
Ces bases adoptées, M. de Metternich était revenu à Gitschin, auprès de son maître, et avait trouvé en y arrivant sa prévoyance parfaitement justifiée. En effet Napoléon, inquiet de ce qui se passait en Bohême, sachant que les allées et venues étaient continuelles entre Gitschin, résidence de son beau-père, et Reichenbach, quartier général des coalisés, sachant même que M. de Metternich avait dû voir les deux souverains de Russie et de Prusse à Oppontschna, n'avait pas pensé qu'il fallût pousser l'application à perdre son temps, jusqu'à rester étranger à tout ce qui se tramait entre les puissances, et peut-être jusqu'à laisser nouer à côté de lui une coalition redoutable, dont il pourrait prévenir la formation en intervenant à propos. En voyant M. de Metternich, avec lequel il avait fort la coutume de s'entretenir, il se flattait au moins de pénétrer les desseins de la coalition, ce qui pour lui n'était pas de médiocre importance, et surtout de se ménager une nouvelle prolongation d'armistice, seul résultat auquel il tînt beaucoup, car pour la paix il n'y tenait nullement aux conditions proposées. En conséquence il avait fait dire par M. de Bassano à M. de Bubna qu'il recevrait volontiers M. de Metternich à Dresde, et qu'il croyait même sa présence devenue nécessaire pour l'entier éclaircissement des questions qu'il s'agissait de résoudre. M. de Bubna avait sur-le-champ écrit à Gitschin, et c'est ainsi que M. de Metternich, en revenant de son entrevue avec Alexandre et Frédéric-Guillaume, avait trouvé l'invitation de se rendre à Dresde auprès de Napoléon. Comme c'était justement ce que lui et l'empereur François désiraient, il n'y avait pas à hésiter sur l'acceptation du rendez-vous offert, et M. de Metternich s'était décidé à se mettre de nouveau en route. Au moment de son départ, l'empereur François lui avait remis une lettre pour son gendre, dans laquelle il donnait pouvoir à son ministre des affaires étrangères de signer tous articles relatifs à la modification du traité d'alliance, et à l'acceptation de la médiation autrichienne. Dans cette lettre, il pressait de nouveau Napoléon de se résoudre à la paix, qui était, disait-il, la plus belle et l'unique gloire qui lui restât à conquérir.
Il y trouve l'invitation de se rendre à Dresde.