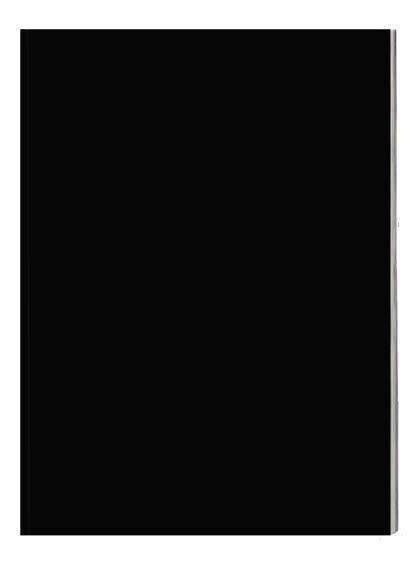8 minute read
BOULEVARD DES HÉROS
MATA HARI LE DESTIN TRAGIQUE D’UNE EXQUISE EXCENTRIQUE
L’auteur MICHAEL KÖHLMEIER raconte les destins hors du commun de personnages inspirants, dans le respect des faits et de sa liberté d’écrivain. Ce mois-ci, une mystérieuse espionne rattrapée par son propre mythe.
Figurez-vous qu’en français, un imposteur n’a, semble-t-il, pas de féminin offciel. Une absence inexpliquée qui laisserait à penser – à tort – que ce travers serait exclusivement l’apanage des hommes. Pour vous prouver le contraire, laissez-moi vous conter l’histoire d’une femme que l’on pourrait, à juste titre, considérer comme la plus grande «imposteur» de tous les temps: Mata Hari, la femme fatale, la belle danseuse fantasque et mystérieuse courtisane devenue agent double, qui aurait infuencé le cours, voire l’issue de la Première Guerre mondiale.
Les mythes ne résistent pas, dit-on, au jugement impartial de l’Histoire. Tôt ou tard, face à la réalité des faits, ils fnissent par s’effriter et retombent dans l’oubli, sans que personne ne sache plus vraiment ce qu’ils ont un jour voulu raconter. Le mythe de Mata Hari a connu la trajectoire inverse: la vérité était connue de tous, dès le début, mais fut, après sa mort, reléguée au second plan pour ne laisser briller que le personnage mythique qu’elle s’était inventé.
Quelle aubaine, il faut dire, que ce destin hors du commun, réunissant tous les ingrédients d’un véritable mélodrame shakespearien: cette dangereuse séductrice, désirable et désirée de tous, jouant avec les hommes comme avec des marionnettes, usant de son intelligence et de son charme pour infuencer le destin politique de tout un continent.
La postérité en ft une sombre héroïne: que de livres, de pièces de théâtre, de chansons ont été écrits sur elle. Elle fut incarnée une dizaine de fois à l’écran: en 1931 par Greta Garbo, en 1964 par Jeanne Moreau, la dernière adaptation télévisuelle de sa biographie MICHAEL KÖHLMEIER datant de 2017. Elle a aussi inspiré un L’écrivain originaire du ballet et de nombreux personnages de Voralberg, en Autriche, jeux vidéo. est considéré comme Mais pour quels faits remarquables, l’un des meilleurs narra teurs de langue allemande. Dernier titre quels exploits de haut vol, cette héroïne romanesque est-elle entrée dans l’Hisparu, en allemand chez toire? Réponse: aucun. Le seul exploit Hanser Verlag: Matou. qu’elle ait réalisé dans sa vie fut de se bâtir, de son vivant, une aura légendaire, un mythe si grand qu’il fnira par la dévorer. En dehors du personnage qu’elle a donc voulu créer, qui était vraiment Mata Hari?
Elle naît sous le nom de Margaretha Geertuida Zelle dans la petite ville de Leeuwarden, en Hollande, le 7 août de l’année 1876, très loin des contrées exotiques de l’Inde et de Java dont on la croira plus tard originaire. Son père est un riche chapelier, un homme connu pour son excentricité et son amour de la mise en scène, qui mène grand train et aime se faire appeler «baron». Adorant sa petite «Grietje» chérie, il lui fait un jour fabriquer, alors qu’elle n’a que trois ans, un somptueux carrosse doré: en promenant ainsi sa flle sous les regards admiratifs des bourgeois de la ville, il veut aussi montrer ce qu’un homme comme lui est capable de s’offrir.
Au centre de l’attention, dans ce carrosse de princesse, la petite Margaretha jubile. Devenue adulte, elle racontera souvent cette scène mémorable, dont le scénario et le décor changeront selon ses envies et son public – un jour en Inde, dans un carrosse tiré par des éléphants ou des chèvres, elle se décrit une autre fois assise dans un magnifque palanquin porté par des singes.
«J’aime les hommes qui ont un avenir et les femmes qui ont un passé», disait Oscar Wilde. À dix-sept ans à peine, Margaretha Geertuida aime déjà s’entourer de mystère et de drame, se façonner un personnage distant et mélancolique. Elle veut devenir comédienne, danseuse et chanteuse: son père dépense des sommes folles pour son éducation, la jeune flle parle parfaitement cinq langues et se peaufne, dans chacune d’elles, y compris sa langue maternelle, un accent suffsamment exotique pour titiller la curiosité de ses interlocuteurs quant à ses origines. Mais de véritables talents artistiques, la jeune Hollandaise en est dépourvue. Qu’à cela ne tienne, elle possède un don unique dont elle usera et abusera tout au long de sa courte vie: l’art de l’affabulation. Une virtuose de la mythomanie, une aventurière douée d’une imagination sans bornes. Ça tombe bien: cette Europe d’avant-guerre raffole de drames, de larmes et de destins déchirants. Comment expliquer, sinon, qu’elle se fût jetée avec autant d’empressement et d’enthousiasme dans l’enfer de la Première Guerre mondiale?
La jeune flle épouse un offcier de la marine néerlandaise, de dix-neuf ans son aîné, puis part s’installer avec lui dans les Indes néerlandaises, où ils resteront cinq ans. De cette union improbable naissent deux enfants: à Java, son petit garçon meurt empoisonné dans d’obscures conditions, ce qui va accélérer la fn de ce couple si mal assorti. Ils rentrent en Europe et divorcent. Alors qu’elle a obtenu la garde de sa flle, son ex-époux l’enlève, lui reprochant d’être une mauvaise mère: elle ne reverra sa petite Louise Jeanne qu’une seule fois.
Àvingt-neuf ans, celle qui se nomme encore Margaretha Geertruida semble avoir la vie devant elle et des rêves de grandeur plein la tête. Elle déménage à Paris, ville de tous les possibles, s’invente un nom – Mata Hari, qui veut dire «œil du jour» en malais – et un passé: flle d’un prince indien, détentrice des traditions de danses sacrées de son pays natal. Avec son physique de déesse exotique, sa peau mate et sa longue chevelure brune, il n’en fallait pas plus pour enfammer le Tout-Paris, qui ne s’intéresse guère aux détails anachroniques d’une biographie fantasmée. Un jour, alors qu’elle est confrontée par un journaliste à l’une de ces contradictions, elle le toise de son regard noir, suffsamment longtemps pour que le pauvre homme en oublie sa question. Si elle sait séduire par la parole, elle sait encore mieux le faire en se taisant…
Ses spectacles de danse commençaient par cette phrase: «Shiva, je la danse pour toi, la danse des bayadères.» Les bayadères étaient ces belles danseuses de temple indiennes – si abondamment décrites dans les récits des voyageurs depuis Marco Polo – dont la tâche était de susciter l’intérêt de Shiva. Or, est-il vraiment besoin de savoir danser comme une ballerine pour éveiller l’attention d’un dieu? Le public, lui, tombe sous le charme de cette danseuse venue d’on-nesait-où et surtout de ses effeuillages savamment orchestrés: au rythme de ses langoureuses ondulations, la voilà qui laisse tomber ses voiles un par un, jusqu’à se retrouver presque entièrement nue, comme une servante de temple offerte à son idole. C’est un véritable triomphe dans le Paris de la Belle Époque! Mais elle ne s’arrête pas là, et décide de partir à Berlin pour poursuivre sa carrière. Elle y rencontre des hommes politiques, des militaires, laisse courir la rumeur qu’elle aurait une liaison avec le fls de l’empereur Guillaume. Partout, le mensonge la suit comme une ombre.
Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, elle a trente-huit ans et sait toute la fragilité de son statut de courtisane. Elle sait que tout ce qu’elle possède n’est que poudre aux yeux. Que ses nombreux amants ne lui ont pas fait connaître l’amour. Qu’elle n’a fait qu’utiliser les hommes pour se bâtir une carrière qui ne repose sur aucun talent véritable, sinon celui de s’inventer une réputation. Lorsqu’elle était à Berlin, elle a bien essayé, une seule fois, d’être embauchée dans un théâtre de renom. Mais la réaction du directeur, d’abord fou de joie à l’idée de rencontrer la grande Mata Hari, fut sans appel: déçu, il dira ne jamais avoir vu de sa vie une comédienne aussi peu douée.
Pendant la guerre, elle fait la connaissance d’un certain Carl H. Cramer, consul allemand à La Haye, qui devient son amant. Or, il se trouve que Cramer est aussi un agent des services de renseignement de l’empire allemand: il propose donc à sa belle de mettre à proft ses connaissances des langues et ses relations politiques et militaires en France pour devenir une espionne au service des Allemands. Cramer, comme les autres, va surestimer le pouvoir et la réputation de cette femme qui fréquente, du moins le dit-elle, les cercles haut placés de la
« Mata Hari joue un double jeu dans les deux camps : qui tombera dans le piège en premier ? »
« Ignorant le danger auquel elle s’expose, la courtisane joue son dernier coup de poker. »
capitale française. Mata Hari accepte, livre quelques informations sans grande importance et savoure sans doute l’attention qu’elle suscite à nouveau… jusqu’au jour où elle fait la connaissance de Georges Ladoux, chef du contre-espionnage français, qui lui fait d’emblée la même proposition alléchante que Cramer: puisqu’après tout, son cœur bat pour la France, elle pourrait travailler pour son pays d’accueil comme agent double et serait payée grassement pour ses services.
Comment ne pas accepter, elle qui n’aspire qu’à retrouver l’aisance, le luxe et l’importance dont elle jouissait avant la guerre? La reine du bluff n’en est pas à son premier coup de poker: elle décide alors de miser le tout pour le tout sur cette combinaison à haut risque. Faisant f du danger auquel elle s’expose, Mata Hari choisit un double jeu: agent H-21 pour les Allemands, agent double pour les Français – qui sera berné en premier? Ce sera elle, fnalement. Les Français croient soudain comprendre que leur agent double travaille en réalité bel et bien pour le Kaiser: après tout, cette étrangère, cette mystérieuse conspiratrice – dont on ne sait rien – n’a-t-elle pas avoué avoir eu une relation avec le fls de l’empereur Guillaume? Prise au piège de ses propres mensonges, Mata Hari crie son innocence, mais il est trop tard: accusée de haute trahison en pleine Guerre mondiale par un tribunal militaire, elle est fusillée le 15 octobre 1917 dans le parc du château de Vincennes.
Le commandant du 26e bataillon de chasseurs français note dans son rapport: «Elle avait une allure étonnamment fère, et je dirais presque théâtrale. Elle embrassa ses protecteurs puis envoya de sa main des baisers d’adieu en direction des spectateurs, où se trouvaient de nombreux gradés et personnalités. Au moment où j’abaissai mon sabre pour donner l’ordre de tirer, elle me regarda droit dans les yeux et me dit d’une voix grave et posée: “Je vous remercie, monsieur.” »