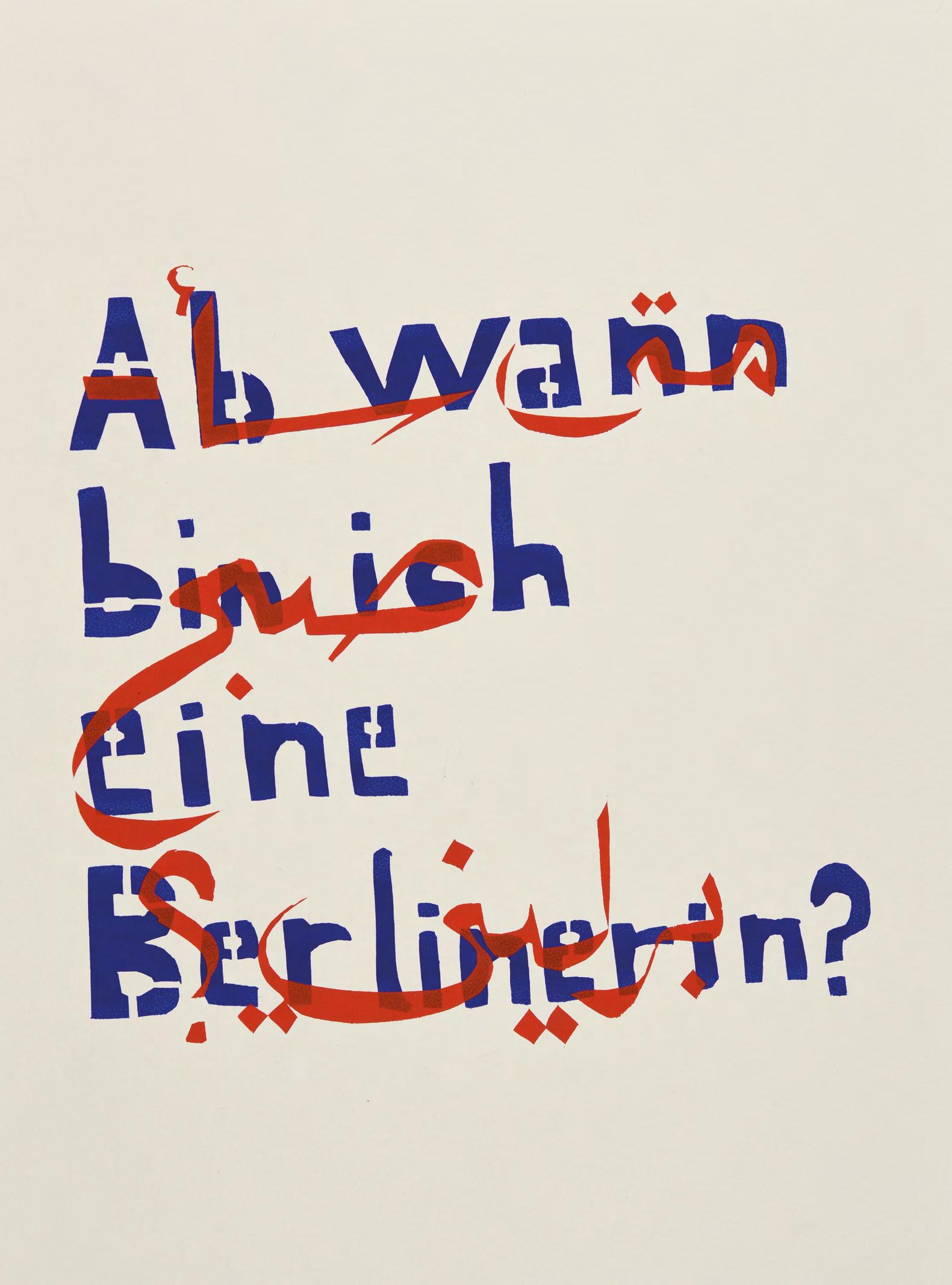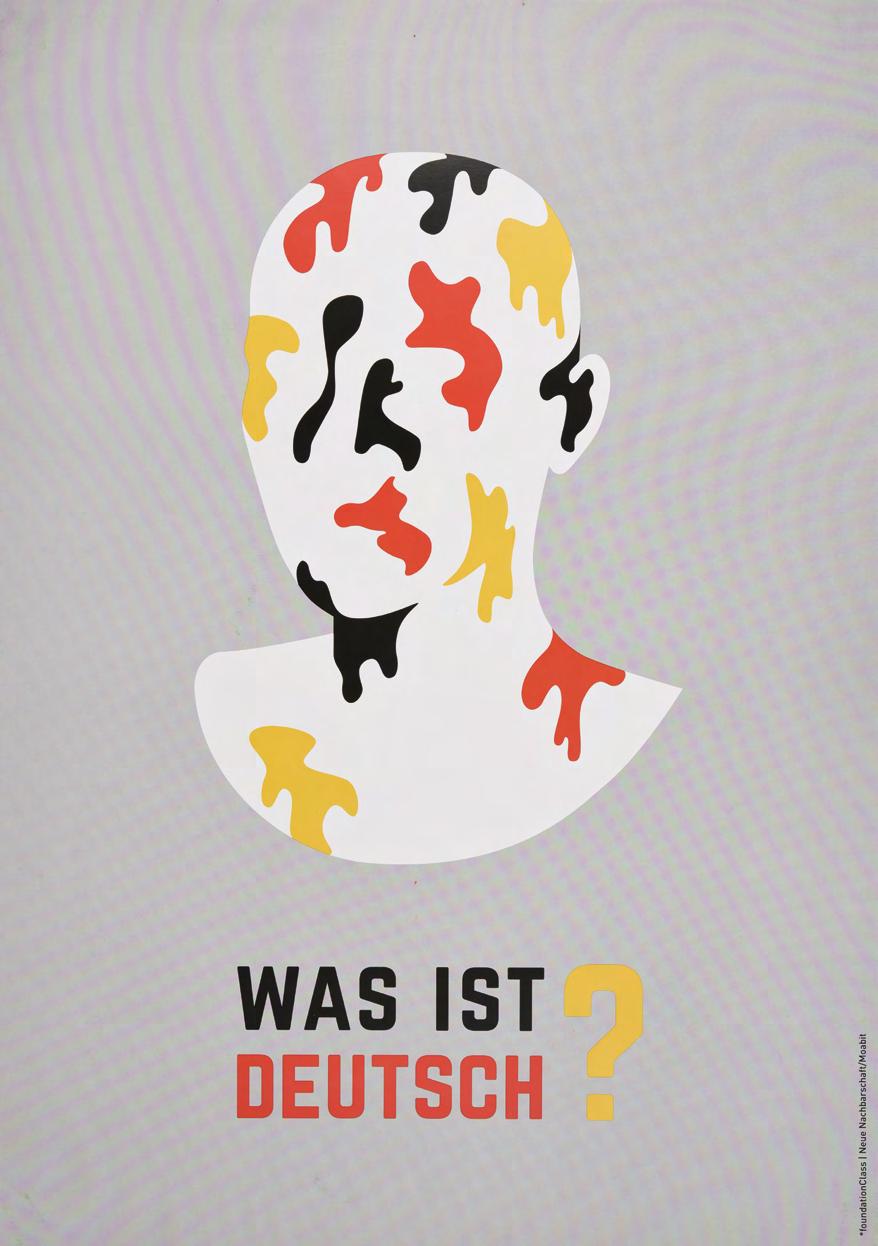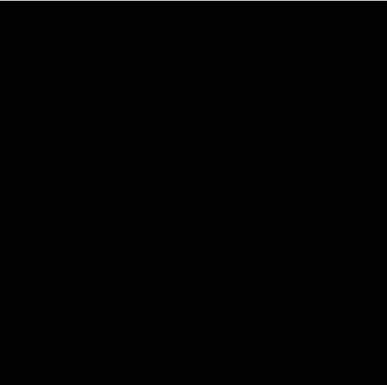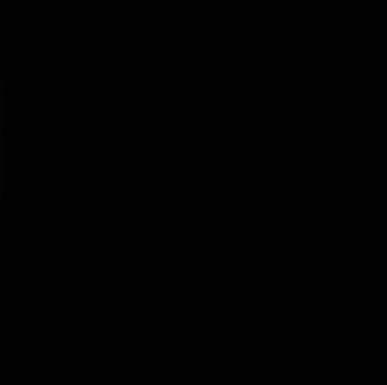Penser les réciprocités entre culture et mobilité
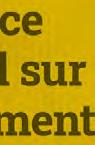


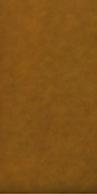
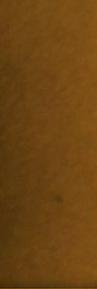














Reflecting on the Connection between Culture and Mobility
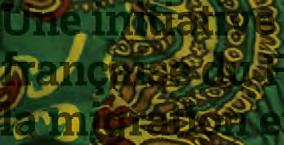

Une initiative de la présidence française du Forum mondial sur la migration et le développement

An initiative of the French Chairmanship of the Global Forum on Migration and Development
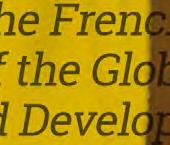

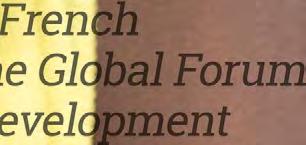



Tiré à part été 2023
Christine est originaire de Sainte-Lucie et vit en Allemagne depuis de nombreuses années. Les deux identités la caractérisent. L’une représente sa personnalité lorsqu’elle est dans son pays d’origine, l’autre est celle qui se fond dans les paysages européens.

















Christine comes from Saint Lucia and lives in Germany many years ago. The 2 identities she carries are part of what makes Christine. One represents her personality when she is in her home country, the other one is the one that blends into European landscapes.
©




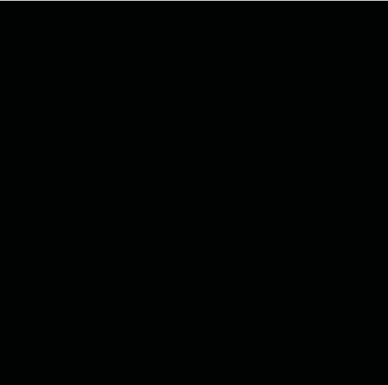

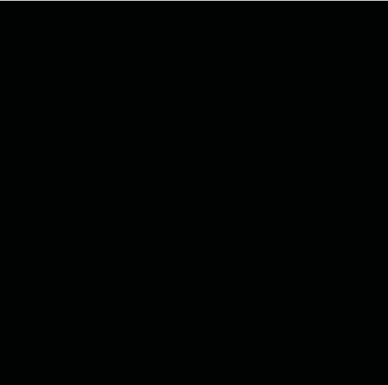
 IOM IDiaspora / Médine Tidou
IOM IDiaspora / Médine Tidou
Penser les réciprocités entre culture et mobilité
Refecting on the Connection between Culture and Mobility
X Chrysoula Zacharopoulou, secrétaire d’État auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux.

X Chrysoula Zacharopoulou, Minister of State for Development, Francophonie and International Partnerships, attached to the Minister for Europe and Foreign Affairs.
© Jonathan Sarago. Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
Avant propos
Chrysoula Zacharopoulou, secrétaire d’État auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux.
Depuis sa création en 2007, les synergies créées par le Forum mondial sur la Migration et le Développement (FMMD) témoignent tout autant de sa vitalité fonctionnelle que du cadre propice qu’il offre pour impulser des avancées constructives et fédératrices sur le nexus migration-développement au niveau international. En prenant la présidence du FMMD en juillet 2022, la France a souhaité prolonger le mouvement initié par ses prédécesseurs en proposant un programme innovant traitant d’une part de l’impact du changement climatique sur les mobilités humaines et d’autre part de la valorisation des apports socio-culturels des migrations.
La France est héritière d’une longue histoire d’immigration et d’émigration. Notre pays et notre culture sont riches des apports des populations qui se sont établies sur notre sol au fil des siècles. La France a donc choisi de mettre la thématique culturelle à l’honneur via les priorités n° (« Les diasporas : actrices du développement économique, social et culturel du développement ») et n° (« Améliorer la place de la migration dans les mentalités collectives : récits, culture, émotion et rationalité ») du programme de sa présidence du FMMD.
Alors que nos sociétés sont de plus en plus mobiles, l’art et les cultures sont des fls rouges qui nous connectent par-delà les frontières. Les migrations et les diasporas, trop souvent réduites à leurs apports économiques, contribuent à l’enrichissement humain, social et culturel de leurs pays d’origine, de ceux qu’elles traversent et, bien sûr, de ceux où elles s’établissent. Elles créent des ponts plus que jamais nécessaires entre les nations et les peuples.
La France porte la vision d’une diplomatie culturelle ouverte sur le monde, axée sur la coopération
internationale et la solidarité. De nombreux projets des opérateurs français soutiennent ainsi des initiatives culturelles de développement local portées par les organisations de la société civile issues des diasporas. L’engagement français s’incarne également par la promotion de discours informés, justes et responsables sur les migrations, qui sont, là aussi, plus que jamais nécessaires face à la tentation de la haine, du repli et de la stigmatisation. Pour approfondir ces questions, le FMMD constitue un formidable laboratoire de réflexion. C’est pourquoi la présidence française soutient la production d’une étude sur les discours publics dans plusieurs régions du monde, menée par l’International Center for Migration Policy (ICMPD), qui sera présentée au 14e Sommet du FMMD.
Je tiens à remercier chaleureusement les contributeurs de cette revue, le Musée national de l’histoire de l’immigration qui en est l’éditeur, ainsi que les États, les représentants de la société civile, du secteur privé, des collectivités locales et de la jeunesse qui font la richesse, la singularité et le succès du FMMD depuis sa création. Nous avons hâte d’écrire, ensemble, la suite de son histoire.
Foreword
Chrysoula Zacharopoulou, Minister of State for Development, Francophonie and International Partnerships, attached to the Minister for Europe and Foreign Affairs.
Since its creation in 2007, the synergies created by the Global Forum on Migration and Development (GFMD) are both evidence of its operational vitality and of the conducive framework it offers for driving constructive, unifying progress on the migration-development nexus at the international level. When France took over the Chairmanship of the GFMD in July 2022, it wanted to build on efforts initiated by its predecessors by proposing an innovative program that addresses the impact of climate change on human mobility while promoting the socio-cultural benefts of migration.
France has had a long history of immigration and emigration, and its culture has grown richer thanks to the populations that settled on its soil over the centuries. It has therefore decided to shine a spotlight on culture, via priorities (Diasporas: actors of economic, social and cultural development of regions) and (Improving the perception of migration in public opinion through narratives, culture, emotion and rational discourse) on its GFMD Chairmanship program.
As our societies become increasingly mobile, art and cultures are the main threads that connect us beyond our borders. Migration and diasporas, very often reduced to their economic value, contribute to the human, social and cultural enrichment of their countries of origin, those they travel through and of course those where they settle. They build bridges between nations and people which are more necessary than ever.
France upholds a vision of cultural diplomacy that is open to the world, focused on international cooperation and solidarity. As such, a number of
projects by French agencies support local cultural development initiatives led by civil society organizations that originated in the diasporas. French commitment is also clear in the promotion of informed, accurate and responsible discourse on migration, which is also more necessary than ever in the face of the temptation towards hatred, withdrawal and stigmatization. For studying these matters more extensively, the GFMD is an excellent think tank, which is why the French Chairmanship is supporting the production of a study on public discourse in several regions of the world, led by the International Centre for Migration Policy Development (ICMPD), which will be presented at the th GFMD Summit.
I would like to warmly thank the contributors to this review, the Musée National de l’histoire de l’immigration which publishes it, and the States, representatives of civil society, the private sector, local governments and young people who have helped to make the GFMD the rich, unique and successful forum that it has been since its creation. We are looking forward to writing the next chapter of its history together.
Édito
Penser les réciprocités entre culture et mobilité
Sébastien Gökalp, directeur du Musée national de l’histoire de l’immigration.
Le Musée national de l’histoire de l’immigration se réjouit d’accueillir le Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD), à l’initiative de la présidence française du Forum mondial sur la migration et le développement, avec comme thématique centrale : « Penser les réciprocités entre culture et mobilité ».
Selon les estimations, dans un monde en constante évolution, 281 millions de personnes vivaient dans un pays autre que leur pays de naissance en 2020, soit 128 millions de plus qu’en 1990 et plus de trois fois plus qu’en 1970. Les mouvements migratoires occupent une place centrale, suscitant parfois rejet et repli des opinions publiques, au risque de rendre invisible des dynamiques sociales, culturelles et artistiques d’une grande intensité. En privilégiant la dimension artistique, qui permet une approche sensible de ces changements, il s’agit de mieux comprendre et entendre ces porte-paroles d’expériences migratoires, qui offrent, chaque fois, une perspective singulière sur les réalités vécues par les individus en exil. Les œuvres d’art deviennent alors un moyen de transmettre histoires, émotions et idées, créant des ponts entre les cultures, déplaçant le regard et la réflexion.
Ce recueil d’articles de la revue Hommes & Migrations, conçu pour ce Forum mondial sur la migration et le développement, s’inscrit dans cette exploration des migrations culturelles et artistiques et de leur inscription institutionnelle. Rassemblant des contributions de chercheurs en sciences humaines, d’écrivains et d’artistes, sur des sujets pour certains rarement abordés comme les droits culturels et les migrations, il ouvre des perspectives sur les liens entre l’art, la migration et l’identité. En combinant des approches, il vise à élargir notre compréhension de ces phénomènes complexes et à encourager une réflexion plus profonde sur les enjeux qui ne sauraient être traités à la seule échelle d’un pays ni même d’un continent, mais bien à celle du monde.
The Interactions between Culture and Mobility
Sébastien Gökalp, Director of the Musée national de l’histoire de l’immigration.
The Musée national de l’histoire de l’immigration is delighted to host the Global Forum on Migration and Development (GFMD), an initiative of the French presidency of the Global Forum on Migration and Development, with the central theme of “Considering the reciprocities between culture and mobility”
It is estimated that, in a constantly changing world, 281 million people will be living in a country other than their country of birth in 2020, 128 million more than in 1990, and more than three times as many as in 1970. Migratory movements occupy a central place, sometimes eliciting arousing rejection and withdrawal on the part of the public, with the risk of rendering highly intense social, cultural and artistic dynamics invisible. By focusing on the artistic dimension, which allows for a sensitive approach to these changes, our aim is to better understand and listen to these spokespersons of migratory experiences, who each offer a singular perspective on the realities experienced by individuals in exile. Works of art thus become a means of transmitting stories, emotions and ideas, building bridges between cultures, and shifting the way we look at and think about things.
This collection of articles from Hommes & Migrations magazine, designed for the World Forum on Migration and Development, is part of this exploration of cultural and artistic migration and its institutional implications. Bringing together contributions from researchers in the human sciences, writers and artists, on subjects that are sometimes rarely addressed, such as cultural rights and migration, it opens up perspectives on the links between art, migration, and identity. By combining different approaches, it aims to broaden our understanding of these complex phenomena and encourage deeper reflections on issues that cannot be dealt with on the scale of a single country or even a continent, but must instead be considered on a global scale.
Hommes & migrations
En , Jacques Ghys ( - ) fondait Les Cahiers nord-africains, première revue de réfexion et d’action sur la présence de l’immigration maghrébine en France, éditée par l’association d’alphabétisation Amana. En , les Cahiers prenaient acte de la diversifcation des fux migratoires en France et devenaient Hommes & Migrations. La revue, pionnière et unique en son genre, publiait dès cette époque des dossiers de fond et des articles de réfexion faisant autorité sur les sujets les plus divers, mélangeant volontairement les regards et laissant la parole aussi bien aux praticiens de terrain qu’aux spécialistes universitaires ou aux décideurs politiques.
De 1999 à 2004, H&M a été éditée par l’Agence pour le développement des relations interculturelles (Adri). À partir du 1er janvier , elle a été éditée par la Cité nationale de l’histoire de l’immigration (CNHI). La plus ancienne des revues traitant des phénomènes de mobilité humaine aborde le siècle nouveau avec la même volonté que par le passé de comprendre, d’expliquer et d’accompagner ces questions. Le décès de Philippe Dewitte, son rédacteur en chef, intervenu en mai , a privé l’équipe du pilote intellectuel de la revue qui, pendant plus de dix ans, avait su faire d’Hommes & Migrations une véritable revue ayant sa place et sa particularité dans le champ des revues en France.
C’est cet héritage qu’Hommes & Migrations entend conserver et développer au sein du Musée national de l’histoire de l’immigration devenu établissement public au 1er janvier 2007 en contribuant à valoriser et diffuser le meilleur état des connaissances sur les thématiques migratoires.
Penser les réciprocités entre culture et mobilité / Refecting on the Connection between Culture and Mobility
Ce Tiré-à-part a été réalisé à l’occasion de la présidence française du Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD)
This special issue was produced as part of the French Chairmanship of the Global Forum on Migration and Development (GFMD).
Présidente du conseil d’administration
Mercedes Erra
Président du conseil d’orientation
François Héran
Comité d’orientation et de rédaction
Jacques Barou, Dominique Caubet, Dana Diminescu, Angéline Escafré-Dublet, Yvan Gastaut, Abdelhafd Hammouche, Alec Hargreaves, Mustapha Harzoune, Thomas Lacroix, Marie Lazaridis, Khelifa Messamah, Jean-Baptiste Meyer, Marie Poinsot, Edwige Rude-Antoine, Alain Seksig, Hélène Thiollet Vasoodeven Vuddamalay, Serge Weber, Catherine Wihtol de Wenden
Directrice générale du Palais de la Porte Dorée
Constance Rivière
Secrétaire générale
Mariane Saïe
Directeur du Musée national de l’histoire de l’immigration
Sébastien Gökalp
Cheffe du service de la diffusion des savoirs
Claire Leymonerie
Rédactrice en chef
Marie Poinsot
Secrétaire de rédaction
Nicolas Treiber
Traduction en l’anglais
Victoria Weavil
Relecture
Yann Lézenès
Mise en page
François Roman Iconographie
Isabelle Eshraghi
Site Internet
Sylvain Gorin, Nicolas Treiber, Anne Volery Conception graphique
État d’Esprit-Stratis
Avec le fnancement de / Funded by :
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères / French Ministry for Europe and Foreign Affairs
Coordination du Tiré-à-Part :
Marie POINSOT, Oscar FAULCONNIER, Léhana CROCHET, Alison LARCHER
Remerciements / Acknowledgements : La Mission de la gouvernance démocratique du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Cécile Frobert, Johanne BOUCHARD, Nicolas TREIBER
Le Secrétariat du FMMD, Réseau de la Jeunesse du FMMD (MYCP), Groupe de travail du FMMD dédiés aux récits publics sur les migrations, L’ensemble des personnes ayant contribué à la rédaction du Tiré-à-part et à sa traduction.
Couverture / Front cover : © IOM IDiaspora / Médine Tidou
Origins Médine Tidou
Afn de sensibiliser la communauté internationale à l'importance du capital culturel des diasporas dans le monde, l'OIM (Organisation internationale pour les migrations) et IBER-RUTAS — programme visant à contribuer à la promotion de la diversité culturelle en Amérique latine pour la protection des droits des migrants dans une approche interculturelle — ont invité des photographes professionnels et amateurs à participer au tout premier concours international iDiaspora, qui s’est tenu de septembre à novembre 2022. Les photos des lauréats de cette exposition ont mis en lumière les différentes façons dont les diasporas s'adaptent lorsqu'elles quittent leur pays d'origine à la recherche de nouvelles opportunités, en menant des existences transnationales. Les photos sélectionnées illustrent la manière dont les diasporas naviguent entre leurs multiples identités tout en embrassant leur nouveau pays, sans oublier leur pays d'origine. Le jury, composé d'experts en photographie et en arts visuels ayant une grande expérience des questions de migration, a fondé sa décision à la fois sur l'esthétique des photographies, le contextes lié aux diasporas mises en avant, et la puissance des récits délivrés. Le concours photo a été lancé sur iDiaspora.org, une plateforme numérique dédiée à l'engagement des diasporas gérée par l'OIM, qui a pour but de permettre aux décideurs et aux membres des diasporas du monde entier de faire entendre leur voix, d'acquérir et de partager des connaissances, et de s'engager à l’échelle mondiale.
Médine Tidou est originaire de Côte d’Ivoire, et réside en Allemagne. Elle est la lauréate du concours photos IDiaspora . Avec Origins , Médine Tidou tente de défnir le concept de culture et la manière dont elle prend forme à travers le temps et l’espace. Ses œuvres décortiquent les strates culturelles qui existent chez chacun, et montrent les différentes identités qu’une personne peut revêtir. Au quotidien, ces multiples facettes se croisent et s’entremêlent, occupant plus ou moins d’espace pour s’adapter avec justesse au contextes spécifques. L’objectif d’Origins est de créer un espace de conversation visuel pour et avec les diasporas. Dans chaque photographie, la frontière du pays d’« origine » est la ligne qui relie les différentes identités portées par ces personnes qui appartiennent aux diasporas établies en Europe (les frontières du Kenya, de Sainte-Lucie, du Zimbabwe et de la Gambie sont visibles sur ces photographies) : c’est en franchissant la frontière physique de son pays que l’on commence à développer d’autres identités.
To raise international awareness of the importance of cultural capital of global diasporas, IOM (International Organisation for migrations) and IBER-RUTAS - Program that aims to contribute to the promotion of cultural diversity in Iberoamerica for the protection of migrants’ rights from an intercultural perspective - invited professional and amateurs photographers to participate in the frst international iDiaspora Photo Contest from September to November 2022. The winner’s photos in this exhibition have shed light on the different forms in which diasporas cope and adapt when they leave their countries of origin seeking new opportunities and living transnational lives. The selected photos were able to portray how diasporas navigate their multiple identities while embracing the new country without forgetting where they come from. The jury panel, which was composed of experts in photography, visual arts and ample experience in migration issues based their decision on equally weighting the esthetics of the photographs with the contextualization of diasporas and the power of their narratives. The Photo Contest was launched on iDiaspora.org, a platform for diaspora engagement and a digital-based environment managed by the IOM, which has the purpose of enabling leaders and members of the diasporas globally to share their voices, gain and share knowledge, and to engage with the global community.
Médine Tidou is originally from Côte d’Ivoire and now lives in Germany. She is the winner of the IDiaspora Photo Contest. With “Origins”, Médine Tidou attempts to defne the concept of culture and how it shapes through time and space. Her works disembowel the cultural layers embodied by a person and show the various identities one could carry. Every day the selves of multicultural people imbricate, using the correct layout to occupy more space in reality – or being repressed to blend in a specifc environment. The goal of “Origins” is to create a visual conversational space for and with diasporas. In each photograph, the border of their country of “Origin” is the line that connects the different identities carried by these people part of the diaspora in Europe (Kenya, Santa Lucia, Zimbabwe, Gambia borders are visible in these photographs). Crossing the physical border of our country is mostly when we start developing other identities.
Scannez le QR code et retrouvez la galerie en ligne du concours photo sur iDiaspora. Retrouvez également l’artiste sur son site Internet, à l’adresse : www.m-tidou.com ».
Discover more about the artist on her website at : www.m-tidou.com.
 Couverture et intérieurs de couverture / Front and inside covers : © IOM IDiaspora / Médine Tidou
Couverture et intérieurs de couverture / Front and inside covers : © IOM IDiaspora / Médine Tidou
Penser les réciprocités entre culture et mobilité
Refecting on the Connection between Culture and Mobility
Sommaire
AVANT PROPOS / FOREWORD
Par Chrysoula Zacharopoulou p. 3
ÉDITO
Penser les réciprocités entre culture et mobilité The Interactions between Culture and Mobility
Par Sébastien Gökalp p. 5
LE POINT SUR
Droits culturels et migrations p. 11
Par Alexandra Xanthaki
Cultural Rights in Migrations p. 16
By Alexandra Xanthaki
La liberté artistique et l’exil. Réfexions à partir de quatre artistes plasticiens p. 21
Par Aline Angoustures
Artistic Freedom and Exile. Refections Based on Four Visual Artists p. 29
By Aline Angoustures
Les musées des migrations dans le monde p. 37
Par Gegê Leme Joseph
Migration Museums around the World: the Main Issues p. 47
By Gegê Leme Joseph
Écrivains migrants, littératures d’immigration, écritures diasporiques Le cas de l’Afrique subsaharienne et ses enfants de la « postcolonie » p. 53
Par Nathalie Philippe
Migrant Writers, Immigration Literature, and Diaspora Writings Sub-Saharan Africa and its Children of the “Postcolony” p. 62
By Nathalie Philippe
La diaspora est-elle (vraiment) un creuset de créativité ? p. 71
Par Jean-Baptiste Meyer
Is the Diaspora (Really) a Melting Pot of Creativity? p. 77
By Jean-Baptiste Meyer
Portfolio : Musiques Mouvements Migratoires : Hors Flux Humains p. 82
Par Nadine Bilong
Portfolio : Migratory Musical Movements: Beyond Human Flows p. 83
By Nadine Bilong
Rap, antiracisme et identités locales en région liégeoise p. 99
Par Marco Martiniello
Rap, Anti-racism, and Local identities in the Liège Region p. 105
By Marco Martiniello
Construction et appropriations de la fgure de l’« artiste réfugié » dans des dispositifs d’accueil artistique à Berlin p. 111
Par Soline Laplanche-Servigne
The construction and appropriation of the Figure of the “Refugee Artist” in Support Measures for artists in Berlin p. 119
By Soline Laplanche-Servigne
L’étude « Dialogues Migrations » : Identifer les acteurs et analyser les représentations médiatiques sur les migrations p. 125
The Study ‘Dialogues Migrations’ : Identifying Actors and Analysing Media Representations of Migration p. 126
X Brang Li, série « No more life » (« Plus aucune vie »), impression et suie sur toile, Yangon, Myanmar, 2016.
Les 2 œuvres intégrées à ce texte sont de l’artiste Brang Li de Myitkyina, capitale de l’État de Kachin, dans le nord du Myanmar. Elles font partie d’une série illustrant les conséquences de la guerre civile au Myanmar, qui a été honorée dans le cadre de l’édition 2022 du Concours d’art international pour les artistes issus de minorités, organisé par le Haut-Commissariat des Nations-Unies aux droits de l’homme, le Haut-Commissariat aux réfugiés, Minority Rights Group International et Freemuse.
Url : https://www.ohchr.org/fr/minorities/ minority-artists-voice-and-dissidence.
X Brang Li, “No more life” Series, print and soot on canvas, Yangon, Myanmar, 2016.
The 2 art work integrated in this text are from the artist Brang Li, from Myitkyina, the capital city of Kachin State in Northern Myanmar. They are part of a series illustrating the consequences of civil war in Myanmar, that was honoured in the 2022 edition of the International Art Contest for Minority Artists, organized by the Ofce of the UN High Commissioner for Human Rights, High Commissioner for Refugees, Minority Rights Group International and Freemuse.
Url : https://www.ohchr.org/en/minorities/ minority-artists-voice-and-dissidence.

Droits culturels et migration
Alexandra Xanthaki, rapporteuse spéciale des Nations unies dans le domaine des droits culturels1
Un rapport présenté en mars 2023 au Conseil des droits de l’homme met l’accent sur les droits des migrants en matière d’accès et de participation effective à tous les aspects de la vie culturelle de l’État d’accueil comme à ceux de leur propre culture. Si ces droits sont protégés par des dispositions du droit international, il s’agit de garantir une égalité réelle dans la protection des droits culturels afn de permettre aux migrants de participer effectivement à toutes les activités visées par les droits culturels. Ces types d’échanges et d’interactions interculturels sont en effet nécessaires dans des sociétés dynamiques, diverses et démocratiques.
Dans mon travail en tant que Rapporteuse spéciale des Nations Unies dans le domaine des droits culturels, je n’ai pu que prendre toute la mesure de l’absence presque totale des droits culturels dans les discussions sur les droits des migrants. Les droits culturels des migrants ne sont pas pris en compte dans les politiques nationales, pas plus qu’ils ne sont un enjeu central des initiatives internationales.
Mon dernier rapport au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies est clair à ce sujet : la priorité accordée à juste titre au principe de non-refoulement, au droit d’asile et à la protection contre la détention arbitraire a mené les États à faire l’impasse sur les droits culturels des migrants. Or, si les droits culturels consistent à avoir le droit d’avoir des aspirations et des rêves, alors en les ignorant, nous manquons à nos obligations vis-à-vis de ces personnes. Les migrants pris au sens large, qu’il s’agisse des migrants de longue durée, des demandeurs d’asile, des réfugiés ou des migrants sans papier, ont le droit de bâtir un avenir reposant sur leurs propres valeurs, philosophie, rêves et aspirations.
Effets de la migration sur les droits culturels
La migration engendre des transformations dont les effets sont positifs, tant pour les migrants
que pour les sociétés qui les accueillent. Le mélange des cultures, des situations et des ressources culturelles qui se produit à la faveur de la migration est un processus dynamique et enrichissant favorisant l’émergence d’idées nouvelles et la réévaluation des valeurs et des pratiques des migrants et des sociétés d’accueil. Les effets positifs de la migration pour la culture des migrants comme pour celle des populations des États d’accueil méritent d’être mieux reconnus et partagés.
D’un autre côté, le processus migratoire compromet les droits culturels des migrants. Il s’accompagne, en effet, de la perte de lieux, de communautés, de relations, d’outils ou d’instruments importants, ainsi que de la perte d’un soutien collectif plus large favorisant la transmission intergénérationnelle, et il provoque même parfois une résistance ou une opposition à la poursuite de certaines pratiques culturelles traditionnelles dans leur nouveau pays. Du fait de la migration, les personnes qui appartenaient à une majorité se retrouvent souvent membres d’une minorité ; après avoir fait pleinement partie d’une société, elles se retrouvent dans des groupes marginaux ou
1. Le présent article est extrait du rapport de 2023 de la Rapporteuse spéciale dans le domaine des droits culturels. Le rapport complet, ainsi que les contributions reçues aux fns de son élaboration, sont consultables sur le site Internet du mandat à l’adresse suivante : www.ohchr.org/en/calls-for-input/2022/ call-inputs-report-cultural-rights-and-migration.
11 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
marginalisées, et cela a pour effet de fragiliser leurs droits culturels. Le désarroi résultant de la perte du lien avec son environnement culturel habituel peut conduire à une situation de deuil culturel et de crise d’identité 2
Il ne s’agit pas dans ce cas d’élaborer de nouvelles normes. Les dispositions générales du droit international des droits de l’homme qui reconnaissent le droit pour tout un chacun de participer à la vie culturelle s’appliquent aux migrants. Le Pacte mondial sur les migrations confirme les droits des migrants. Les migrants de longue durée peuvent également avoir recours à la protection des minorités reconnue par le droit international. Concrètement, les normes de droit international reconnaissent deux types de droits culturels pour les migrants : d’une part, ils ont le droit de participer et d’avoir accès aux ressources culturelles sur un pied d’égalité avec toutes les autres personnes résidant dans l’État concerné ; d’autre part, ils ont le droit de préserver et de développer leur propre culture de la manière qu’ils jugent appropriée.
Les États doivent prendre conscience que les droits culturels ne se limitent pas à avoir accès aux musées du pays d’accueil pour y être instruits sur les beaux-arts nationaux !
Je suis fermement convaincue que certaines mesures simples et importantes doivent être prises pour permettre aux migrants de mener une vie épanouie dans leur État d’accueil.
Faire comprendre aux États les droits culturels des migrants
Les États doivent prendre conscience que les droits culturels ne se limitent pas à avoir accès aux musées du pays d’accueil pour y être instruits sur les beaux-arts nationaux ! Les États doivent s’assurer qu’ils connaissent l’ensemble des éléments constitutifs des droits culturels tels qu’énoncés par les normes en vigueur et leurs obligations correspondantes en vertu du droit international. Ils doivent ensuite veiller
à ce que les droits culturels des migrants dans leur intégralité soient bien compris par leurs structures, notamment par les autorités locales, les organismes culturels publics et les organes décisionnels. Dans certains États, le système administratif ou le manque de communication entre le ministère des Affaires étrangères et les autres organes de l’État ne permettent pas à l’ensemble des organismes publics de bien appréhender leurs obligations à cet égard. Les initiatives considérées par les États comme de bonnes pratiques ne refètent que des normes a minima en matière de droits culturels. Souvent, les États se concentrent sur le seul secteur culturel au lieu de veiller à la garantie des droits culturels dans la vie quotidienne de la société d’accueil et des migrants. Nous devons tous travailler à clarifer les droits culturels spécifques qui sont importants pour les migrants et veiller à ce que tous les organismes publics intègrent cette approche large et bien défnie dans l’ensemble de leurs mesures.
Renouveler notre engagement en faveur d’une véritable égalité en matière de droits culturels des migrants
Le droit international des droits de l’homme consacre explicitement des droits culturels pour tous, d’où il ressort que tout migrant, quel que soit son milieu, son statut ou sa situation, a le droit de « prendre part à la vie culturelle ». Ce droit relève du droit international coutumier et par conséquent personne ne saurait en être privé. Pourtant, de nombreux États continuent de se référer aux droits culturels en tant que droits des citoyens et non comme droits de toute personne, indépendamment de son statut, se trouvant sur leur territoire. Il est essentiel de continuer à mettre l’accent sur ce point et de demander aux États de mettre en œuvre les droits culturels des migrants, quel que soit leur statut.
Nous devons tous accroître nos efforts pour éliminer les entraves à l’accès des migrants à la vie culturelle. Afn de garantir une véritable égalité dans l’exercice des droits culturels, les États doivent adopter des mesures spécifques, claires et parfois même des mesures de discrimination positive. Cela passe par : a) davantage de traductions dans les musées et les événements culturels ; b) davantage d’expositions publiques et d’événements culturels traitant de l’expérience et des besoins des migrants ; c) une plus grande visibilité des migrants et de leur expérience
12
LE POINT SUR | DROITS CULTURELS ET MIGRATION
2. Danilo Giglitto, Luigina Ciolf, Wolfgang Bosswick, “Building a bridge: opportunities and challenges for intangible cultural heritage at the intersection of institutions, civic society, and migrant communities”, in International Journal of Heritage Studies, vol. 28, n° 1, 2022.
dans les médias et la culture populaire ; et d) une plus grande représentation des migrants au sein du personnel du secteur culturel, et notamment dans les postes décisionnels. Cela passe également par des initiatives présentant à la population locale l’incroyable richesse des cultures des groupes de migrants et la production artistique variée, intéressante et stimulante des artistes migrants.

Nombre d’États reconnaissent dans leur législation l’importance de la diversité culturelle ainsi que celle de la culture et des arts. Toutefois, il est indispensable d’aller au-delà de la protection de la culture « de haut niveau » et de celle de la culture de l’État proprement dit pour faire en sorte que la culture soit appréhendée de manière ouverte, large et actuelle. Les artistes migrants évoquent souvent leur invisibilité au sein de la société d’accueil et de son monde des arts. Ils indiquent que très peu
d’initiatives soutiennent les personnes réfugiées et migrantes qui sont des artistes à part entière. Même lorsque l’État concerné promeut les cultures et les arts de l’étranger, son choix se porte plus souvent sur des artistes étrangers et non des migrants. En outre, il est souvent demandé aux artistes migrants, en réponse aux attentes de ceux qui les fnancent, de faire porter l’essentiel de leur œuvre sur leur exil. Il leur est parfois impossible de critiquer l’État ou la société d’accueil, sous peine d’être perçus comme ingrats ou
Mettre l’accent sur le droit pour les migrants de maintenir leur culture vivante
Une partie importante de mon rapport porte sur le droit pour les migrants de maintenir leur culture vivante. Les valeurs culturelles des migrants sont
13 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
déloyaux.
X Brang Li, série « No more life » (« Plus aucune vie »), impression et suie sur toile, Yangon, Myanmar, 2016.
X Brang Li, “No more life” Series, print and soot on canvas, Yangon, Myanmar, 2016.
souvent mises à mal, leur culture d’origine perçue sans discernement comme trop traditionnelle, trop peu libérale ou inférieure à la culture dominante de la société d’accueil. Il n’est pas rare d’entendre dire que les migrants doivent adopter le mode de vie de leur société d’accueil, comme si la population d’un État avait un seul mode de vie uniforme !
Le droit international dispose que les différentes cultures ont toutes la même valeur. Souvent, certains médias et une partie de la classe politique et de la société civile se joignent à l’antienne populiste qui dénonce les supposés dangers que représenteraient les cultures des migrants. Les femmes migrantes sont particulièrement touchées par les discriminations intersectionnelles et leurs droits culturels sont bafoués à la fois par les élites de leur communauté, réticentes au changement, et par la société d’accueil dont les préjugés les privent de leur liberté d’action. Ce type de discours, dénué de tout sens critique, oppose de manière erronée les droits de l’homme les uns aux autres et, dans certains cas, œuvre à une déshumanisation des migrants, ouvrant la voie à davantage de discrimination et de racisme à leur égard. Sur cette base erronée, l’intégration, un concept et une stratégie salués au cours des dernières décennies, est mise en œuvre comme un processus à sens unique et mise au service de politiques d’assimilation des migrants, anciens comme nouveaux.
Certes les droits culturels ne sont pas illimités ! D’ailleurs, le droit international énonce des principes afn de garantir que les droits culturels ne soient pas utilisés pour restreindre d’autres droits de l’homme. Nous devons appliquer ces principes et donner aux personnes les outils, la confance et la marge de manœuvre nécessaires pour faire valoir leurs droits lorsque ceux-ci sont violés au nom de la « culture ».
Participation réelle des migrants aux questions culturelles
Dans son Observation générale n° ( ), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels
énonce que les droits culturels comprennent le droit de prendre part à la défnition, à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques et de décisions qui influent sur l’exercice des droits culturels d’une personne (paragraphe (c)). Il est nécessaire d’opérer un changement de paradigme pour que les migrants ne soient plus considérés comme de simples destinataires des politiques culturelles, mais comme des partenaires prenant une part active à la conception et à la vision de la société et de la vie culturelle. Il n’est pas rare que d’autres s’expriment au nom des migrants, qu’ils s’agisse d’experts, de représentants des autorités publiques ou même d’organisations de la société civile. Il est indispensable que les migrants fassent part de leurs propres expériences et revendications et qu’on applique à leurs droits culturels leur propre vision. Les espaces publics et la possibilité permanente d’interagir et de dialoguer avec les migrants sont des vecteurs importants pour s’acquitter des obligations internationales relatives aux droits culturels.
Nouvelles recommandations
En plus d’approfondir les points susmentionnés, mon rapport contient également un certain nombre de recommandations portant sur des mesures tangibles pour contribuer à concrétiser les droits culturels des migrants. Il s’agit notamment de garantir la participation des migrants aux programmes qui ont des répercussions sur leurs droits culturels, en veillant à ce que les migrants bénéfcient de conditions économiques et sociales leur permettant de faire valoir leurs droits culturels et leurs autres droits fondamentaux ; en révisant la représentation des migrants, de leur art et de leurs cultures dans la sphère publique, notamment dans les médias ; en intégrant des éléments relatifs aux migrations au sein des principales institutions chargées du patrimoine et en créant des institutions spécifquement consacrées aux migrations, dirigées par des migrants ;en prévoyant des outils permettant de revoir et de faire évoluer les pratiques culturelles par les groupes de migrants et les autres groupes afn d’éliminer les pratiques intolérantes.
Afn de réaliser une égalité dans les faits, il convient de mettre l’accent sur les mesures éliminant les stéréotypes et les préjugés sur les migrants et leurs cultures ; de réviser la représentation de la diversité au sein du personnel et des organes décisionnels de l’administration et des institutions publiques, afin d’évaluer la capacité pour des
14
LE POINT SUR | DROITS CULTURELS ET MIGRATION
Il n’est pas rare d’entendre dire que les migrants doivent adopter le mode de vie de leur société d’accueil, comme si la population d’un État avait un seul mode de vie uniforme !
personnes issues de l’immigration d’avoir accès à des postes sur la base de l’égalité ; tout en exerçant une vigilance accrue à l’encontre de tout traitement inégal ou comportement discriminatoire de la part des acteurs privés, notamment dans le domaine de la culture, de la religion, des médias ou de l’éducation. Le renforcement de la compréhension mutuelle et l’intégration à deux sens nécessite de veiller à ce que les espaces publics communs permettent aux migrants de côtoyer et d’interagir avec tous les autres segments de la population du pays d’accueil et favorisent véritablement l’interculturalité ; d’évaluer le degré de diversité culturelle des programmes et manuels scolaires, notamment d’histoire, et la représentation des thèmes et récits partagés par la population du pays d’accueil et les groupes de migrants ; de fournir aux enseignants et aux formateurs des ressources et des contenus leur permettant d’intégrer davantage de diversité dans leur enseignement ; de mettre en place des sessions de formation sur la diversité culturelle et l’art des migrants pour les employés des musées et des secteurs culturels ; d’élaborer des programmes, en offrant des possibilités pour permettre à la population du pays d’accueil de se familiariser avec l’histoire, la réalité et la culture
des migrants ; en incorporant dans les missions des bibliothèques des services pour les personnes migrantes, qui mettent l’accent sur la coopération avec les différents groupes culturels et leur offrent des possibilités équitables de soutien, d’apprentissage et de connexion.
Conclusion
Les droits culturels sont essentiels pour que tout un chacun soit à même de s’épanouir dans son identité et d’en exprimer toutes les facettes. Ils font le lien entre le passé et l’avenir. Lorsque l’héritage du passé est interrompu par la migration, il est d’autant plus nécessaire de protéger ces droits. Les normes du droit international exigent la protection de ces droits. Cela constitue la seule manière pour les migrants de devenir des personnes épanouies et pour les sociétés de demeurer stables et d’accroître leur créativité et leur imaginaire pour affronter l’avenir. Je souhaite que le présent rapport joue un rôle de catalyseur pour accroître l’attention portée aux droits des migrants, leur visibilité et garantir la participation active des migrants dans les sociétés où ils vivent désormais, dans l’intérêt de tous !
15 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
Cultural Rights in Migrations
Ms. Alexandra Xanthaki, UN Special Rapporteur in the feld of cultural rights1
A report presented in March 2023 to the Human Rights Council focuses on the rights of migrants in terms of their access to and effective participation in all aspects of the cultural life of the host State as well as those of their own culture. If these rights are protected by provisions of international law, guaranteeing real equality in the protection of cultural rights is essentiel in order to allow migrants to participate effectively in all the activities covered by cultural rights. These types of intercultural exchanges and interactions are indeed necessary in dynamic, diverse and democratic societies.
In my work as the United Nations Special Rapporteur in the feld of Cultural Rights, I have become only too aware that cultural rights are almost absent from discussions of migrants’ rights. The cultural rights of migrants are not taken into account in national polices and they are not at the centre of international initiatives.
My latest report to the UN Human Rights Council is clear: the understandable focus on rights of non-refoulement, to asylum and against arbitrary detention have allowed States to push aside the cultural rights of migrants. Yet if cultural rights are about the right to aspire, the right to dream, by ignoring these rights, we fail these individuals. Migrants in the wide sense - so including long term migrants, asylum seekers, refugees and undocumented migrants - have the right to fulfl their future based on their own values, philosophies dreams and aspirations.
The impact of migration on cultural rights
Migration has positive transformational effects both on the migrants and the host societies. The mixing of cultures, contexts and cultural resources that takes place through migration is an enriching and dynamic exercise that brings new ideas and promotes the re-evaluation of values and practices, both of the migrants and of host societies. The positive effects
of migration for the cultures of both the migrants and the populations of the host states need to be further acknowledged and shared.
At the same time, migrants’ cultural rights are put in danger by the process of migration. It brings with it the loss of important places, communities and relationships, tools or instruments; the loss of a broader supportive community that fosters intergenerational transmission; and sometimes even resistance or opposition to continuing certain heritage practices in the new home country. Often, migration turns individuals from being part of a majority to being part of a minority, from being part of the mainstream society to being part of peripheral and often marginalised communities and hence, makes their cultural rights more vulnerable. The grief stemming from losing the connection with one’s familiar cultural environment can lead to cultural bereavement and an identity crisis 2
1. The present article is an extract from the 2023 repot of the Special Rapporteur in the feld of Cultural Rights. The full report, as well as the contributions received for its drafting, are available on the website of the mandate at www.ohchr.org/en/calls-forinput/2022/call-inputs-report-cultural-rights-and-migration.
2. Danilo Giglitto, Luigina Ciolf and Wolfgang Bosswick, “Building a bridge: opportunities and challenges for intangible cultural heritage at the intersection of institutions, civic society, and migrant communities”, in International Journal of Heritage Studies, vol. 28, n° 1, 2022.
16 LE POINT SUR | CULTURAL RIGHTS IN MIGRATIONS
Standard setting is not the issue here. Migrants enjoy the general provisions of international human rights law, witch recognises the right of everyone to take part in cultural life. Their rights are confrmed in the Global Compact on Migration. Long-term migrants can also use the minority protection recognised in international law. In essence, international law standards recognise that the cultural rights of migrants are twofold: frst, they have the right to equal participation and access to cultural resources as do all individuals residing in the state; second, they have the right to maintain and develop their own cultures in the ways they deem appropriate.
I am of the frm belief that there are some simple and important steps that have to be taken so that migrants can enjoy a fulflled life in their host states.
States’ understanding of cultural rights of migrants
States need to understand that cultural rights do not only refer to access to the states’ museums, where migrants will be educated about the national high arts! States need to ensure that they understand all elements of cultural rights as included in current standards and their corresponding international law obligations. Then, they need to ensure that the full scope of cultural rights of migrants is understood in all their structures, including local authorities, cultural public bodies and decision-making bodies.
In some states, the public system and/or the lack of communication between the Ministry of Foreign Affairs and the other state bodies result in a lack of understanding of the obligations that all public bodies have. Initiatives discussed by States as good practices are a mere refection of the minimum standards for cultural rights. Often, states focus only on the cultural sector, rather than on the way in witch cultural rights are ensured in the everyday life of the host society and of migrants.
We all need to work to clarify the specifc cultural rights that are important to migrants and ensure that all public bodies apply such broad and specifc understandings in all policies.
Renewing our commitment to substantive equality in migrants’ cultural rights
International human rights law explicitly recognizes cultural rights for everyone, hence any migrant
of any background, status and in any situation has the right ‘to take part in cultural life’. This is customary international law and cannot be denied to anyone. Yet still many States refer to cultural rights as rights of citizens, not of every single person in the territory of the State, regardless of their status. It is important to keep emphasising this and ask states to implement the cultural rights of migrants, irrespective of their status.
We all need to intensify our efforts to eliminate the obstacles that migrants face in accessing cultural life. States need to take specifc, clear and at times positive measures to ensure that substantive equality in exercising cultural rights is achieved. This can be achieved through: a) more translations in museums and cultural events; b) more public exhibitions and cultural events that relate to the experiences and needs of migrants; c) more visibility of migrants and their experiences in the media and popular culture; and d) more representation of migrants as personnel in the cultural sector, and particularly, in decision-making positions of the cultural sector. It also has to do with initiatives introducing to the local population the amazing wealth of cultures in migrant communities and the varied, interesting and inspiring art produced by migrant artists.
Many States recognise the importance of cultural diversity in legislation as well as the importance of culture and arts. Yet we need to move beyond the protection of ‘high culture’ and the protection of only the state’s culture and ensure that culture is understood in an inclusive, broad and current manner.
Migrant artists often talk about their invisibility in the host society and its arts world. They report that there are extremely few initiatives that support refugees and migrants who are actual artists. Even when the State promotes international art and culture, foreign artists are often chosen over migrant artists. In addition, migrant artists often fnd themselves having to focus their art on their displacement, as this is what the funders expect. Sometimes, they are unable to vocalise criticism of the host State and society, as they are then seen as ungrateful or disloyal.
Emphasis on migrants’ rights to their living cultures
An important element of my report focuses on migrants’ rights to their living cultures. Migrants often face an undermining of their cultural values, an
17 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
uncritical perception that their cultures of origins are too traditional, too illiberal, or inferior to the prevailing culture of the host society. We often hear that migrants have to ‘adopt to the host society’s way of life’, as if the population of any State had only one way of life!
International law insists that cultures are of equal value. Often, populist media, politicians and parts of civil society join the chorus about the alleged perils of migrant cultures. Migrant women are particularly the recipients of intersectional discrimination and their cultural rights are violated both within their group elites, resisting change, and by the host society, having a predetermined stereotype that disempowers them. Such uncritical voices pose human rights against each other falsely and in some situations, work towards the dehumanisation of migrants, opening the way for further prejudice and racism against them. On this fawed basis, integration, a concept and policy celebrated in the last several decades, is implemented as a one-way route and used to promote policies that assimilate migrants, old and new.
Of course, cultural rights are not unlimited! But international law has principles to ensure that cultural rights are not used to restrict other human rights. We need to apply such principles and give individuals the tools, confdence and space to claim back their rights if they are violated in the name of “culture”.
Effective participation of migrants in cultural matters
In General Comment No. ( ), the Committee on Economic, Social and Cultural Rights states that cultural rights include the right to take part in the defnition, elaboration and implementation of policies and decisions that have an impact on the exercise of a person’s cultural rights (para. (c)). There must be a paradigm shift, where migrants are not seen as mere recipients of cultural policies but as active partners in the shaping and vision of society and of cultural life. Often, others speak in the name of migrants, be it experts, State offcials or even civil society organisations. It is imperative that migrants share their own experiences and claims and have their own visions implemented about their cultural rights. Public spaces and continuing opportunities for interaction and dialogue with the migrants are important vehicles for the fulfllment of the international obligations regarding cultural rights.
Further recommendations
In addition to the more detailed discussion of the above, my report also provides a number of recommendations about concrete measures to help materialise migrants’ cultural rights. These include:
To guarantee the participation of migrants in programmes that affect their cultural rights, ensure that migrants have the socio-economic conditions that allow them to pursue their cultural rights and other human rights; review the representation of migrants, their art and cultures in the public sphere, including the media; include elements related to migration in mainstream heritage institutions and establish institutions dedicated specifcally to migration, led by migrant communities; and offer the necessary tools for the revisability and the evolution of cultural practices by migrant and non-migrant communities, in order to eradicate illiberal practices.
To ensure substantive equality, insist on measures that eliminate negative stereotypes and narratives about migrants and their cultures; review the representation of diversity in the staffng and decision-making bodies of public institutions and services, with a view to evaluating the ability of persons with migration backgrounds to access such positions on the basis of equality; and exercise due diligence with respect to any unequal treatment or discriminatory conduct by private actors, in particular cultural, religious, media and educational actors.
To strengthen mutual understanding and two-way integration, ensure that common public spaces allow for the co-existence and interaction of migrants with all other sections of the host population and really foster interculturalism; and assess the presence of cultural diversity in educational curricula and textbooks, including in history, and the representation of stories and topics shared by host and migrant communities. Provide teachers and trainers with material and resources to integrate more diversity into their teaching; develop training courses on cultural diversity and the art of migrants for the employees of the museum and cultural sectors; devise programmes and opportunities so that the host population learns about migrants’ histories, realities and cultures; and integrate services for people on the move into the mission statement of libraries, emphasising cooperation with multicultural communities and equitable opportunities for support, learning and connection.
18
LE POINT SUR | CULTURAL RIGHTS IN MIGRATIONS
Conclusion
Cultural rights are important for everyone to develop and express their identity. They are the link between the past and the future. When transmission form the past is interrupted by migration, there is an added need to protect such rights. International law standards require such protection. This is the only way that migrants can become fulflled individuals and societies maintain their stability and increase their creativity and imagination to deal with the future.
I hope that this report acts as a catalyst to focus more on the cultural rights of migrants and ensure further visibility and active participation of migrants in the societies in which they now live, for everyone’s beneft!
19 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
X Wols (dit), Schulze Alfred Otto Wolfgang, Autoportrait, sans date, Staatliche Kunstsammlungen, Kupferstich-Kabinett, Dresde, Allemagne.

X Wols (pseudonym) Schulze Alfred Otto Wolfgang, Self-portrait, no date, Staatliche Kunstsammlungen, Kupferstich-Kabinett, Dresden, Germany.
BPK, Berlin, Dist. RMN-Grand Palais/Image Staatliche Kunstsammlungen Dresden. © ADAGP, Paris, 2022.
Photo
La liberté artistique et l’exil Réfexions
à partir de quatre artistes plasticiens
Aline Angoustures, cheffe de la mission Histoire et exploitation des archives de l’Offce français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), membre associée ISP, affliée à l’Institut Convergences Migrations
Les parcours de François Willi Wendt, Otto Wols, Arnold Daghani et Suzanne Muhr, quatre artistes en exil, actifs en France dans les années 1945-1960, permet de souligner les liens complexes entre la pratique artistique et l’opinion politique, et de mettre au jour les soutiens, fnanciers notamment, dont ils bénéfcient. L’étude comparée des modalités de leur exil en France, à travers leurs dossiers à l’Offce français de protection des réfugiés et apatrides, met en lumière le lien rarement évoqué entre les dispositifs de protection internationale et le groupe des artistes.
L’exposition Paris et nulle part ailleurs s’intéresse, entre autres, aux motivations du départ des artistes étrangers qui s’installent à Paris, et y sont actifs entre et . Parmi les raisons de quitter son pays d’origine fgure bien entendu la crainte de persécutions ou la perte de protection de son pays d’origine, pour lesquelles ont été conçus les statuts internationaux de réfugié et d’apatride entre les années et . Beaucoup d’artistes n’ont pas cette motivation pour s’installer à Paris et il est assez fréquent, y compris lorsqu’ils se sont exilés parce qu’ils avaient des craintes dans leur pays ou qu’ils en ont depuis leur départ, qu’ils ne s’enregistrent pas comme réfugiés, comme par exemple Nicolas de Staël. L’un des plus célèbres d’entre eux, Pablo Picasso, est dans ce cas. Les raisons en sont multiples mais, souvent, les artistes ont d’autres solutions pour s’installer sur le territoire et y bénéfcier d’un séjour régulier. Ceci implique qu’ils n’aient pas besoin de faire appel aux autorités de leur pays d’origine pour voyager ou maintenir leur séjour, ou que les autorités consulaires de ce pays ne leur refusent pas leur protection.
Dans cet article, nous nous proposons de resserrer la focale sur des artistes qui ont demandé à bénéfcier d’une protection comme réfugié ou apatride, marquant ainsi une rupture avec leur pays d’origine, et qui l’ont demandé au nom de leur art, c’est-à-dire en invoquant l’absence de liberté artistique ou la répression du fait de la pratique artistique. Nous le ferons en nous intéressant à quatre parcours singuliers, qui ne prétendent pas être représentatifs de l’ensemble des artistes menacés, ni même de l’ensemble des artistes protégés au titre des statuts de réfugié ou d’apatride 2 , mais qui nous semblent révélateurs des liens entre politique et pratique artistique, ainsi que des soutiens que peuvent rechercher les artistes. Ces artistes sont François Willi Wendt, Otto Wols, Arnold Daghani et Suzanne Muhr. Ils n’ont pas été choisis pour leur
1. Article initialement publié dans Hommes & Migrations, n° 1338, 2022, pp. 93-99.
2. Il faut, en effet, souligner qu’il n’existe pas d’outil permettant d’identifer et de quantifer les artistes parmi l’ensemble des demandeurs de ces statuts. Le critère majeur de l’asile est la nationalité ou le pays d’origine.
21 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
( − )1
célébrité (seul Otto Wols est très connu), mais parce qu’ils permettent d’illustrer, tout d’abord, une situation rarement décrite dans les travaux sur les catégories de réfugiés et apatrides, à savoir la possibilité que la pratique artistique soit, en elle-même, analysée comme une prise de position politique. Leurs parcours offrent l'opportunité d’aborder une question importante et encore une fois rarement soulignée, celle de l’assistance fnancière qui accompagne ces statuts.
François Willi Wendt (1909-1970)
Né à Berlin en 1909, issu d’un milieu modeste, boursier, François Willi Wendt est politiquement engagé dans le Parti socialiste et ses groupements de jeunesse, ce qui lui vaut plusieurs incarcérations 3 . Il obtient, en 1936, l’autorisation de voyager en Italie pour approfondir ses connaissances en archéologie, y travaille avec le peintre Adolf Richard Fleischmann, et choisit défnitivement la peinture. En , son opposition au régime hitlérien le décide à l’exil 4 . Il quitte l’Allemagne pour Paris où il arrive en novembre avec son amie, la peintre Greta Saur. Il fréquente un moment l’atelier de Fernand Léger et entre en relation avec Vassili Kandinsky, Robert Delaunay, Otto Freundlich et Serge Poliakoff 5 . Il participe à des expositions de groupe et, jusqu’à la déclaration de la guerre, travaille également comme décorateur, professeur de langue et journaliste. En 1938, il est interné à la prison de la Santé du fait de sa nationalité, comme « étranger indésirable », et interné à plusieurs reprises durant la guerre6
Son dossier conservé à l’Ofpra commence par un certifcat de la délégation française du Comité intergouvernemental pour les réfugiés (CIR) 7 du 4 avril 1946, qui le considère comme un réfugié allemand au sens de la convention de 1938 8 , ratifée par la France et entrée en vigueur en . Le CIR lui délivre en
3. Demande de protection, Archives Ofpra, Willy WENDT GEN 1655.
4. Hélène Rousssel, « German-speaking Artists in Parisian Exile: Their Routes to the French Capital, Activities There, and Final Flight – a Short Introduction » in Ines Rotermund-Reynard (dir.), Echoes of Exile: Moscow Archives and the Arts in Paris 1933-1945, edited by Ines Rotermund-Reynard, Berlin/Munich/Boston, De Gruyter, 2014, pp. 1-26.
5. Lui-même réfugié, enregistré à l’Ofpra. Archives Ofpra. GEN1145.
6. Anonymes, « Justes et Persécutés durant la période Nazie dans les communes de France », https://www.ajpn.org/ personne-Francois-Willi-Wendt-624.html.
7. Créé à la conférence d’Évian de 1938 pour favoriser l’installation et la ré-émigration des victimes des persécutions nationalessocialistes en Allemagne, en Autriche et dans les Sudètes.
conséquence un acte de naissance destiné à être présenté au Centre national pour la recherche scientifque (CNRS) 9 . Cette protection est assurée ensuite par l’Organisation internationale pour les réfugiés (OIR, - ). Lorsque cette organisation ferme ses portes, François Willi Wendt remplit un formulaire de demande d’asile de l’Offce français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), le décembre . La protection lui est reconnue dans la continuité de celles du CIR puis de l’OIR, et ce en application de l’article A 10 de la convention de Genève. Dans ce formulaire, il indique qu’il a quitté son pays pour « conception antihitlérienne » et « impossibilité de faire en Allemagne la peinture » (sic). L’artiste avait, en effet, fait l’objet de pressions et de rejet du fait de son choix de l’art abstrait. Il déclare ne pas vouloir retourner dans son pays parce qu’il est marié à une Française, a fait une demande de naturalisation et qu’il « fait une peinture non admise à l’Est11 ». Dans un curriculum vitae joint au dossier il relate sa vie et précise : « À cause de mes convictions artistiques, culturelles et politiques, je me trouvais en contradiction avec la conception de l’art hitlérien qui ne condamna pas seulement toute l’évolution de l’art allemand depuis 1900, mais encore tous les grands maîtres étrangers à partir des impressionnistes français et de Van Gogh [...]. La réputation de l’art français et quelques relations personnelles m’ont décidé de me rendre à Paris12 . »
Le cas de François Willi Wendt illustre deux aspects importants de la protection des réfugiés au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Le premier est la ratifcation tardive des instruments signés en qui permet de reconnaître comme réfugiés, après le régime hitlérien, des ressortissants allemands menacés par ledit régime. Pour cette raison sans doute, la crainte évoquée par le peintre évolue de celle du régime nazi à celle de la liberté artistique « à l’Est », ce qui pourrait laisser entendre qu’il serait contraint
8. Convention du 10 février 1938 concernant le statut des réfugiés provenant d'Allemagne, publiée par décret du 14 avril 1945. La convention n’est signée que par sept pays : la Belgique, la Grande-Bretagne, le Danemark, l’Espagne, la France, la Norvège et les Pays-Bas, et elle n’aura guère le temps de produire des effets avant le déclenchement de la guerre.
9. Archives Ofpra, Willy WENDT GEN 1655.
10. Dans cet alinéa, la Convention défnit comme réfugiés ceux qui ont été reconnus comme tels au titre des arrangements et conventions signés entre 1926 et 1939 ou de la Constitution de l’Organisation internationale pour les réfugiés (OIR, 1946-1951).
11. Formulaire de demande d’asile, ibid
12. CV joint au dossier, ibid
22 LE POINT SUR | LA LIBERTÉ ARTISTIQUE ET L’EXIL
X Certifcat de réfugié de Willy Wendt, édité en 1961. Les certifcats de réfugiés ou apatrides attestent que la personne qui les détient est réfugiée au titre de la convention de Genève ou apatride au titre de celle de New York. Ces documents permettent d’obtenir la carte de séjour et un titre de voyage remplaçant le passeport.
X Willy Wendt’s refugee certifcate, published in 1961. Refugee certifcates certify that the holder is a refugee under the Geneva Convention or stateless under the New York Convention. With these documents, they can obtain a residence permit and a travel document in place of a passport. Archives Ofpra.
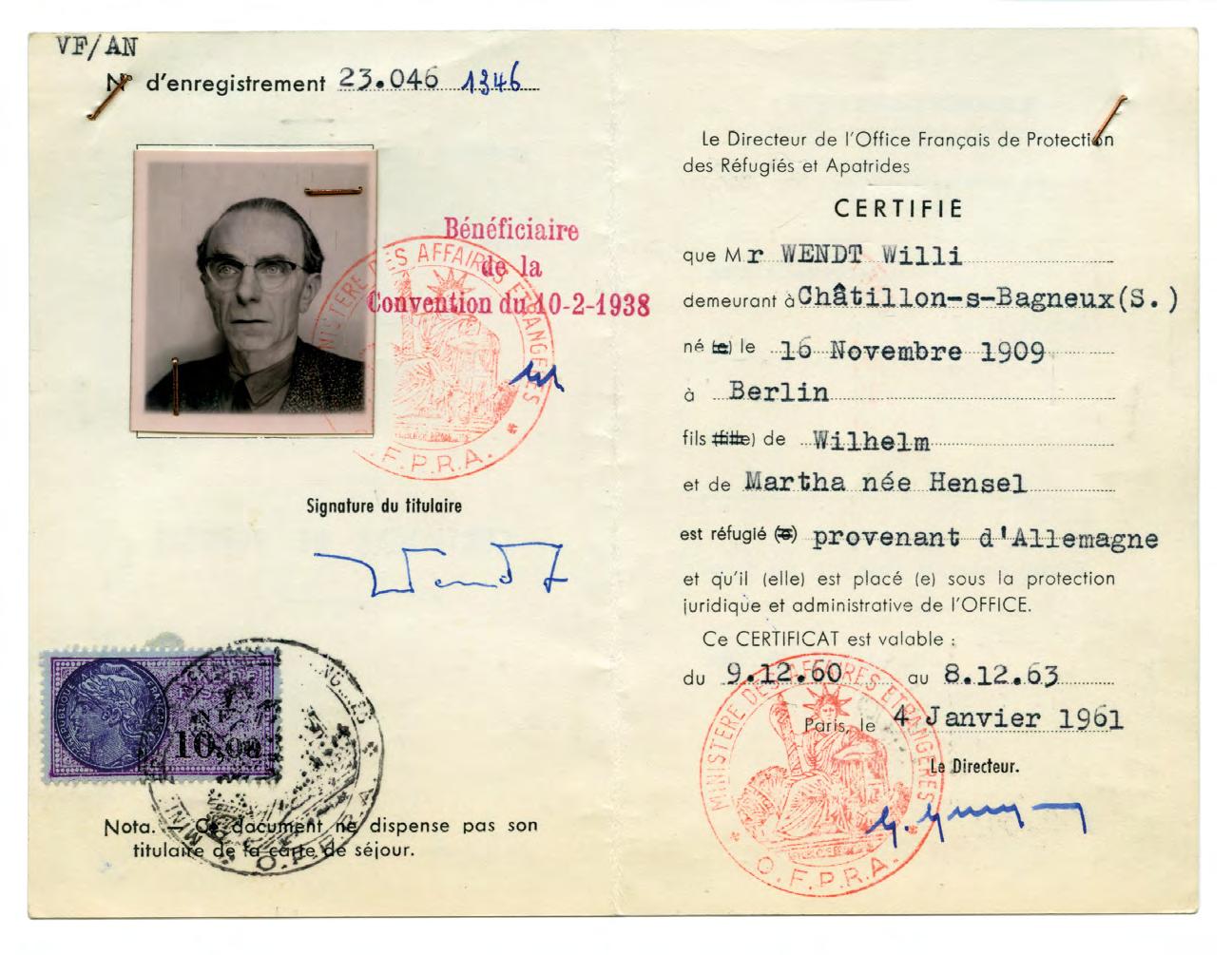
de retourner en République démocratique allemande (RDA). En elle-même, cette situation illustre le caractère réparateur de la Convention de Genève de , qui permet de protéger tous les réfugiés protégés par d’anciennes conventions, comme celle de 1938, et de protéger les personnes refusant de revenir dans un pays laissé à l’infuence soviétique 13 .
Le deuxième aspect est la mise en place de fonds de réparation fnancière dans le cadre de l’OIR14 . Le peintre a en effet demandé à en bénéfcier en expliquant de façon très détaillée combien les années de guerre ont provoqué non seulement des retards dans son art à un âge crucial, mais aussi des maladies dues aux privations et des pertes de biens (chevalets,
13. Voir notamment : Aline Angoustures, Dzovinar Kévonian, Claire Mouradian (dir.), Réfugiés et apatrides. Administrer l’asile en France (1920-1960), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2017, 320 p.
matériaux). Ayant l’occasion d’exposer, enfn, l’ensemble de son œuvre dans le cadre du Salon des réalités nouvelles15 , il estime l’aide nécessaire à cette exposition à 60 000 francs et le matériel pour compléter les tableaux existants à francs. Sa situation particulièrement précaire (meubles loués, résidence en banlieue sans possibilités d’acheter un vélo, situation de confort diffcile pour un couple avec deux jeunes enfants) l’amène à solliciter enfn francs, soit
14. Voir sur ce point Marianne Amar, « Une destinée incertaine. Politique de réinstallation et stratégies migratoires des “élites déplacées” dans les années 1946-1951 », in Marianne Amar, Nancy L. Green (dir.), Migrations d'élite - Une histoire monde (XVIe-XXIe siècle), Tours, Presses universitaires François Rabelais, 2022 [à paraître].
15. Le Salon des réalités nouvelles est le Salon de l'abstraction, il est animé par les artistes eux-mêmes réunis en une « Association Réalités Nouvelles ». Le Salon a lieu tous les ans depuis 1946 à Paris.
23 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
un total de francs. Sa demande est soutenue par plusieurs artistes et par l’aumônerie protestante. Il lui est alloué la somme de francs en . Naturalisé français en 1967, François Willi Wendt meurt en 1970. Dans un article paru dans Les Lettres françaises , l’influent critique d’art Roger van Gindertael16 note que l’artiste, membre de la Nouvelle École de Paris, est « l’un des meilleurs peintres et des plus personnels de sa génération ; artiste d’une grande pureté et d’une solide culture, son exigence vis-à-vis de lui-même, sa modestie et aussi son sens moral l’ont trop longtemps maintenu en dehors de la notoriété qu’il eut mérité d’atteindre ». Dans les expositions collectives auxquelles il fut invité à participer, il fut régulièrement associé aux peintres les plus en vue de la nouvelle École de Paris, notamment Roger Bissière, André Lanskoy, Serge Poliakoff, Nicolas de Staël et Pierre Soulages.
Alfred Otto Wolfgang Schulze dit Otto Wols (1913-1951)
Alfred Otto Wolfgang Schulze, connu sous le pseudonyme d’Otto Wols ou Wols, est un photographe, peintre, et graveur allemand né en 1913 à Berlin. Né dans une famille artistique et en vue, il s’intéresse à la photographie. Il vient à Paris en 1932 pour une réunion avec les artistes Amédée Ozenfant et Fernand Léger. Il se rapproche des surréalistes et rencontre Hans Arp, Alexander Calder, Alberto Giacometti et beaucoup d’autres personnalités de la scène parisienne du théâtre, de la littérature et des beaux-arts. De retour en Allemagne pour régler des affaires d’héritage à l’été , il décide de quitter défnitivement le pays devant l’avènement du régime hitlérien.
En 1936, celui qui s’appelle encore Schulze reçoit avec l’aide de Fernand Léger un permis de séjour limité avec obligation de notifcation mensuelle à la police de Paris. Il gagne sa vie comme photographe et obtient, en 1937, la possibilité de documenter en photographies le Pavillon de l’Élégance et de la Parure à l’exposition universelle de Paris. Il rencontre un grand succès et gagne alors très bien sa vie. Il choisit alors son pseudonyme « Wols », acronyme composé à partir de l’un de ses prénoms et de son nom : Wolfgang Schulze.
Il est détenu à Colombes du fait de sa nationalité allemande au début de la guerre, en 1939-1940 17. Il a
ensuite vécu à Marseille, où il est assisté par un Comité d’entraide aux intellectuels. Au moment de l’occupation allemande de la zone sud, il part vivre clandestinement dans la Drôme. Il se marie avec une Française et demande la protection du CIR en 1948, puis de l’OIR en . Durant cette même période, sa santé mentale et physique se détériore en raison d’un sévère alcoolisme et sa situation psychique et matérielle est diffcile.
Otto Wols est soutenu auprès du CIR en 1948 par Gustave Moutet, chef de cabinet du ministre de la France d’Outre-Mer18 , qui évoque son opposition à Hitler, ses liens avec Fernand Léger et ses qualités artistiques pour estimer qu’il entre dans la catégorie des réfugiés provenant d’Allemagne au titre de la Convention de 193819 . Certains indices laissent à penser que cette demande est avant tout liée aux nécessités de soutien fnancier. En effet, le document établi pour le peintre par le CIR le 28 janvier 1948 n’est pas le certifcat standard certifant qu’il est bien réfugié, mais détaille les aides auxquelles ont droit, en application de l’article 11 de la convention, les réfugiés en situation diffcile, notamment chômeurs, infrmes, et le document est établi « pour être joint à l’appui de sa demande d’assistance médicale gratuite 20 ». Le mai lui est envoyée une lettre de l’OIR lui indiquant que l’agence qui s’est « occupée » de lui va cesser ses activités et, notamment, que le juin , l’assistance matérielle va prendre fn. La lettre lui indique qu’il a le choix de rentrer dans son pays, soulignant les difficultés que peuvent rencontrer désormais les réfugiés qui ne sont pas « réétablis » en France et que l’organisation peut encore l’aider fnancièrement à être rapatrié pendant quelques mois 21 . À cette date, les
17. Formulaire de demande d’assistance de l’OIR, notes de l’OP, 8 juin 1950. Archives Ofpra, Otto SCHULZE WOLS GEN 1516. 18. Gustave Moutet, résistant gaulliste, est le fls de Marius Moutet, ministre de l’Outre-mer. Avocat, socialiste, président du Conseil général de la Drôme, Marius Moutet est nommé ministre de la France d'outre-mer sous les gouvernements Gouin, Bidault, Blum et Ramadier, de janvier 1946 à octobre 1947. Pendant ce mandat, il a mené trois actions particulièrement marquantes : la suppression du travail forcé, l'abolition du régime de l'indigénat et la promulgation du premier Code du travail pour tous les départements d'outre-mer. Il aura ainsi largement contribué à l'évolution du statut des peuples colonisés, une tâche qu'il avait déjà commencée comme ministre des Colonies avant la guerre. Biographie extraite du dictionnaire des parlementaires français de 1889 à 1940 (Jean Jolly). URL : https://www2.assembleenationale.fr/sycomore/bio/(num_dept)/5466.
19. Archives Ofpra, Otto SCHULZE WOLS GEN 1516.
20. Certifcat du CIR, Délégation française, ibid
21. Lettre signée du Délégué général adjoint de l’OIR adressée à Otto Schulze Wols, ibid
24 LE POINT SUR | LA LIBERTÉ ARTISTIQUE ET L’EXIL
16. Roger Van Gindertael, « François Wendt n’est plus », in Les Lettres françaises, n° 1336, 27 mai 1970.
accords conclus avec la France permettent déjà la mise en place de la succession de l’OIR, tant pour l’aide matérielle (du ressort du SSAE) que pour la protection administrative, qui sera du ressort du futur Ofpra. C’est sans doute pour cette raison qu’il remplit un formulaire de demande d’assistance auprès de l’OIR le juin . Les formulaires de l’OIR permettaient à la fois de solliciter une protection administrative et une assistance fnancière.
Le cas de Wols s’éloigne ici de celui du précédent dans la mesure où ses objections au rapatriement en Allemagne sont économiques et artistiques. L’enquêteur de l’OIR relève : « Objections au rapatriement : raisons économiques (est connu comme peintre en France), ne veut pas rentrer en Allemagne où il a pourtant de la famille car ses amis du monde artistique français lui sont plus essentiels que les siens en Allemagne 22 » La protection lui est accordée et il bénéficie du fonds de réparation à hauteur de euros par l’entremise de l’aumônerie protestante, son dossier étant transmis pour assistance au SSAE. Cette unique perspective fnancière est renforcée par le fait que l’artiste est naturalisé français en 1949. Il faut souligner que le peintre, qui souffre d’une addiction à l’alcool, est en grande diffculté depuis plusieurs années. Il meurt en d’une intoxication alimentaire.
Le cas de Wolf peut être considéré comme représentant la question traitée dans cet article : même s’il n’évoque pas la liberté artistique comme argument pour ne pas être rapatrié en Allemagne, il souligne le besoin de rester dans le milieu artistique rencontré en France. De plus, sa santé mentale et physique à l’époque a pu contribuer à cette décision de protection.
Proche du surréalisme, Wols est considéré comme un pionnier de l’abstraction lyrique européenne et un représentant du tachisme et de l’art informel. Il est aujourd’hui beaucoup plus reconnu que François Will Wendt 23 .
Arnold Daghani (1909-1985)
Arnold Daghani 24 est né Arnold Korn le février 1909, à Suczawa en Bucovine (Empire austro-hongrois, aujourd’hui Suceava en Roumanie) d’un couple de
22. Ibid
23. « Wols: retrospective », catalogue d'exposition, Kunsthalle Breme, et The Menil Collection, 2013, avec des essais d'Ewald Rathke, Toby Kamps, Patrycja de Bieberstein Ilgner, Katy Siegel Rathke.
Juifs germanophones. Il fait preuve de talents artistiques à l’école puis fréquente une école d’art à Munich. À l’âge de ans, il est enrôlé dans l’armée, puis, après avoir été libéré au début des années 1930, travaille pour un éditeur, en tant que commis, à Bucarest. Alors qu’il est marié et vit à Czernowitz, Daghani est déporté le 7 juin 1942 vers la Transnistrie, puis à Ladyjin, près du feuve Boug. Le couple y est rafé le août et conduit par la SS dans le camp de travail forcé de Mikhailowka dans le Sud-Ouest de l’Ukraine où ils travaillaient pour l’Organization Todt. Dans le camp, Daghani put réaliser des dessins et des peintures, et il parvint à les conserver et à en faire un facteur de survie : certains des gardiens lui demandèrent de faire leur portrait tandis qu’à d’autres moments, le peintre se concilia tel ou telle en réalisant des objets décoratifs. Il y écrit un journal publié en français en 2019 25 , qui plonge le lecteur dans la Shoah telle qu’elle a fait rage en Roumanie ou en Ukraine, « lors d’une tourmente historique où succéda à l’avancée des Russes celle des Allemands – auxquels s’allia le dictateur roumain Antonescu 26 ». En juillet 1943, alors qu’il travaille à une mosaïque représentant l’aigle allemand, il s’enfuit avec sa femme, aidé par la résistance juive locale. C’est dans le ghetto de Bershad qu’ils apprennent que tous leurs camarades de camp ont été exterminés.
Le couple s’installe à Bucarest en mars 1944. Arnold Daghani rencontre alors des diffcultés dans sa vie artistique. Son refus d’adhérer à l’Union des artistes et des sculpteurs et son rejet du réalisme socialiste en art l’empêchent de pouvoir exposer ses œuvres de façon offcielle. Pour gagner sa vie, il enseigne l’anglais et sa femme le français. Il fnit par adhérer au syndicat offciel en , mais il est resté en retrait 27. Ses dessins et peintures de personnages s’éloignent de la vision glorieuse du réalisme socialiste et il dessine des nus,
24. Deborah Schultz, Edward Timms, Pictorial Narrative in the Nazi Period : Felix Nussbaum, Charlotte Salomon and Arnold Daghani, London, Routledge, 2016 ; Deborah Schultz, « Displacement and identity: Arnold Daghani », in ARTMARGINS, 2002 [en ligne]. URL : https://artmargins.com/displacement-andidentity-arnold-daghani/
25. Arnold Daghani, La tombe est dans la cerisaie. Journal du camp de Mikhaïlovka (1942-1943), trad. du roumain et de l’allemand par Philippe Kellmer, suivi d’un entretien avec Philippe Kellmer et Marc Sagnol, Paris, Fario, 2018. Ce journal a été publié en Roumanie en 1947.
26. Claude Mouchard, « Du fond de l’enfer », in En attendant Nadeau, 29 janvier 2019.
27. Formulaire de demande de protection, Archives Ofpra, Arnold et Anna DAGHANI D 5.
25 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
un thème désapprouvé par les dogmes artistiques socialistes 28 . L’artiste rêve donc de rejoindre « le monde libre » et de s’insérer dans les mouvements artistiques modernistes qui y ont cours. Même son travail sur le camp est critiqué pour n’être pas assez noir ou dramatique, parce qu’il cherche à représenter la dignité des déportés et non les exécutions et les atrocités. « Depuis que je me suis tenu à l’écart, refusant de prendre part à toute manifestation artistique, je suis taxé de réactionnaire, alors que ce que je suis vraiment est un humaniste, qui ne fait que placer les intérêts humains au premier plan. Derrière le rideau de fer, rien ne doit exister à part le Parti. Et je ne peux pas me plier devant lui29 », écrit Daghani dans ses mémoires. De plus, la religion était très importante pour Daghani, et il se rapproche de l’orthodoxie chrétienne orientale. Ses œuvres des années représentent des prêtres, des moines et des intérieurs d’église. Il a produit des vitraux pour la chapelle du Bon Samaritain de Bucarest et, en , il est invité à exposer au Palais du Patriarche. Bien que l’Église soit tolérée par les autorités, Daghani est alors membre de l’Union des artistes et il raconte dans ses carnets que l’artiste et critique Oskar Walter Cisek était « infexible » pour lui enjoindre de ne pas y exposer : « Pas d’exposition d’art sacré. Les autorités et l’Union des artistes et sculpteurs, dont je suis membre à part entière, verraient d’un mauvais œil une telle exposition. » En fn de compte, l’exposition a eu lieu, mais « à huis clos », uniquement pour le Patriarche, les archevêques et les évêques, et quelques amis de Daghani 30
En , Daghani et sa femme Nanino émigrent en Israël, bien que ce ne soit pas le souhait profond du peintre, ainsi qu’il le note dans ses carnets, d’autant qu’avant de partir, ils ont entendu l’artiste roumaine Vilma Badian dire qu’elle n’était pas heureuse là-bas et n’aimait pas du tout la « base coopérative et tout » de la communauté d’Ein Hod 31
Arnold Daghani vient en France en avril . Dans sa demande de protection, présentée à l’Ofpra le 12 mars 1966, il déclare que, parti de Roumanie en Israël en , lui et sa femme sont automatiquement devenus israéliens mais qu’ils ont quitté le pays après un an et neuf mois pour la Suisse puis la France, où ils sont installés à Vence. Ses motivations restent centrées sur
28. « A large, a big question mark », 1968, unpublished notebook, Arnold Daghani Collection, C39.41r., cité par Deborah Schultz, op. cit
29. Ibid
30. Ibid
31. Ibid
la pratique artistique : « La raison pour laquelle nous avons quitté Israël réside dans le fait que comme ARTISTE PEINTRE je fus empêché dans ma carrière, étant donné que la plupart de mes travaux a été dédiée à l’Art Sacré Chrétien. Entretemps j’étais entré dans l’Église par le baptême 32 » La validité de leur passeport israélien ne pouvant être prolongée s’ils ne rentrent pas « un certain temps » en Israël, il considère que, « comme chrétien ou plutôt comme juif baptisé, je ne compte plus comme juif et cela serait pour moi un empêchement primordial pour obtenir un autre passeport pour repartir, si je devais rentrer en Israël 33 ». La lettre se conclut par la demande à être reconnus comme réfugiés. En annexe, il produit un certain nombre de documents (coupures de presse, lettres) attestant de la réception froide qu’aurait son art en Israël.
Le dossier est traité par la section roumaine, qui répond qu’elle ne peut protéger le couple tant qu’ils ont la nationalité israélienne, sans répondre sur la question d’une éventuelle persécution fondée sur la liberté artistique 34 . Le 17 février 1968, Daghani répond que sa femme et lui ne sont plus considérés comme Israéliens par le Consulat. Il lui est donc demandé de produire la lettre du Consulat général d’Israël, l’apatridie devant être légalement établie. Arnold Daghani fait parvenir ce document ainsi que des témoignages. Il est reconnu apatride d’origine israélienne le mars 1968, ainsi que l’en avise, cette fois, le bureau des apatrides de l’Ofpra dirigé par Angèle Kovalsky 35 . Arnold Daghani vit en Suisse en - , puis part s’installer en en Grande Bretagne, où il meurt le avril à Hove (près de Brighton), huit mois après sa femme.
32. Formulaire de demande d’asile, Archives Ofpra, Arnold et Anna DAGHANI, D5.
33. Ibid
34. Lettre du 17 mars 1966, Archives Ofpra, Arnold et Anna DAGHANI, D5.
35. Née à Marioupol en Ukraine, Angèle Kovalska (née Roux), épouse de Nicolas Kovalsky, lui aussi réfugié et ofcier de protection, a débuté sa carrière en 1938 comme secrétaire au sein de la délégation en France du Haut-Commissariat aux réfugiés de la Société des nations (SDN). Durant les années passées au sein de cette institution, surtout après la débâcle et durant la période d’occupation allemande, on sait qu’elle a joué un rôle actif dans la continuité des activités en faveur à la protection internationale des réfugiés avant d’être engagée comme secrétaire de la direction à l’Ofpra, ofciellement à partir du 1er janvier 1953 et de devenir, en 1958, ofcier de protection en charge de la section des apatrides, mission qu’elle a accomplie jusqu’au 6 décembre 1974, lorsqu’il est mis fn à ses fonctions à l’Ofpra. Diego Suarez Gomez, « Administrer l’apatridie, synthèse des textes juridiques et pratiques administratives en France (1952-1960) », en cours de publication.
26 LE POINT SUR | LA LIBERTÉ ARTISTIQUE ET L’EXIL
Artiste polyvalent, il est connu pour ses dessins et ses écrits, et a produit plus de 4 000 œuvres 36 . Ses œuvres sont conservées dans des collections publiques britanniques, notamment la collection Ben Uri, l’université du Surrey et l’université de Warwick. Un total de pièces, dont des lettres et de la prose de l’artiste, sont conservées dans la collection Arnold Daghani de l’université du Sussex. En , Daghani a fait partie des 21 artistes de Last Portrait : Painting for Posterity, présentée par Yad Vashem (musée israélien de la mémoire de l’ Holocauste) à Jérusalem.
Suzanne Murh (1928-1999)
Suzanne Muhr est née le janvier à Budapest, en Hongrie. Elle a été élève à l’Académie des beaux-arts de 1948 à 1949. Peintre abstraite, réalisant aussi des encres de Chine, elle exposait en dans la Galerie Colette Allendy, dans le e arrondissement de Paris 37, mais semble oubliée aujourd’hui.
36. David Buckman, « Artists in Britain Since 1945' », Art Dictionaries Ltd, part of Sansom & Company, cité sur https:// artuk.org/discover/artists/daghani-arnold-19091985.
37. M.-C. L., « Au fl des galeries », in Le Monde, 31 décembre 1954.
À son arrivée en France en , Suzanne Muhr est placée sous mandat de l’OIR, le décembre 38 , protection prolongée par l’Ofpra jusqu’à sa naturalisation en 1966 39 . La motivation indiquée dans sa première demande de protection est retranscrite par l’offcier d’éligibilité de l’OIR ainsi : « Ne voulant répéter les slogans communistes et louer les [ILL…] et les [ILL] qu’elle détestait, avait des ennemis à l’Académie hongroise des Beaux-Arts. Craignant des persécutions, s’évade de Hongrie 40 . »
Suzanne Muhr a transité par l’Autriche et l’Allemagne avant d’arriver en France. Elle fait partie des personnes déplacées après la Seconde Guerre mondiale. Dans le dossier de l’Ofpra se trouve une copie manuscrite d’un certifcat d’éligibilité de la Commission préparatoire de l’OIR où est mentionnée sa présence dans la zone d’occupation américaine de l’Allemagne en avril . On retrouve des documents la concernant dans les Archives Arolsen, notamment
38. Certifcat de la délégation française de l’OIR, Archives Ofpra, Suzanne MUHR GEN966.
39. Renseignements concernant les réfugiés et apatrides, destinés à l’Ofpra, Préfecture de police, 15 avril 1966. Archives Ofpra, ibid
40. Formulaire de la délégation française de l’OIR, 29 novembre 1950, ibid

27 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
X Certifcat d’apatride d’Arnold Daghani / Stateless person certifcate belonging to Arnold Daghani. Archives Ofpra.
sa carte du camp XVII Azberbergasse de Vienne (Autriche) 41 où il est noté qu’elle est « artiste peintre » et est entrée en Autriche le mars . Elle déclare vouloir se rendre en France 42 . D’autres documents permettent de savoir qu’elle a ensuite été placée dans un centre de réinstallation de l’OIR, Nellingen 43 , où, d’après la copie manuscrite du document présent dans le dossier de l’Ofpra, l’éligibilité lui a été accordée le juillet . Le parcours de Suzanne Muhr rappelle beaucoup celui de Judit Reigl évoquée dans l’exposition, mais cette dernière reçoit l’aide d’un artiste hongrois protégé par l’Ofpra, Simon Hantaï.

Le cas de Suzanne Muhr, tel qu’il apparaît dans ces archives, illustre comment un exil d’artiste peut être entièrement fondé sur une menace liée à sa pratique artistique, mais être inséré, par l’administration en charge de l’éligibilité, dans un contexte plus large, comme le relève l’officier de protection à
41. Document ID: 80757035 - ZSUZSANNA MUHR. URL : https:// collections.arolsen-archives.org/undefned.
42. Archives Arolsen, ID: 68353629 - Susanne MUHR.
43. Zone II (Nellingen, Stuttgart).
propos du refus de l’artiste de retourner en Hongrie pour des « raisons politiques 44 ». Cela nous semble illustrer à la fois les liens entre la pratique artistique et les opinions politiques, y compris imputées par le pouvoir en place, ainsi que la souplesse de l’interprétation des textes internationaux sur les réfugiés. Enfn, dans sa situation comme dans celle des deux premiers artistes évoqués, l’aide matérielle dans les années d’après guerres est nécessaire : Suzanne Muhr vit avec l’aide du Comité des réfugiés hongrois et demande une gratuité des documents et une assistance fnancière 45
Ce parcours de quatre artistes actifs dans les années - en France permet de souligner les liens complexes entre pratique artistique, opinion et pouvoir politiques, surtout dans une période où domine la notion d’art offciel. Il permet aussi de mettre en lumière le lien rarement évoqué entre la protection internationale des réfugiés et apatrides et le groupe des artistes, ce qui, nous l’espérons, peut ouvrir un champ de recherche.
LE POINT SUR | LA LIBERTÉ ARTISTIQUE ET L’EXIL 28
44. Formulaire de demande d’assistance, Archives Ofpra, Suzanne MUHR GEN966.
45. Lettre du Comité des réfugiés hongrois du 25 février 1955, Archives Ofpra, Suzanne MUHR GEN966.
X Certifcat de réfugié de Suzanne Muhr, édité en 1962 / Refugee certifcate belonging to Suzanne Muhr, issued in 1962. Archives Ofpra.
Artistic Freedom and Exile Refections Based on Four Visual Artists
Aline Angoustures, Head of the History and Archives Management Mission at the National Offce for Refugees and Stateless People (OFPRA), Associate Member of the Institute of Political Social Sciences (ISP), affliated with the Institut Convergences Migrations ( - ).
The trajectories of François Willi Wendt, Otto Wols, Arnold Daghani, and Suzanne Muhr – four exiled artists active in France during the period 1945 to 1960 – underscore the complex links between artistic practice and political opinion, and reveal the forms of support, primarily fnancial, which they received. A comparative study of the terms of their exiles to France –through their fles held at France’s National Offce for Refugees and Stateless People – brings to light the rarely considered link between international protection provisions and artists.
The exhibition Paris et nulle part ailleurs (Paris and Nowhere Else) focused, among other things, on the motivations that led certain artists to move to Paris, where they practised between and . One of the factors that drove them to leave their countries of origin was of course a fear of persecution or loss of protection there, hence the creation of the international refugee and stateless person statuses between and . However, many artists did not move to Paris for this reason. It was also relatively common, including for those that went into exile on account of fears they had in their home country or which they developed following their departure, for them to not register as refugees, as was the case for Nicolas de Staël, for instance. One of the most famous artists belonging to this category is Pablo Picasso. For many different reasons, artists often found other solutions for settling in the country and residing their legally. This meant that they did not need to appeal to the authorities of their country of origin to travel or extend their stay, or that the consular authorities of their country did not deny them protection.
In this article, we will focus specifcally on artists who applied for protection as a refugee or stateless person, thereby breaking with their country of origin, and who did so in the name of their art, that is, on the grounds of an absence of artistic freedom or repression suffered because of their artistic practice. To this end, we will examine four unique cases. Though they are not representative of all threatened artists, nor of all artists protected by the status of refugee or stateless person1 , these individuals appear to highlight the links between politics and artistic practice, as well as the forms of support to which such artists were entitled. The artists in question are: François Willi Wendt, Otto Wols, Arnold Daghani, and Suzanne Muhr. They have not been selected on account of their renown (among them, only Otto Wols is very well known), but rather because they exemplify a situation that is rarely discussed in relation to the categories of refugees and stateless persons;
1. It should be noted that no tool exists for identifying and quantifying the artists included among the claimants for these statuses as a whole, The key criterion for asylum is nationality or country of origin.
29 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
namely, the possibility of understanding artistic practice as a political position in its own right. Their experiences allow us to tackle an important question that is also rarely discussed: namely, the fnancial assistance that accompanies these statuses.
François Willi Wendt (1909–1970)
Born in Berlin in 1909 into a modest background, François Willi Wendt, was an active member of the Socialist Party and its youth groups while he was a scholarship student, for which he was incarcerated on several occasions 2 . In 1936, he was granted the authorisation to travel to Italy to pursue further studies in archaeology, where he worked with the painter Adolf Richard Fleischmann and chose to focus on painting once and for all. In 1937, his opposition to Hitler’s regime drove him to exile himself3 . He left Germany for Paris, where he arrived in November with his friend Greta Saur, also a painter. For a while, he frequented the studio of Fernand Léger, where he came into contact with Vassili Kandinsky, Robert Delaunay, Otto Freundlich, and Serge Poliakoff4 . He took part in group exhibitions and, until war was declared, also worked as a decorator, language teacher, and journalist. In 1938, he was interned in La Santé Prison because of his nationality, classed as an “undesirable alien”, and he was detained again on several occasions during the war5 .
His fle, which is held at OFPRA, begins with a certifcate issued by the French Delegation of the Intergovernmental Committee on Refugees (ICR) 6 on
2. Application for protection, OFPRA Archives, Willy WENDT GEN 1655.
3. Roussel, Hélène. “German-speaking Artists in Parisian Exile: Their Routes to the French Capital, Activities There, and Final Flight – a Short Introduction”, in Ines Rotermund-Reynard (ed.), Echoes of Exile: Moscow Archives and the Arts in Paris 1933-1945, Berlin, München, Boston: De Gruyter, 2014, pp. 1–26.
4. Also a refugee, registered with OFPRA. OFPRA Archives. GEN1145.
5. Anonymous, “Justes et Persécutés durant la période Nazie dans les communes de France”, http://www.ajpn.org/personneFrancois-Willi-Wendt-624.html.
6. Created at the Évian Conference in 1938 to facilitate the settlement and remigration of the victims of National Socialist persecutions in Germany, Austria, and the Sudetes.
7. Convention held on 10 February 1939 concerning the status of refugees from Germany, published by the decree dated 14 April 1945. The convention was only signed by seven countries –Belgium, Great Britain, Denmark, Spain, France, Norway, and the Netherlands – and scarcely had time to have any effect before war broke out.
April , in which he is classed as a German refugee as per the 1938 Convention 7, which was ratifed by France and came into force in . Consequently, the ICR issued him with a birth certifcate to present to the French National Centre for Scientifc Research (CNRS) 8 . This protection was then also guaranteed by the International Organisation for Refugees (OIR, – ). When the latter organisation closed its doors, on December François Willi Wendt flled out an asylum application form from the French Offce for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA). He was granted protection in continuation of the protection provided by the ICR and subsequently by the OIR, pursuant to Article A 9 of the Geneva Convention. On the form, he noted that he had left his country due to his “anti-Hitler views ” and the « impossibility of painting in Germany ”. The artist had in fact been pressurised and rejected due to his decision to engage in abstract art. He declared that he did not wish to return to his country of origin because he was married to a Frenchwoman, had fled an application for naturalisation, and “was engaged in a type of painting not permitted in the East10 ”. In a curriculum vitae enclosed with the fle, he noted that: “On account of my artistic, cultural and political convictions, I found myself at variance with the Hitlerian conception of art, which condemns not only the entire evolution of German art since 1900, but all the great foreign masters, starting with the French impressionists and Van Gogh […]. I decided to move to Paris because of the reputation of French art and some personal relationships11 ”
François Willi Wendt’s case demonstrates two important aspects of the protection of refugees at the end of the Second World War. The frst is the late ratifcation of the instruments signed in , thanks to which German nationals threatened by Hitler’s regime could be recognised – after the regime – as refugees. Likely for this reason, the fear the painter mentions evolved from of a fear of the Nazi regime into a fear of artistic freedom “in the East”, which may suggest he would be forced to return to the German
8. OFPRA Archives, Willy WENDT GEN 1655.
9. In this paragraph, the Convention defnes refugees as those who have been recognised as such pursuant to the arrangements and conventions signed between 1926 and 1939 or pursuant to the Convention of the International Refugee Organization (IRO, 1946-1951).
10. Asylum application form, ibid
11. CV enclosed in the fle, ibid
30
LE POINT SUR | ARTISTIC FREEDOM AND EXILE
Democratic Republic (GDR). This situation demonstrates the remedial nature of the Geneva Convention, which granted protection to all refugees protected by earlier conventions, such as the 1938 Convention, as well as to anyone that refused to return to a country that had fallen under Soviet infuence 12
The second aspect concerns the introduction of fnancial compensation funds within the framework of the OIR13 . The painter requested such assistance by explaining, in great detail, that the wartime years had not only held back his art at a crucial age, but had also made him ill as a result of the hardships and loss of property (easels, materials, etc.) he suffered as a result. Thus, when he had the opportunity to exhibit all his work during the Salon des Réalités Nouvelles (“Salon of New Realities”14), he estimated that he would require 60,000 Francs of assistance for the exhibition, and 70,000 francs worth of material to complete his twenty-fve existing paintings. Given his particularly precarious situation (rented furniture, living in the suburbs with no possibility of purchasing a bicycle, existing in challenging living conditions for a couple with two young children), he went on to request a further 220,000 francs, bringing the total to , francs. His request was supported by several artists as well as the Protestant chaplaincy. In , he was granted the sum of 360,000 francs.
After obtaining French nationality in , François Willi Wendt died in 1970. In an article published in Les Lettres françaises, the infuential art critic Roger van Gindertael15 described the artist, who was a member of the Nouvelle École de Paris (“The New School of Paris”), as : “one of the best, most personal painters of his generation; an artist of great fnesse and solid cultural grounding, his diligence,
modesty, and moral rectitude too long prevented him from achieving the notoriety he deserved ”. In the group exhibitions in which he was invited to partake, he was frequently associated with the most prominent artists of the New School of Paris: namely, Roger Bissière, André Lanskoy, Serge Poliakoff, Nicolas de Staël, and Pierre Soulages.
Alfred Otto Wolfgang Schulze, known as Otto Wols (1913–1951)
Alfred Otto Wolfgang Schulze, known by the pseudonym of Otto Wols or Wols, was a photographer, painter, and German engraver born in Berlin in . Born into a prominent artistic family, he soon took an interest in photography. He travelled to Paris in 1932 to meet with the artists Amédée Ozenfant and Fernand Léger. He became friendly with the surrealists and met Hans Arp, Alexander Calder, Alberto Giacometti, along with many other key fgures from the Parisian theatre, literary, and fne arts scene. After returning to Germany in the summer of to take care of some inheritance matters, he left the country once and for all after the advent of Hitler’s regime.
In 1936, still going by the name of Schulze, thanks to the assistance of Fernand Léger he was granted a limited residence permit with an obligation to report to the Police of Paris on a monthly basis. He earned a living as a photographer and, in 1937, was presented with the opportunity to take photographs to document the Pavillon de l’Élégance et de la Parure at the Exposition Universelle in Paris. This was a huge success, and he went on to earn a very good living. He then decided to go by the pseudonym “Wols”, an acronym made up of one of his frst names and his surname : Wolfgang Schulze.
12. See, in particular: Aline Angoustures, Dzovinar Kévonian, Claire Mouradian (ed.), Réfugiés et apatrides. Administrer l’asile en France (1920-1960), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2017, 320 pp.
13. On this point, see: Marianne Amar, “Une destinée incertaine. Politique de réinstallation et stratégies migratoires des “élites déplacées” dans les années 1946-1951”, in Marianne Amar, Nancy L. Green (ed.), Migrations d’élite - Une histoire monde (XVIe-XXIe siècle), Tours, Presses universitaires François Rabelais, 2022 [forthcoming].
14. The Salon of New Realities is the Salon of Abstraction: It is led by the artists themselves, who come together to form an “Association of New Realities”. The Salon has been held in Paris every year since 1946.
15. Roger Van Gindertael, “François Wendt n’est plus”, in Les Lettres françaises, n°. 1336, 27 May 1970.
At the start of the war in - , he was detained in Colombes on account of his German nationality 16 . He then moved to Marseille, where he was supported by a mutual aid committee for intellectuals. When the zone in the South came under German occupation, he left clandestinely and went to live in the Drôme region. He married a French woman and applied for protection from the ICR in 1947, and then from the OIR in . During this period, his mental and physical health deteriorated due to severe
31 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
16. Assistance request form, OIR, notes by the OP, 8 June 1950. OFPRA Archives, Otto SCHULZE WOLS GEN 1516.
alcoholism, and his psychological and material situation became challenging.
In , Gustave Moutet, chief of staff of the Ministry of France and Overseas Territories17, supported Otto Wols’ application to the ICR. He noted his opposition to Hitler, his ties with Fernand Léger, and his artistic talents to support his recognition as a refugee from Germany in accordance with the Convention18 . There is some evidence that this request was primarily connected with his need for fnancial support. Indeed, the document that the ICR issued to the painter with on 28 January 1948 was not the standard certifcate certifying his status as a refugee. Rather, it listed the benefts to which refugees in diffcult circumstances were entitled, pursuant to Article 11 of the Convention, notably those who were unemployed or disabled, and the document was drawn up “ to support his request for free medical care 19 ”. On 2 May , he received a letter from the OIR informing him that the agency that had « been dealing with» his case would cease to operate and, notably, that on 30 June the material assistance it provided would come to an end. The letter specifed that he could choose to return to his country, underscoring the diffculties that refugees in France who were not “resettled” might now face, and that the organisation could still provide him with fnancial assistance with the repatriation for a few more months 20 . On that date, the agreements in place with France already allowed for the OIR’s replacement to be put in place, for both material assistance (which fell under the jurisdiction of the SSAE [Social Aid Service for Emigrants]) and administrative protection, which
17. Gustave Moutet, a Gaullist resistant, was the son of Marius Moutet, Minister for Overseas Territories. A lawyer, socialist, and President of the Departmental Council of Drôme, Marius Moutet was appointed as Minister of French Overseas Territories under the Gouin, Bidault, Blum, and Ramadier governments, from January 1946 to October 1947. During this mandate, he led three particularly noteworthy initiatives: the elimination of forced labour; the abolition of the “indigénat” (the regime of administrative sanctions applied to colonial subjects); and the enactment of the frst labour code for all overseas departments. He therefore contributed signifcantly to the evolution of the status of colonised peoples, a task which he had already begun before the war, as Minister of the Colonies. Biography taken from the Dictionary of French Parliamentarians from 1889 to 1940 (Jean Jolly). URL: https://www2.assemblee-nationale.fr/ sycomore/bio/(num_dept)/5466.
18. OFPRA Archi ves, Otto SCHULZE WOLS GEN 1516.
19. Certifcate from the CIR, French Delegation, ibid
20. Letter signed by the Deputy Head of the OIR, addressed to Otto Schulze Wols, ibid
would fall to the future OFPRA. Likely for this reason, on June he flled out an assistance request form at the OIR. The OIR’s forms could be used to request both administrative protection and financial assistance.
In this regard, Wols’ case differs from the previous one inasmuch as he objected to being repatriated in Germany on economic and artistic grounds. The OIR investigator noted that: “Objections to repatriation: economic reasons (is well known as a painter in France); does not wish to return to Germany despite having family there, since his friends in the French art world are more essential to him than the ones he has in Germany 21 .” Protection was duly granted and he received 360,000 euros in compensation thanks to the intervention of the Protestant chaplaincy, his fle having been sent to the SSAE. This exclusive fnancial perspective is reinforced by the fact that the artist obtained French nationality in 1949. It is important to note that the painter, who was an alcoholic, had been in great diffculty for several years. He died of food poisoning in .
Wols’ situation could be seen to be representative of the question considered in this article: even if he did not mention artistic freedom as a reason for not wishing to be repatriated to Germany, he nonetheless stressed his need to remain in the artistic environment he had discovered in France. His mental and physical health may also have contributed to this decision to seek protection.
Close to Surrealism, Wols is considered as a pioneer of European lyrical abstraction and a representative of tachisme and informalism. Nowadays, he is much better known than François Will Wendt 22 .
Arnold Daghani (1909–1985)
Arnold Daghani 23 was born Arnold Korn on February , in Suczawa, Bukovina (AustroHungarian Empire, now Suceava in Romania) to
21. Ibid
22. “Wols: retrospective”, exhibition catalogue, Kunsthalle Breme, and The Menil Collection, 2013, with essays by Ewald Rathke, Toby Kamps, Patrycja de Bieberstein Ilgner, and Katy Siegel Rathke.
23. Deborah Schultz, Edward Timms, Pictorial Narrative in the Nazi Period: Felix Nussbaum, Charlotte Salomon and Arnold Daghani, London, Routledge, 2016; Deborah Schultz, “Displacement and identity: Arnold Daghani”, in ARTMARGINS, 2002 [online]. URL: https://artmargins.com/displacement-andidentity-arnold-daghani/
32
LE POINT SUR | ARTISTIC FREEDOM AND EXILE
germanophone Jewish parents. He showed great artistic promise at school, and went on to attend an art school in Munich. At the age of , he was drafted into the army. After his release in the early s, he worked as an assistant for a publisher in Bucharest. While married and living in Czernowitz, on 7 June 1942 Daghani was deported to Transnistria, and then to Ladyjin, near the River Bug. There, the couple was rounded up on August and taken to the forced-labour camp Mikhailowka in south-west Ukraine, where they worked for the Todt Organisation.
In the camp, Daghani was able to continue producing some drawings and paintings. He managed to preserve them and they proved a key factor in his survival: some of the guards asked him to paint their portraits, while he managed to win the favour of some others by making decorative objects for them. While in the camp, Daghani wrote a journal – published in French in 2019 24 – which immerses the reader into the Shoah as it raged across Romania and the Ukraine: “during a time of historical upheaval when the advance of the Russians was followed by that of the Germans, joined by the Romanian dictator Antonescu 25“. In July 1943, while working on a mosaic representing the German eagle, he fed with his wife, assisted by the local Jewish resistance. In the Bershad ghetto, they learnt that all their campmates had been exterminated.
The couple moved to Bucharest in March 1944, which led to some diffculties in Arnold Daghani’s artistic life. Because of his refusal to join the Union of Artists and Sculptors along with his rejection of socialist realism in art, he could not exhibit his works in an offcial manner. To earn a living, he taught English; his wife taught French. In the end, he joined the official trade union in , but he kept his distance 26 . His drawings and paintings of human fgures did not ft with the glorious visions of socialist realism, and he also painted nudes, a theme disapproved of by socialist artistic dogmas 27. As a result,
24. Arnold Daghani, La tombe est dans la cerisaie. Journal du camp de Mikhaïlovka (1942-1943), translated from the Romanian and German by Philippe Kellmer, followed by an interview with Philippe Kellmer and Marc Sagnol, Paris, Fario, 2018. The journal was published in Romania in 1947.
25. Claude Mouchard, “Du fond de l’enferk”, in En attendant Nadeau, 29 January 2019.
26. Protection request form, OFPRA Archives, Arnold and Anna DAGHANI D 5.
27. “A large, a big question mark”, 1968, unpublished notebook, Arnold Daghani Collection, C39.41r., cited by Deborah Schultz, op. cit
the artist dreamed of joining “the free world” and becoming part of the modernist artistic movements under way. Even his work on the camp was criticised for not being dark or dramatic enough, since he chose to represent the dignity of the deportees rather than the executions and atrocities. “ Since I have kept myself to myself, refusing to take part in any artistic events, I have been classed as a reactionary, while what I really am is a humanist, someone who simply puts human interests frst. Behind the iron curtain, nothing can exist besides the Party. I refuse to bow down to it 28”, wrote Daghani in his memoirs.
Religion was also very important for Daghani, and he had ties with Eastern Orthodox Christianity. His works from the s depict priests, monks, and church interiors. He produced some stained glass windows for the Church of the Good Shepherd in Bucharest, and in he was invited to exhibit his work at the Palace of the Patriarchate. Although the authorities tolerated the Church, at the time Daghani was a member of the Union des Artistes, and in his notebooks he mentions that the artist and critic Oskar Walter Cisek was “unyielding ” in his insistence that he not exhibit his work there: “No exhibitions of sacred art. The authorities and the Union of Artists and Sculptors, of which I am a fully-fedged member, would take a dim view of any such an exhibition.” In the end, the exhibition did go ahead, but “behind closed doors”, solely for the Patriarch, archbishops, bishops, and some of Daghani’s friends 29
In , Daghani and his wife Nanino emigrated to Israel. As he wrote in his notebooks, however, this was not what the painter really wanted, especially since, before leaving, they had heard the Romanian artist Vilma Badian say she was not happy there and could not stand the “cooperative basis” of the Ein Hod community 30
Arnold Daghani arrived in France in April . In his application for protection, which he submitted to OFPRA on March , he declared that, having left Romania for Israel in , he and his wife had automatically become Israelis but that they left the country after one year and nine months to travel frst to Switzerland and then to France, where they settled in Vence. His motivations centred on his artistic work: “The reason we left Israel was that, as a VISUAL ARTIST,
33 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
28. Ibid 29. Ibid 30. Ibid
my career was held back by the fact that most of my work has been dedicated to Christian Art. Meanwhile, I had entered the Church through baptism 31 .” As their passports would not remain valid unless they returned to Israel “for a period of time”, he deemed that, “as a Christian, or rather as a baptised Jew, I no longer class as Jewish, and, if I were forced to return to Israel, that would prove a fundamental impediment to my obtaining another passport to leave again 32 ”. They ended the letter by asking to be recognised as refugees. They enclosed a number of documents (newspaper clippings, letters, etc.) attesting to the cold reception his art would be met with in Israel. The fle was processed by the Romanian section, who responded that they could not protect the couple since they held Israelian nationality. They did not respond to the question about their potential persecution on the grounds of artistic freedom 33 . On 17 February 1968, Daghani replied that the Consulate no longer considered him and his wife as Israelis. They then asked him to provide the letter from the Israeli Consulate, as their stateless status needed to be legally established. Arnold Daghani provided the letter, as well as witness statements. He was recognised as a stateless person of Israeli origin on 20 March , notifed, on this occasion, by the Offce of Stateless Persons of OFPRA, directed by Angèle Kovalsky 34 . Arnold Daghani lived in Switzerland from to , before moving to Great Britain in , where he died on April in Hove (Brighton), eight months after his wife.
A multifaceted artist best known for his writings and drawings, he produced over 4,000 works in total 35 His works are held in public British collections, notably the Ben Uri collection, held by the University of Surrey and the University of Warwick. In its Arnold Daghani collection, the University of Sussex holds a total of 6,000 pieces, including letters and works of prose by the artist. In 2012, Daghani was one of twenty-one artists featured in Last Portrait: Painting for Posterity, presented by Yad Vashem (an Israeli museum commemorating the Holocaust) in Jerusalem.
Suzanne Murh (1928–1999)
Suzanne Muhr was born on January in Budapest, Hungary. She trained at the Academy of Fine Arts between and . An abstract painter who also worked with India ink, she exhibited her work in at the Galerie Colette Allendy, in Paris’s 16th arrondissement 36 , but now seems to have been forgotten about.
When she arrived in France in , Suzanne Muhr was taken in by the OIR on December37, and the protection was extended by OFPRA until she was granted French nationality in 1966 38 . In her frst application for protection, the OIR eligibility officer transcribed her motivations thus: “ By refusing to repeat the communist slogans and praise the (illegible) and the (illegible), which she detests, she has made enemies at the Hungarian Academy of Fine Arts. Fearing persecution, she fed Hungary 39 .”
31. Asylum application form, OFPRA Archives, Arnold and Anna DAGHANI, D5.
32. Ibid
33. Letter dated 17 March 1966, OFPRA Archives, Arnold and Anna DAGHANI, D5.
34. Born in Mariupol in Ukraine, Angèle Kovalska (born Roux), the wife of Nicolas Kovalsky, also a refugee and protection ofcer, began her career in 1938 as a secretary in the French Delegation of the High Commissioner for Refugees of the League of Nations. During the years she spent in this institution, especially after the debacle and during the period of German occupation, we know she played an active role in continuing activities that supported the international protection of refugees, before being appointed as Executive Secretary at OFPRA, ofcially from 1 January 1953 and later, in 1958, Protection Ofcer responsible for the Stateless Persons Section, a mission she upheld until 6 December 1974, when her appointment at OFPRA was terminated. Diego Suarez Gomez, “Administrer l’apatridie, synthèse des textes juridiques et pratiques administratives en France (1952-1960)”, forthcoming.
35. David Buckman, “Artists in Britain Since 1945”, Art Dictionaries Ltd, part of Sansom & Company, cited on: https://artuk.org/discover/artists/daghani-arnold-19091985.
Suzanne Muhr passed through Austria and Germany before arriving in France. She is one of many people displaced after the Second World War. Her OFPRA fle includes a handwritten copy of a certifcate of eligibility from the Preparatory Committee of the OIR, which mentions her presence in the American occupation zone in April . There are also some documents about her in the Arolsen Archives, notably her card from camp XVII Azberbergasse in Vienna
36. M.-C. L., “Au fl des galeries”, in Le Monde, 31 December 1954.
37. Certifcate from the French Delegation of the OIR, OFPRA Archives, Suzanne MUHR GEN966.
38. Information concerning refugees and stateless persons, intended for OFPRA. Police Préfecture, 15 April 1966. OFPRA Archives, ibid
39. Form from the French Delegation of the OIR, 29 November 1950, ibid
40. Document ID: 80757035 - ZSUZSANNA MUHR. URL: https://collections.arolsen-archives.org/undefned.
41. Archives Arolsen, ID: 68353629 - Susanne MUHR.
34
LE POINT SUR | ARTISTIC FREEDOM AND EXILE
(Austria) 40 , which specifes that she is a “visual artist” and that she arrived in Austria on March . She declared that she wished to go to France 41 . Other documents reveal that she was subsequently placed in a resettlement centre, Nellingen 42 , by the OIR, where, according to the handwritten copy of the document included in her OFPRA fle, she was granted eligibility on July . Suzanne Muhr’s experience is very similar to that of Judit Reigl, which is also mentioned in the exhibition, except that Reigl was assisted by a Hungarian artist protected by OFPRA, Simon Hantaï.
From what can be deduced from these archives, Suzanne Muhr’s case suggests that an artist’s exile can be driven entirely by a threat to their artistic practice, and nonetheless be presented as part of a broader context by the administration in charge of determining his/her eligibility, as demonstrated by the protection offcer regarding the artist’s refusal to return to Hungary on “political grounds”43 . This
appears to illustrate both the links between artistic practice and political opinions, including those attributed to them by the powers that be, and the fexibility with which international texts on refugees can be interpreted. Lastly, in her situation, as in those of the frst two artists discussed, material assistance was needed in the postwar years: Suzanne Muhr relied on assistance from the Committee on Hungarian Refugees, and applied to have documents free of charge and for fnancial assistance 44
The trajectories of these four artists, who were active in France in the period to , underscore the complex links between artistic practice and political power and opinion, especially in a period during which the notion of offcial art was so dominant. It also reveals the rarely discussed link between the international protection of refugees and stateless persons and artists, which we hope will open up new avenues of research.
35 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
Traduction en anglais Victoria Weavil
42. Zone II (Nellingen, Stuttgart).
43. Assistance request form, OFPRA Archives, Suzanne MUHR GEN966.
44. Letter from the Committee on Hungarian Refugees dated 25 February 1955. OFPRA Archives, Suzanne MUHR GEN966.
 X Vue de l’exposition permanente du Museu da Imigração de São Paulo (Brésil).
X View of the permanent exhibition of the Immigration Museum (Brazil). © Museu da Imigração de São Paulo.
X Vue de l’exposition permanente du Museu da Imigração de São Paulo (Brésil).
X View of the permanent exhibition of the Immigration Museum (Brazil). © Museu da Imigração de São Paulo.
Les musées des migrations dans le monde
La Coalition internationale des sites de conscience (CISC) est un réseau international de sites historiques, de musées et d’initiatives de mémoire reliant les luttes passées aux mouvements contemporains pour les droits humains et la justice sociale. Ses fnancements, son réseau et ses formations permettent à des sites du monde entier d’impliquer leurs communautés dans la construction d’un avenir plus pacifque. La Coalition comprend plus de membres dans plus de pays. À partir d’une chronologie des musées appartenant à ce réseau, il s’agit de réféchir aux enjeux liés à la trajectoire, à la complexité et à la possibilité de l’existence de musées des migrations.
Créé en afn de favoriser le partage d’expériences et soutenir les pratiques des musées dédiés à la migration, le Réseau des musées des migrations (RMM) de la Coalition internationale des sites de conscience (CISC) comprend musées dans le monde et un membre académique. Le réseau imagine des sociétés ouvertes et multiculturelles où la mobilité humaine est un droit universel. Son objectif est de contribuer à la création d’un avenir pluriel dans le respect, la justice, la citoyenneté active et l’équité pour tous.
Quatre thèmes structurent ma réfexion : les musées de l’immigration, les musées de l’émigration, les musées des migrations et les musées confrontés à des histoires migratoires diffciles. En tissant des liens entre ces éléments, j’espère ouvrir des pistes et interroger la manière dont les musées des migrations peuvent être des musées du partage.
Le boom des musées de l’immigration
Les musées de l’immigration représentent % du RMM et ont émergé entre les années 1980 et les années 2000, environ un siècle après le début des migrations qu’ils représentent. Cette tendance est
peut-être due à l’expansion du domaine des sciences sociales dans les années 1970 et 1980, constituant une réponse à une demande grandissante de consolider et d’honorer la position des migrants dans les sociétés qu’ils avaient rejointes. L’impact de l’immigration sur les lieux d’arrivée et les sociétés d’accueil ont pu déclencher ce que Joachim Baur a décrit en 2003 comme « une réaction à la crise des narrations capables de promouvoir le vivre-ensemble et à la diversifcation des identités culturelles. En représentant l’immigration comme une expérience socialement unifcatrice, les musées construisent un récit d’ensemble de la migration, et de cette façon, ils participent à réviser l’image de la communauté nationale » en « représentant l’immigration comme un récit épique et choral, capable de créer de l’intégration 2 ».
% des musées de l’immigration du RMM se sont d’abord concentrés sur les mouvements de
1. Article initialement publié dans Hommes & Migrations, n° 1340, 2023, pp. 17-24.
37 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
Gegê Leme Joseph, directrice de programmes senior, Afrique, Amérique latine et Caraïbes, International Coalition of Sites of Conscience, coordinatrice du Migration Museums Network1
2. Joachim Baur, « Il museo dell’immigrazione », in Luca Basso Peressut, Francesca Lanz, Gennaro Postiglione (dir.), European Museums in the 21st Century: Setting the Framework, vol. 2., Milan, Politecnico di Milano, 2013, pp. 2-3.
populations venues d’Europe, d’Asie, du Pacifque ou du Moyen-Orient, mettant en lumière leurs expériences et leurs contributions aux sociétés des pays du « Nouveau Monde ». S’intéressant principalement à des périodes à partir du XIXe siècle, ils sont souvent situés dans des sites tels que des bureaux d’immigration, des hôtels et des stations d’immigration, créant un frein à l’inclusion des récits de personnes afro-descendantes ou des populations autochtones qui n’ont pas transité par ces sites en entrant ou en circulant dans ces pays.
Les musées lancés après le milieu des années 2000 ont accepté leur responsabilité sociale et ont répondu à des sujets contemporains brûlants, en parlant d’émigration tout en saisissant l’opportunité de faire des liens avec l’immigration contemporaine vers l’Europe.
Aujourd’hui, en réponse à la demande grandissante faites aux musées d’être socialement pertinents au sein de sociétés multiculturelles, les musées de l’immigration ont dépassé ces premiers récits et interprété les signifcations historiques et le symbolisme de leurs sites, les reliant à des communautés jusqu’alors sous-représentées, à des migrations contemporaines et à leurs impacts. Ils ont créé des liens essentiels entre passé et présent, ce qui n’est pas une tâche facile, car les expériences migratoires d’hier et d’aujourd’hui ne forment pas un ensemble homogène. Rigoureux dans leurs efforts de ne pas laisser le passé être interprété au prisme des nécessités du présent, ces musées examinent des récits auxquels donnent forme des expériences réelles, conçus avec, par, et pour les populations migrantes.
Il est important de noter que seulement % environ des musées d’immigration du RMM se trouvent en Europe. Ceci refète sans doute une nécessité pour le RMM d’élargir le nombre de ses membres localement, mais révèle également une lacune thématique parmi les musées européens, soumis aux difficultés et aux tensions liées aux récits migratoires de leurs régions.
Le développement des musées d’émigration
Les musées dédiés à l’émigration dans le RMM sont apparus après , date de l’inauguration de la
Maison allemande de l’émigration de Bremerhaven. Le projet d’explorer les histoires des , millions de personnes qui ont quitté Bremerhaven après 1830 pour commencer une nouvelle vie ailleurs a été lancé en . Aujourd’hui, les visiteurs sont invités à découvrir l’Allemagne comme une « nation d’immigrants » et un pays en transition, à travers les différents récits, perspectives, objets et luttes sociales qui ont façonné la nation allemande depuis 1949 3
L’Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni (Mu.MA) a également été inauguré en à Gênes (Italie), une ville que des millions d’Italiens ont quittée défnitivement pour rejoindre les Amériques, l’Afrique, l’Asie et l’Australie, au prix de multiples périples. Il s’agit d’un centre culturel lié aux thèmes de la mer, du voyage, du dialogue entre les peuples, les savoirs et les religions. En 2022, le Mu.Ma a lancé le Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana 4 , retraçant, à travers les histoires de vie des migrants, les multiples récits de la migration italienne, de l’époque précédant l’unifcation italienne à nos jours.
Le Red Star Line Museum d’Anvers (Belgique) a ouvert en , et « raconte une histoire universelle d’espoir, de rêves, et de la quête du bonheur, fondée sur les récits personnels d’émigrants du XXe siècle 5 ». En s’appuyant sur l’histoire de l’émigration européenne d’Anvers vers l’Amérique, le musée encourage la réfexion et le dialogue sur la migration passée, présente et future, reliant les récits personnels des migrants aux thèmes et aux problématiques sociales contemporaines.
Depuis , le Muzeum Emigracji w GdyniMusée de l’émigration de Gdynia (Pologne) raconte l’histoire de migrations et de destins polonais dans le monde entier, en lien étroit avec la réalité contemporaine. Le musée considère que l’histoire de l’émigration continue de s’écrire chaque jour, et combine l’histoire partagée des Polonais au dialogue actuel avec les immigrants en Pologne. Pour ce musée, les migrations ne sont pas une histoire statique, mais un processus dynamique prenant place parallèlement à nos vies, avec un impact mondial 6 En , le l’Irish Emigration Museum (EPIC) a été fondé à Dublin afn de permettre à des personnes
3. Url : https://dah-bremerhaven.de/en/about-us.
4. Url : https://www.museidigenova.it/en/muma ; https://www. museidigenova.it/en/mei-museum-italian-emigration.
5. Url : https://redstarline.be/en/content/museum.
6. Url : https://polska1.pl/en/knowledge/idea/.
38
LE POINT SUR | LES MUSÉES DES MIGRATIONS DANS LE MONDE
de toutes origines d’explorer l’histoire, la culture et l’identité irlandaise à travers le récit de l’émigration 7 millions de personnes dans le monde se réclament d’une ascendance ou d’un héritage irlandais, avec un rôle dans le développement culturel, politique et économique à la fois de l’Irlande et des communautés où les migrants se sont installés 8 . Le musée a répondu à un besoin marqué des communautés émigrantes irlandaises d’avoir une institution culturelle qui reconnaisse le rôle que la migration a joué dans la défnition de l’identité irlandaise, ainsi que l’importance de la diaspora irlandaise.
Les cinq musées de l’émigration du RMM ont émergé dans le milieu des années 2000 et sont tous situés en Europe. Ils célèbrent le nombre important d’Européens qui ont émigré aux siècles précédents et rappellent aux Européens les épreuves auxquelles ont dû faire face leurs prédécesseurs. Ils considèrent également les récits de résilience des migrants et l’empreinte qu’ils ont laissée dans les sociétés d’arrivée, évoquant les liens au contexte européen, et rappelant que la circulation des populations nous rassemble à
7. Url : https://epicchq.com/explore/history-and-vision/.
8. Url : https://epicchq.com/explore/history-and-vision/.
travers les frontières, et relie également nos lieux de vies, nos cultures, nos économies, etc.
Les musées lancés après le milieu des années 2000 ont accepté leur responsabilité sociale et ont répondu à des sujets contemporains brûlants, en parlant d’émigration tout en saisissant l’opportunité de faire des liens avec l’immigration contemporaine vers l’Europe. Ce faisant, ils rencontrent un défi constant, celui d’assurer que les récits d’émigration passés ne soient pas idéalisés, instrumentalisés pour créer de la sympathie et de l’ouverture envers les immigrants d’aujourd’hui, et de faire honneur à la complexité qui traverse les problématiques présentes et passées de l’identité, des géographies mouvantes, des histoires et des cultures interconnectées, dans un cadre de diversité, d’équité et d’inclusion.

L’émergence des musées des migrations
Les musées se concentrant sur la migration ont émergé plus récemment, mettant l’accent sur la circulation des populations comme un continuum
39 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
X Vue extérieure du Deutsches Auswandererhaus à Bremerhaven (Allemagne). X Exterior view of the Deutsches Auswandererhaus in Bremerhaven (Germany). © Werner Huthmacher/Deutsches Auswandererhaus.
Chronologie des musées de l’immigration du RMM
Le musée le plus ancien du RMM est l’Angel Island Immigration Station, à San Francisco (États-Unis), qui a ouvert ses portes en 1983. Son objectif est de sensibiliser à l’expérience de l’immigration vers les États-Unis à travers le Pacifique et à l’histoire complexe de l’immigration aux États-Unis. Il incite à apprendre du passé pour assurer que les ÉtatsUnis d’aujourd’hui « tiennent leur promesse de liberté 9 ».
Le Museo de la Inmigración de Buenos Aires (Argentine) a été fondé en 1985 sur le lieu de l’ancien Hôtel des immigrants, pour représenter, à la demande de la société civile, l’expérience de ceux venus d’Europe, d’Asie et d’Afrique à partir du XIXe siècle 10 . En , il a élargi sa portée afn de lier cette histoire à la migration contemporaine en Argentine, en abordant notamment la migration régionale.
Le Migration Museum d’Adélaïde a ouvert ses portes en 1986, avec pour sujet l’histoire de l’immigration et de la colonisation en Australie du Sud, un thème complexe entremêlant colonialisme, immigration, peuples aborigènes et histoires minoritaires. Aujourd’hui, le musée « travaille à la protection et à la compréhension des diverses cultures de l’Australie du Sud, fournissant un lieu où découvrir les nombreuses identités de ses peuples à travers les histoires des individus et des communautés 11 ». Localisé au sein d’un complexe de bâtiments coloniaux, le musée n’hésite pas à aborder les relations complexes entre le lieu, la migration et l’héritage colonial australien.
En , le Wing Luke Museum of the Asian Pacifc American Experience a ouvert à Seattle, succédant à la Fondation mémorielle Wing Luke établie en 1967. Devenu en 2008 le Musée Wing Luke de l’expérience asio-océano-américaine, son objectif est de faire découvrir l’histoire dynamique, les cultures et l’art asio-américains, hawaïens et des îles du Pacifque, afn de promouvoir la justice raciale et sociale 12
Le Lower East Side Tenement Museum de New York a été fondé en afn d’explorer l’histoire migratoire unique des États-Unis, et la richesse et la diversité du paysage qu’elle continue à créer13 . Situé dans un immeuble délabré qui était condamné depuis plus de cinquante ans, le musée est issu
d’une initiative privée ; son intérêt pour l’histoire sociale l’a poussé à devenir le fer de lance de la création du CISC en . Vingt ans plus tard, en partenariat avec le CISC, il a joué un rôle clé dans la mise sur pied du RMM.
L’Ellis Island National Museum of Immigration, situé à New York (États-Unis), a ouvert en 1990.
« Monument vivant à l’histoire du peuple américain », abrité par le bâtiment principal de l’ancien complexe d’immigration, le Musée national de l’immigration retrace l’histoire de la mobilité humaine, à travers une multitude de périples d’immigrants, afn de dire quelque chose de l’identité américaine. Aujourd’hui, Ellis Island demande à ses visiteurs d’examiner leurs propres histoires et de réféchir à la manière dont ils trouvent leur place dans le monde moderne 14 .
En projet depuis 1990, soutenu par des associations d’historiens et de militants, le Musée national de l’histoire de l’immigration de Paris, né de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration, a été ouvert au public en 200715 . Il se concentre sur l’histoire de l’immigration, la promotion et la reconnaissance de son rôle dans la France d’hier et d’aujourd’hui, et des questions à l’intersection de thèmes tels que la législation, la démographie, l’économie, la vie quotidienne, la culture, l’art, mais aussi le racisme, la discrimination, et le lien avec l’esclavage et la colonisation. Il est hébergé par le Palais de la Porte dorée, un bâtiment ayant des liens forts avec le passé colonial de la France, que le musée s’efforce de problématiser.
Le Museum Zeche Hannove d’Hanovre (Allemagne) a ouvert en 1995 et se concentre sur l’histoire industrielle, culturelle et sociale de la région, en mettant un accent particulier sur la manière dont les populations immigrantes, notamment polonaises, italiennes et turques, ont développé leurs propres us et coutumes, laissant des traces culturelles qui persistent encore aujourd’hui parmi les habitants d’Hanovre 16 .
En 1997, le Flugt, Refugee Museum of Denmark (Danemark) a été inauguré à Farum, proposant à ses visiteurs un éclairage sur les populations qui, au cours de l’histoire, ont migré vers le Danemark dans l’espoir de trouver travail, amour, richesses ou
40
LE POINT SUR | LES MUSÉES DES MIGRATIONS DANS LE MONDE
sécurité, ainsi que sur les populations qui furent invitées au Danemark pour apporter leurs savoirs ou leur force de travail. Le musée s’intéresse également à l’histoire de la société danoise et aux personnes que les nouveaux arrivants y ont rencontrées, mettant en lumière les relations tissées et la manière dont elles donnent forme aux Danemark d’aujourd’hui 17 .
En 1998, l’Immigration Museum de Melbourne (Australie) a vu le jour sur les lieux de l’ancien Centre administratif de l’immigration et du commerce, un site d’une grande complexité historique, afn de sonder l’histoire de l’immigration dans le Victoria. Aujourd’hui, il « explore les histoires, récits, et problématiques contemporaines des communautés multiculturelles du Victoria, et ce qui nous relie tous comme êtres humains. Il aborde les thèmes de la migration, de l’identité, de la nationalité et de la communauté à travers des perspectives multiples. Il interagit avec les communautés et avec des professionnels créatifs afn de créer des occasions puissantes de rencontre, d’empathie et de débat18 ».
Le Museu da Imigração à São Paulo (Brésil), qui date également de 1998, est situé dans le bâtiment qui abritait auparavant l’Hôtel des immigrants. Il se concentrait au départ sur la thématique de la « grande immigration » de jusqu’au XXe siècle, une période où ont lieu un nombre record d’enregistrements d’immigrants venus d’Europe, du Moyen-Orient, d’Asie et du Pacifique. Le musée donne à voir les lieux d’où venaient ses immigrants, et ceux où ils sont arrivés, leurs expériences et leur rôle dans la construction de la São Paulo contemporaine19. Après , confronté aux fux d’émigration touchant le pays, son sujet s’est élargi aux migrations contemporaines, au droit de migrer, et plus récemment aux histoires de migrations anciennes ou actuelles passées sous silence au Brésil.
Le Musée canadien de l’immigration, situé au Quai à Halifax, a été fondé en ; c’est un musée national dédié à l’histoire de l’immigration au Canada, d’hier et d’aujourd’hui, de la côte Est jusqu’à la côte Ouest. Le projet a été développé à partir d’initiatives civiles datant de 1999, et se trouve au Quai 21, dans le port de Halifax, où presque un million d’immigrants sont arrivés au Canada entre 1928 et 1971. Il enrichit la compréhension du public
face aux parcours courageux, pleins d’espoirs, d’épreuves et de résilience au cœur de l’expérience immigrante, et leur fait honneur, soulignant leur rôle vital dans la construction de la culture, de l’économie et des coutumes canadiennes 20 .
Depuis son ouverture en 2005, le Arab American National Museum (AANM) est le premier et le seul musée aux États-Unis dédié à la documentation, à la préservation et à la présentation de l’histoire, de la culture et des contributions arabo-américaines. Leurs expositions s’intéressent au monde arabe et à l’histoire des Arabo-Américains depuis les premières vagues d’immigration à la fn du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui 21 .
Enfn, dernier de cette série, le Le Tea Plantation Workers’ Museum & Archive a été créé en 2007 à Paradeka Gampola (Sri Lanka) afin d’ouvrir la discussion sur l’immigration régionale de l’Inde vers le Sri Lanka. Ce musée local, imprégné d’une culture de défense des droits humains, de droit du travail et d’égalité des genres, a été mis sur pied afn de protéger et de préserver l’héritage culturel des premières communautés de travailleurs du thé, d’aborder les sujets de l’identité et de l’assimilation, et de relier cette histoire aux droits des migrants et des travailleurs aujourd’hui 22
9. Url : https://www.aiisf.org/aiisf-history#:~:text=AIISF’s%20 Mission%20Statement&text=AIISF%20collects%20and%20 preserves%20the,education%20initiatives%20and%20public%20 programs.
10. Url : https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones/ museo/el-museo.
11. Url : https://migration.history.sa.gov.au/about/.
12. Url : https://www.wingluke.org/our-mission.
13. Url : https://www.tenement.org/about-us/.
14. Url : https://www.statueofiberty.org/foundation/missionhistory/.
15. Url : https://www.palais-portedoree.fr/en/the-museenational-de-l-histoire-de-l-immigration.
16. Url : https://zeche-hannover.lwl.org.
17. Url : https://www.danishimmigrationmuseum.com/ the-museum/.
18. Url : https://museumsvictoria.com.au/ immigrationmuseum/about-us/.
19. Mariana Esteves Martins, « Museu da Imigração como espaço de discussão e prática de direitos », in Revista Eletrônica Ventilando Acervos, vol. 4, n° 1, 2016, pp. 83-91.
20. Url : https://pier21.ca/about/about-museum.
21. Url : https://arabamericanmuseum.org/about/.
22. Url : https://www.isdkandy.org/tea-museum/.
41 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
entre passé et présent, transcendant la binarité immigration-émigration.
En , le Migrations Museum (Royaume-Uni) a été lancé afn d’explorer l’infuence des mobilités de population depuis et vers la Grande-Bretagne à travers les époques sur les individus, les communautés et la
Il existe actuellement une lacune dans le traitement par les musées migratoires du commerce triangulaire comme un récit de migration forcée et de l’impact des récits présents qui en découlent sur l’Afrique et la diaspora, qu’il nous faudra examiner attentivement si nous voulons devenir des musées partagés.
nation. Il répond à une lacune dans le paysage muséal britannique, où l’on ne s’était pas encore intéressé de manière exhaustive à la migration en tant que problématique contemporaine urgente, au centre de débats politiques polarisés. Il met en lumière l’identité des Britanniques, leurs origines et leurs destinations 23
23. Url : https://www.migrationmuseum.org/about-our-project/.
Le Partition Museum, la plus jeune institution du RMM, a ouvert ses portes en à Amritsar (Inde). C’est un excellent musée pour clore cette chronologie : premier Musée de la Partition au monde, il est né d’une initiative de la société civile, menée par des Indiens et des Pakistanais désireux de raconter leurs récits personnels concernant l’un des événements les plus déterminants du sous-continent indien, qui a occasionné la migration de masse la plus importante de l’histoire jusqu’à nos jours. Malgré le nombre important des victimes et les colossales pertes de propriété, soixante-dix ans plus tard, aucun mémorial ni musée n’avait encore été érigé à la mémoire de la Partition 24 . Étant donné le contexte historique, le musée dépasse la distinction entre immigration et émigration, mettant l’accent sur le mouvement et le déplacement des populations.

Récits migratoires diffciles
Sur le sujet des récits migratoires diffciles, la Maison des esclaves, au Sénégal, est le plus ancien musée de notre réseau. Établi en 1962, il est l’un des
24. Url : https://www.partitionmuseum.org/about-us/.
25. Url : https://www.sitesofconscience.org/membership/ maison-des-esclaves/.
42
X Vue de l’Hôtel de ville qui abrite le Partition Museum à Amritsar (Inde).
X View of the City Hall which houses the Partition Museum in Amritsar (India). © Joy Nk/D.R
LE POINT SUR | LES MUSÉES DES MIGRATIONS DANS LE MONDE
neuf membres fondateurs de la CISC, et il relate les récits personnels relatifs à un domicile privé, ainsi que le rôle de ses propriétaires dans le commerce local et le commerce triangulaire 25 . Depuis , il s’est engagé dans un projet de revitalisation, afn d’assurer que la maison des esclaves historique déploie son potentiel en tant que dépositaire de savoirs sur le commerce triangulaire et catalyseur du dialogue sur la mémoire de cette migration forcée et sur les problématiques en lien avec celles auxquelles nous sommes confrontés aujourd’hui.
Enfn, des sites comme le Cape Coast Castle Museum, dirigé par le Conseil des musées et monuments du Ghana, sont actifs depuis les années , et se concentrent sur l’arrivée des Européens en Afrique, ainsi que sur leurs interactions avec les communautés locales et la région du Centre au Ghana, dans le contexte du commerce triangulaire. Ils plantent également le décor pour les interactions entre les populations restées sur le continent africain et celles de la diaspora 26
Les musées migratoires sont confrontés au déf d’aborder des histoires difficiles reliant le

colonialisme, la migration, l’esclavage et les diasporas. Il existe actuellement une lacune dans le traitement par les musées migratoires du commerce triangulaire comme un récit de migration forcée et de l’impact des récits présents qui en découlent sur l’Afrique et la diaspora, qu’il nous faudra examiner attentivement si nous voulons devenir des musées partagés.
Réfexions fnales
Quels enseignements pouvons-nous tirer des musées du RMM et de leurs pratiques, afn d’atteindre l’objectif d’être des musées partagés ?
Les musées dédiés exclusivement à la migration dans le RMM ont émergé relativement récemment, en grande partie à partir d’initiatives pilotes à petite échelle issues de la société civile. En tant que Sites de conscience, ce sont des musées socialement responsables qui travaillent à la croisée de l’histoire, de l’anthropologie, de l’ethnographie, de la politique, de la sociologie et des arts pour raconter de quelle manière la circulation passée et présente des peuples donne forme au monde que nous connaissons, de l’échelle locale jusqu’à l’échelle internationale.
Au-delà de l’immigration ou de l’émigration, les musées des migrations portent sur la circulation des
43 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
26. Url : https://www.ghanamuseums.org/cape-coast-museum. php.
X Vue générale du Muzeum Emigracji à Gdynia (Pologne). X General view of the Emigration Museum in Gdynia (Poland). © Bogna Kociumbas/Muzeum Emigracji w Gdyni.
populations et ses conséquences sur les sociétés. Surmonter les dissonances et les tensions dans ces récits peut être considéré soit comme la recherche d’une univocité, soit comme celle d’une pluralité dynamique de voix, d’expériences et de récits. Les récits unifés risquent de privilégier une perspective aux dépens d’une autre et de mener à ce que l’autrice nigériane Chimamanda Ngozie Adichie appelait en les « histoires uniques 27 », des récits simplistes, incomplets et souvent erronés, excluant les expériences, les besoins et les voix de groupes minoritaires, conduisant à terme à une rhétorique clivante, des stéréotypes négatifs, de la discrimination, de la haine et de la violence. Laisser la place à l’identifcation et à l’amplifcation de compréhensions partagées parmi des perspectives diverses est un processus pouvant amener à jeter des ponts et à promouvoir la solidarité et la paix.
Il est nécessaire que les musées des migrations créent également un environnement permettant de partager la prise de décision avec les communautés concernées, à travers la co-création et la représentation de ces communautés au sein des équipes des musées, de la direction et des structures de gouvernance.
La force de réseaux tels que RMM et le CISC tient à leur capacité à échanger des pratiques, à apprendre de l’expérience des autres et à créer une voix collective, ce qui présente des difficultés en tant qu’institutions isolées. Le RMM reconnaît également la nécessité d’élargir la représentation de musées locaux, ancrés dans leurs communautés et citoyens, afn de promouvoir la diversité et de proposer une alternative aux récits stéréotypés.
Le concept de musées partagés implique enfn un rééquilibrage du pouvoir dans les récits contemporains sur la circulation des populations à l’échelle mondiale, ces récits étant encore racontés du point de vue des personnes disposant d’un fort pouvoir économique.
D’après des statistiques du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés datant de 2021, avant la guerre en Ukraine, pas moins de % des réfugiés déplacés vers d’autres pays étaient originaires de Syrie, du Venezuela, d’Afghanistan, du sud du
Soudan et du Myanmar, et % d’entre eux étaient accueillis dans des pays limitrophes considérés comme appartenant au Sud 28 . Malgré cela, l’accent est davantage mis sur la crise des réfugiés et des migrants dans le Nord, créant des perceptions déformées de l’impact des déplacements de population à l’échelle mondiale. De plus, tandis que les récits de violence, de déplacements forcés et de la migration de personnes originaires du Sud demeurent invisibles, les personnes déplacées au sein du Nord bénéfcient d’une grande solidarité et d’une couverture médiatique plus importante. Ceci renforce les processus historiques d’altérisation et de passage sous silence utilisés dans le passé pour légitimer la domination coloniale. Il est important que les musées des migrations ne participent pas à ces déséquilibres narratifs, et qu’ils s’efforcent au contraire de renverser ces représentations en proposant d’autres visions de l’histoire, au prisme des communautés migrantes marginalisées.
En tant que réseau international, le RMM a selon moi une position privilégiée pour établir des liens entre ces histoires et ces héritages, en partageant le pouvoir qui réside dans nos récits collectifs et en faisant usage de nos pratiques comme musées partagés.
Sites Internet :
Coalition internationale des sites de conscience (CISC)
https://www.sitesofconscience.org/ Réseau des musées des migrations (RMM)
https://www.sitesofconscience.org/ migrations-museum-network/.
https://www.unhcr.org/afr/fgures-at-a-glance. html.
44
Traduction de l’anglais réalisée par Gaëlle Cogan
27. Chimamanda Ngozi Adichie, The Danger of a Single Story, Produced by TED Talks, 2009.
LE POINT SUR | LES MUSÉES DES MIGRATIONS DANS LE MONDE
28. UNHCR, « Figures at a Glance », UNHCR, 2021.
Migration Museums around the World: the Main Issues
Gegê Leme Joseph, Senior Program Director, Africa, Latin America and the Caribbean, International Coalition of Sites of Conscience.
The International Coalition of Sites of Conscience (“ICSC”, or “the Coalition”) is an international network of historic sites, museums, and remembrance initiatives that connect past struggles with contemporary human rights and social justice movements. Thanks to the funding, network, and training it provides, the Coalition allows the local communities of sites across the world to help work towards a more peaceful future. The Coalition has over members, spread across more than countries. Through a chronology of the museums that belong to the network, this article will refect on the issues surrounding the trajectories, complexity, and viability of migration museums.
Created in 2019 to help share experiences and support the practices of museums dedicated to migration, the Migration Museums Network (“MMN”), which is part of the International Coalition of Sites of Conscience (“ICSC”, or “the Coalition”), is made up of museums worldwide as well as an academic member. The network is centred on a vision of open, multicultural societies where human mobility is a universal right. Its goal is to help create a pluralist future based on respect, justice, active citizenship, and equity for all. This refection will be structured around four areas: immigration museums; emigration museums; migration museums; and museums confronted with difficult migratory histories. By suggesting links between these different areas, I aim to open up new lines of thought and examine how migration museums could serve as sharing museums.
The boom in immigration museums
Immigration museums make up % of the MMN. They emerged between the 1980s and the 2000s, approximately a century after the migratory
movements they represent began. This trend may have been due to the boom in the social sciences in the 1970s and 1980s, in response to the growing call to consolidate and respect the position of migrants in their host societies. The impact of immigration on places of arrival and host societies triggered what Joachin Baur described, in , as: “a reaction to the lack of narratives that encourage living together and the diversifcation of cultural identities. By representing immigration as a socially unifying experience, museums build a narrative of togetherness around migration, thereby helping to alter the image of the national community” by “representing immigration as an epic, choral narrative capable of creating integration 1 ”.
Some % of the immigration museums in the MMN concentrated initially on the movement of peoples from Europe, Asia, the Pacifc, and the Middle East, drawing attention to their experiences and how
45 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
1. Joachim Baur, “Il museo dell’immigrazione”, in Luca Basso Peressut, Francesca Lanz, Gennaro Postiglione (dir.), European Museums in the 21st Century: Setting the Framework, vol. 2., Milan, Politecnico di Milano, 2013, pp. 2–3.
they contributed to the societies of the countries of the “New World”. Focusing on the 19th century onwards, they were often located in sites such as immigration offices, immigration stations and hotels, which obstructed the inclusion of narratives concerning people of African descent or indigenous people, since such individuals did not pass through these sites when entering or travelling through these countries.
Nowadays, in response to the growing call for museums to remain socially relevant within multicultural societies, immigration museums have moved beyond these early stories and begun to interpret the historic signifcance and symbolism of their sites by connecting them to formerly underrepresented communities, as well as to contemporary migration and the impacts it has. They have forged essential links between the past and present, wich is no easy task given that the migratory expériences of the past and present do not form a homogenous whole. Rigorous in their attempt to stop the past from being interpreted through the lens of contemporary needs, these museums examine narratives shaped by real experiences, which are conceived with, via, and for migrant populations.
It is important to note that only around % of the immigration museums on the MNN are located in Europe. This likely refects a need for the MNN to increase its members at the local level, but it also reveals a thematic gap among European museums, which are subject to the diffculties and tensions linked with the migration narratives of their regions.
The development of emigration museums
The museums dedicated to emigration in the MNN emerged after , which was the year when the German Emigration Centre in Bremerhaven was set up. Geared at exploring the histories of . million people who left Bremerhaven after 1830 to start a new life elsewhere, the project was launched in . Nowadays, visitors are encouraged to discover Germany as a “nation of immigrants” and a country in transition, through the different stories, perspectives, objects, and social struggles that have shaped the German nation since 2 . The Museum of the Sea and Migration (Mu.Ma) was also established in , in Genova (Italy), a town that millions of Italians left permanently to travel to the Americas, Africa,
2. URL: https://www.museidigenova.it/en/muma; https://www. museidigenova.it/en/mei-museum-italian-emigration.
Asia, and Australia, embarking on many different journeys. It is a cultural centre dealing with the themes of the sea, travel, the dialogue between peoples, knowledge, and religions. In 2022, Mu.Ma launched the Italian Emigration Museum 3 , tracing the multiple stories of Italian migration through the life stories of migrants, from the period preceding Italian unifcation up to the present day.
The Red Star Line Museum in Anvers (Belgium) opened in 2013, and “ tells a universal story of hope, dreams, and the quest for happiness, based on personal stories of 20th-century emigrants 4”. Starting from the historical story of European emigration via Antwerp to America, the museum encourages refection and dialogue about migration in the past, present and future, connecting the personal stories of migrants with current social issues and themes.
Since , the Emigration Museum in Gydnia (Poland) has told the story of migration and the fates of Polish people across the world, in close connection with the contemporary situation. The museum takes the view that the history of emigration continues to be written every day, and combines the shared history of Polish people with an ongoing dialogue with immigrants in Poland. For this museum, migration is not a static story, but rather a dynamic process taking place in parallel with our lives, with a global impact 5
In 2016, EPIC – the Irish Emigration Museum was established in Dublin with the goal of allowing people from all corners of the globe to explore Irish history, culture, and identity through the narrative of emigration 6 . Around million people all around the world claim Irish heritage or ancestry, which has an impact on the cultural, political, and economic development of both Ireland and the communities in which they settled 7. The museum has responded to the strong need for Irish people who have left the country to have a cultural institution that recognises the role migration plays in how we defne Irish identity, as well as the importance of the Irish diaspora.
The five emigration museums in the MNN emerged in the mid-2000s and are all located in Europe. They celebrate the large number of Europeans who emigrated in previous centuries and remind Europeans of the hardships their predecessors faced.
3. URL: https://redstarline.be/en/content/museum.
4. URL: https://polska1.pl/en/knowledge/idea/.
5. URL: https://epicchq.com/explore/history-and-vision/.
6. URL: https://epicchq.com/explore/history-and-vision/.
7. URL: https://www.migrationmuseum.org/about-our-project/.
46
LE POINT SUR | MIGRATION MUSEUMS AROUND THE WORLD: THE MAIN ISSUES
They also consider the stories of resilience of migrants and the mark they have left on their societies of arrival, highlighting the links with the European context, and recalling that the circulation of peoples brings us together across borders, and also connects our places of living, cultures, and economies, etc.
The museums established after the mid-2000s have accepted their social responsibility and responded to burning contemporary subjects by discussing emigration while at the same time establishing links with contemporary immigration to Europe. In so doing, they are confronted with a constant challenge: namely, how to ensure that the stories of past emigration are not idealised or exploited to create sympathy and openness towards immigrants nowadays, and how to do justice to the complexity of present and past issues of identity, shifting geographies, and interconnected cultures and histories, in a context of diversity, equity, and inclusion.
The emergence of migration museums
Museums concentrating on migration have emerged more recently, focusing on the circulation of populations as a continuum between the past and present, transcending the immigration-emigration binary.
In , the Migration Museum (United Kingdom) was established to explore how the movements of people to and from Britain across the ages has shaped individuals, communities, and the nation. It responded to a gap in the landscape of British museums, since none had comprehensively focused on migration as an urgent contemporary issue, at the centre of polarised political debate. It highlights the identity of British people, their origins, and their destinations 8
The Partition Museum, the youngest instutition on the MMN, opened its doors in in Amritsar (India). It is an excellent museum with which to round off this chronology: the frst Partition Museum in the world, it was created through an initiative of civil society, led by Indian and Pakistani people eager to tell their personal stories about one of the most defnining events in the history of the Indian subcontinent, which led to the largest mass migration in human history. Despite the extensive number of victims and colossal loss of property, seventy years later no
museum or memorial existed anywehere to remember the Partition.
Diffcult migration stories
On the subject of diffcult migration stories, the House of Slaves, in Senegal, is the oldest museum in our network. Established in 1962, it is one of nine founding members of the CISC, and recounts personal stories relating to a private residence, as well as the role of its owners in local and triangular trade 9 . Since , it has been involved in a revitalisation project aimed at ensuring that the historic house of slaves reaches its full potential as a repository of knowledge concerning triangular trade and as a catalyst for dialogue about the memory of this forced migration and the issues connected with present-day concerns.
Lastly, sites such as the Cape Coast Castle Museum, directed by the Ghana Museums and Monuments Board, have been active since the 1970s, and focus on the arrival of Europeans to Africa, as well as their interactions with the local communities and the region of Central Ghana, in the context of triangular trade. They also set the stage for interactions between people who have remained on the African continent and those that have joined the diaspora 10 Migration museums must confront the challenge of tackling diffcult stories connecting colonialism, migration, slavery, and diasporas. There is currently a shortfall in terms of migration museums dealing with triangular trade as a story of forced migration and of the impact of the resulting contemporary narratives on Africa and the diaspora; if we wish to become shared museums, this will need to be carefully examined.
Final refections
What conclusions can we draw from the museums in the MMN and their practices, to help us achieve our goal of becoming shared museums?
The museums in the network that are dedicated exclusively to migration emerged relatively recently, largely thanks to small-scale pilot initiatives by civil society. As sites of conscience, they are socially
9. URL: https://www.ghanamuseums.org/cape-coast-museum. php.
8. URL: https://www.sitesofconscience.org/membership/
47 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
maison-des-esclaves/.
10. Chimamanda Ngozi Adichie, The Danger of a Single Story, Produced by TED Talks, 2009.
responsible museums that operate at the junction between history, anthropology, ethnography, politics, sociology, and the arts, seeking to show how the past and present circulation of peoples has shaped the world as we know it, both locally and internationally.
Beyond the issues of immigration and emigration, migration museums deal with the circulation of peoples and its consequences for society. The attempt to move beyond the dissonances and tensions inherent in these stories might be interpreted as a search both for univocity and for a wide, dynamic range of voices, experiences, and stories. Unifed stories run the risk of favouring one perspective over another, and of creating what the Nigerian author Chimamanda Ngozie Adichie termed, in , “single stories”11 ;simplistic, incomplete, often untrue stories which exclude the experiences, needs, and voices of minority groups and ultimately lead to a polarising rhetoric, negative stereotypes, discrimination, hate, and violence. Moving towards the identifcation and intensifcation of shared understandings incorporating different perspectives could help build bridges and foster solidarity and peace.
Migration museums also need to create an environment in which decision-making is shared with the communities concerned, through co-creation and by ensuring the communities are represented within the museums’ staff, management, and governance structures.
The strength of networks such as the MNN and the ICSC lies in their ability to exchange practices, learn from the experiences of others, and create a collective voice, which is challenging for isolated institutions. The MNN also recognises the need to broaden the representation of local museums, which are anchored in their local communities and citizens, with the aim of promoting diversity and proposing an alternative to stereotyped narratives.
The concept of shared museums also implies a rebalancing of power in contemporary accounts of the global circulation of peoples, since such accounts are told from the perspective of people with strong economic power.
According to statistics from the United Nations High Commissionner for Refugees from 2021, before the war in Ukraine, some % of refugees forcibly
displaced abroad were originally from Syria, Venezuela, Afghanistan, South Sudan, and Myanmar, and % of them were hosted in neighbouring countries considered as part of the South 12 . Despite this, there is a greater focus on the refugee and migrant crisis in the North, which leads to distorted perceptions of the impact of population displacements at the global level. What is more, while the stories of violence, forced displacements, and migration of people from the South remain invisible, displaced people in the North beneft from considerable solidarity and greater media coverage. This reinforces the historic processes of alterisation and silencing used in the past to legitimise colonial domination. It is important for migration museums to avoid participating in these narrative imbalances, and that they seek instead to overturn such representations by proposing alternative versions of history through the prism of marginalised migrant communities.
As an international network, I believe that the MMN is ideally placed to establish links between these stories and heritages by sharing the power that resides in our collective narratives and drawing upon our practices as shared museums.
Websites:
International Coalition of Sites of Conscience (ICSC)
https://www.sitesofconscience.org/ Migration Museums Network (MMN)
https://www.sitesofconscience.org/ migrations-museum-network/.
12. URL: https://www.aiisf.org/aiisf-history#:~:text=AIISF’s%20 Mission%20Statement&text=AIISF%20collects%20and%20 preserves%20the,education%20initiatives%20and%20public%20 programs.
48
11. UNHCR, « Figures at a Glance », UNHCR, 2021. URL: https:// www.unhcr.org/afr/fgures-at-a-glance.html.
LE POINT SUR | MIGRATION MUSEUMS AROUND THE WORLD: THE MAIN ISSUES
Chronology of the immigration museums in the MMN
The oldest museum in the MMN is Angel Island Immigration Station, in San Francisco (United States), which opened its doors in 1983. Its goal is to raise awareness about the experience of immigration to the United States across the Pacifc and about the complex story of immigration in the United States. The museum encourages visitors to learn about the past as a way of guaranteeing that the present-day United States “keeps its promise of liberty13 ”.
The Immigration Museum in Buenos Aires (Argentina) was established in 1985 on the site of the former Immigrants’ Hotel. Responding to the demand of civil society, its goal was to represent the experience of immigrants from Europe, Asia, and Africa from the 19th century onward 14 . In 2013, it broadened its scope to connect this history with contemporary migration in Argentina, in particular by tackling regional migration.
The Migration Museum in Adelaide opened its doors in 1986, dealing with the history of immigration and colonisation in South Australia, a complex topic that encompasses colonialism, immigration, aboriginal peoples, and minority migrations. Nowadays, the museum “works towards the preservation, understanding and enjoyment of South Australia’s diverse cultures. It is a place to discover the many identifes of the people of South Australia through the stories of individuals and communities15 ”.
In 1987, the Asian museum Wing Luke opened in Seattle, taking over from the Wing Luke Memorial Foundation which was established in 1967. Since becoming the Wing Luke Museum of the Asian Pacifc American Expérience in , its objective has been to connect people to the dynamic history, cultures, and art of Asian Americans, Native Hawaiians, and Pacifc Islanders, to advance racial and social equity 16 .
The Lower East Side Tenement Museum of New York was founded in 1988 with the objective of exploring the United States’ unique migration history and the rich, diverse landscape it continues to create.
Situated in a dilapidated building that had been shuttered for more than ffty years, the museum was created thanks to a private initiative: its interest in social history led it to become the spearhead
behind the creation of the CISC in 1999. Twenty years later, in partnership with the CISC, it played a key role in the development of the MMN. Situated in New York (United States), the Ellis Island National Museum of Immigration opened in 1990. “A living monument to the story of the American people”, housed inside the main building of the former immigration complex, the National Immigration Museum traces the story of human mobility through the journeys of an immense number of immigrants, in order to say something about the American identity. Nowadays, Ellis Island encourages visitors to examine their own stories and refect on how they ft into the modern world.17 Having been in the pipeline since 1990, supported by associations of historians and campaigners, the National Museum of Immigration History of Paris, which developed out of the Cité nationale de l’histoire de l’immigration, was established in 2007.18 It focuses on the history of immigration, the promotion and recognition of its role in past and present-day France, and questions at the intersection of topics such as legislation, demography, the economy, daily life, culture, art, as well as racism, discrimination, and the link with slavery and colonisation. It is housed in the Palais de la Porte Dorée, a building that has strong ties with France’s colonial past, which the museum seeks to call into question and revisit.
Hanover Coal Mine (Germany) opened in 1995 and focuses on the industrial, cultural, and social history of the region, paying particular attention to the way in which the immigrant populations, notably Polish, Italian, and Turkish communities, developed their habits and customs, leaving cultural traces
13. URL: https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones/ museo/el-museo.
14. URL: https://migration.history.sa.gov.au/about/.
15. URL: https://www.wingluke.org/our-mission.
16. URL: https://www.statueofiberty.org/foundation/missionhistory/.
17. URL: https://www.palais-portedoree.fr/en/the-museenational-de-l-histoire-de-l-immigration.
18. URL: https://zeche-hannover.lwl.org.
49 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
among Hanover’s inhabitants which persist to this day 19
In 1997, the Danish Immigration Museum was established in Farum, introducing visitors to the populations that have migrated to Denmark throughout history in the hope of fnding work, love, wealth, or security, as well as the people invited to Denmark on account of their knowledge or labour power. The museum also deals with the history of Danish society and the people new arrivals met there, shedding light on the relationships that were forged and how they have shaped present-day Denmark 20 .
In 1998, the Immigration Museum in Melbourne (Australia) was created on the site of the former administrative centre of immigration and trade, a site of great historical complexity, in order to explore the history of immigration in Victoria. Nowadays, it “explores the histories, stories, and contemporary issues of Victoria’s diverse communities, and what connects us all as humans. It explores themes of migration, identity, citizenship and community through multiple perspectives. It engages with communities and creative practitioners to produce powerful opportunities for social interaction, empathy, and debate21 ” .
The Immigration Museum in São Paulo (Brasil), which also dates back to 1998, is situated in the building that once housed the Immigrants’ Hotel (Immigrant Hostelry). At the start, it focused on the topic of the “great immigration” from 1897 to the 20th century, a period in which a record number of immigrants arrived from Europe, the Middle East, Asia, and the Pacifc. The museum shows the places where these immigrants came from, and the places they arrived in, their experiences, and the role they played in building contemporary São Paulo 22 . After 2010, confronted with the emigration flow witnessed by the country, it broadened its scope to cover contemporary migrations, the right to migrate, and, more recently, the stories of ancient and contemporary migrations that have been glossed over in Brasil.
The Canadian Immigration Museum was founded in ; it is a national museum dedicated to the history of immigration in Canada, starting with civil
initiatives dating back to 1999, and is located at Pier 21, in the port of Halifax, where almost a million immigrants arrived in Canada between 1928 and 1971. It aims to raise the public’s awareness about the courageous journeys – flled with hope, challenges, and resilience – that make up the immigrant experience, and to do them justice, underscoring the vital role they have played in shaping Canada’s culture, economy, and customs 23 Since its establishment in 2005, the Arab American National Museum has remained the frst and only museum in the United States dedicated to documenting, preserving, and presenting the history, culture, and contributions of Arab Americans. Its exhibitions cover the Arab world and the history of Arab Americans since the frst waves of immigration in the late 19th century up to the present day 24 .
The fnal museum in this series, the Tea Plantation Workers’ Museum and Archive, was created in in Paradeka Gampola (Sri Lanka) with the aim of opening up the discussion on regional immigration from India to Sri Lanka. Shaped by a culture centred on defending human rights, labour rights, and gender equality, this local museum was established with the goal of protecting and preserving the cultural heritage of the frst communities of tea plantation workers, tackling subjects relating to identity and assimilation, and connecting this history to the rights of migrants and workers nowadays 25
19. URL: https://www.danishimmigrationmuseum.com/ the-museum/.
20. URL: https://museumsvictoria.com.au/ immigrationmuseum/about-us/.
21. Mariana Esteves Martins, “Museu da Imigração como espaço de discussão e prática de direitos”, in Revista Eletrônica Ventilando Acervos, vol. 4, no. 1, 2016, pp. 83–91.
22. URL: https://pier21.ca/about/about-museum.
23. URL: https://arabamericanmuseum.org/about/.
24. URL: https://www.isdkandy.org/tea-museum/.
25. URL: https://dah-bremerhaven.de/en/about-us.
50
LE POINT SUR | MIGRATION MUSEUMS AROUND THE WORLD: THE MAIN ISSUES
BON DE COMMANDE
Paris et nulle part ailleurs. artistes étrangers à Paris -
Sous la direction de Jean-Paul Ameline, Musée national de l’histoire de l’immigration/Harmann, , pages, € (+ € de frais de port),
ISBN 979-1- 0370-1863-2
Juifs et Musulmans de la France coloniale à nos jours
Sous la direction Karima Dirèche, Mathias Dreyfuss et Benjamin Stora, Musée national de l’histoire de l’immigration/ Le Seuil, , pages, , € (+ € de frais de port), ISBN - - - -
Picasso l’étranger
Sous la direction d’Annie Cohen-Solal, Musée national de l’histoire de l’immigration/Fayard, , pages, € (+ € de frais de port),
ISBN 978-2- 2137-1840-8
Paris-Londres. musique connexions
Sous la direction d’Angéline EscafréDublet, Stéphane Malfettes et de Martin Evans, Musée national de l’histoire de l’immigration/RMN-GP, , pages, € (+ € de frais de port),
ISBN - - - -
Mondes tsiganes. Une histoire photographique -
À RETOURNER À :
Les catalogues des expositions du Musée national de l’histoire de l’immigration

Sous la direction d’Ilsen About, Mathieu Pernot, et Adèle Sutre, Musée national de l’histoire de l’immigration/Actes Sud, , pages, € (+ € de frais de port), ISBN 978-2-330-09749-3
Coexistences. lieux saints partagés en Europe et en méditerranée
Sous la direction de Dionigi Albera et Manoël Pénicaud, Musée national de l’histoire de l’immigration/Actes Sud, , pages, € (+ € de frais de port), ISBN 978-2-3300-8626-8
Ciao Italia ! Un siècle d’immigration et de culture italienne en France Musée national de l’histoire de l’immigration/Éditions de la Martinière, mars , pages, x , cm, € (+ € frais de port), ISBN - - -Albums. Des histoires dessinées entre ici et ailleurs. Bandes dessinées et immigrationMusée national de l’histoire de l’immigration/Futuropolis, octobre , pages, x , cm, € (+ € de frais de port), ISBN - - - -Vies d’Exil. Des Algériens en France pendant la guerre d’Algérie,Cité nationale de l’histoire de l’immigration/ Éditions Autrement,
EPPPD - Musée national de l’histoire de l’immigrationAquarium tropical 293, avenue Daumesnil, 75012 Paris https://www.histoire-immigration.fr/diffuser-les-savoirs/les-editions
Nom
Prénom
Organisme
Adresse Code postal Ville Pays
Téléphone E-mail
septembre 2012, 224 pages, , cm x , cm, € (+ € de frais de port), ISBN - - - -
Polonia, des Polonais en France depuis
Cité nationale de l’histoire de l’immigration/montag, mars , pages, , cm x cm, € (+ , € de frais de port), ISBN - - -Générations.
Un siècle d’histoire culturelle des Maghrébins en France
Gallimard/Cité nationale de l’histoire de l’immigration/Génériques, novembre , pages, , cm x cm, € (+ € de frais de port), ISBN - - - -
À chacun ses étrangers ? En France et en Allemagne, de à aujourd’hui
Cité nationale de l’histoire de l’immigration/ Actes Sud, janvier , , cm x cm, pages, € (+ € de frais de port), ISBN - - -, Les étrangers au temps de l’exposition coloniale
Cité nationale de l’histoire de l’immigration/Gallimard, avril , , cm x pages, € (+ € de frais de port), ISBN - - - -
Je commande la ou les publications au tarif indiqué, auquel j’ajoute le ou les frais de port (par publication).
Montant de la commande € Je règle ce montant : par chèque bancaire ci-joint à l’ordre de l’Agent comptable de l’EPPPD par versement sur notre compte à la Recette générale des Finances - Paris cedex RIB n°
IBAN : FR
BIC : BDFEFRPPXXX
Important : l’EPPPD n’est pas habilité à recevoir de règlement par chèque pour les commandes hors métropole (règlement uniquement par virement bancaire).
Si l’adresse de la facturation est différente de l’adresse ci-dessus, prière de nous l’indiquer
Date
Signature
Cachet administratif
Faite votre sélection sur la liste ci-dessus en cochant les cases correspondantes. Pour l’étranger, ajouter 1,50 € aux frais de port indiqués.
Contact / Informations editions@palais-portedoree.fr - 01 53 59 58 63
X Centre d’éducation civique des Africaines à Paris. Magasin Le Louvre, 1966. X Civic education center for Africans in Paris. The Louvre store, 1966.
 Photo Janine Niépce © MNHI.
Photo Janine Niépce © MNHI.
Écrivains migrants, littératures d’immigration, écritures
diasporiques
Le cas de l’Afrique subsaharienne et ses enfants de la « postcolonie »
L’écrivain qui se trouve aujourd’hui entre l’Afrique et l’Europe doit compter avec la situation postcoloniale qui sous-tend les relations entre ces deux territoires. Depuis une quinzaine d’années, un ensemble d’auteurs d’expression française originaires d’Afrique subsaharienne font du devenir du migrant et de sa descendance en France un sujet récurrent. Derrière la description acerbe, et au combien vivifante, des travers d’une société qui trop souvent cantonne l’autre à ses marges, ils défnissent les contours de nouvelles identités.
À l’intérieur même de la définition du mot « migration », se superposent un certain nombre de nuances et de destins humains. Pour l’universitaire Catherine Pesso- Miquel analysant le cas de l’intellectuel britannique d’origine indienne Salman Rushdie 2 , « l’écrivain diasporique [aux vues de l’hindouisme] est considéré avec suspicion, et doit justifer et excuser sa vision fragmentée d’un pays perdu, qui l’oblige à retrouver le passé ‘dans les miroirs brisés, dont certains fragments ont été irrémédiablement
perdus’. » Cette considération sur l’écrivain en situation d’exil, qu’il s’agisse d’un choix ou bien d’un bannissement, cette suspicion s’applique communément à l’ensemble des écrivains migrants, faisant l’objet d’une classifcation spécifque dans la littérature mondiale. Depuis le concept de Weltliteratur énoncé par Goethe qui a cette volonté de rassembler des écrivains ayant dépassé leur contexte originel, jusqu’à celui de Littérature-Monde initié par les écrivains français Michel Le Bris et Jean Rouaud en 2007 et visant à abolir les frontières littéraires entre les écrivains français et écrivains francophones, les seconds étant catégorisés comme écrivains périphériques, en passant par les divisions induites dans le paysage littéraire anglais et anglophone à travers l’idée de « Littérature du Commonwealth » largement
1. Article initialement publié dans Hommes & Migrations, vol. 3, n° 1297, 2012, pp. 30-43.
2. Salman Rushdie. L’Écriture transportée, Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, 2007, coll. « Couleurs anglaises », p. 139.
53 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
Nathalie Philippe, ancienne rédactrice en chef de Cultures Sud1
fustigée par Rushdie, les écrivains migrants, et plus précisément, les écrivains originaires d’anciens pays colonisés, ont toujours fait l’objet d’abusives catégorisations, que ce soit en vue de leur défense ou bien de leur marginalisation.
C’est réellement dans les années quatre-vingt qu’apparaît une abondante littérature écrite, certes, par les enfants de la postcolonie, mais qui ont fait le choix de faire de leur situation d’exilé en France, le plus souvent à Paris et en région parisienne, un moteur de création.
Dans ces volontés de catégorisation, voire même parfois de ghettoïsation d’une population importante d’auteurs, on perçoit aisément qu’à chaque pays anciennement colonisateur correspond une logique et une suite migratoire propres aux facteurs historiques, sociaux, politiques et économiques de chaque nation. Ce n’est pas un hasard si de nombreux Congolais de l’ex-Zaïre vivent aujourd’hui en Belgique, et il n’est pas étonnant non plus que la France compte dans son actuelle population de nombreux ressortissants et descendants de Maliens, Sénégalais, Nigériens, Mauritaniens, Ivoiriens, Congolais de Brazzaville, Camerounais, Centrafricains, Gabonais, etc., sans oublier les populations originaires des pays du Maghreb.
Dans cette analyse, nous nous pencherons précisément sur l’une de ces multiples problématiques de l’écriture décentrée, à savoir les écrivains d’expression française originaires d’Afrique subsaharienne et résidant en France, ceux que l’écrivain djiboutien Abdourahman Waberi, installé dans l’Hexagone depuis la fn des années quatre-vingt, qualife d’« enfants de la postcolonie »
Contexte littéraire
Dans l’histoire des littératures africaines d’expression française, dont on peut dire qu’elles sont véritablement nées dans les années cinquante, et ce essentiellement dans une volonté de donner à voir au monde toute la richesse des civilisations noires, en réaction contre la politique d’assimilation culturelle chère au colonisateur, on distingue aisément plusieurs courants et périodes essentiellement marqués par la fn de la période coloniale – la France
a célébré en 2010 le cinquantenaire des indépendances africaines –, les indépendances et ce que les Anglo-Saxons défnissent comme le postcolonial Ainsi, sous l’impulsion de la personnalité majeure du poète-président sénégalais Léopold Sédar Senghor, l’un des pères fondateurs du courant de la « Négritude », se sont amorcées les premières tendances du roman africain : dénonciation des servitudes coloniales (Amadou Hampâté Bâ 3 , Bernard B. Dadié 4 , Ferdinand Oyono 5 , Mongo Beti 6 , Ousmane Sembene 7) ; l’intellectuel face à la politique d’assimilation (Georges Ngal 8 , Valentin-Yves Mudimbe 9) ; le douloureux clivage entre tradition et modernité (Cheick Hamidou Kane 10 , Camara Laye 11 , Yambo Ouologuem 12). Conséquence des indépendances, la désillusion des peuples donna par la suite lieu à tout un pan d’une littérature dite “du désenchantement” et également des “espérances contemporaines”, pour reprendre des expressions chères à Jacques Chevrier13 . Naissent alors des textes d’anthologie parmi lesquels on citera Tribaliques 14 et Le Pleurer-rire 15 d’Henri Lopes, Les Soleils des indépendances16 et Allah n’est pas obligé 17 d’Ahmadou Kourouma, Saint Monsieur Baly et Le Jeune Homme de sable 18 de Williams Sassine, Les Crapauds-brousse et L’Aîné des orphelins19 de Tierno Monénembo, ou encore La Vie et demie
3. Amadou Hampaté Bâ, L’Étrange Destin de Wangrin, Paris, Union générale d’éditions, 1973.
4. Bernard B. Dadié, Climbié, Paris, Seghers, 1956.
5. Ferdinand Oyono, Le Vieux Nègre et la médaille, Paris, Julliard, 1956.
6. Mongo Beti sous le pseudonyme d’Eza Boto, Ville Cruelle, Paris, Présence africaine, 1954.
7. Ousmane Sembène, Paris, Les Bouts de bois de Dieu, Le Livre contemporain, 1960.
8. Georges Ngal, Giambatista Viko ou le viol du discours africain, Paris, Hatier, 1984.
9. Valentin-Yves Mudimbe, Entre les eaux, Paris, Présence africaine, 1973.
10. Cheikh Hamidou Kane, L’Aventure ambiguë, Paris, Julliard, 1961.
11. Camara Laye, L’Enfant noir, Paris, Plon, 1953.
12. Yambo Ouologuem, Le Devoir de violence, Paris, Seuil, 1968.
13. Jacques Chevrier, Anthologie africaine, vol. I, « Le roman et la nouvelle », Paris, Hatier international, 2002 (coll. « Monde noir »).
14. Recueil de nouvelles paru à Yaoundé, éditions Clé, 1971.
15. Paris, Présence africaine, 1982.
16. Montréal, Presses de l’université de Montréal, 1968 ; Paris, Seuil, 1970.
17. Paris, Seuil, 2000.
18. Publiés respectivement aux éditions Présence africaine en 1973 et en 1979.
19. Publiés respectivement aux éditions du Seuil en 1979 et 2000.
54 LE POINT SUR | ÉCRIVAINS MIGRANTS, LITTÉRATURES D’IMMIGRATION, ÉCRITURES DIASPORIQUES
et L’Anté- peuple 20 de Sony Labou Tansi. Autant d’ouvrages qui donnent à voir la détresse et l’oppression des peuples abandonnés dans des dictatures déguisées en démocraties, leur quotidien diffcile voire misérable, et la diffcile cohabitation entre la modernité croissante dans les villes et l’état de nature, les valeurs ancestrales du village. Autant dire que cette littérature récente donne essentiellement à voir, avec des accents de réalisme merveilleux tout comme dans des descriptions parfois proches du documentaire, l’état d’un continent en marche, dans ses individualités comme dans ses communautés.
C’est réellement dans les années quatre-vingt qu’apparaît une abondante littérature écrite, certes, par les enfants de la postcolonie, mais qui ont fait le choix de faire de leur situation d’exilé en France, le plus souvent à Paris et en région parisienne, un moteur de création. C’est face à ce phénomène nouveau que Jacques Chevrier emploie la notion de « Migritude », en opposition à « négritude », et la défnit en ces termes : « [il s’agit] d’un néologisme qui veut signifer que l’Afrique dont nous parlent les écrivains de cette génération n’a plus grand-chose à voir avec les préoccupations de leurs aînés 21 ». Et de quoi parlent ces auteurs ? De leur condition d’immigré, de leur condition d’écrivain immigré, de leur identité littéraire, de leur rapport au monde et au pays d’origine. Nous allons aborder ces « nouvelles écritures africaines de soi 22 » dans leurs thématiques spécifques et propres au champ des littératures dites d’“immigration”, qui sont la traduction d’autant de regards sur la communauté africaine immigrée en France. Après en avoir défni les contours par la diversité des écritures, nous nous interrogerons également sur la situation de l’écrivain déraciné et les identités littéraires que ces postures génèrent.
Panorama littéraire et choix thématiques
Afn de pouvoir situer l’apparition de ce nouveau champ littéraire, il nous a paru indispensable de le replacer brièvement dans l’histoire générale des
20. Publiés respectivement aux éditions du Seuil en 1979 et 1983.
21. Jacques Chevrier, « Afrique(s)-sur-Seine : autour de la notion de “migritude” », in Notre Librairie, n°155-156, juillet-décembre 2004, pp. 96-100.
22. L’emprunt est fait à Odile Cazenave qui défnit en ces termes la mouvance littéraire des écrivains d’« Afrique sur Seine » dans l’ouvrage éponyme paru chez L’Harmattan en 2003 (coll. « Critiques littéraires »).
littératures communément appelées « africaines » ou bien « d’Afrique subsaharienne », et ce pour mieux en marquer la rupture. En effet, à l’opposé des écrivains nationalistes, panafricanistes, qui se voulaient être de véritables accoucheurs de l’Histoire (Senghor, Kwame Nkruma, etc.), ainsi que de ceux cités plus haut et ayant contribué, chacun à leur manière, à la description des violences coloniales, des lendemains qui déchantent après les indépendances, des diffcultés du quotidien dans cette Afrique nouvelle, les écrivains de la diaspora africaine contribuent à la formation d’une nouvelle « écriture de soi ». Nous allons revenir sur le parcours et l’œuvre des auteurs les plus emblématiques de cette mouvance littéraire qui perdure aujourd’hui, à force d’inégalités et d’exclusion dans une société française qui peine à reconnaître sa diversité culturelle 23
Calixthe Beyala : de Douala à Belleville
Originaire de Douala, l’essayiste et romancière camerounaise Calixthe Beyala, très tôt séparée de sa mère, a grandi au Cameroun élevée par sa grand-mère dans une grande précarité. Ses prédispositions intellectuelles, qu’elle affche dès l’école primaire, la conduisent très vite à faire des études supérieures en France, où elle s’installe défnitivement à l’âge de ans. Aujourd’hui composée d’une quinzaine de romans et de quelques essais, son œuvre s’est affrmée d’emblée sous les couleurs d’un féminisme exacerbé, notamment avec C’est le soleil qui m’a brûlée 24 , son premier roman, dans lequel elle peint les déboires de la survivance de la société patriarcale et la révolte d’Ateba, prostituée qui assassine, à bout d’humiliation, l’un de ses clients. Dès lors, l’œuvre de Beyala se positionne comme un long manifeste féministe, n’ayant de cesse de fustiger la lâcheté et la traîtrise du sexe opposé et d’appeler la femme à sortir de son aliénation millénaire. En 1992, c’est un tournant décisif qui s’amorce dans l’œuvre de l’auteur, avec la publication du Petit Prince de Belleville 25 , son quatrième roman, dans lequel le décor de l’action se transporte de l’Afrique à Paris. Elle y décrit, au travers des confessions épistolaires d’Abdou Traoré,
23. On pourra se reporter notamment aux travaux de l’historien François Durpaire, dont le dernier ouvrage intitulé Nous sommes tous la France ! Essai sur la nouvelle identité française est paru en 2012 aux éditions Philippe Rey (coll. « Documents »).
24. Paris, Stock, 1987.
25. Paris, Albin Michel, 1992.
55 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
travailleur immigré au chômage et polygame, le désenchantement et les frustrations de l’homme qui, confronté à une civilisation nouvelle, se trouve dépossédé de ses valeurs traditionnelles, à commencer par la docilité et l’obéissance de ses deux co-épouses qui ont pris le vent de la liberté. Ainsi, dans une correspondance imaginaire avec un interlocuteur français, il écrit : « Nous vivons à double monde, je le sais, tu le sais, comme on le dirait d’un double sens ou d’une double vie. Nous marchons en parallèle, acrobates sur la corde raide qui nous sépare, entre deux abîmes de réalités adverses. Le jour occulte la nuit. Et les nuits réveillent les silences du jour. À la fn, il faudrait que le jour l’emporte et que nous fassions la lumière. […] Je suis perdu, l’ami. Que faire ? Je suis perplexe devant tes traditions que je ne veux ni froisser ni comprendre de peur aussi de m’y perdre et de gâcher ma foi, la plus forte que je tienne, forte de rester sans comparaison. C’est tout ce qui me reste l’ami. »
Tandis que les fgures patriarcales perdent pied dans cet entre-deux-mondes, les femmes, quant à
elles, découvrent l’ivresse de la liberté, qui passe notamment par l’éducation, l’enseignement auxquels elles n’avaient auparavant pas accès. C’est le cas du personnage de Saïda, l’héroïne des Honneurs perdus26 qui débarque à Paris à l’âge de ans, avec pour seul bagage sa virginité. Employée domestique dans le foyer d’une compatriote, elle apprend à lire à l’école du soir, sous les encouragements de Maîtresse Julie et de sa patronne qui se glorife auprès de ses amis de « transformer une souillon en singe savant ». Chez Beyala, on le voit bien il n’y a aucune complaisance quant à la situation de l’Africain(e) immigré(e) en France, et ce sont naturellement les femmes, comme autant de mères-courages, qui tiennent le haut du pavé.
De Bleu-Blanc-Rouge
à
Black
Bazar :
les tribulations d’un Congolais à Paris

De la même génération que Beyala et né au Congo-Brazzaville, le romancier, poète et essayiste Alain Mabanckou est véritablement entré en littérature, après la publication de plusieurs recueils de poésie, avec un archétype du roman d’immigration – il ne savait alors pas encore qu’il contribuait à l’élaboration d’une nouvelle mouvance littéraire – en : c’est l’année de publication de Bleu-BlancRouge 27, son premier roman. Il y dépeint les déboires du jeune Massala-Massala, un Africain naïf et peu instruit qui débarque à Paris dans le but de réaliser son rêve de réussite, à l’instar de l’un des “grands” du quartier, le dénommé Charles Moki. La narration marque surtout par la fascination aveugle qu’ont les Congolais autochtones pour la France, perçue comme un paradis et même un lieu de culte, ces autochtones qui « décrivaient avec un talent inégalable les lignes du métro, station par station, à croire qu’ils avaient séjourné à Paris ».
Ce roman, bien que sur un mode grinçant, est aussi la dénonciation des violences psychologiques et des humiliations faites aux immigrés en situation irrégulière. Massala-Massala, au bout de ses tentatives infructueuses pour rester coûte que coûte dans son eldorado, sera fnalement admis au rang des rapatriés d’offce et devra prendre l’un de ces « charters de la honte » qui font les gorges chaudes de l’actualité en France. Outre cette humiliation subie par des Africains de toutes nationalités parqués
56
26. Paris, Albin Michel, 1996. Grand Prix du roman de l’Académie française obtenu la même année.
LE POINT SUR | ÉCRIVAINS MIGRANTS, LITTÉRATURES D’IMMIGRATION, ÉCRITURES DIASPORIQUES
X Calixthe Beyala, 1992. Photo ©John Foley/Opale photo.
comme de la marchandise et répartis « par pays […] pour éviter que ceux qui ne savent pas parler et comprendre le français se retrouvent dans un pays qui n’est pas le leur”, est exprimé clairement le pourquoi du refus de ce retour forcé : “Les Africains sont résignés. Le dépit se lit clairement sur leurs traits. Ils rentrent malgré eux. Ce n’est pas tant le besoin de rester qui les tenaille, mais la crainte d’affronter toute une grande famille qui les attend. […] C’est cela, notre crainte. C’est un courage que d’arriver d’un long voyage sans un présent pour sa mère, pour son père, pour ses frères et sœurs. Cette angoisse habite l’intérieur de la gorge. Elle ôte les raisons de vivre. »
Mabanckou, en 1998, posait avec ce texte aux accents de roman d’apprentissage, entre gravité et burlesque, les fondements de la diffcile condition des immigrés africains en France et expliquait leurs motivations, par-delà les critères économiques et politiques, à venir s’installer à Paris, cité magnifée et mystifée.
Ce n’est que cinq romans et dix années plus tard que le romancier reprendra la capitale pour décor avec Black Bazar28 qui raconte la vie quotidienne d’un Congolais à Paris. Il n’y est plus question de naïveté et encore moins de fascination à l’égard des lumières de la Ville, mais c’est ici bel et bien l’expression, dans une tonalité comique et grotesque dont l’auteur a le secret, d’un être au monde dans un espace où la cohabitation entre les immigrés de différentes nationalités devient un lieu permanent de débat. Débats, ou plutôt brèves de comptoir, car le Fessologue – c’est ainsi qu’est désigné le narrateur qui a vocation à s’intéresser à la « face B » des femmes – fraîchement largué par sa copine surnommée « Couleur d’origine », n’a de cesse de se consoler et de s’interroger sur sa condition en ayant entrepris d’écrire sa vie, ce qu’il fait le plus souvent au Jip’s, bar afro-cubain du centre de Paris. Plus qu’un manifeste sur la condition d’immigré en France, Black Bazar est surtout le roman d’une écriture de soi, d’une entité individuelle et confrontée au groupe cosmopolite qui préfgure la France d’aujourd’hui. La narration de l’existence du Fessologue avec ses propres rêves, ses échecs, la façon dont il est arrivé en France, la nostalgie du pays natal permet d’entrevoir la description d’un nouveau paysage social que la société française peine encore à reconnaître. Ce roman, à partir d’une expérience personnelle,
donne à voir toutes les diffcultés que connaît la France d’aujourd’hui à accueillir les autres et leur permettre de s’épanouir, du fait de la discrimination induite par la seule couleur de peau. C’est aussi un regard décentré porté sur la folie du monde qui l’entoure, le racisme au quotidien et les idées reçues. Pour exemple, les propos du voisin raciste, Monsieur Hippocrate, qui n’a de cesse de dénoncer les « incivilités » des locataires africains : « Et il est allé larmoyer auprès de notre propriétaire commun qu’il y avait des groupuscules d’Africains qui semaient la zizanie dans l’immeuble, qui avaient transformé les lieux en une capitale des tropiques, qui égorgeaient des coqs à cinq heures du matin pour recueillir leur sang, qui jouaient du tam-tam la nuit pour envoyer des messages codés à leurs génies de la brousse et jeter un mauvais sort à la France. » Et, allez savoir, comble du comble : il nous est révélé bien plus tard dans la narration que Monsieur Hippocrate est… martiniquais !
Fatou Diome ou la géographie d’une œuvre de part et d’autre de l’Atlantique
Devenue strasbourgeoise par suite d’un mariage avec un Français, l’écrivaine sénégalaise Fatou Diome a fait une entrée remarquée en littérature avec un recueil de nouvelles intitulé La Préférence nationale 29 , qui se construit autour de deux espaces géographiques : le Sénégal, d’un côté, et la France, de l’autre. Cette dichotomie et ce balancement n’auront de cesse, par la suite, de s’inscrire dans l’œuvre de la romancière. Mais encore faut-il souligner qu’il n’est nullement question d’une vision manichéenne des choses, entre les résurgences d’une Afrique idyllique et la description d’une société française peu encline à sympathiser avec ses ressortissants étrangers. En effet, dans les deux premières nouvelles du recueil, « La Mendiante et l’écolière » et « Mariage volé », la narratrice décrit des situations de vie misérables faites d’humiliations et de maltraitances quotidiennes quelque part sur le continent africain, tandis que dans La Préférence nationale , c’est véritablement le personnage de Cunégonde, employée de maison chez un couple de Strasbourgeois, qui fait les frais d’une humiliation constante par ses patrons qui la licencient lorsqu’ils s’aperçoivent qu’elle poursuit, en parallèle, des études supérieures de lettres modernes. Une image qui sans aucun doute ne convenait pas à
57 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
27. Paris, Présence africaine, 1998. 28. Paris, Seuil, 2009. 29. Paris, Présence africaine, 2000.
la représentation d’une femme de ménage, noire de surcroît, dans leurs consciences étroites et ignorantes.
Dans Le Ventre de l’Atlantique 30 , il s’agit de Salle, immigré sénégalais en France, qui tente de dissuader son frère Madické de venir le rejoindre dans ce pays qui n’est pas ce qu’il en croit ou bien ce qu’on lui en a dit. Dans ce dévoilement des faces cachées de l’immigration, subsiste également la diffculté du retour au pays d’origine, qu’il soit temporaire ou défnitif. « Je vais chez moi comme on va à l’étranger », affrme la narratrice du Ventre de l’Atlantique Trois romans plus tard, dans la lignée thématique de son premier roman, Celles qui attendent 31 , dernier ouvrage en date de Fatou Diome, reprend cette logique de balancement – et de schizophrénie – avec celles qui sont restées de l’autre côté de l’Atlantique, regardant leurs maris et leurs fls partir clandestinement vers l’autre rive au péril de leur vie, et mènent un combat quotidien pour simplement survivre. Sur le choix singulier d’un véritable déplacement de points de vue, l’auteur s’exprime en ces termes : « C’est d’abord un hommage à ces femmes qui, du fait de l’immigration, de l’absence des hommes ou bien de la démission de leurs maris, font de leur mieux pour faire vivre leurs enfants. […] Même si le mari sur place a une bonne situation, est fonctionnaire et, par

exemple, prend une deuxième épouse, et bien la première ne peut pas laisser tomber le foyer, les enfants ; elle est obligée de se battre tout le temps. L’immigration ajoute à cette tragédie-là un combat supplémentaire mais c’est malheureusement souvent le lot des femmes en Afrique de parer au carrosse des chefs de famille 32 ».
Chez Fatou Diome, c’est cet entre-deux-rives, ce balancement permanent, ce croisement entre des logiques communautaires vécues parfois comme de véritables souffrances (pour exemple la polygamie) et des « individualismes forcenés » propres aux sociétés occidentales, qui font de l’écrivaine, comme elle aime à se défnir elle-même, un « être hybride », en référence au concept cher à Salman Rushdie.
Sociologue de formation, l’écrivain togolais Sami Tchak, établi en France depuis plus de vingt ans, après avoir commis plusieurs essais, notamment sur la sexualité en Afrique et la prostitution à Cuba, entre véritablement en littérature avec Place des fêtes 33 , roman provocateur, dérangeant et qui bouleversera à jamais le paysage littéraire africain. Dans ce roman, il est question d’un jeune homme résidant en banlieue parisienne et né « ici » de parents « nés là-bas ». C’est effectivement le sort de bien des enfants d’immigrés en France. Au travers de la narration de son cocasse quotidien, se met en place un questionnement fondamental sur l’identité, sur la condition de ces enfants qui ont irrémédiablement « le cul entre deux chaises ». Le retour sur l’expérience d’immigration du père entrevue au départ comme une victoire est un passage criant de cette schizophrénie qui instaure le mal-être des immigrés à la fois au sein de la société d’accueil et auprès de la famille restées au pays : « Papa, tu as
58
« Putain de corps sans patrie » : le cas de Place des fêtes de Sami Tchak
30. Paris, Anne Carrière, 2003.
31. Paris, Flammarion, 2010.
32. Entretien avec Nathalie Philippe publié sur culturessud.com.
33. Paris, Gallimard, 2001 (coll. « Continents noirs »).
LE POINT SUR | ÉCRIVAINS MIGRANTS, LITTÉRATURES D’IMMIGRATION, ÉCRITURES DIASPORIQUES
X Fatou Diome, 2019. Photo Astrid di Crollalanza/Opale photo.
de gros problèmes, de gros soucis de fric. Travail précaire, chômage, dépendance aux aides sociales, logement de porcs, pas de divertissement. Amertume dans la mesure où ton avenir est à jamais compromis par ton âge trop mûr comme un kiwi pourri. Papa, tu es mort pour les tiens de là-bas. Mais oui ! Tu ne réponds plus à leurs lettres parce que tu ne peux plus rien pour eux. Or, tu n’existais que par l’argent que tu envoyais. Tu t’es retiré dans un silence de cadavre. Alors que la société française se refuse à toi, tu perds ton village et ton Afrique. L’Afrique, le pays natal, la famille, les parents, etc., tout cela devient une réalité bien lointaine. Douleur de l’exil forcé ou choisi. »
Autres corpus, autres visions
Nous avons choisi ici et à titre d’exemple les écrivains les plus représentatifs de ces nouvelles écritures de soi, qui sont autant de questionnements identitaires induits par les littératures d’immigration ici traitées. Il s’en dégage, par ailleurs, une vision assez pessimiste du statut de l’immigré africain en France, qui apparaît fnalement comme étant rejeté de toutes parts. Seuls les personnages féminins semblent pouvoir en tirer parti, en termes d’éducation, par exemple, chose à laquelle elles ont rarement accès dans leur pays d’origine.
Il est cependant un autre ouvrage récent qui traite du statut de la femme immigrée africaine en France et qui a beaucoup dérangé les consciences : il s’agit de Des Fourmis dans la bouche 34 , de Khadi Hane, où l’héroïne, prénommée Khadidja Cissé, mère isolée de cinq enfants, vit avec eux dans un appartement délabré du quartier de Château-Rouge à Paris, et dont la seule préoccupation est de pouvoir assurer la subsistance de sa progéniture. Sa vie, en marge de sa communauté d’origine dont elle est tout simplement rejetée pour avoir eu un dernier enfant avec un homme blanc marié qui n’est autre que le propriétaire du logement insalubre qu’elle occupe, est rythmée par les visites de l’assistante sociale qui menace de placer ses enfants dans des familles d’accueil et les moqueries de ses voisines de palier. Khadidja appartient à cet univers des invisibles, sans patrie et sans famille réelle. Véritable roman sur la condition féminine en contexte d’immigration, Des Fourmis dans la bouche nous invite dans une atmosphère extrême, où l’héroïne, de par ses choix ou bien simplement parce
qu’elle n’avait pas le choix, ne se reconnaît aucune appartenance à quelque communauté que ce soit dans un pays où elle n’existe pas. Accusée régulièrement d’avoir quelque peu forcé le trait sur les réalités qu’elle dépeint, Khadi Hane justife du fait qu’il existe en France beaucoup de femmes immigrées qui, à défaut d’avoir suivi leur conjoint, sont venues d’ellesmêmes pour faire des études ou tout simplement pour fuir la misère du pays d’origine. Elles vivent dans la misère la plus absolue et chaque jour devient un combat pour la survie.
Nous aurions pu poursuivre d’autres analyses de cas aux travers des œuvres de Daniel Biyaoula, Bolya ou encore Bessora. Mais cet aspect exhaustif est l’objet d’ouvrages déjà consacrés à la question, à l’instar des travaux d’Odile Cazenave déjà évoqués plus haut. Ce que l’on peut d’ores et déjà retenir, c’est la dualité du processus, tant dans la vie des personnages que dans celle de leur démiurge. Nous reprendrons à ce titre l’analyse faite par Papa Samba Diop : « Écriture de l’écart, celle des migrants traduit une vie double, conjointement emplie du souvenir du pays réel et des réalités nouvelles du lieu d’accueil 35 . »
Ce désengagement simultané de la culture d’origine et de la culture d’accueil conduit inévitablement à l’évolution de l’écrivain de la « migritude » dans un espace-tiers qui devient espace de création littéraire. Pour avoir interrogé certains d’entre eux sur leur posture d’écrivain immigré ou bien de descendant d’immigrés, nous sommes à peu près sûrs d’y avoir perçu cette conscience d’être pleinement au monde un écrivain de la diaspora et aspirant par là même à une certaine forme d’universalité dans leurs écrits.
La nécessaire réhabilitation du personnage subsaharien ou afrodescendant
Pour la romancière camerounaise Léonora Miano, « la littérature est universelle quels que soient les thématiques abordées, les décors ou cultures présentés, dans la mesure où, se focalisant sur l’humain, elle évoque ce que tous ont en partage ». Elle ajoute que « les textes produits par les écrivains subsahariens sont perçus comme spécifiques en raison d’un point de vue eurocentré, qui peine à se projeter dans l’expérience des autres. En créant les catégories raciales dans lesquelles nous sommes
59 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
34. Paris, Denoël, 2011.
35. Papa Samba Diop, « Le pays d’origine comme espace de création littéraire”, in Notre Librairie, n° 155-156, « Identités littéraires », juillet-décembre 2004, p. 60.
encore englués – peut-être défnitivement –, l’Occident s’est inventé une vision de lui-même qui l’empêche de reconnaître ses traits dans ceux des autres » On a le sentiment que cette appellation « littérature d’immigration » ne prend pas chez Miano, car entrevue une fois de plus dans le prisme de l’Occident. L’auteur se justife des choix thématiques de ses romans, entre réalités africaines 36 et réalités « afropéennes 37 », non pas du simple fait d’avoir vécu au Cameroun et de vivre aujourd’hui en France, mais par référence à l’histoire des peuples afrodescendants qui constitue son interrogation constante : « Concernant ce qui motive mes choix thématiques, le fait d’avoir quitté l’Afrique pour l’Europe n’a pas vraiment d’incidence. J’appartiens aux deux espaces depuis toujours, parce que je viens d’un territoire dominé par l’Europe, façonné par elle. L’Afrique, telle que nous la connaissons aujourd’hui, est une construction européenne, que les Subsahariens peinent encore à s’approprier, pour un tas de raisons n’incombant pas à eux seuls. Ensuite, j’ai mon parcours personnel. Il se trouve que très tôt, à l’adolescence, j’ai rencontré l’expérience des peuples afrodescendants. Les infuences caribéenne et afro-américaine sont importantes pour moi, et ma proposition littéraire cherche toujours à s’inscrire dans une dimension qui permette de créer des passerelles entre les Subsahariens et les Afrodescendants. D’où la récurrence du motif de la traite négrière dans mes écrits. Je travaille beaucoup sur la mémoire, sur le non-dit historique, tentant de faire émerger une parole subsaharienne sur certaines questions. Or, cette histoire transatlantique qui m’habite n’est pas uniquement celle des Noirs. Elle est aussi celle de ceux qui se sont rêvés blancs en inventant le Noir et en lui assignant une place, souvent hors de l’humanité. Dans la littérature que je produis, les catégories Noir et Blanc ne sont pas biologiques. Ce sont des entités historiques. Qu’on se souvienne que le Subsaharien ne devient noir aux yeux du monde et aux siens propres, qu’à un moment précis de l’histoire 38 . Il a vécu longtemps, très longtemps, sans se considérer ni comme un Noir, ni comme un
36. Notamment L’Intérieur de la Nuit, Contours du jour qui vient et Les Aubes écarlates, publiés chez Plon respectivement en 2005, 2006 et 2009.
37. Voir Blues pour Élise et Ces âmes chagrines publiés chez Plon respectivement en 2010 et 2011.
38. « Lorsque le terme kamite/kemite est employé pour dire Noir, il ne fait pas référence à la couleur de la peau, comme dans la perception racialisée. Pour ceux qui s’attachent à la civilisation égypto-nubienne comme socle de leur pensée, le noir représente la matrice, le lieu des gestations, et n’est pas vu comme opposé au blanc. Le terme n’induit pas, dans cette acception, de jugement de valeur. » (Note de l’écrivain).
Africain, ces appellations lui étant venues de sa rencontre avec l’Europe. […] Il est capital, à mes yeux, de restituer son individualité au personnage subsaharien ou afrodescendant 39 » Ainsi Leonora Miano, dont la partie plus récente de la production littéraire pourrait aisément être catégorisée dans ces « littératures d’immigration », va bien plus loin dans sa démarche d’écriture avec ce souci permanent de vouloir rétablir une certaine forme de véracité historique dans la condition de ses personnages, qu’ils soient africains ou afrodescendants. Ses personnages sont, chacun à leur manière, les porte-drapeaux de cette complexité historique qui constitue le socle de sa réfexion et de son travail d’écrivain. Le romancier français d’origine sénégalaise Mamadou Mahmoud N’Dongo semble tout à fait partager cette conception historique et cet ancrage fondamental dans la littérature universelle. Pour l’écrivain, en effet, la conjugaison de plusieurs facteurs historiques et migratoires mène naturellement à une déterritorialisation de la langue française, trop souvent enclavée dans la « francophonie » : « Un Homme replié sur lui-même ou une nation repliée sur elle-même sont atrophiés. Notre nature est d’être en mouvement, de notre conception à notre disparition nous sommes un organisme vivant, que cela soit d’un point de vue philosophique ou dans une perceptive physique, disons géographique. La grandeur d’une civilisation se mesure à son expansion, c’est-à-dire à ses invasions (belliqueuse volonté de puissance), économique (savoir- faire industriel), ou du domaine des débats d’idées (à l’exemple de la religion ou des Lumières). J’aime ce mot de “communauté”, j’aime cette confrérie de la diaspora ; je suis un individu qui fait partie d’un vaste ensemble en mouvement, j’aime cette pensée, cette conception que jamais je ne serai un apatride et que j’ai pour moi le fait d’être peul, d’écrire en français, par ma naissance j’appartiens à une civilisation qui par son expansion et ses empires a gagné toute l’Afrique, tout comme l’empire français, qui m’a fait rencontrer la langue française qui me permet non pas d’avoir un accès à la littérature française, ni francophone, ni à la littérature- monde, mais à un pays sans frontière : la littérature d’expression française. »
39. Propos recueillis à l’occasion d’une correspondance privée avec l’auteur.
40. Propos de Tchicaya U Tam’si in Notre Librairie, n° 83, avril-juin 1986, pp. 17-23.
41. Paris, Gallimard, 2012 (coll. « Continents noirs »).
60
LE POINT SUR | ÉCRIVAINS MIGRANTS,
LITTÉRATURES D’IMMIGRATION, ÉCRITURES DIASPORIQUES
« Il nous faut autre chose ! »
Feu le poète congolais Tchicaya U Tam’si, qui passé une majeure partie de sa vie en France, s’insurgeait à l’occasion d’une table ronde portant sur la problématique des « Écritures nationales, écritures ethniques ou écritures tout court ? », en : « Je suis en rupture avec la tribu, je suis en rupture avec l’ethnie ; je suis en rupture avec l’Afrique. Il nous faut autre chose. Je suis en situation de vouloir conquérir et détruire un certain nombre de citadelles qui me sont interdites, et où je voudrais habiter. Et pour cela je me mets en situation de rupture40 . » L’auteur du Mauvais Sang mettait alors le doigt sur une problématique d’avant-garde dont les écrivains d’aujourd’hui semblent se décharger au nom d’un espace diasporique et d’une communauté de langue et d’histoire qui dépasse les frontières académiques de la francophonie. Pour exemple, le Camerounais Eugène Ébodé n’envisage qu’une seule piste possible : « Je suis un écrivain de la diaspora. Toute autre inscription me concernant serait une posture, un masque dérisoire. Mais de quelle diaspora parlons-nous ? De la diaspora africaine, naturellement ! Dans mon dernier roman, Métisse palissade 41 , il se trouve que j’évoque cette question et y réponds : je suis d’origine camerounaise. Il me plaît de conter, chaque fois que possible, l’itinéraire d’un enfant beti qui fait retentir dans ses romans une voix de surplomb, parole des anciens : “Voici l’histoire...” »
À travers ces analyses textuelles tout comme dans ces propos recueillis sur le vif, on aura compris qu’il demeure fondamental, pour une critique éthique et nous dirions même équitable, de ne pas perdre de vue la logique nationale ou binationale qui prévaut dans l’ensemble des textes produits par les écrivains dits « de la diaspora ».
Pour l’Afrique subsaharienne, on l’a vu, les littératures diasporiques sont un phénomène relativement récent et demeureront en matière de critique l’apanage des spécialistes car, on l’a trop souvent constaté, sous des apparences et même des vocations universelles, ces textes regorgent d’un savant entremêlement de civilisations qui est le résultat d’une histoire
commune, et à plus forte raison une histoire douloureuse. Leonora Miano, dans son analyse, a savamment rappelé la complexité de ces littératures, même dans leur apparence parfois « grand public ». Il est indispensable de ne pas confondre la simple lecture avec l’analyse d’un ouvrage ayant trait aux littératures diasporiques, et impliquant, par conséquent, une pluralité de civilisations, d’histoires et de destins individuels. L’écrivain ne doit pas être pris en otage par une perspective critique qui se voudrait trop simpliste et ignorante des facteurs socio-historiques, économiques, qui ont régi son parcours personnel tout comme ses choix d’écriture.
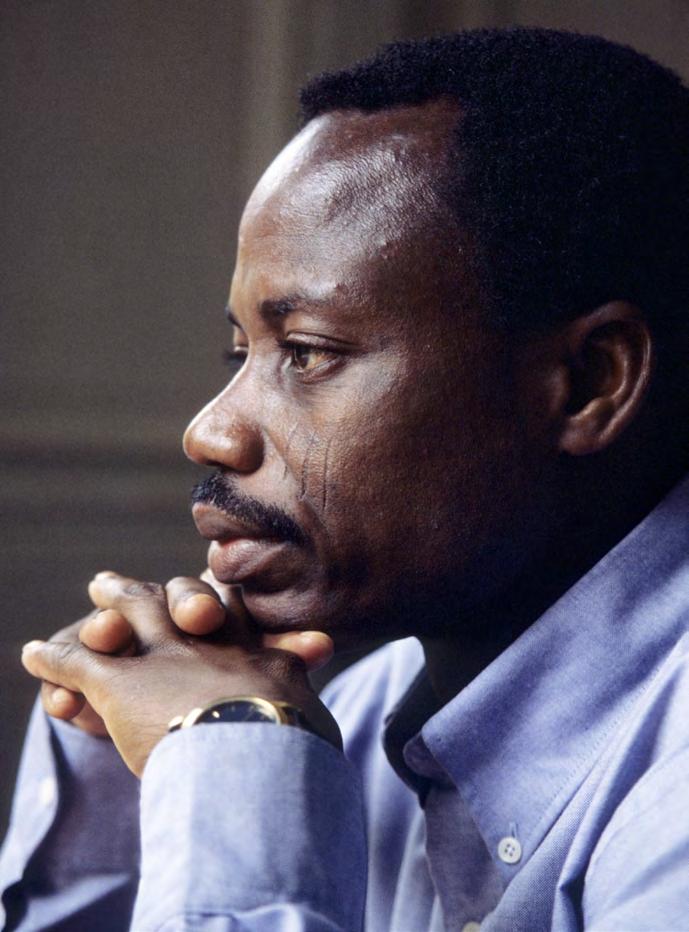
61 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
X Sami Tchak (Sadamba Tcha-Koura), 2000. Photo Jacques SASSIER © Gallimard via Opale photo.
Migrant Writers, Immigration Literature, and Diaspora Writings
Sub-Saharan Africa and its Children of the “Postcolony”
Nathalie Philippe, former editor-in-Chief of Cultures Sud
Contemporary writers positioned between Africa and Europe must contend with the postcolonial situation that underpins relations between the two territories. For around ffteen years, a group of French-speaking authors originally from sub-Saharan Africa have made the fate of the migrant and their descendants in France a recurrent theme in their writing. Behind their cutting, and highly invigorating, description of a society that all too often relegates the other to its fringes, they carve out new identities.
The defnition of the word “migration” itself encompasses a number of nuances and human fates. As the academic Catherine Pesso-Miquel has noted in relation to the British intellectual of Indian origins Salman Rushdie 1 : “ The diaspora writer (in Hindu views), is regarded with suspicion, and forced to justify and excuse their fragmented vision of a lost country, forcing them to retrace the past ‘in broken mirrors, some of whose fragments have been irretrievably lost’.” This analysis of the exiled writer, whether by choice or as a result of banishment, could be applied to all migrant writers, who make up a specifc category of world literature. Migrant writers – or, more specifcally, writers from formerly colonised countries –have always been subject to inappropriate
categorisations, whether to defend or to marginalise them. Examples range from Goethe’s early concept of Weltliteratur, which groups together writers who have left their original context, to the concept of LittératureMonde introduced by French writers Michel Le Bris and Jean Rouaud in 2007 – which seeks to eradicate the literary divisions between French and Francophone writers, with the latter being categorised as outliers –, by way of the divisions introduced into the English and Anglophone literary landscape through the idea of “Commonwealth Literature”, which is broadly condemned by Rushdie.
From these attempts to categorise, or even ghettoise, a large number of authors, it is clear that each former colonial country follows its own migratory future and logic, specifc to the historic, social, political, and economic characteristics of each individual nation. It is no coincidence that many Congolese people from ex-Zaire now live in Belgium, nor should it come as any surprise that France’s current population includes many Malian, Senegalese, Nigerian,
62
1. Salman Rushdie. L’Écriture transportée, Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, 2007, coll. “Couleurs anglaises”, p. 139.
Mauritanian, Ivorian, Congolese (from Brazzaville), Cameroonian, Central African, and Gabonese nationals (and their descendants), etc, as well as people from the Maghreb countries.
In this article, I will examine one of the many issues surrounding decentred writing, that is, Frenchspeaking writers from sub-Saharan Africa who now live in France, whom the Djiboutian writer Abdourahman Waberi, living in France since the late s, has described as “children of the postcolony”.
Literary context
In the history of Francophone African literature – which arguably truly emerged in the s, primarily to show the world the richness of black civilisations in response to the policy of cultural assimilation esspoused by colonisers – a number of currents and periods heavily marked by the end of the colonial period (France celebrated the fftieth anniversary of African independence in ), independence, and what the Anglo-Saxons term the ‘postcolonial’ experience can be clearly identifed.
At the instigation of Senegalese poet and president Léopold Sédar Senghor, a seminal fgure and one of the founding fathers of the “Negritude” movement, the early trends of the African novel began to emerge: namely, the denunciation of colonial oppression (Amadou Hampâté Bâ 2 , Bernard B. Dadié 3 , Ferdinand Oyono 4 , Mongo Beti 5 , Ousmane Sembene 6) ; the experience of the intellectual faced with the policy of assimilation (Georges Ngal 7 , Valentin-Yves Mudimbe 8); and the painful rift between tradition and modernity (Cheick Hamidou Kane 9 , Camara Laye 10 , Yambo Ouologuem 11). Following independence, the
2. Amadou Hampaté Bâ, L’Étrange Destin de Wangrin, Paris, Union générale d’éditions, 1973.
3. Bernard B. Dadié, Climbié, Paris, Seghers, 1956.
4. Ferdinand Oyono, Le Vieux Nègre et la médaille, Paris, Julliard, 1956.
5. Mongo Beti under the pseudonym of Eza Boto, Ville Cruelle, Paris, Présence africaine, 1954.
6. Ousmane Sembène, Paris, Les Bouts de bois de Dieu, Le Livre contemporain, 1960.
7. Georges Ngal, Giambatista Viko ou le viol du discours africain, Paris, Hatier, 1984.
8. Valentin-Yves Mudimbe, Entre les eaux, Paris, Présence Africaine, 1973.
9. Cheikh Hamidou Kane, L’Aventure ambiguë, Paris, Julliard, 1961.
10. Camara Laye, L’Enfant noir, Paris, Plon, 1953.
11. Yambo Ouologuem, Le Devoir de violence, Paris, Seuil, 1968.
sense of disillusionment experienced gave rise to an entire segment of literature called the literature “of disenchantment”, as well as of “contemporary expectations”, to use the expressions held dear by Jacques Chevrier12 . Anthologies emerged, among which we might cite Tribaliques (13) or Le Pleurer-rire 14 by Henri Lopes, Les Soleils des indépendances15 and Allah n’est pas obligé 16 by Ahmadou Kourouma, Saint Monsieur Baly and Le Jeune Homme de sable 17 by Williams Sassine, Les Crapauds-brousse and L’Aîné des orphelins18 by Tierno Monénembo, and La Vie et demie and L’Anté-peuple 19 by Sony Labou Tansi. All of these texts convey he distress and oppression suffered by people left to contend with dictatorships disguised as democracies, their diffcult – even miserable – daily lives, and the problematic coexistence of the increasingly modernised towns and the natural state and ancestral values of the villages. Containing touches of magical realism along with descriptions that at times border on the documentary, these recent writings thus illustrate the state of a continent on the move, at both the individual and community level.
It was not until the 1980s that an extensive body of written literature truly emerged. While it was indeed written by the children of the postcolony, these were individuals that had chosen to turn their situation as exiles in France – in Paris and the Parisian region for the most part – into a catalyst for creativity. Faced with this new phenomenon, Jacques Chevrier employed the notion of “Migritude” in opposition to “negritude”. He gives the following defnition for the term: “ [it is] a neologism implying that the Africa described by the writers of this generation bore little resemblance to the concerns of their elders 20 ”. What did these authors write about? Their situation as immigrants and as immigrant writers, for one thing, but also their literary identities, and their relationship
12. Jacques Chevrier, Anthologie africaine vol. I, “Le roman et la nouvelle”, Paris, Hatier international, 2002 (coll. “Monde noir”)
13. Collection of short stories published in Yaoundé, éditions Clé, 1971.
14. Paris, Présence africaine, 1982.
15. Montréal, Presses de l’université de Montréal, 1968; Paris, Seuil, 1970
16. Paris, Seuil, 2000
17. Published in Présence africaine in 1973 and 1979, respectively.
18. Published by Seuil in 1979 and 2000, respectively.
19. Published by Seuil in 1979 and 1983, respectively.
20. Article entitled “Afrique(s)-sur-Seine : autour de la notion de ‘migritude’” by Jacques Chevrier, in Notre Librairie, n° 155-156, July-December 2004, p. 96-100.
63 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
with the world and with their countries of origin. In this article, I will examine this “new African writing of the self” in relation to the themes it addresses that are specifc to the feld of “immigration” literatures, which reveal attitudes to the immigrant African community in France. After identifying the key characteristics of this writing through the diverse styles encompassed, I will then consider the situation of the displaced writer and the literary identities this produces.
Literary panorama and thematic choices
The emergence of this new literary feld cannot be contextualised without briefy revisiting the general history of what is commonly known as “African”, or even “sub-Saharan African”, literature, in order to highlight its departure from it. Indeed, unlike nationalist, pan-Africanist writers, who saw themselves as the true midwives of history (Senghor, Kwame Nkruma, etc.), as well as the writers mentioned earlier, each of whom helped – in their own way – to describe the colonial acts of violence, less than rosy post-independence futures, and daily challenges of this new Africa, the writers of the African diaspora helped establish a new “writing of the self”. I will examine the personal trajectories and work of the most emblematic authors of this literary movement, which continues to this day, despite the inequalities and exclusion inherent in French society, which still struggles to recognise its own cultural diversity 22
Calixthe Beyala: from Douala to Belleville
Originally from Douala, the Cameroonian essayist and novelist Calixthe Beyala was separated from her mother at a very early age and grew up in Cameroon, raised by her grandmother in a situation of great precarity. Her intellectual abilities, which became clear as early as primary school, led her to pursue further education in France, where she settled permanently at the age of twenty-four. Her œuvre, which now includes around ffteen novels and a few
21. With reference to Odile Cazenave, who defned the literary movement of “Africa on the Seine” writers in these terms in her eponymous work published by L’Harmattan in 2003 (coll. “Critiques littéraires”).
22. See, in particular, the work of historian François Durpaire, whose latest work, Nous sommes tous la France ! Essai sur la nouvelle identité française, was published by Philippe Rey this year (coll. “Documents”).
essays, immediately took the form of a complicated feminism. This was particularly apparent with in C’est le soleil qui m’a brûlée 23 , her frst novel, which conveys the diffculties surrounding the survival of patriarchal society and the revolt of Ateba, a prostitute who murders one of her clients after being humiliated. From that point on, Beyala’s work becomes one long feminist manifesto, relentlessly lambasting the cowardice and betrayal of the opposite sex and calling upon women to escape their age-old state of alienation. The year 1992 witnessed a turning point in the author’s work with the publication of Petit Prince de Belleville 24 , her fourth novel, in which the stage moves from Africa to Paris. Through the epistolary confessions of Abdou Traoré, an unemployed, polygamous immigrant worker, the novel presents the disillusionment and frustrations of a man who, confronted with a new civilisation, fnds himself robbed of his traditional values, starting with the docility and obedience of his two co-wives, who have had their frst taste of freedom. In an imaginary letter with a French interlocutor, he writes : “ We are living in a double world – I know it, and you know it –, what we might describe as a type of double meaning, or double life. We walk in parallel, like acrobats on the tightrope that separates us, between two abysses of opposing realities. Day obscures night. And night awakens the silences of the day. In the end, light must prevail; we must make sure of it. […] I am lost, my friend. What can we do? I am puzzled by your traditions, which I wish neither to offend nor to understand, lest I lose myself and my faith, the strongest thing I have, and which is unparalleled. It is all I have left, my friend.”
While patriarchal fgures fnd themselves out of their depth when caught between these two worlds, women derive a sense of intoxication and freedom, especially thanks to the education and teaching they were previously denied. This is the case for the character Saïda, for example, the heroine of Honneurs perdus 25 , who arrives in Paris at the age of ffty, armed only with her virginity. Working as a domestic helper in the home of a compatriot, she learns to read at evening classes, with the help of Maîtresse Julie and her boss, who boasts to her friends of “turning a slattern into a trained monkey ”. At Belaya’s home, there is no complacency for the situation of African
23. Paris, Stock, 1987.
64
24. Paris, Albin Michel, 1992.
LE POINT SUR | MIGRANT WRITERS, IMMIGRATION LITERATURE, AND DIASPORA WRITINGS
25. Paris, Albin Michel, 1996. Grand Prix du Roman awarded by the Académie Française in the same year.
immigrants in France, and it is the women who run the show, like a group of Mother Courages.
From Bleu-Blanc-Rouge to Black Bazar: the trials and tribulations of a Congolese man in Paris
Of the same generation as Beyala and born in Congo-Brazzaville, after publishing several poetry collections the novelist, poet and essayist Alain Mabanckou truly launched his literary career with an archetype of the immigration novel – at the time, he was unaware that he was helping to forge a new literary movement: In , Bleu-Blanc-Rouge 26 , his frst novel, was published. In it, he depicts the hard-luck struggles of young Massala-Massala, a naive African man of little education, who moves to Paris hoping to achieve his dream of success, following the example of one of the “great men” of the neighbourhood, known as Charles Moki. The narrative is shaped primarily by the blind fascination indigenous Congolese people have for France, which they see as a paradise and even a place of worship, describing “ the metro lines with extraordinary talent, station by station, almost as though they had spent time living in Paris ”. Albeit somewhat gratingly, the novel also denouces the psychological violence and humiliations to which illegal immigrants are subjected. After his fruitless attempts to remain in his El Dorado at whatever cost, Massala-Massala is fnally admitted into the ranks of the individuals repatriated on a compulsory basis and forced to take one of the “charters of shame” poked fun at in the French news. As well as this humiliation, suffered by Africans of all nationalities, who were herded off like merchandise and dispatched back to their “individual countries […] to stop anyone that can’t speak or understand French from fnding themself in a country not their own”, the author also clearly highlights the reason they refused this forced return:
“The African people are resigned. Disappointment is written all over their faces. They return against their will. They are tormented not so much by the need to stay, but rather by the fear of facing the large family that awaits them. […] That is what we are afraid of. It takes courage to arrive after a long journey without a present for your mother, father, brothers and sisters. The dread of it sticks in your throat. It robs you of your reason for living.” With this text, published in – in
the vein of a bildungsroman, oscillating between the serious and burlesque – Mabanckou lay the foundations of the diffcult situation experienced by African immigrants in France, and explains their reasons for moving to Paris – beyond economic and political considerations – that idealised, mystifed city.
More than a manifesto about the condition of immigrants in France, Black Bazar is above all a life-writing novel about an
individual confronted with the cosmopolitan group that prefgures contemporary France.
Ten years and fve novels later, the novelist fnally returned to the setting of the capital city in Black Bazar27, which describes the daily life of a Congolese man in Paris. This is no longer a story of naiveté, and even less one of fascination with the City of Lights. Rather, the novel tells the story – conveyed in the comic, grotesque tone which the author masters – of an individual living in a space where the coexistence of immigrants of different nationalities represents an ongoing forum for debate. This is conveyed through offhand remarks rather than debates, since Fessologue – the name given to the narrator, who has made it his vocation to study the “other side” of women –, having been recently dumped by his girlfriend, nicknamed “Couleur d’origine” (Colour of Origin), never ceases to console himself and refect on his condition, having undertaken to write his life story, at Hip’s for the most part, an Afro-Cuban bar in the centre of Paris. More than a manifesto about the condition of immigrants in France, Black Bazar is frst and foremost a life-writing novel about an individual subject confronted with the cosmopolitan group that prefgures contemporary France. The narrative describing Fessologue’s life –including his dreams, failures, how he arrived in France, and his nostalgia for his native country – provides an insight into a new social landscape that French society struggles to accept. Based on a individual experience, the novel draws attention to all the diffculties France currently experiences in welcoming others and enabling them to thrive, simply because of discrimination rooted in the colour of their skin. It also offers a decentred look at the madness of the world
65 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
26. Paris, Présence africaine, 1998.
27. Paris, Seuil, 2009.
that surrounds the protagonist, as well as the daily racism and received ideas that characterise it. This can be seen, for instance, in the comments made by his racist neighbour, Monsieur Hippocrate, who never stops moaning about how “rude” the African tenants are: “He went and snivelled to our landlord that some small groups of Africans were stirring up ill feeling in the building, claiming they had turned their rooms into a sort of tropical haven, slaughtered cocks at fve in the morning to collect their blood and played the drums in the middle of the night to send coded messages to their genies from the bush and hex France.” And to top it all off: we fnd out much later in Monsieur Hippocrate’s narrative that he is in fact from Martinique!
Fatou Diome and the geography of a text situated on both sides of the Atlantic
After marrying a Frenchman and thereby becoming a resident of Strasbourg, the Senegalese writer Fatou Diome made a remarkable entrance onto the literary scene with her collection of short stories La Préférence nationale 28 (National Preference), which is structured around two geographical spaces : Senegal and France. This dichotomy and back and forth movement was set to become a permanent feature of the novelist’s work. However, it is important to stress once again that this is by no means a Manichean vision of things, between the revival of an idyllic Africa and the description of a French society with little sympathy for its foreign nationals. Indeed, in the frst short stories in the collection, “La Mendiante et l’écolière” and “Mariage volé”, the narrator describes miserable living conditions characterised by daily mistreatment and humiliations somewhere on the African continent, while in La Préférence nationale, the character Cunégonde, the domestic employee of a couple from Strasbourg, is constantly humiliated by her employers, who ultimately fre her when they fnd out she is studying Modern Literature at the same time. No doubt in their narrow-minded, ignorant minds, such an image did not ft with their vision of a cleaning lady, not least a black one.
Le Ventre de l’Atlantique 29 describes the experience of Salle, a Senegalese immigrant in France who tries to dissuade his brother Madické from coming to
join him in this country, which is not what he believed it to be or indeed how people described it to him. Among the hidden sides of immigration uncovered in the texts, the author also reveals the diffculty of returning to one’s country of origin, whether temporarily or permamently. “For me, returning home is like going abroad ”, states the narrator of Ventre de l’Atlantique. Three novels later, in the same thematic vein as her frst novel, Celles qui attendent 30 , Fatou Diome’s latest work returns to this experience of oscillation – and of schizophrenia – but this time among those that have remained on the other side of the Atlantic, watching their husbands and sons set off clandestinely for the other side, risking their lives in the process. Regarding her bold decision to switch between different points of view, the author explains that: “This is frst and foremost a tribute to the women who, because of immigration, the absence of the men in their lives, or even their husbands’ abdication of responsibility, are doing their best to support their children. Even if their husband is in a good position over there, has a job as a civil servant and, for instance, takes a second wife, his frst wife cannot just walk away from the family home, and her children; she must battle on continuously. Immigration adds an additional struggle to this tragic state of affairs, but it is often sadly the fate of women in Africa to have to prepare the carriage of the heads of family 31 .” It is this position between two shores, this ongoing oscillation back and forth, and this cross between community mindsets that are at times a source of veritable suffering (for example, polygamy) and the frenzied individualism typical of western societies that establishes the writer – as she herself likes to defne herself – as a “hybrid being”, in reference to the concept dear to Salman Rushdie.
“Putain de corps sans patrie”: Sami Tchak’s Place des fêtes
After publishing several essays, notably on sexuality in Africa and prostitution in Cuba, the Tongolese writer Sami Tchak, who has lived in France for over twenty years, made his true entry onto the literary scene with the publication of Place des fêtes 32 , a provocative, unsettling novel that would change the
66
28. Paris, Présence africaine, 2000.
29. Paris, Anne Carrière, 2003.
30. Paris, Flammarion, 2010.
31. Interview with Nathalie Philippe published on www. culturessud.com.
LE POINT SUR | MIGRANT WRITERS, IMMIGRATION LITERATURE, AND DIASPORA WRITINGS
32. Paris, Gallimard, 2001 (coll. “Continents noirs”).
African literary scene for good. The novel describes the experiences of a young man living in the Parisian suburbs, born “here” to parents “born over there”. This is the fate of many children of immigrants in France. Through the description of his amusing everyday life, the novel enters into an important refection on the identity and situation of these children, who fnd themselves hopelessly stuck with “ their bums between two stools ”. The return to the father’s experience of immigration, which is initially seen as a victory, is a clear part of this sense of schizophrenia established both within the immigrants’ host society and within their family back home as a result of their experience of unease: “ Dad, you’ve got serious problems to contend with, major money issues; precarious work, unemployment, relying on benefits, disgusting accommodation, no time for fun; resentment that your future will be forever compromised by your age, like some sort of rotten kiwi. Dad, for your people back home, you are dead. It’s true! You no longer reply to their letters because there’s nothing you can do for them anymore. But you only existed thanks to the money you used to send. You’ve retreated into a deathly silence. While French society turns you away, you are losing your village and your Africa. Africa, your native land, your family, your parents; it is all becoming a distant reality. This is the sorry fate of the forced or voluntary exile.”
Other collections; other visions
By way of example here, I have chosen to consider those writers who are most representative of these new forms of writing the self, which present a series of identity refections raised by the immigration literatures studied here. The overall vision that emerges of the African immigrant’s situation in France is also quite pessimistic, since they are ultimately rejected on all fronts. Only female characters seem to be able to capitalise on the situation, for example through education, to which they rarely had access in their countries of origin.
However, one recent work dealing with the status of female African immigrants in France has disturbed readers a great deal: Des Fourmis dans la bouche 33 , by Khadi Hane. The heroine of the novel, Khadidja Cissé, is a lone mother of fve children who lives in a rundown apartment in the Château- Rouge
area of Paris with her children, and whose only concern is to be able to support them. Marginalised by her community of origin, who reject her for having had her last child with a married white man, who is none other than the owner of the unsanitary housing where she lives, her life revolves around the visits of the social worker who threatens to place her children with foster families and the mockery of her next-door neighbours. Khadidja belongs to this world of invisible people with no homeland or real family. A true novel on the female condition in the context of immigration, Des Fourmis dans la bouche plunges the reader into an extreme environment, in which the heroine, because of her choices or simply because she had no choice, does not feel she belongs to any community, in a country in which she does not exist. Regularly accused of exaggerating the situations she depicts, Khadi Hane justifes herself on the grounds that there are many immigrant women in France who, having chosen not to follow their husband, arrived in their own stead to study or simply to escape the poverty of their home country. They live in the most abject poverty and every day is a fght for survival.
We could have examined other cases through the works of Daniel Biyaoula, Bolya, or even Bessora. Yet other works dedicated to the question have already taken such an exhaustive approach, following the example of the studies by Odile Cazenave mentioned earlier. What we wish to highlight here is the duality of the process, both in the lives of the characters and in that of their demiurge. To this end, Papa Samba Diop’s analysis bears mentioning here: ”A writing of difference, migrants’ writing betrays a double life, permeated at once with the memory of their home country and the new realities of their host society 34 .”This simultaneous disengagement from both their culture of origin and their host culture inevitably leads the writer of “migritude” to occupy a third-space, which becomes a space of literary creation. After interviewing some of these writers about their position as immigrant writers or as descendants of immigrants, I believe they can be seen to position themselves fully as writers of the diaspora and that they therefore aspire to a certain form of universality in their writings.
67 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
33. Paris, Denoël, 2011.
34. Papa Samba Diop, “Le pays d’origine comme espace de création littéraire”, in Notre Librairie, n° 155-156, “Identités littéraires”, July-December 2004, p. 60.
The necessary rehabilitation of the sub-Saharan or Afrodescendant character
For the Cameroonian novelist Léonora Miano, “literature is universal, whatever themes it tackles and whatever settings or cultures it presents, insomuch as, by focusing on the human, it reveals that which we share ”. She adds that : “ texts by sub-Saharan writers are seen as specific on account of their eurocentric perspective, which cannot easily enter into the experience of others. By creating the racial categories in which we are still bogged down – possibly forever –, the West has established a vision of itself which means it cannot recognise its own characteristics in those of others ”. The term “immigration literature” does not really seem to work with Miano, since it is again seen through the prism of the West. The author justifies the thematic choices in her novels, which cover African realities 35 and “AfroEuropean 36 ”, ones, not only through the fact that she used to live in Cameroon and now lives in France, but by referencing the history of Afro-descendant people, which she now refects on constantly : “Regarding the reasons behind my thematic choices, the fact that I left Africa for Europe had no real impact. I have always belonged to two different spaces because I come from a territory dominated by Europe, shaped by it. Africa as we now know it is a European construction, which sub-Saharans still have trouble accepting, for a whole host of reasons that do not belong to them alone. Lastly, I have my own personal journey. I actually came into contact with the experience of Afrodescendant people very early on, as an adolescent. Caribbean and Afro-American infuences are important to me, and I always try to situate my writing in a space in which links can be forged between sub-Saharans and Afrodescendants. Hence the recurrence of the motif of the slave trade in my work. I work a lot on memory, on the unspoken in history, seeking to bring out a sub-Saharan voice on certain questions. Yet this transatlantic history within me does not belong to black people alone. It is also the story of those that aspired to be white by inventing the Black person and assigning him/her a place, often outside of humanity. In my
writing, Black and White are not biological categories. They are historical entities. Remember that the sub-Saharan only became black in the eyes of the world – and in their own eyes – at a specifc point in history 37 For a very long time, they did not consider themselves as black, nor as African; these were designations given to them as a result of their encounter with Europe. […] For me, it is essential to give the sub-Saharan or Afrodescendant fgure their individuality back 38 ”.
Leonora Miano, whose most recent literary work could easily be classed as “immigration literature”, thus goes much further in her writing process with this constant desire to reestablish some form of historical truth in her characters’ situation, whether they are African or Afrodescendant. Her characters, each in their individual way, are the standard bearers of this historical complexity, which is the basis of all her refections and her work as a writer.
The French novelist of Senegalese origin Mamadou Mahmoud N’Dongo seems to fully ascribe to this historical view and this fundamental place in universal literature. For the writer, the combination of several different historical and migration factors has led to a natural deterioration of the French language, which is too often confined to the “Francophonie”: “A man turned in on himself, or a nation turned in on itself, are atrophied. It is in our nature to be constantly on the move. From the moment we are born right up until our death, we are living organisms, from a philosophical perspective and in a physical or even geographical sense. A civilisation’s greatness can be measured in terms of its expansion, that is, by its invasions (its aggressive desire for power), its economic power (industrial know-how), and how it confronts ideas (following the example of religion or the Enlightenment). I like the word
35. See, in particular, L’Intérieur de la Nuit, Contours du jour qui vient and Les Aubes écarlates, published by Plon in 2005, 2006, and 2009, respectively.
36. Cf. Blues pour Élise et Ces âmes chagrines published by Plon in 2010 and 2011, respectively.
37. “Lorsque le terme kamite/kemite est employé pour dire Noir, il ne fait pas référence à la couleur de la peau, comme dans la perception racialisée. Pour ceux qui s’attachent à la civilisation égypto-nubienne comme socle de leur pensée, le noir représente la matrice, le lieu des gestations, et n’est pas vu comme opposé au blanc. Le terme n’induit pas, dans cette acception, de jugement de valeur.” [Translation: “While the term ‘kamite/kemite’ is intended to mean Black, it does not refer to skin colour, as in racialised understandings. For those that cling to Egyptian-Nubian civilisation as the pedestal of their thinking, black represents the matrix, the site of gestations, and is not seen as the opposite of white. Based on this understanding, the term does not lead to any value judgement”] (Note by the author).
38. Remarks made during a private correspondence with the author.
68
LE POINT SUR | MIGRANT WRITERS, IMMIGRATION LITERATURE, AND DIASPORA WRITINGS
“community”; I like the brotherhood of the diaspora; as an individual, I am part of a vast, ever-moving group; I like this thought, the notion that I will never be stateless, and that I can hold onto my status as a Fula person, and to writing in French. By birth, I belong to a civilisation that, through its expansion and its empires, has conquered all of Africa, just like the French empire, which introduced me to the French language, opening up the door not to French or Francophone literature, or to world literature, but to a country without borders; French-language literature.”“We need something else!”
The Congolese poet Tchicaya U Tam’si, who spent most of his life in France, made the following declaration during a round-table discussion on the question of “National writing, ethnic writing, or just writing?” in : “I have broken ties with my tribe, with my ethnic group, and with Africa. We need something else. I fnd myself eager to conquer and destroy a number of bastions that have been forbidden to me, and which I wish I could inhabit. For that reason, I have assumed a position of estrangement 39 .”The author of Mauvais Sang touches on an avant-garde issue here that writers now seem to have abandoned in the name of a diasporic space and of a linguistic and historical community that goes beyond the academic limits of the Francophonie. The Cameroonian Eugène Ébodé, for instance, can only see one possible avenue: “I am a writer of the diaspora. For me, any other inscription
would be a facade, a ridiculous mask. Which diaspora are we talking about here, though? The African one, of course! In my latest novel, Métisse palissade 40 , I raise this question and propose a response: I am Cameroonian. At every possible opportunity, I wish to present the itinerary of a Beti child who, in his novels, pronounces from above, in the words of the ancients : “This is the story of… ”
Thanks to these textual analyses, as well as to some remarks made on the spot, it has become clear that, to engage in ethical – or even equitable – criticism, it is essential to keep sight of the national or binational rationale that marks all texts written by so-called “diaspora”writers. As we have seen, for sub-Saharan Africa, diaspora literature is a relatively recent phenomenon, and criticism in this feld remains the preserve of specialists. For, as has too often become apparent, driven by universal aims, these texts brim with a learned mesh of civilisations. This is the result of a shared history, and most importantly, a painful one. In her analysis, Leonora Miano notes how complex such literatures are, even in the “general public” guise in which they are at times presented. It is essential not to confuse a simple reading with the complex analysis required of a work that falls within the feld of diaspora literature, and which therefore encompasses multiple civilisations, histories, and individual fates. Such writers must not be held back by an overly simplistic critical perspective, which overlooks the socio-historical and economic factors that have determined their personal experiences and writing choices.
69 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
39. Remark by Tchicaya U Tam’si in Notre Librairie, n° 83, April-June 1986, pp. 17-23.
40. Paris, Gallimard, 2012 (coll. “Continents noirs”).
Traduction en anglais Victoria Weavil
X Paris, 2011, Camara Production est l’une des principales maisons de production audiovisuelle sur l’Afrique de l’Ouest. Ses artistes sont essentiellement originaires du Mali, du Sénégal et de Mauritanie.
X Paris, 2011, Camara Production is one of leading audiovisual production houses on West Africa. The artists are mainly from Mali, Senegal and Mauritania. Gilles Crampes / Collectif HUMA.

La diaspora est-elle (vraiment) un creuset de créativité ?
Jean-Baptiste Meyer, chercheur au Ceped (Centre population et développement, IRD et Université de Paris).
Si la diaspora est souvent considérée comme un vivier potentiel de talents, il convient de fonder cette appréciation sur l’analyse du lien entre mobilité et créativité. Des éléments issus de la recherche fournissent des explications donnant un crédit avéré à cette vision positive. Cette dernière repose à la fois sur la capacité d’action du migrant, sa situation marginale entre plusieurs territoires et systèmes de représentation, et son insertion dans une mobilité diasporique propice à la création. “
Je suis issue d’un curieux mélange de rigueur alsacienne héritée de ma mère et d’aptitude à agir sur le réel… pour le transformer en rêve poétique, héritage de mon père (nord-africain)… Dès ma naissance, la dualité a semblé être un sceau qui marquerait toute mon existence », confie Betoule Fekkar-Lambiotte dans La double présence 2
Elle n’est guère la seule : nombre de citoyens français, binationaux ou non, revendiquent une origine étrangère et leur appartenance à deux sociétés, avec ferté. De jeunes intellectuels africains, eux-mêmes expatriés, révèlent en effet la mise en récit positive que produisent leurs homologues chercheurs, ingénieurs, entrepreneurs, artistes plasticiens, musiciens, écrivains, et autres, sur leur trajectoire
1. Article initialement publié dans Hommes & Migrations, n° 1332, 2021, pp. 127-133.
2. Betoule Fekkar-Lambiotte, La double présence, Alger/Paris, Casbah éd./Seuil, 2007, p. 44.
3. Aziz Nafa, « Chercheurs et entrepreneurs algériens à l’étranger », in Young African Scientists in Europe (YASE), Toulouse, avril 2019. URL : https://www.youtube.com/watch ?v =6OK8yg23i-U ;
Chaher Mohamed Saïd Omar, « L’identité plurielle/interculturelle comme ancre de carrière artistique », Thèse de doctorat (en cours). URL :https://www.ceped.org/fr/formation/theses-encours/article/l-identite-plurielle-comme-ancre.
socio-professionnelle marquée par des références culturelles issues de deux foyers distincts 3 . Si ces individus perçoivent souvent leur double identifcation comme constructives dans leurs itinéraires – non sans nuances et souffrances –, les collectivités qui leur sont associées, dans les pays d’accueil et d’origine, couvent en eux de plus en plus ouvertement des capacités inédites liées à leur position d’intermédiaire.
Les ressortissants des diasporas africaines apparaissent ainsi comme des agents de transferts scientifques et techniques ou de développements économiques – particulièrement entrepreneuriaux –naturellement dotés de compétences d’ambassadeurs, de traducteurs, de passeurs, dont la mondialisation serait friande 4 . Bref, que ce soit par leur localisation stratégique dans le paysage social ou par des facultés exceptionnelles façonnées à travers leur imprégnation multiculturelle, ils constitueraient des ressources
4. Voir Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique (Codesria), « Chercheurs en mouvement : réclamation du soutien de l’enseignement supérieur en Afrique à la Diaspora Africaine », numéro spécial de la Revue de l’enseignement supérieur en Afrique, vol. 16, n° 1-2, 2018. URL :https://codesria.org/IMG/pdf/-244.pdf ; et le Forum des diasporas africaines, vaste réunion d’affaires annuelle pour le monde socio-économique franco-africain, 2020 [en ligne]. URL : https://forumdesdiasporas.com.
71 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
créatives originales. Ces deux visions, quelque peu structuraliste pour la première et essentialiste pour la seconde,sont-elles conceptuellement crédibles et empiriquement validées par des faits ? En somme, a-t-on raison de fonder des espoirs dans ces aptitudes conférées à la diaspora ?
L’avènement du migrant comme acteur multi-situé
Sur le plan conceptuel tout d’abord, la diaspora jouit d’un engouement certain mais récent, même si le terme est ancien 5 . Il est volontiers associé aux notions d’hybridité, de métissage, de créolisation, de syncrétisme, de circulation voire de liquéfaction, magnifiées par des auteurs souvent qualifiés de défenseurs d’une approche postmoderniste. Or cette dernière fait l’objet de critiques pour son caractère
impressionniste et fguratif. Les connotations positives de la diaspora aujourd’hui ne sont point exemptes des controverses qui animent ce champ de réfexions. La belle image dont elle jouit tient, il est vrai, à des représentations avantageuses : celles de spores distribuées par des fux porteurs, venant inséminer des terrains éloignés, en un exercice naturel et vital de fertilisation croisée ou de pollinisation écosystémique… La désagrégation sémantique du concept avoisineainsi des métaphores biologiques bucoliques qui émaillent les discours à la mode sur l’innovation et l’entrepreneuriat. De fait, il n’y a là guère plus de consistance que dans les visions fantasmées d’une homogénéité culturelle à préserver pour conserver la pureté ethnique, seule garante de l’identité sociale…
C’est précisément parce que les deux approches affchent des représentations contradictoires – et intrinsèquement superfcielles – qu’elles sont objets de spéculations infnies et d’inépuisables confits. Les uns défendront le ressourcement à l’authenticité ancestrale et les autres les promesses d’une diversité biopolitique

72 LE POINT SUR | LA DIASPORA EST-ELLE (VRAIMENT) UN CREUSET DE CRÉATIVITÉ ?
et sociale. Il faut dépasser ce niveau
5. Stéphane Dufoix, La dispersion. Une histoire des usages du mot diaspora, Paris, éd. Amsterdam, 2011.
X Magasin de saris à Paris 10e, dans le quartier surnommé « Little India » par le nombre élevé de boutiques et restaurants indiens (tamouls pour la majorité d’entre eux). À gauche : une représentation de Vishnu garant de la stabilité du Monde.
X A saris store located in Paris 10, in the district nicknamed ‘‘Little India’’ on account of its many Indian shops and restaurants (Tamils are the majority). On the left: a representation of Vishnu, in charge of guaranteeing the stability of the planet. Gilles Crampes / Collectif HUMA.
discursif afn de plonger au cœur de la valeur diasporique ajoutée, d’apprécier les conditions épistémiques de son apparition et d’en prendre éventuellement la mesure.
Tout d’abord, les particularités de la condition diasporique contemporaine prennent sens dans un contexte où les identités sont reconsidérées. La dernière décennie du XXe siècle accouche de travaux anthropologiques qui décrivent et analysent l’entremêlement des sociétés, notamment pour l’Afrique et l’Europe, et théorisent le rôle crucial et nouveau de la personne du migrant dans ces dynamiques transnationales 6 . Cet avènement du migrant-acteur intervient aussi à un moment où sa conception, comme être humain et social, perd de son homogénéité. Ce dernier est perçu comme une entité composite, plurielle, parfois comme un réseau, dans ses liens avec autrui7 Cette entité-personne agrège, combine et utilise des compétences en fonction de son histoire et de ses relations. Elle ne s’identife pas nécessairement à une communauté mais à plusieurs, situées sur différents plans rendus compatibles (professionnels, géographiques, politiques, affectifs, etc.).
Appliquée à l’humain en migration, cette pluralité constitutive de l’acteur social livre des clés d’interprétation éclairantes. Elle permet par exemple au villageois expatrié de jongler avec des références totalement exogènes à chacune des deux sociétés avec lesquelles il interagit. Il ou elle accommode, traduit, transmute des contenus pour pouvoir les faire circuler entre ses deux espaces de vie sociale. Cette agentivité (de l’anglais agency) – comme capacité à agir sur l’environnement et à le transformer – est indissociable de son caractère multi-situé (multisitedness). Pour s’actualiser, se réaliser, cette intelligence sociale produit des institutions, telles que les associations (hometown) par exemple 8 . C’est à
6. Entre autres : Jean-Loup Amselle, Logiques métisses. Anthropologie de l’identité en Afrique et ailleurs, Paris, Payot, 1990 ; Nina Glick-Schiller, Linda Basch, Cristina Szanton Blanc, « From immigrant to transmigrant :Theorizing transnational migration », in Anthropological Quarterly, vol. 68, n° 1, 1995, pp. 48-63.
7. Bernard Lahire, L’homme pluriel. Les ressorts de l’action, Paris, Nathan, 1998 ; sur la théorie de l’acteur-réseau et la construction d’un grand partage entre la société moderne et les autres : Bruno Latour, Nous n’avons jamais été modernes, Paris, La Découverte, 1991.
8. Thomas Lacroix, « Conceptualizing transnational engagements : A structure and agency perspective on (hometown) transnationalism », in International Migration Review, vol. 48, n° 3, 2014, pp. 643-679 ; Thomas Lacroix, « The multi-sited condition of transnational actors and its implication for identity and action », in Migration and Cognitive Change, Philadelphie, University of Pennsylvania, 30-31 mai 2017.
travers elles que des significations traditionnelles locales peuvent ainsi notamment être élaborées, réinventées, pour des transferts internationaux.
Dépasser l’approche pathologique de l’immigré
La psychologie cognitive ne s’est guère encore saisie de cet objet d’étude en tant que tel. Mais sa partie clinique travaille de fait sur les questions des transformations du psychisme, liées à la migration ou aux mobilités. Des praticiens des communautés expatriées, notamment, prennent en charge des patients issus de celles-ci pour des soins en lien avec leur situation particulière 9 . C’est alors plus souvent la dimension pathologique qui ressort. Elle ramène à une vision traumatique de la situation de la personne migrante avec ses troubles identitaires, caractérisés dans la « double absence 10 ». Ce pathos de l’immigré – approche également partagée par des travaux psychanalytiques – n’est pourtant pas une fatalité insurmontable. Le trauma peut-être intégré et géré, par les individus ainsi que par leurs communautés elles-mêmes, et il s’exprime ou évolue selon des conditions sociales extrêmement variables 11 Les tensions que génèrent ces transformations de l’être et les adaptations requises par une situation bi-culturelle apparaissent même comme l’occasion d’un déploiement de facultés extraordinaires. Le secteur de l’entreprise a fait l’objet de constats convergents sur cette réussite des marginaux. Ainsi, selon Norbert Alter, l’expérience montre que les patrons issus de groupes sociaux défavorisés (issus de la migration, en situation de handicap, minorité particulière) puisent les forces de leur réalisation professionnelle au cœur de leurs racines, et non contre elles12 . Plus encore, c’est dans le sentiment de discrimination dont ils font l’objet que se forgent leur
9. Sur le cas des Chinois et des latino-américains à Paris, voir respectivement Simeng Wang, Illusions et souffrances. Les migrants chinois à Paris, Paris, éd. Rue d’Ulm, 2017 ; JeanBaptiste Meyer, La diaspora. Hacia la nuevafrontera, Montevideo, IRD/Universidad de la Republica, 2015.
10. Abdelmalek Sayad, La double absence. Des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré, Paris, Seuil, 1999.
11. Simeng Wang, « The cognitive impact of mobility on migrants and receiving societies : Sociogenesis of mental suffering of Chinese in Paris and their mental health care use », in Migration and Cognitive Change, Philadelphie, University of Pennsylvania, 30-31 mai 2017.
12. Norbert Alter, La force de la différence. Itinéraires de patrons atypiques, Paris, PUF, 2012.
73 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
volonté et leur capacité à inverser la position de dominance. Les sciences de gestion et des organisations font un constat similaire positif : le brassage des individus peut certes secouer les vies et les personnes mais s’avérer productif pour eux et les collectifs auxquels ils appartiennent ou participent 13
Il y a dans ces confrmations empiriques de plus en plus fréquentes le prolongement d’une explication conceptuelle qui a émergé dès les années 1970. Celleci peut être condensée dans la fgure du « marginal sécant », positionné à la jointure de deux systèmes, vecteur de leur association et bénéfciaire des retombées de celle-ci. La théorie des réseaux a par la suite modélisé ces configurations et montré comment certaines positions périphériques optimisent les ressources – notamment cognitives – venues d’ensembles différents, en les interconnectant 14 . Ce que rajoutent les travaux récents à cette mécanique des associations, c’est l’épaisseur de cet acteur migrant, intermédiaire de ces mondes relativement séparés. Non seulement son histoire personnelle accumule des expériences et des liens mais, de surcroît, les ressentis et le vécu qui l’imprègnent déterminent sa motivation, son opiniâtreté et sa persévérance. L’esprit de revanche apparaît ainsi fréquemment comme un stimulus dans les récits de créateurs d’entreprise immigrés de deuxième génération, en particulierd’origine algérienne 15 . C’est un moteur de l’action qui s’alimente volontiers d’une discrimination initiale.
Le potentiel créateur de la mobilité diasporique
Dans la littérature socio-anthropologique, la position marginalea fait l’objet d’études qui démontrent son lien avec la création artistique ou l’innovation sociale. L’étranger de Georg Simmel, à la position précaire près de la porte, est aussi lié à la fgure du pont par lequel transitent les nouveautés introduites dans la cité. Parmi les trois catégories d’outsiders d’Howard S. Becker, les musiciens de danse développent sciemment la culture d’un groupe déviant, avec un statut d’extériorité, afn de conserver intacte leur capacité de création qui se dissoudrait
15 thèmes à explorer pour travailler au contact d’autres cultures, Paris, éd. Charles Leopold Mayer, 2014.
14. Michel Crozier, Erhard Friedberg, L’acteur et le système, Paris, Seuil, 1992 ; Ronald Burt, « Structural holes and good ideas », in American Journal of Sociology, vol. 110, n° 2, 2004, pp. 349-399.
15. Aziz Nafa, op. cit., note 2.
sinon dans la société. Mais ils ne rejettent pas le succès et la reconnaissance qui en proviennent, tout comme dans la socio-histoire que fait Nathalie Heinich de l’élite artiste 16 . Il y a là une ambivalence voulue, cultivée, une volonté de rester à la lisière de la société pour ne pas être tributaire de ses normes tout en recevant ses gratifcations. Liberté de création et reconnaissance sociale sont les deux termes parfois contradictoires et pourtant associésde ces postures dans les marges.
Certes, l’analogie entre une marginalité choisie et celle issue de la migration mérite bien des nuances. Mais le voyage permet de faire le lien entre les deux17 La décision de voyager est une quête d’ailleurs pour l’acquisition de valeur, fut-elle immatérielle. Les déplacements pour études ont ainsi récemmentfait l’objet d’examens détaillés 18 . La vertu pédagogique attendue est celle d’un décentrement de la personne, par sa confrontation à l’altérité, son exposition à l’inconnu, son adaptation requise à des contextes nouveaux. En l’occurrence, c’est bien de faire l’expérience d’une position minoritaire qu’il s’agit, en vue de produire une réaction d’apprentissage féconde. L’interaction atypique est source de connaissances nouvelles, éventuellement transformées en compétences durables. Métabolisées par l’individu, elles sont susceptibles d’être rendues – traduites – à la société en d’autres temps et d’autres lieux.
Par-là s’explique aussi une fréquence des profls nomades dans les professions créatives 19 . Ce n’est pas une volatilité absolue, en apesanteur ou dans le butinage permanent, mais bien plutôt une (des) immersion(s), éventuellement renouvelées, dans une mobilité partagée. Ce sont elles qui permettent des échanges sur le fond et des investissements de contenus significatifs. On sait combien les carrières d’artistes célèbres sont marquées par ces déplacements de lieux et d’institutions. L’impact sur leur
16. Georg Simmel, L’étranger, Paris, Payot, 2019 ; Howard S. Becker, Outsiders. Études de sociologie de la déviance, Paris, Métailié, 1985 ; Nathalie Heinich, L’élite artiste. Excellence et singularité en régime démocratique, Paris, Gallimard, 2005.
17. Loïc Brémaud, Hervé Breton, Sébastien Pesce (dir.), Voyage et formation de soi. Vivre l’épreuve de l’ailleurs, entre initiations et mobilités, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2020.
18. Vincenzo Cicchelli, « “Les voyages forment la jeunesse” : au-delà du lieu commun », in Après-demain, n° 24, 2012, pp. 21-23.
19. Jean-Baptiste Meyer, David Kaplan, Jorge Charum, « Scientifc nomadism and the new geopolitics of knowledge », in Internationale Social Science Journal, vol. 53, n° 168, 2001, pp. 309-321.
74 LE POINT SUR | LA DIASPORA EST-ELLE (VRAIMENT) UN CREUSET DE CRÉATIVITÉ ?
13. Michel Sauquet, Martin Vielajus, L’intelligence interculturelle.
travail apparaît au cas par cas à l’observation de leurs œuvres. Pourtant cette appréciation qualitative ne permet pas de généraliser ce constat ni de mesurer en quoi la mobilité a participé au développement de leur activité créative.
En revanche, cette montée en généralité et la mesure de l’impact de la mobilité diasporique sur le statut créatif ont pu faire l’objet d’approximations rigoureuses dans le champ scientifque. Ainsi, la diaspora sud-africaine, riche de plusieurs milliers de sujets hautement qualifés, a été investiguée lors d’une enquête précise. Celle-ci permet de comparer les cohortes de ressortissants dans la diaspora avec celles de leurs homologues par classes d’âge et issus des mêmes institutions de formation initiale mais restés en Afrique du Sud. Le critère distinctif retenu a été celui de l’obtention du plus haut diplôme universitaire, le doctorat. Celui-ci indique non seulement un niveaud’excellence académique mais aussi une performance créative, puisqu’il s’agit de l’accomplissement d’un projet individuel de recherche et d’une contribution originale à la science.

Les résultats de cette comparaison systématique, sur deux mille personnes recensées dans la diaspora, sont édifants : cette dernière compte deux fois plus de titulaires de doctorat que la population correspondante restée au pays d’origine. La théorie de la sélectivité migratoire dans l’exode des compétences – les meilleurs sont attirés par les pays riches – semble a priori se vérifer… Mais il n’en est rien, car un examen approfondi démontre un phénomène beaucoup plus subtil. En effet, lorsque l’âge de départ du pays d’origine est pris en compte dans l’analyse de la trajectoire des expatriés, le constat est celui d’une équivalence totale de diplôme et de niveau avec leurs homologues sédentaires au même moment. C’est par conséquent après leur départ et dans les pays d’accueil que se fait la différence. Autrement dit, la bonifcation de leur talent s’effectue à l’extérieur
20. Jean-Baptiste Meyer, « Déplacement et fertilisation : les chercheurs mobiles sont-ils meilleurs ? », in Voyage et formation de soi : les mobilités académiques et scientifques, Université de Rennes, 16 juin 2017.
75 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
X L’Étoile du Sud, épicerie marocaine ouverte à Paris depuis 1963. X L’Étoile du Sud, a Moroccan grocery store in Paris since 1963. Gilles Crampes / Collectif HUMA.
et non avant le départ. Elle est le résultat fnal du processus de mobilité et non celui d’un fltre sélectif posé sur le fux de départ… Et elle consacre l’effcacité de l’insertion en diaspora 20
Cette constatation statistique est confrmée par des entretiens individuels avec des chercheurs proéminents dans la diaspora. En déroulant leur histoire de vie, on apprend qu’ils ne sont pas nécessairement les meilleurs au début de leurs études, dans le pays d’origine. Ce n’est donc pas à eux que sont proposées les positions les plus avantageuses à l’issue des premiers cycles. Leur propension à se tourner vers d’autres options, à l’extérieur notamment, et à poursuivre plus avant, s’en trouve accrue. Là, confrontés à une adversité insoupçonnée mais aussi à des opportunités inédites, ils vont déployer une énergie considérable et atteindre des résultats exceptionnels. En raison de tous les efforts consentis et du fait des positions acquises de haute lutte, ils décideront souvent de s’installerdurablement, conformant ainsi une authentique diaspora intellectuelle.
Analyser les diasporas au niveau micro-social
Le cas de fgure est d’ailleurs bien connu des études historiques et fort bien analysé par la sociologie classique. Il correspond en effet à celui du « cadet de Gascogne », le cas d’Artagnan. Privé d’héritage par le droit d’aînesse et dans un souci de préserver l’unité du patrimoine familial, il s’en va construire un autre destin en terres étrangères, en l’occurrence à Paris 21 . Les historiens trouvent même des traces de réussite notable de certains de ces cadets plus tard jusqu’aux Amériques 22 Paradoxalement, ce ne sont donc pas les héritiers, ou les mieux dotés initialement, qui vont aller le plus loin tant géographiquement que socialement. Ironiquement, la migration rompt à l’occasion avec la
logique de reproduction dont elle est issue, et ouvre de nouvelles voies, personnelles et familiales.
L’entourage proche s’avère de fait essentiel dans la réalisation de l’excellence, qui dépasse l’individu. La sociologie de l’immigration américaine fait ressortir clairement ce qu’il en est de la réussite scolaire des deuxièmes générations, par communautés, aux États-Unis 23 . Les enquêtes révèlent que les enfants de migrants asiatiques ont des résultats supérieurs aux jeunes d’origine américaine, dont les scores sont eux-mêmes meilleurs que ceux d’ascendancelatino-américaine. L’analyse – transposable au cas euro-africain – souligne des effets contextuels de proximité plutôt que des différences culturelles massives. Le profl social familial, et notamment l’attention et le suivi éducatif au sein du foyer seraient des facteurs explicatifs déterminants de ces différences par communautés. Norbert Alter fait un constat similaire concernant l’entourage familial des patrons issus des minorités et de son infuence sur leurs succès 24 In fne , les pratiques opérantes au niveau micro-social apparaissent cruciales pour que se réalise le potentiel de la diaspora.
Ainsi, notre question initiale trouve, après analyse, une réponse défnitivement positive : la confguration diasporique est bel et bien propice à la créativité. Les explications théoriques et les constats empiriques s’associent pour le démontrer. Mais – prudence oblige – ils révèlent aussi qu’il n’y a guère de détermination macroscopique : au-delà du lien entre pays et diasporas, il faut que ces relations s’incarnent dans des acteurs aux entourages participatifs, pour qu’elles soient fécondes et prospèrent. Ce n’est pas un enseignement anodin pour la conception de politiques publiques… souvent pensées à grande échelle.
23.
24.
LE POINT SUR | LA DIASPORA EST-ELLE (VRAIMENT) UN CREUSET DE CRÉATIVITÉ ?
21. Pierre Bourdieu, Le bal des célibataires. Crise de la société paysanne en Béarn, Paris, Seuil, 2002.
22. Pierre Force, « Stratégies matrimoniales et émigration vers l’Amérique au XVIIIe siècle. La maison Berrio de La Bastide Clairence », in Annales, vol. 68, n° 1, 2013, pp. 77-107.
Alejandro Portes, Lingxin Hao, « The schooling of children of immigrants : Contextual effects on the educational attainment of the second generation », in Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, vol. 101, n° 33, 2004, pp. 11901-11927.
Norbert Alter, op. cit., note 11.
Is the Diaspora (Really) a Melting Pot of Creativity?
Jean-Baptiste Meyer, Researcher at the CEPED (Centre population et développement [Population and Development Centre], the IRD, and Université de Paris).
While the diaspora is often seen as a potential hotbed for talent, such an understanding calls for an analysis of the link between mobility and creativity. Evidence from research offers explanations that support this positive vision, which is based on the migrant’s capacity for action, their marginal position between different territories and systems of representation, and their integration into a diasporic mobility that fosters creativity.
“I come from a curious mix of Alsatian rigour passed down from my mother, and an ability to transform reality into a poetic dream; a legacy from my father, who was North African. Since I was born, this duality has been like a hallmark of my entire life ”, admits Betoule Fekkar-Lambiotte in La double présence 1 .”
She is far from alone in this: Many French citizens, of dual nationality or otherwise, are proud of their foreign origins and of belonging to two different societies. Young African intellectuals, also expatriates, highlight the positive narratives created by their counterparts – researchers, engineers, entrepreneurs, plastic artists, musicians, writers, and others – in relation to their social and professional trajectories, which are marked by cultural references from two different homes 2 . While such individuals often see this dual identifcation as a constructive part of their journeys – albeit not one which is uncomplicated or without suffering –, the communities with which they are linked, both in their host countries and in their countries of origin, increasingly openly covet
1. Betoule Fekkar-Lambiotte, La double présence, Alger/Paris, Casbah éd./Seuil, 2007, p. 44.
2. Aziz Nafa, “Chercheurs et entrepreneurs algériens à l’étranger”, in Young AfricanScientists in Europe (YASE), Toulouse, April 2019.
URL: https://www.youtube.com/watch ?v =6OK8yg23i-U ; Chaher
Mohamed Saïd Omar, “L’identité plurielle/interculturelle comme ancre de carrière artistique”, Doctoral thesis (in progress). URL: https://www.ceped.org/fr/formation/theses-en-cours/ article/l-identite-plurielle-comme-ancre.
the unique capacities connected with their position as intermediaries.
Members of the African diasporas are thus seen as the bearers of scientifc and technical knowledge and as catalysts of economic developments – particularly in the business world –who are ideally placed to serve as ambassadors, translators, and go-betweens, skills highly coveted in globalisation 3 In short, whether it is thanks to their strategic position in the social landscape or to the exceptional capacities bequeathed upon them by their multicultural experiences, they are seen as an original creative resource. Are these two visions – the former being relatively structuralist while the latter is more essentialist –conceptually credible and borne out empirically by the facts? In short, are we right to pin our hopes on these aptitudes attributed to the diaspora?
The advent of the migrant as a ‘multi-sited’ agent
On a conceptual level frst of all, while the diaspora has elicited considerable interest, this has only
3. See: Council for the Development of Social Science Research in Africa (CODESRIA), “Chercheurs en mouvement : réclamation du soutien de l’enseignement supérieur en Afrique à la Diaspora Africaine”, Special edition of Revue de l’enseignement supérieur en Afrique, vol. 16, no, 1-2, 2018. URL: https://codesria.org/IMG/ pdf/-244.pdf ; et le Forum des diasporas africaines, vaste réunion d’affaires annuelle pour le monde socio-économique francoafricain, 2020 [en ligne]. URL: https://forumdesdiasporas.com.
77 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
occurred recently, despite the term being an ancient one 4 . It is eagerly associated with notions of hybridity, mixing, creolisation, syncretism, circulation, and even liquefaction, particularly by authors often seen as champions of the postmodernist approach. Such an approach is criticised, however, for its impressionist, fgurative character. The positive connotations now associated with the diaspora have by no means escaped the controversies affecting this feld of thought. The favourable image enjoyed by the diaspora springs from a number of positive symbols: that of spores spread by fows of carriers, which come and inseminate far-off lands in a natural, vital exercise of cross-fertilisation or pollination of the ecosystem. The semantic disintegration of the concept thus touches upon the bucolic biological metaphors that pepper popular discussions about innovation and entrepreneurship. In fact, these visions are hardly any more consistent than the romanticised visions of a cultural homogeneity that must be preserved in order to maintain ethnic purity, the only guarantor of social identity.
It is precisely because the two approaches present contradictory – and intrinsically superficial – understandings that they have elicited unending speculations and disputes. While one upholds a return to ancestral authenticity, the other stresses the possibilities presented by biopolitical and social diversity. In order to get to the heart of the diaspora’s added value, appreciate the epistemic conditions of its emergence, and truly get the measure of it, we need to move beyond this level of discourse.
First of all, the distinctive characteristics of the condition of the contemporary diaspora take on meaning as part of a reconsideration of identity itself. The last decade of the twentieth century witnessed the emergence of anthropological works that describe and analyse the intermingling of societies, notably in relation to Africa and Europe, and theorise the crucial new role played by the migrant within these transnational dynamics 5 . This advent of the migrant-actor also occurred at a time when their conception, as a human and social being, became less homogenous. They came to be seen as a composite, plural entity,
and sometimes as a network, on account of their relationships with others 6 . This person-entity incorporates, combines, and makes use of competences according to their individual experiences and connections. They do not necessarily identify with one single community but rather with several, situated on different levels rendered compatible (professional, geographical, political, emotional, etc.). When applied to the migrant individual, the social actor’s constituent plurality delivers enlightening interpretive keys. For example, it allows the expatriate villager to juggle references that are totally exogenous to the two societies with which they interacts. They adapts, translates, and transmutes content in order to circulate it between the two spaces of their social life. This agency – as the capacity to act on and transform one’s environment – is inseparable from their multisitedness. In order to be actualised, or realised, this social intelligence produces institutions, such as (hometown) associations 7 ; through these, traditional local meanings can then be developed, and reinvented, in order to be circulated at the international level.
Moving beyond the pathological approach to the immigrant
Cognitive psychology has still not addressed this question as an object of study in its own right. Clinical studies are nonetheless carried out on questions relating to transformations of the psyche connected with migration and mobility. Practitioners from expatriate communities, in particular, take on patients from these communities for treatments connected with their individual situation 8 . Most frequently, then, the focus is on the pathological
6. Bernard Lahire, L’homme pluriel. Les ressorts de l’action, Paris, Nathan, 1998; on the theory of the actor-network and the construction of a great sharing between modern society and others: Bruno Latour, Nous n’avons jamais été modernes, Paris, La Découverte, 1991.
4. Stéphane Dufoix, La dispersion. Une histoire des usages du mot diaspora, Paris, ed. Amsterdam, 2011.
5. Among others: Jean-Loup Amselle, Logiques métisses. Anthropologie de l’identité en Afrique et ailleurs, Paris, Payot, 1990; Nina Glick-Schiller, Linda Basch, Cristina Szanton Blanc, “From immigrant to transmigrant: Theorizing transnational migration”, in Anthropological Quarterly, vol. 68, n° 1, 1995, pp. 48–63.
7. Thomas Lacroix, “Conceptualizing transnational engagements: A structure and agency perspective on (hometown) transnationalism”, in International Migration Review, vol. 48, n° 3, 2014, pp. 643-679 ; Thomas Lacroix, “The multi-sited condition of transnational actors and its implication for identity and action”, in Migration and Cognitive Change, Philadelphie, University of Pennsylvania, 30-31 May 2017.
8. On the case of Chinese and Latin Americans in Paris, see, respectively: Simeng Wang, Illusions et souffrances. Les migrants chinois à Paris, Paris, ed. Rue d’Ulm, 2017; Jean-Baptiste Meyer, La diaspora. Hacia la nuevafrontera, Montevideo, IRD/Universidad de la Republica, 2015.
78 LE POINT SUR | IS THE DIASPORA (REALLY) A MELTING POT OF CREATIVITY?
dimension. This produces a traumatic vision of the situation of migrants and their identity troubles, characterised by a situation of “double absence”9 . This pathos of the immigrant – an approach also shared by psychoanalysis – is not an insurmountable fate, however. Such trauma can be processed and managed, both by the individuals and by the communities themselves, and is expressed and evolves according to extremely variable social conditions10
The tensions generated by these identity transformations and the adaptations required by a bi-cultural situation also seem to present an opportunity for deploying extraordinary faculties. Studies of the business sector have demonstrated this success among the marginalised. According to Norbert Alter, for instance, experience proves that for bosses from disadvantaged social groups (with a migrant background, experiencing disabilities, or from a particular minority background), their professional achievements occur thanks to their origins, rather than in spite of them 11 . Furthermore, the feeling of discrimination to which such individuals are subject is precisely what gives them the determination and capacity to invert the dominant position. Organisational and management sciences have arrived at a similar, positive conclusion: the intermingling of individuals can indeed shake up lives and people, yet it can also prove positive for such individuals as well as for the communities to which they belong or in which they partake 12
These increasingly frequent empirical confrmations align with a conceptual theory that emerged in the s. This can be condensed into the fgure of the “marginal sécant” (which might be translated as the infuential outsider), who is situated at the junction of two systems and serves as a go-between between them, benefting from the combination. The network theory subsequently modelled these confgurations and demonstrated how certain peripheral positions
allow for an optimal use of resources – particularly cognitive ones – from different sectors by interconnecting them 13 . Along with this mechanism of associations, recent studies have also stressed the depth of the migrant actor, who serves as an intermediary between relatively separate worlds. Not only does their individual background encompass different experiences and connections, but their individual feelings and life experience determine their motivation, tenacity, and perseverance. Feelings of revenge thus frequently serve as a stimulus in the stories of second-generation immigrant entrepreneurs, particularly those of Algerian origin 14 . It is a driving force that springs from an initial experience of discrimination.
The creative potential of diasporic mobility
In socio-anthropological literature, studies have demonstrated the link between this marginal position and artistic creation and social innovation. Georg Simmel’s ‘stranger’, occupying a precarious position near the door, is also linked to the image of the bridge, across which novelties enter the city. Among Howard S. Becker’s three categories of ‘outsiders’, dance musicians knowingly develop the culture of a deviant group, in a position of exteriority, in order to preserve their creative capacities which would otherwise dissolve in society. Yet, as in Nathalie Heinich’s social history of artistic singularity, they do not reject the success and recognition that ensue 15 . An intentional, cultivated ambivalence can be seen here, a desire to remain on the fringes of society to avoid being dependent on its standards, while continuing to beneft from the rewards it offers. Creative freedom and social recognition are the associated and yet sometimes contradictory features of these marginal positions.
Of course, the analogy between voluntary marginality and marginality as a result of migration needs to be qualifed. Travel can, however, provide a link between the two states16 . The decision to travel constitutes a
9. Abdelmalek Sayad, La double absence. Des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré, Paris, Seuil, 1999.
10. Simeng Wang, “The cognitive impact of mobility on migrants and receiving societies: Sociogenesis of mental suffering of Chinese in Paris and their mental health care use”, in Migration and Cognitive Change, Philadelphia, University of Pennsylvania, 30-31 May 2017.
11. Norbert Alter, La force de la différence.Itinéraires de patrons atypiques, Paris, PUF, 2012.
12. Michel Sauquet, Martin Vielajus, L’intelligence interculturelle. 15 thèmes à explorer pour travailler au contact d’autres cultures, Paris, ed. Charles Leopold Mayer, 2014.
13. Michel Crozier, Erhard Friedberg, L’acteur et le système, Paris, Seuil, 1992; Ronald Burt, “Structural holes and good ideas”, in American Journal of Sociology, vol. 110, n° 2, 2004, pp. 349-399.
14. Aziz Nafa, op. cit., note 2.
15. Georg Simmel, L’étranger, Paris, Payot, 2019 ; Howard S. Becker, Outsiders. Études de sociologie de la déviance, Paris, Métailié, 1985; Nathalie Heinich, L’élite artiste. Excellence et singularité en régime démocratique, Paris, Gallimard, 2005.
16. Loïc Brémaud, Hervé Breton, Sébastien Pesce (ed.) Voyage et formation de soi. Vivre l’épreuve de l’ailleurs, entre initiations et mobilités, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2020.
79 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
quest for a distant land in order to achieve value, even if is intangible. Travels motivated by studies have been studied in detail recently 17. The expected pedagogical value entails a decentering of the individual through their confrontation with otherness, exposure to the unknown, and the adaptation necessitated by new contexts. Experiencing a position of minority is in fact the name of the game, as a way of triggering a productive reaction to learning. Atypical interaction generates new knowledge, which can potentially translate into lasting competences. Metabolised by the individual, such skills can then be given back – or translated – to society in other times and other places.
This also explains the large number of nomadic individuals in the creative professions 18 . They do not embody a state of complete volalitility, constantly fitting from one place to the next, but rather an experience (or multiple experiences) of immersion, possibly repeated, in a state of shared mobility. Such individuals allow for substantive exchanges and signifcant content investments. We know the extent to which famous artists’ careers are shaped by such movements between places and institutions. The impact on their work can be seen on a case-by-case basis by examining their individual oeuvres. However, such a qualitative assessment is not enough to generalise this observation, nor to determine how mobility has affected the development of their creative activities.
On the other hand, this increase in generalisation and the impact of diasporic mobility on creativity have been the subject of rigorous calculations in the scientifc feld. A detailed study of the South African diaspora has therefore been conducted, covering several thousand highly qualifed individuals. Thanks to this study, we can compare cohorts of citizens in the diaspora with those of their counterparts by age group and from the same educational institutions who instead remained in South Africa. The distinguishing criterion was having earned the highest level of degree: a doctorate. The latter indicates not only a level of academic excellence but also creative performance, since it involves carrying out an individual research project and making an original contribution to scholarship.
The results of this systematic comparison, carried out in relation to two thousand people recorded in the diaspora, are enlightening : the diaspora comprises twice as many doctorate holders as the corresponding population that remained in their country of origin. On the face of it, the theory of migratory selectivity in the brain drain – the bestskilled individuals are attracted to rich countries – appears to be borne out. This is not the case, however, since a more detailed study shows a far more complex situation. In fact, when we take into account the age at which expatriates left their country of origin when analysing their trajectories, the results show a full equivalence of qualifcations and level with their sedentary counterparts at a given point in time. Thus, it is after their departure and within their host countries that the difference occurs. In other words, their talents are fostered overseas rather than before their departure. This is the end result of the mobility process rather than the result of a selective filter applied to the flow of departures… And it supports the effcacity of joining the diaspora 19 This statistical observation is borne out by individual interviews with prominent researchers in the diaspora. When discovering their life stories, we learn that they were not necessarily the top of the class at the start of their studies, in their countries of origin. They were therefore not the ones to be offered the most desirable positions at the end of their frst degrees. As a result, their inclination to seek out other options, particularly overseas, and proceed further, is heightened. When they arrive, faced with unexpected adversity but also with new opportunities, they put in a huge amount of effort and achieve exceptional results. Thanks to all the effort they put in and their hard-won positions, they often decide to settle there in the long term, thereby forming an authentic intellectual diaspora.
Analysing diasporas at the micro-social level
This scenario is also well recognised in historical studies and has been analysed in detail by classical sociologists. It corresponds, in fact, to the case of the
80 LE POINT SUR | IS THE DIASPORA (REALLY) A MELTING POT OF CREATIVITY?
17. Vincenzo Cicchelli, “‘Les voyages forment la jeunesse’: au-delà du lieu commun”, in Après-demain, n° 24, 2012, pp. 21-23.
18. Jean-Baptiste Meyer, David Kaplan, Jorge Charum, “Scientifc nomadism and the new geopolitics of knowledge”, in Internationale Social Science Journal, vol. 53, n° 168, 2001, pp. 309-321.
19. Jean-Baptiste Meyer, “Déplacement et fertilisation : les chercheurs mobiles sont-ils meilleurs ?”, in Voyage et formation de soi : les mobilités académiques et scientifques, Université de Rennes, 16 June 2017.
“Gascony Cadet”, D’Artagnan. Deprived of his inheritance due to the right of the frstborn, and in the interests of preserving the unity of the family patrimony, he goes off to build his own future overseas, in Paris 20 . Historians have even found evidence of some notable later successes by these cadets as far away as the Americas 21 . Paradoxically, it is not the heirs, or those who are initally best off, who go furthest, either geographically or socially. Ironically, migration sometimes breaks with the original logic of reproduction, and opens up new paths, both personal and familial. An individual’s close circle also proves essential for achieving excellence, beyond the individual level. American sociology of immigration has clearly demonstrated the situation regarding the academic attainments of second generations, by community, in the United States 22 . Studies reveal that the children of Asian migrants achieve better results than youngsters of American origin, whose scores are themselves better than those of young people of Latin American
20. Pierre Bourdieu, Le bal des célibataires. Crise de la société paysanne en Béarn, Paris, Seuil, 2002.
21. Pierre Force, “Stratégies matrimoniales et émigration vers l’Amérique au XVIIIe siècle. La maison Berrio de La Bastide Clairence”, in Annales, vol. 68, n° 1, 2013, pp. 77-107.
22. Alejandro Portes, Lingxin Hao, “The schooling of children of immigrants : Contextual effects on the educational attainment of the second generation”, in Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, vol. 101, n° 33, 2004, pp. 11901-11927.
ancestry. The analysis – which can be applied to the Euro-African case – underscores neighbourhood contextual effects rather than large-scale cultural differences. The social profle of the family, particularly levels of attention and educational monitoring within the home, are decisive factors in explaining these differences between communities. Norbert Alter makes a similar observation concerning the family environment of bosses from minority backgrounds and the impact this has on their success 23 Finally, practices at the micro-social level appear to be crucial for ensuring the diaspora’s potential is fulflled. Based on this analysis, therefore, our initial question would appear to be met with a clear, positive response: the confguration of the diaspora is indeed conducive to creativity. This is borne out both by theoretical explanations and by empirical evidence. We must proceed with caution here, however, since macroscopic conditions have also been shown to have little effect: beyond the link between country and diasporas, in order to be fruitful such relations must be embodied by individuals with actively involved close circles. This lesson is far from insignifcant for designing public policy, which is often conceived at the large scale.
Traduction en anglais Victoria Weavil
81 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
23. Norbert Alter, op. cit., note 11.
Musiques
Mouvements
Migratoires : Hors
Flux Humains
Les humains forment une partie intégrante de l’ADN des musiques, faisant de cette discipline artistique un phénomène alchimique unique. Certains parleront d’un langage universel audible par tout un chacun, quand d’autres préféreront la hisser au rang d’expression sacrée dont seul(e)s les initié(e)s peuvent déchifrer les codes. La musique circule et brave les barrières par le canal complexe de l’humanité et la grâce de la passion, de l’amour et de la survie. Il est question de dialoguer sur les bienfaits de cette alchimie fondée, à la base, sur plusieurs concepts dont les libertés, les rencontres et les circulations. La musique est un excellent outil de réfexion et de méditation autour des enjeux des humanités à l’échelle transnationale. Le parcours photographique
« Musiques Mouvements Migratoires : Hors Flux Humains » est une invitation à une pratique de communion pour bénéficier de ses prometteuses vertus. Le photographe Samuel Nja Kwa nous convie dans des mondes sans frontières et révèle à travers chaque portrait la richesse des mouvements de nos humanités. La musique est cette grande et puissante poésie qui apaise, tout en irritant les pouvoirs. Elle a ce don de produire un efet inoubliable qui transcende les vies comme le soufe vital ; à se demander où va cette force qui nous anime
une fois que la musique s’en est allée ? Elle est faite d’êtres visibles et invisibles et elle compose l’esprit humain aux trames tonales et/ ou atonales illimitées qui nous portent à l’infni. Seule la musique est à hauteur du vent et des océans, car elle incarne l’expression parfaite d’un monde idéal qui se meut en nous par le moyen de l’harmonie. Selon Nelson Mandela, « la curieuse beauté de la musique africaine vient de ce qu’elle vous transporte même quand elle raconte des choses tristes. On peut être pauvre, avoir une maison branlante, avoir perdu son travail, mais les chansons redonnent espoir ».
Après la mélancolie, ce qui nous pousse à exprimer nos soufrances comme nos incompréhensions est la musique ou la mélodie car elle est sonore et lyrique. Il s’agit d’une poétique qui cristallise les expressions des sentiments ou des afects liés à nos dispositions spirituelles, religieuses et existentielles. Seule la musique peut invoquer les entités invisibles. À quoi bon lire de nombreux ouvrages quand un saxophoniste ou un contrebassiste peut à travers ses créations nous faire admirer d’autres mondes parallèles ?
Parce que Papa Groove nous fait bien entendre que le saxophone parle, à hauteur des mers, le langage de ceux qui ne savent pas lire et écrire d’autres langues que celles de leurs aïeuls. C’est un art qui apaise et parfois soigne les jours sans joie. Grave ou joyeuse, la musique épouse toutes les formes.
82 AU MUSÉE | PORTFOLIO
Nadine Bilong. Photos Samuel Nja Kwa.
Humans are an integral part of the DNA of music, making this artistic discipline a unique alchemical phenomenon. Some people speak of a universal language that everyone can understand, while others elevate it to the level of a sacred expression that only the initiated can comprehend. It circulates and crosses barriers through the complex channel of humanity and by dint of passion, love, and survival. Here, we will refect on the benefts of this alchemy, which is grounded on several key concepts, including freedom, meetings, and circulation. Music is an invaluable tool for refecting on human issues at the transnational level. How might this prism be comprehended, in a time of communion, and how can we capitalise on its exciting qualities? The photographic journey « Migratory Musical Movements: Beyond Human Flows» invites us to adopt this perspective. The photographer Samuel Nja Kwa plunges us into worlds without borders, revealing the richness of human movements through each individual portrait. Music is a majestic, powerful poetry that has the power to both appease and aggravate. It creates unforgettable efects that transcend the everyday like the breath of life; what happens to this life-giving force once the music has ended?
Migratory Musical Movements: Beyond Human Flows
It is made up of visible and invisible forces; it is the human spirit with unlimited tonal and atonal bases that opens up the gates to the infnite. Only music is equal to the winds and the oceans, since it is the perfect expression of an ideal world that exists within us, through harmony. According to Nelson Mandela, “The curious beauty of African music is that it uplifts even as it tells a sad tale. You may be poor, you may only have a ramshackle house, you may have lost your job, but that song gives you hope.” Faced with melancholy, music or melody – being sonorous and lyric – express our sufering and inability to understand. It is a form of poetic expression that crystallises feelings linked to spiritual, religious, and existential themes. Only music can invoke invisible entities. What is the point of reading scores of books when a saxophonist or a bass player can conjure up parallel words as soon as they strike up a chord? Papa Groove shows that the saxophone speaks a language equal to the seas, the language of those that only know how to read and write the languages of their forebears. It is an art form that appeases and relieves joyless days. Music embraces all forms, from the serious to the comic.
83 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
Nadine Bilong. Photos Samuel Nja Kwa. Traductions en anglais Victoria Weavil

Manu Dibango

C’est la langue des solitaires comme des mondains. La musique seule a une place dans le monde actuel si rapide, précisément parce qu’elle ne prétend pas dire des choses déterminées.
Comme le signifait si bien Manu Dibango, avec son rire inoubliable : « Nous [musiciens] sommes des bâtisseurs de ponts entre l’Occident et les Afriques, c’est une chance. » Il affrmait avoir l’harmonie de Bach et de Haendel dans les oreilles avec des paroles camerounaises. Il est autant de possibilités d’expression que de richesses.
Manu Dibango, Festival Jazz à Vienne, 2019. Manu Dibango, Jazz Festival in Vienna, 2019.
© Samuel Nja Kwa.
It is the language of the solitary as much as that of the busy socialite. Music alone has a place in our ever so frenzied modern-day world, precisely because it does not claim to say anything specifc. As Manu Dibango said so well, with his unforgettable smile: “We (musicians) are the builders of bridges between the West and Africa”. He claimed that he had the harmony of Bach and Handel in his ear, with Cameroonian lyrics. It is a powerful thing indeed to be able to call upon at least two possible modes of expression.
Bonga, Festival Jazz à Vienne, 2019. Bonga, Jazz Festival in Vienna, 2019.

© Samuel Nja Kwa.
Ray Lema, Festival Jazz à la Villette, Paris, 2021. Ray Lema, Jazz Festival in La Villette, Paris, 2021.
© Samuel Nja Kwa.
85 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART


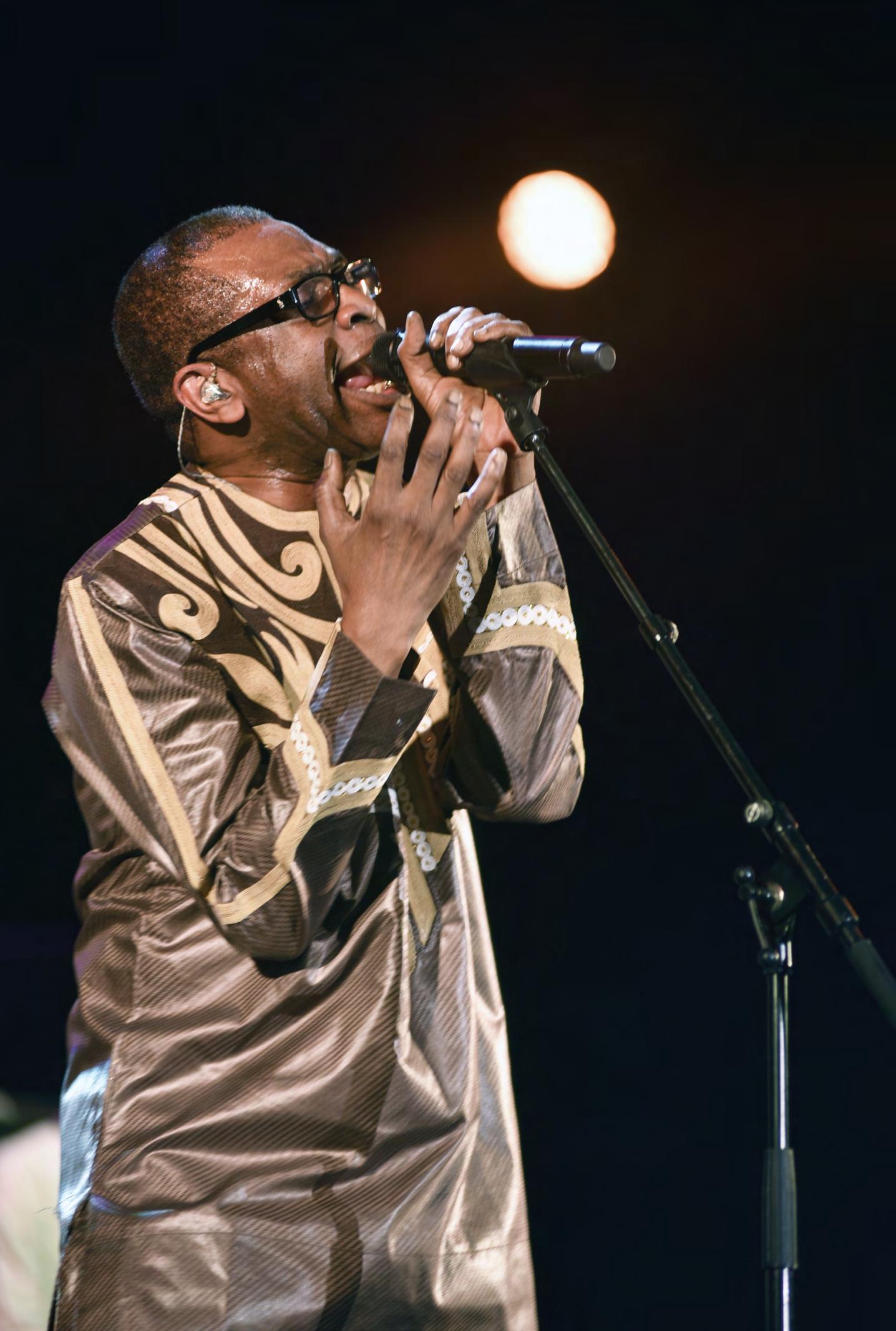
Vent et voix qui apaisent nos crispations, nous aident à reprendre des forces et ne jamais laisser l’obscurité et le chagrin avoir le dernier mot, jusqu’au dernier son. La musique nous apprendra qu’elle est l’expression parfaite d’un monde idéal qui s’exprimait à nous par le moyen de l’harmonie. Youssou N’Dour et bien d’autres artistes ont hérité des griots, dont l’âme toujours active trouve son repos dans la pratique des poésies, des dévotions, des chants traditionnels, des gestes et des sons qui rythment nos vies. La douceur des cordes vocales est aussi suave que la peau d’une liane et ne délivre ses secrets qu’à celui ou celle qui saura tirer les cordes. Fatoumata Diawara et Oum El Ghaït chantent comme on honore la nature. Elles savent aussi faire pleurer et rire. Heureux ceux qui ont cette faculté de faire danser le corps et l’esprit, tant la musique accompagne nos actes et nos actions.
Youssou N’Dour
The wind and voices alleviate tension, helping us to gather our strength and ensure that darkness and suffering never have the last word. Music is the perfect embodiment of an ideal word conveyed through harmony. Youssou N’Dour and many other artists have learnt from the griots, with their ever-active soul that can fnd solace only when practising poetry, devotions, traditional songs, gestures, and the sounds that form the rhythm of our lives. The vocal chords are as soft as the skin of a liana, which delivers its secrets to those that know how to pull the strings. Fatoumata Diawara and Oum El Ghaït sing as though they are paying tribute to nature. They also know how to make people cry and laugh. Lucky are those that can make us dance in our body and mind, for music accompanies our every move.
Page précédente / previous page :
Salif Keita, Festival Jazz à la Villette Paris, 2018.
Salif Keita, Jazz festival in La Villette, Paris, 2018.
© Samuel Nja Kwa.
Ci-contre / opposite :
Youssou N'Dour, Festival Jazz des 5 continents, Marseille, 2018.
Youssou N'Dour, the 5 continents Jazz Festival in Marseilles, 2018.
© Samuel Nja Kwa.
89 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
Fatoumata Diawara

Dans la musique, parfois, se nichent les secrets. C’est la raison pour laquelle il faut les chanter au lieu de les lire. La musique est migrante et mouvante, comme nos émotions. À l’intérieur du mouvement, se cachent des abstractions, un langage mystique qui fait appel à l’intuition autant qu’à la raison. En Afrique, la musique voyage comme dans d’autres continents. Avant les divisions liées à l’esclavage et à la colonisation, chaque famille et, parfois, chaque clan avait ses musiques et ses danses, ce qui explique son immense richesse. L’invention d’un nouveau style nécessitait de bouger sans cesse. À chaque nouvelle union, naissaient de nouvelles danses et de nouveaux contes qui enrichissaient les peuples et les diverses nations. L’Afrique est le continent des métissages permanents où les divers sons entrent en opposition pour se compléter mutuellement. Les musiques africaines sont baignées par des mélanges constants de modernité et elles sont aussi très contemporaines. Elles regroupent un ensemble d’œuvres faites de plusieurs essences. Ainsi, il y a de nombreuses musiques communes, comme les traditions, les spiritualités et les gestes.
« Le concept est une invention à laquelle rien ne correspond exactement, mais à laquelle nombre de choses ressemblent », disait Nietzsche.
Sometimes, music contains hidden secrets. That is why it must be sung rather than read. Music is an itinerant, ever-moving process. Within this movement are hidden abstractions, a mystical language that appeals as much to intuition as to reason. In Africa, music travels as though across different continents. Before the divisions linked to slavery and colonisation, every family – and sometimes every tribe –had its own music and dances, which explains its immense richness. For a new style to emerge, there had to be constant movement; with each new union, new dances and new stories were born, enriching the people and the different nations. It is the continent of endless hybridity where different sounds clash before mutually complimenting one another. African music is bathed in the endless fusions of modernity; it is very modern. It encompasses different works made up of multiple conceptual fusions in their very essence. Like traditions, spiritualities, and common gestures, there are therefore several forms of shared music. “A concept is an invention which nothing corresponds to wholly but many things slightly ”, said Nietzsche.
90 AU MUSÉE | PORTFOLIO
Fatoumata Diawara, Jazz à la Villette, Paris, 2016.

91 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
Fatoumata Diawara, Jazz Festival in La Villette, Paris, 2016. © Samuel Nja Kwa.

92 AU MUSÉE | PORTFOLIO
Les musiques actuelles africaines puisent leurs timbres des divers rythmes hérités. Parce qu’on ne se baigne jamais deux fois dans le même feuve, elles sont variées à l’infni. Cheick Tidiane Seck, Moonchild Sanelly, Mo Laudi font bouger les traditions parce que l’homme est né libre et, à chaque découverte, il ose savoir et il ose faire, n’en déplaise aux adeptes des traditions millénaires qui exaltent leur unité et leur éternité. Rien n’est fxe ou fxé à vie, tout est en mouvement dans le cosmos, comme les vagues et les saisons. À chaque période son aura, ses grandeurs, ses splendeurs et ses décadences. Comme la construction, la destruction est inévitable, même si les majorités des traditions espèrent défnir durablement leurs points d’ancrage ou leurs racines dans la vie, comme dans les idées. Les synthèses sonores forment un ensemble de techniques qui génèrent des milliers de signaux au-delà même de la musique. Tout en améliorant les instruments, elles sont un voyage et une renaissance des instruments oubliés.

Cheick Tidiane Seck
Contemporary African music draws its tones from the different rhythms passed down across the generations. For one never bathes in the same river twice; it is infnitely variable. Cheick Tidiane Seck, Moonchild Sanelly, and Mo Laudi shake up traditions; for man is born free and with each new discovery, he dares to know and to do, not upsetting the defendors of age-old traditions that extol the unity and eternity of tradition. Nothing is fxed or set in stone for life; everything is constantly moving in the cosmos, like the waves and the seasons. Each period has its own aura, its own grandeur, splendour and decadence. Deconstruction is like construction. It is inevitable even if most traditions hope to anchor themselves –and establish their roots – in life, and in ideas, in the long term. Sound syntheses encompass a set of techniques that generate thousands of signals, even beyond music. While improving instruments, they take us on a journey and bring about a resurgence of forgotten ones.
93 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
Cheick Tidiane Seck, Festival La Défense Jazz, 2021. Cheik Tidiane Seck, Jazz Festival in La Défense, 2021. © Samuel Nja Kwa.


Page précedente / previous page : :
Angélique Kidjo et Matthieu Chedid, Festival Jazz à la Villette, Paris, 2021.
Angélique Kidjo and Matthieu Chedid, Jazz Festival in La Villette, Paris, 2021.


© Samuel Nja Kwa.
Mamadou Sarr (à gauche) et Sonah Jobarteh, New Morning, Paris, 2019.
Mamadou Sarr (left) et Sonah Jobarteh, New Morning, Paris, 2019.
© Samuel Nja Kwa.
Lokua Kanza, Festival Saint-Louis Jazz, Sénégal, 2017.

Lokua Kanza, Saint-Louis Jazz Festival, Senegal, 2017.
© Samuel Nja Kwa.
96 AU MUSÉE | PORTFOLIO
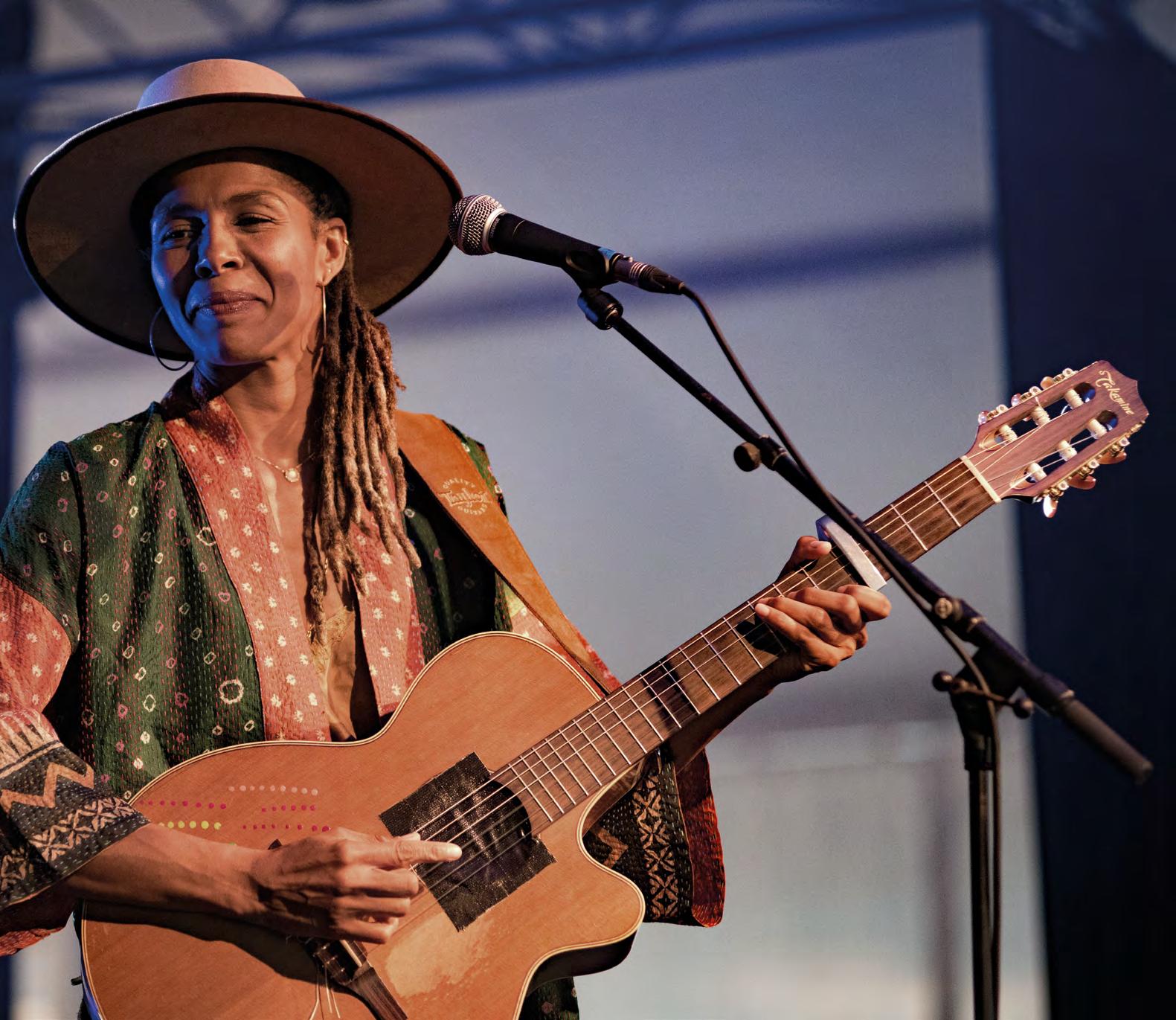
97 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
Ayo, Festival La Ferté Jazz, 2021. Ayo, Jazz Festival in La Ferté, 2021. © Samuel Nja Kwa.
 X Selçuk Demirel, Ogre, 2014, encre sur papier, 37,5 cm x 32,5 cm, paru dans Le Monde, 23 mars 2021.
X Selçuk Demirel, Ogre, 2014, ink on paper, 37.5 cm x 32.5 cm, published in Le Monde, March 23, 2021. © EPPPD-MNHI.
X Selçuk Demirel, Ogre, 2014, encre sur papier, 37,5 cm x 32,5 cm, paru dans Le Monde, 23 mars 2021.
X Selçuk Demirel, Ogre, 2014, ink on paper, 37.5 cm x 32.5 cm, published in Le Monde, March 23, 2021. © EPPPD-MNHI.
Rap, antiracisme et identités locales en région liégeoise
Marco Martiniello, directeur de recherches au FRS-FNRS, Centre d’études de l’ethnicité et des migrations (Cedem), université de Liège (Belgique).
Seconde plus grande ville francophone de Belgique, capitale économique de la Wallonie, Liège est une ville d’art et de culture à la vie nocturne animée. Le rap, style musical prisé par la jeunesse de la région liégeoise, particulièrement dans les quartiers populaires ouvriers, sert de mode d’expression aux artistes issus de populations minorisées. L’étude de deux collectifs, OHK (Organisation Hors du Kommun) et Ultras inferno 96, montre comment l’usage du rap s’inscrit dans une participation socio-politique réinventée1 .
Liège est la seconde plus grande ville francophone de Belgique avec environ habitants au cœur d’une zone urbaine de plus de personnes. Liège est la capitale économique de la Wallonie 2 . Après la révolution industrielle, Liège était devenue l’une des régions les plus riches et les plus développées au monde avec ses industries lourdes (charbon, acier, armes, verre). En raison de sa position géographique et de’ite criminalité urbaine liée à la consommation et au commerce des drogues est loin d’être négligeable. Politiquement, la région a une forte tradition socialiste et communiste, qui a probablement empêché la politisation du racisme comme dans d’autres villes belges. Mais le racisme quotidien et banal est une réalité sociale qui n’épargne pas la région. Les immigrés et leurs descendants sont souvent les boucs émissaires blâmés pour les maux de la ville. Ailleurs en Belgique, Liège est souvent pointée du doigt comme étant un endroit dangereux, sale rempli de chômeurs, de toxicomanes et de criminels.
1. Article initialement publié dans Hommes & Migrations, n° 1317-1318, 2017, pp. 158-164.
2. http://www.liege.be/telechargements/pdf/vie-communale/ carte-de-visite/tableau-de-bord-2013.pdf (consulté le 28 février 2017).
Mais, au-delà ce sombre tableau, Liège est aussi une ville d’art et de culture ainsi qu’une ville de fête surnommée la « cité ardente » en raison de sa vie nocturne animée. L’université de Liège est un des plus grands employeurs de la région. Les fnances de la ville ne permettent pas une politique cultuelle dispendieuse, mais, dans le système fédéral belge, la Fédération Wallonie-Bruxelles est en charge des arts et de la culture et de nombreux projets et institutions sont parrainés à la fois dans les beaux-arts (l’opéra de Liège) et dans les arts plus populaires. La scène théâtrale est particulièrement dynamique comme du reste la scène hip-hop, dans laquelle de nombreux jeunes issus de l’immigration sont des acteurs clés.
La musique, un porte-voix politique
La musique comme mode d’expression et de participation socio-politique 3 des populations
3. Marco Martiniello, Jean-Michel Lafeur, « “Ethnic minorities” cultural practices as forms of political expression: A review of the literature and a theoretical discussion on music », in Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 34, n° 8, 2008, pp. 1191-1215; Marco Martiniello, « Immigrants, ethnicized minorities and the arts: a relatively neglected research area », in Ethnic and Racial Studies, vol. 38, n° 8, 2015, pp. 1229-1235; William G. Roy, Reds, Whites, and Blues. Social Movements, Folk Music and Race in the United States, Princeton, Princeton University Press, 2010.
99 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
minorisées 4 à Liège sera dans les lignes qui suivent discutée à partir de deux cas issus de la culture hip-hop local en s’inspirant du modèle de Mark Mattern 5 : le collectif OHK (Organisation Hors du Kommun) et Ultras inferno .
La recherche empirique qualitative a commencé en et une première phase a pris fn en . Elle se poursuit à ce jour. Plusieurs outils de collecte de données ont été mis en œuvre. Tout d’abord, la littérature spécifque a été consultée. Deuxièmement, j’ai également recueilli les CD et les paroles des chansons. Troisièmement, j’ai pratiqué de l’observation lors d’événements musicaux. Outre la prise de notes écrites classique, j’ai fait des photos et, si possible, des enregistrements sonores et visuels pendant les événements musicaux. Quatrièmement, j’ai réalisé des entretiens semi-structurés avec des artistes et des informateurs clés. Enfn, j’ai recueilli différentes données sur Internet, telles que le contenu des sites et des pages Facebook des artistes, des blogs et des forums. Youtube a été la source la plus précieuse de deux types de données : des clips vidéo musicaux et les commentaires qui apparaissent en dessous de ceux-ci. Ils constituent bien souvent un matériau riche à analyser. La recherche n’a pas mis l’accent au départ sur un style ou un genre musical précis. Toutefois, il est rapidement apparu que le rap constituait le style musical le plus important pour une bonne partie de la jeunesse de la région liégeoise, en particulier dans les quartiers populaires ouvriers qui sont aussi des quartiers historiques d’immigration.
OHK, du rap de quartier à la politique locale
OHK (Organisation Hors du Kommun) est un collectif de rap de La Préalle, un quartier ouvrier de la ville de Herstal en périphérie de Liège. Tout a commencé en 2006 par un atelier hip-hop lancé par une association locale subventionnée dans le cadre de la politique de la ville menée par le gouvernement fédéral belge. L’atelier était dirigé par un artiste local de rap et, comme c’est souvent le cas, il ne dura qu’un ou deux ans. Cependant, Illicite, un jeune BelgoItalien, et Mujahid, un jeune Belgo-Turc, décidèrent de continuer l’expérience sous le nom de OHK, alternant
jusqu’à ce jour les projets musicaux individuels et collectifs.
En 2010, Illicite poste un clip vidéo intitulé « Dans mon quartier » sur Youtube 6 . Tourné en noir et blanc avec très peu de moyens techniques, tout le clip se déroule sur un banc public du quartier sur lequel déflent des habitants de tous les âges et de toutes les origines, ainsi bien sûr qu’Illicite. Le clip présente une image plus ou moins lyrique, mais aussi brute et directe du quartier. Illicite y raconte ce que signife pour les habitants de vivre dans un tel endroit. D’un côté, il narre la misère urbaine et la pauvreté, les conditions de vie diffciles, l’économie irrégulière, un sentiment d’exclusion, la marginalisation et le malaise ressenti par les jeunes. Mais, d’un autre côté, le tableau dressé par Illicite est à bien des égards assez positif. Certes, la vie est diffcile à La Préalle, mais Illicite aime vraiment son quartier. Il prononce l’expression « Dans mon quartier » plus de vingt fois. Il fait l’éloge de la chaleur humaine, de la solidarité entre les habitants, et il célèbre son caractère multiculturel et les relations interculturelles harmonieuses, ainsi que l’absence de racisme. Comme le rappe Illicite, il veut « montrer tous ses côtés » de son quartier. Il ne veut pas le quitter, mais le changer de l’intérieur. À travers le clip, Illicite raconte l’histoire et le quotidien de son quartier (fonction expressive de la musique). Au-delà, Illicite évoque un sens profond de la communauté locale ancré dans l’histoire de la classe ouvrière locale enrichie par l’arrivée et l’enracinement des travailleurs immigrés de nombreuses origines et de leurs familles. L’identité locale de La Préalle selon Illicite est multiculturelle. Ainsi, il écrit : « Dans mon quartier, y a tout le monde. Des cultures, des origines, des religions de tout le monde. Tout le monde connaît tout le monde 7 » Ou encore : « Mon quartier c’est un bout d’Espagne, d’Italie, de Zaïre, de Maroc, de Kosovo, de Turquie. » Mais c’est aussi clairement une identité de classe. « C’était le quartier des immigrés mineurs, des hommes qui allaient au charbon pour leur famille. »
À travers ce morceau, Illicite propose clairement une identité locale ouvrière et multiculturelle source de ferté pour lui. Comme s’il fallait, dans cette période de fn de désindustrialisation, conserver la mémoire de ses racines ouvrières et immigrées pour se projeter
6. https://www.youtube.com/watch ?v =etGXu_zoAIE (consulté le 28 février 2017).
7. Toutes les paroles des chansons citées dans le texte viennent des clips vidéo mentionnés en notes de bas de page.
100 LE POINT SUR | RAP, ANTIRACISME ET IDENTITÉS LOCALES EN RÉGION LIÉGEOISE
4. Jan Rath, Minorisering : De Sociale Constructie van Etnische Minderheden, Amsterdam, Sua, 1991.
5. Mark Mattern, Acting in Concert. Music, Community, and Political Action, New Brunswick, Rutgers University Press, 1998.
dans l’avenir. La fonction délibérative de la musique est ainsi clairement exprimée.
La dimension protestataire n’est qu’indirectement présente dans cette chanson. Dans un passage, Illicite dit que son « quartier se bat chaque jour contre le système. Pour s’en sortir, il fabrique son propre système ». L’auteur s’en prend ici clairement aux pouvoirs économique et politique qui ont relégué le quartier dans la pauvreté et qui ont condamné ses habitants à développer des stratégies de survie par la débrouille dans l’économie informelle.
De l’engagement citoyen à la campagne électorale
Deux ans plus tard, les dimensions protestataire et pragmatique de sa musique apparaîtront de manière très évidente lorsqu’Illicite décidera de se présenter aux élections municipales de la ville de Herstal en octobre sous la bannière du Parti du travail de Belgique, un parti d’extrême gauche implanté dans la ville depuis des décennies. La campagne électorale d’Illicite consistera presqu’exclusivement en un clip vidéo posté sur Youtube le septembre et intitulé « On vient changer la donne 8 ». Tourné en extérieur dans le quartier, mais cette fois en couleur afn de mettre en avant le rouge et le jaune – les couleurs traditionnelles de l’ultra gauche –, le clip se compose de deux parties. La première est rappée par Laurent, un candidat du PTB vêtu d’un T-shirt à l’effgie de Che Guevara. La seconde partie remet en scène Illicite, coiffé d’une casquette de base-ball et portant un foulard rouge et jaune de la section jeune du PTB. Dans les refrains, un groupe de jeunes du quartier de différentes origines reprend l’appel à la mobilisation lors des élections d’octobre .
Le morceau s’inscrit incontestablement dans la veine des protest songs. Les deux rappeurs candidats aux élections mettent en cause le système politique local dominé depuis des décennies par le Parti socialiste qu’ils considèrent comme étant corrompu et clientéliste. Plus largement, ils s’en prennent à la droite et au système capitaliste dans son ensemble de manière assez classique. En un peu plus de minutes et secondes, ils passent en revue toute une série de thèmes comme le démantèlement du
système public de santé, le chômage, la précarisation des emplois, la marginalisation des quartiers et de leur jeunesse, le sort réservé aux personnes âgées ou encore la stigmatisation des immigrés. Ils n’oublient pas une touche environnementaliste en insistant sur la pollution qui touche leur ville et la région dans son ensemble. Par ailleurs, il est intéressant de remarquer qu’au-delà de la protestation ils avancent des propositions pour le développement de politiques publiques davantage en phase avec les besoins de la population. Plutôt qu’à la révolution, ils en appellent au changement par la participation électorale.
Le clip est un bon exemple d’action politique pragmatique par la musique. Son objectif évident est, en effet, d’obtenir le plus de voix possible lors des élections communales et, par conséquent, le plus d’élus possible au conseil municipal, en particulier pour la section jeunes du Parti du travail de Belgique, appelée Comac. Le PTB a au bout du compte obtenu % des suffrages lors des élections locales d’octobre . Il est devenu le second parti de la ville derrière le Parti socialiste qui a conservé % des voix et donc le pouvoir à la mairie. Quatre candidats du PTB ont obtenu un siège de conseiller communal. Parmi ceux-ci, on retrouve un des jeunes que l’on aperçoit furtivement dans le clip de Laurent et d’Illicite, Maxime Liradelfo. Les deux rappeurs n’ont, quant à eux, pas passé la rampe. Bien évidemment, rien ne nous permet de prouver que le clip en question puisse expliquer tout ou partie de ce succès notable. Mais on peut faire l’hypothèse qu’il a joué un rôle dans le choix électoral d’une partie de la jeunesse locale
Ultras inferno 96 : « de l’énergie positive à l’aspect multiculturel »
Outre ses institutions culturelles et son université, la ville de Liège possède aussi un club de football professionnel au passé européen glorieux qui milite aujourd’hui en première division belge. Le Standard de Liège reste aujourd’hui l’un des clubs les plus populaires du pays. Le stade de Sclessin dans lequel il évolue est situé à la sortie de la ville, en bord de Meuse. Il est entouré d’usines et des restes d’un terril, vestige de l’époque minière. Cette saison, le club peut se vanter d’avoir abonnés et des clubs de supporters dans tout le pays, même en Belgique néerlandophone, au-delà de la frontière linguistique qui coupe la petite Belgique en deux.
101 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
8. https://www.youtube.com/watch ?v =JREG07gYbf4 (consulté 28 février 2017).
Fondé notamment par les descendants d’immigrés italiens, les Ultras inferno sont l’un de ces clubs de supporters, l’un des plus chauds, qui prend place en tribune T3 derrière le goal, tribune jadis appelée « pourtours terril ». Le charbonnage n’était, en effet, qu’à quelques centaines de mètres. Créés en , les Ultras inferno se revendiquent, comme leur nom l’indique, du mouvement ultra. Selon les Ultras inferno, le « mouvement ultra » est né en Italie dans le courant des années 1960-197 9 . Il s’inspire du « modèle anglais » tout en restant très différent de par son implication plus concrète dans le club ainsi que par ses diverses actions dans le stade pour encourager son équipe. Comme l’indique son nom, « ultra », ce mouvement regroupe des supporters « acharnés » de leur équipe de football, prêts à les suivre partout, dans leur championnat comme en Europe, par tous les moyens possibles. Un ultra encourage son équipe par ses chants durant toute la rencontre, ses animations (« tifo ») à l’entrée des joueurs sur le terrain, etc. Un ultra peut aussi se distinguer par sa radicalité dans ses actions lorsque l’équipe joue mal : grève des encouragements, tribune bloquée, messages incendiaires, descentes aux entraînements… Un groupe ultra structuré peut avoir une infuence énorme sur les décisions du club dans certains pays (politique de transfert, prix des tickets…).
En bref, un groupe ultra est un groupe constitué de fans invétérés faisant partie à part entière de la vie du club de football qu’ils supportent. Ils peuvent autant lui vouer un amour indéfni qu’une colère redoutable quand le groupe estime que le club « ne le respecte pas » à sa juste valeur ou se « fout » simplement des supporters en général. Certains estiment qu’il s’agit, en quelque sorte, du « syndicat » des fans. Cependant, chaque club, chaque groupe, chaque pays, chaque continent a ses spécifcités, ses contextes qui font qu’il est impossible de défnir un « profl type ».
Sur la page d’accueil du site web des Ultras inferno, on peut trouver cette carte de visite : « Ils sont l’âme diabolique de Sclessin, ils défendent leur Club par vent et marée, ils protègent Liège comme le dernier bastion à conquérir, ils sont les ULTRAS-INFERNO, fraction antifasciste et antiraciste du Royal Standard Club de Liège. Rentrons avec eux dans l’univers des tribunes
engagées et enragées 10 ! ! » Ainsi, les ultras du Standard de Liège se défnissent clairement comme antifascistes, antiracistes et de gauche. Ils font partie du réseau européen Alerta Network. Antifascist Movement11 qui compte une vingtaine de groupes d’ultras de même obédience issus de différents clubs européens, et même un club israélien.
Du stade au clip : savoir occuper une tribune
À l’occasion de leur quinzième anniversaire en , les Ultras inferno ont produit un clip de rap avec l’aide notamment de rappeurs très connus sur la scène hip-hop belge et européenne, dont Kaer et Pavé du groupe Starfam, un des groupes mythiques du hip-hop belge. Le clip, posté sur Youtube en , dure plus de six minutes et emmène le spectateur au cœur du groupe et de ses valeurs sur un rythme très soutenu12 . L’aspect visuel d’abord est très soigné. Le groupe a pris soin de mettre en scène des jeunes de toutes les origines, quelques femmes, dont la rappeuse Psychosa, et une personne handicapée. Che Guevara apparaît aussi sur une des banderoles déployées par le groupe dans le stade. Et le spectateur est invité à y prêter attention. Sanboy dit ainsi : « Si t’as pas capté la vibe, t’as qu’à regarder le tifo. » Le tifo qui présente justement l’effgie de Che Guevara.
La fonction expressive de ce clip, dédié à décrire la vie des Ultras inferno, est puissante. Ce cocktail savamment dosé dominé par la couleur rouge, qui est à la fois la couleur du club et une couleur politiquement très marquée, sert aussi de carte de visite. Ainsi, lorsque j’ai demandé aux ultras les paroles du clip, ils me les ont rapidement et aimablement envoyées, mais en anglais alors que le clip est principalement en français. Ce clip sert clairement à la représentation des Ultras inferno dans le mouvement ultra mondial. D’ailleurs, les commentaires, positifs ou négatifs, en provenance du monde entier ont été postés sur Youtube à son sujet.
L’aspect protestataire du clip comporte néanmoins plusieurs dimensions. En premier lieu, des références sont faites aux interdits de stade pour des raisons sécuritaires. En les soutenant, car certains
10. Ibid
11. http://www.alerta-network.org (consulté le 12 mars 2015).
9. http://www.ui96.net/FR/presentation (consulté le 28 février 2017).
12. https://www.youtube.com/watch ?v =K_WAQvQkpKM (consulté le 28 février 2017).
102 LE POINT SUR | RAP, ANTIRACISME ET IDENTITÉS LOCALES EN RÉGION LIÉGEOISE
X Selçuk Demirel, Discrimination raciale, encre sur papier, 27,5 cm x 24,5 cm, 2000, paru dans Le Nouvel Observateur, avril 2000.

X Selçuk Demirel, Racial Discrimination, ink on paper, 27.5 cm x 24.5 cm, 2000, published in Le Nouvel Observateur, April 2000. © EPPPD-MNHI.
font partie des Ultras inferno, ils s’opposent clairement à l’appareil répressif d’État et en particulier à la police avec laquelle ils ont historiquement des rapports très tendus. En second lieu, l’opposition au fascisme et aux fascistes est affrmée avec force. Le groupe se montre prêt à aller jusqu’au combat physique contre eux. Sanboy dit que les Ultras inferno sont un « Noyau dur acharné qui importune tous les fachos ». En troisième lieu, les ultras se positionnent contre le racisme. « Peu importe la couleur de peau », dit le refrain. Enfn, le parti pris gauchiste traduit un rejet profond du système capitaliste même si la
politisation du groupe fait l’objet de bien des débats entre les ultras, lesquels sont gommés dans le clip.
L’aspect délibératif est primordial dans le clip. Les paroles font référence aux valeurs de fdélité, de loyauté, de courage, d’abnégation qui les caractérisent, tant dans la défense de leur équipe de football que de la ville et de la région de Liège. Plusieurs références sont faites à « ma » ville dans le clip. Par ailleurs, le clip fait l’éloge de la société multiculturelle et revendique les racines ouvrières des supporters du club. C’est le « repère des antifa, des prolétaires ». Il n’est pas anodin que Pavé rappe deux phrases en néerlandais. Dans le contexte belge actuel marqué
103 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
par de vives tensions entre les francophones et les néerlandophones, s’autoriser quelques phrases dans la langue de Vondel est une manière de rendre hommage non seulement aux nombreux supporters famands du Standard, mais aussi à la Belgique multilingue. Remarquons en passant que Pavé se présentera aux élections communales à Liège en 2012 sous la bannière du PTB, un des seuls partis non divisé linguistiquement en Belgique. Il ne sera pas élu.
Conclusion
Les conclusions que l’on peut tirer de la brève présentation de ces deux cas dans un cadre général et théorique particulier sont nombreuses. En premier lieu, l’article montre qu’il est tout à fait pertinent d’étudier les « objets politiques non identifés13 » tels que la musique dans une perspective relevant principalement de la sociologie politique. C’est d’autant plus le cas à l’ère de la politique spectacle et des émotions virtuelles. Il convient donc de redéfnir les frontières et les lieux de l’action politique qui ne se
fait pas uniquement par le vote et dans les assemblées élues dans lesquelles officient des professionnels de la politique. La politique, peut aussi se faire par d’autres moyens moins conventionnels et dans d’autres lieux. C’est ce que cet article a voulu monter. En second lieu, l’article a fait émerger la nécessité de sortir d’une grille de lecture exclusivement ethnique ou culturelle au proft d’une approche plurielle et intersectionnelle, en passant notamment par la convocation du concept de classe sociale dans les débats sur les sociétés post-migratoires. Enfn, cet article a aussi voulu relayer la parole d’une partie de la jeunesse d’un type de société en voie de disparition, la société urbaine industrielle du centrenord européen. Certes, ni OHK, ni les Ultras inferno ne sont statistiquement représentatifs ni du hip-hop belge, ni de l’évolution du multiculturalisme, de l’antiracisme ou des nouvelles formes de mobilisation de l’ancienne classe ouvrière. Toutefois, ils représentent qualitativement un monde qui est en train de mourir et qui se bat pour survivre en utilisant notamment les canaux artistiques pour résister à la marche du néo-libéralisme qui les ignore sans être séduit par les sirènes du nationalisme et de l’extrême droite. N’est-ce pas aussi le rôle de la sociologie de faire voir ceux que personne ne voit ou ne veut plus voir et de montrer que, bien que certains résultats électoraux semblent dire le contraire, l’extrême droite est heureusement encore loin d’avoir colonisé tous les esprits ?
104 LE POINT SUR | RAP, ANTIRACISME ET IDENTITÉS LOCALES EN RÉGION LIÉGEOISE
13. Denis-Constant Martin (dir.), Sur la piste des OPNI (Objets politiques non identifés), Paris, Karthala, 2002.
Rap, Anti-racism, and Local Identities in the Liège Region
Marco Martiniello, Research Director in FRS-FNRS, The Centre for Ethnic and Migration Studies (CEDEM), University of Liège (Belgium).
The second biggest French-speaking city in Belgium and the economic capital of Wallonia, Liège is a city of art and culture with a vibrant nightlife. Rap, a musical style prized by the youth of the Liège region, especially in working-class neighbourhoods, serves as a mode of expression for artists from minority populations. The study of two collectives, OHK (Organisation Hors du Kommun) and Ultras inferno 96, shows how the use of rap is part of a reinvented socio-political engagement.
Liège is the second biggest French-speaking town in Belgium, with around 200,000 inhabitants in the middle of an urban area comprising over 700,000 people. It is also the economic capital of Wallonia 1 After the industrial revolution, Liège became one of the richest, most developed regions in the world thanks to its heavy industries (coal, steel, weapons, and glass). Politically, the region has a strong socialist and communist tradition, which is likely what has prevented the politicisation of racism as in other Belgian towns. However, everyday racism remains a social reality which the region has not been spared. Immigrants and their descendants often become the scapegoats blamed for problems in the city. Elsewhere in Belgium, Liège is frequently singled out as a dangerous, dirty place flled with the unemployed, drug addicts, and criminals.
Outside of this bleak picture, however, Liège is also a city of art and culture as well as a festive city nicknamed the “Ardent City ” thanks to its lively
1. http://www.liege.be/telechargements/pdf/vie-communale/ carte-de-visite/tableau-de-bord-2013.pdf (consulté le 28 février 2017).
nightlife. The University of Liège is one of the main employers in the region. Though the city’s fnances do not allow for an extravagant cultural policy, under Belgium’s federal system, the Wallonia-Brussels Federation is responsible for arts and culture and many projects and institutions fall under the patronage of the fine arts (Liège Opera) and of more popular genres of art. The city’s theatre scene is particularly dynamic, as, incidentally, is its hip-hop scene, in which many young people from an immigrant background are key players.
Music: a political sounding board
As a form of expression and socio-political involvement for minority populations 2 , in the following section we will examine music in Liège by considering two cases from the local hip-hop culture, using the model proposed by Mark Mattern3 : the OHK (Organisation Hors du Kommum), and Ultras Inferno .
105 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
2. Jan Rath, Minorisering : De Sociale Constructie van Etnische Minderheden, Amsterdam, Sua, 1991.
3. Mark Mattern, Acting in Concert. Music, Community, and Political Action, New Brunswick, Rutgers University Press, 1998.
I began conducting qualitative empirical research – still ongoing – in , completing the frst phase in 2014. I applied use of several different data collection tools. Firstly, I consulted specialist literature. Secondly, I collected CDs and song lyrics. Thirdly, I observed live music events. In addition to taken classic written notes, I also took photos and, where possible, sound and visual recordings during music events. Fourthly, I recorded semi-structured interviews with artists and key informants. And last of all, I collected information on the internet, such as the content of the artists’ websites and Facebook pages, blogs, and forums. YouTube has proved the most useful resource for two specifc types of data: music video clips and the comments posted underneath them. These clips and comments often provide valuable information to analyse. Initially, I did not focus on a specifc musical genre or style. It quickly became clear, however, that rap is the most important musical style for many young people in the Liège region, particularly in working-class neighbourhoods, which are also historic immigrant neighbourhoods.
OHK: from neighbourhood rap to local politics
The OHK (Organisation Hors du Kommum) is a rap collective from La Préalle, a working-class neighbourhood in the town of Herstal, in the suburbs of Liège. It all began in 2006 thanks to a hip-hop studio set up by a local association subsidised under the local politics led by the Federal Belgian government. The studio was led by a local rap artist and, as is often the case, only lasted a couple of years. Nonetheless, Illicite, a young Belgian-Italian man, and Mujahid, a young Belgian-Turkish man, decided to continue the experience under the name of OHK, and they still alternate between individual and collective music projects to this day.
In 2010, Illicite posted a video clip entitled “Dans mon quartier” (“In my neighbourhood”) on YouTube 4 Shot in black and white using very limited technical means, the entire clip takes place on a local park bench, where residents of all ages and origins appear one by one, including Illicite of course. The clip presents a lyrical yet fairly raw and direct image of the neighbourhood. Illicite explains what it means for
local residents to live in such a place. On the one hand, he shows the urban deprivation, poverty, tough living conditions, irregular economy, sense of exclusion, marginalisation, and unease experienced by young people. On the other hand, the picture Illicite paints is in many senses a positive one. Life in La Préalle is of course diffcult, but Illicite genuinely loves his neighbourhood. He repeats the phrase “In my neighbourhood” over twenty times. He celebrates the human warmth and sense of solidarity that connects local residents, and praises the neighbourhood’s multicultural character and harmonious intercultural relations, as well as its lack of racism. As Illicite raps, he wants to “present all sides” of his neighbourhood. He does not want to leave; he wants to change things from within. Through the clip, Illicite conveys the history and daily life of his neighbourhood (the expressive function of music). Beyond that, though, Illicite also expresses a profound sense of the local community as being anchored in the history of the local working class, enriched by the arrival and assimilation of immigrant workers of various origins and their families. For Illicite, La Préalle’s local identity is multicultural. Hence, he says: “ You’ll fnd all sorts in my neighbourhood. Different cultures, origins, and religions from all over the world. Everyone knows everyone 5 ”. And: “My neighbourhood is a little corner of Spain, Italy, Zaire, Morocco, Kosovo, and Turkey.”
Yet it is also clearly characterised by a class identity: “It was the neighbourhood of coal miner immigrants, men who went out to the coal plants for their families .” Through this fragment, Illicite clearly shows that this local working-class and multicultural identity is a source of pride for him, as though it were necessary, in this late deindustrialisation period, to preserve the memory of the area’s working-class, immigrant roots in order to look to the future. Music’s deliberative function is thus clearly conveyed.
The protest dimension is only indirectly present in this song. In one passage, Illicite says that his “neighbourhood fghts against the system every day. To get by, it makes its own system ”. Here, the author is clearly attacking the economic and political powers that be, who have relegated the neighbourhood into a situation of poverty and forced its inhabitants to develop survival strategies on the informal economy to get by.
106 LE POINT SUR | RAP, ANTI-RACISM, AND LOCAL IDENTITIES IN THE LIÈGE REGION
4. https://www.youtube.com/watch ?v =JREG07gYbf4 (consulted on 28 February 2017).
5. All the lyrics from the songs cited in the text come from the video clips mentioned in the footnotes.
From civic engagement to electoral campaigns
Two years later, the protest and pragmatic dimensions of Illicite’s music became even clearer when he chose to run for the municipal elections of the town of Herstal in October, under the banner of the Workers’ Party of Belgium (PTB), an extreme-left party based in the city for decades. Illicite’s electoral campaign consisted almost exclusively of a video clip posted on YouTube on September entitled “We’re here to shake things up”6 . Shot outside in the neighbourhood, but this time in colour in order to showcase red and yellow – the traditional colours of the far left –, the clip consists of two parts. The frst is rapped by Laurent, a candidate for the PTB wearing a t-shirt featuring a picture of Che Guevara. In the second part, Illicite comes back onto the scene, wearing a baseball hat and a red and yellow scarf from the youth section of the PTB. In the refrains, a group of young people from the neighbourhood, of different origins, reiterate the call to mobilise for the October 2012 elections.
The section is clearly in the same vein as protest songs. The two rappers, both candidates for the elections, point their fnger at the local political system, which has been dominated for decades by the Socialist Party, which they judge to be corrupt and clientelist. More broadly, they lash out at the right and the capitalist system as a whole, in a fairly classic manner. In just over 3 minutes and 30 seconds, they make their way through a series of themes, including the dismantling of the public health system, unemployment, job insecurity, the marginalisation of working-class neighbourhoods and the young people living in them, the fate reserved for elderly people, and the stigmatisation of immigrants. They do not fail to include an environmentalist element either, stressing the pollution that plagues their city and the region as a whole. It is also interesting to note that as well as protesting, they present proposals to further develop public policies in line with the people’s needs. More than a revolution, they call for change through high a electoral turnout.
The clip is a good example of pragmatic political action through music. Its clear objective is to ensure that as many voices as possible are represented
during the municipal elections and, consequently, to achieve the most elected representatives possible at the town council, particularly for the student youth wing of the Workers’ Party of Belgium, known as Comac. In the end, the PTB obtained % of the votes at the October 2012 local elections. It became the town’s second party, after the Socialist Party which held onto % of the votes and thus stayed in power at the town hall. Four candidates from the PTB obtained a seat as town councillors. Among them was one of the young men featured briefy in Laurent and Illicite’s clip: Maxime Liradelfo. The two rappers, however, do not come across well. We clearly cannot prove that this clip is behind all or even part of this success. However, we can hypothesise that it infuenced the electoral choices of some local young people.
Ultras inferno 96: “positive energy with a multicultural character”
As well as its cultural institutions and university, the city of Liège also has a professional football club with a glorious record in Europe, which is currently competing in Belgium’s frst division. Standard Liege remains one of the most popular clubs in the country. Sclessin Stadium, where the team trains, is situated on the edge of the city, along the River Meuse. It is surrounded by factories and the remains of a slag heap, remnants from the mining era. This season, the club boasts 23,000 season ticket holders and supporters’ clubs across the country, including in Dutch-speaking Belgium, beyond the linguistic border that cuts Belgium in two.
Founded, notably, by descendants of Italian immigrants, Ultras Inferno is one such supporters’ club, one of the most enthusiastic, located at terrace T3 behind the goal, which was formerly called the “ heap ”. The coal plant was in fact just a few hundred metres away. Established in , the Ultras Inferno consider themselves to be an ‘ultra’ movement, as their name suggests. According to the Ultras Inferno, the “ ultra mouvement ” emerged in Italy during the 1960s to 1970s 7 . Although inspired by the “English model”, it is also very different on account of its more concrete involvement in the club, as well as its various actions on the stadium to encourage the team. As its name, “ultra”, suggests, this movement includes “ferce” supporters of their football team who are willing to follow it wherever it goes, by all possible means, be it in the French championship or across
107 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
6. https://www.youtube.com/watch ?v =JREG07gYbf4 (consulted on 28 February 2017).
Europe. An ‘ultra’ encourages their team by chanting throughout the match and through choreographed displays (“tifo”) when the players come onto the pitch, etc. Ultras are also distinguished by their radical reactions when their team plays badly: holding back support; blocking the terraces; infammatory remarks; interrupting training sessions, and so on. In certain countries, organised ultra groups can have an enormous impact on their club’s decisions (such as their transfer policy, the price of tickets, etc.).
In short, an ultra group consists of die-hard fans who participate fully in the life of the football club they support. They can go from limitless love to formidable anger when they judge that the club isn’t not showing them the “respect” they deserve, or simply “doesn’t give a damn” about its fans generally. Some see such groups as a sort of “union” of the club’s supporters. However, as each club, group, country, and continent has its own unique characteristics and contexts, it is impossible to establish a “typical profle”.
On the home page of the Ultras Inferno’s website, you will fnd the following calling card: “ They are the diabolical soul of Sclessin; they will defend their club against all odds; they protect Liège like the last great bastion to be conquered; they are the ULTRAS-INFERNO, the anti-fascist, anti-racist faction of the Royal Standard Club of Liège. Join them in the world of enraged, engaged fans!! 8 ” The ultras of the Royal Standard Club of Liège thus clearly identify as anti-fascist, anti-racist, and left-wing. They are part of the European network Alerta Network Antifascist Movement 9 , which includes around twenty groups of like-minded ultras from different European clubs, and even an Israeli club.
From the stadium to video clips: how to win over the stands
On their ffteenth anniversary in , the Ultras Inferno produced a rap clip with the help of wellknown rappers from the Belgian and European hip-hop scene, including Kaer and Pavé from the band Starfam, one of the mythical Belgian hip-hop bands. The clip, which was posted on YouTube in , is over six minutes long and introduces viewers to the core
7. http://www.ui96.net/FR/presentation (consulted on 28 February 2017).
8. Ibid.
9. http://www.alerta-network.org (consulted on 12 March 2015).
of the band and its values, all at a very swift tempo 10 The visual effect is very carefully considered. The group has made sure to include youngsters of all origins, some women, including the rapper Psychosa, and a disabled person. Che Guevara also features on one of the banners waved by the group in the stadium. Viewers are encouraged to take note of this. Thus Sanboy declares: “If you haven’t picked up on the vibe, just look at the tifo.” The tifo, as it happens, is presenting an effgy of Che Guevara.
Dedicated to describing the life of the Ultras Inferno, the clip has a very powerful expressive effect. The skilfully calibrated cocktail dominated by the colour red – both the colour of the club and a colour with a strong political character – also serves as a calling card. When I asked the ultras for the lyrics to the clip, they were very quick and happy to send them to me, but they sent them in English even though the clip is mainly in French. The clip is clearly intended to represent the Ultras Inferno as part of the global ultra movement. What is more, comments – both positive and negative –have been posted on YouTube about it from all over the world.
The protest aspect of the clip nonetheless has several different dimensions to it. Firstly, it makes references to individuals banned from the stadium for security reasons. By supporting them – some belong to the Ultras Inferno – they are clearly opposing the repressive state apparatus, particularly the police, with whom they have a very strained relationship historically. Secondly, their opposition to Fascism and to fascists in general is very strongly asserted. The group shows that it is ready to go as far as physical combat with them. Sanboy declares that the Ultras Inferno are a “Hardcore group that gets under fascists’ skin.” Thirdly, the ultras take a clear stand against racism. “It doesn’t matter what colour your skin is ”, declares the refrain. Lastly, the frm left-wing stance reveals a complete rejection of the capitalist system, even if the politicisation of the group is the subject of much debate among the ultras, who are airbrushed out of the clip.
The deliberative aspect is central to the clip. The words refer to the values of allegiance, loyalty, courage, and self-sacrifce, values which characterise their defence both of their football team and of the city and region of Liège. There are several references
10. https://www.youtube.com/watch ?v =K_WAQvQkpKM (consulted on 28 February 2017).
108 LE POINT SUR | RAP, ANTI-RACISM, AND LOCAL IDENTITIES IN THE LIÈGE REGION
to “my” city in the clip. It also sings the praises of multicultural society and stresses the working-class roots of the club’s supporters. This is the “reference point of the Antifa, the working classes ”. It is no coincidence that Pavé raps two phrases in Dutch. In the current Belgian context, which is marked by considerable tensions between its French-speaking and Dutch-speaking citizens, the inclusion of a few phrases in Vondel’s language is a way of paying tribute not only to the Standard’s many Flemish supporters, but also to multilingual Belgium. It is worth noting that Pavé actually stood for the local elections in Liège in 2012 under the banner of the PTB, one of Belgium’s only parties that is not linguistically divided. He was not elected.
Conclusion
From a general, theoretical perspective, several conclusions can be drawn from the brief presentation of these two cases. Firstly, the article has shown that it makes perfect sense to study “unidentifed political objects 11 ”, such as music, from a perspective closely aligned with that of political sociology, particularly in the era of “ la politique spectacle ” (showbiz politics) and virtual emotions. The boundaries and sites of political action therefore need to be redrawn, since
such action does not only come about through votes and in the elected assemblies presided over by political professionals. Politics can also take place by other, less conventional means and in other places. This is what this article has sought to demonstrate. Secondly, it has revealed the need to move beyond an exclusively ethnical or cultural interpretative framework and towards a plural, intersectional approach instead, partly by ensuring that the concept of social class is included in discussions on postmigrant societies.
Lastly, the article has sought to give a voice to some of the young people from a type of society on its way out: the industrial urban society of central-northern Europe. Of course, neither the OHJ nor the Ultras Inferno are statistically representative of Belgian hip-hop or of the development of multiculturalism, anti-racism, or new forms of mobilisation of the former working class. From a qualitative perspective, however, they represent a world on the verge of disappearing and which is fghting to survive, primarily by using artistic channels to resist the march of neo-liberalism, which, unseduced by the siren song of nationalism and the far right, pays them no heed. Is it not also the role of sociology to demonstrate what no one can see, or no longer wishes to see, and to show that, even if the electoral results seem to prove the opposite, the far right is thankfully still far from having won everyone over?
109 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
Traduction en anglais Victoria Weavil
11. Denis-Constant Martin (dir.), Sur la piste des OPNI (Objets politiques non identifés), Paris, Karthala, 2002.
X Imprimé graphique de Marwa Younes Almokbel, 2019. Traduction des deux langues, arabe et allemand :
« À partir de quand suis-je une Berlinoise ? »
X Graphic print by Marwa Younes Almokbel, 2019. Translation of the two languages, Arabic and German:
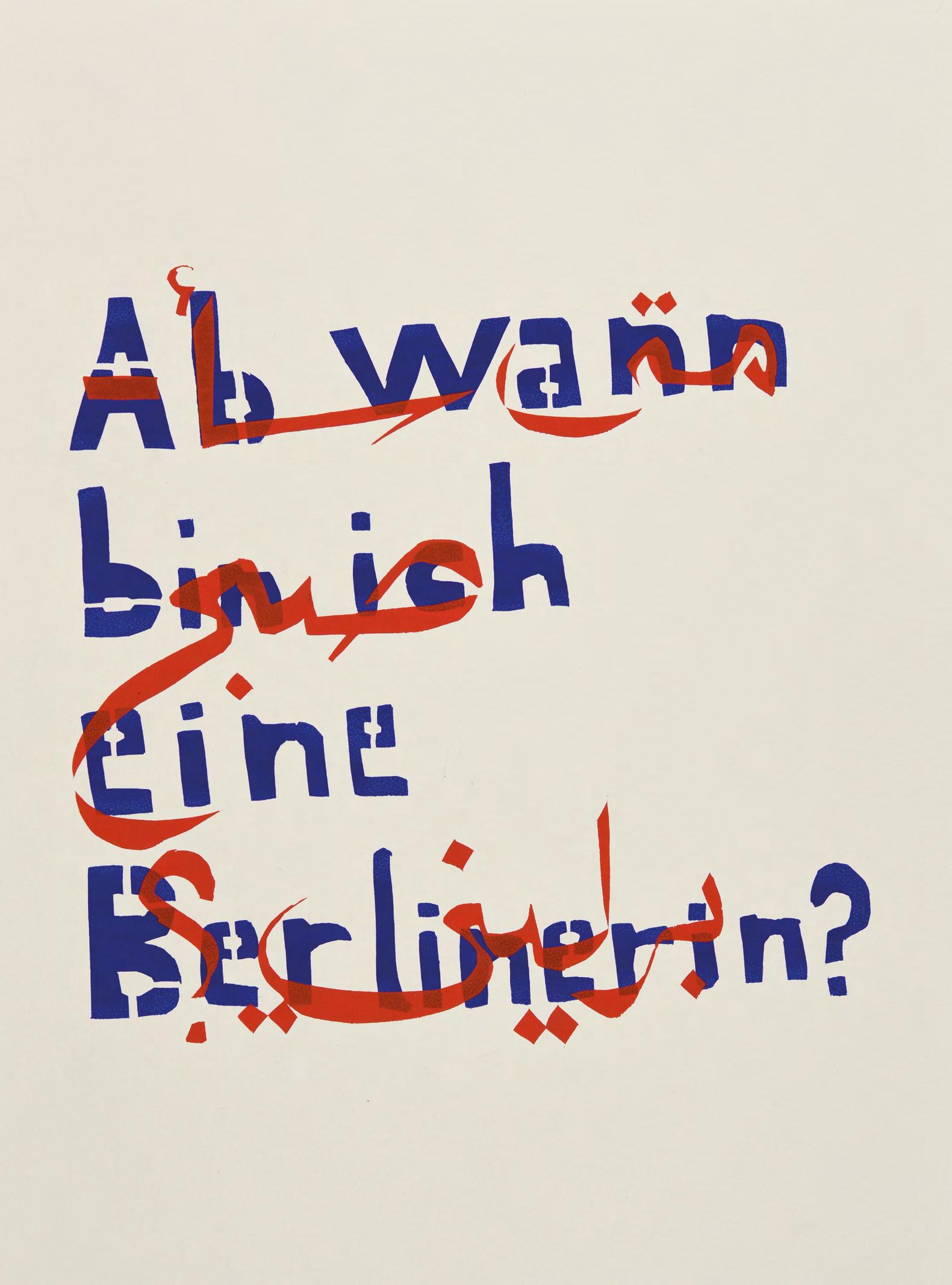
“From when am I a Berliner?”
© Marwa Younes Almokbel.
Construction et appropriations de la fgure de l’« artiste réfugié » dans des dispositifs d’accueil artistique à Berlin
Soline Laplanche-Servigne, maîtresse de conférences en science politique, laboratoire Ermes, université Côte d’Azur1
Une enquête réalisée à Berlin en 2019 auprès d’artistes étrangers résidant dans la ville et de responsables de dispositifs de soutien permet de mettre en lumière le rôle des catégories utilisées pour les appréhender. La fgure de l’« artiste réfugié » mobilisée par les dispositifs d’accueil artistique est le fruit d’une construction qui comporte des biais symboliques aux conséquences bien réelles. Ces créateurs font ainsi face aux attentes d’un public assignant leur travail à une place : celle d’un artiste fuyant des confits dont il serait sommé de traiter.
Àpartir d’une enquête réalisée à Berlin en février et en décembre 2019, fondée sur l’observation de deux ateliers professionnalisants à destination d’artistes étrangers installés à Berlin, six entretiens réalisés avec des artistes de différentes nationalités et trois entretiens avec des responsables de programmes d’aide aux « artistes réfugiés », il s’agit d’analyser la construction et les appropriations de la fgure de l’« artiste réfugié » dans des dispositifs d’accueil artistique à Berlin. La sociologie de la catégorisation permet de questionner les assignations des artistes en mobilité à certaines catégories liées depuis au statut de réfugié. On considérera alors que catégoriser, c’est découper le réel à partir d’une évaluation, et que le travail de catégorisation « donne lieu
à un classement et véhicule donc des enjeux normatifs » : catégoriser revient, parfois en tout cas, « à discrétiser et à hiérarchiser2 ». On considérera aussi que le travail de catégorisation est un travail politique, puisqu’il participe d’un processus consistant à reconnaître, ou à ne pas reconnaître, tel ou tel groupe social. Les catégories au centre de notre analyse sont celles d’« artiste réfugié » et d’« artiste exilé » – utilisées de manière interchangeable ou différenciée, selon les acteurs. Il s’agit ici d’analyser
1. Article à retrouver dans Hommes & Migrations, n° 1343, « Activisme, artistes et migrations », 2023 [à paraître].
2. Jean-Baptiste Comby, Julie Pagis, « Introduction. Politiques de catégorisation du monde social », in Politiques de communication, n° 10, 2018, p. 6.
111 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
à la fois l’amont, c’est-à-dire la construction des catégories d’action publique encapsulant les « artistes réfugiés/exilés », et l’aval, c’est-à-dire les usages et appropriations ou refus de ces catégories par celles et ceux qu’elles entendent désigner. Les catégories sociales peuvent être distinguées entre elles par deux critères de différenciation : leur degré d’objectivation (selon qu’elles relèvent seulement de l’expression discursive ou qu’elles sont enracinées dans des règles de droit, des organisations dotées de représentants, etc.) et le degré d’identifcation qu’elles suscitent (de
Dans les programmes que nous allons évoquer, la catégorisation du public récipiendaire est caractérisée par l’idée d’une mobilité forcée, contrainte, à dimension politique.
la part des membres extérieurs à la catégorie et de la part de ceux qu’elles entendent désigner).
En science politique, les relations entre art et politique comme objet d’étude ont été abordées principalement soit sous l’angle des mobilisations artistiques et de l’engagement des artistes, soit de l’étude des politiques culturelles – par l’analyse des politiques publiques 3 . L’approche choisie ici fait un pas de côté consistant à interroger ce que les processus de catégorisation à l’œuvre au sein de dispositifs d’aide aux artistes font aux artistes en mobilité (qu’ils soient désignés comme « réfugiés » ou « exilés ») et ce que les artistes en mobilité font de ces catégorisations.
Un accent mis sur la dimension politique d’une mobilité contrainte
Depuis le milieu de l’année sont apparus à Berlin un certain nombre de programmes de soutien aux artistes « réfugiés » ou « exilés », généralement co-fnancés, selon des modalités diverses, par l’Union européenne, le Land de Berlin, ainsi que des fondations privées. Dans les programmes que nous allons évoquer, la catégorisation du public récipiendaire est caractérisée par l’idée d’une mobilité forcée, contrainte, à dimension politique. Notons d’abord que
l’on peut considérer le contexte politique berlinois actuel comme favorable à des dispositifs d’accueil aux artistes en mobilité dans la mesure où le Land de Berlin est, au moment de la rédaction de cet article, gouverné par une coalition socialiste et écologiste dite « rouge-rouge-verte », mettant en œuvre une politique culturelle très développée. Dans le domaine culturel plus précisément, le Sénat de Berlin pour la culture et l’Europe est dirigé depuis décembre 2016 par une coalition de gauche antilibérale-socialiste, composée de membres du parti Die Linke, parti à la gauche des Verts et du parti social-démocrate (SPD). Il a créé en 2017 un programme de bourses appelé « Berlin cosmopolite » (Weltoffenes Berlin) destiné à promouvoir « la liberté artistique » « dans le contexte des mouvements migratoires mondiaux » : « Le but de ce programme est de faciliter l’accès à la vie professionnelle des artistes, des travailleurs des médias ou des travailleurs culturels qui ont quitté ou envisagent de quitter leur pays de résidence précédent en raison de la situation politique qui y règne 4 »
Si les conditions de candidature à ce programme d’aide publique semblent assez vagues, ne s’adossant pas à une catégorie juridique spécifque, est néanmoins mise en avant la dimension « politique » des raisons qui doivent avoir présidé à la mobilité. L’appel à candidature s’adresse ainsi aux artistes, travailleurs des médias ou travailleurs culturels « qui ont ou veulent quitter leur pays de résidence car ils perçoivent une menace personnelle (par exemple en raison de persécutions politiques ou de confits armés), ne peuvent pas poursuivre leur activité professionnelle en raison des conditions politiques […], sont fondamentalement opposés aux développements politiques négatifs de leur pays 5 ».
Deux autres programmes d’aide aux artistes en mobilité sont dispensés par des écoles d’art berlinoises : le programme de la *foundationClass , fondé en au sein de l’Académie des Beaux-Arts de Berlin-Weissensee et co-fnancé par le département du Sénat de Berlin pour l’éducation, la jeunesse et la science, le Fonds arabe pour les arts et la culture ( Arab Fund for Arts and Culture) et l’Office allemand d’échanges universitaires (DAAD) ; et le programme d’ateliers Artist Training for Professionals, co-fnancé
5. Ibid
112
LE POINT SUR | CONSTRUCTION ET APPROPRIATIONS DE LA FIGURE DE L’« ARTISTE RÉFUGIÉ »
3. Hélène Dufournet, Loïc Lafargue de Grangeneuve, Agathe Schvartz, Agathe Voisin, « Art et politique sous le regard des sciences sociales », in Terrains & travaux, n° 13, 2007, pp. 3-12.
4. Infoblatt Fellowship-Programm, « Weltoffenes Berlin ». Url : https://www.berlin.de/sen/kultur/foerderung/foerderprogramme/ weltoffenes-berlin/fellowship-programm-weltoffenesberlin-655485.php.
par le Fonds social européen et le Land de Berlin et porté par l’université des Arts de Berlin (UdK). Le premier programme, qui s’adresse à des artistes en formation, refète une catégorisation politique (et non juridique) des candidats potentiels puisqu’elle fait mention en particulier de l’expérience du racisme, s’adressant donc avant tout à un public d’étudiants en art racisés : « tous les futurs étudiants qui ont fui en Allemagne et demandé l’asile ici et qui ont été touchés par le racisme peuvent poser leur candidature ». Il est également mentionné que les enseignements sont dispensés par des personnes « BIPoC [Black, Indigenous and People of Color] ou qui elles-mêmes et/ou leur famille ont migré en Allemagne 6 », et un « manifeste » du programme remet en outre en question les « étiquettes de “réfugiéˮ ou “migrantˮ » : « Tu souhaites étudier l’art ou le design en Allemagne ou poursuivre tes études ? Et tu as émigré en Allemagne et été touché par le racisme ici ? Nous nous réjouissons de ta candidature ! Avec vous, nous voulons formuler des histoire(s) de l’art qui incluent le Sud/ Est global et vos expériences sans utiliser les étiquettes de “réfugiéˮ ou “migrantˮ. Ensemble, nous aimerions trouver des réponses à la question de savoir à quoi ressemblerait une école d’art du futur qui reconnaîtrait réellement la migration comme un facteur social essentiel. »
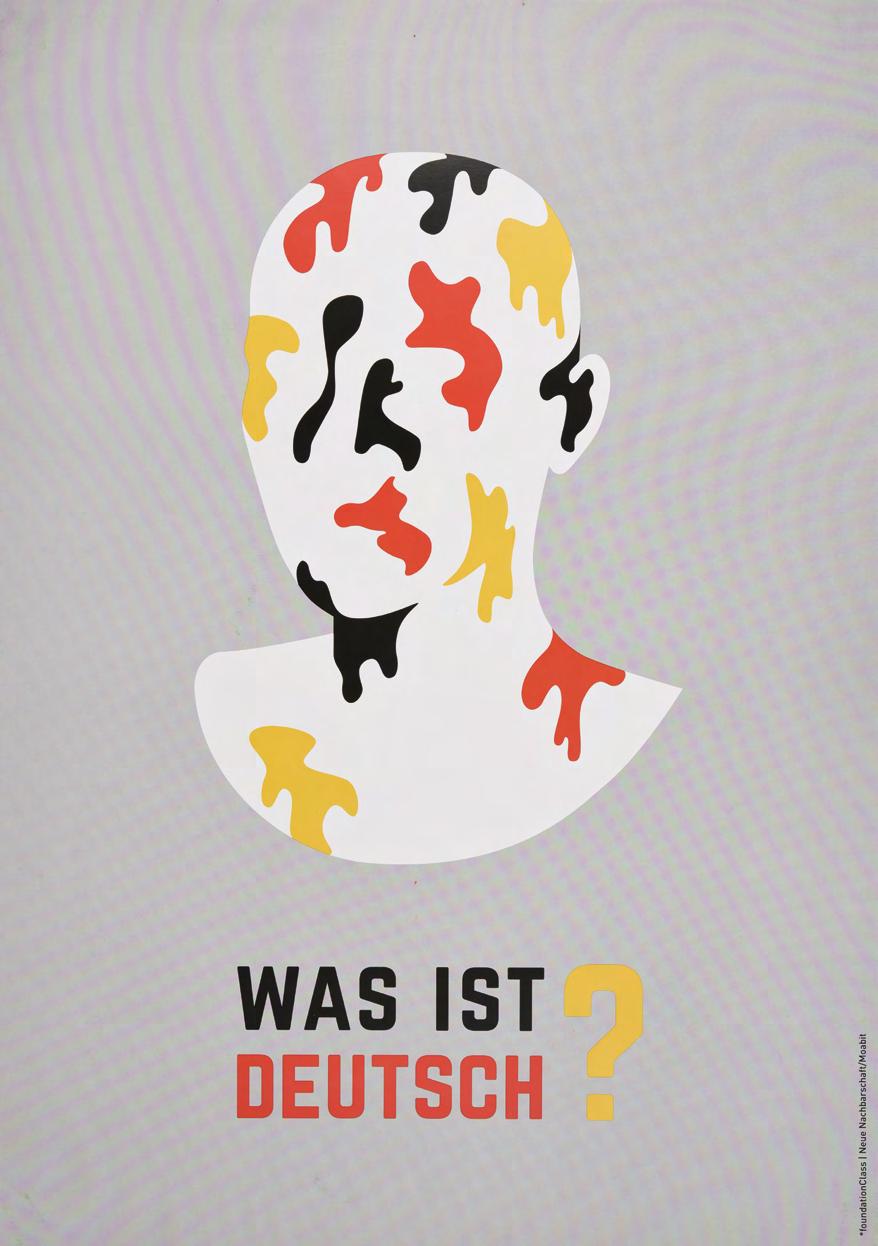
X Imprimé graphique de Marwa Younes Almokbel, 2019. Traduction des deux langues, arabe et allemand : « Qu’est-ce qui est allemand ? »
X Graphic print by Marwa Younes Almokbel, 2019. Translation of the two languages, Arabic and German: “What is German?”
Le manifeste fait aussi mention d’une volonté de transformation de l’institution elle-même par l’incorporation de ces « nouveaux entrants » : « Enfn, la *foundationClass offre à l’Académie d’art de Weißensee la possibilité de générer une nouvelle perception d’elle-même en tant qu’institution artistique éducative. » Toutefois, il est demandé de joindre à la candidature une preuve du statut de résidence,
© Marwa Younes Almokbel.
les statuts indiqués étant alors ceux des personnes en parcours de demande d’asile, soit un retour à une catégorie plus juridique que politique, et relativement contraignante et restrictive.
Le second programme s’adresse à des artistes déjà professionnalisés dans leur pays et leur offre gratuitement des ateliers destinés à les aider à intégrer la scène culturelle et artistique berlinoise (musicale, théâtrale, etc., selon leur domaine
113 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
6. Url : http://foundationclass.org.
artistique). Le programme consiste en des rencontres avec des artistes et professionnels de la scène artistique berlinoise, des visites de lieux culturels, etc. Selon les brochures et les pages du site internet, le public cible des ateliers est parfois qualifé d’« artistes réfugiés », parfois d’« artistes en exil ».
Des « artistes avant tout » ?
On constate donc des oscillations dans la manière de qualifer et de catégoriser le public cible de ces programmes d’aide, que ce soit dans les présentations écrites des dispositifs, sur divers supports, ou dans les discours de ceux qui les mettent en œuvre. Ainsi, le programme Artist Training for Professionals de l’université des Arts s’appelait-il à l’origine « Artist Training : Refugee Class for Professionals ». Le terme « réfugié » a disparu de son intitulé après avoir été contesté par des artistes participants, comme l’explique une des coordinatrices du programme : « Et donc le jour du vernissage, ils [les artistes participant au programme] ont voulu enlever “refugeeˮ de l’affche, leur explication c’était de dire “on voudrait être considérés d’abord comme des artistes, pas comme des réfugiésˮ, donc que ça n’apparaisse pas dans le titre du programme. Et en fait c’est aussi comme ça que moi j’ai eu le job ici, car moi je n’avais aucune expérience avec des réfugiés, mais beaucoup d’expérience avec les artistes ! Et j’ai dit “à la fn, peu importe si ce sont des réfugiésˮ, bon
Selon les brochures et les pages du site internet, le public cible des ateliers est parfois qualifé d’« artistes réfugiés », parfois d’« artistes en exil »
c’est très important si on parle bien sûr des traumatismes ou des choses comme ça, mais pour être artiste en Allemagne, pour avoir des projets ici, peu importe leur origine, ce sont des artistes ; et si c’est un artiste de la Syrie ou de la Russie ou de l’Espagne ou la France… comment dire, ils ont tous les mêmes… vœux, les mêmes, pas les mêmes plans, mais un plan, une idée, ils veulent tous faire leur art, réaliser leurs idées artistiques, et ça, c’est ce qui compte. » (Entretien Berlin, / / ).
Lors d’un des modules du programme auquel j’ai assisté (« Fine Arts III – Empower, Navigate, Participate »), les nationalités des treize artistes participants, âgés pour la plupart d’une trentaine
d’années, étaient de fait très diverses – colombienne, chinoise, sud-africaine, russe, japonaise, syrienne, tunisienne, libanaise – et ne correspondaient pas nécessairement à celles de pays « en confit », la raison de la mobilité des artistes de ce programme n’étant donc pas toujours liée à une situation de crise politique. Leur durée de résidence ou d’« exil » à Berlin était elle aussi très variable, allant de mois à ans.
L’atelier organisé par l’organisme Touring Artists auquel j’ai assisté était lui à destination notamment des artistes ayant tout récemment obtenu une bourse du programme « Berlin cosmopolite ». Les organisateurs de la journée m’ont fait part de leurs hésitations concernant le choix du titre du workshop, avant de fnalement l’intituler : « Prendre ses marques à Berlin. Atelier pour les artistes issus de pays en crise qui se sont récemment installés à Berlin et leurs partenaires institutionnels », la qualifcation d’« artistes issus de pays en crise » leur ayant semblé celle la plus inclusive possible. Les dilemmes de la catégorisation du public récipiendaire peuvent fnalement rendre ambiguës les attentes des gestionnaires des programmes, en matière de candidature, lorsque la définition de ce public est trop floue, comme le montrent les propos de la coordinatrice du programme Artist Training: Refugee Class for Professionals, devenu simplement Artist Training for Professionals , lorsqu’elle évoque ce changement d’intitulé du programme : « Offciellement, on ne peut pas accepter des artistes de pays européens et là, on leur dit : “Non, désolés.ˮ On peut dire par exemple… bon, il y a des artistes de la Chine, de la Russie, de pays d’Amérique du Sud qui candidatent, donc là, on doit vraiment regarder, alors, est-ce que c’est vraiment un artiste qui est venu pour des raisons de répression, ou on ne sait pas… et là on peut dire : “Oui, c’est possible.ˮ Mais de l’Europe, non. Une candidature d’un artiste français, non, ce n’est pas possible ! Ou de la Suède, des États-Unis… Parce que c’est, voilà, on est fnancé… Si c’était un projet seulement de l’université des Arts, oui, d’accord, mais comme c’est un projet ESF Fonds social européen, il y a certaines règles.
« Il y a un questionnaire qu’ils doivent remplir comme candidature, et là on demande leur pays d’origine, et je pense aussi depuis quand ils sont ici en Allemagne, mais on ne demande pas leur statut de réfugié, d’asile, non, pas du tout. […] On ne demande pas… ou on ne fait pas une hiérarchie, “voilà un réfugié politique ça, çaˮ, non pas du tout, c’est “réfugié et artisteˮ, et c’est tout. » (Entretien Berlin, / / ).
114
LE POINT SUR | CONSTRUCTION ET APPROPRIATIONS DE LA FIGURE DE L’« ARTISTE RÉFUGIÉ »
Elle cherche ainsi, tout en mobilisant la catégorie de « réfugié » pour exclure certaines nationalités, à la dissocier d’une catégorisation comme réfugié « politique » qui serait trop restrictive. De même, les ateliers organisés par Touring Artists ont-ils un contenu s’adressant à « des artistes avant tout », en considérant que les enjeux sont les mêmes pour tous les artistes en Allemagne (et à Berlin, dans ce cas-ci) : comprendre les arcanes administratifs de leur statut ( freelance, etc.) concernant leurs droits à la sécurité sociale, à la retraite et au chômage ; se constituer un réseau au sein de la scène artistique et culturelle berlinoise ; nouer des liens avec des institutions culturelles berlinoises. Toutefois, le statut spécifque du public ciblé réapparaît dans les choix des encadrants des ateliers : tous les workshops organisés mobilisent comme conférenciers et encadrants des artistes berlinois ayant eux-mêmes un lien à la migration et installés à Berlin depuis au moins quelques années.
Les formes de hiérarchisation entre artistes migrants dans l’espace artistique berlinois
Les catégories mobilisées par les concepteurs des programmes d’accueil ou d’aide aux artistes migrants ne correspondent pas clairement à une catégorisation d’État permettant d’identifier des « ayants droit 7 » – telles que les catégories d’État de « réfugiés », « chômeurs », etc. Leur contour est plus fou et, en pratique, se mettent en place des formes de hiérarchisation entre artistes migrants au sein de l’espace artistique berlinois. En se concentrant sur la scène artistique syrienne à Berlin, Simon Dubois fait état des « recompositions d’un paysage créatif syrien à Berlin », en faisant la démonstration d’une « retraduction de l’exil en des termes spécifques au domaine créatif » : il évoque les enjeux autour du statut d’« artiste-demandeur d’asile » avec l’affrmation d’une hiérarchie artistique dans la dynamique même du déplacement 8 . Ainsi, certains artistes syriens perçoivent-ils leur exil berlinois « comme le prolongement […] d’une insertion dans un espace artistique
mondialisé », « comme une étape dans le déroulement d’une carrière » et refusent toute catégorisation comme artistes réfugiés, quand d’autres « cherchent à intégrer le champ d’accueil et […] acceptent une identité artistique liée à l’origine et/ou au statut d’exilé 9 ». Dans notre enquête, les effets de hiérarchisation n’apparaissent pas entre artistes issus d’une même « communauté nationale » mais entre des artistes de nationalités diverses. En l’occurrence, se joue une mise en concurrence entre artistes « issus d’un pays
Dans notre enquête, les effets de hiérarchisation n’apparaissent pas entre artistes issus d’une même « communauté nationale » mais entre des artistes de nationalités diverses.
en crise », la défnition de « pays en crise » étant très malléable. Un artiste chilien m’explique ainsi son ressenti (dans des propos très proches de ceux que me tiendra également une artiste brésilienne) : « Je comprends que les artistes syriens soient favorisés par ce programme Berlin cosmopolite, ils viennent d’un pays en guerre, mais pour nous c’est diffcile de trouver des moyens de rester ici, alors que nous venons aussi d’un pays en crise, politiquement… » (Entretien Berlin / / ).
Comme le rappellent Jean-Baptiste Comby et Julie Pagis, « les luttes catégorielles sont au cœur des modes de gouvernement pour défnir qui a droit à quoi10 ». Paradoxalement, certains artistes, d’Amérique latine notamment, qui peuvent être considérés comme moins légitimement éligibles à des aides, en comparaison avec des artistes ayant fui la guerre, bien qu’ils aient quitté leur pays pour des raisons qu’ils qualifent de « politiques », sont aussi parfois celles et ceux qui ont le plus de diffcultés à obtenir un visa de longue durée afn de pouvoir rester résider en Allemagne et y pratiquer leur art.
Positionnements dans l’espace artistique berlinois « post-migrant »
Une scène artistique qualifée de « post-migrante » et « postcoloniale » s’est développée à Berlin
115 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
7. Gérard Noiriel, « Représentation nationale et catégories sociales. L’exemple des réfugiés politiques », in Genèses, n° 26, 1997, pp. 25-54.
8. Simon Dubois, « Négocier son identité artistique dans l’exil. Les recompositions d’un paysage créatif syrien à Berlin », in Migrations Société, n° 174, 2018, p. 48.
9. Ibid., p. 56.
10. Jean-Baptiste Comby, Julie Pagis, op. cit., p. 7.
X Graphic print by Marwa Younes Almokbel, 2019. Translation of the two languages, Arabic and German: “Everything for everyone” X Graphic print by Marwa Younes Almokbel, 2019. Translation of the two languages, Arabic and German: “Everything for everyone” © Marwa Younes Almokbel.

depuis les années 2000 particulièrement, se donnant pour objectif de redessiner les contours de la communauté nationale germanophone en y intégrant les personnes migrantes, aussi bien du côté des artistes que du public. Plusieurs théâtres ont développé depuis la fn des années une approche « qualifée de “ Postmigrant ˮ qui s’appuie sur la normalité de la migration dans la société contemporaine. Ce courant s’est bâti sur le constat de l’absence des populations immigrées et descendantes de l’immigration dans l’art11 », ainsi que sur le constat de l’absence dans l’art des populations non blanches et postcoloniales.
On peut citer comme exemples de cette conception théâtrale le théâtre Maxim Gorki et le théâtre Ballhaus Naunynstrasse qui, par leur programmation,
les metteurs en scène et les comédiens qui s’y produisent, cherchent à réinterroger le paysage théâtral germanophone à l’aune des apports migratoires, en particulier en promouvant des pièces jouées dans différentes langues et en banalisant l’usage de la langue arabe notamment. Le théâtre Ballhaus Naunynstrasse est ainsi présenté sur son site Internet : « Maintenant, en tant que théâtre post-migratoire, le Ballhaus Naunynstraße offre une scène institutionnalisée, un espace pour les protagonistes ayant une expérience de l’immigration et pour leurs récits, il y a un nouvel espace de résonance culturelle 12 » La présentation du théâtre Gorki va quant à elle jusqu’à évoquer la nécessité d’interroger l’identité collective berlinoise, à l’aune d’un « monde diversifé » : « Le Gorki s’adresse à toute la ville, et cela inclue tous ceux qui sont arrivés dans la ville au cours des dernières décennies, qu’ils soient en quête d’asile, en exil, qu’ils soient immigrés ou simplement des personnes qui ont grandi à Berlin. Nous vous invitons tous à un espace public dans lequel la condition humaine actuelle et notre confit d’identité seront refétés à travers l’art de faire du théâtre et de regarder du théâtre, afin de contribuer à un débat approfondi et patient sur le vivre ensemble dans le monde diversifé d’aujourd’hui. Comment sommesnous devenus ce que nous sommes ? Et qui voulons-nous être à l’avenir ? En bref : qui est “nousˮ ? » Le théâtre Gorki a par ailleurs créé en une « troupe d’exilés », l’Exil Ensemble, fnancé depuis 2019 uniquement par le Sénat de Berlin pour la culture et l’Europe, et décrit comme une « plateforme pour artistes professionnels, qui vivent en exil ». Sept comédiens et comédiennes de Syrie, de Palestine et d’Afghanistan y travaillent et s’y produisent.
Plusieurs des artistes rencontrés lors de notre enquête ont mentionné être venus à Berlin par choix artistique, en raison de la réputation artistique, de l’histoire de l’art, de la scène musicale ou théâtrale allemande. Mais si elle offre des opportunités aux artistes migrants, cette scène culturelle et artistique « post-migrante » peut aussi leur apparaître limitative et restrictive, en les cantonnant à celle-ci, comme le souligne un metteur en scène syrien : « Nous, les artistes syriens, nous avons sûrement besoin d’un lobby pour être plus entendus. […] Nous avons un point commun, c’est de venir de Syrie. Mais ça ne veut pas
12.
116 LE POINT SUR |
11. Simon Dubois, op. cit., p. 51.
Url : https://ballhausnaunynstrasse.de/about/.
dire qu’on est unifé. […] Mais ici on est tous mis dans une même case en tant que Syriens et on fait du théâtre au Gorki. Ça n’est pas une véritable ouverture. » (Entretien Berlin, / / ).
Simon Dubois note lui aussi que, pour certains artistes syriens installés à Berlin, « ces catégorisations “artiste réfugiéˮ et “artiste syrien en exilˮ semblent être comprises comme une dépréciation artistique 13 ». On peut dès lors observer des modes de subversion autour de l’étiquetage comme « artiste réfugié », dont il est à la fois tiré parti comme capital symbolique, tout en le contestant dans certaines des représentations qui lui sont associées.
Affrmer sa présence et s’approprier une parole artistique sur l’exil
On peut dire des artistes bénéficiaires des programmes mentionnés qu’ils ont candidaté « en tant qu’ »artiste réfugié/exilé « pour refuser d’être traité comme » réfugié/exilé, pour reprendre la formulation du paradoxe minoritaire relevé par Didier Fassin et Éric Fassin 14 . Ainsi, si l’on ne peut parler d’un degré élevé d’objectivation de la catégorie « artiste réfugié/exilé », dont on a vu que ses contours sont fous et qu’elle n’est pas institutionnalisée, le degré d’identifcation suscitée par ce type de catégorie est également limité. En tout cas, les artistes jouent de ce label « artiste réfugié/exilé » en l’utilisant à leur proft souvent sans y adhérer en tant que tel mais pour mieux combattre les stéréotypes sur les migrants.
La catégorisation en tant qu’artiste réfugié peut conduire à se sentir exotisé. Certains artistes cherchent alors à retourner le sens du regard porté sur eux et à se réapproprier la parole sur leur situation. Ainsi, des étudiants artistes de la *foundationClass de 2017 se sont-ils saisis de la réception d’un prix, à l’occasion de laquelle des journalistes devaient venir les flmer, pour se faire sujets plutôt qu’objets, en s’armant eux-mêmes de caméras afn de flmer à leur tour les journalistes, dénonçant par ce geste les formes d’exotisation dont ils percevaient être l’objet (performance vidéo « Trust us »).
Des artistes de ce même programme ont de même
monté un projet intitulé « Nous sommes ici », visant à réaliser des affches au moyen desquelles rendre compte des « perceptions, des déclarations et des demandes des personnes qui ont fui à Berlin », en leur rendant la parole et en mettant en lumière les sujets qui « du point de vue des réfugiés, sont à peine mentionnés dans les débats publics » et les « stéréotypes » auxquels « sont confrontés les habitants des pays en guerre et en crise 15 ».
Un autre effet de la situation de migration peut être, pour certains artistes, la transformation de leur pratique artistique. N., trompettiste syrien de ans, explique ainsi comment sa pratique musicale s’est modifée en Allemagne, en évoquant non pas une forme d’assimilation artistique, mais bien plutôt ce qu’il perçoit des influences réciproques entre musiques « allemande » et « arabe » : « J’ai dû changer ma musique pour que les Allemands la
En tout cas, les artistes jouent de ce label « artiste réfugié/exilé » en l’utilisant à leur proft souvent sans y adhérer en tant que tel mais pour mieux combattre les stéréotypes sur les migrants.
comprennent, je ne peux pas jouer de la musique purement syrienne, donc j’ai utilisé un peu de jazz ou de la musique européenne. Notre musique est tellement mélancolique, tellement triste parfois, nostalgique, alors que la musique allemande est plus joyeuse, plus agressive. […] Ils m’affectent et nous avons affecté la musique ici aussi, en tant qu’Arabes disons. Maintenant, ici on entend dans chaque piste de musique la vibe orientale, dans les clubs, les bars, même au Berghain, un des clubs technos les plus réputés de Berlin, vibe orientale, vibe arabe. C’est tellement mélangé maintenant. Maintenant, les musiques allemande et syrienne sont un peu comme fusionnées. J’ai changé et je ne peux plus jouer de la musique purement syrienne. » (Entretien Berlin, / / ).
Quant à M., graphiste, peintre et performeuse syrienne de ans, elle souligne comment elle a intégré à sa pratique artistique la langue allemande,
13. Ibid., p. 53.
14. Didier Fassin, Éric Fassin (dir.), De la question sociale à la question raciale ? Représenter la société française, Paris, La Découverte, 2006.
15.
117 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
Url : http://neuenachbarschaft.de/2017/07/04/wir-sind-daplakatausstellung.
l’apprentissage de celle-ci lui étant apparu comme un impératif non pas pour se conformer aux injonctions faites aux immigrés, mais pour pouvoir davantage, dans la langue du pays de résidence, défendre son point de vue sur la situation des immigrés, à travers ses œuvres graphiques : « Tout de suite j’ai décidé d’apprendre l’allemand. Pas pour l’injonction au test d’intégration mais pour pouvoir parler de mon point de vue de l’intégration. Maintenant, je fais des peintures avec des textes, en allemand. » (Entretien Berlin, / / ).
D’autres, enfin, expriment la nécessité de s’émanciper totalement des attentes formulées à l’égard des artistes exilés de produire des œuvres rendant compte de cet aspect-là de leur trajectoire et de leur expérience de vie. O., photographe et vidéaste, né en Syrie en 1993, et passionné de japonais et de littérature, évoque ainsi sa volonté de créer de façon libre, autour des thématiques qui lui tiennent à cœur et qui n’ont aucun rapport avec la guerre ou l’exil. Il explique avoir déjà fait un flm sur son passage de frontières lors de son parcours d’exil, mais ne plus vouloir s’y laisser prendre, ayant été gêné par la réception qui en a été faite et qui faisait de lui une victime suscitant la pitié, blessant son ego : « Les gens attendent ça de moi, en tant que Syrien… “tu devrais faire un flm sur la guerre en Syrie !ˮ, mais je ne veux pas faire quelque chose qui n’est pas ma voix. Et moi je n’ai pas les compétences pour faire un documentaire sur la guerre, juste parce que je suis syrien… » (Entretien Berlin, / / ).
Conclusion
Le débat « classique » sur la façon pertinente de qualifer les personnes en mobilité et les connotations qui sont associées à différentes catégorisations – « migrant », « réfugié », « exilé » – vient, dans le cas des artistes, percuter l’idée de liberté créative associée à cette activité professionnelle singulière. Faire appel à la sociologie de la catégorisation permet de rendre visible certaines contraintes et limitations, ainsi que certains jeux de concurrence, qui pèsent sur les artistes en mobilité issus de certains pays. Le faible degré d’objectivation de la catégorie « artiste réfugié » ou « artiste exilé » est perceptible dans les atermoiements des qualifcatifs employés dans des programmes berlinois d’aide et de soutien destinés aux artistes « ayant fui leur pays ». Ce type de catégorisation apparaît finalement être à double tranchant, du point de vue des artistes bénéfciaires : il permet de bénéfcier de fnancements, publics et privés, mais il peut également apparaître limitatif lorsqu’à cette catégorie sont associés des rôles assignés qui peuvent alors contraindre la pratique artistique – par exemple, se sentir assignés à des projets artistiques en lien avec l’expérience vécue de la guerre. Le cas des artistes en exil permet fnalement d’interroger sous un nouveau jour la problématique commune à nombre de minorisés (racisés, femmes, etc.), confrontés à la « nécessité d’affrmer et de refuser à la fois la différence 16 ».
118 LE POINT SUR | CONSTRUCTION ET APPROPRIATIONS DE LA FIGURE DE L’« ARTISTE RÉFUGIÉ »
16. Joan W. Scott, La citoyenne paradoxale. Les féministes françaises et les droits de l’homme, Paris, Albin Michel, 1998.
The Construction and Appropriation of the Figure of the “Refugee Artist” in Support Measures for Artists in Berlin
A survey carried out in Berlin in 2019 among foreign artists living in the city as well as managers of support systems brings to light the different categories used to represent such artists. The fgure of the “refugee artist” employed in reception facilities for artists stems from a construction based on symbolic prejudices, with concrete effects. Such artists are thus confronted with the expectations of a public that assigns their work to a specifc role: that of the artist feeing confict, which they are expected to tackle.
Through a survey carried out in Berlin in February and December 2019, based on the observation of two professional workshops aimed at artists of different nationalities along with three interviews with managers of support programmes for “refugee artists”, our goal here is to examine how the fgure of the “refugee artist” is constructed and appropriated in the systems in place for receiving displaced artists in Berlin. The sociology of categorisation invites us to question the use of certain categories connected with the refugee status to represent displaced artists since .
Categorisation will thus be seen to dissect reality, based on a particular assessment. It will also be seen to “give rise to a ranking system, thus conveying normative issues ”: at times at least, the act of categorising implies “discretising and hierarchising” 1
Categorisation will also be seen as a political action, since it is part of the process of recognising, or not recognising, a particular social group. This analysis will focus on the categories of the “refugee artist” and of the “exiled artist”, which are either used interchangeably or distinguished depending on the actors concerned. We will analyse both the upstream stage, that is, how the categories used in public policy to represent “refugee/exiled artists” are constructed, and the downstream stage, that is, how these categories are then used, appropriated, and rejected by those they are intended to designate. Such social categories can be distinguished from one another on
119 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
Soline Laplanche-Servigne, Lecturer in Political Science, Ermes laboratory, Côté d’Azur University.
1. Jean-Baptiste Comby, Julie Pagis, “Politiques de catégorisation du monde social”, in Politiques de communication, vol. 1, n° 10, 2018, p. 6.
the basis of two criteria: their degree of objectifcation (depending on whether they relate only to discursive expression or are instead rooted in rules of law, decision-making bodies, etc.) and the degree of identification they elicit (on the part both of people outside of the category and of those it is intended to designate).
In political science, the relations between art and politics have mainly been studied either from the perspective of artistic mobilisations and artists’ political engagement, or as part of the study of cultural policies, through the analysis of public policies 2 . The approach adopted here differs inasmuch as it takes into account the effect of the categorisation processes underpinning support measures for artists on displaced artists (whether they are classed as “refugees” or “exiles”), and how such artists respond to these categories.
Focusing on the political dimension of forced mobility
Since mid- , a number of programmes supporting “refugee” or “exiled” artists have emerged in Berlin. They are generally co-fnanced, through different arrangements, by the European Union, the Länd of Berlin, and private foundations. In the programmes considered here, the target recipients are categorised according to the idea of forced mobility with a political dimension. It should frstly be noted that the current political situation in Berlin appears to support measures for displaced artists since Berlin’s Länd is currently governed by a socialist and environmentalist coalition known as “red-redgreen”, which is implementing a highly sophisticated cultural policy. In the cultural sphere more specifcally, since 2016 Berlin’s Senate for Culture and Europe has been led by a left-wing antiliberal-socialist coalition, made up of membres of the Die Linke party, a party to the left of the Greens, and of the Social Democrat Party (SPD). In , it set up a fellowship programme called Weltoffenes Berlin (Cosmopolitan Berlin), intended to promote “artistic freedom” “in the context of global migratory movements”: “These are designed to facilitate the professional integration of people working in art, media, and culture who have
left or intend to leave their countries of origin due to the current political situation there.”
While the conditions for applying for this public assistance programme seem fairly vague, since they are not linked to a specifc legal category, the “political” side of the individual’s reasons for leaving their country of origin is nonetheless stressed. The call for applications is thus aimed at artists or professionals working in the media and culture sectors, “who have left or intend to leave their countries of origin because they feel threatened personally (e.g., on account of political persecution or armed conflicts), cannot continue their professional activity on account of the current political situation […] are in fundamental opposition to negative political trends in their country ”
Two other support programmes for displaced artists are provided by Berlin art schools: the *foundationClass programme, set up in 2016 as part of the Berlin-Weissensee Art Academy and co-fnanced by Berlin’s Senate Department for Education, Youth, and Science, the Arab Fund for Arts and Culture, and the German Academic Exchange Service (DAAD); and the workshop programme Artist Training for Professionals, co-fnanced by the European Social Fund and Berlin’s Länd and led by the Berlin University of the Arts (UdK). In the frst programme, which is aimed at artists in training, potential candidates are categorised from a political (rather than legal) perspective, since the experience of racism is specifcally mentioned. The progrmame is thus directed frst and foremost at racialised art students: “anyone interested in studying art of design who has fed to Germany and applied for asylum here and who has been affected by racism can apply ”. It also mentions that the teaching is provided by individuals who identify as “BiPoc (Black, Indigenous and People of Colour) or who have themselves – or whose family has – migrated to Germany”. The programme “manifesto ” also calls into question the “ labels of “refugee” or “migrant”) : “Do you want to study art or design in Germany or continue your studies? Have you emigrated to Germany and been affected by racism here? We invite you to apply! Together with you, we wish to formulate histories of art that include the global South/East and your own experiences, without using the labels of ‘refugee’ or ‘migrant’. Together, we hope to determine what an art school of the future that fully recognises migration as an essential condition might look like.”
The manifesto also mentions the institution’s own desire to transform by incorporating these “new
120 LE POINT SUR | THE CONSTRUCTION AND APPROPRIATION OF THE FIGURE OF THE “REFUGEE ARTIST”
2. Hélène Dufournet, Loïc Lafargue de Grangeneuve, Agathe Schvartz, Agathe Voisin, “Art et politique sous le regard des sciences sociales”, in Terrains & travaux, vol. 2, n° 13, 2007, pp. 3-12.
arrivals”: “Lastly, thanks to the *foundationClass, the Weißensee Art Academy can now see itself in a new light as an educational artistic institution.” Applicants are nonetheless asked to include evidence of their residence status with their application; the statuses indicated are those of individuals in the process of applying for asylum, suggesting a return to a relatively restrictive category that is more legal than political. The second programme is aimed at artists already established in their countries of origin. It offers free workshops to help them integrate Berlin’s cultural and artistic scene (music, theatre, etc, according to their artistic feld) as well as meetings with artists and professionals from Berlin’s artistic scene, visits to cultural sites, and so on. According to the programme’s brochures and the website, the target audience for the workshops is sometimes described as “refugee artists” and sometimes as “exiled artists”.
Artists “above all else”?
The manner in which the target audience of these assistance programmes is described and categorised thus varies, whether in written presentations of the programmes, on different media platforms, or in the speeches of those in charge. For example, the Artist Training for Professionals programme by the University of the Arts was originally called “Artist Training: Refugee Class for Professionals”. “Refugee” was removed from the title after participating artists contested the term, as one of the programme coordinators explains: “ On the day of the opening exhibition, the artists participating in the programme wanted to remove the term ‘refugee’ from the poster so it didn’t feature in the title of the programme, their explanation being that ‘we want to be considered as artists above all else, not as refugees.’ That’s actually how I got the job, incidentally, since I had no experience with refugees, but lots of experience with artists! I said, ‘at the end of the day it doesn’t really matter that they’re refugees’; of course it’s very important if we’re talking about trauma and things like that, but in terms of being artists in Germany, carrying out projects here, their background doesn’t matter. They are all artists; and whether they’re an artist from Syria or Russia, or from Spain or France… they’ve all got the same, how can I put it… wishes, the same, not the same plans as such, but a plan, an idea: They all want to make art, realise their artistic visions. That’s what matters. ” (Berlin Interview, / / ).
During one of the modules of the programme I took part in (“Fine Arts III – Empower, Navigate, Participate”), the thirteen participating artists, who were mostly in their thirties, were in fact of very diverse nationalities – Colombian, Chinese, SouthAfrican, Russian, Japanese, Syrian, Tunisian, Lebanese – which were not countries “in confict”. The reasons that led the artists on the programme to emigrate were therefore not always connected to situations of political crisis. The length of their residence or “exile” in Berlin also varied greatly, ranging from three months to ten years.
The workshop organised by the Touring Artists organisation that I attended was aimed in particular at artists who had recently been awarded a fellowship for the “Cosmopolitan Berlin” programme. The organisers told me about their hesitation over what to call the workshop, fnally deciding on: “Finding your feet in Berlin. A workshop for artists from countries in crisis who have recently moved to Berlin and their institutional partners.” The description “artists from countries in crisis” seemed to them the most inclusive possible. When the defnition is too vague, dilemmas about how to categorise the target audience can also lead to ambiguity in programme managers’ expectations about applications. This can be seen, for instance, in the comments by the coordinator of the programme Artist Training: Refugee Class for Professionals , which became, simply, Artist Training for Professionals. On this change in the programme title, she explained that: “Offcially, we can’t accept artists from European countries, in which case we simply have to say: ‘No, sorry’. When artists from China, Russia, or South American countries apply, in that case we really have to give it some careful thought – has this artist really arrived for reasons of repression, or something else? And in that case, we can say: ‘Yes, it’s possible”’ But Europe ? No. An application from a French artist – no, not possible! Or from Sweden, or the United States… Because, well, we are funded. If this were simply a project led by the University of the Arts, okay, but as it is a European Social Fund project, there are certain rules that have to be followed. There’s a questionnaire applicants have to fll out, in which they have to specify their country of origin, and, I think, how long they have been here in Germany. But it doesn’t ask them to specify their status as a refugee or asylum seeker – not at all. […] We don’t ask… or rather we don’t hierarchise : ‘this is a political refugee’; not at all, it’s “refugee and artist” and nothing more.” (Berlin Interview, / / ).
121 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
While using the category of “refugee” to exclude certain nationalities, she thus seeks to dissociate the term from the categorisation of the “political” refugee, which is overly restrictive. Likewise, the workshops organised by Touring Artists are directed at “artists above all else”, on the basis that the issues are the same for all artists in Germany (and in Berlin, in this case) : getting to grips with the administrative challenges surrounding their status (as a freelancer, etc.) when it comes to social security, pension, and unemployment entitlements; building a network within Berlin’s cultural and artistic scene; and making contacts with cultural institutions in Berlin. However, the specifc status of the target audience is also revealed by the individuals chosen to run the workshops: for all the workshops, the keynote speakers and activity leaders are Berlin-based artists who themselves have a connection to the issue of migration, and who have been living in Berlin for several years at least.
Forms of hierarchisation between migrant artists in Berlin’s art scene
The categories employed by the creators of the reception and assistance programmes for displaced artists do not clearly correspond to a state categorisation wherein “benefciaries 3 ” can be easily identifed – such as the state categories of “refugees”, “the unemployed”, etc. They are more vague and, in practice, there is also some hierarchisation between different displaced artists within the Berlin art scene. Discussing the Syrian art scene in Berlin, Simon Dubois describes “shifts in the Syrian creative landscape in Berlin ”, highlighting a “reconsideration of exile in specific terms in the creative field”. He mentions the issues surrounding the status of the “artist-asylum seeker” with the emergence of an artistic hierarchy within the dynamic of displacement itself4 . Thus, some Syrian artists see their exile in Berlin “as the extension […] of their insertion into a globalised artistic space ”, or simply “as one step in their career ”, and refuse to be categorised as refugee artists. Others, on the other hand, “seek to integrate
3. Gérard Noiriel, “Représentation nationale et catégories sociales. L’exemple des réfugiés politiques”, in Genèses, n° 26, 1997, pp. 25-54.
the scene of their host country and… accept an artistic identity connected with their background and/or with the status of exile 5 ” . In our survey, the effects of hierarchisation do not arise between artists from the same “national community” but rather between artists of different nationalities. To be precise, artists “from a country in crisis” are placed in competition with one another, with the defnition of “country in crisis” being very malleable. A Chilean artist thus described to me how he felt (his comments were very similar to those of a Brazilian artist) : “I understand that Syrian artists are prioritised in the Cosmopolitan Berlin programme; they have come from a country at war. But it’s diffcult for us to fnd a way to stay here, even though we too have come from a country in crisis, politically speaking… ” (Berlin Interview, / / ).
As Jean-Baptiste Comby and Julie Pagis recall, “categorisation struggles are at the heart of how governments define who is entitled to what 6 ”. Paradoxically, some artists, particularly from Latin America – who could be considered as less entitled to this assistance than artists who have fed a war, even though they left their country for reasons they judge to be “political” - are also sometimes the ones who face the greatest diffculty in obtaining the longterm visas needed to remain in Germany and practise their art there.
Positions in Berlin’s “post-migrant” art scene
Particularly since the 2000s, a so-called “post-migrant” and “postcolonial” art scene has developed in Berlin. Its objective is to redefne the national German-speaking community through the inclusion of migrants, both among artists and the public. Since the late 2000s, several theatres have developed a “postmigrant” approach, “anchored on the normalcy of migration in contemporary society. This trend developed following the acknowledgement of the absence of immigrants and descendants of immigrants in art 7 ”, as well as of non-white and postcolonial people.
Examples of this theatrical approach include the Maxim Gorki Theatre and the Ballhaus
5. Ibid., p. 56.
6. Jean-Baptiste Comby, Sylvie Pagis, op. cit., p. 7.
122 LE POINT SUR | THE CONSTRUCTION AND APPROPRIATION OF THE FIGURE OF THE “REFUGEE ARTIST”
4. Simon Dubois, “Négocier son identité artistique dans l’exil. Les recompositions d’un paysage créatif syrien à Berlin”, in Migrations Société, vol. 4, n° 174, 2018, p. 48.
7. Simon Dubois, “Négocier son identité artistique dans l’exil. Les recompositions d’un paysage créatif syrien à Berlin”, op. cit., p. 51.
Naunynstrasse Theatre. Through their programmes, directors, and the actors that perform there, these theatres seek to reconsider the German-speaking theatre scene in the light of the contribution of migration, particularly by promoting plays performed in different languages and normalising the use of the Arabic language. On its website, the Balhaus Naunynstrasse is presented as follows: “Now, as a post-migrant theatre, the Ballhaus Naunynstraße has offered an institutional stage, a space for protagonists with an experience of immigration and their stories; a new space for cultural vibrancy. The presentation of the Gorki Theatre even mentions the need to question Berlin’s collective identity in the light of the ‘diversifed world’: ‘The Gorki is aimed at the entire city, including those that have arrived in the city in recent decades; those seeking asylum, in exile, immigrants, or simply people who grew up in Berlin. You are all invited to this public space where we will examine the human condition and our identity conficts through the art of making and watching theatre, contributing to a thorough, thoughtful debate on living together in today’s diversifed world. How did we become what we are? And who do we want to be in the future? In short: who are ‘we’? ”
In , the Gorki Theatre also created a “troupe of exiles”, the Exil Ensemble, which since 2019 has been funded exclusively by the Berlin Senate Department for Culture and Europe, and which is described as a “platform for professional artists forced to live in exile ”. Seven actors and actresses from Syria, Palestine, and Afghanistan work and perform as part of the troupe. Several of the artists encountered during our survey mentioned that they came to Berlin for artistic reasons, drawn by its artistic reputation and the history of Germany’s art, music and theatre scenes. However, while it does present migrant artists with certain opportunities, this “post-migrant” cultural and artistic scene can also prove limiting and restrictive, hemming them into it, as one Syrian producer notes: “ We Syrian artists, we defnitely need a lobby, to ensure our voices are heard more clearly. […] We have something in common: We are all from Syria. But that doesn’t mean we are all the same. […] Here, though, as Syrians, we are all lumped together, and we make theatre at the Gorki. That’s not a real opening.” (Berlin Interview, / / ).
Simon Dubois also notes that for some Syrian artists who have settled in Berlin, “ the categories of ‘refugee artist’ and ‘Syrian artist in exile’ seem to be
understood as a depreciation in artistic terms 8 ”. Some forms of subversion can be witnessed in relation to the label “refugee artist”, which is both employed as symbolic capital and contested in relation to some of the representations associated with it.
Affrming one’s presence and appropriating an artistic voice on exile
It is worth noting that the artists benefting from the programmes mentioned here applied “as” refugee/exiled artists “in order to refuse to be treated as” a refugee/person in exile, in line with the minority paradox identifed by Didier Fassin and Éric Fassin 9 Thus, while the category of the “refugee/exiled artist” does not demonstrate a high degree of objectifcation – it has proven be very vague and not institutionalised – it also elicits a very limited degree of identifcation. In any case, artists play with the label of “refugee/ exiled artist” for their own beneft; often, they do not ascribe to it as such but rather use it as a means of combating the stereotypes surrounding migrants. Being categorised as a refugee artist can lead to a sense of being exoticised. Some artists thus seek to change people’s view of them and reclaim their situation. One might cite, for instance, the example of when a number of student artists in the *foundationClass of 2017 took over an award ceremony, when some journalists were supposed to come and flm them; by arming themselves with cameras and flming the journalists in their turn, they established themselves as subjects rather than objects. Through this gesture, they denounced the forms of exoticisation to which they felt they were subjected (video performance, “Trust us”). Some artists on the same programme also worked on a project entitled “We are here”, the objective being to produce posters that would demonstrate some of the “perceptions, declarations, and demands of people who have fed to Berlin ”, by giving them the foor and shining a light on individuals who “from the point of view of refugees, are barely mentioned in public debates ” and the “stereotypes ” with which “ the citizens of countries at war and in crisis are confronted 10 ”.
8. Ibid., p. 53.
9. Didier Fassin, Éric Fassin (ed.), De la question sociale à la question raciale ? Représenter la société française, Paris, La Découverte, 2006.
10. URL: http://neuenachbarschaft.de/2017/07/04/wir-sind-daplakatausstellung.
123 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
For some artists, another effect of migration is that it transforms their artistic practice. N., a 29-yearold Syrian trumpet player, thus explains how his musical practice has changed in Germany. He does not allude to a form of artistic assimilation, but rather what he sees as reciprocal influences between “German” and “Arabic” music : “I’ve had to change my music so that Germans could understand it. I can’t play purely Syrian music, so I’ve added in a bit of jazz and European music. Our music is so melancholic, so sad and nostalgic at times, while German music is more joyful, more aggressive. […] It’s had an effect on me and we have affected music here too, as Arabs that is. Nowadays, you can detect an oriental vibe in every music track, in clubs, bars, and even at the Berghain, one of the most well known techno clubs in Berlin; an oriental, Arab vibe. It’s so mixed nowadays. German and Syrian music are fused together a bit now. I’ve changed ; I can no longer play purely Syrian music.” (Berlin Interview, / / ).
M., a Syrian graphic designer, painter and performer born in 1991, explains how she incorporated the German language into her art, seeing learning the language as imperative not to comply with the requirements made of immigrants, but rather so she could better defend the situation of immigrants through her graphic work in the language of her country of residence: “I decided to learn German straight away, not because of the integration test but so I could discuss my perspective on integration. Nowadays, I make paintings featuring written texts, in German.” (Berlin Interview, / / ).
Lastly, others have expressed the need to liberate themselves completely from the expectations directed at exiled artists to produce work that takes into account this aspect of their journey and life experience. O., a photographer and video maker born in Syria in 1993 with a passion for Japanese and for literature, stressed his desire to create freely around the themes that are important to him and which are in no way related to war or exile. He explained that he has already made a flm about his experience of crossing borders during his exile journey, but no longer wished to get caught up in it, since he was upset by how it
had been received, with people seeing him as a victim worthy of pity, which hurt his ego: “As a Syrian, people expect that of me… ‘You should make a flm about the war in Syria!’ But I don’t want to do something that isn’t in my own voice. And just because I am Syrian doesn’t mean I have the skills to make a documentary about the war...” (Berlin Interview, / / ). ‘
Conclusion
When it comes to artists, the “classic” debate on the right way to describe displaced persons and the connotations associated with different categorisations – “migrant”, “refugee”, “exile” – is at variance with the idea of creative freedom associated with this unique professional activity. An approach based on the sociology of categorisation reveals certain constraints and limitations, as well as forms of competition, affecting displaced artist from certain countries. The low degree of objectifcation of the categories of “refugee artist” or “exiled artist” is demonstrated by the hesitations over the terms used to describe such individuals in Berlin’s assistance and support programmes for artists forced to “fee their countries”. Finally, from the perspective of the artists themselves, this categorisation appears to be a double-edged sword: while on the one hand such categories entitle them to funding (both public and private), they can also prove limiting when they are associated with designated roles that restrict their artistic practice, for instance when they feel obliged to engage in artistic projects relating to their experience of war. The case of exiled artists, lastly, provides new insights into the challenges shared by several minorities (racial minorities, women, etc.), all of whom are confronted with the “need to simultaneously affrm and deny their difference 11 ”.
124 LE POINT SUR | THE CONSTRUCTION AND APPROPRIATION OF THE FIGURE OF THE “REFUGEE ARTIST”
Traduction en anglais Victoria Weavil
11. Joan Scott, La Citoyenne paradoxale. Les féministes françaises et les droits de l’homme, Paris, Albin Michel, 1998.
L’étude « Dialogues Migrations »
Identifer les acteurs et analyser les représentations

médiatiques sur les migrations
L’agence française de développement médias CFI a lancé en avril le projet Dialogues migrations, fnancé par le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), qui met en œuvre des activités pilotes de renforcement de capacités et d’appui à la production sur la thématique migratoire auprès de médias, de journalistes et d’écoles de journalisme en Gambie, en Guinée, en Mauritanie et au Niger. Dans le cadre du projet Dialogues migrations, une étude participative a également été commanditée. Elle s’inscrit dans une démarche prospective pour apprécier la pertinence et l’opportunité de développer, en lien notamment avec l’Agence française de développement (AFD), de futurs projets de renforcement et d’appui aux médias pour un traitement « informé » et « équilibré » du sujet des migrations. Cette étude participative a été conduite afn d’identifer les acteurs et les actrices agissant dans les médias et sur les migrations, de comprendre et d’analyser les représentations véhiculées par les discours médiatiques et les publics relayés dans les médias et les réseaux sociaux sur les migrations. Elle dresse un état des lieux des actions déjà déployées par d’autres opérateurs internationaux et analyse leur impact. Elle couvre la période de janvier à mars et étudie seize pays : Burkina Faso, Colombie, Comores, Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée, Jordanie, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal, Togo et Tunisie. Agence française de développement médias CFI

125 HOMMES & MIGRATIONS TIRÉ À PART
Scanner le QR code pour accéder à l’étude
X Illustration © Carole Barraud
The Study ‘Dialogues Migrations’

Identifying Actors and Analysing Media

Representations of Migration
In April , t he French media development agency CFI launched the “Dialogues Migrations” project, fnanced by the French Ministry of Europe and Foreign Affairs (MEAE), which organises pilot capacity-building and production support activities on migration issues for media, journalists and journalism schools in Gambia, Guinea, Mauritania and Niger. Within the framework of the Dialogues Migrations project, a participatory study was also commissioned as part of a forward-looking approach to assess the relevance and opportunity of developing, in conjunction with the French Development Agency (AFD), future projects to strengthen and support the media in order to ensure an “informed” and “balanced” coverage of migration issues. This participatory study was conducted to identify the actors working in the media and on migration, and to understand and analyse the representations conveyed by media and public discourses of migration in the media and social networks. It takes stock of the actions already deployed by other international operators and analyses their impact. It covers the period from January to March and studies sixteen countries: Burkina Faso, Colombia, Comoros, Ivory Coast, Gambia, Guinea, Jordan, Lebanon, Madagascar, Mali, Mauritania, Morocco, Niger, Senegal, Togo and Tunisia.
126 LE POINT SUR | L’ÉTUDE « DIALOGUES MIGRATIONS » / THE STUDY ‘DIALOGUES MIGRATIONS’
French media development agency CFI
Scan the QR code to access the study
X Illustration © Carole Barraud
LA REVUE EST DISPONIBLE À NOTRE SIÈGE
Établissement public du Palais de la Porte Dorée
Musée national de l’histoire de l’immigration
Librairie : 293, avenue Daumesnil | 75012 Paris
Tél. : 01 53 59 58 63 | Fax : 01 53 59 58 66 editions@palais-portedoree.fr | www.histoire-immigration.fr | www.hommes-et-migrations.fr


Vous pouvez commander auprès de votre libraire et/ou vous adresser aux librairies suivantes, qui connaissent la revue :

RÉGIONS : Librairie du Vieux Port, 29 Quai de Belges, 13001 Marseille | Librairie de l’Université, 12 rue de Nazareth, 13100 Aix en Provence | Librairie Privat, 17 rue de la Liberté, 21000 Dijon | Librairie Grangier, 14 rue du Château, 21000 Dijon | Librairie Ombres Blanches, 50 rue Gambetta, 31000 Toulouse | Librairie universitaire - Études Université Le Mirail, 5 allée Antonio Machado, 31000 Toulouse | Librairie La Machine à Lire, 8 place du Parlement, 33000 Bordeaux | Librairie Mollat, 15 rue Vital-Carles, 33080 Bordeaux Cedex | Le Grain des mots, 13 bd du Jeu-de-Paume, 34000 Montpellier |Librairie Scrupule, 26 rue du Fbg-Figuerolles, 34070 Montpellier | Librairie Durance, 4 allée d’Orléans, 44011 Nantes | Librairie Vent d’Ouest, 5 place Bon-Pasteur, 44016 Nantes cedex 1 | Librairie des Temps Modernes, 57 rue Notre-Dame-de-Recouvrance, 45000 Orléans | Librairie Contact, 3 rue Lenepveu, 49100 Angers | Librairie Espace Harmattan, 35 rue Basse, 59000 Lille | Librairie Furet du Nord, 15 place du Général-de-Gaulle, 59800 Lille | Librairie les Volcans d’Auvergne, 80 bd F.-Mitterrand, 63000 Clermont-Ferrand | Librairie internationale Kléber, 1 rue Francs-Bourgeois, 67000 Strasbourg | Librairie des Facultés, 2-12 rue de Rome, 67000 Strasbourg (Esplanade) | Librairie Au bonheur des Ogres, 4 quai de la Pêcherie, 69001 Lyon | Librairie H. Decitre, 29 Place Bellcourt, 69002 Lyon | Librairie universitaire D. Reaux – Université de Lyon, 5 avenue Mendès-France, 69500 Bron | Librairie Champitre.com, 19 place Bellecourt, 69002 Lyon | Librairie l’Armitière, 5 rue des Basnages, 76000 Rouen | Librairie La Galerne, 170 rue Victor-Hugo, 76600 Le Havre | Libriaire Siloé Sype, 58 rue Joffre, 85004 La Roche sur Yon Cedex


PARIS ET RÉGION PARISIENNE : Librairie la Réserve, 81 avenue Jean-Jaurès, 78711 Mantes-la-Jolie | Librairie Les Folies d’Encre, 22 rue Jean-Jaurès, 93200 Saint-Denis | Librairie l’Harmattan, 16 rue des Écoles, 75005 Paris | L’Harmattan-Boutique de l’Homme, 24 rue des Écoles, 75005 Paris | Librairie Compagnie, 58 rue des Écoles, 75005 Paris | Librairie le Point du jour, 58 rue Gay-Lussac, 75005 Paris | Librairie la Procure, 28 bis rue Madame, 75006 Paris | Librairie Tschann, 125 bd Montparnasse, 75006 Paris | Librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot, 75011 Paris | Librairie Quilombo, 23 rue Voltaire, 75011 Paris | Librairie la Brêche, 27 rue Taine, 75012 Paris | L’Arbre à Lettres, 62 rue du Fbg Saint-Antoine, 75012 Paris | Librairie Jonas, 14 rue de la Maison Blanche, 75013 Paris | Librairie des éditions Byzance, 48 rue du Chevaleret, 75013 Paris | Librairie le Divan, 203 rue de la Convention, 75015 Paris | Librairie de Paris, | 7 place de Clichy, 75017 Paris | Kiosque Belleville, 1 rue de Belleville, 75019 Paris | Librairie l’Atelier, 2 bis rue du Jourdain, 75020 Paris | Librairie de la Documentation française, 29-31 quai-Voltaire, 75340 Paris cedex 07
ÉTRANGER : Librairie Dokumente-Verlag, postfach 13-40, Offenburg, Allemagne | Librairie Fnac, rue Neuve 123/401, 1000 Bruxelles, Belgique | Librairie Tropisme, 11 Galerie des Princes, B-1000 Bruxelles, Belgique | Librairie Filigranes, avenue des Arts 38/39, B-1040 Bruxelles, Belgique | Librairie Pax, 4 place Cockerville, B-4000 Liège, Belgique | Librairie du Boulevard, 34 rue de Carouge, 1205 Genève, Suisse
DIFFUSION POUR LES LIBRAIRES FRANCE ET ÉTRANGER : merci de vous adresser à editions@palais-portedoree.fr – 01 53 59 58 63. Remise libraire 35 % (frais de port non compris).
hommes & migrations est publiée par l’établissement public du Palais de la Porte Dorée, Musée national de l’histoire de l’immigration, 293 avenue Daumesnil, 75012 Paris

Conception graphique www.4minutes34.com & www.lendroit.com
avec le concours de :
Dupliprint, , rue Saint Léonard, Mayenne cedex • Tél. : - mrocton@dupliprint.fr • Les titres, les intertitres et les chapeaux sont de la rédaction. Les opinions émises n’engagent que leurs auteurs. Les manuscrits qui nous sont envoyés ne sont pas retournés. ISSN - X - ISBN - - - -
NUMÉROS DISPONIBLES
2023 ( €)
n Revisiter les migrations européennes
n Musées partagés
n hors-série Racisme, antisémitisme et discriminations
L’état des savoirs
2022 ( €)
n École & socialisations
n Artistes étrangers à Paris ( - )
n #Connectés
n Place aux jeunes ( €)
n Saisir le murmure du monde. Récits de soi en migration
n Exposer le racisme et l’antisémitisme
n hors-série Corps de femmes en migration
(accessible en ligne uniquement)
n L’enfance en exil
n Ce qui s’oublie et ce qui reste ( €)
n hors-série Poser pour la liberté. Portraits de scientifques en exil (en vente uniquement par PAUSE)
n Femmes engagées
n 1973, l’année intense
n Migration et création littéraire
n Les réfugiés dans l’impasse ( €)
n hors-série blédi
Toulouse Présences maghrébines dans la ville rose – 1945-2001 (épuisé)
n Diversités culturelles dans les capitales européennes depuis 1945 : Paris-Londres-Madrid
n Londres et ses migrations – Les affches Cavaniol entrent au Musée
n Paris-Londres –
L’art de la contestation
n Religion et discrimination ( €)
n hors-série blédi
Toulouse Présences maghrébines dans la ville rose – 1945-2001 (épuisé)
n Diversités culturelles dans les capitales européennes depuis 1945 : Paris-Londres-Madrid
n Londres et ses migrations – Les affches Cavaniol entrent au Musée
n Paris-Londres –L’art de la contestation
n Religion et discrimination
Les parutions antérieures à sont disponibles uniquement en librairie ou en libre accès sur revues.org/ hommes-et-migrations ( €)
n Persona grata (épuisé)
n Exposer les migrations
n Les mots de l’exil dans l’Europe du XIXe siècle
n Au prisme de la consommation ( €)
n Réfugiés et migrants au Liban
n - L’Europe en mouvement
n L’Islam en Europe ( €)
n Ondes de choc
n Migrations chinoises et générations
n 1983
Le tournant médiatique ( €)
n Diasporas iraniennes
n Femmes & migrations
n Fashion Mix
n Le troisième âge des migrants ( €)
n Les Paris des migrants
n L’Afrique qualifée dans la mondialisation
n Écrire la migration
n L’exil chilien en France ( €)
n Frontières
n Diasporas marocaines
n Le Japon, pays d’immigration
n Migrations et mondes ruraux ( €)
n Les nouveaux modèles migratoires en Méditerranée
n Musulmanes et féministes en Grande-Bretagne
n Algérie - France, le temps du renouveau
n Migrations en création
n Le Mexique
dans les migrations internationales
n Algérie - France, une communauté de destin ( €)
n L’intégration en débat
Établissement public du Palais de la Porte Dorée Musée national de l’histoire de l’immigration , avenue Daumesnil, Paris www.hommes-et-migrations.fr karima.dekiouk@palais-portedoree.fr Nom
Je m’abonne pour un an ( numéros) pour la première fois et bénéfcie de l’abonnement découverte à € (Offre réservée uniquement aux abonnés – particuliers et associations résidants en France métropolitaine). Prochain dossier à paraître en 2022 : Migrations et réseaux sociaux (n° , avril-juin ).
Je me réabonne (abonné n° ) Institutions, bibliothèques, entreprises : France € Étranger €
Particuliers et associations : France € Étranger €
Je commande numéro(s) (Dossiers grand format) au tarif unitaire de 15 € et j’ajoute 5 € de frais de port par dossier (cochez les numéros commandés sur la liste ci-contre).
Pour l’étranger, compter 2 € supplémentaire de frais de port par numéro (soit 7 €).
Je commande numéro(s) (Dossiers petit format parution antérieure à 2019) au tarif unitaire de 10, 12 ou 15 € et j’ajoute 3 € de frais de port par dossier (cochez les numéros commandés sur la liste ci-contre). Pour l’étranger, compter 1,50 € supplémentaire de frais de port par numéro (soit 4,50 €)
Montant de la commande €
Je règle ce montant : par chèque bancaire ci-joint à l’ordre de l’Agent comptable de l’EPPPD par versement sur notre compte à la Recette générale des Finances - Paris cedex
RIB n°
IBAN : FR
BIC : BDFEFRPPXXX
Important : Pour nos abonnés à l’étranger, nous ne pouvons accepter les chèques.
Si l’adresse de la facturation est différente de l’adresse ci-dessus, prière de nous l’indiquer
Date Signature
Prénom Organisme Adresse Code postal Ville Pays Téléphone E-mail
Musa est originaire de Gambie et travaille en tant que styliste à Berlin. Son art lui permet de donner plus de visibilité à sa culture d’origine et de la partager avec la société européenne.





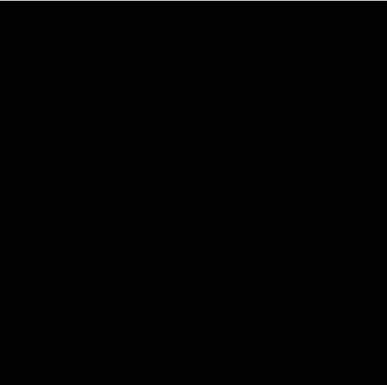


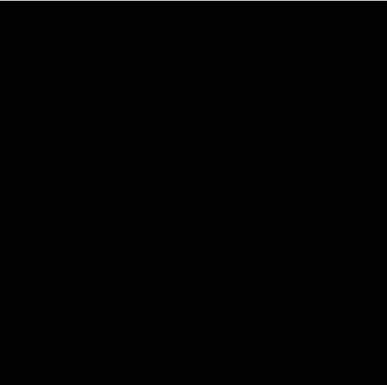
Musa is from Gambia and works as a fashion designer in Berlin. His art allows him to give more space to his culture of origin and share it with the European crowd.







© IOM IDiaspora / Médine Tidou





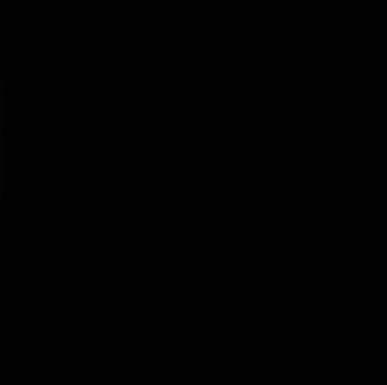



culture et mobilité
Reflecting on the Connection between Culture and Mobility
Une initiative de la présidence française du Forum mondial sur la migration et le développement An initiative of the French Chairmanship of the Global Forum on Migration and Development

■ Droits culturels et migrations
// Cultural rights in migrations
Alexandra Xanthaki
■ La liberté artistique et l’exil – Réflexions à partir de quatre artistes plasticiens
// Artistic Freedom and Exile – Reflections Based on Four Visual Artists
Aline Angoustures
■ Les musées des migrations dans le monde
// Migration Museums around the World : the Main Issues
Gegê Leme Joseph
■ Écrivains migrants, littératures d’immigration, écritures diasporiques – Le cas de l’Afrique subsaharienne et ses enfants de la « postcolonie »

// Migrant Writers, Immigration Literature, and Diaspora – Writings Sub-Saharan Africa and its Children of the “Postcolony”
Nathalie Philippe
■ La diaspora est-elle (vraiment) un creuset de créativité ?
// Is the Diaspora (Really)
a Melting Pot of Creativity?
Jean-Baptiste Meyer
■ Portfolio Musiques Mouvements Migratoires : Hors Flux Humains
// Portfolio Migratory Musical Movements: Beyond Human Flows
Nadine Bilong
■ Rap, antiracisme et identités locales en région liégeoise
// Rap, Anti-Racism, and Local Identities in the Liège Region
Marco Martiniello
■ Construction et appropriations de la figure de l’« artiste réfugié » dans des dispositifs d’accueil artistique à Berlin
// The Construction and Appropriation of the Figure of the “Refugee Artist” in Reception
Facilities for Artists in Berlin
Soline Laplanche-Servigne
■ L’étude « Dialogues Migrations » – Identifier les acteurs et analyser les représentations médiatiques sur les migrations
// The Study “Dialogues Migrations” – Identifying Actors and Analysing Media Representations on Migration
Revue Hommes & Migrations | été 2023 | Tiré à part |
Penser les réciprocités entre
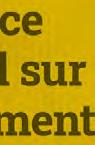


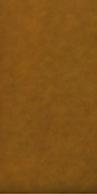
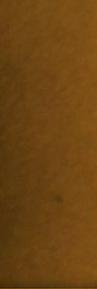














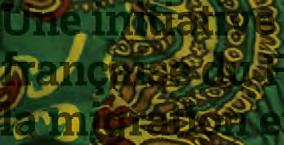


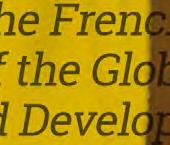

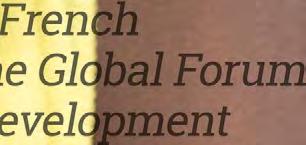
























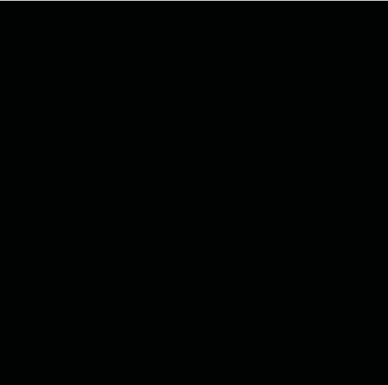

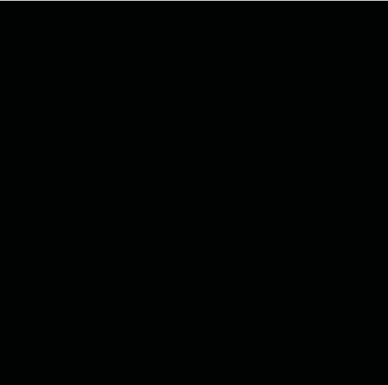
 IOM IDiaspora / Médine Tidou
IOM IDiaspora / Médine Tidou


 Couverture et intérieurs de couverture / Front and inside covers : © IOM IDiaspora / Médine Tidou
Couverture et intérieurs de couverture / Front and inside covers : © IOM IDiaspora / Médine Tidou



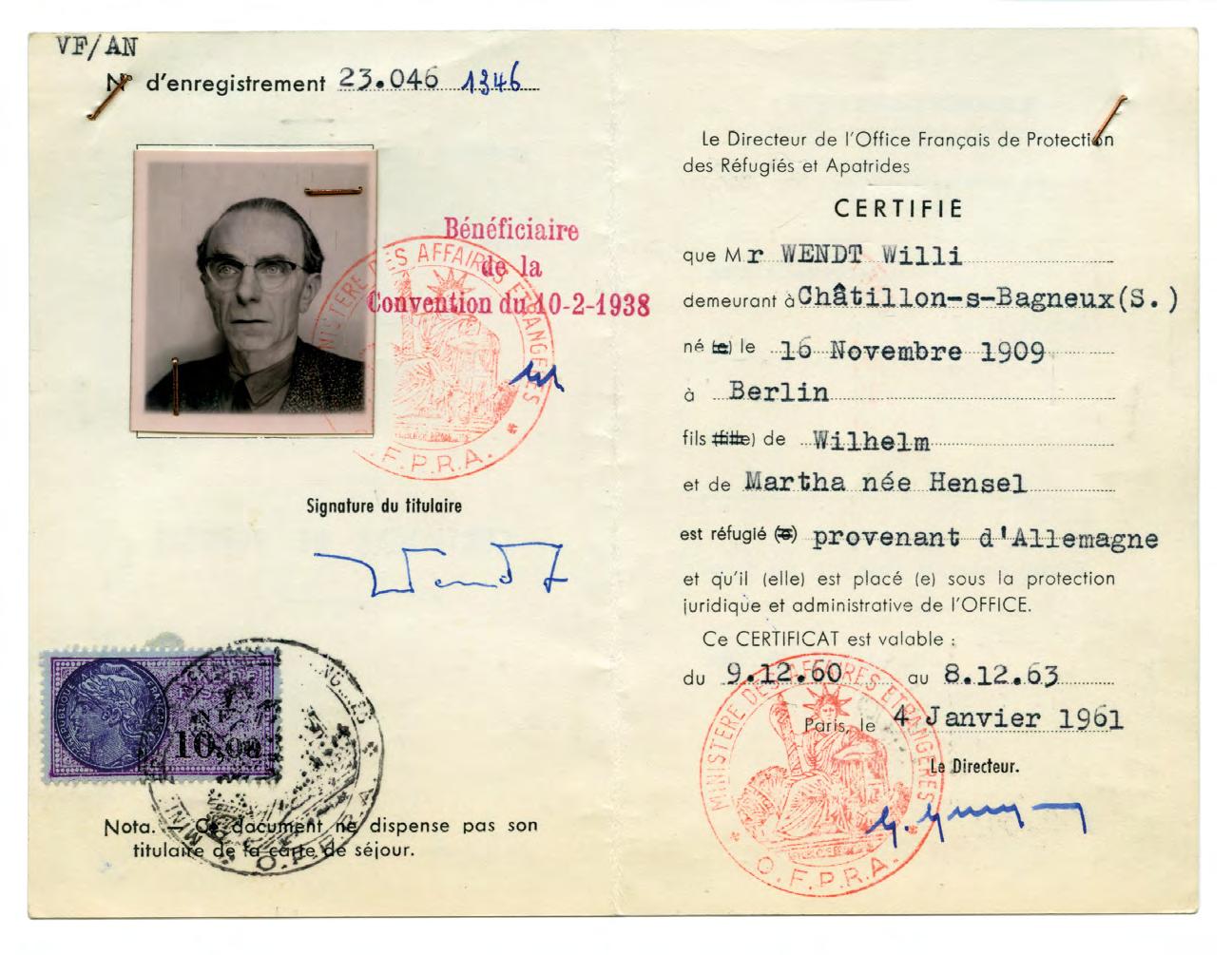


 X Vue de l’exposition permanente du Museu da Imigração de São Paulo (Brésil).
X View of the permanent exhibition of the Immigration Museum (Brazil). © Museu da Imigração de São Paulo.
X Vue de l’exposition permanente du Museu da Imigração de São Paulo (Brésil).
X View of the permanent exhibition of the Immigration Museum (Brazil). © Museu da Imigração de São Paulo.




 Photo Janine Niépce © MNHI.
Photo Janine Niépce © MNHI.


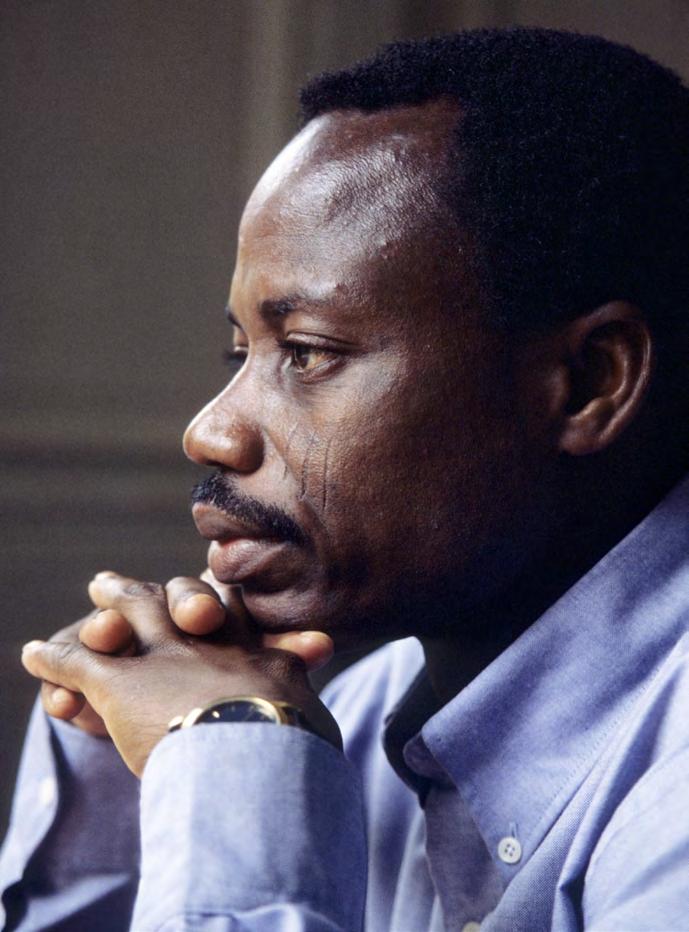








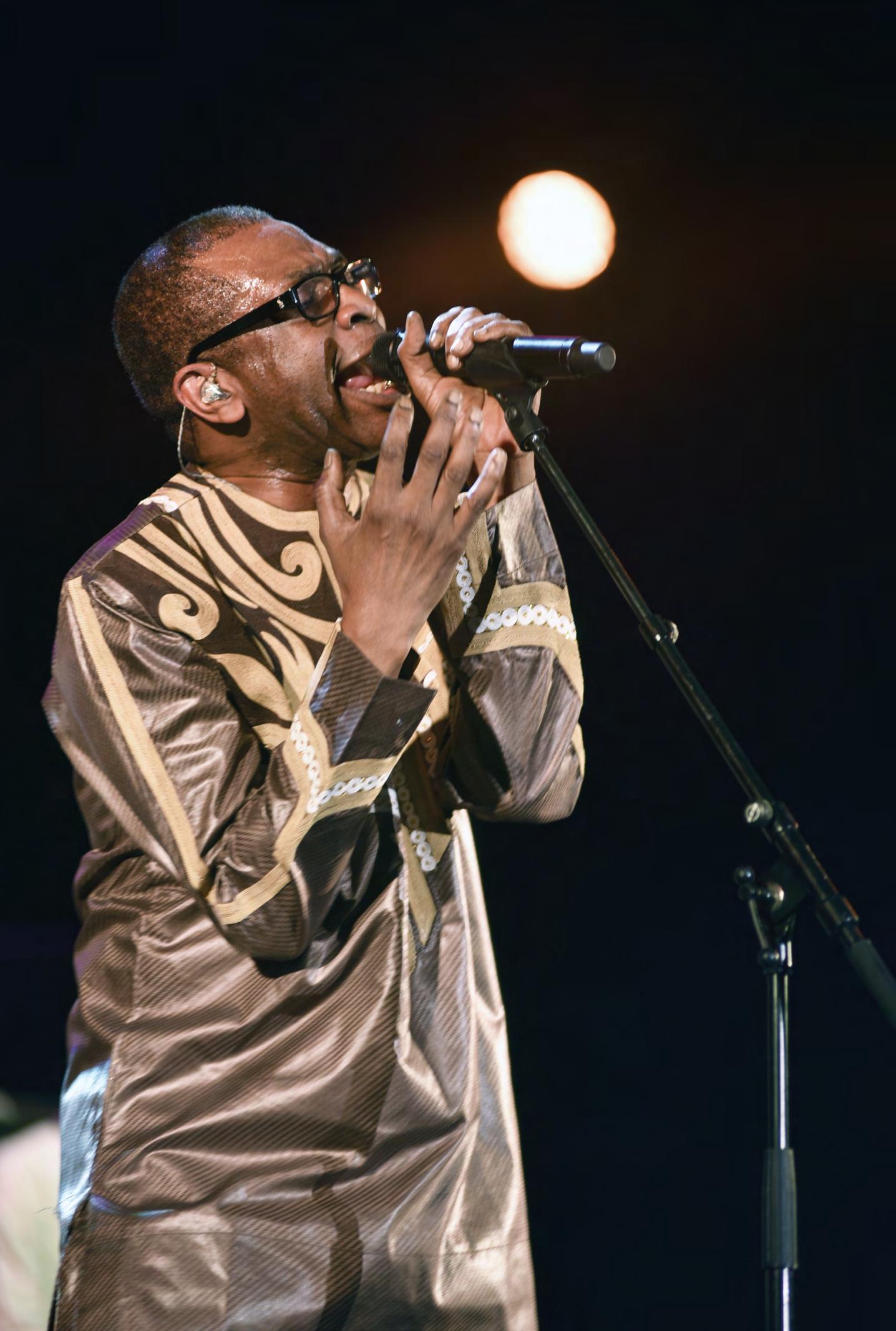









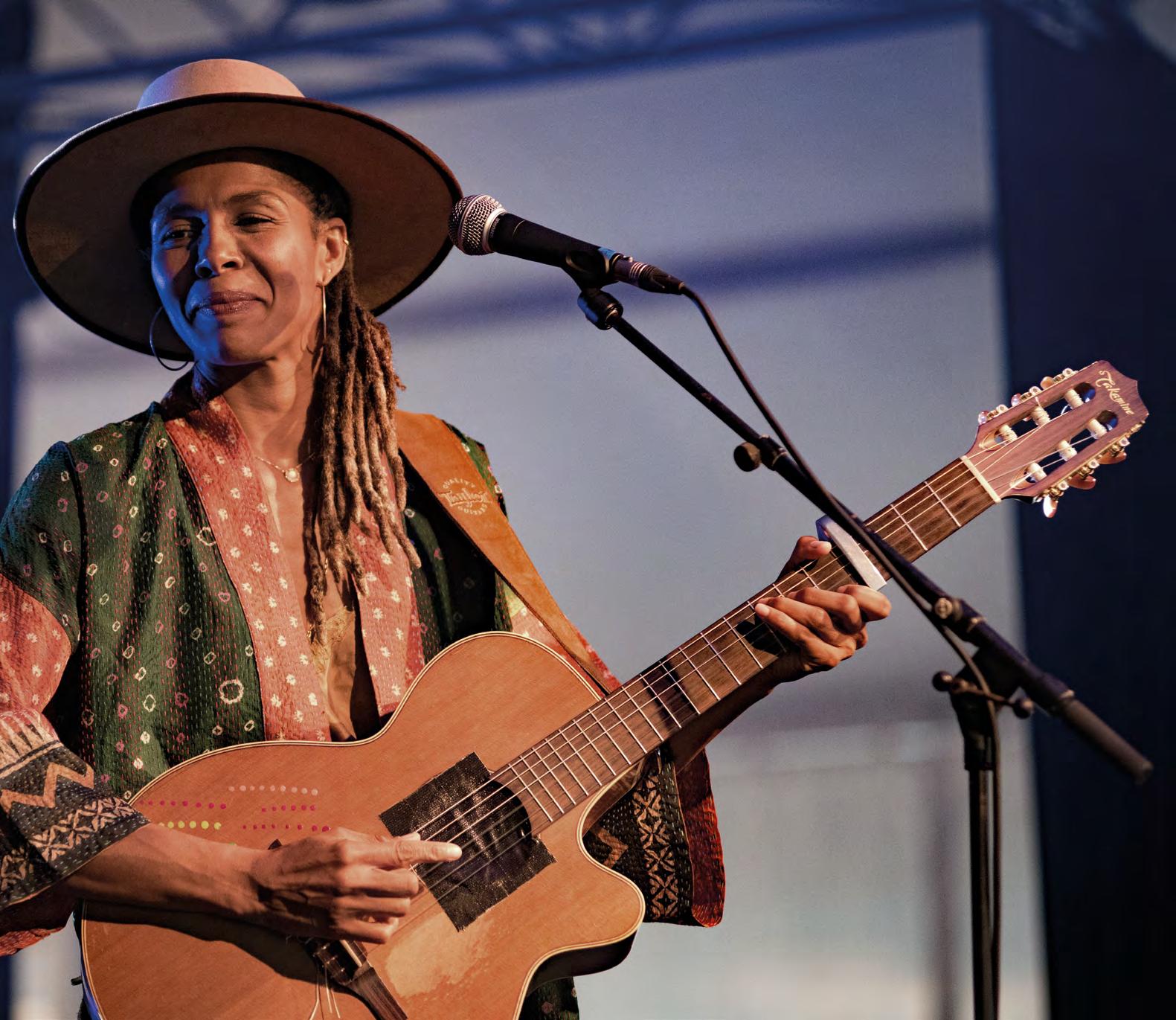
 X Selçuk Demirel, Ogre, 2014, encre sur papier, 37,5 cm x 32,5 cm, paru dans Le Monde, 23 mars 2021.
X Selçuk Demirel, Ogre, 2014, ink on paper, 37.5 cm x 32.5 cm, published in Le Monde, March 23, 2021. © EPPPD-MNHI.
X Selçuk Demirel, Ogre, 2014, encre sur papier, 37,5 cm x 32,5 cm, paru dans Le Monde, 23 mars 2021.
X Selçuk Demirel, Ogre, 2014, ink on paper, 37.5 cm x 32.5 cm, published in Le Monde, March 23, 2021. © EPPPD-MNHI.