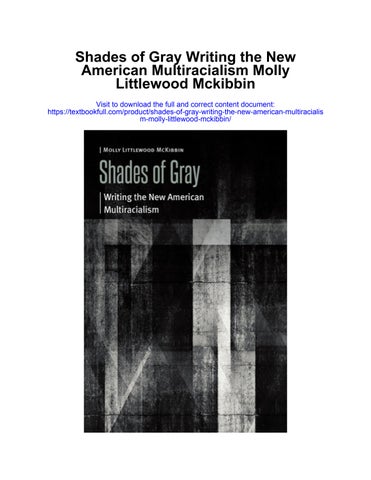Shades of Gray
Introduction
Race and Mixed Race in the United States
While race mixing began well before there were “races” to mix, what is usually meant by European and African race mixing in the United States occurred even before enslaved Africans were brought to North America. Many scholars note that mixing occurred during the Middle Passage and that Europeans who arrived in Africa before the transAtlantic slave trade had already begun producing what we might now call “multiracial children” with Africans before the first Africans were forced aboard slave ships. Reaching even further back, others point out that “whites and blacks had been mixing in Africa, Europe, and Asia for eons before Columbus sailed the western ocean, and they mixed in Latin America for a century before either white Englishmen or black Africans came to the Virginia shore.”¹ It is interesting, then, that while black–white racial mixture has been a part of American history since the first African was brought to the “new world,” this same mixture has been considered new generation after generation. In literature alone, the newness of race mixing is remarked upon over the course of centuries. For instance, Frederick Douglass proclaims in his 1845 Narrative, “It is plain that a very different looking class of people are springing up at the south . . . from those originally brought to this country from Africa,” while in Charles W. Chesnutt’s 1900 novel The House behind the Cedars, John Warwick insists: “You
must take us for ourselves alone—we are a new people.”² In the 1930s Jean Toomer asserted, “In America, we are in the process of forming a new race. . . . I was one of the first conscious members of this race,” while Vera/Greta, in Danzy Senna’s 2004 novel Symptomatic, claims, “We’re a new race. A new people.”³
The perpetual renewal of race mixing’s “newness” is largely a result of, or a response to, shifting perceptions of blackness, whiteness, and race more generally. Race and racial mixing are thought about and defined differently over time, and so both undergo huge shifts in the social imagination. However, because of the United States’ historical obsession with race and the separation of black and white, mixture has never posed a formidable threat to either the existing racial hierarchy or the categories of black and white, though it has certainly demonstrated the problematic conceptions and applications of both. That is, while the United States changes the way it thinks about race over time, its changing attitudes toward and understandings of race have always maintained in one way or another a belief in a race binary that has survived centuries of social, legal, and scientific revision. As a result, race mixture has been continually in a position of resistance even though it is nothing new and has not caused an overhaul or dissolution of the black–white binary. In turn, American literature reflects and responds to ideas about race and race mixture as they change, and since race mixture never generated significant change to existing race concepts over time and was itself so infrequently acknowledged, it is little wonder that, a century apart, Chesnutt and Senna would write characters who identify themselves as members of a “new people.” Because multiracialism has never successfully altered the conception of black and white throughout American history, it can be seen as a perpetual— though largely ineffectual—threat to the racial binary.
One might rightly ask, then, why this book claims that we are witnessing a “new multiracialism” in the twenty-first century; in fact, many critical mixed race studies scholars decidedly oppose the idea that black–white multiracialism in the current century is any different from multiracialism in the past. Those who assert that contemporary multiracialism offers nothing more than did its iterations in the nineteenth
and twentieth centuries often raise concerns that are important when considering some of the claims that multiracial advocates make. Among the skeptics’ most vital concerns are the possibilities that, depending on how and what we understand it to be, multiracialism might well duplicate racial caste systems of the past that left white supremacy and the race binary entirely intact, or it could abandon race and in the process abandon social justice struggle. These are not only valid concerns but issues central to any responsible discussion of multiraciality, and they are addressed in chapter 1. They remind us how careful we must be as we think through the complexities of (multi)racial identity. However, they do not foreclose the possibility that we are witnessing a new era of multiracialism— one in which a genuine and socially sensitive challenge is being posed to American race concepts. What Shades of Gray works to establish is that contemporary multiracialism is not only arising out of a very different social context than in the past but also offering a different and new set of challenges to monoracial conceptions of blackness and whiteness. Like some opponents of multiracialism, I agree that we must be very careful not to invest in multiracialism as a hybrid category that leaves blackness and whiteness untouched or as an end to race via color blindness. I do not propose that contemporary multiracialism is already dismantling racialism or racism, and I do not see the category of multiracialism as disruptive to American race practices. Rather, I hope that this book helps us to think through how being both black and white—not simply “multiracial”— can alter the ways in which both blackness and whiteness are conceptualized. I also hope to demonstrate that contemporary multiracialism can be black positive and framed in the terms of social justice, and that it can work to unseat the white supremacy that has characterized historical conceptualizations of whiteness.
While we do need to be careful about accepting multiracialism uncritically or praising it as some sort of solution to centuries of racialism and inequality in a naïve or premature effort to achieve a “postracial” society, such caution can translate into defensiveness or even dismissal. I propose that while we need to call out efforts among some scholars and advocates to turn multiracialism into color blindness or some
other “end to race,” there is rich opportunity to consider carefully what multiracialism can offer us and what writers do offer in their representations of it. If we reorient some of the existing discussion to see black–white multiracialism in its contemporary context—informed by but no longer existing within the first half of the twentieth century—we can notice how the literature often prods us to see multiracialism in a new light. Specifically, I think that contemporary multiracial literature is, for the first time, challenging the monolithic categories that we believe blackness and whiteness to be and the dichotomous way they have historically functioned in the United States. If anything, multiracialism is more about blackness and whiteness than it is about hybridity in and of itself. In other words, this examination of multiracialism and its depiction in contemporary literature proposes that multiracialism is neither simply a third category of hybridity nor a reconstitution of the race binary that sets black and white in opposition. It is only by reading multiracialism as a simultaneous claim of both blackness and whiteness that we can change the views of blackness as a racial sponge, whiteness as racially pure, and hybridity as a separate category that leaves blackness and whiteness untouched as a binary. Rainier Spencer dismisses the effectiveness of multiracialism’s impact on race: “Adopting multiracial identity is not owning oneself; it is merely trading monoracial bondage for multiracial bondage. Race is still race, whether the shackles are monoracial or multiracial.”4 I agree that multiracial identity is as much a racialized identity as monoracial identity. But where Spencer sees this as evidence that multiraciality is not, in fact, doing anything to race, I propose that multiracialness can force us to think through how racialization works and what our race concepts mean. If the prevailing beliefs about race—the “pure” conceptualization of whiteness and one- drop conceptualization of blackness— are tested through black–white multiracialism, then multiraciality is doing quite important and unprecedented work. While passing narratives of a century ago used multiracialism to demonstrate the arbitrariness of the color line, the degree to which they could really challenge beliefs about blackness and whiteness was limited by the time period, when the color line was seen in quite “black and white” terms, helped
not a little by de jure segregation and fresh memories of racial slavery. Shades of Gray argues that contemporary representations of multiracialism are unlike those of the past because they begin to query how we conceptualize monoraces (that is, blackness and whiteness as monoracial categories). So while multiracialism, in its present state, is not “destroying” race, it is making us rethink race in ways that call into question our beliefs about race. It is by rethinking those race concepts that we might, eventually, “break down” race—but we are not at a historical moment where race can logically be “destroyed.” Rather, we still need race for reasons of, at the very least, social justice.5 Whether race in and of itself ever stops being practiced or needed is a related question but really a different conversation than what we are having in critical mixed race studies at the moment.6 Ultimately, Shades of Gray exemplifies Kenneth Warren’s observation that “African American literature is the study and contestation of what race had done and is still doing to people”; it is in this spirit— of understanding what race “has done” and examining what race is “still doing” in America—that I offer what follows.7
Talking about Race: A Note on Terminology
Because this discussion is an analysis of literary engagement with the social practice of race rather than an examination of the legitimacy of race as a concept, my analysis will use racial terminology with its inaccuracy, shifting meanings, and complicated history in mind. This kind of language helps us understand how labels (and the concepts and ideologies they signify) operate in the particular cultures from which they arise. Shades of Gray seeks to engage with the history of race concepts and the resulting terminology without lending them validity; it also seeks to explore the impact of what race has been believed (and is believed) to mean.
The only term I will define in an attempt to be more precise is “racial identity.” With this term, I mean to evoke the nature of racial classification as a social practice, avoid the idea that race is inherent or ascribed with certainty, and signal that “identity” is something that can take many forms, originate from various sources, and be altered. I use “racial identity” as a way of noting that racial identity can reflect
personal choice or public opinion, can change over time or in an instant, can encompass or resist conventional racial and ethnic categories, might or might not reflect ancestry, and can be performed or thought to require an “authentic” claim. In other words, the phrase “racial identity” is meant to acknowledge that race is a socially developed system of classification and that its labels (and the concepts behind them) are not innate or scientific.8
Historical Context: Multiracialism Then and Now
Dichotomous American race concepts began with slavery and have produced not only concepts of blackness, whiteness, and mixedness but also what have become black pride and political solidarity—two of the most important aspects of current multiracial discourse. Because the long history of race and mixture in the United States has produced these beliefs and values that we now grapple with in the twenty-first century, it is helpful to take a moment here to understand that history.9
The British colonies treated white indentured servants (who owed their voyage costs) and black Africans (who were first traded to Virginians in 1619) similarly for about forty years until economic pressures divided and ranked them—that is, until white labor diminished (since it was against Christianity to enslave fellow Christians, the indentured had to be set free) and black slavery was adopted in full (since slave labor was deemed necessary and indigenous peoples were so difficult to enslave).¹0 The justification of slavery at the time, based largely on racist religious claims, ensured black inferiority, white superiority, and a future in which black enslavement could be continued indefinitely. Kathleen Korgen observes that the first colonists categorized people based on status rather than race (by distinguishing between “servants and masters” and lacking conceptions of “white and black”), and so a distinction had to be made between the races for slavery to work; convincing lower- class whites to see the inferiority of blackness was the cornerstone of this strategy.¹¹ Korgen also points out that while miscegenation was condemned “even before slavery was an issue,” by 1622 the English law that relegated all children to the status of their fathers was reversed in the colonies to ensure that mixed children (most of whom
were the offspring of white fathers and black mothers due, in part, to a shortage of white women among the colonists) would follow their mothers’ slave status.¹² Once white women began to immigrate in larger numbers, efforts were made to keep white women accessible to white men as wives and to prevent race mixture. For instance, white women were discouraged from marrying black men through a short-lived 1664 law that enslaved them along with their husbands.¹³ Laws like these, which condemned multiracial children and their white mothers to indentured servitude—and enslaved free blacks who married whites— were abolished, in part because they actually caused miscegenation when “masters” would encourage or force the coupling of white women and black men to gain decades of bondage from the families. By the end of the seventeenth century, anti-miscegenation laws prohibited the coupling of black men and white women and thus, through matrilineal racial descent laws, worked to keep black and white from mixing officially.¹4 Such anti-miscegenation laws reflect a relatively new and developing idea at the time about black and white as a racial dichotomy, with the former firmly subjugated to the latter.¹5 Indeed, anti-miscegenation laws in the seventeenth century show a “society in the act of inventing race” in order to strengthen slavery.¹6
Over time, the racial caste systems in slave states changed to accommodate a growing free population: a group that was predominantly multiracial. In the only pre-Revolutionary enumeration of free blacks in the Southern colonies, the “overwhelming majority” of the small number of “free Negroes” were “light- skinned children of mixed racial unions.”¹7 As centuries passed, free blacks and “mulattoes” formed a separate class in the Deep South and, in fact, were treated relatively well by whites since they were considered a buffer between slaveholding whites and the black masses. In some cases, groups within this (wealthier) class of free “colored” people had more in common with sophisticated, moneyed whites than with any black people. In many instances, in fact, the allegiance of elite groups of free mulattoes to whites was a result of their own family connections to them, since the large number of freed mulattoes in the Deep South was due to wealthy white men taking an interest in and freeing their multiracial families.
As a result of this close relationship between particular groups of mulattoes and whites, mulatto populations participated in anti-blackness at times (as they attempted to separate themselves from blackness), though when defensive white supremacy was reinvigorated—as it was periodically—whites tended to restore a race binary and return mulattoes to categorical blackness.
The lower South behaved more like Latin America and the Caribbean in its consideration of racial classification and its observation of many degrees of blackness/whiteness—behavior that was strikingly different from that of the upper South, where anyone not “pure” white was considered black.¹8 In South Carolina, for instance, “the harshest slavery somehow bred the greatest freedom for free mulattoes,” and before 1850 “mulattoness did count, real distinctions were made, and the one- drop rule did not always prevail.”¹9 In Louisiana, the “Creoles of color” also complicated race categories since they enjoyed intermediate status not simply as mulattoes but as a “triracial” and “alternate third identity.” G. Reginald Daniel argues that Creoles of color effectively challenged assumptions about the race binary, though the intermediate status they had enjoyed under Spain and France became quite different under the United States after the Louisiana Purchase.²0 The subsequent attempt to make Creoles simply black led the Creoles of color to institute blue vein societies that “challenged the social inequities associated with being designated African American” and to form communities “‘outside’ the social and cultural parameters of the African American community.”²¹ However, Creoles, mixed people, and free black people in the lower South made up small groups, relatively speaking, and the buffer mulatto caste was formed along the lines of economic class (as opposed to racial mixture itself). The majority of mixed individuals were enslaved and free mulattoes (or other free “colored” people) without powerful white connections were often poor and considered just as subordinate as “servants, Negroes, slaves, mustees, and Indians” by the governing elite.²²
As a result of the Louisiana Purchase of 1803 (which spread slavery) and the Slave Act of 1807 (which halted the importation of new slaves), the enslaved were getting notably whiter.²³ However, by the
mid-nineteenth century, many states conferred slave and free status based on race: if you were black you were a slave; if you were white you were not. Whites could not be slaves—the idea was repugnant to those who otherwise endorsed slavery. The ironies of such a view abound, including the fact that whites knew perfectly well that their slaves had white ancestry (to the point that some enslaved people looked entirely white) and sometimes were their own relatives. Additionally, whites’ own sexual exploitation of black women resulted in a small but conspicuous trade in “fancy girls”—young enslaved people who were mixed or white (in appearance if not in status) and were bought expressly for more miscegenation.²4 The great intellectual effort to justify slavery leading up to the Civil War was built upon the race binary, and as Joel Williamson points out, nowhere did the proslavery argument account for mixed race; nowhere did proponents of slavery based on white supremacy account for the enslavement of white blood. Williamson explains that “in effect by 1850 proslavery thinkers had no choice.”²5 Advocates of slavery had already committed themselves to a racial defense of slavery, and thinkers in the 1830s did not know what to make of people with black and white ancestry: “Slaves, by definition, could not be white. The fact that slavery was getting whiter, that in reality many slaves were more white than black, was a fact with which the proslavery argument could not cope. Either it could ignore the problem, which it did explicitly, or it could brusquely dismiss it by applying the one- drop rule to persons in slavery, which it did implicitly.”²6 As in the early decades of slavery in the seventeenth century, the nineteenth century’s understanding of black and white was based not on any abstract notion of race but on the necessity of explaining slavery. As Williamson argues, “Racism took the shape that slavery imposed. In the world the slaveholders made, Southern whites were not allowed to believe anything about black people other than what served the purposes of slavery.”²7
As slavery underwent extensive attack by the middle of the nineteenth century and white Southerners “closed ranks” in its defense, free mulattoes were “looked upon with increasing suspicion.”²8 In the effort to defend slavery in the years preceding the Civil War, communities formerly tolerant of a free “colored” class instead began to consider
mulattoes in terms of the taint of blackness encroaching upon their superiority and purity and to reassert the racial binary.²9 Vigilante and surveillance groups sought to punish and expel interracial and mulatto families through terrorism, while some states passed laws prohibiting “any free persons of color from living in the state.”³0 The rise of scientific racism in this century helped fuel hostility toward the free mulatto class, and “no longer did many whites view mixed-race people as ‘almost white’”—instead, mixed blood was considered a racial category worse than blackness.³¹ It did not take long for the one- drop rule to erase the remaining mulatto caste, and by the 1850s and ’60s, “any black blood, no matter how remote, made one black.”³² The infamous comments of a grand jury in Virginia summarize concisely the danger of a mulatto category: “No intermediate class can be other than immensely mischievous to our peculiar institution.”³³
The existence of an elite mulatto caste well before the Civil War illustrates how the perpetuation of the race binary was to some extent an accepted fiction. The small groups of sophisticated and wealthy mulatto families had much more in common with slaveholding whites than with the enslaved black population, to the point that some even acquired black slaves of their own. However, after the Civil War, mulattoes dissolved as a separate class or race and became black in both public perception and the sentiment among themselves, though Creoles were an exception to a large extent.³4 The imposition of the onedrop rule was a “tightening of racial boundaries” intended to protect whiteness and white power.³5 This rule, paired with the bitterly hostile brand of racism that flourished during and after the war, resulted in mulattoes generally identifying more with blacks. After emancipation the position of elite mulattoes no longer existed since there was no longer a distinction between free and enslaved status. Lines were drawn along the black–white color line alone, and the sharp increase in violent white supremacy (marked in part by the postwar rise of Anglo-Saxon clubs, including the Ku Klux Klan) meant that poor whites could assert themselves in a way that was formerly impossible. Additionally, former slaveholders eventually sought the alliance of poor whites against the new population of free “colored” people, exploiting
the anxiety of poor whites who were eager to reaffirm their superiority in new ways after losing the reliable hierarchy of racial slavery. After the war “colored” people had to face the hatred of a population that had been ruined militarily, socially, economically, and politically. Black emancipation offered a focus for that hatred quite readily. The racism of whites in the South as well as the North taught mulattoes to align themselves with blacks. Simultaneously, anti-miscegenation laws, which in the antebellum era were “a necessary adjunct to slavery,” became “the foundation of post– Civil War white supremacy” by “grouping all non-White races in opposition to Whites.”³6
While the one- drop rule was resisted by some former members of the mixed racial tier who mourned their loss of status and made efforts to maintain a racial hierarchy, by the 1920s such ambitions “had faded because those who most desired to be white had passed and slipped quietly into the white world,” and the remainder focused on black “racial survival,” worrying little about the maintenance of a system that observed gradations of blackness.³7 The strong new political alliance among all “colored” people was bolstered by hypodescent, which ensured that mixture continued to be synonymous with blackness for subsequent generations.³8 By the early decades of the twentieth century, the elite class of mulattoes had become “Negro” and shifted their loyalty to blackness, often using their privilege and education for the sake of black rights. This elite group would help form the naacp and influence the cultural movement of the Harlem Renaissance. Williamson asserts that a vastly disproportionate number of Negro leaders in the generations after the Civil War were “visibly mulatto,” and that many from this group, including both W. E. B. Du Bois and Booker T. Washington, came to dominate black political struggle.³9 In fact, “almost all” of Du Bois’s “Talented Tenth” (those who formed black leadership) consisted of individuals with known white ancestry.40 For instance, Walter White, a president of the naacp, was himself blond and blue- eyed and had to assure Negroes that he was black. As Naomi Zack notes, mixed individuals “were well regarded by both blacks and whites—blacks made them their leaders, and whites accepted them as black leaders.”4¹ Thus, despite the elimination of the middle tier of
mulattoes as the buffer between whites and blacks, the members of that elite group continued to serve as the bridge between white and black. Notwithstanding the one- drop rule and segregation, both of which affirmed the race binary, gradations of black–white multiracialism were counted in numerous census surveys until the removal of such categories from the federal census signaled an official shift away from recognizing black–white mixture. For instance, the “mulatto” population was counted in censuses from 1850 to 1890 and then again in the 1910 and 1920 censuses before the category disappeared for good.4² In 1890 the census included black, white, mulatto, quadroon, and octoroon; although white was still pure and superior, “a person half white and half black was neither black nor white” officially.4³ Such counting, which was meant to be a reasonably scientific account of clearly delineated races, served only to reveal that it was quite impossible to determine race with any certainty. White ancestry could be invisible in black-identified people, just as black ancestry could be invisible in white-looking people. Mixture was usually left up to the surveyor to determine, and the census included certain criteria at various times regarding appearance, community, and lineage to help assign racial categories. The U.S. Census Bureau even undertook research into racial groups in 1918, the results of which suggested it was likely that threequarters of the “Negroes in the United States were of mixed blood” in 1910 even though only 21 percent of them “were counted as mulattoes by the census, in which visibility was the test. Pure blacks,” they thought, “were on the way to extinction.”44 Thus, racial classification schemes, even when they attempted to account for mixture, were totally unreliable and had no real method of determining racial classification. Anthropologists in the mid-1920s also determined that physically, the “New Negro” was a new homogeneous group “neither African nor European, neither Negro nor Caucasian.”45 This study also concluded that the “new” population of black people was largely mixed blackwhite-Native. (It goes without saying that all conclusions about race groups and their degrees of so- called mixedness or purity depended on particular methodologies and classifications that were inherently biased.) When mixture was removed from the census in 1930, the U.S.
Census Bureau helped “to create a simply biracial America” as “the entire Negro population became lighter” and all shades, fractions, and degrees simply counted as black.46 The courts were no better able to determine legal racial classification with certainty; many legal cases regarding race classification took into consideration appearance, ancestry, economic status, social rank, and the opinion of the community as to one’s race, while state after state sought to legally define race in terms of fractions. Often, racial identity boiled down to whether one “acted like” and was “treated as” a white or black person. Apparently white people were informed in court that they were actually black, and people who were visibly “colored” were granted legal whiteness. The acknowledgment, from slavery to Jim Crow, of “white niggers” or “white Negroes” highlights the difficulty the United States had in successfully classifying and keeping separate white and black. However, this is not to say that the country did not work hard to maintain the color line. In the early to mid-twentieth century antimiscegenation laws were still in place in many states in an attempt to keep black and white “blood” separate, and interracial sex and marriage were regulated in the majority of the country through these laws—as well as through custom and lynching. Several racial-minority groups were named in anti-miscegenation laws, which worked not to prevent intermarriage between all groups but to prevent intermarriage with whites. These laws, in other words, were “equally” applied to everyone but were usually phrased in ways that specified it was marriage between whites (especially white women) and other groups that was illegal in order to protect the purity of the white race.47 As some anti-miscegenation laws were abolished, new laws were created so that interracial relationships validated in some states were invalidated in others. This attempt to stem the spread of human and civil rights continued well after the 1948 United Nations Declaration of Human Rights prohibited limitations on the right to marry based on race. In the fifties, the courts in Virginia—the state perhaps most dedicated to anti-miscegenation statutes—asserted that the state’s anti-miscegenation laws reflected Virginia’s goal “to preserve the racial integrity of its citizens” and to “regulate the marriage relation so that it shall not have a mongrel breed of
citizens.”48 The Virginia Supreme Court stated that anti-miscegenation laws merely reflected appropriate “racial pride”49—the same white supremacist pride that was apparent in the state’s eugenics-inspired Racial Integrity Act of 1924, which was “the most draconian miscegenation law in American history.”50 It is significant in no small measure, then, that it was in Virginia that what is considered the final legal victory of the civil rights movement took place. The Loving v. Virginia case of 1967 struck down all remaining anti-miscegenation laws in the United States and, as Peggy Pascoe argues, initiated the multiracial movement when the couples finally able to legally wed after the Loving case began forming support groups for the first federally protected interracial families in the late seventies.5¹
Importantly, marriage rights were essentially the last civil right addressed because the issue was so “explosive to whites” in that segregationists and other white supremacists were convinced that intermarriage with whites was the ultimate goal of black people agitating for racial equality.5² Additionally, “most civil rights activists believed that fighting segregation and disenfranchisement was more important than trying to change laws and customs prohibiting personal relationships across the color line.”5³ While racial integration among their membership was important to many civil rights groups, interracial sex was still a major concern for groups like sncc (Student Nonviolent Coordinating Committee) and core (Congress of Racial Equality), which generally attempted to prevent it within their organizations and keep it out of the public’s gaze when it did occur.54 The potential of interracial relationships to derail civil rights efforts made the topic risky—in the midcentury, even liberal pro-integration whites were uncomfortable with and unprepared to accept the logical extension of civil rights to matters of interracial sex and marriage. In the second half of the twentieth century a large proportion of whites opposed interracial marriage, but so too did many black people.55 The militant black nationalism of the 1960s and ’70s opposed interracial relationships, especially between black women and white men—in large part because black nationalism was so invested in black masculinity. The racism that had fueled
Another random document with no related content on Scribd:
Galérius, Maximin et Licinius. Mais il ne rachetait ce défaut par aucune bonne qualité: naturellement timide et paresseux, il l'était devenu encore davantage par la vieillesse. Cependant il n'eut pas besoin d'un plus grand mérite pour se soutenir plus de trois ans contre Maxence, comme nous le verrons dans la suite.
Deux caractères tels que ceux de Maximien et de Galérius ne pouvaient demeurer long-temps unis.
������. Maximien quitte la pourpre pour la seconde fois
Le premier chassé de Rome, exclu de l'Italie, obligé enfin à quitter l'Illyrie, n'avait plus d'asyle qu'auprès de Constantin. Mais en perdant toute autre ressource, il n'avait pas perdu l'envie de régner, quelque crime qu'il fallût commettre. Ainsi, en se jetant entre les bras de son gendre, il y porta le noir dessein de lui ravir la couronne avec la vie. Pour mieux cacher ses perfides projets, il quitte encore une fois la pourpre. La générosité de son gendre lui en conserva tous les honneurs et tous les avantages: Constantin le logea dans son palais, il l'entretint avec magnificence; il lui donnait la droite partout où il se trouvait avec lui; il exigeait qu'on lui obéît avec plus de respect et de promptitude qu'à sa propre personne; il s'empressait lui-même à lui obéir: on eût dit que Maximien était l'empereur, et que Constantin n'était que le ministre.
Le pont que ce prince faisait construire à Cologne, donnait de la crainte aux barbares d'au-delà du Rhin, et cette crainte produisait chez eux des effets contraires: les uns tremblaient et demandaient la paix; les autres s'effarouchaient et couraient aux armes. Constantin qui était à Trèves rassembla ses troupes; et suivant le conseil de son beaupère, dont l'âge et l'expérience lui imposaient, et dont sa propre franchise ne lui permettait pas de se défier, il ne mena pour cette expédition qu'un détachement de son armée. L'intention du perfide vieillard était de débaucher les troupes qu'on lui laisserait, tandis que son gendre, avec le reste en
Lact., de mort. pers c 29
Eumen. Pan. c. 14 et 15
A� 309
���� Il la reprend
Eumenius, Pan c 16
Lact , de mort pers c 29
petit nombre, succomberait sous la multitude des barbares. Quand après quelques jours il crut Constantin déja engagé bien avant dans le pays ennemi, il reprend une troisième fois la pourpre, s'empare des trésors, répand l'argent à pleines mains, écrit à toutes les légions, et leur fait de grandes promesses. En même temps pour mettre toute la Gaule entre lui et Constantin, il marche vers Arles à petites journées en consumant les vivres et les fourrages, afin d'empêcher la poursuite; et fait courir partout le bruit de la mort de Constantin.
Cette nouvelle n'eut pas le temps de prendre crédit. Constantin, averti de la trahison de son beau-père, retourne sur ses pas avec une incroyable diligence. Le zèle de ses soldats surpasse encore ses désirs. A peine veulent-ils s'arrêter pour prendre quelque nourriture; l'ardeur de la vengeance leur prête à tous moments de nouvelles forces; ils volent sans prendre de repos des bords du Rhin à ceux de la Saône [Arar]. L'empereur pour les soulager les fait embarquer à Châlons [Cabillonensis portus]; ils s'impatientent de la lenteur de ce fleuve tranquille; ils se saisissent des rames, et le Rhône même ne leur semble pas assez rapide. Arrivés à Arles ils n'y trouvent plus Maximien, qui n'avait pas eu le temps de mettre la ville en défense, et s'était sauvé à Marseille. Mais ils y rejoignent la plupart de leurs compagnons qui, n'ayant pas voulu suivre l'usurpateur, se jettent aux pieds de Constantin et rentrent dans leur devoir. Tous ensemble courent vers Marseille, et quoiqu'ils connaissent la force de la ville, ils se promettent bien de l'emporter d'emblée.
En effet, dès que Constantin parut, il se rendit maître du port, et fit donner l'assaut à la ville: elle était prise, si les échelles ne se fussent trouvées trop courtes. Malgré cet inconvénient, grand nombre de soldats s'élançant de toutes leurs forces, et se faisant soulever par leurs camarades, s'attachaient aux créneaux et s'empressaient de
�. Constantin marche contre lui.
Eumen. Pan. c. 18.
Lact., de mort. pers. c. 29.
��. Il s'assure de sa personne.
Eumen. Pan. c. 19 et 20.
Lact , de mort pers c 29
gagner le haut du mur, lorsque l'empereur, pour épargner le sang de ses troupes et celui des habitants, fit sonner la retraite. Maximien s'étant montré sur la muraille, Constantin s'en approche, et lui représente avec douceur l'indécence et l'injustice de son procédé. Tandis que le vieillard se répand en invectives outrageantes, on ouvre à son insu une porte de la ville, et on introduit les soldats ennemis. Ils se saisissent de Maximien et l'amènent devant l'empereur, qui, après lui avoir reproché ses crimes, crut assez le punir en le dépouillant de la pourpre, et voulut bien lui laisser la vie.
Cet esprit altier et remuant, qui n'avait pu se contenter ni du titre d'empereur sans états, ni des honneurs de l'empire sans le titre d'empereur, s'accommodait bien moins encore de l'anéantissement où il se voyait réduit. Par un dernier trait de désespoir, il forma le dessein de tuer son gendre; et par un effet de cette imprudence, que Dieu attache ordinairement au crime pour en empêcher le succès ou pour en assurer la punition, il s'en ouvrit à sa fille Fausta femme de Constantin: il met en usage les prières et les larmes; il lui promet un époux plus digne d'elle; il lui demande pour toute grace, de laisser ouverte la chambre où couchait Constantin, et de faire en sorte qu'elle fût mal gardée. Fausta feint d'être touchée de ses pleurs, elle lui promet tout, et va aussitôt avertir son mari. On prend toutes les mesures qui pouvaient produire une conviction pleine et entière. On met dans le lit un eunuque, pour y recevoir le coup destiné à l'empereur. Au milieu de la nuit Maximien approche; il trouve tout dans l'état qu'il désirait: les gardes restés en petit nombre s'étaient éloignés; il leur dit en passant qu'il vient d'avoir un songe intéressant pour son fils et qu'il va lui en faire part: il entre, il poignarde l'eunuque et sort plein de joie, en se vantant du
A� 310 ��� Mort de Maximien
Lact , de mort pers c 30
Euseb Hist eccl l 8, c 13
Eutrop l 10
Vict epit p 221
Idat chron
Orosius, l. 7, c. 28
Till. art. 17.
Médailles [Eckhel, doct Num vet t ����, p. 34-40].
coup qu'il vient de faire. L'empereur se montre aussitôt, environné de ses gardes; on tire du lit le misérable, dont la vie avait été sacrifiée: Maximien reste glacé d'effroi; on lui reproche sa barbarie meurtrière, et on ne lui laisse que le choix du genre de mort: il se détermine à s'étrangler de ses propres mains; supplice honteux, dont il méritait bien d'être lui-même l'exécuteur et la victime. Il ne fut pourtant pas privé d'une sépulture honorable. Selon une ancienne chronique[9] , on crut, vers l'an 1054, avoir trouvé son corps à Marseille, encore tout entier, dans un cercueil de plomb enfermé dans un tombeau de marbre. Mais Raimbaud, alors archevêque d'Arles, fit jeter dans la mer le corps de ce persécuteur, le cercueil, et même le tombeau. Constantin, assez généreux pour ne pas refuser les derniers honneurs à un beau-père si perfide, voulut en même temps punir ses crimes par une flétrissure souvent mise en usage dans l'empire romain à l'égard des princes détestés: il fit abattre ses statues, effacer ses inscriptions, sans épargner les monuments mêmes qui lui étaient communs avec Dioclétien. Maxence qui n'avait jamais respecté son père pendant sa vie, en fit un dieu après sa mort[10] .
[9] Voyez la Collection de Duchesne, t ���, p 641 S -M
[10] Plusieurs médailles où il est appelé divus, sont la preuve de son apothéose, voyez Eckhel, Doct. num. vet., t. ����, p. 38. S.-M.
Maximien, selon le jeune Victor, ne vécut que soixante ans. Il avait été près de vingt ans collègue de Dioclétien. Pendant les cinq dernières années de sa vie, il fut sans cesse le jouet de son ambition, tour à tour tenté de reprendre et forcé de quitter la puissance souveraine; plus malheureux après en avoir goûté les douceurs, qu'il ne l'avait été dans la poussière de sa naissance, que son orgueil lui fit oublier dès qu'il en fut sorti. Les panégyristes, corrupteurs des princes quand ni l'orateur ni le héros ne sont philosophes, s'entendirent avec lui-même pour le séduire. Il avait pris le nom d'Herculius; ce fut pour la flatterie des uns et pour la vanité de l'autre
����. Ambition et vanité de Maximien.
Vict. epit. p. 222. Mamertin. Pan. c. 1.
un titre incontestable d'une noblesse qui remontait à Hercule. Pour effacer la trace de sa vraie origine, il fit construire un palais dans un lieu près de Sirmium, à la place d'une cabane où son père et sa mère avaient gagné leur vie du travail de leurs mains.
Incert pan Maximien, et Const c 8
Il mourut à Marseille au commencement de l'an 310, qui est marqué dans les fastes en ces termes, la seconde année après le dixième et le septième Consulat: c'était celui de Maximien et de Galérius, en 308. Galérius n'ayant point nommé de consuls pour les deux années suivantes, elles prirent pour date ce consulat. Quoi qu'en dise M. de Tillemont, je soupçonne qu'Andronicus et Probus, marqués pour consuls en 310, dans les fastes de Théon, ne furent nommés par Galérius qu'après la mort de Maximien. Il ne voulut pas qu'on continuât de dater les actes publics par le consulat d'un prince, qui venait de subir une mort si ignominieuse. En Italie Maxence s'était fait seul consul pour la troisième fois, sans prendre pour collègue son fils Romulus, comme dans les deux années précédentes: ce qui donne à quelques-uns lieu de croire que ce jeune prince était mort en 309. Son père le mit au nombre des dieux.
La révolte de Maximien avait réveillé l'humeur guerrière des barbares; son malheureux succès leur fit mettre bas les armes. Sur la nouvelle de leurs mouvements, Constantin se mit en marche vers le Rhin: mais dès le second jour, comme il approchait d'un fameux temple d'Apollon, dont l'histoire ne marque pas le lieu, il apprit que tout était calmé. Il prit cette occasion de rendre hommage de ses victoires à ce dieu, qu'il honorait d'un culte particulier, comme il paraît par ses médailles, et de lui faire de magnifiques offrandes.
��� Consulats
Idat chron
Till. art. 14 et note 25 sur Constantin Pagi, in Baron [Eckhel, doct. num vet t ����, p 59 ]
��. Constantin fait des offrandes à Apollon.
Eumen. Pan. c. 21.
[Eckhel, doct. num. vet. t. ����, p. 75.]
��� Il embellit la ville de Trèves
Il continua sa marche jusqu'à Trèves, et s'occupa à réparer et à embellir cette ville, où il faisait sa résidence ordinaire. Il en releva les murailles ruinées depuis long-temps: il y fit un cirque presque aussi grand que celui de Rome, des basiliques, une place publique, un palais de justice; édifices magnifiques, si l'on en croit Euménius, qui prononça en cette occasion l'éloge du prince restaurateur.
Eumen Pan c 22
����. Guerre contre les barbares. Nazar. Pan. c. 18.
Euseb. vit. Const. l. 1, c. 25. Médailles. [Eckhel, doct. num. vet. t. ����, p 94]
Le repos de Constantin était pour les barbares d'au-delà du Rhin le signal de la guerre. Dès qu'ils le voient occupé de ces ouvrages, ils reprennent les armes, d'abord séparément; ensuite, ils forment une ligue redoutable et réunissent leurs troupes. C'étaient les Bructères, les Chamaves, les Chérusques, les Vangions, les Allemans, les Tubantes. Ces peuples occupaient la plus grande partie des pays compris entre le Rhin, l'Océan, le Véser et les sources du Danube. L'empereur toujours préparé à la guerre dans le sein même de la paix, marche contre eux dès la première alarme; et fait, en cette occasion, ce qu'il avait vu pratiquer à Galérius dans la guerre contre les Perses. Il se déguise, et s'étant approché du camp ennemi avec deux de ses officiers, il s'entretient avec les barbares et leur fait accroire que Constantin est absent. Aussitôt il rejoint son armée, fond sur eux lorsqu'ils ne s'y attendaient pas, en fait un grand carnage, et les oblige de regagner leurs retraites. Peut-être fut-ce pour cette victoire qu'on commença cette année à lui donner sur ses monnaies le titre de Maximus, que la postérité lui a conservé. Rappelé dans la Grande-Bretagne par quelques mouvements des Pictes et des Calédoniens, il y rétablit la tranquillité.
Tandis que Dieu récompensait, par ces heureux succès, les vertus morales de Constantin, il punissait les fureurs de Galérius, qui avait le
�����. Nouvelles exactions de
Galérius.
premier allumé les feux de la persécution, et qui la continuait avec la même violence. Ce prince après l'élection de Licinius s'était retiré à Sardique. Honteux d'avoir fui devant un ennemi qu'il se croyait en droit de mépriser, plein de rage et de vengeance, il songeait à rentrer en Italie, et à rassembler toutes ses forces pour écraser Maxence. Un autre dessein occupait encore sa vanité. La vingtième année depuis qu'il avait été fait César, devait expirer au 1er mars 312. Les princes se piquaient de magnificence dans cette solennité, qu'on appelait les Vicennales; et l'altier Galérius, qui se mettait fort au-dessus des trois autres Augustes, se préparait de loin à donner à cette cérémonie toute la splendeur qu'il croyait convenir au chef de tant de souverains. Pour remplir ces deux objets, il avait besoin de lever des sommes immenses, et de faire de prodigieux amas de blé, de vin, d'étoffes de toute espèce, qu'on distribuait au peuple avec profusion dans les spectacles de ces fêtes. Sa dureté naturelle et la patience de ses sujets était pour lui une ressource qu'il croyait inépuisable. Un nouvel essaim d'exacteurs se répandit dans ses états; ils ravissaient sans pitié ce qu'on avait sauvé des vexations précédentes: on pillait les maisons; on dépouillait les habitants; on saisissait toutes les récoltes, toutes les vendanges; on enlevait jusqu'à l'espérance de la récolte prochaine, en ne laissant pas aux laboureurs de quoi ensemencer leurs campagnes; on voulait même exiger d'eux à force de tourments ce que la terre ne leur avait pas donné: ces malheureux pour fournir aux largesses du prince, mouraient de faim et de misère. Tout retentissait de plaintes, lorsque les cris affreux de Galérius arrêtèrent tout-à-coup les violences de ses officiers, et les gémissements de ses sujets. Il était tourmenté d'une cruelle maladie: c'était un ulcère au périnée, qui résistait à tous les remèdes, à toutes les opérations. Deux fois les médecins vinrent à bout de fermer la plaie; deux fois la cicatrice s'étant rompue, il perdit tant de sang qu'il fut prêt d'expirer. On avait beau couper les chairs, ce mal incurable gagnait de proche en proche; et après avoir dévoré
Lact., de mort. pers. c. 31.
��� Sa maladie
Lact , de mort pers c 33
Euseb Hist eccl l 8, c 16
toutes les parties externes, il pénétra dans les entrailles et y engendra des vers, qui sortaient comme d'une source intarissable. Son lit semblait être l'échafaud d'un criminel: ses cris effroyables, l'odeur infecte qu'il exhalait, la vue de ce cadavre vivant, tout inspirait l'horreur. Il avait perdu la figure humaine: toute la masse de son corps venant à se corrompre et à se dissoudre, la partie supérieure restait décharnée, ce n'était qu'un squelette pâle et desséché; l'inférieure était enflée comme une outre; on n'y distinguait plus la forme des jambes ni des pieds. Il y avait un an entier qu'il était en proie à ces horribles tourments: n'espérant plus rien de ses médecins, il eut recours à ses dieux; il implora l'assistance d'Apollon et d'Esculape; et comme les victimes se trouvaient aussi impuissantes que les remèdes employés jusqu'alors, il se fit amener par force tout ce qu'il y avait de médecins renommés dans son empire, et se vengeant sur eux de l'excès de ses douleurs, il faisait égorger les uns, parce que ne pouvant supporter l'infection ils n'osaient approcher de son lit, les autres, parce qu'après bien des soins et des peines ils ne lui procuraient aucun soulagement. Un de ces infortunés qu'il allait faire massacrer, devenu hardi par le désespoir: «Prince, s'écria-t-il, vous vous abusez, si vous espérez que les hommes guérissent une plaie dont Dieu vous a frappé lui-même: cette maladie ne vient pas d'une cause humaine; elle n'est point sujette aux lois de notre art; souvenez-vous des maux que vous avez faits aux serviteurs de Dieu, et de la guerre que vous avez déclarée à une religion divine, et vous sentirez à qui vous devez demander des remèdes. Je puis bien mourir avec mes semblables, mais aucun de mes semblables ne pourra vous guérir.»
Anony Vales
Vict epit p 221
Zos l 2, c 11
Rufin l 8, c 18
Oros l 7, c 28
A� 311.
Ces paroles pénétrèrent le cœur de Galérius, mais sans le changer. Au lieu de se condamner luimême, de confesser le Dieu qu'il avait persécuté dans ses serviteurs, et de désarmer sa colère en se soumettant à sa justice, il le regarda comme un ennemi puissant et cruel avec qui il
fallait composer Dans les nouveaux accès de ses douleurs, il s'écriait qu'il était prêt à rebâtir les églises, et à satisfaire le Dieu des chrétiens. Enfin, plongé dans les noires vapeurs d'un affreux repentir, il fait assembler autour de son lit les grands de sa cour; il leur ordonne de faire sans délai cesser la persécution, et dicte en même temps un édit dont Lactance nous a conservé l'original: en voici la traduction.
�� Édit de Galérius en faveur des chrétiens.
Lact de mort pers. c. 33 et 34. Euseb. Hist. ecc. l. 8, c. 17.
«Entre les autres dispositions dont nous sommes sans cesse occupés pour l'intérêt de l'état, nous nous étions proposé de réformer tous les abus contraires aux lois et à la discipline romaine, et de ramener à la raison les chrétiens qui ont abandonné les usages de leurs pères. Nous étions affligés de les voir comme de concert tellement emportés par leur caprice et leur folie, qu'au lieu de suivre les pratiques anciennes, établies peut-être par leurs ancêtres mêmes, ils se faisaient des lois à leur fantaisie, et séduisaient les peuples en formant des assemblées en différents lieux. Pour remédier à ces désordres nous leur ordonnâmes de revenir aux anciennes institutions: plusieurs ont obéi par crainte; plusieurs aussi, ayant refusé d'obéir, ont été punis. Enfin, comme nous avons reconnu que la plupart, persévérant dans leur opiniâtreté, ne rendent pas aux dieux le culte qui leur est dû, et n'adorent plus même le dieu des chrétiens, par un mouvement de notre très-grande clémence, et selon notre coutume constante de donner à tous les hommes des marques de notre douceur, nous avons bien voulu étendre jusque sur eux les effets de notre indulgence, et leur permettre de reprendre les exercices du christianisme, et de tenir leurs assemblées, à condition qu'il ne s'y passera rien qui soit contraire à la discipline. Nous prescrirons aux magistrats, par une autre lettre, la conduite qu'ils doivent tenir. En reconnaissance de cette indulgence que nous avons pour les chrétiens, il sera de leur devoir de prier leur Dieu pour notre conservation, pour le salut de l'état, et pour le leur, afin que l'empire soit de toute part en sûreté, et qu'ils puissent euxmêmes vivre sans péril et sans crainte.»
Cet édit bizarre et contradictoire, plus capable d'irriter Dieu que de l'apaiser, fut publié dans l'empire, et affiché le dernier d'avril de l'an 311 à Nicomédie, où la persécution s'était ouverte, huit ans auparavant, par la destruction de la grande église. Quinze jours après on y apprit la mort de ce prince. Il avait enfin expiré à Sardique après un supplice d'un an et demi, ayant été César treize ans et deux mois, Auguste six ans et quelques jours. Licinius reçut ses derniers soupirs, et Galérius, en mourant, lui recommanda sa femme Valéria et Candidianus, son fils naturel, dont nous raconterons dans la suite les tristes aventures. Il fut enterré en Dacie, où il était né, dans un lieu qu'il avait nommé Romulianus, du nom de sa mère Romula. Par une vanité pareille à celle d'Alexandre-le-Grand, il se vantait d'avoir eu pour père un serpent monstrueux. On ignore le nom de sa première femme, dont il eut une fille qu'il donna en mariage à Maxence. Malgré ses débauches il avait respecté Valéria, et lui avait fait l'honneur de donner son nom à une partie de la Pannonie. Il avait auparavant procuré à cette province une grande étendue de terres labourables, en faisant abattre de vastes forêts, et dessécher un lac nommé Pelso dont il avait fait écouler les eaux dans le Danube. Maxence, qui se plaisait à peupler le ciel de nouvelles divinités, en fit un dieu, quoiqu'ils eussent été mortels ennemis; et ce ne fut qu'après la mort de Galérius qu'il se ressouvint que ce prince était son beau-père, titre qu'il lui donna alors avec celui de Divus sur ses propres monnaies.
Je ne dois pas dissimuler que plusieurs auteurs païens ont parlé assez avantageusement de Galérius: ils lui donnent de la justice et même de bonnes mœurs. Mais outre que ce sont des abréviateurs qui n'entrent dans aucun détail, et qu'il faut croire sur leur parole, le zèle de ce prince pour la religion que ces auteurs professaient, peut
��� Mort de Galérius
Lact de mort pers c 33
Euseb Hist eccl l 8, c 17
Hist Misc l 11, apud Murat t 1, p 71 Vict epit p 222 [Eckhel, doct num vet t ����, p. 38].
���� Différence de sentiment au sujet de Galérius. Eutrop. l. 10.
bien, dans leur esprit, lui avoir tenu lieu de mérite
Peut-être aussi les auteurs chrétiens, par un motif contraire, ont-ils un peu exagéré ses vices. Mais il n'est pas croyable que des hommes célèbres, tels que Lactance et Eusèbe, qui écrivaient sous les yeux des contemporains de Galérius, et qui développent toute sa conduite, aient voulu s'exposer à être démentis par tant de témoins sur des faits récents et publics. Or, à juger de ce prince non pas par les qualités qu'ils lui donnent, mais par les actions qu'ils en racontent, parmi une foule de vices on ne lui trouve guère d'autre vertu que la valeur guerrière.
Il était, quand il mourut, consul pour la huitième fois. Les fastes sont fort peu d'accord sur les consulats de cette année: les uns donnent pour collègue à Galérius, Maximin pour la seconde fois; d'autres Licinius; et il est constant que celui-ci avait été consul avant l'année suivante: quelques-uns nomment Galérius seul consul. Maxence laissa Rome et l'Italie sans consuls jusqu'au mois de septembre, qu'il nomma Rufinus et Eusébius Volusianus.
Aurel. Vict. de Cæs. p. 169 et 170. Vict. epit. p. 222.
�����. Consulats de cette année.
Lact. de mort. pers. c. 35.
Till note 28 sur Constantin.
A la première nouvelle de la mort de Galérius, Maximin, qui avait pris d'avance ses mesures, accourt en diligence pour prévenir Licinius et se saisir de l'Asie jusqu'à la Propontide et au détroit de Chalcédoine. Il signale son arrivée en Bithynie par le soulagement des peuples, en faisant cesser toutes les rigueurs des exactions. Cette générosité politique lui gagna tous les cœurs, et lui fit bientôt trouver plus de soldats qu'il n'en voulut. Licinius approche de son côté; déja les armées bordaient les deux rivages; mais au lieu d'en venir aux mains, les empereurs s'abouchent dans le détroit même, se jurent une amitié sincère, et conviennent, par un traité, que toute l'Asie restera à Maximin, et que le détroit servira de borne aux deux empires.
���� Partage de Maximin et de Licinius
Lact de mort pers c 36
Après une conclusion si favorable, il ne tenait qu'à Maximin de vivre heureux et tranquille. Ce prince, sorti, ainsi que Galérius et Licinius, des forêts de l'Illyrie, n'avait pourtant pas l'esprit aussi grossier. Il aimait les lettres, il honorait les savants et les philosophes: peut-être ne lui avait-il manqué qu'une bonne éducation et de meilleurs modèles, pour adoucir l'humeur barbare qu'il tirait de sa naissance. Mais enivré du pouvoir suprême, pour lequel il n'était pas né, emporté par l'exemple des autres princes, enfin devenu féroce par l'habitude de verser le sang des chrétiens, il n'épargna plus ses provinces; il accabla les peuples d'impositions, il se livra sans réserve à tous les désordres. Il ne se levait guère de table sans être ivre, et le vin le rendait furieux. Ayant observé qu'il avait alors plusieurs fois donné des ordres dont il se repentait ensuite, il commanda que ce qu'il ordonnerait après son repas, ne fût exécuté que le lendemain: précaution honteuse, qui prouvait l'intempérance dont elle prévenait les effets. Dans ses voyages il portait partout la corruption et la débauche, et sa cour fidèle à l'imiter flétrissait tout sur son passage. Avec ses fourriers courait devant lui une troupe d'eunuques et de ministres de ses plaisirs, pour préparer de quoi le satisfaire. Plusieurs femmes, trop chastes pour se prêter à ses désirs, furent noyées par ses ordres: plusieurs maris se donnèrent la mort. Il abandonnait à ses esclaves des filles de condition, après les avoir déshonorées: celles du commun étaient la proie du premier ravisseur; il donnait lui-même par brevet, et comme une récompense, celles dont la noblesse était distinguée; et malheur au père qui, après la concession de l'empereur, aurait refusé sa fille au dernier de ses gardes, qui presque tous étaient des Barbares et des Goths chassés de leur pays.
L'édit de Galérius en faveur des chrétiens avait été publié dans les états de Constantin et de Licinius; et il devait l'être dans tout l'empire. Mais Maximin, à qui il ne pouvait manquer de déplaire, le supprima, et prit grand soin d'empêcher qu'il ne
��� Débauches de Maximin
Vict epit p 222
Lact de mort pers c 38
Euseb Hist eccl l 8, c 14
����. Maximin fait cesser la persécution.
Euseb Hist eccl l 9, c 1
devînt public dans ses états. Cependant, comme il n'osait contredire ouvertement ses collègues, il ordonna de vive voix à Sabinus son préfet du prétoire de faire cesser la persécution. Celui-ci écrivit à tous les gouverneurs des provinces une lettre circulaire; il leur mandait que, l'intention des empereurs n'ayant jamais été de faire périr des hommes pour cause de religion, mais seulement de les ramener à l'uniformité du culte établi de tout temps, et l'opiniâtreté des chrétiens étant invincible, ils eussent à cesser toute contrainte, et à n'inquiéter personne qui fît profession du christianisme.
Maximin fut mieux obéi qu'il ne désirait. On mit en liberté ceux qui étaient détenus en prison ou condamnés aux mines pour avoir confessé le nom de Jésus-Christ. Les églises se repeuplaient, l'office divin s'y célébrait sans trouble: c'était une nouvelle aurore dont les païens même étaient frappés et réjouis; ils s'écriaient que le Dieu des chrétiens était le seul grand, le seul véritable. Ceux d'entre les fidèles qui avaient courageusement combattu pendant la persécution, étaient honorés comme des athlètes couronnés de gloire; ceux qui avaient succombé, se relevaient et embrassaient avec joie une austère pénitence. On voyait les rues des villes et les chemins des campagnes remplis d'une foule de confesseurs qui, couverts de glorieuses cicatrices, retournaient, comme en triomphe, dans leur patrie, chantant à la louange de Dieu des cantiques de victoire. Tous les peuples applaudissaient à leur délivrance, et leurs bourreaux mêmes les félicitaient.
����� Délivrance des chrétiens
������ Artifices contre les chrétiens
L'empereur, dont les ordres avaient procuré cette joie universelle, était le seul qui ne la goûtait pas; elle faisait son supplice; il ne put l'endurer plus de six mois. Afin de la troubler, il saisit un prétexte pour défendre les assemblées auprès de la sépulture des martyrs. Ensuite il se fit envoyer des députés par les magistrats des villes, pour lui demander avec instance la permission de chasser les chrétiens et de détruire leurs églises. Dans ces pratiques
Eus Hist eccl l 9, c 2 et 3
Lact de mort pers c 36
secrètes il s'aida des artifices d'un certain Théotecnus magistrat d'Antioche. C'était un homme qui joignait à un esprit violent une malice consommée. Ennemi juré des chrétiens, il les avait attaqués par toutes sortes de moyens, décriés par les calomnies les plus atroces, poursuivis dans leurs retraites les plus cachées, et il en avait fait périr un grand nombre. Maximin était adonné aux affreux mystères de la magie; il ne faisait rien sans consulter les devins et les oracles: aussi donnait-il de grandes dignités et des priviléges considérables aux magiciens. Théotecnus, pour autoriser par un ordre du ciel une nouvelle persécution, consacra, avec de grandes cérémonies, une statue de Jupiter Philius, titre sous lequel ce dieu était depuis long-temps adoré à Antioche; et après un ridicule appareil d'impostures magiques et de superstitions exécrables, il fit parler l'oracle, et lui fit prononcer contre les chrétiens une sentence de bannissement hors de la ville et du territoire.
A ce signal, tous les magistrats des autres villes répondirent par un semblable arrêt, et les gouverneurs, pour faire leur cour, les y excitaient sous main. Alors l'empereur, feignant de vouloir satisfaire aux instances des députés, fit graver sur des tables d'airain un rescrit dans lequel, après avoir félicité ses peuples en termes magnifiques de leur zèle pour le culte des dieux, et de l'horreur qu'ils manifestaient contre une race impie et criminelle, il attribuait aux chrétiens tous les maux qui dans les temps passés avaient affligé la terre, et à la protection des dieux de l'empire tous les biens dont on jouissait alors, la paix, l'heureuse température de l'air, la fertilité des campagnes: il permettait aux villes, conformément à leur requête, et leur ordonnait même de bannir tous ceux qui resteraient obstinés dans l'erreur: il leur offrait de récompenser leur piété en leur accordant sur-le-champ telle grace qu'elles voudraient demander. Il n'en fallait pas tant pour renouveler les fureurs de la persécution. On vit aussitôt rallumer tous les feux, lâcher sur les chrétiens toutes les bêtes féroces. Jamais il n'y avait eu plus de martyrs, ni
���� Édit de Maximin
Euseb Hist eccl l 9, c 7
��� La persécution recommence.
Euseb Hist eccl l 9, c 4 et 6
Lact de mort pers c 36
Vales in Euseb p 169
plus de bourreaux. Maximin choisit en chaque ville, entre les principaux habitants, des prêtres d'un ordre supérieur, qu'il chargea de faire tous les jours des sacrifices à tous leurs dieux, d'empêcher que les chrétiens ne fissent, ni en public ni en particulier, aucun acte de leur religion, de se saisir de leurs personnes, et de les forcer à sacrifier ou de les mettre entre les mains des juges. Pour veiller à l'exécution de ces ordres, il établit dans chaque province un pontife suprême, tiré des magistrats déja éprouvés dans les fonctions publiques; ou plutôt, comme l'institution en était ancienne, il augmenta la puissance de ces pontifes, en leur donnant une compagnie de gardes, et des priviléges très-honorables: ils étaient au-dessus de tous les magistrats; ils avaient droit d'entrer dans le conseil des juges, et de prendre séance avec eux.
Comme la superstition s'allie avec tous les crimes, Maximin, étant passionné pour les sacrifices, ne passait point de jour sans en offrir dans son palais, et pour y fournir on enlevait les troupeaux dans les campagnes. Ses courtisans et ses officiers n'étaient nourris que de la chair des victimes. Il avait même imaginé de ne faire servir sur sa table que des viandes d'animaux égorgés au pied des autels et déja offerts aux dieux, pour souiller tous ses convives par la participation à son idolâtrie.
���� Passion de Maximin pour les sacrifices.
Lact de mort pers. c. 57.
Tous ceux qui aspiraient à la faveur, s'efforçaient à l'envi de nuire aux chrétiens: c'était à qui inventerait contre eux de nouvelles calomnies. On forgea de faux actes de Pilate, remplis de blasphèmes contre Jésus-Christ, et par ordre de Maximin on les répandit par toutes les provinces; on enjoignit aux maîtres d'école de les mettre entre les mains des enfants, et de les leur faire apprendre par cœur: on suborna des femmes perdues, pour venir déposer devant les juges qu'elles étaient
����� Calomnies contre les chrétiens
[Euseb Hist eccl l 9, c 7]
chrétiennes, et pour s'avouer complices des plus horribles abominations, pratiquées, disaient-elles, par les chrétiens dans leurs temples. Ces dépositions, insérées dans les actes publics, étaient aussitôt envoyées par tout l'empire.
Le théâtre le plus ordinaire des cruautés de Maximin était Césarée de Palestine. Mais partout où il allait, son passage était tracé par le sang des martyrs. A Nicomédie il fit mourir, entre autres, Lucien, célèbre prêtre de l'église d'Antioche: à Alexandrie, où il paraît qu'il alla plusieurs fois, il fit trancher la tête à Pierre, évêque de cette ville, à un grand nombre d'évêques d'Égypte, et à une multitude de fidèles. Il ôta la vie à plusieurs femmes chrétiennes, à qui il n'avait pu ôter l'honneur. Eusèbe en remarque entre les autres une qu'il ne nomme pas; c'est, selon Baronius, celle que l'église honore sous le nom de sainte Catherine, quoique Rufin la nomme Dorothée. Elle était distinguée par sa beauté, sa naissance, ses richesses, et plus encore par sa science; ce qui n'était pas sans exemple entre les femmes d'Alexandrie. Le tyran, épris d'amour, avait inutilement tenté de la séduire. Comme elle se montrait prête à mourir, mais non pas à le satisfaire, il ne put se résoudre à la livrer au supplice; il se contenta de confisquer ses biens et de la bannir d'Alexandrie; et ce trait fut regardé dans le tyran comme un effort de clémence, que l'amour seul pouvait produire. Enfin, las de carnage et de massacres, par un autre effet de cette même clémence qui lui était particulière, il ordonna qu'on ne ferait plus mourir les chrétiens, mais qu'on se contenterait de les mutiler. Ainsi, on arrachait les yeux aux confesseurs, on leur coupait les mains, les pieds, le nez et les oreilles; on leur brûlait, avec un fer rouge, l'œil droit et les nerfs du jarret gauche, et on les envoyait en cet état travailler aux mines.
������. Divers martyrs.
Euseb. Hist. eccl. l. 9, c. 6, et l. 8, c. 14.
Lact. de mort. pers. c. 36.
Euseb. Mart. Pal. c. 8.
[Euseb. hist. eccl. l. 8, c. 14. Rufin. l. 8. c. 17].
La vengeance divine ne tarda pas à éclater. Maximin, dans son édit contre les chrétiens, faisait honneur à ses dieux de la paix, de la
����� Famine et peste en Orient
Euseb Hist eccl l 9 c 8 santé, de l'abondance qui rendaient les peuples heureux sous son règne. Les commissaires chargés de porter cet édit dans toutes les provinces, n'avaient pas encore achevé leur voyage, que le Dieu jaloux, pour démentir ce prince impie, envoya tout à la fois la famine, la peste et la guerre. Le ciel ayant refusé pendant l'hiver ces pluies qui fertilisent la terre, les fruits et les moissons manquèrent, et la famine fut bientôt suivie de la peste. Aux symptômes ordinaires de cette maladie s'en joignit un nouveau: c'était un ulcère enflammé, qu'on appelle charbon, qui, se répandant par tout le corps, s'attachait surtout aux yeux, et qui fit perdre la vue à un nombre infini de personnes de tout âge et de tout sexe, comme pour les punir par le même supplice qu'on avait fait endurer à tant de confesseurs. Ces deux calamités réunies dépeuplaient les villes, désolaient les campagnes: le boisseau de blé se vendait plus de deux cents francs de notre monnaie: on rencontrait à chaque pas des femmes recommandables par leur naissance, qui, réduites à mendier, n'avaient d'autres marques de leur ancienne fortune, que la honte de leur misère. On vit des pères et des mères traîner dans les campagnes leur famille, pour y manger comme les bêtes le foin et les herbes même malfaisantes et qui leur donnaient la mort: on en vit d'autres vendre leurs enfants pour la misérable nourriture d'une journée. Dans les rues, dans les places publiques, chancelaient et tombaient les uns sur les autres des fantômes secs et décharnés, qui n'avaient de force que pour demander, en expirant, un morceau de pain. La peste faisait en même temps d'horribles ravages; mais il semblait qu'elle s'attachait surtout aux maisons que l'opulence sauvait de la famine. La mort, armée de ces deux fléaux, courut en peu de temps tous les états de Maximin; elle abattit des familles entières; et rien n'était si commun, dit un témoin oculaire, que de voir sortir à la fois d'une seule maison deux ou trois convois funèbres: on n'entendait dans toutes les villes qu'un affreux concert de gémissements, de cris lugubres, et d'instruments alors employés dans les funérailles. La pitié se lassa bientôt: la multitude des indigents, l'habitude de voir des mourants, l'attente prochaine d'une mort semblable avait endurci tous les cœurs; on laissait au milieu
des rues les cadavres étendus sans sépulture, et servant de pâture aux chiens. Les chrétiens seuls, que ces maux vengeaient, montrèrent de l'humanité pour leurs persécuteurs: eux seuls bravaient la faim et la contagion, pour nourrir les misérables, pour soulager les mourants, pour ensevelir les morts. Cette charité généreuse étonnait et attendrissait les infidèles; ils ne pouvaient s'empêcher de louer le Dieu des chrétiens, et de convenir qu'il savait inspirer à ses adorateurs la plus belle qualité, qu'ils pussent euxmêmes attribuer à leurs dieux, celle de bienfaiteurs des hommes.
A tant de désastres, Maximin ajouta le seul qui manquait encore pour achever de perdre ses sujets. Il entreprit contre les Arméniens une guerre insensée. Ces peuples, depuis plusieurs siècles, amis et alliés des Romains, avaient embrassé le christianisme, dont ils pratiquaient tranquillement les exercices.
����. Guerre contre les Arméniens.
[Cette guerre, dont le souvenir nous a été conservé par le seul Eusèbe, et qui fut entreprise à cause de l'attachement que les Arméniens avaient pour la religion chrétienne, n'a pas été assez remarquée par les savants modernes, qui se sont occupés des antiquités ecclésiastiques. Elle nous révèle un fait d'une grande importance resté inconnu jusqu'à présent. Elle nous montre qu'en l'an 311, c'est-à-dire avant que Constantin se fût déclaré chrétien, la doctrine de l'Évangile était professée publiquement dans un grand royaume, voisin de l'empire, ce qui donne lieu de penser que la religion chrétienne y était déja établie depuis quelque temps. Cette simple indication, donnée par Eusèbe, suffit pour faire voir que les Arméniens sont réellement la première nation qui ait adopté la foi chrétienne. Ce fait aussi curieux que remarquable, est resté inconnu aux Arméniens eux-mêmes; mais il est pleinement démontré par la série de leurs rois, comparée à la succession de leurs patriarches. Cette portion de la chronologie arménienne est environnée de difficultés; c'est là ce qui a empêché de reconnaître cette vérité. Quoi qu'il en soit, on peut regarder comme constant que le christianisme devint, vers l'an 276, la religion du roi, des princes, et des peuples de l'Arménie. Le roi Tiridate, issu du sang des Arsacides, fut alors
[Hist. eccl. l. 9, c. 8.]
[11] Tous ces résultats qui seraient susceptibles de plus grands développements, ont déja été indiqués dans le premier volume (pag 405, 406, 412 et 436) de mes Mémoires historiques et géographiques sur l'Arménie, publiés en 1818 S -M
Juvenal, sat 15 converti avec tous ses sujets, par saint Grégoire, surnommé l'illuminateur, ainsi que lui de la race des Arsacides, mais descendu d'une branche collatérale, de la portion de cette famille, qui avait long-temps régné sur la Perse. Dix-sept ans avant cette époque et, à ce qu'il paraît, au temps de la malheureuse expédition de Valérien contre Sapor, Tiridate avait été rétabli par les Romains sur le trône de ses aïeux, dont il avait été dépouillé dans sa tendre enfance, vingt-sept ans auparavant, vers l'an 233, par le roi de Perse Ardeschir, fils de Babek, fondateur de la dynastie des Sassanides. Ce souverain, appelé ordinairement Artaxerxès, ayant détruit l'empire des Arsacides en Perse, en l'an 226, fut obligé de soutenir une guerre longue et opiniâtre, contre le prince de la même race, qui possédait l'Arménie et se nommait Chosroès. Après des succès balancés par des revers, un assassinat délivra le roi de Perse de son antagoniste, l'Arménie fut sa conquête, et le jeune Tiridate, fils de Chosroès, fut porté chez les Romains, où il trouva un asile, des instituteurs, et enfin des vengeurs[11] . Le même prince occupait encore le trône, et il y avait plus de cinquante ans qu'il régnait quand Maximin entreprit son expédition contre les Arméniens en haine du christianisme].—S.-M.
Le tyran se mit à la tête de ses troupes pour aller les forcer dans leurs montagnes, et relever les idoles qu'ils avaient abattues. Les historiens ne nous ont point instruits du détail de cette expédition: ils nous apprennent seulement, que l'empereur et l'armée, après avoir beaucoup souffert, n'en rapportèrent que la honte et le repentir. Si l'on excepte ces querelles sanglantes qu'une ridicule superstition avait quelquefois excitées en Égypte entre deux villes voisines, c'est ici la première guerre de religion dont parle l'histoire[12] . J'ai rassemblé tout ce que nous savons de Maximin pour cette année et la suivante, afin de n'être pas obligé d'interrompre ce qui reste de l'histoire de Maxence jusqu'à sa mort.
[12] Cette observation empruntée au savant Tillemont (Hist. des Emp., t. ��, p. 145, édition de 1723), n'est pas exacte. Il ne serait pas difficile de trouver dans l'histoire ancienne d'autres guerres qui eurent la religion pour motif Je me contenterai de rappeler, à ce sujet, les guerres des rois de Syrie contre les Macchabées et les Juifs S -M
Ce prince, en montant sur le trône, avait trouvé grand nombre de chrétiens à Rome et en Italie. Comme il savait qu'ils étaient portés d'affection pour Constantin, qui imitait à leur égard la douceur de son père, pour se les attacher il fit cesser la persécution, leur fit rendre leurs églises, et feignit même pendant quelque temps de professer leur religion. Le christianisme reprenait haleine en Italie; et pour suffire au baptême et à la nourriture spirituelle des fidèles, qui se multipliaient tous les jours, le pape Marcel avait augmenté jusqu'à vingtcinq le nombre des titres de la ville de Rome: c'étaient des départements pour autant de prêtres et comme autant de paroisses. Il avait engagé deux femmes pieuses et riches, nommées Priscilla et Lucine, l'une à bâtir un cimetière sur la voie Salaria, l'autre à laisser par testament à l'église l'héritage de tous ses biens. Ces donations ne furent pas heureuses. Maxence, jaloux de la pieuse adresse de ce saint pape, leva le masque, se déclara ennemi des chrétiens, voulut contraindre Marcel à sacrifier aux idoles; et sur son refus, il le fit enfermer dans une de ses écuries pour y panser les chevaux. Marcel y mourut de misère après cinq ans, d'autres disent deux ans de pontificat, dont la plus grande partie s'était passée, comme celui de presque tous ses prédécesseurs, ou dans l'attente continuelle de la mort, ou dans les souffrances. Eusèbe, Grec de naissance qui lui succéda, ne resta sur le saint siége que quelques mois, et fut remplacé par Miltiade, dont j'aurai occasion de parler dans la suite.
Tandis que Maxence faisait aux chrétiens en Italie une guerre, où il ne courait aucun risque, il en terminait en Afrique une autre, qui aurait été
�����. État du christianisme en Italie
Euseb Hist eccl l 8, c 14
Anastas Vit Marcel p 11
Platina, in Marcel Sigon de Imp Occ p 43 et seq Baron Ann ������. Guerre contre