Adobe Dreamweaver CC Classroom in a Book (2019 Release) 1st Edition Jim Maivald
Visit to download the full and correct content document: https://textbookfull.com/product/adobe-dreamweaver-cc-classroom-in-a-book-2019-re lease-1st-edition-jim-maivald/
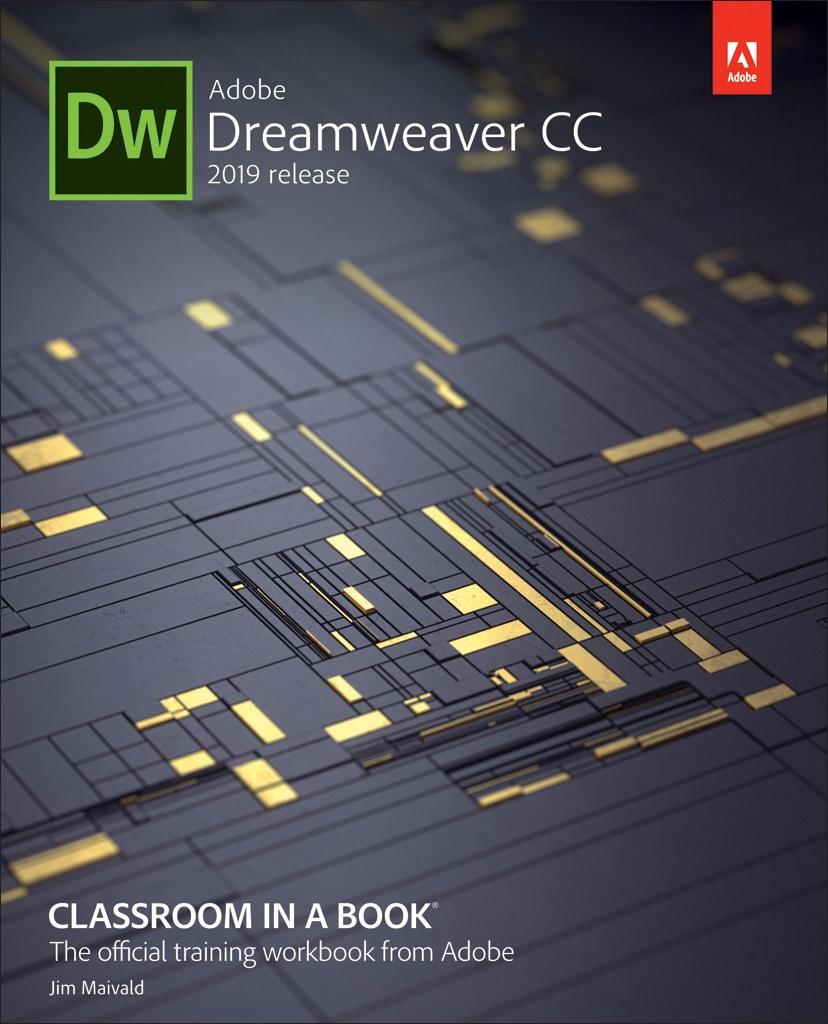
More products digital (pdf, epub, mobi) instant download maybe you interests ...
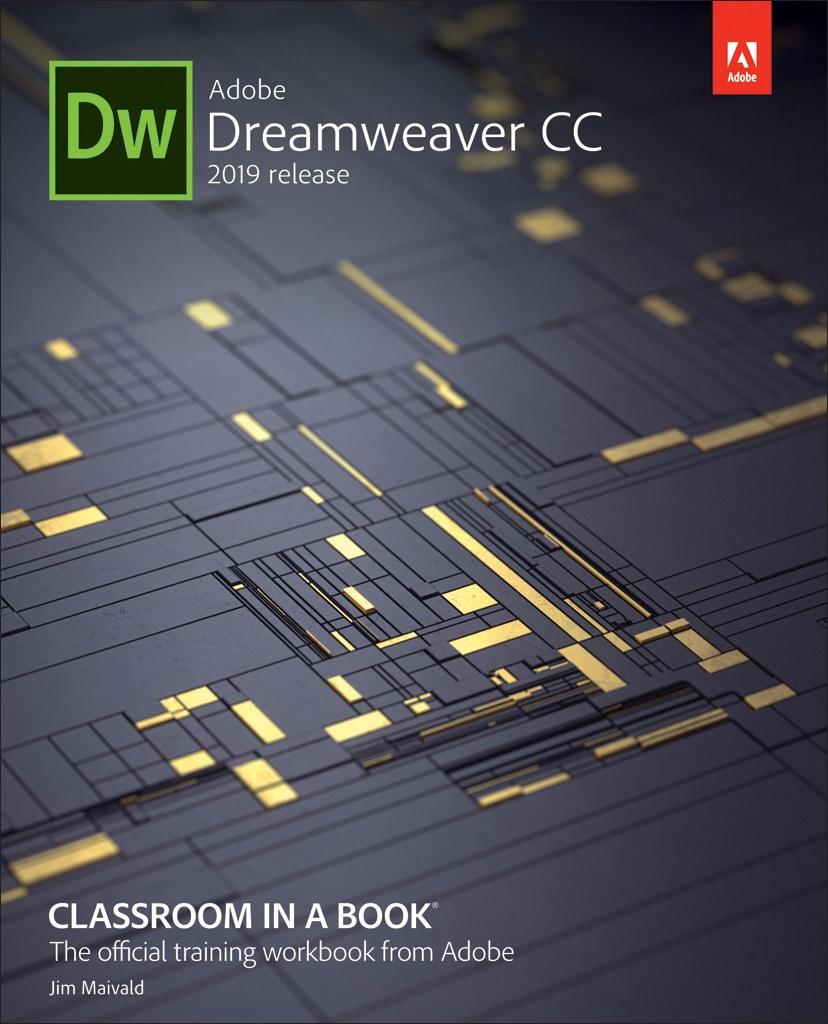
Adobe Dreamweaver CC Classroom in a Book (2019 Release)
1st Edition Jim Maivald
https://textbookfull.com/product/adobe-dreamweaver-cc-classroomin-a-book-2019-release-1st-edition-jim-maivald/
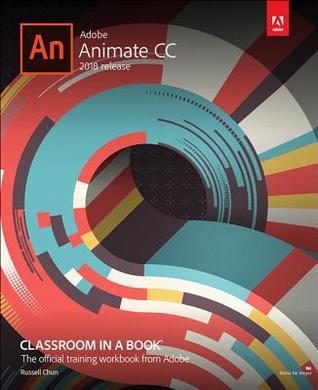
Adobe Animate CC Classroom in a Book (2018 Release)
Russell Chun
https://textbookfull.com/product/adobe-animate-cc-classroom-in-abook-2018-release-russell-chun/
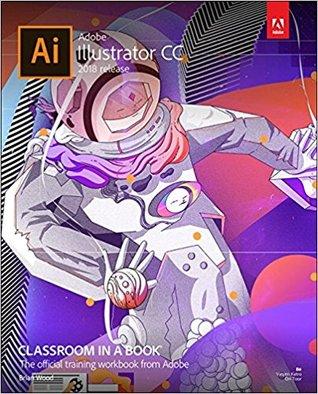
Adobe Illustrator CC Classroom in a Book 2018 Release
Edition Brian Wood
https://textbookfull.com/product/adobe-illustrator-cc-classroomin-a-book-2018-release-edition-brian-wood/
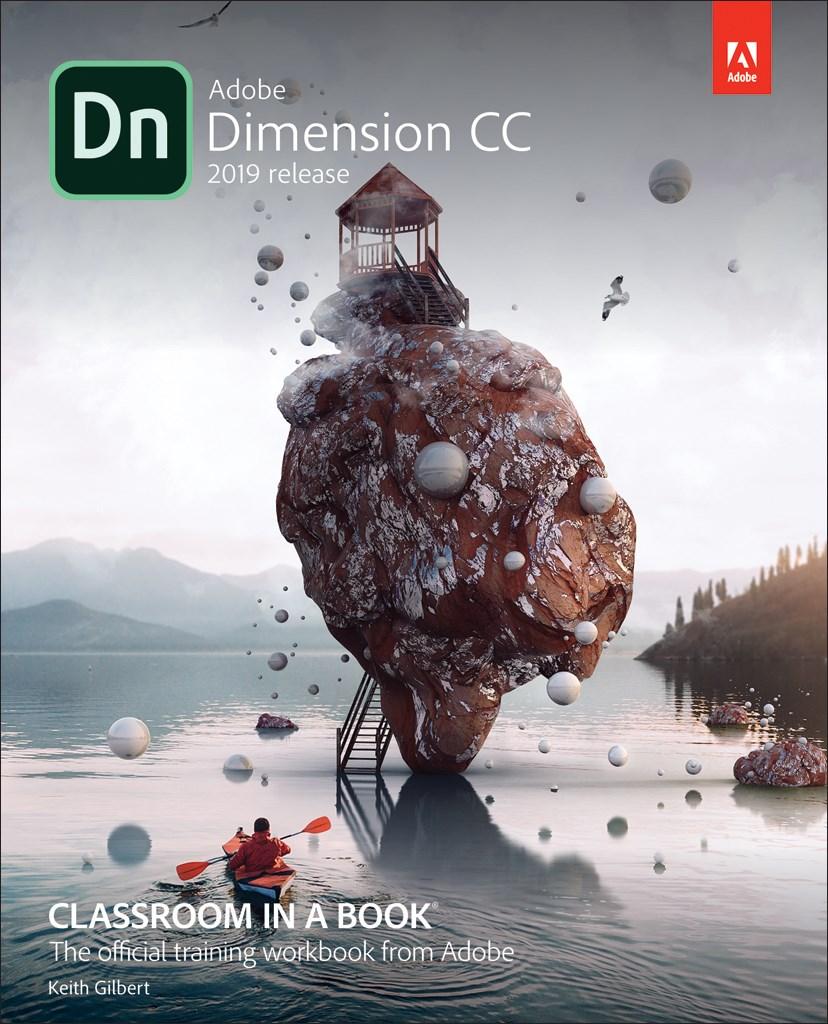
Adobe Dimension CC Classroom in a Book 2019 Release
1st Edition Keith Gilbert
https://textbookfull.com/product/adobe-dimension-cc-classroom-ina-book-2019-release-1st-edition-keith-gilbert/
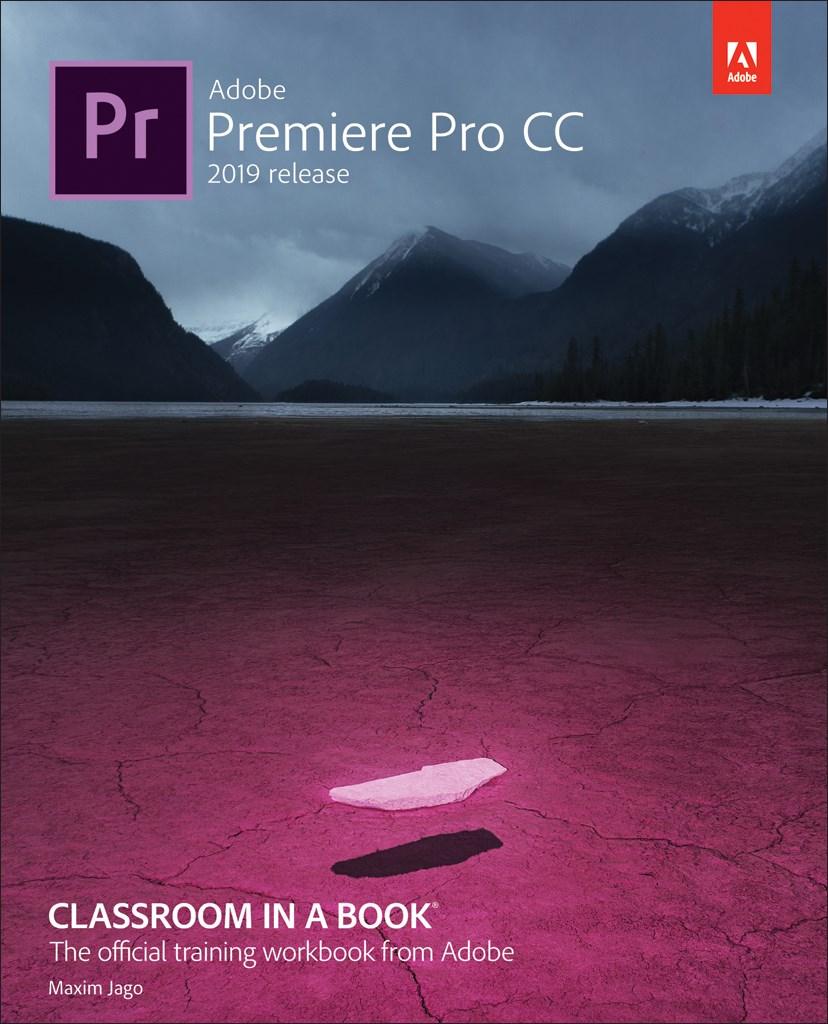
Adobe Premiere Pro CC Classroom in a Book 2019 Release 1st Edition Maxim Jago
https://textbookfull.com/product/adobe-premiere-pro-cc-classroomin-a-book-2019-release-1st-edition-maxim-jago/
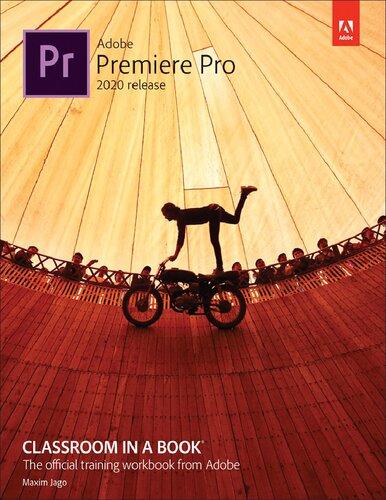
Adobe Premiere Pro CC Classroom In A Book 2020 Release 2020th Edition Maxim Jago
https://textbookfull.com/product/adobe-premiere-pro-cc-classroomin-a-book-2020-release-2020th-edition-maxim-jago/
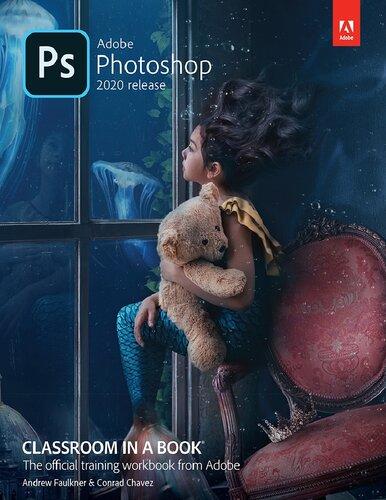
Adobe Photoshop CC Classroom In A Book 2020th Edition
Adobe Press https://textbookfull.com/product/adobe-photoshop-cc-classroom-ina-book-2020th-edition-adobe-press/

Adobe Muse CC Classroom in a Book Brian Wood
https://textbookfull.com/product/adobe-muse-cc-classroom-in-abook-brian-wood/
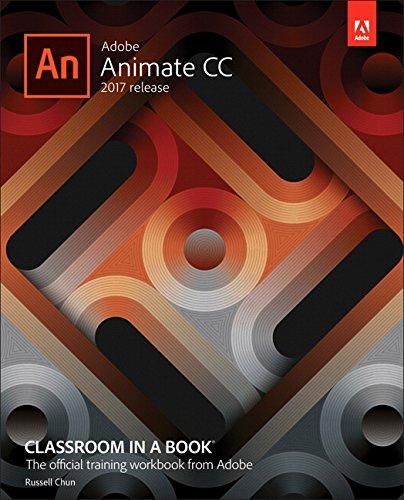
Adobe Animate CC Classroom in a Book 1st Edition
Russell Chun
https://textbookfull.com/product/adobe-animate-cc-classroom-in-abook-1st-edition-russell-chun/
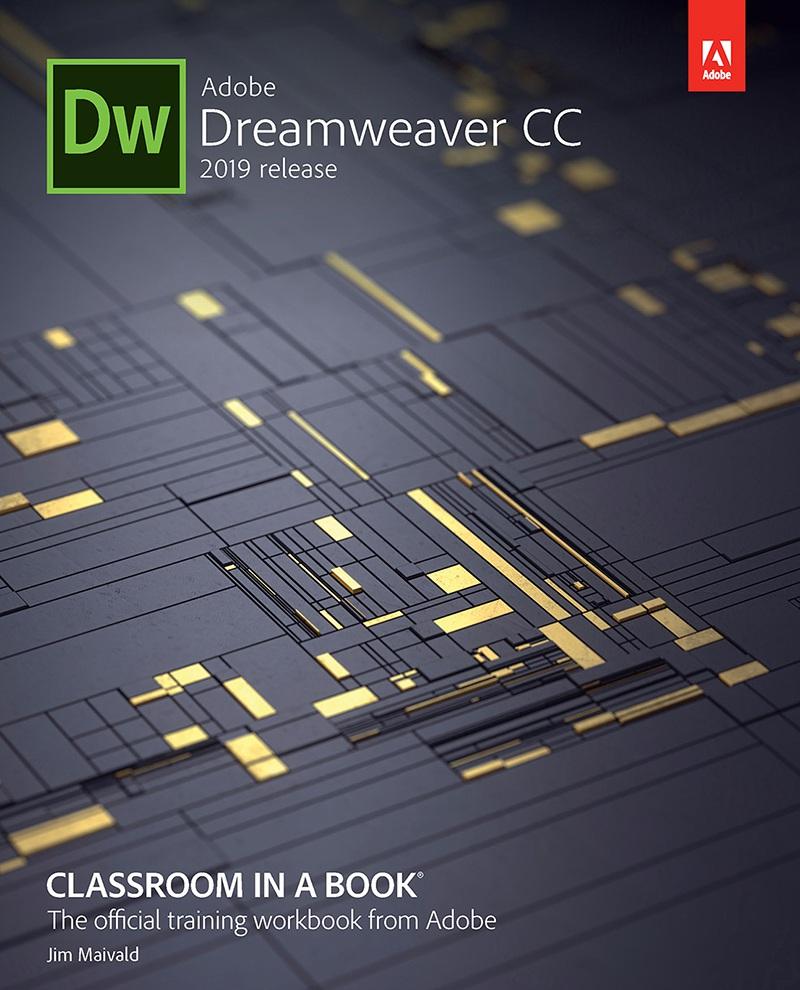
Contents
Cover Page
Title Page
Copyright Page
Where are the Lesson Files?
Contents
Getting Started
About Classroom in a Book
TinyURLs
Prerequisites
Conventions used in this book
Windows vs. macOS instructions
Installing the program
Updating Dreamweaver to the latest version
Online content
Recommended lesson order
Bonus material
On first launch
Choosing the program color theme
Setting up the workspace
Defining a Dreamweaver site
Checking for updates
Additional resources
1 Customizing Your Workspace
Touring the workspace
Using the Start Screen
Exploring New Feature guides
Setting interface preferences
Switching and splitting views
Selecting a workspace layout
Working with panels
Personalizing Dreamweaver
Working with Extract
Working with toolbars
Creating custom keyboard shortcuts
Using the Property inspector
Using the Related Files interface
Using tag selectors
Using the CSS Designer
Using the Visual Media Query (VMQ) interface
Using the DOM Viewer
Using element dialogs, displays, and inspectors
Setting up version control in Dreamweaver
Exploring, experimenting, and learning
Review questions
Review answers
2 HTML Basics
What is HTML?
Where did HTML begin?
Frequently used HTML elements
What’s new in HTML5
Review questions
Review answers
2 HTML Basics Bonus
Lesson overview
Writing your own HTML code
3 CSS Basics
What is CSS?
HTML vs. CSS formatting
HTML defaults
CSS box model
Applying CSS styling
Multiples, classes, and ids, oh my!
Review questions
Review answers
3 CSS Basics Bonus
Lesson overview
Previewing the completed file
Formatting text
Formatting objects
4 Web Design Basics
Developing a new website
Scenario
Working with thumbnails and wireframes
Review questions
Review answers
4 Creating Web Assets Using Photoshop Generator Bonus
Lesson overview
5 Creating a Page Layout
Evaluating page design options
Working with predefined layouts
Styling an existing layout
Styling elements using the Extract panel
Extracting text from a Photoshop mockup
Troubleshooting CSS styling
Extracting text styling from a Photoshop mockup
Creating a gradient background using Extract
Extracting image assets from a mockup
Adding CSS background effects in code
Finishing up the layout
Review questions
Review answers
6 Working with Templates
Creating a template from an existing layout
Inserting editable regions
Inserting HTML entities
Inserting metadata
Validating HTML code
Producing child pages
Moving CSS styles to a linked file
Updating a template
Review questions
Review answers
7 Working with Text, Lists, and Tables
Previewing the completed file
Creating and styling text
Creating lists
Creating and styling tables
Spell-checking webpages
Finding and replacing text
Optional self-paced exercise
Review questions
Review answers
8 Working with Images
Web image basics
Previewing the completed files
Inserting an image
Controlling image positions with CSS classes
Working with the Insert panel
Using the Insert menu
Inserting non-web file types
Working with Photoshop Smart Objects (optional)
Copying and pasting images from Photoshop (optional)
Inserting images by drag and drop
Optimizing images with the Property inspector
Review questions
Review answers
9 Working with Navigation
Hyperlink basics
Previewing the completed file
Creating internal hyperlinks
Creating an external link
Setting up email links
Creating an image-based link
Targeting page elements
Locking an element on the screen
Styling a navigation menu
Checking your page
Adding destination links (optional)
Review questions
Review answers
10 Adding Interactivity
Learning about Dreamweaver behaviors
Previewing the completed file
Working with Dreamweaver behaviors
Working with jQuery accordion widgets
Inserting a jQuery accordion widget
Styling a jQuery accordion
Review questions
Review answers
11 Publishing to the Web
Defining a remote site
Cloaking folders and files
Wrapping things up
Putting your site online (optional)
Synchronizing local and remote sites
Review questions
Review answers
12 Working with Code
Creating HTML code
Working with multicursor support
Commenting your code
Working with CSS preprocessors
Selecting code
Collapsing code
Expanding code
Accessing Split Code view
Previewing assets in Code view
Review questions
Review answers
13 Designing for Mobile Devices
Responsive design
Media type properties
Media queries
Media query syntax
Working with the Visual Media Queries interface
Introducing web frameworks
Identifying the Bootstrap structure
Creating a Bootstrap layout
Review questions
Review answers
Appendix: Tiny URLs
Index
14 Working with a Web Framework
Lesson overview
Creating a responsive site template
Creating a responsive template
Transferring content to a responsive template
Managing components in Bootstrap
Creating a responsive template
Optional exercise: Adding metadata placeholders
Applying a new template to existing pages
Review questions
Review answers
15 Adapting Content to Responsive Design
Lesson overview
Updating responsive design
Adapting content to responsive design
Adapting tables to a Bootstrap layout
Adapting images to smaller screens
Hiding components on a responsive layout
Trouble-shooting an interactive element
Previewing pages using Real-Time Preview
Fixing issues for mobile design and desktop
Review questions
Review answers
16 Working with Web Animation and Video Bonus
Lesson overview
Understanding web animation and video
Previewing the completed file
Adding web animation to a page
Adding web video to a page
Don’t host your own videos
Review questions
Review answers
B2-3
B2-4
B2-5
B2-6
B2-7
B2-8
B2-9
B2-10
B2-11
B2-12
B2-13
B2-14
B2-15
B2-16
B2-17
B2-18
B3-2
B3-3
B3-4
B3-5
B3-6
B3-7
B3-8
B3-9
B3-10
B3-11
B3-12
B3-13
B3-14
B3-15
B3-16
B3-17
B3-18
B3-19
B3-20
B3-21
B3-22
B3-23
B3-24
B3-25
B3-26
B3-27
B3-28
B3-29
B3-30
B3-31
B3-32
B3-33
B3-34
B3-35
B3-36
B3-37
B3-38
B3-39
B3-40
B3-41
B3-42
B3-43
B3-44
B3-45
B3-46
B3-47
B3-48
B3-49
B3-50
B3-51
B3-52
B3-53
B4-7
B4-8
B4-9
452
B14-2
B14-3
B14-4
B14-5
B14-6
B14-7
B14-8
B14-9
B14-10
B14-11
B14-12
B14-13
B14-14
B14-15
B14-16
B14-17
B14-18
B14-19
B14-20
B14-21
B14-22
B14-23
B14-24
B14-25
B14-26
B14-27
B14-28
B14-29
B14-30
B14-31
B14-32
B14-33
B14-34
B14-35
B14-36
B14-37
B14-38
B14-39
B14-40
B14-41
B14-42
B14-43
B14-44
B14-45
B14-46
B14-47
B14-48
B14-49
B14-50
B14-51
B14-52
B14-53
B14-54
B14-55
B14-56
B14-57
B14-58
B14-59
B14-60
B15-2
B15-3
B15-4
B15-5
B15-6
B15-7
B15-8
B15-9
B15-10
B15-11
B15-12
B15-13
B15-14
B15-15
B15-16
B15-17
B15-18
B15-19
B15-20
B15-21
B15-22
B15-23
B15-24
B15-25
B15-26
B15-27
B15-28
B15-29
B15-30
B15-31
B15-32
B15-33
B15-34
B15-35
B15-36
B15-37
B15-38
B15-39
B15-40
B15-41
B15-42
B15-43
B15-44
B15-45
B15-46
B15-47
B15-48
B15-49
B15-50
B15-51
B15-52
B15-53
B15-54
B15-55
B15-56
B15-57
B15-58
B15-59
B15-60
B15-61
B15-62
B15-63
B15-64
B16-2
B16-3
B16-4
B16-5
B16-6
B16-7
B16-8
B16-9
B16-10
B16-11
B16-12
B16-13
B16-14
B16-15
B16-16
B16-17
B16-18
B16-19
B16-20
B16-21
B16-22
B16-23
B16-24
Another random document with no related content on Scribd:
[122] Pour le sens de cette expression, voir Rom. II, 16 ; XVI, 25 ; Tim. II, 8 ; II Cor. IV, 3 ; I Cor. XV, 1 ; Gal. I, 11 ; II, 2
A Damas, porta-t-il, de synagogue en synagogue, ces hardiesses ? Les Actes n’en disent rien. Sa prédication paraît avoir surtout causé une surprise énorme : « Comment ! Celui qui dévastait la secte nazaréenne, il soutient à présent que Jésus, c’est le Messie ! »
On l’écouta d’abord par curiosité. Mais le fanatisme israélite se mit sur ses gardes. Saul fut jugé, comme il avait jugé les disciples du Christ, un renégat. Son cas s’aggravait d’une sorte de trahison officielle. Quoi donc ! Le sanhédrin l’avait chargé de poursuivre les hérétiques dangereux, et il se faisait le héraut de leur apostasie ! C’était absurde et scandaleux !
Les docteurs de la ville l’attaquèrent furieusement ; il leur tint tête. L’obstacle excitait son énergie, comme la pierre, sur le passage du torrent, le fait rebondir plus haut qu’elle. Il confondit leurs objections. Exaspérés, ils préparèrent contre lui des violences. Il ne brava point ce péril de mort. Au bout de quelques jours, il partit.
Lui-même a rappelé[123] qu’il prit le chemin du désert : « Je m’en allai en Arabie. » Trois mots pour une période de trois ans, c’est peu.
[123] Gal. I, 17.
Qu’alla-t-il faire en Arabie ?
On a supposé qu’il se recueillit, comme Moïse, dans la solitude. Saul, au pied du Sinaï, méditant sur l’ancienne et la nouvelle Alliance, ce thème serait beau pour une amplification romanesque. Il a parlé quelque part du Sinaï, mais dans un sens purement allégorique :
« Le Sinaï est une montagne d’Arabie correspondant à la Jérusalem actuelle qui est esclave avec ses fils[124] … » Nul indice ne confirme qu’il ait séjourné dans ces régions. Assurément, il utilisa, pour des heures contemplatives, le silence des espaces sans routes et sans maisons. Mais le désert, pas plus que la mer, ne
pouvait l’arrêter longtemps. A cet égard, comme à bien d’autres, il tourne le dos aux prophètes d’avant le Christ. Les images qui, d’elles-mêmes, s’insèrent dans son éloquence sont des métaphores de citadin, d’homme sociable qui prend plaisir à voir des maçons tailler des pierres, des cohortes en armes défiler, même des athlètes courir dans le stade, d’un homme qui sait la valeur de l’épargne et des échanges commerciaux.
[124] Id. IV, 24.
Le Christ l’avait élu pour qu’il portât son nom devant les peuples. Selon toute vraisemblance, à Pétra, ou parmi les montagnards du Hauran, il essaya d’implanter l’Évangile. Les colonies juives étaient d’ailleurs nombreuses en un pays qui servait de passage aux plus lointaines caravanes, aux tapis de la Perse et aux perles de l’Inde. S’il n’a jamais évoqué cette mission, c’est qu’elle n’aboutit à aucun établissement durable ; de même il sous-entendra son voyage à Chypre, ayant remis à Barnabé tout le soin de l’Église qu’ils y fondèrent.
Avec sa confiance magnifique, il revint à Damas, comme il repassera par Lystres, Iconium, Antioche de Pisidie, après avoir été chassé de ces trois villes, et, à Lystres, lapidé.
A Damas, les chefs des synagogues avaient, comme on s’en doute, signalé sa défection au grand sanhédrin de Jérusalem, aux princes des prêtres. Ceux-ci n’avaient pu qu’ordonner de saisir le traître et de le ramener à leur tribunal où il recevrait le châtiment de sa forfaiture.
Mais Saul était alors loin de Damas ; et, quand il y rentra, Rome avait repris d’une main forte les rênes de l’Orient. Citoyen romain, il était protégé contre une arrestation arbitraire, même contre une expulsion. Les Juifs, pour se défaire de lui, complotèrent de l’assassiner. Il l’apprit, se cacha, se préparait à s’enfuir. Afin de rendre l’évasion impossible, les Juifs s’assurèrent la complicité de l’ethnarque, officier au service du roi arabe Arétas, à qui incombait la
police de la ville[125] . L’ethnarque fit garder par des soldats toutes les portes.
[125] L’histoire de la Syrie, dans ces années-là, est fort trouble. Il est très simple pourtant d’admettre la présence simultanée de l’autorité romaine et d’une police locale qu’exerçaient les indigènes. C’est ainsi que nous procédons encore en Syrie.
Les « disciples » ménagèrent à Saul un moyen aventureux de s’échapper. L’un d’eux habitait, dans un faubourg, une maison dont les fenêtres surplombaient le rempart. En pleine nuit, on descendit par là Saul caché au creux d’une corbeille d’osier ronde, une corbeille pour le pain ou le poisson.
Paul, plus tard, commémora cette fuite[126] en glorifiant le Seigneur de l’avoir dérobé au poignard de ses ennemis.
[126] II Cor XI, 32-33
Une témérité, qui semblerait excessive, si l’Esprit n’avait dirigé ses pas, le conduisit à Jérusalem ; là, d’autres embuscades le guettaient.
Son désir était grand de voir Pierre, le premier des Douze, et de « l’interroger[127] ». Il voulait connaître aussi Jacques, le parent du Seigneur, et Jean, ceux qui « passaient pour être des colonnes[128] ».
[127] Gal. I, 18.
[128] Id. II, 9.
Ce séjour dans la ville sainte allait être une des grandes épreuves du converti.
Les Juifs, au début, ne paraissent pas l’avoir inquiété. Trois ans après l’événement de Damas, la persécution juive était finie. Rome interdisait au sanhédrin toute violence tyrannique. Malgré son privilège de citoyen romain, Saul s’exposait pourtant à des représailles. Mais une humiliation acerbe l’attendait. Il tenta d’entrer
en rapports avec les disciples, de « se coller à eux[129] », dit naïvement le narrateur. Tous avaient peur de lui, « ne voulaient pas croire qu’il fût vraiment un disciple ». Le miracle de sa conversion s’était accompli au loin ; quand on en parlait, on secouait la tête. Le parti judaïsant devait savoir sa prétendue mission de mettre, dans l’Église, les gentils baptisés au rang des chrétiens nés Juifs. Il sema derrière lui de méchants soupçons. Rien ne pouvait être plus dur à Saul que de sentir niées sa loyauté et l’évidence du fait divin.
[129] Actes IX, 26
Les Douze le tenaient à l’écart, prudents comme il convient à des chefs. Mais Saul aborda Barnabé, homme d’un naturel entreprenant, généreux, semblable au sien. Ils fraternisèrent aussitôt. Barnabé crut au miracle, à l’inspiration de Saul ; il pénétra l’avenir d’un tel compagnon, et, mettant sa main dans la sienne, il l’introduisit auprès des Apôtres.
Prodigieuse rencontre de Paul et de Pierre, des héros qui allaient s’emparer du monde avec deux bâtons mis en croix !
Saul raconta comment le Seigneur s’était montré sur la route et lui avait parlé ; puis son entrée hardie dans les synagogues de Damas où, par sa voix, Jésus fut annoncé comme le Fils de Dieu.
Son récit émerveilla Pierre, Jacques et Jean. L’enthousiasme de Saul, sa puissance irradiante de conviction les transportèrent. En un moment il devint leur ami. Ils sortirent avec lui dans les rues de Jérusalem. Saul visita les lieux où s’étaient déroulées les souffrances du Christ. Il « interrogeait » sur lui ceux qui avaient mangé et bu en sa compagnie après sa Résurrection.
Il confrontait avec leurs principes d’apostolat les siens. Pierre, semble-t-il, n’avait pas encore eu la vision de Joppé ; il croyait, en bon Juif, devoir s’abstenir des aliments impurs ; il subissait les préventions nationales au sujet des idolâtres ; il avait quelque peine à n’établir aucune différence entre les chrétiens circoncis et les païens baptisés. Cependant il admettait que le don de la pénitence et de la justice appartient à tous.
Saul entreprit de lui faire un esprit plus large ; d’autre part, il reçut de l’Apôtre une connaissance plus riche des traditions évangéliques. Beaucoup de choses lui avaient été révélées par le Seigneur luimême[130] . Mais, sur la manière d’interpréter les dogmes, d’administrer les sacrements, ces entretiens ouvraient des questions multiples.
[130] I Cor. XI, 23 : « Pour moi, j’ai appris du Seigneur et je vous l’ai enseigné aussi que le Seigneur Jésus, la nuit qu’il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâces, le rompit en disant : « Ceci est mon corps livré pour vous… »
A Jérusalem, Saul se retrouva en face des gens qu’il avait connus avant sa conversion, et principalement, des Juifs hellénistes, ciliciens, syriens, cyrénéens. Il se mit à disputer contre eux ; il voulut leur démontrer que le Messie était venu, que tous les hommes étaient appelés au salut.
Ils s’irritèrent d’une doctrine outrageante pour la fierté juive. Saul devenait un péril public ; il fallait le mettre hors d’état de nuire. Comme à Damas, on résolut de l’exterminer.
Prévenu, Saul ne se résignait pas à la fuite. Malgré l’obstination imbécile de ses ennemis et les méfiances persistantes des judaïsants, il voulait travailler à la rédemption de ses frères. Mais une vision changea ses plans. Comme il priait dans le Temple, il eut une extase et il vit Jésus qui lui disait :
« Sors en hâte de Jérusalem, parce qu’ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. »
Saul, se défendant contre une injonction qui le déconcertait, opposa :
« Seigneur, ils savent que je menais en prison et que je violentais dans les synagogues ceux qui croyaient en toi. Et, quand on versait le sang d’Étienne, ton témoin, j’étais là, j’approuvais, et je gardais les vêtements de ceux qui le mettaient à mort. » (Donc, sous-entendaitil, mon témoignage aura pour eux plus de force qu’un autre.) Mais Jésus lui répéta :
« Pars ; je vais t’envoyer au loin chez les gentils [131] . »
[131] Actes XXII, 17-21
Cette vision, comme toutes celles que nous connaissons dans la vie de saint Paul, porte ce signe original d’être totalement involontaire. Il ne cherchait point les révélations. Elles se présentaient à l’improviste, quand il avait besoin d’être éclairé ou conforté ; et il n’en retenait que l’élément intellectuel. Il ne fut pas un visionnaire à la façon d’Ézéchiel ou de Jean ; on supposerait difficilement l’Apocalypse dictée par lui. Son génie est, en somme, peu créateur d’images apocalyptiques. Dans ses prévisions sur la fin des temps[132] , il renvoie à une catéchèse orale, se contentant d’allusions sommaires aux approches de la Parousie. Certes, il désira le retour du Christ dans sa gloire, comme l’espéraient tous les disciples, comme nous devons nous-mêmes l’espérer[133] . Venez, Seigneur, c’est toute l’attente des chrétiens[134] . Paul, quand il appliquait à Jésus, devant les Juifs, les textes des prophètes qui montrent le Messie, tantôt humilié, tantôt triomphant, leur exposa bien des fois l’argument dont les accablera Tertullien[135] : il faut concevoir deux Avents du Christ ; une première fois, il s’est manifesté sous la figure de la Victime. Mais il reparaîtra, selon sa parole, avec des légions d’Anges, dans la splendeur du feu et l’éclat des trompettes, sur la majesté des nuées.
[132] II Thessal II
[133] Voir sur ce point le catéchisme de Trente.
[134] Les deux mots araméens qu’on répétait dans les assemblées chrétiennes, Maran Atha, répondaient à cette attente, ils signifiaient : Venez, Seigneur ; ou : Je viendrai vite.
[135] Adversus Judaeos, ch XIV
En attendant, l’Apôtre possédait la Présence mystique, l’intimité de l’Esprit, et, parfois, il était ravi jusqu’au troisième ciel, là où il percevait « ces mots ineffables qu’il n’est pas licite à un mortel de
redire[136] ». Il entendait, aux tournants décisifs de sa route, la voix qui redresse et fortifie.
[136] II Cor. XII, 4.
Sa première vision, à Jérusalem, lui précisa l’objet de son avenir : à Pierre, le soin des églises juives d’origine ; à lui, la moins belle part, la plus humble, les incirconcis.
Et c’est pourquoi il écrira aux Galates qu’il a quitté Jérusalem « inconnu de visage aux églises de Judée qui sont dans le Christ. On y avait simplement entendu dire : Celui qui nous persécutait annonce aujourd’hui la foi qu’il dévastait. Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet[137] ».
[137] I, 22-24
Chose étonnante ! Les Apôtres lui avaient assurément communiqué les fameuses paraboles où Jésus signifiait la déchéance d’Israël : celle de la vigne louée à d’autres ouvriers, quand les vignerons ont tué le Fils du Maître envoyé vers eux ; celle de l’invité aux noces jeté, mains et pieds liés, dans les ténèbres extérieures, tandis que les gueux du chemin viennent prendre place dans la salle du banquet. Il connaissait les prophéties sur la destruction du Temple, sur la ruine de Jérusalem. Jamais, dans ses Épîtres, il n’évoquera ces traits populaires. S’il rappelle l’institution de l’Eucharistie, c’est qu’il en fut instruit par le Seigneur lui-même. Il négligera de répéter ce qui appartenait au domaine commun ; sa mission, il la circonscrira dans « son évangile », dans les vérités qu’il tenait d’une révélation directe, non, d’ailleurs, sans les soumettre au discernement de « ceux qui passaient pour des colonnes ».
Il avait séjourné à Jérusalem, auprès de Céphas, quinze jours seulement[138] . A son départ, des chrétiens l’escortèrent, de peur qu’il ne fût assailli en route, jusqu’à Césarée. Là, il s’embarqua pour la Syrie, et gagna Tarse, la ville de son enfance. Qu’y fera-t-il ? De nouveau, comme en Arabie, nous perdons la ligne exacte de ses
mouvements. Sa vie ressemble à ces fleuves qui, par intervalles, s’en vont sous terre, puis resurgissent. Mais, alors même qu’on ne peut la suivre, on devine, dans la profondeur, l’impulsion grondante du courant ; et, lorsqu’il se déploiera en pleine lumière, nous le reverrons plus ample, puissamment nourricier.
[138] Gal I, 18
