On ne cesse de le dénoncer : les dommages causés par les générations passées et actuelles compromettraient l’existence des générations futures. D’un côté, l’urgence climatique ; de l’autre, les effets à long terme des technologies, pollutions ou dégradations environnementales en tous genres, réclament en effet d’agir dès au présent pour ne pas obérer l’avenir. En clair, le concept de générations futures – et à travers lui l’idée d’en défendre les droits – offre pour certains un nouvel horizon plus soutenable à l’action publique. Cette temporalité inédite qui entre en tension avec l’étroitesse des mandats politiques peut elle être opérable ? Comment esquisser un futur souhaitable sans peser trop fortement sur les seules générations présentes, ni remettre à demain l’ampleur des changements à initier aujourd’hui ?
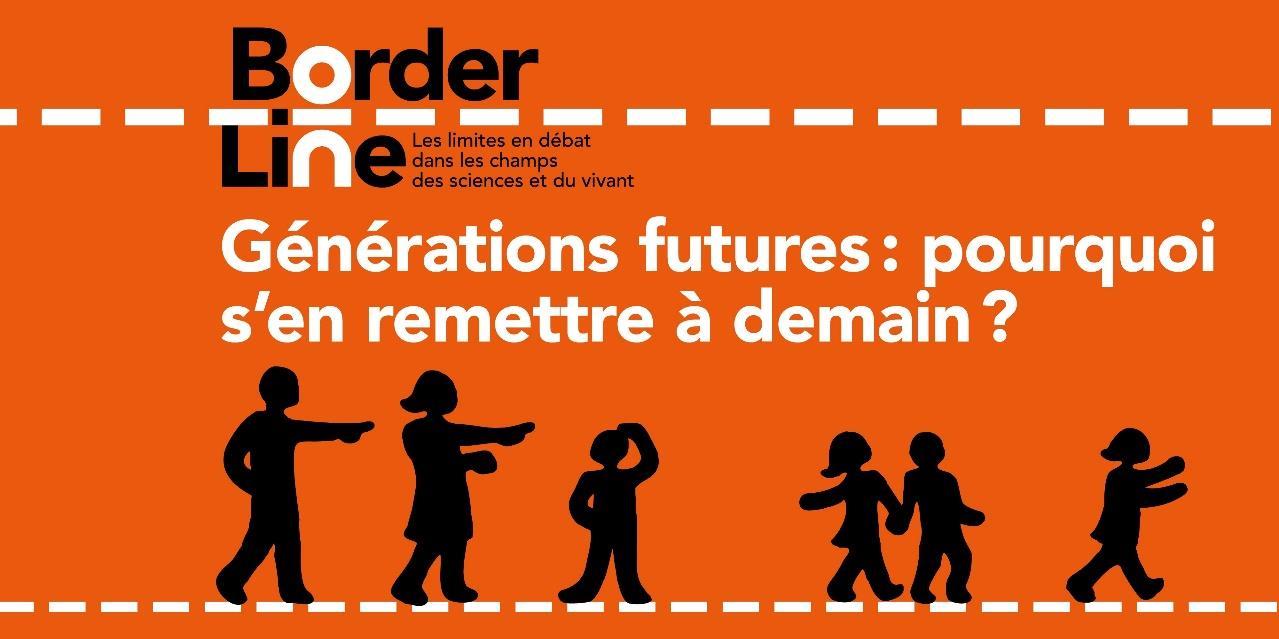
Rencontre-débat organisée par la Mission Agrobiosciences-INRAE et le Quai des Savoirs
Jeudi 03 novembre 2022, de 18h00 à 20h00
Dans le cadre du festival « Lumières sur le Quai »
18h00/18H20 – [Générations futures] Parole de militant.e Par POUSSE, membre de Youth for Climate et d’Extinction Rebellion.
18H20/19H00 - [Générations futures] Agir au plus juste Dialogue entre Valérie DELDRÈVE, directrice de recherche en sociologie à INRAE et Emilie GAILLARD, maître de conférences HDR en droit à Sciences Po Rennes.
19H00/20h00 - Débat avec le public Réagissez : #BorderLineTalk
[PORTRAITS]
Valérie DELDRÈVE. Directrice de recherche en sociologie, Valérie Deldrève démarre sa carrière au Centre Lillois d’Etudes et de Recherches Sociologiques et Economiques (Clersé). Alors que la sociologie rurale est en plein boom, elle choisit un domaine totalement à contre courant et peu investi : la pêche. Editée en 1998, sa thèse « Marins de pêche artisanale en Manche orientale : étude des organisations professionnelles et des pratiques des pêcheurs du boulonnais et de l’Est Cotentin » sera le point de départ d’une réflexion, qui la conduira à faire de la justice environnementale son objet d’étude. C’est dans son habilitation à diriger des recherches éditée en 2006 aux éditions Peter Lang, « Pour une sociologie des inégalités environnementales », qu’elle pose véritablement ce que sont les inégalités environnementales et s’intéresse aux conditions de leur émergence. Ses terrains d’études ? Ils suivent le littoral français, du Touquet jusqu’aux Calanques, sans oublier la Réunion, et se penchent tout autant sur les effets des politiques de la pêche que les impacts des aires marines protégées. Aujourd’hui directrice adjointe INRAE de l’Unité « Environnement, territoires en transitions, infrastructure, société » au centre Nouvelle Aquitaine Bordeaux, Valérie

Deldrève a dirigé avec Jacqueline Candau le projet de recherche Effijie « L’EFFort environnemental comme Inégalité : Justice et Iniquité au nom de l’Environnement » qui portait sur la répartition de l’effort environnemental demandé par les politiques de l’eau et de la biodiversité en France métropolitaine et à La Réunion. Un projet dans lequel les deux chercheuses explorent la manière dont les politiques publiques génèrent des injustices ou des inégalités entre acteurs. Coordinatrice du réseau EJJE regroupant des chercheurs francophones en sciences sociales travaillant dans le champ de la justice environnementale, elle coordonne actuellement avec le concours de trois autres chercheurs, le projet JustBaux dédié aux enjeux de justice environnementale sur la trajectoire de la bauxite. Elle est l’auteure de nombreux articles scientifiques. Parmi ceux ci, citons notamment « La fabrique des inégalités en France. Approches sociologiques qualitatives » édité dans la revue de l’OCFC en 2020 et qui est accessible librement.
Émilie GAILLARD. Maître de conférences HDR en droit à Sciences Po Rennes, Emilie Gaillard est considérée comme la spécialiste du concept juridique de droit des générations futures en France. Après y avoir dédié sa thèse« Générations futures et droit privé. Vers un droit des générations futures » éditée en 2008, elle poursuit ses recherches sur ce thème axant celles-ci autour de deux pôles : la protection de l’intégrité de l’environnement et celle de l’intégrité humaine. Très active, elle multiplie les publications scientifiques par exemple sur les droits transgénérationnels ou la reconnaissance des crimes contre les générations futures et la nature, sans pour autant délaisser l’arène publique pour faire connaître ce concept. Aux côtés de personnalités telles que Olivier de Schutter ou Vandana Shiva, elle participe au comité d’organisation du tribunal citoyen international contre Monsanto. Organisé à la Haye les 15 et 16 octobre 2016, ce Tribunal avait pour mission « d’évaluer les faits reprochés [à Monsanto] et de juger les dommages causés par la multinationale ». Elle est également la co autrice de la Déclaration universelle des droits de l’humanité, élaborée à l’occasion de la COP 21 et entendue comme « le droit pour tous les habitants de la Terre à vivre dans un monde dont le futur n’est pas compromis par l’irresponsabilité du présent. » Rien d’étonnant donc à ce qu’elle crée en 2021 le master « Générations futures et transitions juridiques », qu’elle dirige, ou encore qu’elle prenne en charge la coordination générale de la chaire d’excellence CNRS Normandie pour la paix. Lancée en 2019, cette dernière a pour objectif de former les professionnels du droit pour qu’ils mobilisent le droit des générations futures. Egalement codirectrice du pôle Risques à la Maison de la Recherche en Sciences Humaines de Caen, elle enseigne le droit privé, le droit international de l’environnement et les droits de l’homme à Sciences Po Rennes et au campus de Caen.

POUSSE, c’est d’abord un pseudo. Comme un clin d’œil à la jeunesse de la personne qui le porte. Comme un écho au combat qui est le sien en faveur du climat et de l’environnement. Comme un leitmotiv enfin, celui de pousser les politiques à prendre bras le corps la question du climat.
Pousse est membre de l’antenne toulousaine de Youth for Climate, un mouvement indépendant, apolitique et transnational, « rassemblant les jeunes du monde entier qui agissent pour l’environnement et le futur ». Non violent, le mouvement se mobilise aux côtés d’autres collectifs sur des fronts aussi divers et vastes que les « grands projets inutiles en Occitanie » ou la COP 26 à Glasgow. Outre son engagement au sein de Youth for Climate, Pousse est également membre d’Extinction Rebellion, mouvement international de désobéissance civile en lutte contre l’effondrement écologique et le dérèglement climatique.

[DÉFINITIONS]
Droit des générations futures | En pleine émergence, cette branche du droit vise à intégrer dans les décisions politiques, économiques et technologiques une considération pour les intérêts des générations futures.
Justice environnementale | Alors que la justice écologique s’intéresse à la nature, la justice environnementale y adjoint les questions de justice sociale. Ce maillage entre social et écologique a émergé dans les années 1980, face au constat que les maux écologiques touchent plus durement certaines populations que d’autres.
Justice intergénérationnelle | Cette forme de justice propose des principes normatifs censés régir la distribution des avantages et des coûts entre différentes générations, sur des domaines aussi variés que l’environnement ou la dette.
1972 | Conférence de Stockholm.
Considérée comme le premier sommet de la Terre, elle « proclame le devoir solennel de l’Homme de protéger et d’améliorer l’environnement présent et futur ». Elle pose les fondements d’un droit à un environnement sain.
1979 | Principe de responsabilité.
Le philosophe Hans Jonas formule un « principe de responsabilité » des générations actuelles envers les générations futures, donnant corps à de nouveaux impératifs éthiques.
1987 | Développement durable.
Le 27 avril 1987, la commission Brundtland, du nom de sa présidente, remet son rapport au Secrétaire général des Nations Unies. Intitulé « Notre avenir à tous », ce document pose les fondements de la notion de développement durable et en donne cette définition : « le développement durable, c’est s’efforcer de répondre aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire les leurs ».
1992 | Sommet « Planète Terre » à Rio.
Lors de cette conférence, les pays membres des Nations Unies adoptent une déclaration qui fait progresser les droits et responsabilités des nations en matière d’environnement, en s’appuyant sur la notion de développement durable.
2016 | Déclaration Universelle des Droits de l’Humanité (DDHu),
C’est le « Premier texte à reconnaître des droits et des devoirs pour l’Humanité, vis à vis d’elle même, des générations futures, des autres espèces et de la nature ».
2021 | Envoyé.e spécial.e.
Dans son rapport « Notre programme commun », le secrétaire général de l’ONU António Guterres propose de nommer un.e « Envoyé(e) spécial(e) pour les générations futures dont le rôle serait de représenter les intérêts des femmes et hommes encore à naître au cours de ce siècle.
[POUR ALLER PLUS LOIN]
Générations futures : un droit d’avenir. Entretien avec Emilie Gaillard, Sesame 11, mai 2022. https://revue-sesameinrae.fr/generations futures un droit davenir/ AgroParisTech : bifurquer… Ou pas. Rémi Mer, juin 2022. https://revuesesameinrae.fr/agroparistech bifurquer ou pas/
Collapsologie : qui aura le dernier mot ? Laura Martin Meyer, avril 2020. https://revue-sesameinrae.fr/collapsologie dernier mot/
Collapsologie : comment faire face au déclin énergétique qui s’annonce ? Entretien avec Luc Semal, avril 2020. https://revue-sesameinrae.fr/collapsologie faire face au declin energetique/ Faut-il en finir avec le Développement Durable ? François de Ravignan, mars 2005. https://www.agrobiosciences.org/agricul ture-115/article/faut-il-en-finir-avec-ledeveloppement durable
Des articles à retrouver sur le blog de la revue Sesame et le site de la Mission Agrobiosciences-Inrae
PROPOS DE BORDERLINE ]
Explorer les champs de tension qui s’exercent aujourd’hui autour de l’idée des limites, qu’elles soient frontière géographique, borne des savoirs, seuil éthique ou finitude des ressources. C’est ce que propose BorderLine, un cycle de rencontres débats au titre volontairement provocateur, coproduit par la Mission Agrobiosciences-INRAE et le Quai des Savoirs. Des débats accessibles gratuitement à tous les publics, laissant une large part aux échanges et aux regards croisés, pour instruire collectivement les points de frictions et les voies possibles, sans partis pris ni évitements. Il donne lieu, à l’issue de chaque rencontre, à la réalisation d’un podcast disponible, via ce QR Code, sur toutes les plateformes d’écoute ou via ce lien : https://podcast.ausha.co/borderline
Déjà disponibles à l’écoute : Le chercheur-militant, un nouveau citoyen ? | En partie au nom de l’urgence climatique, la figure du « chercheur militant » ressurgit forement. Que dit ce phénomène de la place et du rôle des sciences ?
Humains et animaux sauvages : éviter les lieux communs ? | Bien des animaux sauvages se heurtent aux activités humaines, de l’agriculture aux loisirs, générant crispations et conflits. Entre présence humaine et faune sauvage, quel juste milieu possible ? Un podcast en deux épisodes.
[À VENIR]
Xénogreffes : l’humanité à corps perdu ?
Jeudi 15 décembre 2022, de 18h00 à 20h00, Muséum d’Histoire naturelle de Toulouse.
Vivre avec le cœur d’un porc génétiquement modifié. C’est désormais chose envisageable depuis qu’une équipe américaine de l’École de médecine du Maryland a réussi une opération de xénogreffe chez un patient, début janvier 2022, et décédé deux mois plus tard. Qualifiée de prouesse technologique, cette transplantation inter espèce suscite bien des espoirs, dans un contexte de pénurie d’organes mais également une foule d’interrogations, éthiques notamment, au regard des limites qu’elle abolit et des changements qu’elle conduit pour les corps.

La Mission Agrobiosciences-INRAE
Centre national de médiation et d’instruction des controverses, la Mission Agrobiosciences INRAE est chargée de repérer les signaux faibles et d’analyser les tensions qui traversent la société dans les domaines de l’agriculture, de l’alimentation, de l’environnement, des sciences et des techniques du vivant. Son outil privilégié : la mise en débat pluriacteurs.


https://www.agrobiosciences.org/ 24 Chemin de Borde Rouge, 31320 Auzeville Tolosane Téléphone : +33 (0)5 61 28 54 70 Mail : mission-agrobiosciences@inrae.fr
Le Quai des Savoirs Centre culturel de la métropole toulousaine consacré aux sciences, aux innovations, et à la création, le Quai des Savoirs invite à reprendre la main sur nos futurs par l’exploration des enjeux des recherches contemporaines et des différents récits prospectifs en cours.
https://www.quaidessavoirs.fr/ 39 Allées Jules Guesde, 31000 Toulouse
