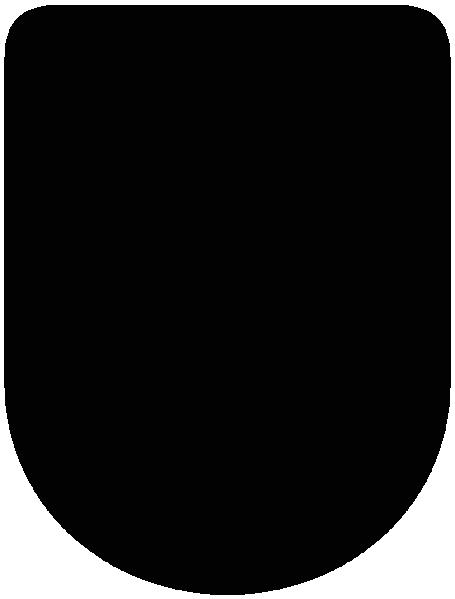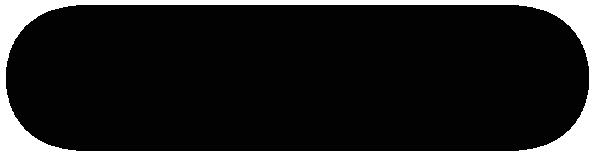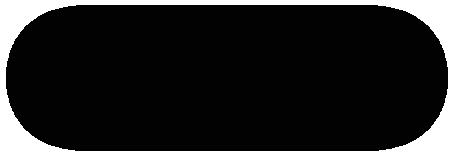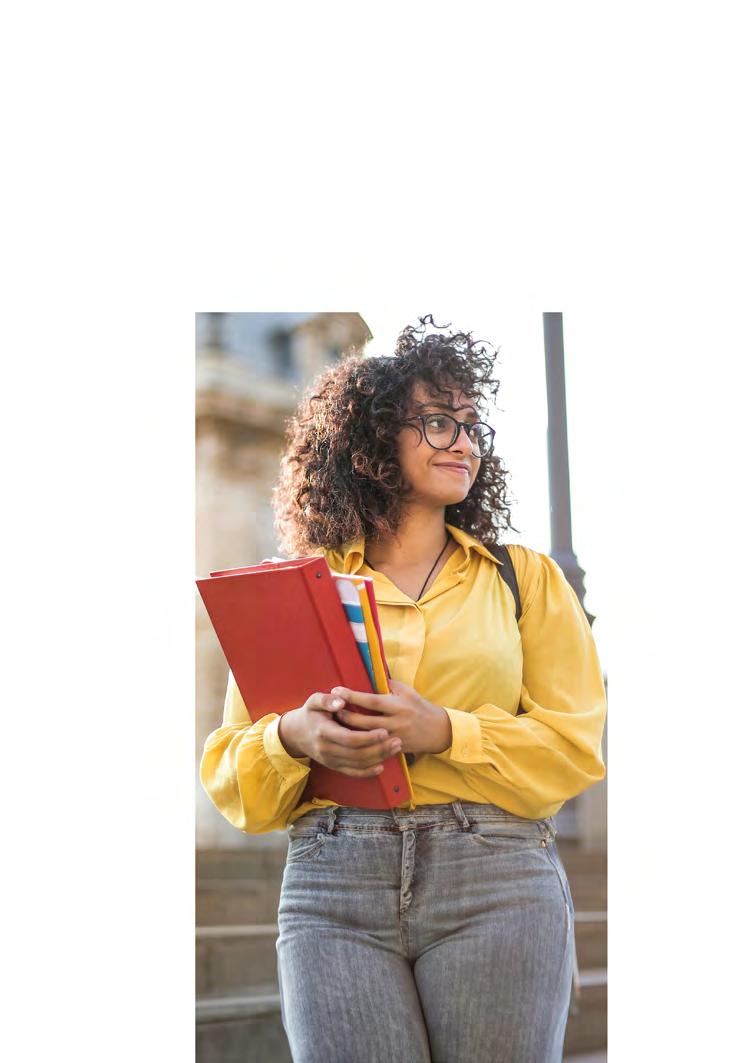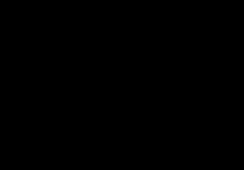Stage de la Toussaint
Travaillez et consolidez vos connaissances en questions contemporaines, histoire et en anglais grâce au livret, à la masterclass, aux cours, exercices, ateliers d’écriture, etc.
Stage de Noël
Stage de Février
En distanciel, en visioconférence.
En présentiel dans les villes des 7
Sciences Po du réseau ScPo : Aix-en-Provense, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse.
* Les stages de la Toussaint et de Noël se déroulent exclusivement en distanciel et sont réservés uniquement aux élèves de Terminale.
** Le stage de février est ouvert aux élèves de Première (en distanciel) ainsi qu'aux élèves de Terminale (en distanciel et en présentiel).
Retrouvez toutes les informations sur le site internet Tremplin IEP
Les places sont limitées, réservez la votre dès maintenant !
S’inscrire
Editorial
Si le parallèle souvent invoqué entre le monde contemporain et l’entre-deux-guerres doit nécessairement être nuancé, il n’en demeure pas moins que nous connaissons actuellement une période de brutalisation de la vie économique, sociale et politique, en échos au concept forgé par l’historien Georges Mosse à l’issue de la Première Guerre mondiale. Frédéric Charillon ne dit pas autre chose dans La géopolitique de l’intimidation dont la lecture est recommandée en fin de première partie.
Aux États-Unis, Donald Trump fait régner la loi du plus fort en annonçant une guerre commerciale ou en bafouant la séparation des pouvoirs. En Turquie, l’arrestation du maire d’Istanbul et figure de proue de l’opposition, Ekrem İmamoğlu, fait craindre un nouveau raidissement du pouvoir d’Erdogan. Pourtant, c’est une autre arrestation, celle de Rodrigo Duterte, ancien président des Philippines, suite à un mandat d’arrêt émis par la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes contre l’humanité, qui nourrit l’espoir en une justice internationale contre ce culte de la violence, alors que dans le même temps,
un accord de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan met un terme à près de quarante ans de tensions et de conflits.
En France, la sécurité est au cœur de ce numéro d’avril 2025. Un effort budgétaire massif en matière de défense devrait permettre de compenser plusieurs décennies de sousinvestissement. Cette priorité donnée au réarmement devrait profiter à l’industrie de la défense alors que la France se classe désormais au deuxième rang mondial des exportations d’armes, derrière les États-Unis.
Enfin, Horizon Défense revient d’abord sur l’espace baltique et sa remilitarisation du fait de la politique d’affirmation de puissance et d’intimidation stratégique de la Russie. La Direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS) est l’objet de la dernière contribution. Elle a en charge la mission de rénover et de rationaliser les fonctions « relations internationales » et « stratégie de défense » au sein du Ministère de la Défense.
UNE RÉALISATION LES TREMPLINS
Tremplin Le Mag est une revue d’actualité et de culture générale portant à la fois sur des enjeux militaires et des questions de société. A travers une approche synthétique, elle vise à permettre un suivi de l’actualité internationale et nationale, tout en ouvrant vers des articles parus dans la presse généraliste. Un troisième moment permet d’élargir la réflexion en abordant une actualité moins chaude.
VN PARTICIPATIONS
42 RUE DEYRIES
33800 BORDEAUX
TÉL : 05.33.49.01.80 contact@trempliniep.fr
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Thierry CORDE
COMITÉ DE RÉDACTION
Florent VANDEPITTE
AUTEURS
Arnaud LE GARS - M. Vincent BIENSTMAN - M. Cyril HUNAULT - M. Jonathan HIRIART
PHOTOS
Vue satellite. (Nasa) - Arc de triomphe. (Unplash) - Vue satellite. (Nasa) - Donald Trump présentant les droits de douane le 2 avril 2025. (Chip Somodevilla/ Getty images) - Miami Herald for Cartooning for peace - Des manifestants turcs dans les rues d’Istanbul au lendemain de l’arrestation du maire d’Istanbul, Ekrem Imamoglu, principal opposant au Président Recep Tayyip Erdogan. (Ed Jones/AFP) - Rodrigo Roa Duterte comparaissant pour la première fois devant les juges de la CPI le 14 mars 2025. (CPI) - Des Arméniens déposent des fleurs sur un mémorial du génocide à Erevan, le 28 février 2025 pour protester contre la détention de prisonniers politiques par l’Azerbaïdjan. (Anthony Pizzoferrato/AFP) - Mark Carney, le nouveau Premier ministre du Canada. (Dave Chan/AFP) - Un immeuble effondré dans la ville de Mandalay, dans le centre de la Birmanie, vendredi 28 mars. (AFP) - Couverture La guerre mondiale n'aura pas lieu, Frédéric Encel - Couverture Géopolitique de l'intimidation, Frédéric Charillon - Drapeaux français (Pxhere) - Emmanuel Macron lors de son allocution du 5 mars 2025(France tv info) - Les dirigeants européens lors du Sommet sur l'aide apportée à l'Ukraine (c news) - Un défilé de troupes russes à Moscou (les echos) - Yacht russe saisi par les douanes françaises (radio france) - L'usine de canons français Caesar (france bleu) - Des rafales en attente de livraison (radio france) - Pascal Praud, présentant une émission sur Cnews (gstatic) - Vincent Bolloré, le propriétaire du groupe Vivendi (les jours) - Gérald Darmanin et Bruno Retailleau à l'Assemblée Nationale (le parisien) - Le centre pénitencier d'Alençon-Condé-sur-Sarthe qui pourrait accueillir les plus importants narcotrafiquants français (france 3)- Buste (Unplash) - Carte l'espace baltique (Wikimedia)
Tous droits de reproduction, même partielle, par quelque procédé que ce soit, réservés pour tous pays.
TREMPLIN
LE MAG
Revue d’actualité et de culture générale
ACTUALITÉ INTERNATIONALE
ACTUALITÉ NATIONALE
HORIZON SCIENCES PO
- Pascale Molinier, Sandra Laugier et Patricia Paperman (dir.), Qu'est-ce que le care ? Souci des autres, sensibilité, responsabilité, 2021
- Françoise Benhamou, Nathalie Moureau, Le don dans l'économie, 2022.
1. États-Unis, guerre commerciale : « Liberation day » ou « ruination day » ?
2. États-Unis, quand les contre-pouvoirs vacillent.
3. Turquie, la colère de la rue
4. Justice internationale, Rodrigo Duterte détenu par la CPI
5. L’Arménie et l’Azerbaïdjan concluent un accord de paix
6. Mark Carney, un technocrate à la tête du Canada, entre crise et renouveau
7. Séisme meurtrier au Myanmar, la junte militaire dépassée par la catastrophe
8. Dans nos librairies ce mois-ci
Arnaud LE GARS
ALLER PLUS LOIN...
ARTE, le dessous des cartes : Guerre commerciale, le prix de l’IPhone
VIE PUBLIQUE.FR : Les droits de douane entre l’UE et les États-Unis en 7 questions
ÉTATS-UNIS, GUERRE COMMERCIALE :
« LIBERATION DAY » OU « RUINATION DAY » ?
Le 2 avril 2025, Donald Trump a donné un tournant décisif à sa politique économique avec l’annonce d’une série de hausses spectaculaires des droits de douane. Instaurant un tarif universel de 10 % sur toutes les importations (hors Canada et Mexique) et des surtaxes ciblées sur plus de soixante pays, cette décision s’inscrit dans une ligne économique déjà amorcée lors de son premier mandat : celle d’un protectionnisme assumé, à rebours des logiques de libre-échange qui avaient prévalu depuis des décennies aux États-Unis.
Cette orientation économique, fondée sur un discours
de réindustrialisation, de souveraineté économique et de rejet du multilatéralisme, rebat les cartes des relations commerciales internationales et suscite autant d’adhésion que d’inquiétudes. Entre volonté affichée de relocaliser l’industrie et risque d’embrasement commercial mondial, le « Liberation Day » proclamé par Trump marque une intensification majeure d’un projet politique et économique clivant.
Dans une mise en scène présidentielle depuis les jardins de la Maison-Blanche, Donald Trump a justifié cette décision par l’existence d’une « urgence nationale » affectant
Donald Trump présentant les droits de douane le 2 avril 2025.
la souveraineté économique des États-Unis. La mesure phare : un tarif universel de 10 % applicable à toutes les importations, à l’exception du Canada et du Mexique, censés être des « partenaires loyaux ». S’ajoutent à cela des surtaxes spécifiques sur les pays accusés de déséquilibres commerciaux ou de pratiques jugées déloyales : 34 % pour la Chine (portant le total à 54 %), 20 % pour l’Union européenne, 25 % pour la Corée du Sud, 24 % pour le Japon.
Trump affirme que ces mesures permettront de rapatrier des chaînes de production, de recréer des emplois industriels et de générer des revenus publics massifs pour rembourser la dette et réduire les impôts. Il entend ainsi réaliser une promesse centrale de sa campagne : "Make America Great Again" par la réindustrialisation.
Cette décision ne s’inscrit pas dans une stratégie concertée ou négociée avec les partenaires. Elle constitue au contraire une rupture avec l’ordre économique libéral et multilatéral que les États-Unis eux-mêmes avaient contribué à bâtir depuis 1945. Trump continue de rejeter l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qu’il accuse de brider la souveraineté américaine, et privilégie des actions unilatérales basées sur le rapport de force.
Cette logique, amorcée dès son premier mandat, avait déjà donné lieu à des tensions commerciales avec la Chine, l’Union européenne et d’autres puissances économiques. Le retour de Trump à la Maison-Blanche en 2025 semble annoncer une intensification de cette approche : l’Amérique se veut désormais en dehors des règles globales, libre de taxer, sanctionner ou récompenser à sa guise.
La philosophie économique sous-jacente à cette politique est celle d’un recentrage productif. Il ne s’agit pas seulement de protéger des secteurs fragiles, mais de transformer la structure de l’économie américaine. Trump souhaite reconstruire une base industrielle, renforcer la souveraineté technologique, et réduire la dépendance aux importations stratégiques, en particulier dans les domaines des semiconducteurs, de l’énergie ou de l’automobile.
Cette stratégie séduit une partie de l’opinion publique, notamment dans les États industriels désindustrialisés du Midwest, touchés depuis trente ans par les délocalisations. Le discours protectionniste permet à Trump d’incarner un président en guerre contre les élites globalisées, défenseur des travailleurs et des intérêts américains face à une mondialisation perçue comme prédatrice.
Mais ce tournant protectionniste n’est pas sans effets secondaires. À court terme, il provoque déjà des tensions avec les principaux partenaires commerciaux des États-Unis. La Chine a annoncé en retour une augmentation équivalente de ses droits de douane sur les produits américains, tandis que l’Union européenne et d’autres pays préparent des mesures
de représailles. Une nouvelle guerre commerciale se profile, risquant d'entraîner une fragmentation accrue du commerce mondial.
Les marchés financiers ont d’ailleurs réagi avec nervosité. Les indices américains ont chuté après les annonces, inquiets de l’impact sur les chaînes d’approvisionnement mondiales, les marges des entreprises importatrices et la stabilité des prix. En effet, l’augmentation des droits de douane pourrait alimenter une hausse généralisée des coûts de production et donc de l’inflation, fragilisant le pouvoir d’achat des ménages.
Par ailleurs, les mesures annoncées aggravent une situation budgétaire déjà tendue. La politique de Trump repose sur une forte baisse des impôts et une hausse des dépenses militaires et industrielles. Combinée à une croissance incertaine, cette stratégie fait exploser le déficit public, et donc la dette. Le pari de Trump est que les revenus générés par les nouveaux droits de douane compenseront ces déséquilibres, mais cette hypothèse est fortement contestée par de nombreux économistes.
Ce retour en force du protectionnisme illustre une approche populiste de l’économie : simplifier des enjeux complexes, désigner des responsables extérieurs, incarner la puissance retrouvée par le volontarisme politique. Trump entend gouverner par le choc, dans une logique d’affrontement et de renversement des conventions établies.
Cette approche peut produire des effets politiques immédiats. Elle galvanise une base électorale, donne une direction lisible, polarise le débat. Mais elle ignore les interdépendances profondes de l’économie mondiale et les limites structurelles d’un modèle fondé sur l’autarcie relative. Elle risque aussi de dégrader la position des États-Unis dans les institutions internationales et de pousser leurs alliés vers d’autres centres de gravité.
En imposant un tarif universel et des surtaxes massives, Donald Trump assume un tournant stratégique dans la politique économique américaine. Il fait le pari que le protectionnisme renforcera la puissance industrielle, redynamisera l’emploi et rétablira la souveraineté économique des États-Unis. Mais ce pari est aussi celui d’une rupture profonde avec l’ordre économique mondial, et d’une gestion à court terme des équilibres commerciaux et budgétaires.
Entre ambition industrielle et isolement commercial, entre mobilisation populaire et inquiétude des marchés, la nouvelle doctrine économique de Donald Trump ouvre une période d’incertitudes majeures pour les États-Unis et pour l’économie mondiale dans son ensemble. La question demeure ouverte : cette stratégie permettra-t-elle de reconstruire une Amérique plus forte (peu probable), ou précipitera-t-elle de nouvelles fractures globales ?
ÉTATS-UNIS, QUAND LES CONTRE-POUVOIRS VACILLENT
Depuis la fondation des États-Unis, le principe de séparation des pouvoirs est au cœur de l’architecture politique du pays. Le président, le Congrès et les tribunaux forment un système pensé pour empêcher la concentration du pouvoir et garantir un équilibre démocratique. Ce mécanisme repose aussi sur des forces plus informelles, comme les médias ou les gouvernements des États fédérés, qui jouent un rôle fondamental dans la régulation et la critique du pouvoir central. Or, sous la présidence de Donald Trump, ce fragile équilibre est mis à rude épreuve. Ce qui se joue dépasse la seule figure de Trump : il s’agit d’une transformation profonde des équilibres institutionnels américains. Les médias ont toujours occupé une place particulière dans la vie politique américaine. Appelés souvent le « quatrième pouvoir », ils assurent un rôle de surveillance de l’action gouvernementale. Sous l’administration Trump, ce rôle est délibérément remis en cause. Le Président américain utilise une stratégie de confrontation constante, allant jusqu’à qualifier certains médias de « ennemis du peuple ». Mais plus que des attaques verbales, des actions concrètes ont été
entreprises pour réduire l’influence des organes d’information. Plusieurs institutions médiatiques financées par l’État fédéral, comme Voice of America ou Radio Free Europe, ont vu leurs journalistes mis à pied ou soumis à des pressions politiques. L’objectif semble clair : placer ces canaux d’information sous un contrôle plus direct du pouvoir exécutif, et limiter ainsi leur indépendance éditoriale.
Dans un contexte de polarisation politique, la stratégie fonctionne. Une partie de l’opinion ne reconnaît plus la légitimité des médias traditionnels, les accusant de partialité ou de mensonge. Cette méfiance généralisée affaiblit l’un des piliers essentiels du débat démocratique : l’accès à une information pluraliste et vérifiée.
Autre pilier de l’État de droit : le pouvoir judiciaire. Les juges, en particulier au niveau fédéral, sont garants de la Constitution et de la légalité des décisions politiques. Dans l’histoire des États-Unis, la Cour suprême comme les juridictions
inférieures ont souvent freiné l’action du pouvoir exécutif lorsqu’elle dépassait ses prérogatives.
Là encore, Donald Trump a adopté une posture de confrontation. Il a publiquement critiqué des juges qui s’opposaient à ses décisions – comme ceux qui avaient bloqué son décret migratoire en 2017. Il les a parfois désignés nommément, allant jusqu’à contester leur compétence ou leur loyauté. Cette mise en cause publique contribue à saper la légitimité du pouvoir judiciaire, et à faire peser une pression inhabituelle sur des magistrats qui, pourtant, ne sont pas élus, mais nommés à vie précisément pour garantir leur indépendance.
Par ailleurs, le pouvoir présidentiel sur les nominations de juges à vie – notamment à la Cour suprême – a été utilisé de manière stratégique. En trois ans, lors de son dernier mandat, Trump a nommé trois juges à la Cour suprême, tous conservateurs, modifiant durablement l’équilibre idéologique de la juridiction la plus puissante du pays.
Dans le système américain, le Congrès joue un rôle essentiel : il vote les lois, contrôle le budget et peut théoriquement contraindre le Président. Mais sous l’administration Trump, nous assistons à un glissement vers une hyperprésidence. Le recours fréquent aux décrets présidentiels – les « executive orders » – a permis de gouverner sans majorité parlementaire.
Cette manière de gouverner n’est pas nouvelle, mais elle a été intensifiée depuis janvier 2025. Trump a souvent préféré l’affrontement au compromis, et s’est appuyé sur sa base électorale pour légitimer ses décisions unilatérales. En pratique, cela a réduit l’influence du Congrès – pourtant composé de représentants élus – au profit d’un exécutif plus directif, moins contrôlé, plus vertical. La logique de la confrontation s’est aussi traduite dans la manière dont le pouvoir exécutif répondait (ou
ne répondait pas) aux enquêtes du Congrès lors du dernier mandat de Trump. À plusieurs reprises, des membres du gouvernement ont refusé de témoigner ou de transmettre des documents à des commissions parlementaires, limitant ainsi les capacités de contrôle du pouvoir législatif.
Enfin, dans le modèle américain, les 50 États fédérés disposent de compétences larges. L’enseignement, la police, la santé publique ou encore certaines questions migratoires sont gérées localement. Cette structure a été conçue pour éviter une centralisation excessive du pouvoir. Mais là aussi, les équilibres sont mis à mal. Depuis son retour à la Maison blanche, les relations entre le gouvernement fédéral et les États sont devenues conflictuelles. Des gouverneurs – notamment en Californie ou dans l’État de New York – dénoncent des pressions financières, des représailles politiques, voire un chantage budgétaire.
Ce que ces dynamiques révèlent, ce n’est pas une simple opposition entre un président et des institutions, mais une remise en cause plus profonde des mécanismes de contrôle démocratique. Les contre-pouvoirs ne sont pas des obstacles, mais des garde-fous. Lorsqu’ils sont affaiblis – volontairement ou par effet d’usure – c’est l’ensemble du système démocratique qui vacille.
Les États-Unis restent une démocratie robuste, avec une société civile active, une presse encore vivace, et des institutions judiciaires souvent résilientes. Mais l’expérience Trump montre à quel point ces acquis peuvent être fragiles. Le fonctionnement démocratique ne repose pas uniquement sur des textes, mais aussi sur des pratiques, des traditions, une culture du respect institutionnel. Or, quand cette culture est attaquée, la démocratie peut reculer sans bruit – non pas par un coup d’État, mais par une lente érosion.
TURQUIE, LA COLÈRE DE LA RUE
Le 19 mars 2025, la Turquie a été brutalement réveillée par l’arrestation d’Ekrem İmamoğlu, maire d’Istanbul et figure de proue de l’opposition. Accusé de corruption et de « soutien à une organisation terroriste », İmamoğlu a été incarcéré à la prison de haute sécurité de Silivri quatre jours
plus tard, par décision d’un juge que ses partisans qualifient de « fidèle au régime ». Cette arrestation, qui intervient à trois ans de l’élection présidentielle de 2028 où İmamoğlu faisait figure de principal challenger de Recep Tayyip Erdoğan, a provoqué une onde de choc dans le pays. Elle a surtout déclenché une
La suite est réservée aux étudiants Tremplins. Se connecter au campus
Pour continuer à avoir accès à un contenu d'information de qualité,
Intégrez nos formations
à une Turquie moderne, libre, où les jeunes peuvent vivre sans peur. »
Une répression féroce
Un isolement international, une démocratie à l’agonie
En savoir plus
Malgré l’ampleur de la crise, la communauté internationale reste, pour l’instant, relativement silencieuse. Si