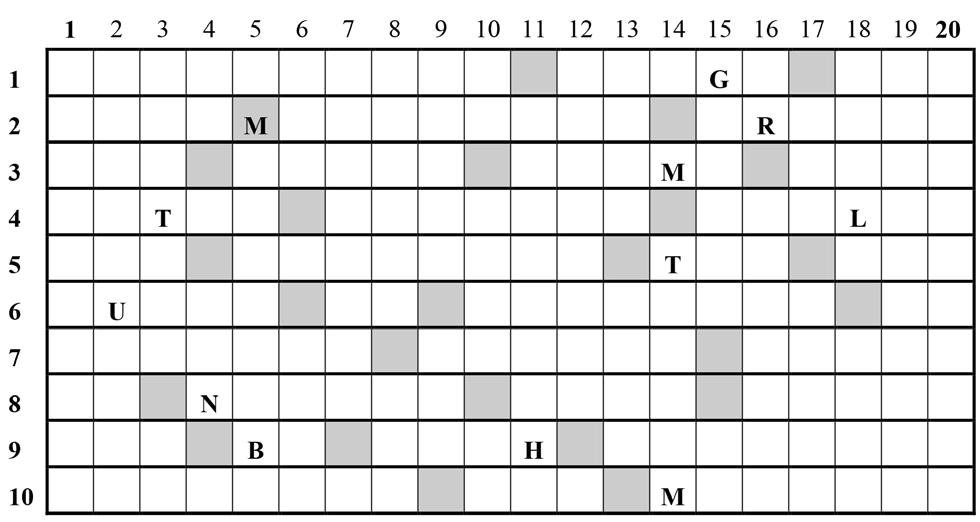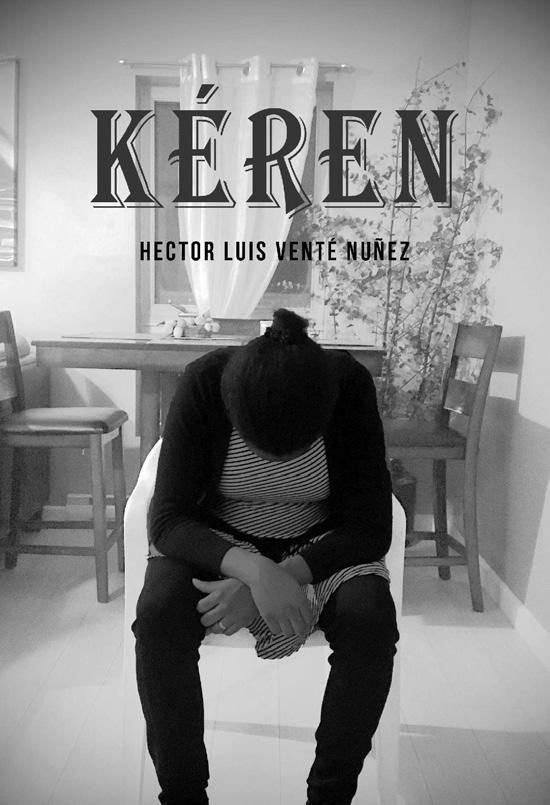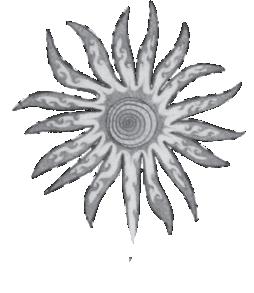3 minute read
L'habit ne fait pas le moine
C ourtoi sie: Claude Cossette
L’auteur gréco-romain Aulus Gellius affirmait: «La barbe ne fait pas le philosophe» (voir le portrait de l’auteur dans l’entête). Dans notre culture, son proverbe est devenu: «L’habit ne fait pas le moine». Mais ne le fait-il pas un peu tout de même? Comment réagirait le patient typique devant une chirurgienne qui se présenterait dans les vêtements de la chanteuse Sofia Nolin?
Advertisement
LE VÊTEMENT COMME UNIFORME
Le vêtement sert à protéger. Du froid, on le sait au Québec, et du soleil sous d’autres latitudes. Partout, il sert à préserver la pudeur; même sous les tropiques, hommes et femmes portent au moins un cache-sexe. La Bible elle-même rapporte ainsi l’aventure de la pomme vécue par Adam et Ève: «Leurs yeux s’ouvrirent et ils s’aperçurent qu’ils étaient nus. Ils cousirent donc des feuilles de figuier et s’en firent des pagnes».
Les vêtements sont dessinés pour un usage donné. Ils varient par leur coupe et par les tissus dans lesquels on les taille. Certains répondent à un besoin précis. La cowgirl porte un pantalon de denim pesant, mais inusable. L’infirmier, un uniforme qui l’identifie et qui convient à ses activités. La juge, la robe de magistrat distinctive et impériale. L’ouvrier, une salopette tout usage qui le protège largement. Le soldat, une tenue qui lui permet de se fondre dans le paysage.
La styliste d’affaires Marie-Claude Pelletier avise : «Vous serez rassurés [si votre banquier se présente] en costumecravate. En revanche, ce sera presque inquiétant de voir arriver un créatif d’agence de publicité en complet». Dans chaque profession existe un style convenu. Voyez les étudiants universitaires: ceux d’administration ou de droit portent la tenue traditionnelle des cadres alors que ceux de communication ou de sciences sociales s’affichent en tenue décontractée, voire négligée. J’ajouterai que l’on peut tromper les gens en revêtant le vêtement caractéristique d’une fonction. C’est le cas quand un terroriste affiche la livrée d’un pilote de ligne, une détrousseuse celle d’une policière, un pique-assiette celle d’un bourgeois en goguette ou une mythomane celle d’une star.
LE VÊTEMENT COMME MESSAGE
Par ailleurs, le vêtement est toujours un moyen de communication. Jusqu’à une époque récente, il servait dans nos collectivités à distinguer les classes sociales. Par exemple, comme coiffure, l’ouvrier portait une casquette, le col blanc un chapeau mou et le bourgeois un haut-de-forme. Dans les sociétés primitives, le chef avait droit à un éblouissant couvre-chef.
Dans notre pays égalitaire, patrons comme ouvriers portent désormais un habit de ville… en ville! Mais l’ouvrier croisé dans le bus pourrait porter un bleu de travail pendant son quart de travail. Par ailleurs, comme pour lancer un doigt d’honneur aux conventions, les contestataires interchangent parfois leurs tenues: ainsi la riche vedette qui, pour se présenter à son gala, choisit un jeans usé troué (payé 2 000$ chez son designer préféré?) alors que le jeune désargenté revêt pour son mariage un smoking usagé (il est vrai qu’un corps de 20 ans resplendit même dans un T-shirt élimé).
Les vêtements permettent aussi de marquer sa présence. Les talons, les épaulettes ou les chapeaux grandissent les gens. Les formes originales et les couleurs flamboyantes mettent en valeur. Et ce sont les chemises à froufrous et les robes de brocart qui fabriquent l’apparat des prestigieux galas.
Dans tous les groupes, qu’ils soient ethniques, religieux, politiques, ou simplement professionnels ou culturels, les vêtements servent à affirmer son appartenance. Au-delà, chacun adapte ses tenues aux circonstances (travail, mondanités, vacances, loisirs ou intimité). Après quoi, d’aucuns instilleront des indices de goût personnel, d’affirmation ou de contestation.
De toute manière, l’habillement manifeste des choix, conscients ou non, entre, d’une part, la liberté de pensée et la créativité et, d’autre part, le sentiment d’appartenance et le besoin de normalité. Finalement, le vêtement traduit un
délicat équilibre entre l’être et le paraître. Tout ce que j’ai évoqué jusqu’ici ici se passe dans le monde ordinaire. J’ajoute un bémol pour rappeler la réalité du monde extraordinaire de la pauvreté et de l’itinérance. Dans ce monde-là, sa garde-robe, on la porte sur le dos; sa boutique de mode, c’est le comptoir de dépannage. Dans ce monde-là, le vêtement que l’on porte ne vise à exprimer ni ses idées ni sa personnalité. Il permet seulement de survivre.