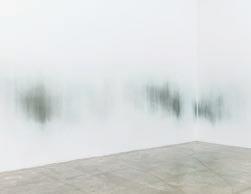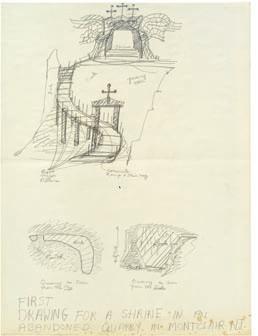Cyprien Gaillard
DUMPTY HUMPTY
Palais de Tokyo Lafayette Anticipations
F
Préfaces
Guillaume Désanges 4 Guillaume Houzé 5
Introduction Rebecca Lamarche-Vadel 7
Conversation Cyprien Gaillard et Rebecca Lamarche-Vadel 9
Le Défenseur du Temps Olivier Schefer 23
HUMPTY \ DUMPTY, ou quand les superstars perdent de leur éclat Jack Halberstam 31
L’opéra d’HUMPTY \ DUMPTY Lisa Le Feuvre 37 Nautilus (version dub) Louis Henderson 47
SOMMAIRE
Notices des œuvres Renaud Gadoury 52
HUMPTY 53
Love Locks 53 Overrunner 53 The Lake Arches (Restored version) 54 Oreste e Pilade 54 Gargouilles crachant du plomb 55 Overburden (1), Overburden (2), Overburden (3) 55 Eiffel Cable Burnish 56
Everything but Spirits 57 Sober City 57 Ocean II Ocean 58
Gates (Passaic) 58
Nautilus Dub (First Half) 59 Dessins de Robert Smithson 59 Nautilus Dub (Second Half) 60
Formation 60 Mutter mit zwei Kindern 61
L’Ange du foyer (Vierte Fassung) 61
White Vessel Study 62
Constat d’état (HUMPTY Palais de Tokyo) 62
DUMPTY 63
Constat d’état (DUMPTY, Lafayette Anticipations) 63
Frise 1 63
Le Défenseur du Temps 64 Palais de la découverte vitrifié 64 Frise 2 65
L’Irrestaurable (pour Gaël) 65
Biographies 67
PRÉFACES
Le travail de Cyprien Gaillard invite à une exploration sensible de la ville et s’attelle à révéler les traces du temps dans l’espace urbain, les objets, les matières, mais aussi dans l’imaginaire, les humeurs et les affects contemporains.
L’artiste signe son retour à Paris avec son exposition HUMPTY \ DUMPTY, qui se déploie en deux volets complémentaires et concomitants au Palais de Tokyo et à Lafayette Anticipations. Au Palais de Tokyo, l’exposition s’inscrit dans un bâtiment lui-même chargé d’une histoire de l’art moderne puis contemporain en France, dont l’architecture porte aujourd’hui la marque. Il offre un cadre de choix qui entre en résonance avec l’imaginaire de Cyprien Gaillard et des artistes qu’il a conviés pour ce projet.
Je tiens ici à remercier Cyprien Gaillard pour la générosité de son implication, Emma Lavigne, qui l’a invité à imaginer ce projet au Palais de Tokyo, Rebecca Lamarche-Vadel, directrice de Lafayette Anticipations et commissaire de l’exposition avec laquelle le projet s’est construit dans une chaleureuse complicité, et Clément Raveu qui l’a accompagnée. L’artiste ayant convié au Palais de Tokyo des œuvres qui ne portent pas sa signature, je tiens à exprimer ma gratitude envers Daniel Turner qui a contribué à HUMPTY \ DUMPTY avec une nouvelle création réalisée spécialement pour le Palais de Tokyo, ainsi qu’aux prêteurs des œuvres de Giorgio de Chirico, Käthe Kollwitz et Robert Smithson.
HUMPTY \ DUMPTY constitue une précieuse occasion pour Lafayette Anticipations et le Palais de Tokyo de travailler ensemble et de renforcer de manière vertueuse les synergies au sein de l’écosystème parisien de la création contemporaine. Mes remerciements les plus chaleureux vont donc enfin, et bien sûr, à Guillaume Houzé, président de Lafayette Anticipations, pour cette belle collaboration.
Guillaume Désanges
Président du Palais de Tokyo
Lafayette Anticipations collabore depuis plusieurs années avec Cyprien Gaillard, notamment par le biais de sa collection qui conserve son œuvre Real Remnants of Fictive Wars I. Nous sommes ravis d’accueillir son nouveau projet à Paris, où il trouve un ancrage particulier dans le quartier de la Fondation avec cette restauration spectaculaire du Défenseur du Temps de Jacques Monestier. Au moment où Paris se transforme dans la perspective des Jeux olympiques, les artistes nous offrent aujourd’hui des clés pour mieux comprendre demain.
HUMPTY \ DUMPTY a été pensée dès le départ comme une exposition en deux chapitres déployés à Lafayette Anticipations et au Palais de Tokyo, avec lequel nous avons construit une collaboration particulièrement fructueuse. Je remercie chaleureusement Guillaume Désanges et toute son équipe pour leur expertise et leur énergie, ainsi qu’Emma Lavigne qui a initié ce projet. Je tiens également à souligner l’investissement de Rebecca Lamarche-Vadel, directrice de Lafayette Anticipations, qui a assuré le commissariat d’ensemble de ce projet particulièrement ambitieux. L’équipe de notre Fondation s’est aussi mobilisée avec force pour accompagner l’artiste dans une aventure à la fois technique, historique et visionnaire.
Ce livre en deux volumes – textes et images – témoigne de ce long processus de recherche et de production tout en nous offrant une vision immersive au cœur de l’exposition. Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à le parcourir que nous en avons eu à l’élaborer avec Cyprien Gaillard.
Guillaume Houzé
Président de Lafayette Anticipations
4 5
Alors que Paris restaure frénétiquement ses monuments les plus prestigieux et en efface les marques d’usure en préparation des Jeux olympiques, Cyprien Gaillard s’intéresse à la ville comme un lieu d’expression du désordre, où l’humain lutte contre les éléments au travers de régulières et vastes campagnes de rénovation. Ce sont dans les marges, les recoins et les espaces de dissidence que l’artiste trouve les récits de nouvelles relations possibles avec le vivant et sonde les limites de nos désirs de stabilité et de permanence.
HUMPTY \ DUMPTY est une exposition en deux chapitres, présentés au même moment à Paris, au Palais de Tokyo et à Lafayette Anticipations. Ce titre fait référence à une comptine anglaise dans laquelle un personnage tombé d’un mur se brise en une myriade de fragments et qui, malgré de multiples tentatives de reconstruction, ne pourra retrouver son état originel.
INTRODUCTION
Au Palais de Tokyo, HUMPTY, le premier chapitre de l’exposition, rassemble une sélection d’œuvres de Cyprien Gaillard inédites ou encore jamais présentées en France, ainsi que celles d’artistes invités (Giorgio de Chirico, Käthe Kollwitz, Robert Smithson et Daniel Turner) qui constituent une forme d’étude de l’entropie. C’est au travers de la relation entre le corps et l’architecture, les territoires délaissés ou encore les espèces dites invasives, que Cyprien Gaillard dresse un portrait de notre lien à l’effondrement et à la reconstruction. Se racontent l’obsession de la conservation des choses, la tentation de maintenir ou de retrouver un certain ordre du monde, et, enfin, notre irréductible vulnérabilité face au temps et à ses effets. L’exposition se déploie d’elle-même comme une spirale, un motif récurrent qui rappelle autant la coquille d’un nautile qu’un vortex ou encore la représentation d’un temps cyclique.
À Lafayette Anticipations, pour le second chapitre, DUMPTY, l’artiste redonne vie à une œuvre tombée dans l’oubli depuis 2003, Le Défenseur du Temps de Jacques Monestier : une horloge monumentale installée en 1979 au cœur de Paris dans le quartier de l’Horloge. Unique au monde, elle est constituée d’un homme juché sur un rocher, muni d’un glaive et d’un bouclier, qui se bat régulièrement contre des créatures représentant les éléments. Cet automate a été abandonné depuis plus de vingt ans aux effets du temps, contre lesquels il tentait pourtant de nous protéger. Cyprien Gaillard fait de sa restauration un acte de création, et l’acteur principal d’un opéra au centre de la Fondation, avant qu’il ne soit réinstallé à son emplacement initial à l’issue du projet. La renaissance du Défenseur du Temps est mise en perspective avec l’impossible retour d’un être cher, Gaël Foucher, dit « El Magnifico », ami disparu il y a quelques années, à qui Cyprien Gaillard dédie cette exposition.
7
Rebecca Lamarche-Vadel
« Car celui qui saute dans le vide n’a plus de comptes à rendre à ceux qui le regardent. »
Jean-Luc Godard
Rebecca Lamarche-Vadel : Pour préparer l’exposition HUMPTY \ DUMPTY imaginée en deux chapitres au Palais de Tokyo et à Lafayette Anticipations, tu as sillonné inlassablement la ville de Paris. Tu y as capturé beaucoup d’images autour de la tour Eiffel et de la place de la Concorde, ainsi que de l’ensemble des monuments historiques actuellement rénovés en perspective des Jeux olympiques de 2024.
Cyprien Gaillard : J’aime l’idée que nous soyons au moment où Paris fait son bilan entropique. La ville tente de préserver certains édifices, mais sa politique publique de restauration est inévitablement exclusive : elle ne peut inclure tout l’espace bâti. Une hiérarchie qui définit les bâtiments et monuments à restaurer en priorité est donc déjà en place. C’est précisément ces limites qu’il m’intéresse d’explorer. J’ai toujours été fasciné par les failles. J’ai connu l’époque des jeux de billes où il fallait pousser l’agate dans un trou, la fissure dans le sol était toujours pour moi un espace à viser, à investir. Ce motif de l’interstice revient souvent d’ailleurs dans mon travail. Je crois que chaque artiste cherche un point d’entrée dans le monde qui l’entoure, une brèche où la lumière puisse passer, et je sens qu’avec notre environnement urbain de plus en plus rationalisé, normé, il y a de moins en moins d’espace libre où se projeter, où expérimenter autre chose que soi-même…
Restaurer Le Défenseur du Temps, cette œuvre de Jacques Monestier installée en 1979 et abandonnée depuis 2003, était une réponse évidente à ton invitation. J’ai toujours eu cette idée d’insuffler une vie nouvelle dans l’œuvre d’un autre, parce que j’étais particulièrement touché par le sort réservé aux œuvres d’art public, surtout à celles qui sombrent dans une forme d’anonymat. Le Défenseur du Temps est encore plus symbolique de cette idée d’une nouvelle vie puisqu’il a été en mouvement, puis s’est arrêté. Je me rappelle l’avoir vu fonctionner, enfant, et avoir éprouvé un grand sentiment d’étrangeté. C’était une énigme, dans un quartier dont je n’arrivais pas à saisir la nature et l’origine. Il n’était pas central puisque c’était « sur la route » du Centre Pompidou, mais il était bien plus intéressant que le musée aux yeux d’un enfant. Et je me rappelle être passé dans cet espace interstitiel, le quartier de l’Horloge, de nombreuses fois ; c’est un espace piéton qui prête à la dérive. L’automate se trouve entre le Centre Pompidou et le musée des Arts et Métiers, mais il n’a sa place ni dans l’un ni dans l’autre. Il existe dans un « contreespace », comme Foucault le disait au sujet de ses hétérotopies.


CONVERSATION
Le quartier de l’Horloge, c’est aussi dans la conscience collective parisienne un peu un fiasco urbanistique au même titre que les Halles. Ces deux sites faisaient d’ailleurs partie d’un seul et même projet de la ZAC à l’époque (zone d’aménagement concerté). Fidèle aux idées postmodernes et à leur goût pour les réappropriations historiques, le quartier de l’Horloge reprend le concept de l’îlot médiéval. C’est aussi un quartier qui regorge d’histoires. La pièce de Gordon Matta-Clark, Conical Intersect, avait été réalisée rue Beaubourg en 1975 sur un immeuble en cours de démolition pour faire place au quartier de l’Horloge, quelques années à peine avant l’inauguration du Défenseur du Temps en 1979. On y trouvait aussi cette boîte de nuit, Le Saxo, un after assez connu dans les années 1990 – il y avait souvent des descentes de police, l’endroit fermait pendant des mois avant de rouvrir secrètement au grand désarroi des riverains… À quelques pas de là, un jeune homme aurait fait une overdose dans une fontaine, juste après Le Grand Assistant de Max Ernst, aussi appelé le « hibou ». Ce dernier a d’ailleurs l’air de nous dire : « N’allez pas plus loin. » Coincé entre Leroy Merlin et Flunch, il semble être une balise indiquant que la sphère d’influence du Centre Pompidou s’arrête là.
9
Cyprien Gaillard et Rebecca Lamarche-Vadel Juillet 2022
Cyprien Gaillard, The Lake Arches vue d’exposition au Palais de Tokyo (HUMPTY), 2022
Cyprien Gaillard, Frise 1, vue d’exposition à Lafayette Anticipations (DUMPTY), 2022
L’idée de restaurer
Le Défenseur du Temps était aussi en réponse à l’architecture de Lafayette Anticipations, conçue par Rem Koolhaas. La Fondation est un manifeste, et il me semble qu’on aura toujours plus l’impression de visiter un bâtiment qu’une exposition. Il est assez « techno », transparent et honnête sur ses capacités de mouvement, avec ces plateformes déplaçables au centre, ces vérins visibles, peints avec une couleur spécifique. Il y a aussi ce caillebotis, ce métal présent partout. C’est un musée du 21e siècle, performatif, modulable.
Étude du mécanisme de la tête du dragon du Défenseur du Temps (carnet de croquis de Jacques Monestier), 23 avril 1976

L’horloge à automates Le Défenseur du Temps de Jacques Monestier, dans le quartier de l’Horloge à Paris, France, décembre 1979

RL-V : Oui, très inspiré du projet du Fun Palace de Cedric Price. Ce dernier avait imaginé un musée flexible, avec des espaces programmables, au service des utilisateurs. Il pensait que les nouvelles technologies contribueraient à la libération de l’humanité. Il disait d’ailleurs que le Fun Palace devait être « l’université de la rue ». C’était une espèce d’antidote à la constatation que le musée était devenu un mausolée, immobile et figé, obsédé par la conservation et hors du monde. Ce bâtiment de Rem Koolhaas, en écho à Price, célèbre la métamorphose, la transformation, la désorientation aussi.
CG : Je voulais dialoguer avec ce bâtiment de manière frontale, mais il me fallait un soldat, un centurion pour y pénétrer en confiance. J’ai donc écrit une lettre à Jacques Monestier, l’auteur du Défenseur du Temps pour lui proposer mon idée d’insuffler une vie nouvelle dans son automate, de penser l’acte de restauration comme un acte de création. C’était une proposition d’entraide, car sans lui, je n’avais pas de réponse à cette architecture de la Fondation, et sans moi, les jours de son automate étaient comptés. On sait maintenant qu’il y avait trois cents kilos de fientes de pigeon à l’intérieur du rocher de la sculpture et qu’il menaçait de s’effondrer…
RL-V : Le Défenseur était aussi assez central pour une certaine communauté, comme une sorte de cœur battant qui rassemblait chaque heure des curieux venus de toute part, les habitants du quartier, mais aussi des touristes du monde entier.
CG : Beaucoup de Parisiens ne le connaissent pas, mais il était central pour quelques autres : les habitants du quartier qui se retrouvaient au Bistrot de l’Horloge pour le voir se battre contre ses trois adversaires à midi, dix-huit heures et vingt-deux heures. Le Défenseur se bat contre les éléments : le crabe représente l’eau, l’oiseau l’air, et le dragon le feu. En réalité, je l’ai surtout connu en panne. Je me souviens qu’il y avait dans les années 2000 un panneau demandant des fonds pour le restaurer. Je me demandais combien ça coûterait et j’étais assez touché par ce geste, comme un appel de détresse bricolé. J’ai toujours gardé Le Défenseur en tête, mais il faut parfois des années pour trouver la bonne opportunité de réaliser une idée.

RL-V : Je me souviens que faire renaître Le Défenseur à la Fondation était une évidence pour toi.
CG : Je n’avais pas de plan B. Ce qui me plaisait, c’était de décontextualiser cet automate, d’augmenter son champ d’action pour qu’il ne soit plus attaché à son mur, qu’il se remette à fonctionner à quelques pâtés de maisons dans l’architecture
de Rem Koolhaas, dont tout le monde s’accorde à dire qu’elle est importante, contrairement à l’indifférence rencontrée par Le Défenseur. Je voulais associer cet automate et le bâtiment en donnant une peau neuve au Défenseur et un nouveau contexte qui permettrait de le reconsidérer. Il y a des limites mécaniques à ce que Le Défenseur peut faire : il fonctionne avec ces vérins penumatiques qui créent une chorégraphie assez archaïque. Je souhaitais tout de même qu’il puisse rattraper le temps perdu depuis son immobilisation, d’où la nouvelle fréquence de mouvement toutes les quinze minutes plutôt que toutes les heures, et les aiguilles de l’horloge mère qui partent en arrière, qui le libèrent aussi du temps du quartz.
RL-V : 2003 est l’année où Le Défenseur s’est arrêté, son créateur Jacques Monestier ayant décidé de le débrancher après la coupure du budget de maintenance de l’automate – ainsi condamné à une lente déchéance. Plutôt que de le voir décliner et sombrer, Monestier a préféré le plonger dans une forme de coma.
CG : C’est une forme d’auto-sabotage. Il y a trois dates clés : en 1979, l’œuvre est inaugurée ; en 2003, elle s’éteint ; et en 2022, elle est réactivée. Il était important pour moi que l’œuvre témoigne d’une réanimation, qu’elle garde certaines traces de sa vie hors service…
Or, pour Jacques Monestier, c’était très problématique d’embrasser les traces du temps, de laisser la patine et les fientes de pigeon. Au terme d’une longue discussion, on est arrivés à un compromis consistant à garder le personnage central avec les traces d’usure et à restaurer le reste de l’objet. Je pense mon exposition comme une fiction et je souhaitais que cet automate y joue un rôle central. Ce rôle n’est pas celui que Monestier lui a initialement attribué et cette histoire n’est pas celle qu’il a écrite pour lui ; ce que je cherche à raconter avec cette œuvre, c’est sa deuxième vie, entre sa mort en 2003 et sa renaissance en 2022. Il fallait donc repenser une chorégraphie pour l’occasion, la reprogrammer.
RL-V : Le Défenseur du Temps sera ton œuvre seulement pour ces trois mois d’exposition. Tu embrasses la vision de Marcel Duchamp, selon qui l’artiste du 21e siècle allait disparaître. Tu insuffles cette nouvelle vie dans cet objet, créant ainsi une œuvre immatérielle qui s’évanouira lorsque Le Défenseur sera réinstallé dans le quartier de l’Horloge en 2023.
CG : Oui, il ne restera rien à mon nom.
RL-V : Tu mets sa renaissance en perspective avec la disparition de ton ami Gaël Foucher il y a quelques années, un être cher qui, lui, ne pourra pas renaître ni connaître ce second souffle.
CG : En effet, il ne pourra pas revenir à la vie. Ces questions de conservation architecturale et culturelle ne sont intéressantes pour moi que quand on les lie à l’instinct de conservation des êtres, de soi. La ville essaye en permanence de se soigner et de maintenir des objets pour qu’ils nous survivent. Il y a deux obstacles majeurs à ce projet de régénération de la ville de Paris : l’un est un métal –le plomb – et l’autre un minerai – l’amiante. Le plomb se trouve essentiellement dans les peintures, par exemple dans certaines couches de la tour Eiffel ; l’amiante
Le Défenseur du Temps de Jacques Monestier en train d’être reprogrammé par Cyprien Gaillard après sa restauration à l’atelier Prêtre et fils, Mamirolle, France, septembre 2022
10 11
est, entre autres, au Grand Palais, au Palais de la découverte. Ces monuments font l’objet de chantiers que j’ai pu visiter : ils sont extrêmement toxiques. Un projet de désamiantage est à haut risque. Je pense souvent à ces hommes et ces femmes qui sont en première ligne de cette guerre contre la ruine, qui risquent leur vie pour la préservation de ces monuments qui finissent d’ailleurs par n’exister qu’en deux dimensions dans la mémoire collective, sous forme de carte postale imprimée, ou virtuellement sur les réseaux sociaux et autres fonds d’écran…

J’ai un rapport émotionnel à l’architecture : un immeuble en ruine est pour moi comparable à l’état dans lequel on peut se trouver à un moment spécifique dans la ville, le corps étant lui aussi un fragment d’espace. L’amiante rappelle que notre environnement construit n’est pas seulement autour de nous, il peut aussi être en nous. Nous sommes des êtres poreux. Il me semblait qu’il devait y avoir une présence humaine dans l’exposition qui évoque l’instinct de conservation de soi. J’ai ainsi voulu rendre hommage à mon ami décédé en 2013, Gaël Foucher, à qui Le Défenseur du Temps plaisait d’ailleurs beaucoup. J’imagine qu’il voyait en cette œuvre abandonnée l’âme intacte de l’outsider en marge de l’institution que représente le Centre Pompidou…
On peut se projeter dans les œuvres d’art public, on peut les faire siennes le temps de la dérive d’un soir, à l’inverse des œuvres dans un musée, qui ont toujours un contexte très clair, une temporalité imposée, un accès limité par des horaires d’ouverture, un billet payant, etc.
En repassant devant cet automate quelques jours après avoir reçu ton invitation à faire cette exposition, je l’ai considéré à nouveau. J’ai vu en lui un personnage autant lié au quotidien qu’au surnaturel, capable d’incarner une autre personne que celle imaginée par son auteur.
RL-V : Dans l’exposition HUMPTY \ DUMPTY, l’humain apparaît souvent dans une relation complexe à l’environnement construit et à l’histoire. On le voit dans les œuvres présentées : les personnages anonymes de Chirico qui digèrent des couches d’architecture, les dessins de Smithson qui figurent une crise intérieure où jaillissent des éléments de la ville, du langage et des mythes. Chez Käthe Kollwitz, la figure humaine devient monstrueuse à force de tenter de protéger l’enfance contre la force du temps et la barbarie de la guerre. Quelle est la place de l’humain dans tes œuvres ?

CG : L’humain y apparaît très peu. Ses apparitions et disparitions sont plus liées à des questions de représentation d’un espace. Dans mes films, un sujet traditionnellement traité en premier plan telle une figure devient arrière-plan, et vice versa un paysage peut aussi devenir un élément de premier plan, ce qui peut parfois être source de télescopage, comme dans mon film The Lake Arches À l’époque, je filmais tout le temps, je portais toujours avec moi une petite caméra Sony Handycam. Je voulais initialement montrer une scène idyllique – deux amis
qui observent leur reflet dans l’eau avant de s’y baigner – en commençant par un plan très serré pour filmer le reflet du ciel dans l’eau, puis faire un long dézoom qui révélerait l’architecture de Bofill en arrière-plan. Ce n’était pas un très bon scénario en soi… J’ai commencé à filmer sans savoir qu’ils allaient plonger.
L’un d’eux a plongé un peu plus à pic, ressortant de l’eau avec le nez écorché, alors que l’autre était indemne. La caméra a continué de tourner – d’ailleurs, il me semble qu’à un moment donné, mon ami d’enfance Nicolas regarde directement la caméra et a l’air de dire que c’est maintenant un document d’importance.

C’est un film que j’ai fait très tôt, qui représentait l’idée d’une confrontation entre l’homme et l’architecture, mais aussi l’enchevêtrement entre nos corps et notre environnement. Cela me rappelle d’ailleurs cette œuvre de Hajo Rose qui, dans sa vingtaine, avait fait son autoportrait en superposant son visage et la façade de l’école du Bauhaus à Dessau.

Dans les bâtiments de Bofill, et aux Arcades du Lac en particulier, on a parfois l’impression d’être dans une peinture de De Chirico, avec ces arches, l’univers piéton, les piazzas. The Lake Arches fait plus directement référence à la gouache réalisée par de Chirico présentée au Palais de Tokyo, Oreste e Pilade, deux êtres sans visage, avec l’architecture avalée encore visible dans leur estomac. Ce tableau m’évoque aussi la difficulté d’assimiler toute notre culture occidentale, le fardeau de l’héritage à l’image de ces fragments antiques indigestes logés dans les intestins, notre deuxième cerveau.
RL-V : On y voit comme une indigestion qui rappelle les personnages Bouvard et Pécuchet de Flaubert, qui veulent tout savoir du monde, tout assimiler, mais qui n’y parviennent évidemment pas. Dans The Lake Arches, le personnage de Nicolas vit lui aussi un épisode douloureux : il se casse le nez dans un espace pourtant imaginé pour le plaisir et le loisir de l’homme. On parle de la difficulté à domestiquer et à contrôler le monde.
CG : La difficulté de tout connaître, de faire sens de notre culture fragmentée. C’est intéressant, parce que Bofill connaît aujourd’hui un regain de notoriété sur Internet. Beaucoup de gens considèrent son édifice de Noisy-le-Grand, le Palacio d’Abraxas, comme une destination pour se prendre en photo et nourrir leur compte Instagram. Terry Gilliam l’a aussi utilisé pour Brazil. Dans un sens, The Lake Arches perce ces représentations plates. Cette façade, d’abord en arrière-plan, devient centrale lors de l’impact de Nicolas sur le fond du lac. Cet accident, paradoxalement, restaure aussi l’image que l’on a de l’architecture de Bofill. Il la réinscrit dans un monde tangible, la remet au premier plan, loin de son rôle de décor sur les réseaux sociaux et autres fictions.
RL-V : Ces questions de la fragmentation, de la fracture, de la décomposition sont très présentes, notamment dans le titre HUMPTY \ DUMPTY CG : HUMPTY \ DUMPTY fait référence à un personnage dont l’histoire est celle de sa fragmentation, rapportée dans le livre De l’autre côté du miroir de Lewis Carroll, ouvrage pensé comme une suite à Alice au pays des merveilles. Ce personnage était
12 13
Giorgio de Chirico, Oreste e Pilade, 1928
Ricardo Bofill, Le Viaduc, Les Arcades du Lac, Montigny-le-Bretonneux, France, 1971
Cyprien Gaillard, The Lake Arches (version de 2007)
Hajo Rose, Untitled (Self-Portrait) 1931
apparu auparavant dans une comptine au 18e siècle. Chez Carroll, Humpty Dumpty à la forme d’un œuf anthropomorphe, mais la comptine ne nous dit rien de tel. Elle parle d’un personnage fictif qui se tient sur un mur de brique chancelant, qui en tombe et se casse, et puis de l’effort collectif déployé pour le ramener à son état originel. Il est ensuite expliqué qu’il est impossible de retrouver un tel état. Même si, rassemblé, il ne sera plus jamais le même ; c’est l’idée de la spirale qui effectue le même mouvement que la boucle, mais ne revient jamais à son point d’entrée. Ce titre me paraissait particulièrement juste pour parler de cette grande campagne de restauration du centre de Paris en vue des Jeux olympiques, et pour évoquer les enjeux de préservation qui y sont liés.
RL-V : L’obsession de conservation du patrimoine est en effet de plus en plus présente. Elle s’est développée tout au long du 20e siècle dans un souci de préservation et de permanence de ces objets. Il y a aujourd’hui 121 millions de pièces à conserver dans les collections des musées de France, mais cette obsession conduit à une réalité étrange qui nécessite de complètement couper les œuvres du monde, d’atteindre une permanence du climat, de se soustraire à toutes les expressions du temps, des saisons, du jour, de la nuit, de la lumière, de réduire à néant toute variation.


CG : Oui, ce sont des idées récentes. Une obsession qui va d’ailleurs à l’encontre de la préservation générale du monde, parce que maintenir en permanence la température d’un musée ou d’un entrepôt entre 18 et 21 degrés entraîne forcément des conséquences sur le monde extérieur. Encore une fois, ces désirs de préservation des œuvres s’exercent au détriment de la préservation de la Terre et des êtres. C’est cet enchevêtrement des désirs qui m’intéresse. On préserve toujours l’un au détriment de l’autre. Or, s’il n’y a plus personne, pour qui sont les œuvres ? Pour en revenir au Palais de Tokyo, sa précarité climatique m’a poussé à montrer des pièces fragiles comme la gouache de Giorgio de Chirico, mais aussi à penser un dispositif dans lequel cette œuvre puisse être montrée sans être endommagée. L’idée était de la montrer dans un autre contexte que celui d’un musée traditionnel normé, pour en souligner la fragilité. Ce dispositif altère l’œuvre visuellement : une peinture devient une sculpture au moment où elle est placée sous cloche. Cette idée de soin et de considération pour l’autre se retrouve dans le sujet même de cette œuvre, où la main de l’un des amis se pose sur l’épaule de l’autre, avec à leurs pieds ce système de contrôle hydrométrique, tel un appareil respiratoire artificiel.
RL-V : Le fait que la conservation des uns engendre la détérioration des autres revient dans l’œuvre Love Locks, déposée à l’entrée de l’exposition au Palais de Tokyo. Ce sont d’immenses sacs de la voirie dans lesquels on découvre des milliers de « cadenas d’amour » accrochés par les passants sur les ponts de Paris et qui menaçaient de les faire sombrer. Comment t’est venue cette idée ?
CG : En parcourant la ville. Je les connaissais, mais un jour, je les ai reconsidérés. Ces cadenas ne sont pas laissés par des Parisiens, mais par des couples de touristes qui viennent des États-Unis, d’Asie et d’ailleurs, laissant cette trace qui symbolise la permanence de leur amour scellé par ces cadenas une fois la clé jetée dans la Seine. Ces cadenas ne posent pas qu’un problème éthique parce qu’ils symbolisent un amour lié à la possession, mais aussi un problème structurel, comme dans le cas du pont des Arts où leur poids a fait s’effondrer une partie des rambardes. En 2018, tous ces cadenas ont été retirés et les grilles du pont remplacées par des parois vitrées. C’est comme la tombe d’Oscar Wilde au Père-Lachaise, sculptée par le vorticiste anglais Jacob Epstein que j’aime beaucoup, qui est maintenant sous verre pour ne pas être abîmée, notamment par les traces de rouge à lèvres laissées par les baisers de ses admirateurs et admiratrices, mais il n’empêche que ces plaques de verre l’altèrent. On voit un paradoxe se dessiner dans ces exemples : préserver détruit. C’est l’ironie de ces efforts de conservation : ils obstruent notre accès à l’œuvre au moment présent, mais, dans le même temps, assurent sa pérennité pour les générations futures. Je pense vraiment cette œuvre – ces grands sacs récupérés dans les entrepôts de la voirie de Paris – comme un ready-made. C’est un objet d’une grande ironie, non ? Vouloir que ces cadenas soient une expression d’amour, alors que le cadenas représente vraiment l’enfermement, ainsi qu’un déchet difficile à retirer sur la voie publique.
RL-V : Ils racontent une certaine manière contemporaine d’aimer. L’exposition évoque beaucoup cette question de l’amour, de la dignité, de l’attention qu’on porte aux choses. Ces cadenas représentent un amour normé qui s’exprime au travers de ces objets ; les politiques culturelles publiques désignent quelles pièces, quels monuments, quels bâtiments sont dignes d’amour, donc de préservation.
Le Défenseur du Temps renaît après avoir été « mal aimé » et oublié. Tout ceci évoque la question de la restauration : la restauration matérielle semble procéder de la restauration spirituelle et affective.
CG : Les cadenas évoquent l’amour générique et parlent en effet de l’amour normalisé. Pour Le Défenseur du Temps, il s’agissait aussi de faire une œuvre qui ne s’ajoute pas à la longue liste d’objets qui ensevelissent notre monde, tels ces cadenas. Le geste de réanimation du Défenseur est profondément immatériel.
J’ai toujours aimé les œuvres d’art qui ont une économie de moyens. Il faut travailler avec ce qui nous entoure…
RL-V : C’est aussi le parti pris de Tino Sehgal, qui a eu une « carte blanche » au Palais de Tokyo en 2016 et considère que l’œuvre d’art peut s’incarner dans une rencontre, qu’il est possible de ne produire que des objets immatériels et d’en faire une exposition. Il n’est pas fou de penser que ce qui fait œuvre va profondément changer dans les prochaines années et décennies, et que le culte de l’objet ainsi que le rituel de l’exposition vont évoluer, voire – ce n’est pas impossible – disparaître. Ils racontent notre culture et notre rapport au vivant, qui sont en train de se modifier profondément. La relation au monde que tu écris avec Le Défenseur du Temps sort du culte de la permanence et de l’auteur ; il s’agit plutôt de lui redonner une dignité et une intensité nouvelles, de renouveler les affects à son endroit. L’immatériel et ses qualités reviennent beaucoup dans le projet, notamment au moyen du son et de la musique, qui sont fondamentaux dans ton travail.
CG : Avec Le Défenseur du Temps, c’est la première fois que je réalise une bande-son pour une sculpture. Je pense généralement le son en lien avec mes films, et mes choix musicaux relèvent de considérations conceptuelles vis-à-vis du sujet. J’essaie de me soustraire à l’équation et de réfléchir au son que ce fossile, cet arbre ou ce feu d’artifice aimerait entendre – tout comme il faut demander à la brique ce qu’elle veut devenir avant de construire un bâtiment, comme le disait Louis Kahn.
Dans Ocean II Ocean, j’en suis rapidement venu au steel drum. À Trinité-et-Tobago, il existait plusieurs raffineries dans les années 1940. De larges bidons d’essence étaient donc facilement disponibles. Ellie Mannette fut le premier à accorder ce contenant de combustible fossile vide. On associe souvent le son de cet instrument au calypso, un style de musique dansante de carnaval. Je l’associe plutôt à un son industriel lié au forage en mer, avec ces notes pleines de réverbération qui émanent
14 15
Tombe d’Oscar Wilde au cimetière du Père-Lachaise (réalisée par Jacob Epstein en 1914)
d’une carcasse de métal. C’est en cela que je vois en ce bidon d’essence vide un son prophétique. Près d’un siècle plus tard, sa résonance semble de plus en plus se rapprocher de nous, comme un écho joué à l’envers. Le carnaval est fini.
Pour Le Défenseur du Temps, j’ai cherché à évoquer l’origine de mon projet, une date, 2003, l’année de sa mise en arrêt. Comment évoquer ce passé proche à une audience ? Il m’a semblé juste de convoquer certains morceaux de musique qui ont été écoutés par le plus grand nombre à l’époque. J’ai donc commencé à sampler les hits de cette même année.
RL-V : Ces musiques sont comparables à l’amiante, non ? Elles contaminent, s’immiscent dans les mémoires, font un assaut des psychés.
CG : Oui, elles sont indélogeables de nos mémoires et nous renvoient à une période spécifique. Je voulais amener l’idée d’une musique dure, qui n’est pas séduisante, d’une musique agressive. C’est un choix plus expérimental grâce auquel je sais dès le départ que le son n’aura pas le rôle immersif qu’il peut avoir dans mes films. La bande-son oscille entre l‘idée de corrosion avec la partie « Hit », et celle de réparation avec « Heal ».
RL-V : La partie « Heal » est celle d’une musique spirituelle traversée par la recherche de l’harmonie et du pouvoir guérisseur du son porté par la composition de Laraaji.
CG : Oui, la guérison, c’est la musique new age, l’ambient, parfois considérée comme « musique d’ascenseur », mais l’ascenseur, c’est aussi un interstice, un espace public qui oscille entre le niveau de la terre et le ciel, et le son de Laraaji est définitivement céleste. Sa musique connaît depuis quelques années un nouvel engouement, même s’il travaillait déjà avec Brian Eno dans les années 1980, et il me semble qu’il y a en général un nouvel intérêt pour l’ambient. C’est une musique poreuse, tu n’entends jamais deux fois le même titre, car ce genre musical laisse les sons de l’extérieur s’y mêler – une sirène, des rires d’enfants ou le son de l’air conditionné. C’est une musique inclusive, sans barrière sonique, ouverte sur le monde, qui s’intéresse au bien commun, à la rue, aux parcs, à l’espace public.
À la fin des années 1970, Laraaji jouait à Washington Square Park, un parc bruyant de New York. Sa musique s’inscrit dans la ville comme une nappe musicale, une sous-couche d’abord à peine discernable, puis qui se révèle doucement telle une apparition. Nous nous sommes d’ailleurs rencontrés par hasard dans un espace public l’hiver dernier sur la 125e Rue, à Harlem. Deux jours plus tard, on s’est retrouvés au sommet de Marcus Garvey Park. On a peu parlé de musique et d’art, mais surtout d’expériences psychédéliques, de la possibilité d’une transcendance de la vision binaire du monde, d’éroder certaines barrières perçues entre ancien et nouveau, nature et culture, ici et ailleurs. Il a de grandes capacités à penser le monde de manière holistique. Un mois plus tard, nous étions ensemble en studio d’enregistrement. Il a joué sur deux cithares, qu’il avait lui-même électrifiées, ainsi que sur un mbira. J’ai ensuite monté cet enregistrement avec quatre morceaux qui émanent de
l’automate entre chacun de ses combats. La bande sonore de Laraaji alterne avec quatre remixes de divers tubes, datant de 2003 et du début des années 2000, que j’ai réalisés avec Joe Williams. J’ai aussi travaillé avec Nicolas Becker – un grand collectionneur d’enregistrements de silence, qui comprend bien l’importance de l’espace entre les notes – pour mettre en espace la bande-son dans l’exposition.
Nous avions l’idée d’augmenter l’automate en y installant un sound system.

Lors de sa restauration, nous lui avons aussi greffé quatre transducteurs et quelques microcontacts pour amplifier le son de ses mouvements.
RL-V : Le thème du débordement et de la perte de contrôle apparaît dans l’exposition à plusieurs moments : Le Défenseur du Temps et sa lente déchéance, les dessins de Smithson avec l’expression d’une implosion intérieure, et le débordement dans l’espace public avec les perruches considérées comme invasives, présentes dans l’œuvre Formation. L’idée de vomissement est aussi centrale, en contrepoint du motif de l’avalement de l’amiante et de la musique qui contamine l’esprit.
CG : Rien n’est figé. S’il y a partout dans Paris des exemples de « ravalements » de façade, alors il peut aussi y en avoir de « vomissements » de façade. Il faut juste en trouver des exemples, qui sont assez rares. C’est le cas des anciennes gargouilles de la cathédrale de Reims présentées au Palais de Tokyo. Il y a eu un incendie en 1914 à la suite de la chute d’un obus sur la cathédrale, incendie qui a été nourri, non sans ironie, par l’embrasement d’un échafaudage en bois ceinturant la tour nord de l’église. La charpente a ensuite pris feu, faisant fondre la toiture de plomb qui a doucement jailli par la bouche des gargouilles. En un sens, c’est un objet sans auteur qui porte à la fois les traces d’une première intention – la restauration de la cathédrale par Viollet-le-Duc à la fin du 19e siècle avec création de ces gargouilles –et les traces de la Première Guerre mondiale matérialisée par cette coulée de plomb. L’enchevêtrement de ces deux intentions opposées – restaurer et détruire –, visible dans le même objet, est plastiquement extrêmement puissant.
Mon idée est de montrer ces fragments à nouveau et de les sortir d’un contexte qui est seulement historique. Je souhaite restaurer leur potentiel sculptural en leur donnant un nouvel espace, avec un nouveau système d’accrochage, pensé par mes soins, qui permet de centrer notre regard sur ce vomissement à la fois figé dans le temps et lévitant dans l’espace.


Gargouille crachant du plomb de la cathédrale de Reims, telle que montrée au Palais du Tau, Reims, 2022
L’idée n’était pas de les dissocier de leur contexte premier, mais plutôt de penser, le temps d’une exposition, une alternative à la culture officielle de la mémoire… Je ne suis pas historien, j’ai un rapport plus psychédélique à l’Histoire. L’Histoire est une matière malléable avec laquelle on peut expérimenter, c’est un cas du passé au présent. Un siècle plus tard, cette régurgitation du patrimoine nous dit peut-être autre chose : peut-être nous invite-t-elle aussi à pratiquer une forme de sevrage, comme le vomissement nécessaire au début d’une cérémonie du peyotl ?
Je perçois aussi ce voyage psychédélique dans les dessins de jeunesse de Robert Smithson, où le langage devient un motif de cette hallucination, où les mots se répètent et semblent incapables de décrire certaines visions.
Gargouille
16 17
Laraaji enregistrant en studio « Heal », la bande-son du Défenseur du Temps, 2022
crachant du plomb avec son nouveau dispositif d’installation, vue d’exposition au Palais de Tokyo (HUMPTY), 2022
L’héritage de Smithson m’évoque surtout un artiste « post-studio ». Pour moi, l’espace intérieur de l’atelier a toujours été une source d’anxiété. En vingt ans de pratique artistique, je n’ai jamais eu une seule idée dans un espace fermé, ce n’est pas un lieu propice à la création. Et je pense que pour Smithson aussi, cette idée de quitter l’espace de l’atelier est centrale : c’est en s’alignant sur le flux de la ville, de l’espace commun, du paysage qu’il a trouvé une forme de transcendance de cette anxiété dont ces premiers dessins témoignent.
RL-V : Dans une lettre adressée à son galeriste George Lester à Rome en 1961, il écrit : « La souffrance a contaminé tout mon système nerveux1. » C’est ce désordre intérieur qui semble le pousser à aller regarder ce qui habite l’ailleurs, l’espace extérieur.
CG : Parmi la sélection des dessins présentés, il y a une œuvre qui est un peu plus tardive que les autres et semble représenter un chemin émergeant d’un gouffre. Ce dessin (First Drawing for a Shrine in an Abandoned Quarry in Montclair N.J.), une composition pour la réhabilitation d’une carrière à ciel ouvert, est un projet non réalisé. Smithson souhaitait y ériger un temple. Ici, on retrouve déjà ses considérations pour le sédiment, la sédimentation des corps, pour une temporalité géologique, la fossilisation du monde et l’épuisement de notre société occidentale. Dans un autre dessin, Disease, apparaît une scène alcoolisée. On dirait une fête païenne du type Oktoberfest, avec des clowns, la décadence, le mot « cancer » au centre… Ces dessins ne correspondent pas à l’idée qu’on a de Smithson. Certains n’ont jamais été exposés et sont sortis pour la première fois des archives. D’ailleurs, aucun d’eux n’avait été encadré. J’ai donc pensé une vitrine pour les inclure et, en la dessinant, il m’est apparu la possibilité d’intégrer un élément nouveau spécifique à notre temps, un « non-site » ancré dans le 21e siècle. Entre chaque dessin, j’ai placé un fragment d’amiante vitrifié, aussi appelé « amiante inerte ». C’est un peu la fin d’un cycle pour ce minerai, qui a d’abord été extrait de la terre, introduit dans un grand nombre de matériaux de construction, eux-mêmes introduits dans l’espace bâti et finalement retirés lors de chantiers de désamiantage… La trajectoire actuelle de ce cristal fibreux est un retour à la terre dans des centres d’enfouissement de déchets d’amiante. La France en compte une douzaine aujourd’hui.
Comment intervenir sur cette boucle ? Comment modifier le parcours de ce cristal pour lui donner un nouveau destin, une nouvelle vie, et le réintégrer à un cycle proche du motif de la spirale, si central pour Smithson ?
Cette possibilité d’une renaissance, je l’ai trouvée chez Inertam, cette usine des Landes unique en Europe qui, à l’aide de torches de plasma capables de chauffer à 1 600 degrés, transforme les déchets d’amiante en un verre d’un noir profond, telle l’obsidienne, que l’entreprise dénomme Cofalit. Ce sont ces mêmes fragments d’amiante vitrifié que l’on retrouve dans la vitrine sous forme de presse-papiers pour ces dessins entropiques.
RL-V : William Blake disait que le rôle de l’artiste est d’ouvrir les portes de la perception. Avec la vidéo Formation, tu ouvres littéralement une porte sur une perspective qui nous était jusque-là interdite. Tu renouvelles notre manière d’envisager les êtres, en l’occurrence des perruches considérées comme invasives. Notre manière de dire, de fabriquer et de représenter le monde des oiseaux, et particulièrement celui des perruches, ne te convenait pas ?
CG : Il y a quelques années, j’ai voulu recentrer mon regard sur quelque chose de petit en ville. J’ai commencé à développer un intérêt pour les oiseaux à New York. C’est un endroit assez privilégié pour les voir en temps de migration, car ils s’arrêtent dans Central Park pour faire étape. J’ai passé du temps à regarder ces oiseaux à travers mes jumelles, ainsi que cette communauté d’ornithologues professionnels et amateurs qui créent des collections immatérielles d’oiseaux vus. Pour eux, voir est suffisant pour créer une collection. L’idée de la mémoire comme lieu de collection me semble très juste. Cependant, leur manière d’appréhender l’oiseau est académique et toujours directement liée à son identification (mâle, femelle, juvénile, migrateur ou pas, etc.). Ils le font souvent à l’aide d’applications
qui reconnaissent le son des oiseaux et qui imitent même leur cri pour qu’ils s’approchent. Ils ont un œil sur l’oiseau et l’autre sur le téléphone. À Central Park, on trouve aussi l’étourneau, un oiseau non natif introduit par Eugene Schieffelin, un fan de Shakespeare qui voulait s’entourer des oiseaux d’Hamlet ; l’oiseau est partout dans le parc maintenant. Les bird watchers s’intéressent aux questions écologiques et considèrent souvent ces animaux introduits par l’homme comme une nuisance. Cette hiérarchie dans la nature, projetée par l’homme, m’a interpellé… L’une des espèces introduites, et qui est de plus en plus répandue en Europe, est la perruche à collier indienne, native du sud de l’Inde. On peut la voir dans un grand nombre de parcs européens, comme aux Kew Gardens à Londres, devant le Prado à Madrid, au jardin du Luxembourg à Paris ou encore à Düsseldorf, lieu de tournage de Formation. Cet oiseau a une double identité : il est considéré comme une nuisance par certains, car perturbateur d’un écosystème en place, mais il est aussi admiré par d’autres parce qu’il illustre une forme de liberté retrouvée car il est issu d’une lignée d’oiseaux domestiqués. Leur origine et la manière dont ils se sont échappés de leur cage sont souvent mystérieuses ou relèvent de légendes urbaines…
RL-V : La légende à Londres veut que Jimi Hendrix ait relâché un couple de perruches au milieu de Carnaby Street. D’autres histoires parlent de perruches échappées lors du tournage du film La Reine africaine (The African Queen, John Huston, 1951). Les hypothèses expliquant la raison de leur arrivée sont très liées à notre représentation autour du « sauvage » et du geste incontrôlé ou anarchique, du désordre.
CG : Oui, je connais cette légende de Jimi Hendrix sous acide qui libère ses perruches de leur cage. Ces nuées d’oiseaux psychédéliques sont les acteurs d’une forme de débordement du monde de la fiction vers le réel, échappés d’un film ou d’un livre –tels ces étourneaux de Central Park. Les premiers témoignages de perruches vues à Düsseldorf datent de 1982. Elles se seraient échappées d’un élevage d’oiseaux exotiques à cette époque. D’ailleurs, cette espèce de perruches n’a plus sa place aujourd’hui dans les oiselleries d’Europe : elle est désormais considérée comme trop commune du fait de l’avancée des croisements biologiques depuis les années 1980.
Comme la perruche à collier indienne est un oiseau tropical dépourvu d’instinct migratoire, elle reste dans les rues et les parcs de Düsseldorf, ne trouvant de légitimité ni en liberté ni en captivité. L’espace interstitiel de la Königsallee –grande rue de boutiques de luxe bordée de platanes de cette grande ville de la Ruhr – est donc aussi leur « biocorridor » : les perruches s’y engouffrent toute l’année aux dernières lueurs du jour.

Je vois en ces êtres une résilience admirable. Dans les documentaires animaliers, ces oiseaux n’apparaissent pourtant que dans leur habitat originel, une nature vierge et intacte. À Düsseldorf, ils ont un terrain vierge à investir, un nouvel interstice. J’ai donc pensé les filmer avec les mêmes codes que ces documentaires animaliers, avec une longue focale au ralenti, et surtout filmer leur vol en contreplongée pour admirer leur plumage sans contre-jour.
Quand il pleut, comme dans mon film, ils volent assez haut, passant devant les bâtiments de la Königsallee, certains d’avant-guerre et d’autres plus récents, comme le Kö-Bogen de Daniel Libeskind qui me rappelle le siège social de Rheinmetall, également à Düsseldorf. Rheinmetall est l’un des plus grands producteurs d’armes
18 19
Perruche à collier, Rome, 2019
1 : Robert Smithson à George B. Lester, 1er mai 1961, Lettres de Smithson à George B. Lester. Archives of American Art, Smithsonian Institution, Washington D.C.
en Allemagne, qui opère dans la région depuis la fin du 19e siècle. Historiquement, la Ruhr était le centre de l’industrie de l’armement et c’est aussi pour cette raison que Düsseldorf a été gravement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Le survol de la Königsallee par ces perruches indiennes au crépuscule m’a tout de suite fait penser à une formation militaire. C’est un peu l’ironie de l’histoire, ici, que d’avoir cet oiseau tropical, cet oiseau autre, qui s’empare de la ville, prenant peu à peu le dessus sur l’oiseau allemand, générant une forme de colonialisme à l’envers.

RL-V : Tu parles de la libération de ces oiseaux, qui amène à la question de la domestication du sauvage. Le sujet de la libération est aussi évoqué avec la sculpture en bronze de Käthe Kollwitz, Mutter mit zwei Kindern, qui fait face à Formation, et que tu as voulu sortir de son contexte de présentation devant le musée Käthe Kollwitz à Berlin.


CG : Cette œuvre était placée sur un bout de pelouse, coincée entre la grille d’entrée du musée et les grilles des fenêtres du rez-de-chaussée, avec une pile de briques sans joint en guise de piédestal, rappelant d’ailleurs le mur d’où tombe Humpty Dumpty. M’est alors apparue la responsabilité de sortir cette œuvre de ce contexte, de la libérer de sa condition, car il m’était très difficile de la voir dans cette situation à Berlin. J’avais l’idée de montrer dans la grande verrière du Palais de Tokyo une sculpture qui évoque le monde extérieur, en dialogue avec mon film, Formation, en arrière-plan, qui serait comme un nouveau décor dont elle serait la figure centrale. Käthe Kollwitz a fini le plâtre en 1936 et elle est morte en 1945 avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Comme sa pietà à la Neue Wache, symbole de la réunification, cette œuvre a été coulée en bronze à titre posthume.
RL-V : L’idée du sort de l’histoire et de la renaissance présente chez Kollwitz se cristallise aussi au travers de ton installation L’Ange du foyer (Vierte Fassung). Cet hologramme, une forme fantomatique qui apparaît et disparaît en fonction de notre position dans l’espace, est inspiré d’une œuvre de Max Ernst (Der Hausangel, 1937). C’est aussi l’évocation d’un certain rapport au temps qui, comme chez Smithson d’ailleurs, prend la forme d’une spirale. Cette vision d’un temps cyclique s’oppose au tracé linéaire vers le progrès ou vers une forme triomphante de l’histoire souvent prônée en Occident.
CG : L’idée était de continuer le mouvement du monstre de Max Ernst qui, dans la peinture originale, est figé dans l’air, cet ange qui, une fois encore, a une double identité, une identité ambiguë. Le titre de l’ange est surprenant, car ce personnage évoque plutôt un monstre et on l’associe à la montée du fascisme en Europe. À l’instar des perruches indiennes de Formation, il est monstre et ange. Dans le tableau d’Ernst, il existe un espace vide à hauteur du ventre du personnage, sans information, qui est dans l’ombre des lambeaux de ses vêtements j’y ai vu un intervalle à investir pour l’animer… L’animation de l’ange qui se dévore lui-même a également été pensée en relation aux formes du ventilateur holographique sur lequel L’Ange du foyer allait surgir. Ses hélices, sur lesquelles sont placées des
ampoules micro-LED, tournent à une vitesse que l’œil ne perçoit pas. Le résultat est comme une apparition. Ces ampoules n’étant situées que d’un seul côté des hélices, j’ai décidé de les tourner vers le fond de la salle : ainsi, le public ne découvre l’œuvre que depuis la seconde moitié de la salle. Un certain nombre de personnes semblent donc regarder dans le vide, l’animation ne pouvant être perçue depuis l’entrée de la salle. C’est une œuvre à mi-chemin entre une sculpture et une image en mouvement. Je l’ai d’ailleurs accrochée comme une sculpture. Elle n’est pas alignée avec nos yeux comme une vidéo, mais installée dans une position plus viscérale : elle s’aligne avec nos estomacs. Mon désir d’animer un motif figé se retrouve aussi dans le film Ocean II Ocean Les fossiles incrustés dans les murs des stations de métro staliniennes proviennent de carrières éloignées de Moscou, situées dans l’Oural, la Crimée ou encore le Caucase, ils agissent comme un vortex spatio-temporel qui nous ramène aussi à un temps géologique éloigné. Ces ammonites renvoient à un temps bien plus vaste que l’histoire du communisme. Un autre vortex est présent dans la scène de la chasse d’eau, tournée dans une toilette publique à New York d’abord apparaît une image abstraite ressemblant à un wormhole, puis un dézoom révèle la cuvette des toilettes. Au-delà d’évoquer l’idée d’un temps cyclique, cette scène permet aussi de libérer concrètement ce film du temps linéaire de la projection cinématographique… Mon film est une boucle, sans début et sans fin, sans fracture de son et d’image, où le métro devient un vaisseau qui navigue cette fois dans le temps, faisant des allers-retours entre l’océan Atlantique et l’océan primitif dont sont issus ces fossiles. Cela me rappelle cet exercice pratique dans les écoles primaires, quand on demande à un élève de dérouler un rouleau de mille feuilles de papier toilette dans son intégralité pour représenter à la classe la longueur de notre temps géologique, pour ensuite lui indiquer que l’apparition de l’humain sur Terre se trouve quelque part dans le dernier centimètre de la dernière feuille. Pour en revenir à l’exposition et à son évocation de différentes échelles de temps, je repense à la contribution de Daniel Turner, qui a utilisé les câbles aujourd’hui disparus du premier ascenseur de la tour Eiffel pour produire son œuvre. Sa sculpture, réalisée dans un effort de réduction absolue à travers la transformation de ces éléments en poussière, illustre parfaitement une métaphore apparue dans un essai de Mark Twain en 1903.
Plus d’un siècle sépare ces deux artistes américains portant leur regard sur la tour Eiffel. L’un la regarde dans sa fragmentation, l’autre dans son entièreté, l’un pour évoquer le présent, l’autre pour se représenter l’âge du monde.
« Voilà l’histoire. L’homme est ici depuis trente-deux mille ans. Qu’il ait fallu préparer pendant cent millions d’années le monde pour lui est la preuve que c’était bien le but. Je suppose. Chais pas. Si la tour Eiffel représentait l’âge du monde, la couche de peinture sur le mamelon du sommet représenterait la part de l’homme à l’échelle de cet âge et n’importe qui verrait que cette couche était ce pour quoi cette tour a été construite. J’imagine, chais pas2. » Mark Twain
20 21
Vue de Mutter mit zwei Kindern (1932–1936) de Käthe Kollwitz installée devant le musée Käthe Kollwitz à Berlin, 2022
2 Mark Twain, Cette Maudite Race humaine, trad. Jörn Cambreleng et Isis Von plato, Paris, Actes Sud, 2018, p. 23.
Tournage de Ocean II Ocean, Astoria, New York City, 2019
Käthe Kollwitz, graphiste, peintre et sculptrice dans son atelier à Berlin, 1935
J’attends au café, comme toujours en avance de plusieurs minutes. L’anxiété sans doute, ou le sentiment tenace d’un retard irrémédiable sur le temps. Un vent froid d’automne s’engouffre dans le quartier de l’Horloge. Nous sommes dans un espace flottant où il ne se passe pas grand-chose, un non-lieu pris entre des boutiques de photocopies, le Centre Pompidou, le musée des Arts et Métiers. Me suis-je jamais arrêté ici, dans cette espèce de coude temporel, ce repli à peine visible, banal, comme la grande ville moderne en produit tant, ou plutôt en rejette dans ses marges ? Ou n’ai-je fait, comme tout le monde, que passer là sans m’attarder ?
Dans son Livre des passages, Walter Benjamin décrivait la poésie particulière des galeries parisiennes du 19e siècle. Il y décelait une transposition du cadre bourgeois, avec ses bibliothèques, ses tableaux, ses enluminures, vers l’espace du dehors ; un dehors abrité par des architectures modernes de verre et de fer, espaces fermés la nuit par des grilles, appréciés le jour par le flâneur, le rêveur, le dandy, l’esthète qui herborise sur le bitume, dirait Baudelaire. Je regarde autour de moi. Tout est gris, neutre, un peu sale ou d’une propreté suspecte. Les temps ont bien changé. À quelques mètres de là, Gordon Matta-Clark réalise Conical Intersect en 1975. Lors de la transformation du secteur Beaubourg, il crée dans un bâtiment vétuste une fenêtre ronde en œil-de-bœuf, un vide dans le plein, résultat de découpes dans l’épaisseur des solives et des murs. C’est une veduta classique provisoire dans un immeuble voué à la destruction, une œuvre d’« anarchitecture », terme qu’il utilisait pour désigner ses interventions sur des sites urbains dont il déstabilisait la mythologie, celle de la maison et de l’enclosure capitaliste. Matta-Clark rêvait également de trouver des « lieux oubliés, enfouis sous la ville, qu’il s’agisse de zones historiques ou des traces subsistantes de projets et de fantaisies perdues […]. Il s’agirait de faire sortir l’art des galeries et de le conduire dans les égouts1. » Le contraire est sans doute vrai ; je vais m’en rendre compte.
LE DÉFENSEUR DU TEMPS
Cyprien Gaillard arrive à vélo, puis nous commençons à discuter des deux expositions simultanées à Lafayette Anticipations et au Palais de Tokyo, en 2022. Il m’a donné un rendez-vous stratégique en ce point précis. J’en mesurerai plus tard toute la portée. Chacune de ces expositions semble dotée d’une dimension commémorative, disons mémorielle : hommage à un ami mort d’overdose qui fréquentait ce quartier, hommage détourné à l’automate du quartier de l’Horloge. Au Palais de Tokyo, présence du dessin de Giorgio de Chirico, Oreste e Pilade ; dialogue avec une peinture de Max Ernst traduite en hologramme ; série déroutante de dessins de Robert Smithson grouillant de monstres, d’anges exterminateurs, de scènes de sacrifice.
Le titre de ces deux expositions, HUMPTY \ DUMPTY, semble malicieusement emprunté à une ancienne comptine. Il m’en récite les vers en anglais. En rentrant, j’en retrouverai la traduction.
« Humpty Dumpty était assis sur un mur, Humpty Dumpty tomba de haut sur le sol dur, Tous les chevaux du roi, tous les soldats du roi N’ont pu relever Humpty et le remettre droit. »
Puis la discussion glisse sur l’œuvre de Robert Smithson, qui évoque lors d’un entretien tardif la présence de cette comptine dans le roman À travers le miroir de Lewis Carroll. Smithson y décèle un exemple type d’entropie – déclin irréversible de l’énergie au cœur de son travail. Comment montrer la chute sans drame, tel un fait banal, le lent écroulement de chaque chose, le chaos résultant du productivisme, sans emphase sublime ? Pas étonnant que parmi les modèles entropiques, Smithson
23
Olivier Schefer
Création de Gordon Matta-Clark, Conical Intersect 1975, au 27/29 rue Beaubourg, Paris, aujourd’hui quartier de l’Horloge.

cite des supermarchés, des terrains vagues, des chantiers à l’abandon ou à l’arrêt. Ces espaces, tout comme la mémoire, sont à la fois remplis et vides. Combien de fois me suis-je arrêté dans une allée de supermarché sans me souvenir de ce que j’étais venu y chercher ?
Je crois comprendre ce qui fait de ces futures expositions l’écho entêtant des enquêtes « smithsonniennes ». Plus qu’un simple goût pour la poétique des ruines, le geste artistique est chez lui intrinsèquement politique. Il concerne la cité et sa vie, ses désordres, ses multiples failles. Il est question de décrire, de topographier, de s’attarder dans les angles morts de l’histoire contemporaine, de montrer, faire entendre, mais aussi de sentir – littéralement – ce qu’on cherche à maquiller, à embellir, à effacer. Faire œuvre avec l’entropie, c’est faire mémoire des ruines jetées en vrac par le progrès. Et cette mémoire saisit concrètement les matériaux dont est constitué le temps moderne : tôles, laiton, pièces métalliques, fibres d’amiante. Elle les recueille, les reprend, les combine, les modifie aussi. Je me rappelle soudain que Smithson, avec un sens incomparable de l’ironie, comparait Rome à un « grand tas de ferraille d’antiquités2 ».
Au cours d’un autre rendez-vous, il me montre sur son téléphone portable des images d’échafaudages et de chantiers qu’il a prises un peu partout. On croirait des structures infinies de Piranèse, la série des prisons imaginaires. Des escaliers qui ne mènent nulle part, des passerelles, des cordages suspendus dans le vide. On ne sait plus si les échafaudages, censés permettre la conservation et la transformation d’un bâtiment existant, ne deviennent pas eux-mêmes de nouveaux monuments.
qui aurait pu figurer dans un centre d’art moderne ou un musée d’horlogerie, avait été condamnée par quelque étrange malédiction à occuper une zone floue, derrière Beaubourg, à quelques pas des Arts et Métiers. Une marge en plein centre.
1 : Gordon Matta-Clark, Entretiens, trad. Raphaëlle Brin, Paris, Éditions Lutanie, 2011, pp. 80–81.
2 Robert Smithson, « Entropy made visible » (1973), entretien avec Alison Sky, in Robert Smithson. The Collected Writings (éd. Jack Flam), Berkeley et Los Angeles, University of California Press, 1996, p. 304.
3 Robert Smithson, « Une visite des monuments de Passaic, New Jersey (1967) », in Art et science-fiction la Ballard Connection (éd. Valérie Mavridorakis), Genève, Mamco, 2011, pp. 207–215.
4 Charles Baudelaire, « L’Horloge », in Les Fleurs du mal, Paris, Gallimard, collection « Bibliothèque de la Pléiade », tome I, 1975, p. 81.
L’automate regorge d’astuces, comme ces ronds implantés sur le crâne du défenseur censés envoyer au moyen de piques des décharges électriques aux pigeons. Un personnage frêle – presque adolescent – armé d’un bouclier et d’une épée se dresse sur une roche en laiton oxydé. Les autres figures, comme le défenseur, sont en laiton martelé et doré à la feuille. Je regarde plus attentivement Le Défenseur du Temps qui, à cette hauteur, semble nous dominer. Quel temps défend-il et contre quoi lutte-t-il exactement ? La nature représentée par ces animaux ? Le hasard qui frappe çà et là ? Je repense à ce poème de Baudelaire :
« Horloge ! dieu sinistre, effrayant, impassible, Dont le doigt nous menace et nous dit : Souviens-toi ! Les vibrantes Douleurs dans ton cœur plein d’effroi Se planteront bientôt comme dans une cible4 […] »
Le défenseur de Monestier a les yeux vides d’un cadavre. Le soir même, je regarde une vidéo sur Internet qui présente Monestier, à l’allure de jeune séminariste, en train d’agencer les éléments de son automate, mis en branle par un système mécanique digne d’une nouvelle d’Edgar Allan Poe. Le défenseur lève et abat son glaive pour « défendre » le temps – un globe terrestre entouré d’aiguilles – contre les assauts intermittents d’animaux symboliques associés à un élément naturel : un crabe venu de l’eau, un coq terrestre aux pattes menaçantes, un dragon d’air et de feu battant de la queue. On dirait le bricolage étrange d’un artiste brut ou la machine d’un facteur Cheval de science-fiction. À chaque heure, l’automate se bat avec des gestes simplifiés, presque schématiques, contre une des trois figures de manière aléatoire. Quand celles-ci s’animent, on entend sortir d’une enceinte dissimulée le bruit de l’élément auquel elles sont associées. Puis, sur fond de gong, le défenseur se démène seul contre les trois animaux à midi, 18 heures et 22 heures. Il y a dans tout cela quelque chose d’à la fois solennel et dérisoire. Presque une vanité.
Et puis il y a Passaic dans le New Jersey. J’y suis retourné quarante ans après Robert Smithson. Je lui raconte – alors que nous ne nous connaissons pas – ce voyage bizarre, sans éclat, dans un lieu ordinaire que l’artiste américain décrivait tel un décor de carton-pâte pour amateurs de séries B. Encore une zone d’oubli dont un « monument », un vaste parking coupant la ville, reflétait les deux moitiés. « Le miroir intervertissait sans cesse sa place avec le reflet. On ne savait jamais de quel côté du miroir l’on se trouvait3. » Il en va ainsi de ces deux expositions qui, à ce que j’en comprends, sont peut-être une seule et même exposition coupée en deux fragments, reliés bien qu’irréconciliables.
Soudain, il me montre le mur d’en face. Je lève les yeux. Des pigeons tournoient et se posent sur une sculpture en relief assez grande, plantée sur un mur d’immeuble. On se lève. Il y a une plaque en dessous : « Le Défenseur du Temps, œuvre de Jacques Monestier ». Un automate commandé par la société Cogedim et inauguré par le maire de Paris de l’époque, Jacques Chirac, en 1979. Le Défenseur du Temps ne fonctionne plus. Cette pièce est une drôle de machinerie qui défie (ou ignore) le bon goût moderne. L’ai-je jamais vue en marche ? Peut-être que oui, mais bizarrement, aucun souvenir ne m’en reste. Tout se passe comme si cette œuvre,
Je commande un autre café. Des assistants et un photographe arrivent. Cyprien Gaillard me fait comprendre qu’il va inverser les choses, les affoler aussi. Avant d’être réinstallé sur le site en état de marche, l’automate doit être remonté et conservé avec les fientes de pigeon ainsi que la saleté qui s’y sont accumulées au fil du temps. C’est un revenant d’entre les morts qui porte les marques de l’usure. Aloïs Riegl dans Le Culte moderne des monuments (1903) et Cesare Brandi avec sa Théorie de la restauration (1963) ont réfléchi à ce problème épineux : faut-il restaurer un monument ou un artefact tel qu’il était à l’origine, ou conserver les signes du temps écoulé et de la dégradation qui en écrivent l’histoire ? Lui entend œuvrer à rebours de la logique du progrès pour laquelle la restauration est synonyme de négation, d’effacement des traces.
Autre particularité de sa résurrection de l’automate de Monestier, le défenseur se bat seul contre tous, la tête agitée d’un léger mouvement latéral, comme une machine qui n’arrive pas tout à fait à redémarrer (je pense au Terminator déglingué, avec l’œil qui pend et la tête secouée de soubresauts). L’horloge, elle, tournera à l’envers, comme pour remonter le temps écoulé depuis sa panne en 2003.
24 25
En l’écoutant, je repense à ce roman d’anticipation de Brian Aldiss paru en 1966, Cryptozoïque, dans lequel les protagonistes remontent la pente de l’entropie : le temps s’y écoule à rebours, le futur redevient une préhistoire chaotique où les espèces s’entremêlent dans un combat primitif. Je songe aussi à une nouvelle de Nabokov intitulée « Lance ». Selon l’écrivain, la meilleure idée d’un temps éloigné, incommensurable avec le nôtre, nous est offerte par les vieux costumes, les habits démodés, « un je-ne-sais-quoi de chiffonné, de négligé, de poussiéreux ».
« Le futur n’est que l’obsolète à l’envers5 », écrit-il.
Nous prenons rendez-vous pour le mois suivant. Nous voici près de Besançon, à Mamirolle, chez Prêtre et Fils. Chargé de la restauration de l’œuvre de Monestier, le responsable de l’atelier d’horlogerie nous apprend que les ouvriers ont retiré pas moins de trois cents kilos de fientes de pigeon accumulées sur l’ensemble de la pièce depuis son installation.
Cyprien Gaillard me montre une vidéo sur son téléphone. Dans le secteur du quartier de l’Horloge sévissait celui qu’on appelait l’« homme aux pigeons », Giuseppe Belvedere, figure errante et inclassable de la ville moderne qui vivait dans une estafette recouverte de tags. Clochard, poète urbain, il se définissait lui-même comme le bienfaiteur d’une espèce honnie et pourchassée. Il nourrissait des nuées de pigeons près de la piazza et aux alentours du Centre Pompidou.
Le Défenseur du Temps est complètement démantelé. Les pièces sont disposées un peu partout sur des tables et au sol. Je suis frappé par les systèmes de ressorts, les nombreux branchements, le « cerveau » du mécanisme plusieurs boîtiers en charge des mouvements ont une forme de grille-pain. J’assiste aux essais de l’équipe : branchements de transducteurs sur des pièces en laiton. Tests sonores avec une composition originale de Laraaji, cithariste afro-américain qui a d’abord joué ses pièces ambient et méditatives en plein air, en dehors de tout système de production, notamment à Washington Square Park où Brian Eno l’a repéré. Sa musique se veut apaisante, restauratrice, healing. Encore une affaire de restauration.
Puis passent des bribes déformées de tubes des années 2000 : 50 Cent (« In Da Club »), Gnarls Barkley (« Crazy »), etc. Le métal sonne et crisse, il crie parfois, comme l’intérieur d’une cloche. Je me rends compte que cet ensemble automatisé repris et modifié devient une œuvre sonore hantée par des voix souterraines. L’automate semble vibrer du tréfonds de lui-même et faire remonter un temps perdu – l’intervalle entre la première moitié des années 2000 et sa mort, cette panne mystérieuse survenue en 2003. Une rumeur avait alors circulé : on s’était demandé si Monestier, seul en charge du maintien de son œuvre, n’avait pas pour une obscure raison introduit un défaut dans la mécanique. Voulait-il lui aussi arrêter quelque chose du temps des ruines ?
Le problème de la (non-)restauration de l’automate et de ses éléments semble être une mise en abîme du travail d’artiste de Cyprien Gaillard. On pourrait dire qu’il se saisit de morceaux défaits, abandonnés, sans en trahir la mémoire et en les inscrivant dans le temps présent. Dans un autre entrepôt, je vois au sol des plaques de métal rongées par la rouille qui rappellent des œuvres d’Anselm Kiefer, mais c’est trop dire sans doute. Certaines pièces seront présentées telles quelles. Par terre, des bouts d’aiguilles brisées, un amplificateur hors d’usage, débris archéologiques d’une civilisation (la nôtre) déjà éteinte. La structure vert métallisé soutenant le défenseur et les autres pièces gît au sol. Elle ressemble un peu à une sculpture constructiviste qui aurait échoué ici par hasard.


Sur le coup, j’ai envie de lui demander si ce n’est pas lui le défenseur du temps.
Retour à Paris. Je traîne dans le quartier de l’Horloge, un peu désœuvré. L’emplacement de l’automate démonté laisse voir sur le mur une trace de saleté brunâtre, au liseré noir, très belle, épurée. Elle est là comme l’ombre portée de toute l’œuvre.
On dirait le plan abstrait d’un vaisseau fantôme dessiné par Sol LeWitt ou un reste de figures pompéiennes.
Le soleil improvise un cadran solaire avec des restes de pitons et de clous.
Deuxième voyage et c’est comme aller au cœur de toute cette machinerie temporelle. Remonter le temps pour s’y perdre. De Bordeaux, un TER nous dépose dans une gare inconnue nommée Morcenx. Briques au sol où poussent des herbes folles et du chiendent. Nous arrivons sur le site d’une ancienne usine électrique à présent occupé par une entreprise chargée de la transformation des déchets d’amiante. Filiale du groupe Europlasma, la société s’appelle Inertam. Elle est unique au monde. Ici, on « inerte » entre vingt-cinq et trente tonnes d’amiante par jour, on les conditionne dans des big bags, gros sacs en toile frappés de quatre « A » (consignes sur l’amiante en quatre langues), on les stocke dans des bennes, on les brûle dans un four à 1 500 degrés où plonge une torche à plasma qui monte, elle, à plus de 4 000 degrés. Puis l’amiante devient une lave en fusion qui s’écoule dans d’épais moules en fonte – des lingotières. Le liquide refroidit et noircit à l’air libre pendant plusieurs heures. Enfin, un camion aux roues épaisses soulève et bascule le moule d’où le bloc d’amiante durci rejoint d’autres morceaux dans une sorte de carrière étrange située à deux doigts d’une pinède.
La pierre d’amiante (extraite à l’origine du sous-sol) redevient donc pierre. Ce traitement écologique, plus sûr que l’enfouissement des déchets encore largement majoritaire, opère un cycle complet. L’aspect de l’amiante vitrifié rappelle de l’obsidienne, du charbon gluant et brillant, presque du diamant brut, du verre coupant. On utilise l’acronyme Cofalit pour désigner ce caillou. On nous explique qu’au terme de ce processus de purification et de pétrification des fibres, le Cofalit est broyé et concassé. Il sert parfois de remblai sur les routes.
26 27
5 Vladimir Nabokov, « Lance », in Mademoiselle O trad. Maurice et Yvonne Couturier, Paris, Julliard, Presses Pocket, 1982, p. 227.
Fragments du crabe composant Le Défenseur du Temps en restauration à l’atelier Prêtre et Fils, mars 2022
Emplacement original du Défenseur du Temps, quartier de l’Horloge, Paris, mai 2022
Vertige : j’apprends que l’usine fonctionne jour et nuit, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. Un volcan en fusion au cœur d’un site industriel. L’ensemble est digne d’une série photographique de Bernd et Hilla Becher sur les hauts-fourneaux. La même complexité, la même précision objective des détails. Nous avons sous les yeux des sculptures anonymes aux multiples marches, tours de métal, poutres en acier, robinets. Des corps métalliques dont les organes internes sont exposés en plein air. J’avise un groupe de tuyaux gainés en torsade ; on dirait la queue du dragon de Monestier et ses écailles.

À la manière d’un capriccio de Panini ou de Piranèse, des fragments disparates de bâtiments amiantés venus du Grand Palais, de l’Assemblée nationale, de la tour Eiffel, s’accumulent dans d’immenses conteneurs rouillés. Dans la perspective du Grand Paris, la ville fait son bilan carbone et entropique : une partie échoue donc ici pour subir un processus fascinant de recyclage et de métamorphose des déchets toxiques. Ces lieux tiennent autant de la décharge que du laboratoire alchimique. L’après-midi, nous montons dans la salle des machines pour suivre le parcours d’une benne d’amiante, dont les vitrifiats seront spécialement utilisés pour les deux expositions. Notre lot est composé de colle amiantée qui servait à durcir les dalles du Palais de la découverte que Cyprien arpentait dans son enfance. Un bloc de Cofalit sera exposé à Lafayette Anticipations ; d’autres pièces en Cofalit, parfois légères comme de la pierre ponce, serviront de presse-papiers pour les dessins de Smithson au Palais de Tokyo.
Je vois Cyprien à genoux en train de chercher des morceaux de Cofalit, comme Smithson lorsqu’il arpentait des carrières de basalte et de sel pour ses non-sites. Nous sommes non seulement sur un site industriel, mais aussi au cœur d’un imaginaire. Peut-être le sien. J’aime quand l’art est pris dans un processus de travail. Les expositions, une fois accrochées, m’ennuient toujours un peu. Comme si, dès lors qu’elles commençaient, il n’y avait plus à chercher. Je préfère venir avant, me glisser dans les coulisses. Voir ce qui tâtonne, ce qui essaie. Et recommence. Être dans l’atelier plutôt que dans le musée. J’ai le sentiment que ces deux expositions, ou ce show en deux volets, auront l’instabilité d’un chantier aux mécanismes visibles, ouverts, potentiels.

Tout se rejoint dans une troublante boucle temporelle : le Centre Pompidou doit fermer ses portes en 2024, après la tenue des Jeux olympiques. S’ouvrira alors un vaste chantier de désamiantage dont certaines structures échoueront peut-être en ces lieux. Des sculptures d’extérieur, en l’occurrence les figures de la fontaine Stravinsky de Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle, sont en cours de restauration. Je m’y rends par un après-midi de chaleur écrasante. Il n’y a plus d’eau. Derrière des grilles de chantier, quelques restes au sol, des plaques métallisées, des tuyaux en boule ; tout un monde éteint, en sommeil.
Alors que nous évoluons, en fin de journée, au milieu d’une montagne de diamants de verre noir de Cofalit – déchets sublimes, inutilisés, veinés de rouge, de vert bouteille –, je crois voir La Mer de glace de Caspar David Friedrich repeinte au goudron, une œuvre qui me hante, que je tiens pour la représentation d’une sculpture à la fois archaïque et contemporaine. « La glace du Grand Nord doit tout de même ressembler à autre chose », aurait dit une éminente figure politique contemporaine de Friedrich au sujet de ces blocs erratiques, marron comme de la terre, durs et coupants comme du verre.

Sacs d’amiante sur le chantier de restauration du Palais de la découverte/ Grand Palais à Paris, 2022
Les analogies avec l’œuvre de Smithson donnent le tournis. Machines de l’industrie et créatures archaïques : les camions sont des monstres préhistoriques. L’usine ouvre la gueule béante des enfers, elle exhibe des passages, des sous-sols, des tuyaux excrémentiels tels qu’en a dessinés l’artiste américain. Dans la salle des contrôles, nous avons suivi une heure plus tôt, derrière une vitre épaisse, la lente chute des sacs remplis d’amiante et de matériels contaminés (gants chirurgicaux, masques, etc.) dans des broyeurs à couteaux. Les gants bleus étaient déchiquetés et transformés en une pâte épaisse mêlée de gravats.
Images du camion-benne déversant des blocs de basalte dans le Grand Lac Salé pour la création de la Spiral Jetty. Je pense aussi aux corps morcelés des dessins pop de Smithson, marqués par un christianisme obscur. Des corps torturés, ligotés, parfois flottants, qui s’agglutinent dans la souffrance et l’extase pour mieux fusionner et se transformer en permanence. Les croquis de Jacques Monestier que j’ai regardés pour préparer mon texte ressemblent autant à des crobars savants et poétiques de Léonard de Vinci qu’aux visions torturées des dessins de Smithson.

28 29
Giovanni Battista Piranesi, Carceri d’invenzione (Prisons imaginaires) 1750
Blocs d’amiante vitrifée, Inertam, Morcenx, 2022
Caspar David Friedrich, La Mer de glace, ca. 1823–1824
Sur le chemin du retour, je passe par Pessac et m’amuse du rapprochement avec Passaic dont nous avons parlé des mois plus tôt. Je lui envoie une photo par téléphone. Il me répond : « Learning from Pessac. »
Entre tant d’images, de matières, de sensations vives, il reste un son entêtant. Celui de la salle de déconditionnement où les bennes déversaient régulièrement les big bags remplis d’amiante nocif. En collant mon oreille contre la vitre, j’entendais d’étranges sonorités, crissements mécaniques, hurlements indistincts, appels au secours désordonnés.
C’est drôle, maintenant que nous rentrons, je me rappelle que Franz Kafka, arpenteur des labyrinthes modernes, avait peur du téléphone. Au début du Château, lorsque retentit une sonnerie, K. décroche le combiné. Il écoute mais ne parle pas. « On entendait sortir de l’écouteur un grésillement tel que K. n’en avait jamais perçu au téléphone. On eût dit le bourdonnement d’une infinité de voix enfantines mais ce n’était pas un vrai bourdonnement, c’était le chant de voix lointaines, de voix extrêmement lointaines6 […] »
En 1896, les frères Lumière, pionniers du cinéma, ont réalisé un court-métrage montrant un groupe d’hommes en train de démolir un mur. Au milieu de la projection de Démolition d’un mur, le projecteur a malencontreusement commencé à rembobiner le film et à le lire à l’envers. Comme le public était à la fois choqué et ravi, les deux frères ont décidé d’intégrer cet « incident » aux projections suivantes. Ainsi, au lieu de regarder la simple démolition d’un mur supervisée par Auguste Lumière, les spectateurs voyaient d’abord le mur s’effondrer, puis le temps défiler en sens inverse et le mur se redresser comme par magie, défiant la pesanteur et les lois mêmes du temps pour se reconstruire. Seul le cinéma peut donner à voir ce fantasme d’un monde totalement fluctuant, capable de reculer ou d’avancer dans le temps, de remédier à l’effondrement par une restauration fluide et parfaite. Bien que ce film des frères Lumière ne soit qu’une œuvre brève et sans grande importance au regard de leur impressionnante contribution au cinéma moderne, il précède et préfigure tous les genres visuels qui détruisent des mondes, des villes, des empires, des familles, des structures et des relations, puis changent de dimension temporelle à la fin en restaurant la situation de départ dans son intégralité. En effet, le cinéma grand public est devenu l’inversion de la démolition, un fantasme de réparation, un effacement monstrueusement optimiste des lignes de fracture de l’effondrement. « D’une certaine manière, cela donne à penser que le cinéma offre une échappatoire illusoire ou temporaire à la dissolution physique », disait Robert Smithson, mais en ajoutant que ce contrôle apparent de l’éternité est faux et que « les “superstars” perdent de leur éclat1. »
En effet, les superstars finissent toujours par perdre de leur éclat et l’entropie par régner sans partage. En dehors du cinéma conventionnel, les mondes, le temps et les formes matérielles s’effondrent réellement. Dans l’œuvre de l’artiste basé à Berlin Cyprien Gaillard, on trouve de riches archives de mondes, de villes et de monuments qui s’effondrent, disparaissent, s’écroulent, se décomposent, tombent, cèdent. Bien que Gaillard répare certains de ces systèmes à travers
HUMPTY \ DUMPTY
,
OU QUAND LES SUPERSTARS PERDENT DE LEUR ÉCLAT
le processus d’exposition, ils ne paraissent jamais indemnes, entiers ou parfaits. Ses collections d’objets, qui ne sont ni des ruines ni des « ruines à l’envers2 » à la Smithson, accompagnent les « grands événements » de l’histoire en pistant leur impact sur le paysage naturel et urbain, en témoignant de la reconstruction effrénée qui suit les petits et grands actes de destruction.
Constructions tournées vers l’extérieur depuis la scène de dégâts, d’effondrement, d’abandon ou de délabrement, l’exposition HUMPTY \ DUMPTY de Gaillard fait du signe de destruction le fondement esthétique d’une nouvelle œuvre. Cette nouvelle esthétique examine la chose en ruine, à la fois en quête de « futurs à l’abandon3 », pour reprendre la formule de Smithson, et de futurs annulés au sens d’une rupture de l’histoire, voire de l’arrêt total du temps. Les objets exposés attestent de trois types de rencontres différents avec l’effondrement ou le déclin entropique. Dans le premier, les objets sont créés par une violente collision entre passé et futur ; dans le deuxième, ils sont engendrés par la cessation du temps lui-même ; et dans le troisième, ils menacent de tout détruire. D’autres modalités parcourent l’œuvre, comme la chute, la rupture, le vol, le démantèlement, l’inversion, les vides, les façades ou les futurs ratés.
30 31
Jack Halberstam
6 : Franz Kafka, Le Château, in Œuvres complètes, trad. Alexandre Vialatte, Paris, Gallimard, collection « Bibliothèque de la Pléiade », tome I, 1976, p. 512.
Louis Lumière, Démolition d’un mur, I, usine Lumière, Monplaisir, Lyon, France, 1896

1. COLLISION : l’histoire jaillit à travers des monuments et des monuments mineurs quand des mondes entrent en collision avec Dieu. En témoignent les gargouilles que Cyprien Gaillard emprunte au Palais du Tau et provenant de l’incendie de la cathédrale de Reims. Cette église médiévale érigée au 5e siècle a été reconstruite dans le style gothique rayonnant aux 13e et 14e siècles. Bien qu’elle ait survécu à plusieurs incendies et révolutions au cours des siècles suivants, elle a été bombardée pendant la Première Guerre mondiale et le plomb de sa toiture a entièrement fondu. Il s’est écoulé à travers la gueule des gargouilles en pierre en formant une transposition saisissante de l’intérieur et de l’extérieur tout en offrant l’image d’un discours étouffé. Le toit de plomb est ainsi littéralement devenu partie intégrante du métabolisme des gargouilles, une extrusion grossière par laquelle les systèmes signifiants internes de la religion, de la guerre, du militarisme et
L’arc narratif plombé des gargouilles, ce flot de ruines qui durcit lorsqu’il traverse leur gosier, ne peut être inversé. La cathédrale de Reims a été reconstruite et certaines de ses gargouilles à langue noire y vivent toujours, preuve que, comme Humpty Dumpty, autre figure entropique du mythe et comptine traditionnelle, il est impossible de reconstituer les morceaux brisés d’une autre époque.
Humpty Dumpty est rond et fragile là où les gargouilles sont fines et robustes. Si ces dernières deviennent partie intégrante de l’architecture qu’elles décorent, l’homme-œuf n’a jamais été qu’une présence temporaire sur le mur dont il est tombé, son nom servant désormais de marqueur fantaisiste de la chute précipitée par l’arrogance, de marqueur disgracieux de dommages irréparables. La comptine du 18e siècle le plus souvent associée à Humpty Dumpty parle d’un personnage rond et fragile qui tombe d’un mur et s’écrase au sol. Cet acte d’autodestruction était irréversible, et malgré tous les efforts des chevaux et des soldats (aucune mention n’est faite des pouvoirs de guérison particuliers que les chevaux auraient pu avoir), aucun homme ni aucun animal n’a pu reconstituer Humpty Dumpty. Contrairement au film des frères Lumière où le mur se reconstruit tout seul post-démolition, la chute qui désintègre Humpty Dumpty nous rappelle que ce qui est cassé n’est parfois pas réparable. Et plus encore, que la réparation est parfois la plus mauvaise des réponses : et si la réparation, au lieu de remédier aux dégâts, était une dissimulation à grande échelle de dommages irréversibles et continus qui s’inscrivent au sein d’un lent désastre provoqué par le capitalisme ? Dans ce cadre de référence, l’histoire d’Humpty Dumpty est un avertissement, un refus, un coup d’œil jeté sur un futur qui se fragmente rapidement. La figure arrogante de la fragilité et de la supériorité blanches ne peut que tomber, et, sans l’aide du roi, ce scandaleux édifice d’hubris s’effondrera et ne se relèvera pas.
1 Robert Smithson, « Une visite des monuments de Passaic, New Jersey (1967) », in Art et science-fiction : la Ballard Connection (éd. Valérie Mavridorakis), trad. Caroline Anderes et Vincent Barras, Genève, Mamco, 2011, pp. 207–215. 2 : Ibid., p. 211. 3 : Ibid.
Henri Deneux, Bras du transept : Gargouille débordant de plomb, juillet 1915 (témoignage de l’incendie de 1914 de la cathédrale de Reims)

de l’apocalypse se déversent comme un discours à travers la bouche de ses gardiens baroques. Les rivières noires de plomb remplacent l’eau qui devrait normalement s’écouler de la gueule des gargouilles et entravent leur fonction d’évacuation. Ainsi, alors que la gargouille était autrefois la gorge de l’édifice, elle devient aujourd’hui, à travers cette collision entre histoire et modernité, un monument au silence, au durcissement du discours – le corps n’émet plus de paroles liquides, mais prend forme autour de ce qui bloque tous les flux. À la place, ces langues noires peuvent seulement promettre que la solidité du passé s’est fondue dans la sombre incertitude d’un futur diminué.
2. CESSATION : les notions de progrès, de cohérence, d’intégrité et de développement servent à assurer aux êtres humains que ce qui est cassé peut être réparé et que ce qui s’est arrêté recommencera. Pourtant, tel un monument érigé en l’honneur de la fin des temps, une horloge cassée a passé deux décennies dans le quartier parisien auquel elle a donné son nom (quartier de l’Horloge). L’horloge en question, un automate conçu par Jacques Monestier, offrait une vision véritablement gothique du temps. Construite en 1979 et installée à une rue de l’endroit où, quelques années plus tôt, l’« anarchitecte » Gordon Matta-Clark avait creusé des formes coniques dans deux immeubles avant leur démolition, l’horloge de Jacques Monestier s’est jointe à Gordon Matta-Clark pour rendre hommage à ce monde qui s’effondrait et qu’il fallait effacer au nom du progrès. Elle présente un personnage humain qui se bat à chaque heure contre l’une des créatures cherchant à le vaincre, puis doit lutter contre les trois à la fois à midi, dix-huit heures et vingtdeux heures. Le personnage ne peut que perdre cette bataille et le temps rester en suspens. Les éventrements pratiqués par Gordon Matta-Clark permettaient aux visiteurs de voir le Centre Pompidou en cours de construction sur les ruines du quartier entourant Les Halles ; l’horloge de Monestier offrait une vision de la bataille épique entre espace public et art public, entre les marchés de l’art et la gentrification.
Dans son exposition, Cyprien Gaillard s’est emparé de l’horloge cassée et l’a réparée pour qu’elle tourne à l’envers sur une nouvelle bande-son. Ce magnifique et étrange dispositif évoque la banalité de la pendule à coucou tout en refusant de remplacer le kitsch de cette dernière par l’héroïsme de la victoire humaine. Les stars de l’horloge, ce sont les monstres – dragon, coq, crabe –, pas le personnage en fer armé d’un glaive et animé par un système pneumatique. Les créatures se comportent de façon étrange et effrayante : le crabe déploie ses pinces pour s’emparer du glaive, le coq descend en piqué toutes griffes dehors et le bec grand ouvert, le dragon cherche à saisir sa proie par-derrière. Même quand ils battent en retraite, ces monstres de métal paraissent redoutables. À l’envers, ils deviennent apocalyptiques.
32
33
Cette horloge, désormais réglée pour tourner à l’envers et retirée du quartier qui vit dans l’ombre de son absence, revient dans l’œuvre de Cyprien Gaillard à travers plusieurs sites hétérotopiques – miroirs, bateaux, trains, ponts, etc. Pour Michel Foucault, le site hétérotopique marquait le passage d’une époque régie par le lent écoulement du temps historique à une période caractérisée par des configurations de relations dans l’espace. « L’époque actuelle serait peut-être plutôt l’époque de l’espace4 », écrit-il. Évidemment, le temps et l’espace sont liés –l’espace a une histoire, nous rappelle Foucault –, et dans le contexte de la modernité, cette histoire évolue d’un ensemble vertical de relations entre temps et espace vers des réseaux horizontaux qui enveloppent les objets, les désirs, les orientations politiques et la fonctionnalité dans des surfaces, des institutions et de l’art. Dans l’univers de Cyprien Gaillard, l’espace hétérotopique peut être dangereux : la surface miroitante d’un superbe lac cache un fond en béton peu profond (The Lake Arches) ; parfois, l’espace hétérotopique s’inverse : les anciens wagons de métro, au lieu de servir de moyen de transport, sont eux-mêmes transportés par bateau (Ocean II Ocean) ; le pont ne dessine plus un arc au-dessus de l’eau, il tombe lentement dedans (Love Locks) ; l’horloge ne donne plus l’heure, mais marque l’espace, puis l’absence (Le Défenseur du Temps). Pour Cyprien Gaillard, l’hétérotopie n’est pas seulement relationnelle. Comme les magnifiques perruches vertes qui volent au-dessus de la ville (Formation), elle marque un affrontement entre les surfaces, les sensibilités, les mouvements migratoires et les paysages urbains immobiles. L’hétérotopie faisait référence aux systèmes qui ont engendré des sociétés disciplinaires dans un passé récent ; aujourd’hui, elle désigne la façon dont ces systèmes – la prison, la migration, les affaires – se sont fondus dans le paysage. Face à la généralisation et à la banalisation des régimes de régulation brutaux, des réactions militantes et esthétiques radicales cherchent à tout faire tomber.
3. TOUT S’EFFONDRE : la vaste vision esthétique de Cyprien Gaillard place le spectateur au contact direct de choses cassées, d’os brisés, de la démolition et de l’effondrement. Dans son monde mu par l’entropie, les choses sont toujours en train de s’écrouler et aucun pouvoir souverain ne peut les relever. En effet, l’effondrement ne se produit pas de lui-même : la présence humaine est le principal moteur qui alimente ce ralentissement progressif de l’expérience du monde que l’œuvre de Cyprien Gaillard documente méticuleusement. Les détritus de la vie urbaine forment la matière première des collections de l’artiste. Par exemple, dans l’œuvre intitulée Love Locks, d’énigmatiques sacs de cadenas sont posés dans l’espace d’exposition pour évoquer la perte d’une certaine sécurité. Ces cadenas étaient en fait accrochés sur des ponts de Paris – une activité humaine apparemment simple et innocente qui pèse pourtant de tout son poids sur l’environnement construit.
4 Michel Foucault, « Des espaces autres. Hétérotopies », in Architecture, Mouvement, Continuité, n° 5, 1984, p. 46.
5 José E. Muñoz, « Ephemera as Evidence: Introductory Notes to Queer Acts », in Women and Performance: A Journal of Feminist Theory, vol. 8, n° 2 (1996), p. 6. 6 Ibid.
7 Robert Smithson, « Une visite des monuments de Passaic, New Jersey (1967) », op. cit., p. 210.
8 En anglais, « a utopia minus bottom ». 9 : Ibid., p. 210.
Les amoureux qui se promenaient sur les ponts parisiens ont ainsi accroché des cadenas gravés d’une date ou d’initiales sur les balustrades ou les grilles métalliques de la structure pour confirmer leur amour – du moins pour ce jour-là – et éviter que le passage du temps diminue la force de leur affection. Toutefois, comme le plomb qui jaillit de la gueule des gargouilles, comme le verre qui vole en éclats au contact du sol, le désir ne peut rester entier ni fluide. Il se brise et se fige ; il détruit le vaisseau à travers lequel il se déplace et aucun cadenas ne saurait le maintenir en place. Un observateur compatissant pourrait saisir le romantisme du geste consistant à accrocher un cadenas au-dessus de la Seine, alors qu’un observateur queer y verrait plutôt la loi rigide de l’amour hétérosexuel qui repose sur la possession, insiste sur l’assortiment du couple et cherche à laisser une trace

permanente de ce qui ne peut être qu’une expérience brève. La queerness, écrivait le théoricien José Muñoz, « s’exprime souvent à la dérobée5 ». Selon lui, elle « existe sous forme d’insinuations, de commérages, de moments fugaces6 » et de performances qui disparaissent des archives, se produisant souvent une seule fois et jamais plus ensuite. Pour cette raison, l’éphémère devient une temporalité queer étrangère à ces engagements désespérés à la permanence que représentent les cadenas. Comme d’autres structures hétérosexuelles, les cadenas sur les ponts ont un tel poids symbolique et matériel que, loin d’attacher des gens à des constructions et des corps à d’autres corps, ils incarnent la présence écrasante et dominante que les corps et les désirs humains font peser sur un paysage.
La plupart des œuvres de Cyprien Gaillard sont dépeuplées d’êtres humains.
Et c’est très bien ainsi. Les humains trébuchent sur le paysage en laissant derrière eux des déchets et des monuments à leur intention qui perdurent partout, alors que la permanence n’est qu’un fantasme, même quand elle s’adapte aux rythmes de l’expansion coloniale, du racisme et de l’invention capitaliste. À une époque où des groupes d’activistes déboulonnent les monuments coloniaux et impériaux érigés en l’honneur d’anciens récits de conquête et de domination raciale, c’est un soulagement de pénétrer dans un monde esthétique où la vie intermittente des choses est ponctuée par l’effondrement et la démolition du monumentalisme lui-même. L’intérêt de Cyprien Gaillard pour le monument est proche de celui qu’exprime Robert Smithson dans son essai de 1967 sur les « monuments mineurs » d’une banlieue en cours de construction7. En qualifiant le paysage plat et bétonné qu’il traverse, de « panorama zéro », de « ruines à l’envers », en le décrivant comme « plein de “trous” » ou de « vides monumentaux », il déplore l’expansion de la nouveauté et la construction de ce monde qu’on appelle développement suburbain. Dans la chaîne signifiante de Passaic, il cherche en vain une ouverture où le centre-ville « apparaissait comme une morne adjonction ».
Pour Robert Smithson, ces ruines à l’envers ne sont pas des ruines romantiques abandonnées, mais des ruines futures, des constructions qui s’élèvent vers la démolition, des paysages de banlieue qui n’ont pas de passé, mais « seulement ce qui passe pour un futur ». En ce sens, elles sont « une utopie sans fondement8 », sans mauvais jeu de mots, mais c’est en explorant ces structures utopiques qu’il trouve un autre point d’accès au fondement : une fontaine industrielle formée de six gros tuyaux qui prélevaient l’eau de la rivière et la déversait dans un cratère. « De manière assez énigmatique, le gros tuyau était connecté à la fontaine infernale », écrit-il. « C’était comme s’il sodomisait secrètement quelque orifice technologique caché et qu’il procurait un orgasme à ce monstrueux organe sexuel (la fontaine). Un psychanalyste dirait que le paysage manifestait des “tendances homosexuelles”, mais je ne tirerais pas une conclusion aussi grossièrement anthropomorphe. Je dirais simplement : “C’était là”9. » Robert Smithson a peut-être reculé devant la conclusion anthropomorphe grossière d’un paysage qui afficherait des tendances homosexuelles, mais en y regardant
34 35
Grilles originales de la passerelle Léopold Sedar Senghor recouvertes de cadenas en train d’être démantelées par les services de la voirie de la ville de Paris, 2022
de plus près, on peut déceler la trace des tendances queer qui se lovent dans les paysages de l’effondrement dans cette image du tuyau sodomite et du surplus orgasmique jaillissant de la fontaine en béton. En inversant ici l’ordre des choses, Robert Smithson associe le mode de vie hétérosexuel au manque d’originalité de la banlieue et aux constructions ordonnées, leur opposant les structures des déchets évacués par un gros tuyau qui ne vont nulle part, mais inondent néanmoins le paysage de leur excès infertile. Si certains peuvent grincer des dents devant ce passage légèrement homophobe, j’y vois plutôt une directive claire concernant le potentiel érotique de l’effondrement.
L’érotisme nous enseigne, en effet, ce que pourrait être la différence entre des ruines et un bâtiment effondré. Alors que les ruines confirment la progression ordonnée de l’Histoire, la grandeur et la décadence des civilisations, le fait que le passé appartient bien au passé et le futur à son avènement inéluctable, l’effondrement est choquant : il peut être soudain comme progressif, sinueux ou cataclysmique ; il peut faire voler en éclats les architectures ou les détruire lentement. C’est exactement ce que fait le cadenas accroché au pont : il le fait lentement tomber. Bien que le cadenas soit censé capturer le désir à son apogée pour verrouiller la passion, il ne peut pas cimenter des émotions qui s’avèrent brèves, éphémères et, quand elles sont accrochées à des monuments matériels, ruineuses. La ruine chasse l’amour, chasse le désir, la passion est l’effondrement à l’envers, et l’effondrement est la passion qui s’en va. La marée est haute, le niveau de l’eau est bas, le miroir se révèle être une surface peu profonde.
L’effondrement a-t-il une forme ? Si la construction, l’action, la création et l’invention sont les grands moteurs du capital, l’effondrement, la perte, l’écroulement, le démantèlement et la fracture peuvent-ils devenir le vocabulaire d’autres façons d’être au monde ? Collapse, le terme anglais qui signifie « effondrement », est d’origine latine. Il est formé de col qui veut dire « ensemble » et de labi qui signifie « glisser ». Cette étymologie nous donne une idée des plis esthétiques qui se cachent potentiellement dans ce terme. L’effondrement peut faire référence à un système en proie à de nombreuses défaillances, à une dépression nerveuse, à un épuisement physique, à une structure qui cède, à une chute, mais il signifie spécifiquement que de nombreuses choses tombent ensemble et que leur chute est provoquée par un manque de soutien. Il désigne aussi l’échec, le dysfonctionnement total d’un système. Une esthétique de l’effondrement pourrait nommer une série de gestes qui s’orientent vers la chute, qui s’éloignent de la création, de la construction et de l’amélioration par des chemins obliques pour embrasser la beauté de la désintégration progressive et inévitable.
Humpty Dumpty vit et meurt conformément au deuxième principe de la thermodynamique, selon lequel l’entropie totale d’un système ne peut qu’augmenter ou rester constante, quel que soit le processus spontané, mais ne diminue jamais. Elle ne diminue jamais. Autrement dit, la chaleur ne peut pas être transmise d’un corps plus froid à un corps plus chaud. L’ordre ne peut pas réparer ce qui est cassé. L’entropie, ou le désordre, augmente avec le temps. Si vous tombez et vous cassez quelque chose, on ne pourra pas vous remettre dans l’état exact où vous étiez.
Cyprien Gaillard nous répète inlassablement que les mondes cassent. Nous devons résister à l’envie de les réparer, de donner une forme passable à leurs fragments, de créer les fac-similés d’une vie qui n’aurait pas été interrompue. L’exposition de Cyprien Gaillard nous mène au contraire à l’intérieur de la rupture elle-même. Elle nous demande de trouver une place au milieu des bords tranchants, des éclats de verre, des débris et des rebuts. Une fois au cœur de la démolition, nous comprenons que l’avenir ne nous appartient pas, que nous ne pouvons ni le saisir ni le rêver, ni l’acheter ni l’occuper. Il est là, il est maintenant et il est terminé.
HUMPTY \ DUMPTY est un opéra urbain de Cyprien Gaillard qui prend la forme d’une exposition fragmentée entre deux sites parisiens. Le Palais de Tokyo est HUMPTY et Lafayette Anticipations est DUMPTY HUMPTY fonctionne comme un corps entropique, DUMPTY comme une machine. Paris, à l’instar de n’importe quelle ville, est un monument vivant, dont l’entropie est alimentée depuis les périphéries par des mythes métropolitains parfaitement entretenus, une main-d’œuvre à peine visible, des économies de soutien un peu délirantes et un magnétisme ineffable qui porte la promesse d’une magie insaisissable. À la fois observation et invocation, cette exposition en deux parties entremêle des futurs passés et des présents fragiles. Imaginez un œuf anthropomorphe assis sur un mur, un personnage maladroit et fragile qui oscille doucement pour s’asseoir confortablement. Alors qu’il a presque trouvé la position idéale, l’inévitable se produit : l’œuf tombe et s’écrase au sol, la coquille brisée. Il est absolument impossible de revenir au moment précédant la chute. Les autorités tentent, de toute leur force et avec toute leur technologie, de remettre en état cette forme craquelée qui dégouline. Il est trop tard ; le cours du temps ne peut être inversé. Il ne reste qu’une coquille vide et des regrets ; il va falloir faire avec ce qui reste1 Imaginez un bac à sable, un désert miniature. Imaginez qu’il ait été qualifié de monument, de marqueur d’une chose passée dont quelqu’un a voulu qu’elle s’impose au présent dans le futur. Les déserts sont des lieux pleins de vie et d’histoire où l’échelle est inversée : un grain de sable, selon la manière dont on le regarde, peut atteindre la taille d’un rocher. Pourtant, ces étendues de sable sont utilisées comme des écrans vierges sur lesquels projeter des futurs et des passés imaginés. Les déserts sont des sites de films, de romans, de land art et d’opérations militaires ; on pourrait même dire que « le mythe du désert stérile a été perpétué intentionnellement par le gouvernement et les grandes entreprises pour cacher leur malfaisance écologique et culturelle2 ». Le mythe est quelque chose de puissant – il a le pouvoir de produire des fictions et de mobiliser des structures
L’OPÉRA
D’HUMPTY \ DUMPTY
qui contrôlent l’existence. En 1967, Robert Smithson a découvert un bac à sable à Passaic, ville du New Jersey aujourd’hui densément peuplée, et qualifié ce site de monument. Il l’a décrit comme un « vaste dépôt d’ossements et de pierres pulvérisés en poussière. Chaque grain de sable était une métaphore morte de l’intemporalité, et déchiffrer de telles métaphores reviendrait à traverser le faux miroir de l’éternité3 ». C’est dans « Une visite des monuments de Passaic, New Jersey (1967) » qu’il a qualifié ce bac à sable de monument, un essai visuel relatant une excursion dans la ville du New Jersey qui l’a vu naître, où les ponts, les derricks et les canalisations sont identifiés, à côté du bac à sable, comme des supports mémoriels, des sanctuaires du progrès industriel et de l’entropie. Il a photographié ce monument avec son Kodak Instamatic 400, le cadre carré fixant le temps et montrant un terrain de jeu ordinaire où personne ne joue : il y a des barres en métal sur lesquelles on peut prendre appui et se suspendre, des chevaux en plastique sur lesquels rebondir, un bac à moitié rempli de sable, entouré de grains répandus et de broussailles. Robert Smithson a découvert The Sandbox Monument (also known as the Desert), pour citer son titre complet, lors d’une odyssée en banlieue qu’il relate dans un texte où il demande au lecteur d’imaginer ce paysage granulaire dans un temps d’avant, de réfléchir à son contenu soigneusement divisé en impeccables moitiés de sable blanc (sans doute du gypse ou du corail écrasé) et de sable noir (probablement du basalte). Il nous demande ensuite, dans ce qu’il appelle une « expérience puérile », d’imaginer un enfant qui court « des centaines de fois dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que le sable se mélange et commence à devenir gris puis faisons-le courir en sens inverse ; le résultat ne sera pas la restauration de la division originale, mais un gris plus prononcé et une augmentation de l’entropie4 ».
36 37
Lisa Le Feuvre
En 1971, un essai de Rudolf Arnheim intitulé Entropy and Art: An Essay on Disorder and Order abordait les relations entre art et entropie, terme emprunté au deuxième principe de la thermodynamique qui s’est introduit dans le langage courant dans les années 1950 avec la généralisation des craintes suscitées par l’épuisement des ressources énergétiques. Plus de soixante-dix ans après, l’entropie est une condition indéniable de notre époque et un sujet de préoccupation pour Cyprien Gaillard, qui explore la dissipation du mythe du progrès autrefois tant désiré. HUMPTY \ DUMPTY est l’incarnation de l’entropie. « L’ordre est une condition nécessaire à tout ce que l’esprit humain doit comprendre », écrit Arnheim. « Des agencements tels que le plan d’une ville ou d’un immeuble, un ensemble d’outils, un étal de marchandises, la verbalisation de faits ou d’idées, un tableau ou un morceau de musique sont considérés comme ordonnés quand un observateur ou un auditeur peut en saisir la structure générale et ses ramifications à travers certains détails. L’ordre permet de se concentrer sur le semblable et le différent, sur ce qui va ensemble et ce qui est à part5. » L’ordre a du sens, mais le sens et l’ordre ne sont pas des vérités, aussi réconfortantes qu’une formule puisse paraître. Le sens et l’ordre sont des inventions subjectives pour essayer de gérer les impondérables de l’existence. Prenons l’exemple de la carte géographique : c’est une fiction utilisée pour ordonner la surface de la planète, qui transpire le pouvoir et le jugement6.
Arnheim suggère que la tendance à rechercher l’équilibre est essentielle à l’activité humaine, voire au vivant lui-même.
Dans ce contexte, le désordre suscite un désir d’ordre et d’agencement, et avec lui l’envie de trouver l’équilibre. Cela se produit souvent à travers le potentiel structurant du langage qui, d’une certaine manière, est capable de tout aligner au même niveau – s’il existe une logique numérique ou narrative, tout et n’importe quoi peut passer pour ordonné. Comme le désordre conduit à une différenciation des éléments et à une rupture de la structure, il stimule la recherche de formes d’expression alternatives. En tant que mesure de la dispersion de l’énergie d’un système, l’entropie indique des tendances à l’équilibre et au déséquilibre.
1 À l’origine, la comptine « Humpty Dumpty » ne parlait pas exactement d’un œuf : dans le roman De l’autre côté du miroir (1871), Lewis Carroll présente Humpty Dumpty (appelé « Le Gros Coco » dans la version française, NdT) au chapitre six comme un personnage qui a l’apparence d’un œuf aux yeux d’Alice c’est une personne « décevante » qui prétend être maître des mots, se montre dédaigneux envers Alice et s’avère incapable de tenir assis sur un mur étroit.
2 : Traci L. Jordan, « Destroyers, Desert(ed) Places, and the Reign of the Death-Eye Dog in Silko’s Ceremony and Almanac of the Dead and DeLillo’s Underworld », Journal of Kentucky Studies n° 30, 2013, p. 138. Voir aussi Stefanie Sobelle, « Point Omega / Omega Point: Desert in Three Parts », in The Invention of the American Desert: Art, Land, and the Politics of the Environment, (éd. Lyle Massy et James Nisbet), Oakland, University of California Press, 2021, p. 128.
3 : Robert Smithson, « Une visite des monuments de Passaic, New Jersey (1967) », in Art et science-fiction : la Ballard Connection (éd. Valérie Mavridorakis), trad. Caroline Anderes et Vincent Barras, Genève, Mamco, 2011, p. 214.
4 : Ibid.
5 Rudolf Arnheim, Entropy and Art: An Essay on Disorder and Order, Berkeley, University of California Press, 1971, p. 1.
6 Smithson a observé que « la carte géographique exerce une fascination sur l’esprit des artistes ». Il a cité Jorge Luis Borges et Lewis Carroll, qui voyaient dans les cartes des fictions et des approximations du réel montrant toujours autre chose. Voir Robert Smithson, « A Museum of Language in the Vicinity of Art (1968) », in The Collected Writings (éd. Jack Flam), Berkeley, University of California Press, 1996, p. 92.
7 : Thomas Pynchon, « Entropie », in L’Homme qui apprenait lentement trad. Michel Doury, Paris, Seuil, 1985, p. 109.
8 : Ibid., p. 107.
9 Ibid., p. 102.
10 : Robert Smithson, « Entropy Made Visible: Interview with Alison Sky (1973) », The Collected Writings, op. cit., p. 301.
11 Entretien oral d’histoire avec Robert Smithson mené du 14 au 19 juillet 1972 par Paul Cummings, Archives of American Art, Smithsonian Institution. L’entretien avec Alison Sky a été édité par Smithson et Sky, tandis que cette interview n’existe que sous la forme d’une transcription brute.
Sauf mention contraire, les citations sont issues de l’interview avec Cummings. Pour plus de clarté, les citations de cet entretien ont été légèrement modifiées. Voir www.aaa.si.edu/collections/ interviews/oral-history-interview-robert-smithson-12013#transcript.
En 1960, dix ans avant l’essai d’Arnheim, Thomas Pynchon a écrit la nouvelle « Entropie », racontant l’histoire d’une fête tapageuse dans un appartement à Washington, D.C. – siège du gouvernement des États-Unis – en février 1957 par
une soirée à la douceur printanière. Des invités turbulents et divers événements perturbent le déroulement de la fête : un couple se dispute au sujet de théorie de la communication, des marins ivres prennent l’endroit pour un bordel, un groupe de musiciens de jazz se met à jouer sans instruments. L’hôte, Meatball Mulligan, se demande s’il doit aller s’enfermer dans la penderie ou essayer de contrôler le chaos. Après avoir pesé le pour et le contre, il choisit la seconde option et rétablit l’ordre entre les éléments disparates en faisant les bonnes présentations. La compatibilité rétablit progressivement l’équilibre. Pendant ce temps, dans l’appartement au-dessus, le couple formé par Callisto et Aubade vit sa vie dans une serre hermétiquement close où règne une température parfaite, aussi imprévisible que soit le climat extérieur. Ce chiffre est de 37 degrés Fahrenheit – 37 degrés Celsius étant la température idéale du corps (les ordres de mesure sont différents). Le couple cherche à vivre en dépensant le moins d’énergie calorifique possible – l’inverse de ce qui se passe dans l’appartement en dessous. Callisto prend soin d’un oiseau malade qu’il essaye en vain de ranimer grâce à la chaleur de son corps tout en énonçant les principes de la thermodynamique : il définit l’entropie comme « la mesure de désorganisation d’un système clos7 » qui, selon ses références, « s’accroît de façon continue8 ». L’application de cette théorie dans la vie quotidienne devient une métaphore vécue à l’intérieur de ce qui « formait dans le chaos de la ville une minuscule enclave d’ordre, étrangère aux fantaisies climatiques, aux débats de la politique nationale et aux différents désordres sociaux9 », tandis qu’un étage plus bas, c’est un présent bruyant et chaotique qui emplit l’enclave de Meatball Mulligan. Quand la fête entre dans sa quarantième heure, l’ordre est rétabli parmi les invités. À l’étage, l’oiseau malade pousse son dernier soupir. Aubade brise une fenêtre, perturbant ainsi l’équilibre écologique hermétique dont la création avait pris plus de sept ans. Avec Callisto, elle attend patiemment que la température de la ville pluvieuse au dehors s’aligne avec le climat idéal de la bulle qu’ils se sont inventée.
Robert Smithson, The Monuments of Passaic (The Sand-Box Monument, also called The Desert) 1967

(un des six clichés publiés dans la contribution de Robert Smithson, « The Monuments of Passaic », Artforum, vol. 6, no 4, décembre 1967)
Dans un entretien avec Alison Sky en 1973, Robert Smithson explique ce qu’est l’entropie à travers le personnage d’Humpty Dumpty. Il va droit au but dès la première ligne : « D’accord, commençons par l’entropie. C’est un sujet qui me préoccupe depuis longtemps. Dans l’ensemble, je dirais que l’entropie contredit la vision mécaniste habituelle du monde. Autrement dit, il s’agit d’une condition irréversible, d’une condition qui tend progressivement vers l’équilibre et cela est suggéré de nombreuses manières. La comptine “Humpty Dumpty” ferait une bonne et succincte définition de l’entropie :
Humpty Dumpty était assis sur un mur, Humpty Dumpty tomba de haut sur le sol dur, tous les chevaux du roi, tous les soldats du roi N’ont pu relever Humpty et le remettre droit10. »
38 39
Robert Smithson, Untitled, n.d.

L’année précédente, Smithson avait déjà utilisé ce personnage comme métaphore entropique dans une interview plus décousue avec Paul Cummings11. Interrogé sur son intérêt pour les mines et les carrières, il avait cité une phrase de Vladimir Nabokov qui le fascinait – « Le futur n’est que l’obsolète à l’envers12 » – et défini l’entropie comme un phénomène comparable à « ce qui s’est produit quand Humpty Dumpty est tombé, et que tout le monde… a essayé de le recoller. Il y a l’idée de chercher du sens dans une situation insensée, de trouver une sorte de continuité ».

Dans HUMPTY, il y a des chutes littérales et métaphoriques. La vidéo The Lake Arches de Cyprien Gaillard est une sorte d’œuvre de land art pour le temps présent. Elle marque une rupture dans le paysage qui utilise ce qui est déjà là comme matériau. La surface de la planète est d’abord façonnée par l’histoire géologique, puis par l’histoire humaine qui la modifie à travers l’extraction et l’ajout. Deux hommes plongent dans un lac étincelant, mais l’un d’entre eux comprend que l’eau n’est pas assez profonde seulement au moment où son visage percute violemment le fond en béton. L’eau est une fiction : ce lac, dont l’eau n’arrive que jusqu’au niveau des genoux, est un dispositif contextuel situé dans un complexe d’habitation à l’extérieur de Paris, les Arcades du Lac, une « ruine récente » bâtie en 1981 comme un temple classique pour le futur, l’ensemble évoquant l’atmosphère des romans de J. G. Ballard. Lorsque les hommes retrouvent l’équilibre dans ce que l’artiste qualifie d’« excursion qui a mal tourné », l’un d’eux a le nez qui saigne et se tourne vers la caméra. Smithson aussi s’intéressait vivement aux périphéries, aux abords de la ville, au chaos précaire de la corruption urbaine, à Passaic plus qu’à Manhattan. Il revenait inlassablement explorer le New Jersey, qui deviendrait bientôt le postindustriel « Garden State », s’aventurant dans les carrières de Montclair et la nature de Pine Barrens, explorant des sites industriels en ruine. Entre les « humm » et les « ah » de son interview de 1972, Smithson revient sur sa formation en tant qu’artiste et contemple ce qui l’attend. Il évoque ses débuts artistiques, le petit musée de fossiles et de reptiles qu’il a créé dans son enfance, l’importance de ses racines dans le New Jersey, la planification des vacances familiales, son intérêt pour Jérôme Bosch, Djuna Barnes, T. S. Eliot, Wyndham Lewis et Ezra Pound, ainsi que sa fascination pour les histoires de Dante et du Nouveau Testament, en particulier pour la Passion du Christ13. L’un des premiers articles citant Smithson en tant qu’artiste date du numéro d’octobre 1959 d’Art News, dans lequel Irving Sandler le présentait comme « un artiste prometteur originaire du New Jersey et désormais installé à New York [qui] expose des collages peints basés sur des barreaux verticaux emprisonnant des dinosaures et cannibales délirants aux yeux multiples ». Treize ans plus tard, Smithson parle de cette période dans son interview : « Je me suis toujours intéressé aux origines et aux débuts primordiaux, à la nature archétypale des choses. Cela m’a hanté tout au long des années 1959 et 1960, quand je me suis intéressé au catholicisme à travers T. S. Eliot, puis au monde byzantin grâce à T. E. Hulme et à sa vision de
l’abstraction comme contrepoint de l’humanisme de la fin de la Renaissance. » Robert Smithson opère une distinction en qualifiant ses débuts de « sorte de période de recherche à tâtons » et en insinuant qu’il est devenu, vers 1964, un artiste plus « conscient » qui rejetait « la menace de l’anthropomorphisme religieux païen » et reconnaissait l’épuisement de la culture européenne.
12.: Il cite cette expression dans son essai intitulé « The New Monuments and Entropy », Artforum, vol. 4, n° 10, été 1966.
13 : Voir Eugenie Tsai, Robert Smithson Unearthed: Drawings, Collages, Writings New York, Columbia University Press, 1991 c’est le premier ouvrage qui analyse les œuvres des débuts de Smithson.
14 : Dans cet ouvrage, Conversation entre Cyprien Gaillard et Rebecca Lamarche-Vadel, juillet 2022, p. 18.
15 : Voir Paul Shepard, Man in the Landscape: A Historic View of the Esthetics of Nature New York, Knopf, 1967. Ce livre était une référence importante pour Smithson, qui le cite dans son essai « Frederick Law Olmsted and the Dialectical Landscape », Artforum, vol. 11, n° 6, février 1973.
Quel peut être le résultat d’une phase de recherche artistique à tâtons ? Robert Smithson fait référence à des « dessins fantasmagoriques de mondes cosmologiques à mi-chemin entre Blake et une espèce d’imagerie boschienne ». HUMPTY met au jour ces dessins rarement exposés ; dans cet opéra en plusieurs actes, Cyprien Gaillard réunit un chœur de voix qui résonne avec la condition humaine et son magnétique compagnon de voyage qu’est l’inhumanité. La découverte de Robert Smithson a eu une grande importance pour Cyprien Gaillard : « L’héritage de Smithson m’évoque surtout un artiste “post-studio”. Pour moi, l’espace intérieur de l’atelier a toujours été une source d’anxiété. En vingt ans de pratique artistique, je n’ai jamais eu une seule idée dans un espace fermé, ce n’est pas un lieu propice à la création14. » Les deux s’intéressent aux bords, pas au centre ; ce sont la puissance du désordre, la réalité de l’entropie, la nature serpentine du temps, la culpabilité de l’activité anthropique et la présence absolue qui les passionnent. En effet, les dessins de Robert Smithson que Cyprien Gaillard a sélectionnés pour HUMPTY explorent des questions fondamentales sur la manière dont nous pourrions faire face à l’impossibilité d’être au monde en recherchant l’inconnu avec incertitude.
Un dessin, c’est d’abord une étendue de néant qui évolue ensuite vers quelque chose de visible quand les idées descendent, à travers le bras, de l’esprit jusqu’à la main et la page. Robert Smithson observe que ces hésitantes œuvres sur papier « montraient des images explicites telles que la ville ; elles avaient aussi quelque chose de monstrueux, comme de grands dessins de Moloch ». Le Moloch est une créature mythique : dans Le Paradis perdu de John Milton, c’est le chef va-t-enguerre des anges de Satan ; dans le poème « Howl » d’Allen Ginsberg, le Moloch est une métaphore de la société industrielle américaine ; dans Le Capital de Marx, il représente l’argent.
Les mythes sont le fruit de l’expérience, du désir, de la spéculation, de la peur et de l’histoire ; ils unissent croyance et perception15. Comme les déserts, les villes sont à la fois matérielles et conceptuelles, des réalités et des imaginaires venant toujours s’immiscer entre une image et une existence. Les villes sont des environnements construits dont le temps est cyclique ; elles sont érodées par les particules polluantes en suspension, les intempéries, les récits historiques,

40 41
Robert Smithson, Exhaust, 1961
Robert Smithson, Untitled 1961
leurs visiteurs et leurs habitants, leurs représentations et leurs restaurations. Des sculptures publiques ponctuent le paysage urbain : ces marqueurs et monuments sont inaugurés en grande pompe, mais se fondent rapidement dans le décor à mesure qu’ils deviennent familiers, condamnés à n’être remarqués que par les touristes, ne manquant à leurs cohabitants que lorsqu’ils voyagent ailleurs en émissaires de la ville.
Il y a deux représentants de l’art public dans HUMPTY \ DUMPTY. Dans DUMPTY c’est Le Défenseur du Temps de Jacques Monestier, une sculpture qui compte les heures à travers un conflit entre automates : armé d’un bouclier et d’un glaive, un homme en équilibre sur un rocher se bat à horaires fixes contre un crabe, un oiseau et un dragon, des créatures choisies pour représenter la mer, le ciel et la terre. L’œuvre a été installée en 1979 dans un Paris rénové, le nouveau quartier de l’Horloge étant même rebaptisé en son honneur, mais on l’a oubliée au fil des années et son ordonnancement combatif du temps s’est arrêté le 1er juillet 2003. Le temps ne peut être défendu contre son destin entropique. Dans HUMPTY, ce représentant est la sculpture Mutter mit zwei Kindern de Käthe Kollwitz, extraite de son piédestal en brique situé devant le musée portant le nom de l’artiste à Berlin.
Dans HUMPTY, Cyprien Gaillard présente d’autres traces de villes imaginées – des rêves inventés par la banlieue – aux côtés des références que sont les dessins de Robert Smithson, la sculpture de Käthe Kollwitz et le dessin Oreste e Pilade réalisé par Giorgio de Chirico en 1928, où deux personnages tendrement assis l’un contre l’autre tiennent dans leurs mains les ruines urbaines qui sortent de leurs corps. À Paris, les touristes viennent verrouiller leur amour sur des ponts et immortaliser leur couple par une photo avec la tour Eiffel en arrière-plan, mais il y a tellement d’amour en ville que le poids de ces cadenas menace de détruire l’infrastructure. Dans l’entrée du Palais de Tokyo, cinq sacs de cadenas d’amour brisés se fondent en un tas de symboles épuisés (Love Locks). Eugène Viollet-le-Duc affirmait que « restaurer un édifice, ce n’est pas l’entretenir, le réparer ou le refaire, c’est le rétablir dans un état complet qui peut n’avoir jamais existé à un moment donné16 ». Il utilisait la technologie de son temps pour créer une idée du passé peutêtre plus puissante que le passé lui-même. Trois gargouilles en calcaire vomissant du plomb, retirées de la cathédrale de Reims restaurée par Viollet-le-Duc à la fin du 19e siècle sont dans une salle précédant l’espace où sont exposées les œuvres réalisées par Robert Smithson en tant qu’« artiste préconscient », des scènes qui explorent les « idées de mythe, d’archétype et d’anthropomorphisme17 ».
Dans son interview, Robert Smithson affirme que ces personnages protopsychédéliques l’ont libéré de « toute notion d’anthropomorphisme ».
Les conversations enregistrées et transcrites sont de curieux événements ; elles touchent au vif du sujet de la création et donnent voix aux idées, mais cela demande du temps : les idées évoluent et se transforment, et ce qui est dit un jour n’est peut-être plus pensé le lendemain. La mémoire n’est pas un miroir, mais une méthode de voyage temporel sinueuse, interprétative et faillible. Celui ou celle qui réfléchit à sa vie a tendance à rechercher l’ordre, un récit chronologique, à trouver des mots pour produire un savoir qui surpasse le langage. Ces dessins annoncent que Robert Smithson va bouleverser le terreau même du modernisme. Bien qu’il ne mentionne pas Wilfredo Lam ni Pablo Picasso dans cette interview, les yeux, les bouches et les corps distendus, tout sauf humains, résonnent fortement avec ces prédécesseurs. Cette « sorte de période de recherche à tâtons » renvoie au mythe, à la religion, au mysticisme, à la science-fiction, à la numérologie et à la littérature ; aux archétypes, aux modèles, aux bonds conceptuels, au refus de ce qu’Adorno appelait le sédatif de l’industrie culturelle, et à la croyance en un « autre chose » hors de portée.
« J’ai toujours considéré l’histoire comme psychédélique », observe Cyprien Gaillard.
« Je ne me suis jamais vraiment préoccupé des dates ni de l’exactitude historique. Je vois l’histoire comme un matériau avec lequel travailler, faire des collages et des rapprochements – entre Passaic et Rome, par exemple. Ce processus naît d’un désir d’ensemble, d’une envie de joindre un monde fragmenté18. » Robert Smithson a fait ces dessins au début des années 1960. En 1968, un an après la découverte
du monument-bac à sable, il a commencé à concevoir et développer son idée du « nonsite » : des œuvres d’art qui déplaçaient un site et le faisaient entrer à l’intérieur du musée, une idée qui vient « d’une compréhension des limites19 ». Il s’agissait pour lui d’une théorie « hésitante » qui « pourrait être abandonnée à tout moment » – l’adjectif « hésitant » renvoie à la recherche à tâtons, autre expression employée par Smithson. Il poursuit : « Les théories aussi, comme les choses, sont abandonnées. Il n’est pas sûr que les théories soient éternelles. Des théories disparues forment les strates de nombreux livres oubliés20. »
16 Eugène Viollet-le-Duc, « Restauration », in Dictionnaire raisonné de l’architecture française du 11e au 16e siècle, Paris, B. Bance, 1866, tome VIII, p. 14.
17 : Peter Halley, « Introduction », in Robert Smithson: The Early Work: 1959–1962, New York, Diane Brown Gallery, 1985.
18 : En conversation avec l’auteurice, août 2022.
19 : « Interview with Robert Smithson / Paul Toner (1970) », in The Collected Writings, op. cit., p. 234. Voir aussi Phyllis Tuchman, « Robert Smithson, “A Nonsite (Franklin, New Jersey)” (1968) », Scholarly Texts, Holt/Smithson Foundation, 2020, www.holtsmithsonfoundation.org/robert-smithson-nonsite-franklin-new-jersey-1968.
20 : Robert Smithson, « A Provisional Theory of Non-Sites (1968) », in The Collected Writings, op. cit., p. 364.
Le nonsite est présent et s’étend dans un ailleurs – le site – qui est toujours éloigné. Pour ses sculptures appelées « nonsites », Robert Smithson recueillait les matériaux d’un site et les exposait dans un musée à l’intérieur de contenants dépouillés, parfois avec des cartes ou des images du site : le site est éloigné, le nonsite est proche. Le fait de rendre mobile un lieu fixe crée un vide, un trou dans un paysage fluide qui fait entrer la périphérie dans le centre. Il ne faut pas oublier que les centres et les bords ne sont jamais fixes : tout dépend du moment et du lieu où l’on se trouve. Robert Smithson insistait sur l’importance de la reconnaissance des limites, qu’il s’agisse de celles de la vue, du site ou de la connaissance. Pour le lieu de son art, il préférait la périphérie au centre, donc le New Jersey à New York, ou une carrière abandonnée à un paysage bucolique.
Le collage filmique Ocean II Ocean de Cyprien Gaillard fait écho à de nombreux sujets d’intérêt de Robert Smithson ; il superpose site et nonsite, temps géologique et avenir humain, obsolescence et crédibilité. Le film débute par une parade de wagons de métro new-yorkais hors service immergés dans l’océan Atlantique. En se déposant sur le plancher océanique, ils forment le substrat de récifs futurs.
L’écho de ces sites se poursuit par une étude des spirales des fossiles d’ammonites incrustés dans les murs en marbre des stations de métro de villes d’ex-Union soviétique telles Moscou, Kiev, Saint-Pétersbourg et Tbilissi. Les ammonites sont les ancêtres disparus des nautilus, fossiles vivants apparus il y a des millions d’années. Ensemble, ces architectures de mouvement font s’effondrer le futur et le passé dans un avenir possible en les conjuguant au temps présent, en superposant l’histoire géologique et humaine. Le métro est un réseau urbain qui sert à transporter les habitants du centre vers les périphéries et vice versa. C’est un système qui oscille entre la surcharge et le vide, révèle les cycles de la ville et offre un aperçu de la main-d’œuvre disparate grâce à laquelle les rouages de la ville continuent de tourner.
Revenons aux dessins de Robert Smithson : ils sont ses racines, ses idées en gestation, son analyse brute et sans entraves de l’idée de modernisme et des systèmes de connaissance. Il y a des arbres, des spirales, des bifurcations, du langage, des veines, des formes palpitantes qui s’étendent au-delà des corps sylvestres et humains. Dès le départ, son art ne parlait pas du monde : il était du monde. La sélection de Cyprien Gaillard vibre sous l’effet de l’entropie, du temps qui spirale, du bourdonnement produit derrière la façade élégante de la ville.
Il y a une tête qui crie, avec une dent de travers et un crâne perméable révélant un thalamus en forme d’œuf – le relais cérébral qui gère la vue, le toucher, le goût et l’ouïe, mais pas l’odorat. Il y a une autre tête qui, comme les gargouilles, vomit une substance inconnue par la bouche, les yeux et les oreilles en dégringolant entre une tour urbaine moderniste et un immeuble à gradins classique ; les deux édifices sont reliés par des pylônes électriques, et la tête bousculée par un boulet de canon.
42 43
21: «
En 1959, Robert Smithson a visité Rome pendant trois mois. « J’étais très intéressé par l’art byzantin. Je me rappelle m’être promené dans ces vieilles églises baroques et avoir traversé ces caveaux labyrinthiques. Pendant ce temps-là, je lisais des gens comme William Burroughs. Tout semblait étrangement coïncider. Après ce séjour romain, T. S. Eliot a exercé beaucoup d’influence sur moi… J’étais très intéressé par Rome en elle-même. Je voulais comprendre les origines de… ce qu’on peut appeler la “civilisation occidentale” et l’influence de la religion sur l’art21. » L’année suivante, il a réalisé des dessins au crayon qu’il a nommés sur l’envers avec des titres tels Chaos, Disease, Devil, Usury et Work. Dans Usury, un sol composé de corps hybrides et fragmentés alimente une forêt de corps à l’appétit carnavalesque. Le chiffre cinq est le point mort, un symbole de changement et de croissance en numérologie, autre système de croyance auquel Smithson s’intéressait. Dans Chaos, au milieu d’une masse de corps, un être humain se transforme en tête d’animal ressemblant à un masque à gaz ; des bras, désolidarisés des troncs par l’enroulement de leurs épaules en spirale, se déploient sous forme de tentacules, de griffes et d’armes tandis qu’une tête se transforme en nautilus. Ces enchevêtrements de corps thérianthropiques bidimensionnels présentent des formes dessinées avec la simplicité des lignes musculaires des fresques et céramiques que Robert Smithson a certainement vues à Rome. Ils sont entourés de créatures ailées fantastiques qui volent et veulent s’approprier la selve de la ville – comme la nuée de perruches vertes à Düsseldorf dans le film Formation de Cyprien Gaillard, qui occupe une surface de six mètres de haut sur quarante-cinq mètres de large dans les vastes espaces du Palais de Tokyo. Ces oiseaux qui ont échappé à la captivité domestique s’envolent à travers la ville et se regroupent la nuit pour se reposer dans Königsallee, un boulevard de boutiques de luxe.
», in The Collectied Writings, op. cit. p. 282.

22 : Robert Smithson, « Conversation in Salt Lake City / Gianna Pettena (1972) », in The Collected Writings, op. cit., p. 298.
La spirale est de retour – comme à son habitude – dans Nautilus Dub (Second Half), une sculpture de Cyprien Gaillard encastrée dans un mur entre deux miroirs. D’un côté, un miroir révèle une vue intérieure de la coquille, sa structure en spirale s’étendant hors du champ de vision. À l’intérieur de sa première courbe apparaît un détail gravé du tableau Les Proverbes flamands de Pieter Brueghel l’Ancien, une œuvre épique représentant la nature insensée de l’homme à travers le progrès. Cyprien Gaillard entrecroise la figure de style « se cogner la tête contre les murs » avec l’expression plus obscure « un pied chaussé, l’autre nu », idiome qui fait référence à l’équilibre et au déséquilibre. Le mur et l’instabilité, attributs de la fameuse histoire d’Humpty Dumpty, disparaissent dans la spirale. Si l’on pouvait voir juste au-delà du champ de vision, peut-être que le personnage ovoïde observerait cette figure familière désespérée depuis l’autre côté du mur. L’autre miroir de Nautilus Dub (First Half) reflète la coquille à l’infini. Le centre de l’œuvre est occupé par une cellule magnétique et une aiguille de tourne-disque – les outils des platines qui permettent de manipuler le temps et l’espace à travers la spirale de
l’oreille. Le dub est une musique profondément sculpturale : elle rebondit dans l’espace, en modifie l’échelle et la perception, se dédouble et se réverbère, entrelace site et nonsite.
L’intérêt de Robert Smithson pour la spirale dans ces premiers dessins préfigure son œuvre la plus connue : Spiral Jetty. Cet earthwork réalisé en 1970 se trouve à Rozel Point au bord du Grand Lac Salé, un lac salé endoréique situé dans l’État de l’Utah. Construite avec 6 650 tonnes de roche et de boue collectées sur la rive, la spirale change continuellement de forme sous l’effet de la nature, de l’industrie et du temps. Le niveau d’eau du Grand Lac Salé monte et descend en raison du dérèglement climatique, de l’activité industrielle et de l’augmentation rapide de la population. Pour Smithson, il faut embrasser le changement et la déliquescence : Spiral Jetty n’est pas ce qu’elle a été et ne sera pas ce qu’elle est. Robert Smithson insistait sur le fait que la compréhension de la nature doit prendre en compte le facteur humain, et les êtres humains être conscients que leur – notre – existence est inextricablement liée à celle de tous les êtres ; ses earthworks sont vastes et s’écartent de la conception humaniste du monde. Après Spiral Jetty, Smithson s’est de plus en plus intéressé aux projets de remblaiement qui révélaient, plus qu’ils ne les cachaient, les ravages de l’industrie si palpables dans ces dessins. Il voulait réfléchir à la manière dont l’écologiste pouvait travailler avec l’industriel. Ses idées étaient vraiment en avance sur leur temps et reconnaissaient l’impact dévastateur de l’être humain sur le monde. Elles sont enracinées dans ces premiers dessins de recherche qui parlent d’épuisement postindustriel, de marges, de paysages entropiques, toujours au présent et sans nostalgie. Les œuvres d’art de Robert Smithson sont des champs d’informations qu’il est impossible de réduire à un seul élément.

En explorant les limites conceptuelles et physiques du paysage, Robert Smithson et Cyprien Gaillard soulèvent des questions sur notre place dans le monde qui revêtent aujourd’hui un caractère d’extrême urgence. Robert Smithson observait : « En tant qu’artiste, il est assez intéressant de se créer un personnage d’agent géologique où l’homme devient en fait partie intégrante du processus au lieu de le surmonter22. »

44 45
Robert Smithson, Usury ca. 1960–1963
Pieter Bruegel l’Ancien, Les Proverbes flamands, 1559
Robert Smithson, Spiral Jetty, 1970
Interview with Robert Smithson for the Archives of American Art / Smithsonian Institution / Paul Cummings (1972)
Robert Smithson et Cyprien Gaillard s’intéressent aux déchets produits par les êtres humains, à la nature entropique de l’existence que nous essayons de supporter à travers l’art, la croyance et l’empirisme. Aucun de ces deux artistes ne prône un art autonome leur art est désordonné, souillé, à des années-lumière du divertissement. Ils ne sont pas non plus pour l’empirisme : la géologie se confronte à la sciencefiction, et l’histoire au mythe. Tous deux brouillent les frontières et choisissent les zones périphériques du doute plutôt qu’un engagement ontologique clair avec les idées, explorant la croyance en tant que nonsite – une idée pointant toujours ailleurs. Au Palais de Tokyo, Cyprien Gaillard a choisi de présenter les dessins de Robert Smithson sous verre avec des reliques de la toxicité environnementale d’origine humaine : de l’amiante vitrifié 23, substance brillante ressemblant à l’obsidienne. Commercialisé au début de la révolution industrielle, l’amiante était apprécié pour ses qualités isolantes. Il était extrait et intégré à des projets de construction, mais s’infiltrait aussi dans les poumons de celles et ceux qui travaillaient avec ce matériau ou dans des lieux qui en contenaient. On désamiante les bâtiments depuis les années 1970. Les déchets toxiques sont acheminés dans des décharges spéciales ou recyclés en verre de silicate. Comme l’amiante vit plus longtemps que les êtres humains, nous le léguerons aux générations futures. Il représente la deuxième plus grande cause de cancer et sa vitrification coûte dix fois plus cher que son enfouissement. Ces morceaux disposés en guise de presse-papiers sur les œuvres de Robert Smithson proviennent de différents sites ; ses dessins de maladies et de relations abusives côtoient ainsi des reliques matérielles de la fin du 20e siècle dans une double entropie qui évoque l’huile obscure grâce à laquelle la machine de la ville continue de tourner.
« Dans cet essai, le mot “fossile” est utilisé dans un sens particulier pour évoquer la capacité rythmique à re-sentir des espaces opposés, ainsi que pour suggérer l’existence d’un curieux rapport entre la ruine et l’origine en latence dans les arts de la genèse1. » Wilson Harris

« Une des questions qui nous hante aujourd’hui est la nature du temps2. » Wilson Harris
J’ai rêvé que j’étais ailleurs, puis j’ouvrais un œil et me souvins de l’endroit où je me trouvais. Entouré de pièces d’acier, de plastique et de verre rivetées pour former une longue boîte en forme de cercueil, je volais à deux cents kilomètres à l’heure quelque part entre l’Italie et la Suisse. Installé près de la vitre du côté droit, avec une vue de carte postale sur les montagnes de granite et de calcaire ponctuées de lacs d’un bleu océanique, je ne voyais que le smiley géant rose vif aux contours noirs et or tagué sur l’extérieur du hublot de la boîte en forme de cercueil. Le soleil de midi inonde le graffiti de ses rayons, le transformant par intermittence en une sorte de vitrail profane qui se moquait de moi d’un air menaçant tandis que je m’efforçais de regarder la lumière au travers. C’est l’été le plus chaud jamais enregistré et la climatisation était en panne. Je pouvais presque littéralement sentir l’imminence de notre mort collective sur la planète. La vitesse du cercueil fendant l’espace semblait me précipiter vers la fin de cette vie. Nous entrions dans un trou dans le flanc d’une montagne et tout devint noir. Flou. Ce devait être au début du printemps 2019. Je venais de voir Ocean II Ocean pour la première fois et m’étais remémoré un bref passage du livre Network Culture de Tiziana Terranova, dans lequel elle se demandait comment les images pourraient servir d’armes biologiques pour infecter et perturber des environnements en forçant l’association de moments, de lieux et de cultures opposés. Elle citait notamment l’exemple des « trains couverts de graffitis qui faisaient entrer l’intensité hip-hop de Brooklyn au cœur de Manhattan à la fin des années 19703 ». La rame de métro faisait office de médium en ceci qu’elle transférait l’image d’un certain mode de vie dans un espace dont il était normalement exclu en reliant ces moments et lieux disparates au moyen d’un collage oxymorique. Alors que la Metropolitan Train Authority (MTA) de New York considérait les graffitis comme du vandalisme, Tiziana Terranova y voyait au contraire une sorte d’énergie stimulante capable de restaurer une vitalité perdue ou absente dans le centre financier de la ville. La ligne qui sépare le vandalisme de la restauration est très fine et la perception qu’on s’en fait oscille de l’un à l’autre : l’effacement de graffitis sur une rame de métro par les autorités peut être considéré comme un acte de vandalisme restaurateur ou de restauration vandale.
NAUTILUS (VERSION DUB)
Plus spécifiquement, ce que nous voyons dans Ocean II Ocean est une inversion complète de l’effet restaurateur des trains tagués. Les rames désaffectées, au lieu de relier Brooklyn à Manhattan, couvertes de graffitis colorés, sont poncées, décapées puis jetées dans l’océan Atlantique au large des côtes de New York, produisant ce que Cyprien Gaillard appelle « un acte de vandalisme approuvé par le gouvernement, un acte qui a lieu à bien plus grande échelle et ne peut pas être facilement individualisé4 ». Et pourtant, ce vandalisme d’État, cette pollution de la mer par le cortège funéraire de trains morts est mise en scène performativement comme une restauration de la vie sous-marine à travers la création de nouveaux récifs qui redonneront vie aux fonds marins et où la faune pourra se développer.
Ocean II Ocean en est le témoin. Les cassettes Hi8 des archives de la MTA montrent des monstres de métal flottants qui saisissent les wagons morts entre leurs mâchoires, les soulèvent puis les jettent dans leur tombe aqueuse. Au milieu d’une fanfare d’écume blanche, les wagons coulent vers le fond de la mer où ils s’empilent les uns sur les autres, servant de refuge à divers poissons et crustacées, et peut-être

46 47
Louis Henderson
23 : Appelée Cofalit.
Cyprien Gaillard, Ocean II Ocean, 2019
Graffiti dans la station de métro Times Square, début des années 1970
un jour aux coraux. Il y a pourtant une chose à laquelle je n’arrête pas de penser en regardant la vidéo : les trains sont faits d’acier et d’amiante, des produits industriels issus de la combustion d’énergies fossiles, de l’extraction de minerais cachés en profondeur sous les fonds marins et la surface terrestre. Les procédés de fabrication de ces matériaux accélèrent le réchauffement climatique de manière considérable et irréversible, et ces trains inextricablement liés au capitalisme industriel semblent être autant de memento mori annonçant une mort planétaire imminente. L’extraction et la combustion d’énergies fossiles font augmenter la température des océans du monde entier, provoquant la mort des coraux et d’autres animaux, mais aussi des poissons, des algues et du plancton. En atteignant les fonds marins, ces plantes et animaux créeront une couche de matière morte qui finira par les transformer en fossiles, et ceux-ci produiront à leur tour des combustibles fossiles eux-mêmes transformés en pétrole. Peut-être que les trains aussi deviendront des fossiles ? Les archéologues du futur les arracheront peut-être d’un flanc de montagne asséché en y voyant les témoins de ce qu’était autrefois l’océan Atlantique. Ces images de wagons de métro hors service inhumés en mer présentent une inquiétante vision du temps où le passé revient hanter le présent pour poser les bases d’un futur inévitable. Dans ces images, le temps apparaît comme une spirale où la ruine engendre sa propre origine. La vie et la mort ne font plus qu’un, et « En mon commencement est ma fin5 ».
1 : Wilson Harris, Fossil and Psyche Austin, University of Texas Press, 1974, p. 1. 2 Ibid., p. 2.
3 : Tiziana Terranova, Network Culture, Londres, Pluto Press, 2004, p. 142.
4 Extrait d’un e-mail envoyé à l’auteur, 20 juillet 2022.
5 : T. S. Eliot, « East Coker », The Four Quartets, Londres, Faber & Faber, 1944, p. 23.
6 Wilson Harris, Eternity to Season, Londres, New Beacon Books, 1978, p. 9.
7 Wilson Harris, « Adversarial Contexts and Creativity », New Left Review n° 154 (novembre/décembre), pp. 124–128.
8 Wilson Harris, Fossil and Psyche, op. cit.
La veillée funéraire de ces trains engloutis se déroule sous l’eau. La caméra flotte à travers un wagon de métro oublié, croisant des poissons, une tortue et une raie au plus profond du grand bleu, « New York City M Transit », puis coupe sur un gros plan de ce qui semble être l’œil d’acier d’un gros poisson qui me regarde. Pendant que je fixe des yeux le trou noir de sa pupille, son centre blanc étincelant se met à ondoyer et à crépiter au rythme de la musique, comme si c’était le roulement des baguettes sur le steel drum qui faisait vibrer l’image, vibrer le centre de l’œil. Soudain, l’ondoiement se dilate et il devient évident que cet œil est en fait nos propres yeux qui sont dans l’eau et regardent dans l’eau. Peut-être n’est-ce que le reflet de mon œil qui regarde le vide obscur de sa propre pupille ? L’eau tombe en cascade depuis les bords du cadre, inondant l’image reflétée de mon œil qui me regarde et se transforme en trou noir dont le centre absorbe toute matière par le pouvoir de sa force gravitationnelle. Deux points opposés font tourbillonner le haut et le bas d’un cercle qui se défait (sens dessus dessous) et nos yeux sont évacués par le centre qui spirale de ce qui se révèle lentement être une cuvette de W.-C. en métal. En tant que trou noir, la cuvette des toilettes est une frontière entre la vie et la mort, nos cellules mortes étant chassées sous forme d’excréments – grouillants de bactéries vivantes – dans l’eau qui finira par alimenter l’océan. Dans ce trou noir, le temps/l’espace, la vie/la mort mutent l’un en l’autre. La matière se reforme ailleurs et autrement en renaissant dans l’au-delà, dans le monde d’en dessous, sous la terre. Enterrement.
Ce moment est le tournant de la vidéo autour duquel deux mondes axiaux sont en rotation. Le trou noir qui tourne marque la rencontre entre le monde du dessus et le monde du dessous. S’ensuit l’exhumation d’un océan jurassique inversé, environ quatre-vingt-quatre mètres sous la surface terrestre. Les lumières d’une rame de métro qui passe se reflètent sur le marbre moucheté qui orne le sol, les murs et les colonnes d’une station de métro profondément enfouie quelque part sous terre. Des tons rouges, verts, noirs, blancs, crème et gris colorent les taches, les motifs flous et les imperfections des créatures marines préhistoriques fossilisées prises dans la roche métamorphique. Alors que la musique va crescendo


et se réverbère en rythme dans un écho, les animaux piégés dans l’hypostase rocheuse commencent à bouger. L’image ondoie et sa surface se liquéfie, les vibrations des steel drums redonnant vie aux fossiles.
Illustration d’un trou noir avec les données fournies par la NASA, 2020
À travers l’image et le son, grâce à des mouvements de caméra subtils et à la musique, Ocean II Ocean forme ce que Wilson Harris appelait des « fossiles vivants » en citant le scientifique français Jacques Monod : « Tout être vivant est aussi un fossile6. » Pourrait-on faire pivoter cette formule sur son axe pour affirmer que tout fossile est aussi un être vivant ? L’expression « fossile vivant » est un bel oxymore dans la mesure où la mort est l’essence même du fossile. Ce mot n’est nécro-ontologique que quand on l’envisage simplement comme un nom, mais en ajoutant la forme adjectivale du verbe « vivre » au mot « fossile », ce nom est animé par une résurrection dialectique où les significations habituelles de « fossile » et de « vivant » sont réfutées par la « re-sensation » d’« espaces opposés » réunis dans une association paradoxale. Les deux mots « consument leurs propres biais7 » et ne s’annulent pas ; au contraire, ils sont sublimés dans une signification supérieure qui désigne quelque chose d’à la fois vivant et mort.
Les vivants et les morts sont composés par les pouvoirs de re-sensation du montage d’Ocean II Ocean qui créent cette « capacité rythmique » grâce à laquelle les images deviennent oxymores. Des espaces et des temps contradictoires sont réunis par un type spécifique d’œil/d’oreille cinématographique capable de re-sentir le monde qu’on lui présente. Le monde marin situé au-dessus du plancher océanique reflète et est reflété par le sous-sol marin jurassique fossilisé, et en se reflétant l’un l’autre, ils créent une répétition variée, une « répétition infinie » qui, je le crois, est idéalement représentée par la forme de la spirale. Quand la caméra s’éloigne en zoom arrière du corps en spirale d’une ammonite fossilisée, je commence à comprendre que la structure même du montage se trouve à l’intérieur des images qu’il utilise. La boucle fluide de la vidéo n’est peut-être pas qu’une simple répétition, mais une répétition qui change chaque fois que je la vois parce qu’elle et moi changeons à chaque fois, dans le temps et avec le temps qui n’a « ni début précis ni fin déterminée8 ». La capacité rythmique de cette répétition infinie fonctionne comme un contre-chant où deux mélodies indépendantes sont jouées simultanément, l’une sous l’autre, soulignant la rupture du temps et de l’espace entre les différents océans, comme si l’océan jurassique souterrain était la contre-mélodie syncopée de l’océan Atlantique évoluant au-dessus des fonds marins. Un contrechant, comme un oxymore, met précisément en valeur la ligne de différence qui oppose deux choses et nous demande de prêter attention à la tension induite par la comparaison. Ici, semble-t-il, la tension repose sur la compréhension fixe de l’océan Atlantique comme l’origine (animaux/vie) qui engendre l’océan jurassique en tant que ruine (fossile/mort). Dans la rotation axiale de ces océans qui se reflètent, pouvons-nous voir une inversion de la genèse de l’un dans l’autre, les créatures marines jurassiques faisant office d’indices originels de la dégradation de l’Atlantique et de tous les océans par les combustibles fossiles ? Les morts peuventils nous renseigner sur ce que sera notre avenir ?
La bande-son de la vidéo représente un autre lieu de dissonance important. Une analyse contrapuntique approfondie pourrait révéler l’influence de la musique sur le montage. En effet, la bande-son repose sur un contre-chant entre le groupe
48 49
Cyprien Gaillard, Ocean II Ocean, 2019, vue d’exposition au Palais de Tokyo (HUMPTY), 2022
de steel drum afro-trinidadien Solo Harmonites et l’opérette Cavalerie légère de Franz von Suppé (1866), dont les Solo Harmonites ont créé leur propre version interculturelle en 1972. Ainsi, un collage de fragments d’une musique créée dans un pays caribéen réinterprète la musique classique d’un pays européen. L’existence même de cette musique dépend de la présence absente – de l’au-delà – de la domination coloniale de l’Europe sur les Caraïbes par le travail forcé et la traite atlantique des esclaves. Au 18e siècle, la traite sucrière générait de moins en moins de profits aux Caraïbes, ce qui a en partie encouragé l’abolition du commerce d’esclaves. Trinité-et-Tobago a donc délaissé les plantations de sucre au profit des champs de pétrole, devenant le plus grand producteur de pétrole des Caraïbes. À l’origine, les steel drums tels que ceux qu’on entend sur la bande-son étaient des barils en métal remplis du pétrole extrait des fonds marins de Trinitéet-Tobago et expédiés aux quatre coins du globe pour alimenter le capitalisme industriel. La population afro-descendante les a reconvertis en instruments pour jouer de la musique au carnaval après que les autorités coloniales avaient banni l’usage de ses tambours à la fin du 19e siècle. Eux-mêmes fossiles vivants, les steel drums témoignent du recours au travail forcé et aux combustibles fossiles au sein du système capitaliste des plantations qui a conduit à la mort présente et future de nos océans.
aux steel drums est une autre forme de re-sensation qui, comme le dit Nathaniel Mackey, implique « un mouvement du nom vers le verbe12 » entrant « en contradiction avec l’hypostase, la réification d’identités fixes qui empoisonne la vie des groupes socialement marginalisés13 ». Le mouvement du nom vers le verbe est une façon de réanimer l’objet apparemment statique, de le doter de la capacité de se déplacer et de s’exprimer, d’arracher les idées fossilisées qui s’effritent afin de les soustraire aux récits totalisants et monolithiques pour les raconter autrement, pour les mettre en mouvement différemment.

9 Selon Nathaniel Mackey, l’engagement dissonant est « une expression inventée en référence à des pratiques qui, en vue d’ouvrir des ordres d’identité et de signification supposément fermés, mettent l’accent sur la fissure, la fracture, l’incongruité, l’assortiment bancal et imparfait entre mot et monde ». L’engagement dissonant « cherche à déloger les modèles d’identité homogènes et les hypothèses de forme monolithique ». Il « relève et est symptomatique de la méfiance postmoderne/postcoloniale envers les paradigmes totalisants ». Voir Nathaniel Mackey, Discrepant Engagement: Dissonance, Cross-Culturality, and Experimental Writing Cambridge, Cambridge University Press, 1993.
10 Dick Hebdige, cité in Nathaniel Mackey, « Other: From Noun to Verb », in Discrepant Engagement, op. cit., p. 266.
11 : Nathaniel Mackey, « Other », op. cit., p. 267.
12 Ibid., p. 266.
13 : Ibid., p. 267.
14 Nathaniel Mackey, « Poseidon: Dub Version », in Discrepant Engagement op. cit. p. 189.
15 Wilson Harris, The Four Banks of the River of Space, Londres, Faber and Faber, 1990, p. 151.
Une analyse contrapuntique de la relation coloniale ancrée dans les strates conscientes et subconscientes de la version de Cavalerie légère jouée aux steel drums par les Solo Harmonites révèle toutefois un engagement dissonant9 au cœur de cette histoire de subordination entre l’Europe et les Caraïbes. La musique atteste aussi de l’utilisation du steel drum pendant le carnaval comme une négation à la fois politique et spirituelle de l’ordre exercé par la suprématie blanche. Le bidon de pétrole transformé en instrument de musique porte en lui la mémoire de la divinité yoruba Ogun, le seul orisha capable de créer des objets en métal à partir des minerais présents sous la surface terrestre, et qui à ce titre préside au métal, à la terre, aux ferronniers, à la technologie, à l’armement et au transport, mais aussi à la guerre et à la résistance. À Trinité-et-Tobago, Ogun est l’orisha protecteur du steel drum, et quand les baguettes font vibrer le métal, l’instrument convoque la présence absente d’un pouvoir animiste qui a contribué à l’indépendance et à l’affranchissement de l’esclavage.

Il est intéressant de noter que la musique choisie pour la vidéo est la reprise aux steel drums d’un morceau existant, or, comme nous le dit le sociologue Dick Hebdige, la reprise « est non seulement au cœur du reggae, mais aussi de toutes les musiques afro-américaines et caribéennes : jazz, blues, rap, R&B, reggae, calypso, soca, salsa, musique afro-cubaine, etc.10. » Pour Nathaniel Mackey, la reprise est l’une des manières dont l’expression artistique noire utilise les « pratiques d’altérisation » pour « réagir et réfléchir de façon critique à l’autre type d’altérisation auquel ses pratiquants, privés de capacité d’action dans la société qui les désignent comme autres, ont été soumis11 ». En ce sens, je pense donc que la reprise des Solo Harmonites inverse totalement le rapport de force colonial, et qu’elle peut être considérée à ce titre comme un geste d’appropriation culturelle provocateur qui exerce une capacité d’action nouvellement trouvée et reconfigure notre compréhension de l’idée même d’originalité. La version de Cavalerie légère
Cette mise en mouvement à travers la reprise constitue l’un des aspects clés de la musique dub jamaïcaine. Pratique de studio d’enregistrement née à Kingston dans les années 1960, le dub dépouillait les disques « jusqu’à l’os », c’est-à-dire jusqu’aux basses et aux percussions, avec des fragments de voix qui se réverbéraient en écho et dégoulinaient sur la section rythmique pour créer des « versions doublées » des morceaux originaux, lesquelles étaient ensuite encore doublées par le DJ racontant sa propre reprise narrative par-dessus et en direct sur le sound system. L’écho, la réverbe et le delay comptent parmi les outils grâce auxquels le dub modifie le temps et l’espace d’un morceau de musique existant, en lui conférant plus de profondeur et une présence spectrale. Peut-être que le dubplate est aussi une sorte de fossile vivant, l’indice d’un événement passé ranimé par le sillon en spirale au creux duquel le saphir vibre. En fait, la bande-son est une version dub que Cyprien Gaillard a lui-même faite de la reprise aux steel drums : il a créé une boucle composée de sections du disque des Solo Harmonites pour obtenir un tout nouveau morceau de musique. Celui-ci a ensuite été mixé par Moritz von Oswald de Rhythm and Sound, qui a ajouté des effets dub de studio – écho, réverbe et delay – apportant de nouvelles textures presque liquides à la musique. Il est évident qu’Ocean II Ocean n’utilise pas ces techniques pour les mêmes raisons que les Solo Harmonites ou les producteurs de dub jamaïcains, mais de par sa forme et son contenu, la vidéo engage un ensemble de pratiques et d’idées qui « cherchent à déloger les modèles d’identité homogènes, les hypothèses monolithiques et les attentes puristes en redéfinissant “les caractéristiques de l’expression originale”14 ». L’œuvre de Cyprien Gaillard met la fixité en mouvement en exerçant une dissonance vers la notion de séparation entre des termes tels que vie/mort, mouvement/ immobilité, début/fin, berceau/tombe, nom/verbe, animal/fossile ou origine/ ruine, qu’elle inverse totalement pour proposer de tout autres grilles de lecture du présent, aussi empêtré soit-il avec le passé et le futur.
« Aucune reconstruction fossile de squelette ou d’ossature n’est une réalisation purement technique ; car ce qui est reconstruit par une manœuvre faillible marche, nage ou vole à nouveau dans l’inconscient universel de la nature pour s’interroger, pour remettre en cause toute formule par laquelle ses écailles, ses plumes ou ses poils ont été créés. C’est ainsi qu’un petit enfant revit dans un corps de complétude inconsciente qui remet en question chaque initiative de l’imagination faillible visant à le fixer, ou à l’épingler, au mur d’une cabane ou d’un musée15. » Wilson Harris
50 51
Stephen Mallon, The End (Série « Next Stop Atlantic »), 2008–2011
Cyprien Gaillard, Ocean II Ocean, 2019
Cyprien Gaillard, Love Locks 2022

Sacs, cadenas prélevés sur le pont des Arts et le pont de l’Archevêché (Paris) Œuvre produite grâce à une donation de la Ville de Paris Courtesy de l’artiste
Nous sommes accueillis à l’entrée de l’exposition par cinq grands sacs remplis de cadenas. Ils se trouvaient, il n’y a pas si longtemps de cela, suspendus aux rambardes du pont des Arts et du pont de l’Archevêché, où ils furent accrochés par des couples de touristes. Les uns après les autres répétèrent le même rituel. Après avoir acheté un cadenas pour quelques euros à un vendeur de rue, ils y inscrivaient une déclaration d’amour tenant généralement en quelques syllabes : « Jack + Sheila 2018 », « R.G. ♥ E.F. », « Iris & Sean forever ». Puis, ils verrouillaient le cadenas sur les grilles du pont et jetaient la clé dans les eaux de la Seine, comme pour sceller un certain état du monde et de leur relation. Ces « preuves d’amour » se sont accumulées comme autant d’excroissances, modifiant peu à peu la morphologie des ponts qu’elles ont parasités de tout leur poids, au risque de les briser, comme ce fût le cas des grilles du pont des Arts, en 2014. La Ville de Paris procède régulièrement à des opérations de retrait de ces cadenas, dont une partie est ici rassemblée. Ceux-ci témoignent aussi de l’imbrication de nos vies sentimentales dans l’architecture, et des heurts qui peuvent découler de leur rencontre. Censés représenter l’amour éternel, les cadenas n’auront finalement pas su résister au passage du temps. Ils se retrouvent, dans l’exposition, arrachés au paysage urbain et rouillés par la pluie, agglomération de désirs disloqués.
Cyprien Gaillard, Overrunner (Sjöguden / Kungsträdgården / East River Park) 2019
Diptyque, polaroïds à double exposition, passe-partout, cadre en aluminium et plexiglas

Courtesy de l’artiste, Sprüth Magers et Gladstone Gallery
Ce diptyque juxtapose une toilette publique de l’East River Park de New York à la sculpture Sjöguden de Carl Milles, une œuvre située de l’autre côté de l’Atlantique, sur un quai à Stockholm. Elle représente un dieu marin traversé par une plateforme de la station de métro Kungsträdgården, qui semble jaillir de sa gueule béante.
53
HUMPTY
ŒUVRES
Palais de Tokyo, Paris
NOTICES DES
Renaud Gadoury
Cyprien Gaillard, The Lake Arches (Restored version) 2007–2022

Vidéo 1’39’’, rétroprojection sur écran de verre Courtesy de l’artiste, Sprüth Magers et Gladstone Gallery
Deux amis échangent quelques paroles devant un lac artificiel. L’instant d’après, ils s’élancent et plongent dans l’eau. L’un d’eux en ressort crispé de douleur et le visage ensanglanté. Son plongeon a été arrêté par le fond étonnamment peu profond du bassin qu’il a violemment percuté.
La caméra dézoome et révèle, à l’arrière-plan, les Arcades du Lac, un ensemble architectural de Ricardo Bofill. Ses piazzas bordées d’arches rappellent certains paysages métaphysiques peints par Giorgio de Chirico. Conçu comme un « Versailles du peuple », ce projet monumental affiche un style postmoderne empreint de classicisme que l’on pourrait qualifier d’« architecture de façade », à l’instar de ce miroir d’eau qui tient lieu de lac. Ce décalage entre forme et fonction est parfois source de malentendus, voire d’accidents, et révèle la nature ambiguë et parfois douloureuse de notre relation à l’espace bâti.
Giorgio de Chirico, Oreste e Pilade 1928

Gouache, charbon, craie noire
Courtesy The Mayor Gallery
© Adagp, Paris, 2022
Dans la mythologie grecque, les figures d’Oreste et Pylade sont connues pour leur amitié indéfectible et pour la force de l’amour qui les unit. Ils occupent ici le centre du dessin, où ils se tiennent côte à côte. Leurs visages dénués de traits leur donnent l’apparence de mannequins ou de statues antiques que le temps aurait érodées. De leurs estomacs émergent des fragments de colonnes, de corniches et de quelques bâtiments aux volumes dépouillés. L’architecture est à l’intérieur de leurs corps comme ceux-ci sont à l’intérieur d’elle, le cadre néoclassique qui borde le tableau venant cloisonner leur univers. Ils font face à l’œuvre vidéo The Lake Arches qui, comme eux, offre une vision de l’enchevêtrement des corps et de l’architecture.
Le dessin de Giorgio de Chirico est présenté sous une vitrine qui renferme un ensemble d’appareils permettant de réguler la circulation de l’air et le taux d’humidité afin d’éviter d’exposer la peinture à des variations climatiques trop importantes, susceptibles de l’endommager. La préservation du tableau nécessite donc sa mise à distance du monde extérieur, qui le place « sous respirateur artificiel ».
Gargouilles crachant du plomb 1873–1914
Dispositif scénographique par Cyprien Gaillard, 2022 Gargouilles provenant de la cathédrale Notre-Dame de Reims et déposées suite à l’incendie de 1914, plomb, pierre de Courville © Centre des monuments nationaux, palais du Tau (Reims) Classées monuments historiques au titre immeuble par arrêté du 1er janvier 1862
Des créatures en pierre flottent dans le Palais de Tokyo. Ces gargouilles rescapées de la cathédrale Notre-Dame de Reims s’apparentent à des fantômes minéraux. De leurs gueules coulent d’épaisses coulées de plomb, sortes de reflux vomi par l’architecture.
Ces gargouilles ont été créées entre 1861 et 1873 lors des travaux de restauration entrepris par Eugène Viollet-le-Duc pour rendre à la cathédrale son aspect du 12e siècle. Elles ont été gravement endommagées le 19 septembre 1914 quand des obus allemands ont embrasé les échafaudages en bois d’un chantier de restauration. La charpente en plomb de l’édifice s’est alors liquéfiée sous l’effet de la chaleur de l’incendie, s’écoulant dans les chenaux et à travers la gueule des gargouilles.
En les exposant auprès de fossiles préhistoriques et d’œuvres contemporaines, Cyprien Gaillard complexifie encore davantage leur ancrage temporel. À la fois incarnations d’un Moyen Âge fantasmé par un architecte du 19e siècle et victimes collatérales de la Première Guerre mondiale, elles sont désormais libérées de leur contexte historique et de leur fonction initiale de canalisations. En les présentant en état d’apesanteur, suspendues, Cyprien Gaillard en propose une lecture nouvelle, teintée d’étrangeté et de surréalisme.
Cyprien Gaillard, Overburden (1), Overburden (2), Overburden (3) 2020

Nid d’abeille en aluminium, roche sédimentaire, incrustation en acier inoxydable Courtesy de l’artiste, Sprüth Magers et Gladstone Gallery
Cette série, qui fait écho à l’œuvre vidéo Ocean II Ocean, emprunte son titre au verbe overburden qui, en anglais, signifie « surcharger de travail ». Dans l’industrie minière, ce terme désigne les couches de matière à retirer avant d’atteindre la ressource désirée. Dans un cas comme dans l’autre, ce mot fait référence à une forme de surplus. Véritable marqueterie de marbre et d’acier, cette série de sculptures est parsemée de fossiles. À la surface du marbre apparaît le logo en acier de la New Jersey Transit Corporation, ainsi que des vis incrustées en tout point identiques à celles que l’on trouve sur les fenêtres des wagons de métro new-yorkais. Chacune des plaques a été affinée avec une ponceuse industrielle ainsi qu’une machine de coupe à jet d’eau, qui servit à découper les bords de l’œuvre et l’espace destiné à l’incrustation du logo. Ce procédé de réduction par l’eau rappelle le processus de sédimentation survenant dans les fonds marins, qui condense le passage du temps sous une forme minérale extrêmement dense. Les plaques de marbre constituent aussi une forme primitive d’enregistrement, tels des photogrammes préhistoriques conservant l’empreinte d’un passé lointain.

54 55
Pigmentation à partir d’éléments désagrégés de l’ascenseur ouest (1899) de la tour Eiffel
Cette œuvre a reçu le généreux soutien de la Société d’exploitation de la tour Eiffel (Paris)
Courtesy de l’artiste et Galerie Allen
Daniel Turner travaille principalement dans le domaine de la sculpture en transformant des matériaux, des objets et des environnements en formes tactiles ou atmosphériques. Ses œuvres se caractérisent par une réponse spécifique à un site, suivant un ensemble contrôlé de processus mécaniques et chimiques.
Dans le cadre des travaux de rénovation des ascenseurs de la tour Eiffel, plusieurs des câbles historiques servant à soutenir les cabines ont dû être retirés et remplacés. Ce sont ces résidus qui servent de matière première à l’œuvre. L’artiste les détourne de leur fonction initiale, qui consistait à lutter contre la gravité en élevant de lourdes charges sur un axe vertical, pour en faire une expression de légèreté déployée à l’horizontale. Objet de campagnes de restauration régulières, la tour Eiffel illustre parfaitement l’étendue des ressources que nécessite la conservation patrimoniale et ses efforts visant à fixer l’architecture hors du temps. Les câbles de la tour Eiffel ont été fondus sous une forme solide et cylindrique, avant d’être fraisés en filaments d’acier par un processus d’usinage numérique (CNC). Ceux-ci sont réduits en brins de métal conglomérés de manière à constituer une laine d’acier, qu’il frotte contre de larges pans de murs. En résulte une tache grisâtre laissée dans le coin d’une pièce, telle une ombre sans objet.
En travaillant à partir d’une matière maintes fois transformée, issue du célèbre monument parisien, Daniel Turner porte notre attention sur l’inexorable métamorphose du monde matériel, où même les plus hautes tours finissent par devenir poussière.
Cyprien Gaillard, Everything but Spirits 2020
Polaroïds à double exposition, passe-partout, cadres en aluminum et plexiglas


Courtesy de l’artiste, Sprüth Magers et Gladstone Gallery
Des réfrigérateurs de bières, typiques des épiceries américaines, sont envahis par des plantes à l’aspect minéral dont les formes sculpturales évoquent un paysage sous-marin composé d’algues et de coraux. Grâce à la technique de la double exposition, ces compositions juxtaposent entre elles plusieurs photos comme autant de couches de sédiments que l’artiste conglomère en une seule image. Le titre de cette série de photographies joue sur la polysémie du terme spirit qui, en anglais, renvoie à la fois au concept d’esprit et aux boissons spiritueuses.
Cyprien Gaillard, Sober City 2015
Polaroïds à double exposition, passe-partout, cadre en aluminium et plexiglas
Courtesy de l’artiste, Sprüth Magers et Gladstone Gallery
Dans son roman La Forêt de cristal (1967), J. G. Ballard raconte le parcours chaotique d’un physicien qui se fraye un chemin à travers une jungle en proie à un mystérieux phénomène métamorphosant sa faune et sa flore en une multitude de cristaux. Ceux-ci finissent par complètement l’absorber, plongeant hors du temps et dans une existence intermédiaire l’ensemble des êtres et des choses qui s’y trouvent.
Prenant place à New York, Sober City présente une vision similaire. Des clichés pris en extérieur se superposent à des photos d’une géode d’améthyste, conservée dans les collections du musée américain d’Histoire naturelle, qui surgit dans les zones d’ombre de la ville et disparaît dans sa lumière. Ces doubles expositions sont le résultat de déplacements répétés entre l’espace urbain et la géode, qui en est le point de départ à la fois géographique et conceptuel.
Selon la lithothérapie, une pratique de soin basée sur le pouvoir des cristaux, l’améthyste possède des vertus purificatrices qui peuvent, entre autres, participer à soigner des addictions à la drogue, à l’alcool ou au tabac. Elle accompagne donc la guérison, à l’image de cette accolade visible sur l’un des polaroids entre Pee Wee Reese et Jackie Robinson, le premier joueur noir des ligues majeures de baseball américaines. Ce geste d’amitié en est venu à symboliser l’abattement des frontières raciales qui divisent encore aujourd’hui la société. Cyprien Gaillard pointe la possibilité d’une réparation.
Cyprien Gaillard, Ocean II Ocean 2019
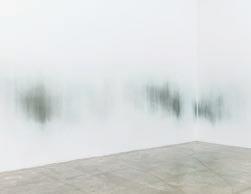
Vidéo HD, bande-son composée par Moritz von Oswald et Cyprien Gaillard, 10’56”
Courtesy de l’artiste, Sprüth Magers et Gladstone Gallery
Au fond de l’océan Atlantique, des créatures marines s’aventurent dans un wagon de métro abandonné, évoluant au son des steel drums, ces instruments de percussion caribéens fabriqués à partir de barils de pétrole vides. Un logo indique qu’il appartient à la MTA, l’agence responsable des transports publics de la région métropolitaine de New York, qui est à l’origine de la décision d’engloutir des milliers de wagons au large de la côte est des États-Unis dans le but de créer des récifs artificiels. Décrié par certains groupes écologistes, soutenu par d’autres, ce projet a abouti à la création d’un étrange paysage marin ponctué, entre autres, des carcasses en acier inoxydable d’anciens Brightliners, ces iconiques wagons argentés qui ont marqué le paysage urbain new-yorkais depuis leur introduction dans les années 1960.

Apparaît ensuite un point lumineux à la surface d’une eau limpide, comme une étoile lointaine emportée dans un tourbillon qui se révèle être la chasse d’eau d’une toilette publique new-yorkaise.
De l’autre côté, une rame de métro file entre les quais d’une station datant de l’époque soviétique. Puis s’enchaîne une succession de plans filmés dans les stations des métros de Kiev, Moscou, Saint-Pétersbourg, Tbilissi, Bucarest et Berlin. Leurs murs et leurs sols sont recouverts de marbres venus des montagnes de l’Oural, de Crimée, du Caucase et de Transylvanie. Visibles à leur surface, quelques fossiles d’ammonites, nautiloïdes, bélemnites et autres créatures marines témoignent de temps géologiques reculés. Certains d’entre eux, dont l’origine remonte à la période jurassique, attestent de la présence d’océans disparus, notamment la Panthalassa, surnommée « l’océan primitif ». Dans le reflet du marbre, ces empreintes ancestrales se juxtaposent aux wagons de métro, faisant ainsi écho à leurs homologues new-yorkais immergés qui, à force de sédimentation, formeront de nouveaux fossiles au fond de l’Atlantique.
56 57
Daniel Turner, Eiffel Cable Burnish 2022
Graphite sur papier
Courtesy de l’artiste,
Sprüth Magers et Gladstone Gallery
Les bouches d’égout qui jalonnent la chaussée sont autant de portes menant au monde souterrain qui se déploie sous nos pieds. Elles séparent l’espace urbain de ses rebuts qui cheminent secrètement à travers les canalisations s’étalant sous la ville tel un système racinaire. Cyprien Gaillard, en exposant leurs empreintes, confère à ces objets confidentiels une nouvelle forme de visibilité. Ces marques ont été obtenues, en deux temps, par le frottement d’une craie de graphite contre une feuille de papier directement apposée sur deux plaques d’égout, situées de part et d’autre de la rivière qui sillonne la ville de Passaic dans l’État du New Jersey, ville natale de l’artiste américain Robert Smithson. Des variations au niveau de leur typographie dénotent le décalage temporel qui les sépare.
En 1967, Smithson a consacré un article à cette ville de la banlieue new-yorkaise. On y suit une excursion qu’il présente comme une visite guidée des monuments locaux. On y rencontre, entre autres « monuments », un bac à sable, des piliers en béton soutenant une autoroute et des tuyaux déversant une eau grisâtre dans la rivière attenante. Comme Robert Smithson avant lui, Cyprien Gaillard s’intéresse à l’aspect entropique de ces espaces laissés à eux-mêmes, qui semblent suspendus hors du temps, quelque part entre un passé révolu et leur ruine prochaine. Vers la fin de son article, Smithson s’interroge : « Passaic a-t-elle remplacé Rome au titre de Ville éternelle1 ? »
1: Robert Smithson, « The Monuments of Passaic », Artforum, vol. 6, n° 4, décembre 1967, pp. 48–51.
Cyprien Gaillard, Nautilus Dub (First Half)
2022
Coquille de nautile, cellule Ortofon Concorde
Courtesy de l’artiste, Sprüth Magers et Gladstone Gallery
Une demi-coquille de nautilus encastrée dans un mur est bordée de deux miroirs dans lesquels son reflet se répercute à l’infini. De son centre émerge une cellule Ortofon Concorde, un modèle prisé par les DJ du monde entier et dont la forme élancée évoque celle de l’avion éponyme. Le titre de l’œuvre fait référence au dub, un genre musical né de la pratique du remix originaire de Jamaïque qui a exercé une influence décisive sur le développement de la musique électronique. Souvent associé à la notion d’écho en raison de son utilisation du delay et de la reverb le dub donne parfois l’impression de se trouver au cœur d’un vaste espace souterrain, au fond d’une grotte ou d’un océan.

Untitled, 1961, crayon et aquarelle sur papier, 32,1 × 37,8 cm
Untitled, 1962, encre sur papier, 45,7 × 61 cm
Ill Defined Drawing or What Not to Do [recto/verso], ca. 1960–1963, crayon sur papier, 48,3 × 61 cm Work, 1960, crayon sur papier, 43,2 × 45,7 cm

The Whore, 1960, crayon sur papier, 61 × 45,7 cm
Usury, 1960, crayon sur papier, 45,7 × 54,6 cm
Untitled, 1962, encre sur papier, 55,6 × 41 cm Disease, 1960, crayon sur papier, 45,7 × 44,5 cm
First Drawing for a Shrine in an Abandoned Quarry in Montclair, N.J., ca. 1960–1963, crayon sur papier, 61,3 × 45,7 cm
Untitled, n.d., encre et gouache sur papier, 31,1 × 29,8 cm
Untitled, 1962, encre sur papier, 45,7 × 61,6 cm Usury, ca. 1960–1963, crayon sur papier, 25,4 × 45,7 cm Devil, 1960, crayon sur papier, 48,3 × 36,2 cm Chaos, 1960, crayon sur papier, 61 × 35,6 cm Exhaust, 1961, encre sur papier, 61 × 45,7 cm
Courtesy Holt/Smithson Foundation et Marian Goodman Gallery
© Holt/Smithson Foundation / Adagp, Paris, 2022
Les dessins de jeunesse de Robert Smithson sont peuplés de personnages inquiétants, de monstres dévorant des corps dilacérés, de démons menaçants et de créatures ailées tombant du ciel, tels des anges déchus. À première vue, ces visions dantesques à mi-chemin entre le carnaval et l’enfer paraissent complètement étrangères aux earthworks, les œuvres environnementales plus tardives de Robert Smithson conçues à partir de sites extérieurs. Pourtant, on y voit naître plusieurs des obsessions qui accompagnent l’ensemble de sa pratique :
l’imbrication entre l’humain, l’architecture et le paysage, les thèmes cosmologiques, la sédimentation des corps, l’étendue du temps géologique ainsi que les investigations in situ, dont témoigne le croquis d’un projet de sanctuaire non réalisé dans une mine abandonnée du New Jersey.
De part et d’autre des dessins, Cyprien Gaillard dispose, en guise de presse-papiers, des morceaux de Cofalit qui font le pont entre les différentes feuilles. Ce matériau vitreux, parfois qualifié de « matière dernière », est le résultat de recherches visant à détoxifier les déchets contenant de l’amiante par un processus de vitrification qui permet de faire fondre les fibres d’amiante pour les rendre inoffensives. Cette métamorphose n’est pas sans rappeler certains travaux de Robert Smithson dans lesquels les paysages se transmutent. Bien qu’ancrée dans la matière, sa pratique n’est pas pour autant exempte de transcendance, comme en témoignent les thèmes de ses premiers dessins qui ébauchent une forme de mysticisme de la terre marqué par le chaos et l’entropie.

Robert Smithson, First Drawing for a Shrine in an Abandoned Quarry in Montclair, N.J., ca. 1960–1963
Fragment d’amiante vitrifiée utilisé comme presse-papier par Cyprien Gaillard, vue d’exposition au Palais de Tokyo (HUMPTY), 2022
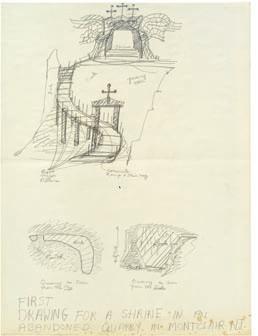
58 59
PASSAIC
Cyprien Gaillard, Gates
2013
Robert Smithson
Käthe Kollwitz, Mutter mit zwei Kindern 1932–1936 (1984)

Bronze fonte posthume, fonderie d’art Hermann Noack Berlin Courtesy Käthe-Kollwitz-Museum, Berlin
Cyprien Gaillard, Nautilus Dub (Second Half) 2022

Coquille de nautile gravée, encre de Chine Courtesy de l’artiste, Sprüth Magers et Gladstone Gallery
Seconde partie du diptyque, cette demi-coquille de nautilus évoque avec sa forme en spirale le plan de l’exposition HUMPTY qui débute avec de grandes salles, se poursuit dans une longue galerie incurvée et se termine par une cage d’escalier s’enroulant sur elle-même.

S’inscrivant dans la tradition de la gravure sur coquillages qui remonte au 17e siècle, cette œuvre est ornée d’une gravure ciselée à même la nacre qui représente un homme se heurtant la tête au mur qui lui fait face. Il s’agit de la reproduction d’un détail d’un tableau de Pieter Brueghel l’Ancien illustrant de manière littérale le proverbe flamand « frapper sa tête contre un mur de brique », qui désigne l’action de tenter l’impossible.
L’œuvre renvoie également à la figure d’Humpty Dumpty tombant d’un mur, symbole de l’impossibilité de reconstituer ce qui, comme lui, s’est irrémédiablement brisé. Cette sculpture, à l’instar de l’exposition, vise à conjurer cette impossibilité en créant un tout à partir de bribes éparses. Le dispositif de l’œuvre permet ainsi au coquillage de retrouver sa forme complète à partir d’un simple fragment qui se dédouble dans le miroir. Comme souvent dans la pratique de Cyprien Gaillard, le morcellement côtoie ici un désir d’unification.
Cyprien
Gaillard, Formation 2021
Vidéo ultrapanoramique, 1:7.45, 4’17’’
Produite par VOLTE, financée par le Medienboard Berlin-Brandenburg et le Gouvernement fédéral à la culture et aux médias
Courtesy de l’artiste, Sprüth Magers et Gladstone Gallery
Une nuée d’oiseaux au plumage vert clair voltige entre les gratte-ciel et les boutiques de luxe de la Königsallee, une rue située en plein centre de Düsseldorf. Il s’agit de perruches à collier, une espèce originaire d’Afrique et d’Asie introduite en Allemagne de l’Ouest vers la fin des années 1960. Certains spécimens, qui ont échappé à la captivité, sont à l’origine des colonies de perruches installées dans plusieurs centres urbains de la vallée du Rhin, où le climat tempéré et l’absence de prédateurs ont favorisé leur prolifération. Leur impact sur la faune locale est depuis débattu. Certaines études démontrent que la concurrence faite aux oiseaux indigènes à la région n’est que très relative, alors que d’autres se font plus alarmantes, incitant ainsi la ville de Düsseldorf à réintroduire sur son territoire le faucon pèlerin, un prédateur de la perruche à collier.

Au centre des enjeux écologiques soulevés par la présence de ces oiseaux exotiques en Europe, se trouvent l’opposition apparente entre espèces invasives et indigènes ainsi que la notion de conservation, au sens de préservation en l’état de la nature. Or, comme nous le rappelle Emanuele Coccia, « il n’y a aucune forme de vie strictement autochtone […] La relation au territoire est toujours un résultat, jamais un présupposé1. » Chaque écosystème est une synthèse entre un territoire et les formes de vie qui s’y implantent tandis que d’autres s’en éclipsent. La présence des perruches de Düsseldorf illustre cette fluctuation constante du vivant qui engage humains et non-humains au sein d’un monde commun, rejetant ainsi toute forme d’opposition binaire entre nature et culture.
La silhouette d’une femme nue, recroquevillée sur ellemême, se détache de l’espace vide sous la grande verrière. Son corps affaissé sur le sol semble particulièrement vulnérable face aux gratte-ciel de la vidéo Formation qui la surplombe. La femme blottit son visage contre deux jeunes enfants qu’elle tient fermement dans ses bras. Par cette puissante étreinte, elle se confond avec sa progéniture en un seul bloc. Elle s’érige en barricade contre le monde qui les entoure, comme pour les protéger de la ville immense qui les domine, des nuées d’oiseaux qui les survolent et des visiteurs de l’exposition qui les dévisagent. Longtemps installée en extérieur devant le musée Käthe Kollwitz à Berlin, cette sculpture soumise à l’abrasivité des éléments évoque une forme de résilience et de résistance aux effets du temps.
Dans une lettre adressée à sa belle-fille Ottilie, Käthe Kollwitz confie avoir ajouté un deuxième enfant au groupe à la suite de la naissance de ses petites-filles Jutta et Jördis. Elle envisage alors de lui en offrir une copie, accompagnée de la légende « Die Mutter – der Mutter – von der Mutter » (« La mère – de la mère – depuis la mère »). Par ces quelques mots, l’artiste effectue un télescopage générationnel qui permet aux personnages d’être à la fois une fille et une mère en puissance. Au moment où elle écrit cette lettre, Käthe Kollwitz travaille sur cette œuvre depuis plus de vingt ans sans jamais l’avoir exposée. Il n’est pas anodin que tout au long de sa carrière, elle soit revenue sans cesse vers cette œuvre, fondue en bronze à titre posthume en 1984, qui traite précisément du cycle éternel de la vie et de la création.
Ventilateur holographique LED, acier inoxydable, aluminium
Les trois versions de L’Ange du foyer peintes par Max Ernst, dont s’inspire Cyprien Gaillard, ont été créées à quelques semaines d’intervalle en 1937 après la victoire des troupes nationalistes espagnoles du général Franco, soutenues par l’Allemagne nazie. Le fascisme y est représenté sous les traits d’un monstre, « une sorte d’animal qui détruit et anéantit tout sur son passage » pour reprendre la formule d’Ernst. La dernière des trois versions, la plus grande et la plus détaillée, sert de base à une nouvelle itération conçue par Cyprien Gaillard. Modélisée en 3D, la créature cauchemardesque prend forme grâce à un ventilateur à hélices holographiques. D’abord invisible, elle apparaît subitement au public dès que celui-ci lui fait face. Gesticulant en tous sens, comme aux prises avec d’incontrôlables spasmes, elle va jusqu’à plonger brusquement en elle-même, dans le trou noir qui jaillit de son torse et vers lequel tout le dispositif de l’œuvre converge.
Il s’agit d’un « monstre » au sens étymologique du terme, qui renvoie aux mots latins monere, une mise en garde, et monstrare, l’acte de montrer. Elle donne à voir la pulsion de mort et de destruction qui, au fil de l’histoire, ne cesse de réapparaître, telle cette étrange créature protéiforme en constante recomposition qui, dès qu’elle semble s’être résorbée, resurgit.
60 61
Cyprien Gaillard, L’Ange du foyer (Vierte Fassung) 2019
Courtesy de l’artiste, Sprüth Magers et Gladstone Gallery
1: Emanuele Coccia, « Toutes les espèces sont constamment en train de changer le monde », Le Nouveau Magazine Littéraire, n° 16, 28 mars 2019.
Lafayette Anticipations
Cyprien Gaillard, White Vessel Study
2021
Polaroïds à double exposition, passe-partout, cadres en aluminum et plexiglas

Courtesy de l’artiste, Sprüth Magers et Gladstone Gallery
Tel un vaisseau spatial parti à la découverte de galaxies inexplorées, une seringue s’enfonce à travers des feuilles de fougères spiralant dans l’espace comme autant de fractales en apesanteur. Elle semble nous indiquer une direction à suivre au-delà de la forme apparente des choses, comme une invitation à creuser sous leur surface afin d’interroger leur vie intérieure et d’exhumer les fantômes qui s’y cachent. Traversant une forêt, elle rencontre sur son chemin conifères et herbes folles.
Les images demeurent muettes quant à ce que cette seringue injecte. On ne sait s’il s’agit d’un poison ou d’un antidote, de rêves éveillés ou d’un puissant sédatif. Récemment investis d’un rôle social inédit, les vaccins et les seringues voient l’imaginaire qui les entoure se renouveler dans un mélange d’espoir, de crainte, de soulagement et d’extrême anxiété. En éludant toute forme de contexte, Cyprien Gaillard restitue à cet objet plurivoque la densité de sa dimension symbolique.
Cyprien Gaillard, Constat d’état (HUMPTY, Palais de Tokyo) 2022

Vidéo HD, musique originale composée par Laraaji, 1’57’’ Courtesy de l’artiste et Laraaji
Tout en bas des escaliers en spirale du Palais de Tokyo, un moniteur diffuse des images vidéo du Défenseur du Temps, l’horloge à automates qui surplombe depuis 1979 le quartier de l’Horloge, situé au cœur du 3e arrondissement de Paris. Mise à l’arrêt en 2003, elle a depuis cessé de fonctionner. On observe sa léthargie, alors qu’elle regarde, immobile, le quartier qui l’entoure. Sur l’un des plans, des employés de Prêtre et Fils, une société spécialisée en restauration d’horloge monumentale, préparent son démantèlement, en vue de sa remise en état, à l’initiative de Cyprien Gaillard.


Cette vidéo est accompagnée d’une bande son de Laraaji, compositeur de musique ambient. Cette vidéo annonce la restauration et la renaissance du Défenseur du Temps, œuvre centrale de l’exposition présentée à Lafayette Anticipations.
Cyprien Gaillard, Constat d’état (DUMPTY Lafayette Anticipations) 2022
Vidéo HD, musique originale composée par Laraaji, 1’57’’ Courtesy de l’artiste et Laraaji
Trait d’union entre les deux lieux d’exposition d’HUMPTY \ DUMPTY, cette vidéo qui clot le parcours du Palais de Tokyo est présentée de nouveau au début des escaliers qui mènent au projet de Cyprien Gaillard à Lafayette Anticipations.
Cyprien Gaillard, Frise 1 2022
Vidéo HD sur écran LED, 4’08’’ Courtesy de l’artiste
En prévision de l’accueil des Jeux olympiques de 2024, Paris traverse une période de restauration intensive de son patrimoine, qui se traduit par une prolifération d’échafaudages dans le paysage urbain. Leurs ossatures métalliques ponctuent la trame urbaine en obstruant la vue des ouvrages qu’elles participent à restaurer. Un enchevêtrement complexe de poteaux et de plateformes recouvre ainsi, le temps de travaux censés leur insuffler une nouvelle vie, des monuments hérités des siècles passés, tels le Grand Palais, la tour Eiffel, l’Assemblée nationale ou l’obélisque de la place de la Concorde. Les édifices à rénover et dont l’existence sera ainsi préservée sont sélectionnés, alors que d’autres, comme Le Défenseur du Temps, ont été laissés en marge des politiques publiques de restauration.
63 62
DUMPTY
1979
réactivé par Cyprien Gaillard, 2022
Composition de la bande sonore Hit par Cyprien Gaillard et Joe Williams, et Heal par Laraaji (durée totale : 60’)
Laiton, plomb, acier, enceintes, micros contact et transducteurs Courtesy de l’artiste, Jacques Monestier, Laraaji, Joe Williams et l’ASL du quartier de l’Horloge
© Adagp, Paris, 2022
Le Défenseur du Temps, installé au cœur de la Fondation, est l’élément central du quartier de l’Horloge, ensemble immobilier postmoderne construit à la fin des années 1970 à proximité du Centre Pompidou, où se situait l’un des derniers îlots insalubres de Paris. Créé en 1979 par Jacques Monestier, cet automate fut mis à l’arrêt en 2003 suite au retrait du budget alloué à son entretien. En 2022, Cyprien Gaillard lui redonne vie et l’installe ici au centre du bâtiment prototype aux plateformes mobiles imaginé par Rem Koolhaas. Il s’active à intervalles réguliers en brandissant son épée pour protéger l’horloge qui trône au-dessus de lui des créatures qui l’entourent. Son corps abîmé et tapissé de fientes de pigeon témoigne de la longue période d’abandon au cours de laquelle il fut laissé à lui-même. Le temps qu’il tente de rattraper se manifeste au travers du mouvement des aiguilles de l’horloge, qui vont en sens inverse des aiguilles d’une montre.

En insufflant une nouvelle vie à l’automate, Cyprien Gaillard restaure un monument périphérique, délaissé par les politiques publiques de restauration du patrimoine.

La rénovation de l’œuvre d’un autre devient ainsi un acte de création.
Transposé dans ce nouveau contexte, à Lafayette Anticipations, l’automate émerge de sa paralysie au son des hits sortis vers 2003, l’année de son arrêt. Les tubes pop alternent avec une musique atmosphérique aux sonorités apaisantes, composée par Laraaji, un multi-instrumentiste de musique ambient À l’issue de l’exposition, Le Défenseur retrouvera son emplacement originel au coeur du quartier de l’Horloge, à quelques centaines de mètres de la Fondation, et pourra de nouveau veiller sur le lieu qui l’a vu naître.
Cyprien Gaillard, Palais de la découverte vitrifié 2022


Amiante vitrifiée (Cofalit) issue du Palais de la découverte, Paris
Courtesy de l’artiste
Ce monolithe d’un noir profond, diposé au centre de la plateforme et semblable à de l’obsidienne, est un bloc de Cofalit, un matériau synthétique résultant d’un processus de transformation des déchets d’amiante, fondus à très haute température. Ce procédé unique en Europe, développé par la société française Inertam, offre une alternative à l’enfouissement de cette matière cancérogène. L’imposant lingot a été produit à partir de débris amiantés collectés au Palais de la découverte, qui fait actuellement l’objet d’ambitieux travaux de rénovation. En étant ainsi exposés, ces fragments du musée, qui abrite notamment une collection de minéraux, deviennent eux-mêmes un spécimen géologique et le témoignage d’une matière née d’un cycle de métamorphoses.
Cyprien Gaillard, Frise 2 2022
Diaporama et vidéo HD sur écran OLED, trappe en verre, 10’14’’
Courtesy de l’artiste
Un écran vidéo OLED est disposé dans une trappe au sol, ouverte à proximité du Défenseur du Temps. Cyprien Gaillard révèle cet accès aux mécanismes du bâtiment pour en exposer le fonctionnement et montre ainsi les dispositifs invisibles qui permettent d’insuffler vie et mouvement dans l’architecture de la Fondation. La vidéo présentée regroupe plusieurs séquences. Y apparaissent des centaines de portraits de Gaël Foucher, un ami de Cyprien Gaillard décédé tragiquement en 2013. L’artiste lui rend hommage au travers de ces fragments de souvenirs captés sur le vif et empreints de complicité.
Leur succède une séquence du Défenseur du Temps filmé de nuit en 2022 à son emplacement d’origine dans le quartier de l’Horloge, dans laquelle la caméra examine les traces de temps et d’usure déposées sur sa surface et dans ses cavités.
Une dernière séquence présente un ouvrier au travail de l’entreprise Lassarat, chargée de la restauration de la charpente métallique du Grand Palais. La tâche astreignante qui s’effectue dans le bruit et la poussière rappelle que la restauration du bâti s’accompagne d’efforts humains qui sont eux-mêmes source d’usure.
Cyprien Gaillard, L’Irrestaurable (pour Gaël) 1979–2022
Tirage chromogène, verrin pneumatique du cou du dragon, verrin de la jambe droite du Défenseur, distributeur pneumatique du coq, œuf de pigeon trouvé dans les débris du Défenseur du Temps
Courtesy de l’artiste
Ce portrait de Gaël Foucher, ami intime de Cyprien Gaillard décédé en 2013 et à qui l’exposition est dédiée, est présenté auprès des pièces du Défenseur du temps qui n’ont pas pu être sauvées. Prise par l’artiste dans le métro à Mexico City en 2007, cette photographie est un hommage à cet être cher et ce temps partagé révolu. Les fragments du corps mécanique du Défenseur du temps posés dans la vitrine sont des pièces qui ont dû être remplacées afin de permettre la rénovation de l’œuvre. Apparaît ici la possibilité de faire revenir la machine et surmonter les effets du temps, en écho à l’impossibilité de faire revenir un homme. Une coquille d’œuf de pigeon trouvée dans les ruines du Défenseur du temps avant sa restauration évoque la renaissance et la force des cycles du vivant.
64 65
Jacques Monestier, Le Défenseur du Temps