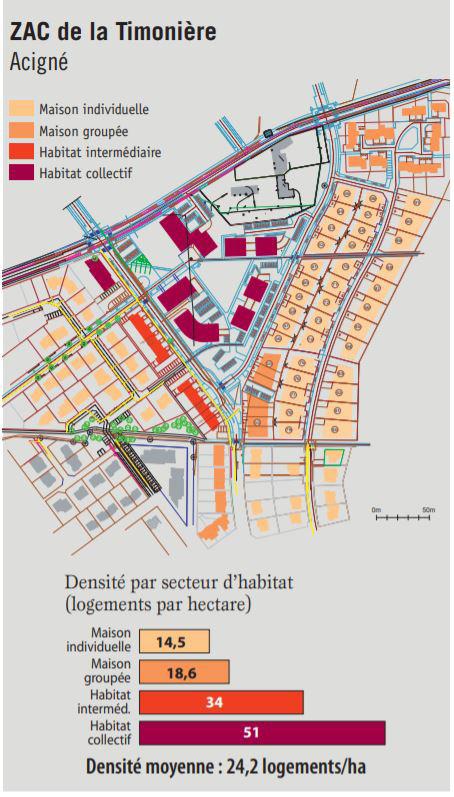10 minute read
III.1 - La notion d’habiter : d'un logement au chez soi
III - LE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE, UNE MANIÈRE CONTEMPORAINE D’HABITER
1 - LA NOTION D’HABITER : D’UN LOGEMENT AU CHEZ SOI
Advertisement
« On demande à la maison qu’elle soit agréable, construite avec des matériaux solides, qu’elle représente le projet familial : stable et durable » 1 À travers cette citation, EIGUER explique que l’habitat est une importante source d’espérances et d’investissements. On transpose nos idéaux au sein de notre habitat, l’accès à la propriété par exemple est important car il représente la stabilité. L’habitat est un pilier de notre société, or, la notion habiter, ne se limite pas au fait de se loger. Habiter induit un certain nombre de comportements de l’habitant vis-à-vis de son espace et constitue notamment une forme d’interaction entre l’intérieur de l’être et son environnement extérieur.
A - Les aspects psychologiques liés à l'habitat
« Au-delà du regard que l’on peut poser sur les pratiques des architectes, c’est bien évidemment parce que celles-ci conditionnent le cadre de vie qu’il importe de recourir aux sciences humaines pour mieux comprendre les enjeux humains de l’aménagement de l’espace d’une part, et les effets qu’il produit sur les individus, d’autre part. »2
Lorsque l’on construit les espaces de vie, en partie les habitats, il est important de comprendre et prendre en compte les aspects psychologiques et sociologiques liés à ces derniers afin d’offrir le meilleur confort de vie possible aux habitants. Cette pratique est souvent retrouvée sous la formulation de psychologie environnementale. La psychologie environnementale apparue dans les années 60-70 en outre-mer, puis dans les années 80 en France est, « l'étude des interrelations entre l'individu et son environnement physique et social, dans ses dimensions spatiales et temporelles ».3 L’habitat n’est pas seulement un abri, ni même un logement, c’est un réel lieu d’investissement psychologique. EIGUER considère ce dernier comme « [...] le reflet de ce que nous sommes, en termes d’individus non pas isolés mais groupés dans un ensemble formé de ses habitants.» 4 Cette notion évoquée n'est autre que celle de « l'habitat intérieur », un lien fort existe entre le mécanisme psychisme de l'habitant et son environnement concret. Ce concept s'inscrit dans la continuité de l'approche phénoménologique des années 1950, où l'habiter est perçu comme une « expression de l’être »5 . Or pour Bachelard « l’être commence par le bien-être »6 , ainsi habiter commence par le bien-être. L'habitat dans ce sens est considéré comme une « extension du corps et de la conscience »6 . Le corps de l’habitant fait office de lien entre l’intérieur de son être et l’extérieur, son milieu de vie.
Cette projection se fait également dans le sens inverse et d’une certaine manière l’espace dans lequel on vit, influence nos pensées nos sentiments et est « source de comportements »7 . L’architecte, en menant correctement son travail d’analyse des habitants, de l’environnement, des usages etc. en amont, peut faire en sorte d’apporter du bien être aux habitants et de générer des comportements positifs. Des études scientifiques ont par exemple prouvé que, les espaces verts améliorent les capacités cognitives, notamment sur la concentration :
1 et 4 EIGUER Alberto, 2004, L’inconscient de la maison, p.20 et p.14 2 COURTEIX Stéphan, 2017, E232 Cours pratiques de l’habiter, p.7 3 MOSER G., WEISS K., 2003 Espaces de vie : aspects de la relation homme-environnement, Paris, Armand Colin 5 HEIDEGGER M., 2001 (première édition en 1958), « Bâtir Habiter Penser », et « L’Homme habite en poète », in Essais et conférences, coll. Tel, Gallimard, p. 170-193 et p. 224-245. 6 BACHELARD G., 1998 (première édition en 1957), La Poétique de l’espace, Quadrige / PUF 7 MOLES A., ROHMER MOLES E., 1998, Psychosociologie de l’espace, textes assemblés par SCHWACH. V, p.32
« […] La contemplation d’un jardin ou d’une forêt améliore la concentration.» De même que l’apport en lumière au sein d’un habitat peut également avoir une grande incidence sur l’habitant. : «la lumière du jour synchronise notre cycle veille-sommeil […] des études ont montré qu’une quantité suffisante de lumière solaire améliore les résultats des élèves. »1
Dans les projets d’habitats intermédiaires étudiés dans ce rapport, les architectes promeuvent la qualité des espaces de vie et le confort des habitants, en proposant de grandes surfaces, des espaces lumineux et des espaces extérieurs abondants. La satisfaction et le bien-être des habitants est l'une des priorités de ces opérations.
B - L’appropriation des lieux de vie
L’appropriation d’un habitat traduit la volonté de s’y sentir chez soi : l’habitant y projette une part de lui, peut-être de façon à maîtriser inconsciemment l’espace. L’appropriation peut se définir comme un processus de mise en conformité de l'habitat avec l’habitus2 des individus. Selon EIGUER «L’appropriation interroge non seulement l’avoir mais aussi l’être »3, en effet une manière de s’approprier l’espace est de l’investir en disposant des objets. D’une part, cela montre la possession, d’autre part, le type d’objets exposés montre explicitement qui est l’habitant, ou au moins l’image de lui qu’il souhaite renvoyer. Bien que certains objets soient fonctionnels, ils reflètent aussi notre personnalité, et « traduisent nos goûts esthétiques et nos besoins fonctionnels »3 . L’appropriation d’un espace par les objets fait donc partie du processus de projection de l’être dans l’espace concret 4. LEFEBVRE définit l’appropriation comme « [...] l’ensemble des actions des hommes dans l’espace, consistant simultanément à lui donner des configurations spatiales matérielles et des significations.» 5 L’appropriation de l’espace peut donc être matérielle (objets, meubles, etc.) mais peut également se traduire par la manière dont le corps interagit avec l’espace, comment il l’occupe et l’appréhende. L’appropriation de l’habitat peut aussi se définir par l’agencement des pièces, l’aménagement, l’ouverture d’un mur etc. Le rôle de l’habitat influe également en partie sur le processus d’appropriation, s’il est définitif ou transitoire, la relation qu’entretient l’habitant avec son espace de vie sera certainement différente car il n’y développera pas le même d’attachement.
C - Intimité et sociabilité : maîtrise et hiérarchie des rapports
Habiter induit la notion d’intimité et interroge les limites entre le privé et le public ainsi que le choix d’intensité de ce qui est montré et caché. Parfois cette limite est confuse puisque les espaces d’intimité ont évolué au fur et à mesure des siècles (ex : avant on recevait dans la chambre, qui aujourd’hui est le lieu d’intimité par excellence.6) D'après EIGUER 7, il y a deux types d’intimités, l’intimité propre à soi et celle qui est partagée avec un proche. L’habitat familial doit être conforme et se prêter aux besoins de ses deux formes d’intimité. Au sein même de l’intimité réside alors une forme de sociabilité : la structure familiale est à la fois intime face au regard extérieur, cependant cette intimité est générée par des liens familiaux comme la complicité, la vie commune, le respect etc. L’espace de la maison familiale traditionnelle française est révélatrice des différentes échelles de l’intime.
1 ANTHES E., Juin 2009, Article « Comment l’architecture influence nos pensées », Cerveau et psycho n°33, p. 32-33 2 Habitus comme manière d’être, phénomène d’habitus décrit par Pierre Bourdieu en 1972. 3 EIGUER Alberto, 2004, L’inconscient de la maison, p.81 4 Espace concret : référence à BOUDON Ph. qui en 1971 dans son ouvrage Sur l’espace architectural, distingue 3 catégories d’espace: l'espace mental, l'espace concret et l'espace vécu. 5 LEFEBVRE H., 1970 La Révolution urbaine Paris, Gallimard, coll. Idées p. 203 6 ELEB Monique, 1998, chapitre « L'habitation entre vie privée et vie publique » dans Logement et habitat : l’état des savoirs p.72 7 EIGUER Alberto, 2004, L’inconscient de la maison, p.47 27
Les murs du logement, représentent une coque qui préserve l’intimité familiale : à l’intérieur de cette dernière prend vie une forme de sociabilité intime (famille ou amis dans certains moments). Puis au sein de ses murs, des cloisons séparent les fonctions et usages des pièces créant ainsi une autre forme d’intimité : WC, Salle de Bain, chambres renvoient à une intimité personnelle. Dans les opérations collectives ou semi-collectives, l’intimité est mise à l’épreuve. En effet, l’une des principales craintes des habitants de ce type de d’habitats concerne le manque d’intimité, qu’elle soit sonore, à cause d’une mauvaise isolation ou visuelle de part un vis-à-vis important. Les logements intermédiaires pour la plupart, ont la volonté de remettre en question les principes du collectif afin de l’adapter au besoin d’intimité des habitants. Ainsi les architectes développent différentes techniques afin de proposer des habitats semi-collectifs où l’intimité est préservée. Elles peuvent être de l’ordre du plan, de l’habillage tout comme de l’ordre du matériau.
Dans le projet de 18 habitats intermédiaires à Jouy-Le-Moutier,1 l’utilisation du bois est vectrice d’intimité. La densité au sein de l’opération (en tout composée de 65 logements) est forte et les logements sont rapprochés. Pour contrer les problèmes de vis-à-vis qui pourrait naître, les architectes ont travaillé avec la déclivité du terrain en offrant à chaque logement un espace extérieur privatif, une grande loggia avec des persiennes ajourées en bois, à l’abri des regards. Ainsi chaque habitant se sent chez lui. L’intimité est aussi générée par les circulations piétonnes nombreuses au sein de l’îlot : chacun choisit le parcours de son choix pour rentrer chez lui ou pour rejoindre ses voisins dans le jardin collectif. L’idée est de « créer » au-delà des espaces intimes, « le sentiment de vivre ensemble, en proposant des lieux de partage de l’espace ».
2 Cependant on peut noter que la volonté de limiter les vis-à-vis n’a pas été menée totalement à bout visiblement puisque les balcons, des logements collectifs, ne bénéficiant pas d’un traitement spécial, semblent êtres ajoutés aléatoirement là où il était nécessaire d’offrir un espace extérieur. Les vues depuis ces balcons semblent, directement donner sur les jardins et terrasses des logements intermédiaires. À mes yeux, ces balcons ne sont pas à la hauteur du reste de l’opération. Bien qu’ils ne concernent pas directement les logements intermédiaires, le but de l’opération reste tout de même de faire cohabiter ces différents types d’habitats tout en préservant l’intimité des habitants. D’une manière générale je pense tout de même que le projet a bien été réussi et propose des espaces de vie très qualitatifs.
Persiennes en bois à Jouy le Moutiers (fig. 46)

Cohabitation des types d’habitat à Jouy le Moutiers (fig. 47)

Logements intermédiaires à Jouy le Moutiers (fig. 48) 1 Projet présenté par l’Observatoire CAUE de l’urbanisme et du paysage 2 Citation DUFLOS Chloé, associée chez MUZ Architecture et urbanisme
Parmi les projets d’habitats intermédiaires, Le piano à queue dans Lyon 9 réalisé en 2007 1 place la notion d’intimité au cœur de son projet. Cette opération de 38 logements intermédiaires développe une typologie en plan, permettant de gérer la superposition des logements bénéficiant chacun d’espaces extérieurs, tout en préservant leur intimité. Au rez-de-chaussée prennent alors place des logements plains pieds donnant chacun sur un jardin extérieur privatif. En étage, des appartements en duplex sont organisés autour d’un patio privatif, de manière introvertie, tout en profitant du ciel. Dans cette opération, l’architecte a d’une part voulu redonner au sol un usage privatif et intime, souvent délaissé dans le collectif et d’autre part proposer un accès au logement étant privatif ou partagé entre deux logements. De par cet aspect hybride entre vie collective et intimité, l’intermédiaire représente une nouvelle fois un « produit immobilier ambiguë » 2 .

Balcon Piano à queue, Lyon 9 (fig. 49)

Espaces extérieurs, Piano à queue, Lyon 9 (fig. 50)

Plan masse du projet, Piano à queue, Lyon 9 (fig. 51) Espaces extérieurs, Piano à queue, Lyon 9 (fig. 52)
1 Projet présenté dans une vidéo youtube publiée par le CAUE (Conseil d’Architecture de l’Urbanisme et de l’Environnement) de Rhône Métropole, remporte le Prix Habitat du Grand prix de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement du Rhône en 2010. 2 Citation GACHON Régis, architecte associé du projet 29