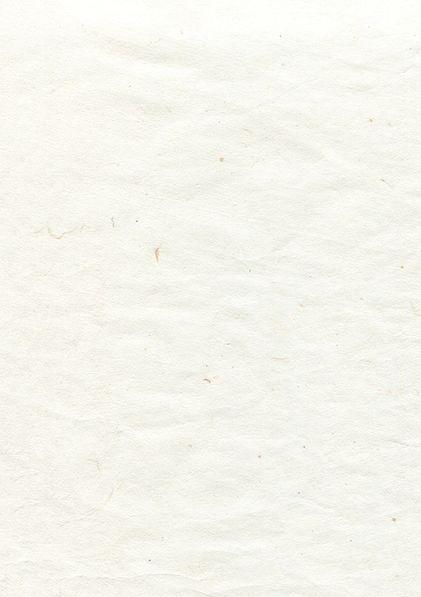LE PETIT CHAPERON ROUGE
La peur sexuée comme instrument de ségrégation spatiale
Ana de la Fuente Sánchez
1. Introduction.
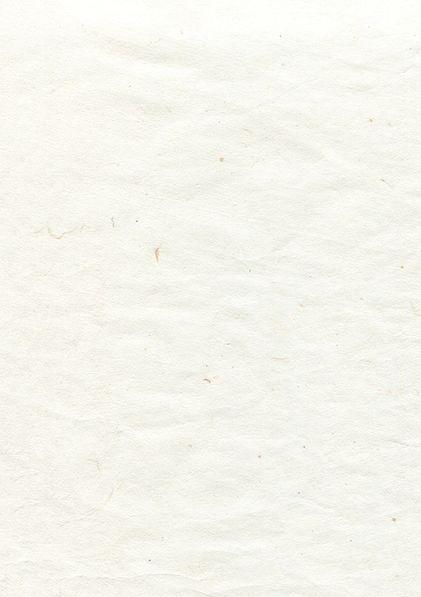
2. Une définition de l’espace public qui n’est pas encore en vigueur.
3. Dimension socio-politique de l’espace et formes d’exclu sion à travers l’histoire.
4. Les mécanismes d’exclusion à l’ère de la (dés)information.
5. Conclusion. Planification urbaine sensible au genre : la nécessité d’inverser le discours.
6. Biblio-filmografía.
Annexe (I) : Quelques conversations.
La première à nous parler du loup a été maman. C’était en juin, cette période de l’an née où les jours sont plus longs et où il y a encore de la lumière dans le ciel, où ma man nous réunit autour de la table pour dire le Notre Père avant le dîner. “Promets-moi que tu seras à la maison avant 10 heures. Ne pense même pas à être dehors quand le loup sortira”, m’a dit ma mère alors que je me préparais à partir. C’était la première fois que je sortais sans mon frère et la première fois que ma mère me mettait en garde contre le loup, mais pas la première fois que j’en entendais parler. Il ne faut pas être très attentive pour entendre parler du loup au moins une fois par semaine aux infor mations locales, à la radio ou même dans les journaux que papa ramenait à la maison


“Ce n’est pas le moment d’être dans la rue, mon chéri.”, “Penses-tu que cette jupe est appropriée pour sortir ?”, “Tu ne devrais pas marcher dans cette rue toute seule la nuit”.
Ces phrases et bien d’autres similaires nous bombardent chaque jour, nous les femmes. Dans les conversations familiales, entre amis, aux informations, dans les journaux... Tout comme le Petit Chaperon Rouge nous prévient dans le conte écrit par les frères Grimm : “Je ne m’écarterai plus jamais du chemin et je n’irai pas dans la forêt quand ma mère me l’a demandé” 1.Ces histoires et d’autres, ces commentaires, nous mettent en garde contre les dangers qui nous guettent lorsque nous sortons de chez nous, dans la rue, dans l’espace public. Ils nous disent quelles rues ne pas emprunter, avec qui marcher, à quelle heure nous pouvons nous déplacer.
Ce récit génère un récit qui lui est propre, le récit de la terreur se xuelle. De nombreuses études féministes affirment que ce récit fondé sur la menace constante des terreurs que l’on peut trouver dans l’espace public fonctionne comme un instrument de contrôle social 2 , ce qui contribue à la perpétuation des normes sociales et à la non-pré sence des femmes dans l’espace public.
La division de l’espace public et privé et l’attribution de ces espa ces à chaque sexe (les hommes occupent l’espace public tandis que les femmes restent dans l’espace privé, domestique) est une distinction qui a été produite et reproduite au cours de l’histoire par différents mécanismes.
Dans la société actuelle, malgré les énormes progrès du fémi nisme, cette ségrégation sexuelle de l’espace est toujours en vigueur. Dans cette société, caractérisée par la médiatisation et le trop-plein d’informations, cette terreur sexuelle peut-elle devenir l’un des principaux axes qui expulsent les femmes de l’espace public ?
L’objectif de ce travail est d’étudier les mécanismes par lesquels cette terreur sexuelle s’exerce et les implications qu’elle a sur la vie des femmes. À cette fin, une fois le cadre théorique et les questions d’intérêt établis, une série de rencontres ou de conversations ont été organisées avec avec des personnes lues comme des femmes afin d’observer comment cette histoire fonctionne dans leur vie quotidienne et quel est leur rapport à la terreur sexuelle.
1. Grimm Jacob y Grimm Wilhelm. (2016) Caperucita Roja. Educ.ar. https:// www.educ.ar/recursos/131413/caperucita-roja-de-jacob-y-wilhelm-grimm
2. Stephanie Riger and Margaret T. Gordon (1981) The Fear of Rape : A Study in Social Control. Journal of social issues. 37(4) 71-92.
02. Une définition de l’espace public qui n’est pas encore en vigueur.
Cette nuit-là, dans la rue, à 21 heures ; alors qu’il y avait encore un peu de lumière dans le ciel mais que le soleil avait déjà disparu ; comme si une alarme sonnait, mes amies et moi, tous vaincues par la présence du loup, nous nous sommes rapide ment embrassées sur la joue et nous sommes rentrées en hâte dans nos maisons res pectives. C’était notre premier jour seules, et nous avions réussi à déjouer le loup


Pour comprendre comment fonctionnent les mécanismes qui perpétuent l’expulsion des femmes de l’espace public, il faut d’abord comprendre ce qu’est cet espace, non seulement dans sa dimension spatiale mais aussi dans sa charge sociopolitique, afin de comprendre pourquoi il y a un intérêt à nous en tenir éloignées.
Dans une définition spatiale, nous pourrions dire que l’espace public est cet espace résiduel entre les espaces privés, ces rues, parcs, places qui, en raison de leur caractère légal “public”, peuvent être traversés par tous les citoyens et citoyennes. Mais l’espace public ne se résume pas à cela. L’espace public, c’est la ville. L’espace public est l’espace dans lequel la société se représente et se rend visible. Les relations entre les habitants et entre le pouvoir et les citoyens et citoyennes sont matérialisées et exprimées dans le façonnage des rues, des places, des parcs, des lieux de rencontre publics, des monuments, etc. et dans la manière dont la ville est représentée et rendue visible.3.
Il implique la simultanéité, les rencontres, la convergence des communications et des informations, la connaissance et la recon naissance ainsi que la confrontation des différences..4 C’est un espace physique et politique. Et c’est précisément cette deuxième dimension qui ne permet pas de mettre pleinement en œuvre sa définition.
L’espace public aujourd’hui n’est pas un espace accessible à tous. Aujourd’hui, c’est un environnement où de multiples exclusions ont lieu. C’est un espace de représentation, mais seulement pour quel ques-uns.
Si l’on se concentre sur la question du genre, dans une société patriarcale et hiérarchique, l’intérêt des échelons supérieurs sera de perpétuer ce statu quo, ce seront donc, dans ce cas, les femmes qui auront intérêt à ne pas être autant représentées dans l’espace pu blic. Dans cet article, je me concentrerai sur la question des femmes, mais je pense qu’il est important de souligner que cette expulsion ne s’exerce pas seulement à l’encontre des femmes, mais aussi à l’en contre de nombreux autres groupes sociaux qui sont en dehors de la “normativité”, tels que les migrants, les dissidents de genre, les per sonnes ayant peu de ressources économiques, etc.
Comme il n’est pas possible dans cet article de couvrir et de parler de tous ces groupes sociaux, même si beaucoup d’entre eux sont sou mis à la même violence et sont exposés aux mêmes dangers, je me ré fère dans ce cas particulier à l’expérience des femmes, en comprenant les femmes dans ce cas, en raison du sujet de l’étude, comme toutes celles qui peuvent potentiellement être lues comme des femmes dans l’espace public.
3. Jordi Borja y Zaida Muxí. (2003). El espacio público, ciudad y ciudadanía. Bar celona: Ed.Electa
4. Henri Lefebvre. (1968). El derecho a la ciudad. España: CAPITAN SWING S.L; N.º 1 edición (15 mayo 2017).
03. Dimension socio-politique de l’espace et formes d’exclusion à travers l’histoire

Au fil du temps, nous nous sommes habituées à la présence du loup. Mais s’y habituer ne signifie pas que nous avons cessé de le craindre. Petit à petit, nous avons développé des te chniques pour l’éviter et lui échapper, qui sont progressivement devenues partie intégrante de notre façon d’être et de marcher dans la rue, presque sans nous en rendre compte. Nous ne marchions jamais seules, toujours par deux. Plus il y avait de personnes dans le groupe, plus le loup avait peur. Nous portions les vêtements de nos frères. Le loup a faim de tes ju pes, tu es beaucoup moins en danger si tu portes le pantalon de ton frère. Nous marchions toujours à la lumière du soleil ou des lampadai res. Le loup court dans les rues sombres, il est préférable de les éviter.

Chaque société produit un espace, son espace5 Tout au long de l’histoire, chaque société a construit et configuré ses espaces de diffé rentes manières, tant privés que publics, et en fonction des activités qui s’y déroulaient, ainsi que des normes sociales qui prévalaient à l’époque, ceux-ci ont été attribués différemment aux hommes et aux femmes. Dans cette section, nous allons étudier comment chaque société produit une ségrégation spatiale, sa ségrégation spatiale.
Cette répartition inégale de l’espace est proposée par Engels dans l’émergence du mariage. Avec son apparition en Occident, la monogamie et la propriété privée apparaissent également. Au sein de cette unité, et en raison de la mobilité limitée due à la grossesse et aux menstruations, les femmes devaient rester à la maison, et c’était l’homme qui partait chercher de la nourriture.
Dans la Grèce classique, l’espace public par excellence était l’agora, l’espace des hommes, où se tenaient les assemblées publiques et mu nicipales et où se déroulait la vie des relations et du commerce ; les femmes n’avaient pas droit à ces espaces, le lieu qui leur était imposé était le foyer. Dans le cadre des normes sociales, leur non-participa tion à la vie politique et à l’activité économique associée à l’espace public, elles étaient chargées des tâches domestiques et des soins de la famille au sein du foyer.
Cela génère deux sphères : la sphère productive, liée aux activités extra-domestiques et occupée par les hommes, et la sphère reproduc tive, liée à la sphère domestique et attribuée aux femmes..6
À Rome, nous trouvons également une distinction claire entre l’espace de la communauté, de la citoyenneté, dont les femmes ont été exclues pendant des siècles, et l’espace familial, auquel les femmes étaient réduites. Toutefois, au cours des derniers siècles de l’Empire romain, la situation des femmes a considérablement changé, puisqu’elles sont sorties de leur foyer pour rejoindre les espaces publics de production et de décision politique. Ces changements sont attribués aux niveaux élevés d’urbanisation atteints à Rome, qui ont été suivis par des phénomènes tels que la diffusion de l’éducation.7
5. Henri Lefebvre. (1974). La producción del espacio. España: CAPITAN SWING S.L; N.º 1 edición (Noviembre 2013).
6. Friederich Engels. (2010). The Origin of the Family, Private Property and the State. London: Penguin Classics.
7. Artemio Baigorri. Usos del espacio y diferencias de género. Grupo 6 Sociolo gía Urbana. Sesión 2ª, Granada, 1995.
Au cours du Moyen Âge, la ségrégation sexuelle a diminué : les espaces publics essentiels de la ville médiévale, l’église et la place du marché, étaient occupés à la fois par des hommes et des femmes (mais pas par des postes au sein de leurs institutions). Dans les villes, les ateliers étaient généralement situés dans les maisons et tous les membres de la famille contribuaient aux différents aspects du pro cessus de production.
À l’époque baroque, la division sexuelle du travail marquée par la société patriarcale tenait les femmes à l’écart de la sphère publi que et encourageait l’apprentissage des compétences domestiques et des techniques de cuisine et de couture, qui constituaient les élé ments de base de l’éducation des femmes. La fonction productive domestique a été attribuée aux femmes, qu’elles soient urbaines ou paysannes. La vie publique des femmes était très limitée, avec très peu d’occasions de mettre le pied dans la rue. L’un des moyens les plus courants d’échapper à la réclusion domestique était de s’adon ner à des pratiques religieuses à l’église. Pour cette raison, les églises sont devenues un lieu de rencontre pour de nombreuses femmes.
La ville baroque, puis le siècle des Lumières, marquent l’indiffé renciation de l’espace urbain, en contraste avec une forte différencia tion sociale. Hommes et femmes partageaient les champs, les forêts, les ateliers d’artisans, les jardins, les marchés, les théâtres, les églises, les salons... mais le pouvoir dans chacun de ces domaines restait plus que jamais fermé aux femmes.
La révolution industrielle marque un tournant dans le rôle des femmes dans la sphère publique avec l’incorporation massive des fe mmes dans le travail rémunéré. Les hommes ne sont plus les seuls à rapporter un salaire à la maison. Malgré cette incorporation des femmes dans la vie publique et sur le marché du travail, la même incorporation des hommes dans la sphère domestique ne s’est pas produite, et la sphère domestique a donc continué à être la tâche des femmes, qui devaient combiner la charge de travail des deux sphères.
04. Les mécanismes d’exclusion à l’ère de la (dés)information.
La première fois que j’ai vu le loup, c’était en hiver. Je rentrais chez moi, en faisant un détour pour ne pas passer par un de ces quartiers que l’on n’est pas censé traverser. Mais le détour prenait plus de temps que prévu. J’ai regardé ma montre. Il n’y avait presque plus de lumière dans la rue. J’ai mis ma capuche et j’ai accéléré le rythme. J’ai tourné au coin de ma rue et c’était là. Dans un troupeau. Je me suis figée et ils ont marché vers moi. Avec leurs pattes velues et leurs yeux menaçants. Ils m’ont entouré. J’ai senti leurs souffles chauds et puants. Leurs dents pointues brillaient à la lumière des lampadaires. J’ai oublié toutes les techniques de défense que j’avais apprises au fil des ans. Leurs voix m’ont glacé le sang :

- Hé ma belle, que fais-tu ici toute seule à cette heure-ci ? - J’aime ton corps.
- Si tu ne veux pas coucher avec moi, tu me donneras au moins un baiser ? - J’ai une petite amie à Bilbao, mais je ne pense pas qu’elle m’en voudra pour ce que je vais te faire
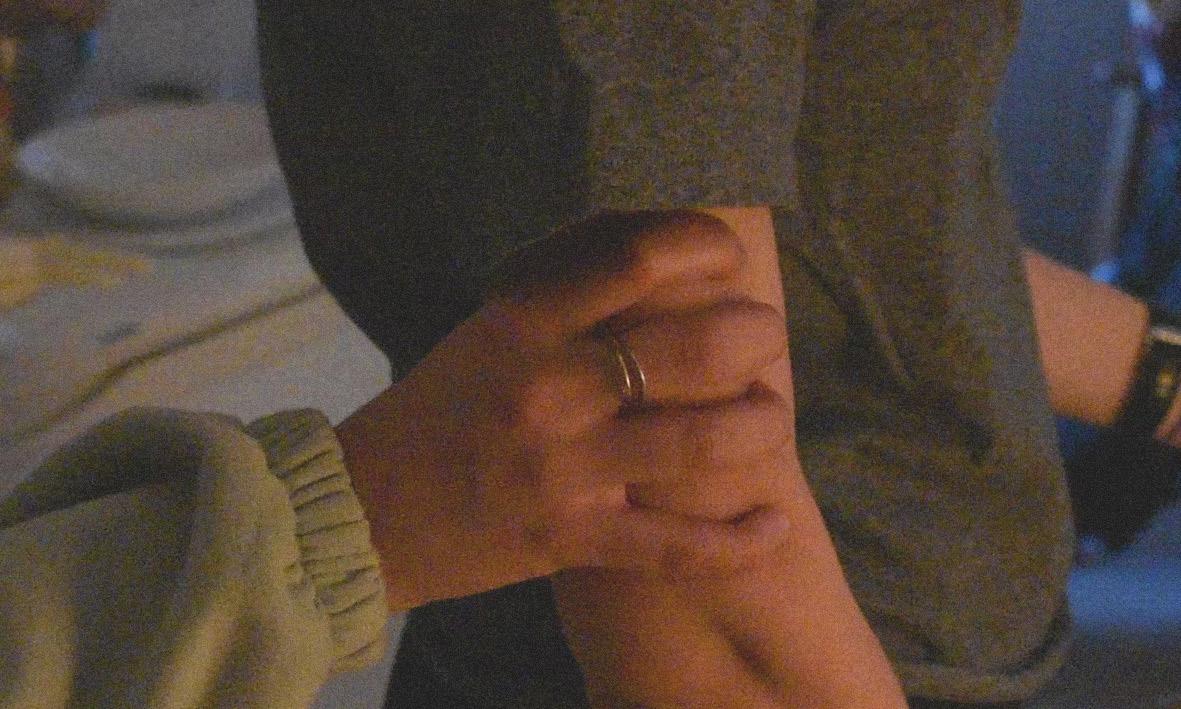
Si chaque société produit son propre espace, comment la société actuelle produit-elle le sien ? Comment génère-t-elle la ségrégation sexuelle que nous avons mentionnée au début et dont nous avons vu comment elle s’est produite au cours de l’histoire ?
Tout d’abord, malgré des progrès significatifs en termes d’égalité professionnelle et d’accès des femmes au travail, l’objectif pour lequel les femmes occupent l’espace public n’est pas le même que celui pour lequel les hommes occupent la rue.
Les femmes occupent généralement la rue comme un prolon gement de leur travail à la maison, comme un simple support pra tique, comme une extension de leurs tâches privées ou domestiques. Cependant, ils sortent souvent dans la rue sans objectif fixe mais comme une simple possibilité, comme un acte de dérive.8 Comme le souligne Teresa del Valle, “le fait de mentionner que les femmes sor tent de la maison (espace intérieur) souligne leur incorporation à la vie active de la ville, alors qu’en réalité, il est fréquent que les actions des femmes à l’extérieur de la maison réaffirment leur appartenance à l’espace intérieur”..9
Au-delà de ce fait, les études montrent que la peur est le facteur le plus fréquemment mentionné par les femmes en termes d’éléments qui rendent difficile leur accès à l’espace public.1⁰
La peur d’être volé mais surtout d’être agressé ou violé. Des crimes qui les touchent “relativement” peu. C’est donc un paradoxe : toutes les études s’accordent à dire que les femmes sont principalement sus ceptibles d’être agressées par des hommes qu’elles connaissent dans un cercle proche. 11 Il convient de noter que l’une des raisons pour lesquelles il existe une si grande différence entre la violence subie par les femmes dans les espaces publics et celle qu’elles subissent dans les espaces privés est la prise en compte de ce qui est considéré comme de la “violence” dans les statistiques, qui n’incluent pas certaines ac tions menées contre les femmes dans la rue, comme les compliments, les menaces ou les approches qui violent également la présence des femmes dans les espaces publics et compromettent leur sécurité.
L’accent mis sur la menace de viol dans la rue, plutôt que dans la sphère domestique, conduit de nombreuses études et groupes féministes à affirmer qu’il s’agit d’un instrument de contrôle social des femmes plutôt que d’un mécanisme de sécurité,
8. Martha C. Cedeño. (2013). El cuerpo femenino en el espacio público urbano.. 16/11/2021, de Research Gate Sitio web: https://www.researchgate.net/publica tion/340609639_El_cuerpo_femenino_en_el_espacio_publico_urbano_The_fe male_body_in_urban_public_space
9. Teresa del Valle. (1991). el espacio y el tiempo en las relaciones de genero. Kobie (Serie Antropología Cultural), 227, 224-236.
10. Zúñiga Elizalde, Mercedes (2014). Las mujeres en los espacios públicos: en tre la violencia y la búsqueda de libertad. Región y Sociedad, (4),77-100.[fecha de Consulta 29 de Mayo de 2022]. ISSN: 1870-3925. Disponible en: https:// www.redalyc.org/articulo.oa?id=10230108004
11. Marylène Lieber. (2008) Genre, violences et espaces publics. La vulnérabilité des femmes en question. Paris : Presses de Sciences Po.
“en les maintenant dans un état d’anxiété et en les encourageant à s’imposer des restrictions comportementales en quête de sécurité”12, perpétuant ainsi la ségrégation spatiale des sexes. Comme dans l’histoire du Petit Chaperon Rouge, qui nous encourage à ne pas sortir dans les bois. Cette crainte n’est d’ailleurs pas également répartie en tre les femmes. Ce sont ceux qui ont moins de ressources pour faire face à la victimisation, les personnes âgées et les minorités ethniques, ainsi que ceux qui ont moins de ressources économiques, qui sont les plus sensibles à ce type de peur.
Les récits sur le danger sexuel produisent des vérités et des con naissances sexistes. Cette vérité est produite par les métaphores qui composent et coordonnent le récit de l’actualité, généralement par le biais de deux mécanismes.
Dans cette histoire, il y a eu, dès le départ, une discussion pu blique sur le corps des adolescentes. Les détails des autopsies, les photographies et les images ont été diffusés sans discernement. Avec les corps des adolescentes à la une, une analyse tempérée, politique et féministe était difficile à faire. À cette époque, la société dans son ensemble, et les femmes en particulier, s’identifiaient déjà à toutes les tortures et agressions subies par les adolescentes.13
Tout d’abord, en se concentrant sur la terreur des cas, décrivant ad nauseam les situations vécues par les femmes victimes. Lais ser leurs corps et leurs histoires entre les mains des médias. En Es pagne, nous pouvons en voir un exemple dans l’affaire Alcàsser, au début des années 1990, dans laquelle 3 jeunes femmes ont été assassinées par 2 hommes alors qu’elles faisaient de l’auto-stop.
D’autre part, ce type de récit concentre son regard sur la recherche des responsabilités et des responsables, en centrant l’explication pos sible de ce qui s’est passé sur leurs actions. Je pourrais également illus trer ce récit par l’affaire Alcasser, mais je vais choisir un événement plus récent. Il ne s’agit pas d’un cas en soi, mais d’un discours pro noncé par la présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lors d’une intervention dans un congrès : “Leur façon de voir la vie, typique des enfants gâtés qui aspirent à arriver seuls et ivres, dénués de toute responsabilité même pour leurs pires décisions, est une honte pour la majorité des femmes” 1⁴. Ici, le risque d’être violé/ assailli n’est pas discuté ni remis en question. Elle n’est pas considérée comme pertinente dans l’opinion publique. Ce sont eux qui doivent être prudents et faire attention, ce sont eux qui ne doivent pas y aller seuls ou ivres. Ainsi, une double peine est établie : à celles qui trans gressent et au reste des femmes sous forme d’avertissement. Le petit chaperon rouge est à blâmer pour ne pas avoir fait attention à sa mère.
13. Nerea Barjola. (2018). Microsofía Sexista del Poder. El caso Alcàsser y la construcción del terror sexual. . Barcelona: Virus Editorial.
14. Isabel Díaz Ayuso, pendant son discours au congrès du PP à Madrid le 20 mai 2022
05. Conclusion. Planification urbaine sensible au genre : la nécessité d’inverser le discours.

Soudain, l’un d’eux a tourné la tête, reniflant l’air. Il a dit quelque chose que je n’ai pas pu comprendre aux autres et soudain, ils se sont tous enfuis à toute allure. Je suis restée là pen dant quelques secondes, à prendre en compte tout ce qui s’était passé. Puis j’ai couru jusqu’au seuil de ma porte, à quelques mètres de là où je me trouvais. J’ai ouvert la porte et j’ai couru jusqu’à ma maison. Après être entrée, j’ai verrouillé la porte en faisant un double tour de clé.

Grâce à cette recherche, à mes conversations avec mes collègues, ainsi qu’à ma socialisation en tant que femme, j’ai réalisé quelque chose - que je savais déjà au fond de moi - que les récits de danger sexuel produisent une vérité et un savoir sexistes. Le sentiment est tou jours là, parfois plus ou moins éveillé. Elle peut se manifester par de petites réac tions du corps, comme le fait de se surprendre à marcher plus vite que d’habitude ou de vérifier compulsivement son environnement. Je pense qu’il est également important de noter que dans l’une des conversations, une amie a parlé de la peur qu’elle a commencé à ressentir en marchant dans la rue après certai nes demandes formulées par un mouvement féministe dans sa ville. Mais ensuite, lors de mon premier master, je me souviens qu’il y a eu des agressions sexuelles dans la ville et que de nombreuses personnes ont pris des mesures pour rendre visible ce qui s’était passé, allant jusqu’à écrire dans les rues “quelqu’un a été agressé ici”, et ces actions, même si je pense qu’elles ne sont pas nécessairement mauvaises, m’ont fait me sentir moins en sécurité. La connaissance génère la connaissance et la connaissance génère la libération, mais ce type de connaissance, insérée dans les logiques narratives de la terreur que nous vivons et dont nous avons parlé, ne parvient pas à libérer, mais nous renvoie plutôt aux dangers et aux images de la terreur dont les “contes du petit chaperon rouge” nous mettent en garde.
La différence que je peux voir maintenant est énorme, maintenant j’ai l’air beaucoup plus masculin, j’ai les cheveux courts, je porte toujours des vêtements très amples, je pense que cela vous aide beaucoup à être laissé seul : dans le métro, à Stalingrad, à Chappelle, j’ai juste peur d’être volé.. Penser à la façon dont ils interpréteront les vêtements que nous portons, penser à l’itinéraire que nous emprunterons, penser à l’heure à laquelle nous arriverons, penser à dire à un ami de nous accompagner à la maison quand nous rentrerons
Ce problème souligne la nécessité d’une perspective de genre lorsqu’on parle d’occupation de l’espace, de mobilité dans la ville, de sécurité dans la rue. Ces dernières années, cette perspective de genre a été introduite de manière intégrée dans toutes les disciplines, y compris celle qui est chargée de la planification des espaces publics eux-mêmes, l’urbanisme. Les rues sont devenues - physiquement - plus sûres. L’éclairage de certaines rues a été renforcé, davantage d’arrêts de bus ont été mis en place, des numéros de contact et des protocoles pour les victimes ont été créés... Mais les histoires res tent les mêmes. Non seulement nous avons besoin du matériel dans nos rues pour être en sécurité, mais nous devons, selon les mots de Nerea Barjola, nous entourer d’un univers de contre-représentations du danger sexuel. Il s’agit donc d’intégrer dans la vie quotidienne de nouvelles représentations et expériences qui contrecarrent la subs tance et la matière du danger sexuel. Occuper chacune des places que le régime sexiste permet pour sa survie et les mettre hors d’état de nuire.1⁵
15. Nerea Barjola. (2018). Microsofía Sexista del Poder. op. cit., p. 23
Biblio-filmographie
Bibliographie
1. Artemio Baigorri. Usos del espacio y diferencias de género. Grupo 6 Socio logía Urbana. Sesión 2ª, Granada, 1995.
2. Friederich Engels. (2010). The Origin of the Family, Private Property and the State. London: Penguin Classics.
3. Gill Valentine (1992) Images of danger: Women’s Sources of Information about the Spatial Distribution of Male Violence. Area, 24(1), 22-29.
4. Grimm Jacob y Grimm Wilhelm. (2016) Caperucita Roja. Educ.ar. https:// www.educ.ar/recursos/131413/caperucita-roja-de-jacob-y-wilhelm-grimm
5. Henri Lefebvre. (1968). El derecho a la ciudad. España: CAPITAN SWING S.L; N.º 1 edición (15 mayo 2017).
6. Henri Lefebvre. (1974). La producción del espacio. España: CAPITAN SWING S.L; N.º 1 edición (Noviembre 2013).
7. Jordi Borja y Zaida Muxí. (2003). El espacio público, ciudad y ciudadanía. Barcelona: Ed.Electa
8. Luce Irigaray (1985) This sex which is not one. Ithaca, New York: Cornell University Press.
9. Martha C. Cedeño. (2013). El cuerpo femenino en el espacio público urba no.. 16/11/2021, de Research Gate Sitio web: https://www.researchgate.net/ publication/340609639_El_cuerpo_femenino_en_el_espacio_publico_urba no_The_female_body_in_urban_public_space
10. Marylène Lieber. (2008) Genre, violences et espaces publics. La vulnéra bilité des femmes en question. Paris : Presses de Sciences Po.
11. Mercedes Zúñiga Elizalde (2014). Las mujeres en los espacios públicos: entre la violencia y la búsqueda de libertad. Región y Sociedad, (4),77-100. [fecha de Consulta 29 de Mayo de 2022]. ISSN: 1870-3925. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10230108004
12. Nerea Barjola. (2018). Microsofía Sexista del Poder. El caso Alcàsser y la construcción del terror sexual. . Barcelona: Virus Editorial.
13. Rachel Pain (1991) Space, sexual violence and social control: integrating geographical and feminist analyses of women’s fear of crime. Progress in Hu man Geography, 15(4) 415-431.
14. Sophie Paquin (2006). Le sentiment d’insécurité dans les lieux publics urbains et l’évaluation personnelle du risque chez des travailleuses de la san té. Nouvelles pratiques sociales, 19 (1), 21–39. Recuperado de https://doi. org/10.7202/014783ar
15. Stephanie Riger and Margaret T. Gordon (1981) The Fear of Rape : A Study in Social Control. Journal of social issues. 37(4) 71-92.
16. Teresa del Valle. (1991). el espacio y el tiempo en las relaciones de genero. Kobie (Serie Antropología Cultural), 227, 224-236.
17. Zaida Muxí (2018) Hacia un urbanismo con perspectiva de género, Fun dación Arquia: Blog.
Filmographie
1. Agnès Varda (1977) L’une chante l’autre pas,
Ana Lily Amirpour (2014) A Girl Walks Home Alone at Night
Caru Alves de Souza (2020) Meu Nome é Bagdá
Crystal Mosselle (2019) Skate Kitchen, 5. Eva Giolo (2020) Flowers blooming in our throats 6. Hadas Ben Aroya (2016) People that are not me 7. Mònica Rovira (2017) Ver a una mujer
Quelques conversations
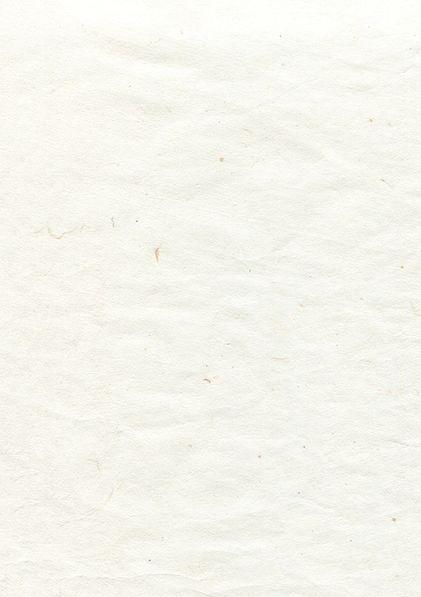
Pour ouvrir une conversation avec mes amies sur le sujet, j’ai préparé une série de questions ci-dessous. Ce type d’entretien pourrait être intéressant pour une étude statistique et fournir des données plus pré cises et des tendances sur certains comportements. La durée et les con traintes de temps de ce travail ne me permettent pas de réaliser ce type d’étude, donc ces conversations, en plus de clarifier certains aspects étudiés, servent surtout à ouvrir, à petite échelle, une conversation qui nous aide à comprendre que notre blessure est une blessure collective, qui nous aide à comprendre et à nous situer face à la violence sexuelle.
Ce sont les questions suggérées dans les conversations : ¿Connaissez-vous le sentiment d’insécurité lorsque vous marchez seul dans la rue ? Pouvez-vous identifier la source de ce sentiment ?
Ce sentiment augmente-t-il ou diminue-t-il selon les personnes avec lesquelles vous marchez (en groupe, avec votre partenaire, avec vos parents, etc.) ?
Avez-vous le sentiment d’avoir déjà été agressé ou harcelé dans un espace public (la violence peut prendre de nombreuses formes) ? Cela a-t-il changé votre façon de marcher dans la rue après cela ?
En dehors de cet événement (s’il s’est produit), vous souvenez-vous d’un événement dans votre vie qui a fait augmenter ou diminuer ce sentiment (une conversation avec une amie qui vous a raconté quelque chose qui lui est arrivé, quelque chose que vous avez entendu aux informations...) ?
Il y a toutes ces histoires sur les endroits de Paris où “il ne faut pas aller la nuit”. Avez-vous déjà été dans un de ces endroits, qu’avez-vous ressenti, vous êtes-vous senti en sécurité ? Si vous l’avez fait, y avait-il quelque chose de menaçant ou était-ce la peur elle-même ?
L’expérience de la marche a-t-elle changé l’idée que vous vous faisiez de l’endroit ? Y êtes-vous retourné par la suite ?
M. Lorsque j’étais à Gand pendant mes trois premières années, je ne me suis ja mais vraiment sentie en danger, je rentrais toujours chez moi à pied après une fête le soir, je n’avais jamais peur. Mais ensuite, lors de mon premier master, je me sou viens qu’il y a eu des agressions sexuelles dans la ville et que de nombreuses person nes ont pris des mesures pour rendre visible ce qui s’était passé, allant jusqu’à écrire dans les rues “quelqu’un a été agressé ici”, et ces actions, même si je pense qu’elles ne sont pas nécessairement mauvaises, m’ont fait me sentir moins en sécurité. Je sais que lorsque je suis arrivé à Paris, mon premier colocataire m’a dit de ne pas sortir la nuit dans les rues en “vêtements de riches”. Elle m’a mis en garde contre l’avenue de Flandre, qui est une rue où il y a beaucoup de gens qui peuvent vous voler, puis elle m’a dit que mon visage n’avait pas l’air très “touristique” et que je ne serais peut-être pas blessé. Je n’ai jamais eu de problèmes, aucun sentiment d’insécurité. N. Peut-être qu’une partie de mon expérience peut vous aider, il s’agit de la di fférence entre deux fois où j’ai été à La Chappelle et à Stalingrad. Au début de l’an née, lorsque j’avais les cheveux longs et une apparence plus efféminée, les gens me disaient des choses dans la rue, m’appelaient, c’était très effrayant parce que j’étais seul, il était 19h et tout le monde me regardait. Il n’y avait que des hommes, pas de femmes. C’était très effrayant. La différence que je peux voir maintenant est énor me, maintenant j’ai une apparence beaucoup plus masculine, j’ai les cheveux courts, je porte toujours des vêtements très amples, je pense que cela vous aide beaucoup à être laissé seul : dans le métro, à Stalingrad, à Chappelle, j’ai juste peur d’être volé. Porter une apparence masculine vous aide à ne pas être vu par ce genre de personnes.
C. Oui, je connais bien le sentiment d’insécurité lorsque je suis seul dans la rue et c’est quelque chose que j’ai normalisé. Si je suis avec un garçon/homme, avec beaucoup de gens ou avec ma famille, ce sentiment diminue. Cela m’est arrivé (harcèlement sexuel dans la rue), mais cela n’a pas changé ma façon de marcher dans la rue.
Je ne me souviens d’aucune conversation qui m’ait fait changer mes sentiments ou mon attitude vis-à-vis de ma façon de marcher ou de la peur que j’éprouve dans l’espace public. Je ne suis pas sûre d’avoir déjà été dans l’un de ces endroits (les endroits où l’on vous dit de ne pas aller), mais je ne me suis jamais limitée dans mon choix de lieux à visiter à Paris. Je me suis toujours sentie en sécurité, sauf une fois et depuis, je n’aime pas rentrer seule chez moi, mais je le fais quand même.
F. La ville d’où je viens est enveloppée d’une membrane de peur qui plane dans l’air de ses rues. Où que vous alliez, vous devez avoir un sens supplémentaire activé. Un sentiment qui, parfois, peut avoir été développé par les événe ments ou simplement par l’hypothèse que quelque chose de mau vais est sur le point de se produire. Il faut donc toujours être vigilant. Le sentiment est toujours là, parfois plus ou moins éveillé. Elle peut se manifester par de petites réactions du corps, comme le fait de se surprendre à mar cher plus vite que d’habitude ou de vérifier compulsivement son environnement. Je pense avoir effacé de ma mémoire la plupart des événements les plus traumatisants que j’ai vécus. Il se peut que je ne sois pas en mesure de dire si j’ai déjà été harcelé dans la rue, car je ne peux pas identifier si j’en ai fait l’expérience ou non dans mes souvenirs. Nous sommes constamment bombardés d’histoires choquantes de violen ce dans les rues. Il n’est pas difficile d’en entendre parler et d’entrer éventue llement en contact avec elle. Je pense donc que c’est aussi une partie du con texte social et normalisé qui nous a fait développer cette peur introjectée. J’ai entendu parler de certains endroits où je ne devrais pas aller, mais peutêtre que je ne les ai jamais pris au sérieux, parce que je pense toujours qu’au cune ville ne peut être plus violente que celle d’où je viens. Cela me fait me sentir en sécurité à Paris. Peut-être ai-je créé ce manteau protecteur ima ginaire qui me permet de croire que je peux me déplacer calmement.