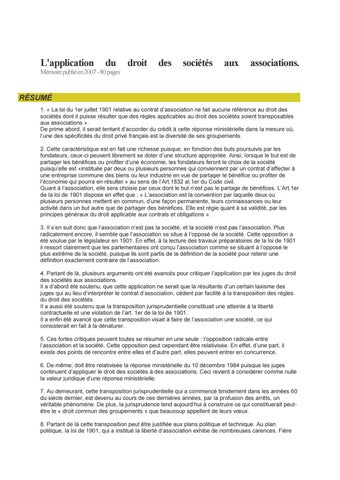L'application
du
droit
des
sociétés
aux
associations.
Mémoire publié en 2007 - 80 pages
RÉSUMÉ 1. « La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ne fait aucune référence au droit des sociétés dont il puisse résulter que des règles applicables au droit des sociétés soient transposables aux associations ». De prime abord, il serait tentant d’accorder du crédit à cette réponse ministérielle dans la mesure où, l’une des spécificités du droit privé français est la diversité de ses groupements. 2. Cette caractéristique est en fait une richesse puisque, en fonction des buts poursuivis par les fondateurs, ceux-ci peuvent librement se doter d’une structure appropriée. Ainsi, lorsque le but est de partager les bénéfices ou profiter d’une économie, les fondateurs feront le choix de la société puisqu’elle est «instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou profiter de l’économie qui pourra en résulter » au sens de l’Art.1832 al.1er du Code civil. Quant à l’association, elle sera choisie par ceux dont le but n’est pas le partage de bénéfices. L’Art.1er de la loi de 1901 dispose en effet que : « L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations ». 3. Il s’en suit donc que l’association n’est pas la société, et la société n’est pas l’association. Plus radicalement encore, il semble que l’association se situe à l’opposé de la société. Cette opposition a été voulue par le législateur en 1901. En effet, à la lecture des travaux préparatoires de la loi de 1901 il ressort clairement que les parlementaires ont conçu l’association comme se situant à l’opposé le plus extrême de la société, puisque ils sont partis de la définition de la société pour retenir une définition exactement contraire de l’association. 4. Partant de là, plusieurs arguments ont été avancés pour critiquer l’application par les juges du droit des sociétés aux associations. Il a d’abord été soutenu, que cette application ne serait que la résultante d’un certain laxisme des juges qui au lieu d’interpréter le contrat d’association, cèdent par facilité à la transposition des règles du droit des sociétés. Il a aussi été soutenu que la transposition jurisprudentielle constituait une atteinte à la liberté contractuelle et une violation de l’art. 1er de la loi de 1901. Il a enfin été avancé que cette transposition visait à faire de l’association une société, ce qui consisterait en fait à la dénaturer. 5. Ces fortes critiques peuvent toutes se résumer en une seule : l’opposition radicale entre l’association et la société. Cette opposition peut cependant être relativisée. En effet, d’une part, il existe des points de rencontre entre elles et d’autre part, elles peuvent entrer en concurrence. 6. De même, doit être relativisée la réponse ministérielle du 10 décembre 1984 puisque les juges continuent d’appliquer le droit des sociétés à des associations. Ceci revient à considérer comme nulle la valeur juridique d’une réponse ministérielle. 7. Au demeurant, cette transposition jurisprudentielle qui a commencé timidement dans les années 60 du siècle dernier, est devenu au cours de ces dernières années, par la profusion des arrêts, un véritable phénomène. De plus, la jurisprudence tend aujourd’hui à construire ce qui constituerait peutêtre le « droit commun des groupements » que beaucoup appellent de leurs vœux. 8. Partant de là cette transposition peut être justifiée aux plans politique et technique. Au plan politique, la loi de 1901, qui a institué la liberté d’association exhibe de nombreuses carences. Fière