L’AVENTURIER
Techniques de survie • bushcraft • plantes • orientation


les différentes techniques pour fabriquer du feu
Allumer un feu avec une batterie ou une pile
Les courts-circuits avec étoupe
En plaçant de l’étoupe entre les pôles positif et négatif d’une batterie, vous créez, l’espace d’une demi-seconde, un arc électrique qui va enflammer votre étoupe. Attention, cette opération peut s’avérer dangereuse si vous essayez d’allumer du feu avec une batterie automobile par exemple, ou directement avec du 220 V. Je vous conseille de le faire avec une pile de 9 V. Cela sera amplement suffisant pour faire naître une belle étincelle.
Les courts-circuits avec paille de fer
Le mieux est d’utiliser de la paille de fer ou des isolants de câble électrique constitués de fils d’acier très fins tressés. Provoquez un court-circuit en mettant en contact la paille de fer et les pôles Nord et Sud de votre pile. (Le voltage de la pile est primordial : en dessous de 9 V, le court-circuit est plus compliqué à obtenir.)
Les courts-circuits avec une ampoule cassée avec filament
Il se peut que vous ayez dans votre sac un système d’éclairage constitué de piles et d’ampoules à filament. Cassez délicatement le verre de l’ampoule pour mettre à l’air libre le filament et allumez votre lampe. Soyez rapide pour mettre en contact votre amadou ou étoupe avec le filament qui va rougir puis casser après 1 à 2 secondes seulement.
Les courts-circuits avec papier de chewing-gum
Si vous avez à votre disposition une pile d’au moins 1,5 V et un papier de chewing-gum, vous avez peut-être l’opportunité de créer un point chaud. Le secret de votre réussite réside dans le pliage et la découpe du papier.
Allumer
un feu avec le Soleil : effet loupe
Une loupe est une lentille qui fait converger la lumière. Avec votre loupe ou votre objet faisant office de loupe, trouvez la position et l’inclinaison idéales : la lumière captée doit former un petit point par terre. Appliquez-la sur un matériau foncé, dense et sec, comme de l’amadou ou une bonne étoupe d’herbe. Si vous avez exposé au Soleil votre dispositif et si l’effet focal est à son maximum, la fumée sera instantanée, et vous générerez de la braise voire une flamme en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire. Il existe toutes sortes de loupes : souples, rigides, intégrées à la boussole. Mais une règle est valable : plus votre loupe est puissante, moins vous avez besoin d’un Soleil radieux.

Vous pouvez vous procurer assez facilement dans le commerce des lentilles de Fresnel, spécialement pensées pour allumer un feu.
Avec vos lunettes
Si vous avez des lunettes, vous pouvez essayer de créer un point chaud. À l’instar d’une loupe, les verres concentrent les rayons du Soleil en un seul point. Mais leur efficacité est moindre. Attention, les lunettes équipées de verres antireflet ne fonctionnent pas.
Avec un préservatif
Cela pourrait être un mauvais gag mais cette technique est très efficace ! Remplissez le préservatif avec une eau claire afin d’obtenir une boule de 8 à 10 centimètres de diamètre. Pour bien concentrer la lumière du Soleil en un point, approchez délicatement la boule de votre amadou. Si vous êtes bien positionné, la fumée apparaît instantanément.
Avec une boule ou une loupe de glace
Il s’agit toujours ici de trouver un matériau permettant la convergence des rayons lumineux du Soleil. Essayez de créer une belle boule ou une loupe avec la glace l a plus translucide et sans bulle d’air possible. Puis, comme avec le préservatif ou votre loupe, rapprochez la boule de votre étoupe ou amadou et cherchez le point de focale. Si vous êtes bien positionné, la fumée apparaîtra instantanément.
Avec une bouteille plastique
C’est exactement le même principe qu’avec un préservatif ou une boule de glace. Trouvez une bouteille transparente de forme arrondie après le goulot (se rapprochant le plus possible d’une boule). Approchez-la de votre amadou de couleur foncée (il captera mieux la lumière et chauffera plus rapidement).
Allumer un feu avec le Soleil : four solaire
Contrairement à l’effet loupe, l’effet « four solaire » ne décompose pas le spectre de la lumière pour le reconcentrer en un seul point mais fait rebondir sur un miroir les rayons du Soleil pour les faire converger en un seul point. Le secret de votre dispositif est de bien orienter votre « miroir » pour que le point de chauffe soit puissant.
Le principe du four solaire (ici au Népal), c’est de faire converger l’énergie solaire vers un point à chauffer, en utilisant une surface réfléchissante.

Avec un culot de canette de soda
C’est le culot de la canette que vous utiliserez pour faire rebondir les rayons du Soleil, car il est en forme de minifour solaire et en métal réfléchissant. Pour obtenir un bon résultat, rendez l’aluminium le plus « miroir possible » en le polissant avec un abrasif très fin, comme un carré de chocolat, du dentifrice ou du sable farineux, et un chiffon. Frottez bien le culot pour obtenir une surface lustrée éclatante. Puis déterminez le point de convergence des rayons lumineux en plaçant un petit bout d’amadou ou un matériau inflammable près du culot. Comme toujours avec le Soleil, le résultat sera instantané.
Allumer un feu avec des produits chimiques
Ce n’est pas ma spécialité et je me méfie des produits chimiques, à mes yeux trop dangereux. Mais s’il ne vous reste que cette possibilité pour faire votre feu de camp… il faut tout tenter !
Avec un mélange explosif
• Un mélange de sucre + chlorate de sodium
• Un mélange de sucre + permanganate de potassium + étincelle
• Un mélange de sucre + chlorate de potassium + acide sulfurique
• Un mélange de permanganate de potassium + glycérol
Avec une batterie de téléphone portable
Attention, cette opération peut être dangereuse, car explosive. Elle est aussi polluante, donc prenez toutes vos précautions. Cette technique est un mix entre la maîtrise de produits chimiques et la fabrication d’une étincelle. Pour créer une flamme avec votre batterie de téléphone, il faut une batterie au lithium (les plus courantes sur le marché). Dégagez les deux pôles et fixez avec les moyens du bord un fil conducteur sur le pôle + et un autre sur le pôle –. Percez d’un coup sec le corps de la batterie sans la traverser pour provoquer une fuite de lithium, puis mettez en contact les pôles de la batterie pour obtenir un court-circuit. Au contact de l’air, le lithium s’échappant grâce à la fuite que vous avez provoquée va chauffer puis s’embraser grâce à l’étincelle du courtcircuit. Il ne vous reste plus qu’à poser la batterie sur votre étoupe pour faire partir le feu.
Allumer un feu par friction
Il est plus facile de réaliser ce type de feu à plusieurs. L’union fait la force et vous comblerez votre manque de technique et de résistance grâce au collectif. En effet, seuls ceux qui possèdent le savoir-faire et l’entraînement y arriveront sans effort. Si vous vous improvisez survivor d’un jour, vous n’obtiendrez de braise qu’en vous unissant à deux ou trois personnes. Une parfaite coordination est indispensable.
Méthode par friction, rotation et frottement
Il existe une vingtaine de variantes mais cette méthode consiste à produire un échauffement entre deux matériaux (souvent du bois) en les frottant rapidement et fortement pour obtenir de la cendre chaude incandescente (braise).
Drille + planchette avec ou sans archet
> Avec archet
L’archet permet de faire tourner une drille de 20 centimètres environ rapidement, sans effort ni ampoules aux mains. La paumelle permet d’effectuer une belle pression sur la drille pour provoquer un frottement plus important sur la planchette. C’est ma technique favorite, qui marche par tous les temps. Elle fonctionne dans beaucoup d’environnements et, avec un peu d’entraînement, ne nécessite pas forcément beaucoup d’énergie (surtout si vous êtes plusieurs).
Mon secret : pour commencer, prenez le temps de trouver les bons morceaux de bois. Je ne peux que vous encourager à savoir identifier les essences qui conviennent le mieux (la planchette en lierre et la drille en noisetier – c’est l’idéal), puis à fabriquer différents outils comme la drille et l’archet. Si votre préparation est correcte, vous fabriquerez de la braise en moins de temps.
Une fois la braise obtenue, transvasez-la dans un « nid » constitué de végétaux et matières inflammables, puis soufflez doucement pour avoir une flamme.
 Mouvement de l’archet.
Paumelle
Mouvement de l’archet.
Paumelle
> Sans archet
Le principe est simple : il vous faut fabriquer une drille de 50 à 90 centimètres de long et de 1 centimètre de diamètre environ. Cela fonctionne avec pas mal d’essences de bois. Si vous êtes en Europe, je vous conseille une belle tige de sureau noir. Si, en plus, vous êtes plusieurs (au moins deux), vous mettrez toutes les chances de votre côté.
Feu avec la technique raramurie
Toujours avec le même principe de frottement façon sciage, voici la technique des Indiens d’Amérique centrale.

Pour réaliser la partie dormante du dispositif, assemblez deux planchettes réalisées avec une tige florale de yucca (poussant principalement en Amérique centrale et en Amérique du Sud), ou de bambou. Glissez entre les deux planchettes deux cailloux aux extrémités ; de l’étoupe et de l’amadou au centre ; serrez le tout avec un cordage bien solide.
Pour réaliser la partie active du dispositif, fabriquez une troisième planchette que vous utiliserez comme une scie pour couper le support.
Pour obtenir la braise : faire une légère fente au-dessus de l’étoupe, sur le dormant au milieu de vos deux planchettes assemblées, pour guider la partie active et bloquez le dormant avec une grosse pierre ou un rondin bien lourd. Il ne vous reste plus qu’à frotter l’actif sur le dormant. La fumée devrait apparaître rapidement. Poursuivez votre effort le plus longtemps possible pour produire la flamme qui tombera sur l’étoupe et créera la braise.










Assemblez deux planchettes, glissez deux cailloux aux extrémités, ajoutez de l’étoupe et de l’amadou et serrez le tout avec un cordage bien solide.











 Mouvement de friction.
Faites une légère fente au-dessus de l’étoupe pour guider la planchette.
Mouvement de friction.
Faites une légère fente au-dessus de l’étoupe pour guider la planchette.
Orienter sa carte



Matériel

boussole + carte

Choisissez un endroit plat comme une table en bois ou mettez-vous directement sur le sol. Dépliez votre carte. Vérifiez qu’il n’y a aucune interférence électromagnétique qui fausse le fonctionnement de votre boussole (portable, clou, vis, métal, couteau…).
Tournez le cadran rotatif de votre boussole jusqu’à ce que le nord du cadran rotatif, avec sa flèche d’orientation, soit aligné avec la flèche de visée. Superposez votre boussole et la rose des vents, ou bien posez votre boussole sur la carte en alignant l’un de ses côtés avec un méridien. Dans tous les cas, il faut que la flèche de visée soit bien orientée vers le nord de la carte. Vérifiez que tout est aligné : la flèche d’orientation qui indique le nord, la flèche de visée et le nord de la carte.
Tournez doucement votre carte avec la boussole posée dessus, jusqu’à ce que l’aiguille aimantée vienne se superposer à la flèche d’orientation. À présent, la carte est orientée de façon à correspondre exactement au paysage que vous avez sous les yeux.







Prendre un azimut ou choisir un cap
Matériel

boussole + carte
Sur la carte correctement orientée, repérez votre position actuelle, c’est le point A, et le point où vous voulez arriver, c’est le point B.






Tracez une ligne entre les deux points.






Posez votre boussole le long de la ligne, avec la flèche de visée qui pointe le point B.
Sans faire bouger la boussole, tournez le cadran rotatif pour que le nord du cadran soit aligné avec le nord de la carte.
Vous pouvez lire votre cap, ou votre azimut, sur la boussole : c’est le chiffre du cadran qui est aligné avec la flèche de visée. Ici, 120 degrés.

Faire une visée
Matériel boussole

Une fois que vous avez lu votre azimut, sans dérégler la boussole, rangez votre carte. Prenez votre boussole en main. Ne touchez plus votre cadran mais tournez sur vous-même jusqu’à ce que l’aiguille aimantée s’aligne avec la flèche d’orientation. On appelle cette manœuvre « mettre le nord dans sa maison ».
Dès que le nord est dans sa maison, regardez dans la direction donnée par l’axe de visée et repérez un point remarquable : une montagne, un pont, un clocher d’église…
Vers point B
Point A


Une fois que vous aurez défini votre repère, vous pouvez ranger votre boussole et partir dans la direction du repère en essayant de ne jamais le perdre de vue. Une fois rendu au pied du repère que vous avez visé, sortez carte et boussole et renouvelez l’opération à partir de votre nouveau point A en reprenant un cap et en refaisant une visée… Jusqu’à atteindre votre point d’arrivée. Essayez de prendre votre repère le plus loin possible de vous car plus le point visé est loin, moins vous aurez à effectuer cette opération et moins vous ferez d’erreurs !

Astuce
Quand vous faites votre visée, si votre boussole n’a pas de capot, vous pouvez utiliser un morceau de ficelle tendu ou le cordon de la boussole pour vous aider.

Vous n’êtes pas obligé de partir en ligne droite. Si un obstacle vous empêche de progresser, vous pourrez le contourner sans perdre votre objectif de vue. Empruntez donc les chemins les plus praticables et les plus rapides.


Une visée = une erreur possible ! Plus vous aurez à faire cette opération, plus vous additionnerez de petites erreurs de visée et moins vous tomberez sur votre objectif. En effectuant des « grandes visées » vous diminuerez vos risques d’erreur.
Boussole
sucré, la mûre est très appétissante, mais n’oublions pas que les jeunes bourgeons sont eux aussi comestibles (plus amers que les fruits tout de même !) et seront parfaits crus ou bouillis, en complément d’autres aliments. Enfin, les racines elles aussi sont comestibles et peuvent être cuisinées comme un légume classique, mais bon courage pour espérer en déterrer, car la bestiole se défend !
Autres usages :
Tiges des ronces : Elles pourront servir à la confection de paniers et autres contenants. Il existait autrefois un vrai savoir-faire en Dordogne et en Corse pour travailler la ronce et effectuer un excellent travail de vannerie.
Épines : Elles pourront vous être utiles pour concevoir des hameçons et espérer pêcher des poissons pas trop regardants sur la finesse du piège. Vous pourrez aussi fabriquer des accroches pour harponner des grenouilles ou tout autre petit animal.
Écorce des tiges les plus droites : Elle vous servira à la fabrication de kilomètres de cordage. En effet, sans trop d’apprentissage, vous serez capable de tresser, torsader, rabouter les longs brins d’écorce pour en faire des liens efficaces et solides (attention tout de même : en séchant, ils risquent de devenir cassants).
SALICORNE
Catégorie : Plante vivace de bord de mer de la famille des Chénopodiacées Autre nom ou origine du nom : Passepierre Nom latin ou scientifique : Salicornia europaea L.

Saison de cueillette : Toute l’année.
Vertus médicinales : Elle contient beaucoup de vitamine C, d’oxalate, de sodium, et du brome, ce qui ne conviendra pas aux personnes sujettes aux calculs rénaux ! Mais elle sera excellente pour vous redonner la pêche et fixer l’eau trop faible en minéraux dans votre organisme.
Usage culinaire et saveur : Il sera judicieux de ne collecter que les jeunes pousses beaucoup plus tendres et juteuses que les plus anciennes, plus ligneuses. Vous leur trouverez un goût salé et acidulé parfois.
J’aime les consommer crues et croquantes, mais elles remplissent amplement le rôle d’épice pour saler viandes, poissons et fruits de mer.
SORBIER DES OISELEURS
Catégorie : Arbuste de la famille des Rosacées
Autre nom ou origine du nom : Sorbier des oiseaux
Nom latin ou scientifique : Sorbus aucuparia

SOUDE MARITIME
Catégorie : Plante de la famille des Amaranthacées
Autre nom ou origine du nom : Blanchette, blanquette, patte-d’oie-marine, salanquet, suéda maritime
Nom latin ou scientifique : Suaeda maritima
Saison de cueillette : Dès le début des gelées en automne et hiver.
Vertus médicinales : Les sorbes consommées crues sont astringentes et peuvent, en décoction, servir à soigner les extinctions de voix. Elles ont aussi des propriétés laxatives et diurétiques indéniables.

Usage culinaire et saveur : Il faudra être patient et attendre que les fruits du sorbier deviennent presque rouges, bien mûrs, pour espérer les consommer. Autrement, ils seront toxiques. Il faudra aussi laisser passer le gel pour que les sorbes soient blettes et bien cuites par le froid. Vous apprécierez leur saveur acidulée en plein hiver, crues ou en les faisant revenir dans votre popote pour les consommer en compote.
Usages autres : Les fruits sont d’excellents appâts pour piéger les oiseaux, notamment les grives.
Saison de cueillette : Les jeunes pousses et feuilles se ramassent plutôt de mars à mai.
Usage culinaire et saveur : Les jeunes feuilles et pousses sont consommées sous forme de condiment ou directement en salade. Mais attention au goût salé très prononcé !
Autres usages : Si le cœur vous en dit, vous travaillerez beaucoup pour extraire de ses cendres la soude qu’elle renferme et vous pourrez fabriquer avec de la graisse une lessive intéressante (encore faudra-t-il avoir de la graisse en quantité suffisante).
SUREAU NOIR
Catégorie : Arbuste de la famille des Caprifoliacées
Autre nom ou origine du nom : Arbre de Judas, grand sureau
Nom latin ou scientifique : Sambucus nigra

grande modération sur l’arbre. Si le cœur vous en dit, vous pourrez les presser et les cuire pour en faire un doux jus violet (attention à ne pas presser les pépins, cela rajouterait un goût amer). Le sureau ne sera consommé qu’en quantité raisonnable pour éviter un effet purgatoire et vomitif.
Saison de cueillette :
Les fleurs : Juin.
Les fruits : D’août à septembre.
Vertus médicinales : Hormis les fleurs et les baies, la plante renferme des substances toxiques telles que l’oxalate de calcium. Il conviendra aussi de faire attention à la maturité des fruits avant de les consommer, car les fruits non matures contiennent un alcaloïde toxique qui provoque des vomissements. Les fleurs fraîches ainsi que les feuilles et la partie verte des tiges se trouvant sous l’écorce contiennent du mucilage, des flavonoïdes, des anthocyanes et des tanins. Ils sont laxatifs et diurétiques. Les fruits mangés à forte dose (grains noirs luisants), eux, sont sudorifiques et purgatifs. Ils renferment des vitamines A, B et C15. Les fleurs séchées en infusion sont sudorifiques et peuvent être conseillées pour soigner les rhumes, les bronchites et soulager la grippe et les rhumatismes.
Usage culinaire et saveur : Les fruits sont sucrés et frais, légèrement acides parfois. Ils peuvent être mangés avec une
ATTENTION : Ne pas confondre avec le sureau l’hièble (ou yèble) qui, lui, est bien plus toxique et pousse en colonies cou‑ vrant de grandes surfaces. Il ne dépasse pas 2 mètres de haut. Cette plante a en apparence les mêmes fruits que le sureau à chaque sommité, mais elle regarde vers le ciel. Si vous passez à côté de ce « faux sureau », vous le remarquerez par son odeur nauséabonde.
Usage survie : Grâce à son fort pouvoir tachant, vous pourrez utiliser la baie pour teinter des tissus en violet ! Les tiges droites, une fois vidées de leur matière spongieuse, pourront servir de sarbacane, de paille, de bouffadou ou de flûte. Les plus solides serviront à faire du feu par frottement (sans archet) à l’aide d’une planchette.
TAMIER
Catégorie : Plante grimpante de la famille des Dioscoréacées
Autre nom : Herbe-aux-femmes-battues, respounchou
Nom latin ou scientifique : Tamus communis
TILLEUL commun
Catégorie : Arbre du genre Tilia et de la famille des Tiliacées
Autre nom : Arbre-qui-pleure Nom latin ou scientifique : Tilia


Saison de cueillette : La poussée s’effectue dès les premières chaleurs du printemps.
Vertus médicinales : La racine est toxique mais peut être utilisée en cataplasme une fois râpée, pour soigner les contusions et les bleus. Elle agit aussi contre les douleurs articulaires et les crises d’acide urique. Mais attention aux réactions cutanées car il aura sûrement sur votre peau des effets secondaires.
Usage culinaire et saveur : Les très jeunes pousses sont tendres et font penser aux asperges sauvages. Mais elles peuvent être amères. Il convient de les faire bouillir dans un grand volume d’eau pour atténuer ce goût trop prononcé.
Saison de cueillette : Du printemps à la fin de l’été.
Vertus médicinales : Les feuilles sont riches en mucilage, en huiles essentielles, en tanins, en glucosides, en sucres, en gomme, en manganèse et en vitamine C. Les bractées donnent la célèbre infusion apaisante. Elles sont utilisées pour les troubles nerveux, les crises d’angoisse, les migraines, les insomnies, les dépressions. Elles sont aussi sédatives, diaphorétiques et euphorisantes, mais attention à ne pas trop forcer sur le dosage car vous obtiendrez l’effet inverse. L’aubier (le bois le plus tendre de l’arbre), pris en infusion, aurait des actions hépato-toniques remarquables pour éliminer les toxines et l’acide urique.
Usage culinaire et saveur : Jeunes feuilles : Elles se mangent crues. Mucilagineuses, elles ont un goût très agréable et frais.
Feuilles plus vieilles : Séchées, elles sont broyées et tamisées pour créer une farine qui donne un bon apport en protéines végétales et un bon épaississant pour vos soupes. Feuilles : En infusion, elles donnent un excellent thé.
Pour 4 personnes
Temps de préparation :
1 heure environ
Banane grillée au chocolat à la laminaire sucrée
Ingrédients dans votre sac :
• 4 bananes
• 1 mètre de papier aluminium
• 1 tablette de chocolat au lait ou noir
Ingrédients sauvages
• 1 mètre de laminaire sucrée
1 Préparation des bananes : pour commencer, vous aurez le choix crucial entre deux stratégies pour fendre vos bananes en deux. Certains préfèrent les entailler sur toute la longueur et d’autres (dont je fais partie) les entailleront sur l’une des deux faces. La deuxième option, à mon goût, sera plus efficace et facilitera la cuisson de vos bananes sur le feu. Car en étant entaillées sur la face, elles resteront stables et ne perdront pas leur chocolat ni leur jus pendant la cuisson. Cela est un détail, mais qui pourra faire la différence à la fin !
2 Il ne vous restera plus qu’à mettre au moins 4 carrés de chocolat dans les fentes de chaque banane. Enveloppez les fruits dans du papier aluminium en prenant soin d’éviter les fuites.
3 Mettez les bananes sur le feu pendant 15 minutes afin que le chocolat fonde et imbibe la chair de la banane.
4 Préparation de la laminaire : vous aurez cueilli l’algue à la main sans jamais arracher l’attache au sol. Coupez en petits carrés un bon 20 centimètres d’algues par personne puis dessalez-les en les plongeant dans de l’eau fraîche pendant une heure (goûtez-les pour savoir si elles sont à votre goût). Il ne vous restera plus qu’à les faire bouillir comme des pâtes dans l’eau durant 20 minutes. (Les algues seront cuites lorsqu’elles seront tendres sous la dent.)
5 Dressez la banane dans son papier alu avec les carrés d’algue. Le côté sucré-salé de cette recette vous surprendra !
Café avec des glands de chêne
1 Il ne faut pas rêver, si vous voulez transformer des glands de chêne en café, vous aurez beaucoup de travail pour obtenir au mieux un jus de chaussette buvable. Mais certains d’entre vous, « caféinomanes », ne résisteront pas longtemps en situation d’inconfort sans café ! Tout d’abord, sachez qu’il existe plus d’une centaine de chênes différents qui donnent tous des glands plus ou moins tanniques. Certains ont simplement besoin d’un rinçage de quelques heures et d’autres, de plusieurs jours pour éliminer en partie leur goût amer. Il sera donc indispensable de les travailler pour que votre café soit acceptable.
2 Faites bouillir l’eau puis sortezla du feu et plongez-y les fleurs. Laissez vos glands quelques minutes dans une grande bassine d’eau claire et froide. Éliminez tous les glands qui flottent (ils doivent être habités). Laissez faire le temps. À chaque fois que vous constatez que l’eau a viré au brun, changez-la. Cela pourra durer plusieurs jours.
Pour aller plus vite, vous pourrez faire la même opération avec de l’eau bouillante. Vous arrêterez de changer d’eau dès que vous estimerez, en les goûtant, que les glands seront plus amers.
3 Il ne vous reste plus qu’à les faire sécher ou torréfier à sec dans une poêle, à feu doux, pendant 10 minutes. N’oubliez pas de les remuer souvent. Si vous les torréfiez avec leur coquille, ils pourront se conserver longtemps. Dès que vous voudrez faire du café, cassez la coquille comme celle d’une noisette, puis décortiquez. Faites bouillir votre eau, sortez-la du feu et plongez-y vos fleurs. Attendez quelques minutes et broyez les glands jusqu’à les réduire en poudre.
4 Mettez dans l’eau bouillante 1 à 3 cuillères de café de glands. Faites bouillir votre eau puis sortezla du feu et plongez vos fleurs dans l’eau. Attendez quelques minutes. Laissez infuser 3 minutes. Filtrez ou laissez le café se déposer au fond de la tasse (comme un café turc). Savourez !
LE B.A.-BA du brêlage de base
Cette technique vous sera vraiment très utile. Elle consistera à mettre en œuvre et à cumuler les techniques de fabrication de nœuds et d’assemblages. Ainsi vous pourrez prolonger, lier, assembler, solidifier une infinité de choses.
Surliure
Carré Diagonalfeu par friction



Cette technique a plus de 400 000 ans et de très nombreuses versions et déclinaisons existent. Un livre entier ne suffirait pas à recenser toutes les techniques ancestrales de fabrication du feu, mais la méthode dite « de l’archet » est vraiment la plus abordable et facile de mise en œuvre sous nos latitudes ! Si vous n’y arrivez pas seul, faites-vous aider. À deux, trois ou quatre, vous dépenserez moins d’énergie mais il vous faudra plus de coordination !
Matériel


Planchette en lierre d’environ 5 cm de largeur et 1 cm d’épaisseur
Drille taillée en pointe de 20 cm de longueur et de 1 cm de diamètre environ, en noisetier
Paumelle
Tout sera bon à prendre : un coquillage, un caillou creux, un bout de bois dur...
A Mouvements d’allers-retours avec l’archet pour faire tourner la drille, et créer une braise qui va tomber dans le réceptacle.

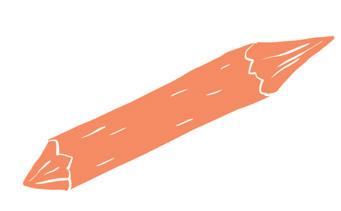










Z Le mouvement rotatif de la drille permet de créer une braise qui va tomber sur la feuille.

La braise dure une ou deux minutes chaude.
E La braise est versée dans une étoupe en forme de nid d’oiseau.
Archet de 70 cm de longueur environ
Réceptacle pour la braise

R Une fois la braise dans le nid, tenez-le devant vous et soufflez doucement pour créer la flamme.

différentes sortes de feu





Chaque personne, chaque communauté, chaque pays a trouvé une façon différente d’agencer son feu. Certains le font en tipi, d’autres sous-terrain, ou façon trappeur… En réalité, chacun a développé la meilleure façon de domestiquer le feu pour qu’il réponde au mieux à ses besoins. Donc analysez bien ce que vous voulez obtenir de votre feu.




Est-ce pour faire cuire vos aliments ? Vous éclairer ? Repousser les bêtes ?





Avez-vous beaucoup ou peu de bois à disposition ?
Feu de chauffage bûches longues
Feu scandinave ou torche suédoise, pour allumer un feu dans des conditions difficiles, notamment sur la neige
Feu trappeur : protège les braises du vent et offre une bonne assise à la gamelle
 Feu trou de serpent, parfait pour les endroits exposés au vent
Feu Dakota, qui n’a pas besoin de beaucoup de matériau pour être efficace
Feu avec cercle de pierre
Feu en étoile, parfait pour la cuisson directe sur le feu
Feu tipi
Feu trou de serpent, parfait pour les endroits exposés au vent
Feu Dakota, qui n’a pas besoin de beaucoup de matériau pour être efficace
Feu avec cercle de pierre
Feu en étoile, parfait pour la cuisson directe sur le feu
Feu tipi
Ce grand guide s’adresse à tous les aventuriers et toutes les aventurières amoureux des grands espaces, de la nature, des voyages et des découvertes.
La première partie est consacrée à la survie : comment y faire face, gérer le stress, se nourrir, trouver de l’eau potable, alerter les secours…
Vous y apprendrez ensuite les essentiels de la vie en pleine nature : faire du feu, reconnaître et cuisiner les plantes et les fruits, ou encore construire un bivouac du plus simple au plus évolué.
Enfin, le chapitre sur l’orientation vous donnera toutes les clés pour vous diriger, aussi bien avec votre GPS qu’avec les étoiles. Vous y trouverez notamment des tutoriels très complets pour maîtriser parfaitement cartes et boussoles. MDS : VA07780
