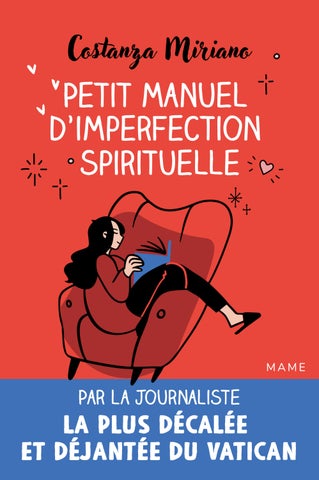J’ai demandé une chose, la seule que je cherche
C’est décidé. Je veux devenir moniale.
On pourrait ergoter et me faire remarquer que je suis mariée. Pour être précise, je suis même mariée deux fois. Avec le même homme, mais deux fois. Au-delà de l’aspect bureaucratique ennuyeux, le fait est qu’ils m’ont tous entendue dire par deux fois que je resterai pour toujours avec ce mari. Nous avons quatre enfants, ce qui n’est pas vraiment l’idéal pour une vocation monastique. Toutefois, même dans un petit appartement avec quatre enfants, on peut trouver des moments de silence : en pleine nuit, ou dans la salle de bains. Mais, à condition de fermer à clé. Je n’ignore pas le fait que j’avance en âge, et même si la télévision existait déjà à ma naissance, les railleries de mes enfants sur ma décrépitude ne me font absolument pas rire. Ne pas savoir allumer Sky1 n’a rien à voir avec l’âge mais avec d’autres problèmes cognitifs que je n’aborderai pas ici – en tout cas, je ne dérange personne et contemple avec sérénité l’écran noir quand je suis seule.
En résumé, j’ai dépassé depuis quelques années le moment où l’on choisit sa vocation, a fortiori monastique. Et même si la serviette mise comme un voile après m’être lavé les cheveux me donne ce petit quelque chose (que je ressens depuis que je
suis toute petite), mes choix de vie sont faits : j’essaie de tout mon cœur d’être chrétienne, je suis indubitablement épouse et mère, je contribue au budget familial en écrivant – bien que les qualificatifs « journaliste » et surtout « écrivain » me semblent très abusifs. Je suis aussi très régulièrement en retard, je ris trop et pas toujours à bon escient, je détonne mais sans m’en apercevoir, je cours tout le temps, je parle beaucoup et fais plein de choses – comme mettre du vernis à ongles, puis le remettre après l’avoir abîmé en sortant le saucisson du frigo –, je téléphone à mes amies chaque jour pour faire un point sur la vie, ce que je considère être un « vrai travail sur soi » (alors que mon mari le voit comme du papotage) et je fais encore plein d’autres choses, trop de choses, pour animer ma vie de famille.
Toutefois, c’est justement parce que j’ai vieilli – oui, je l’admets, la télévision était encore en noir et blanc – et que je peux me fonder sur des milliers de discussions entre amies et des milliers de rencontres, que je peux énoncer aujourd’hui quelques certitudes : non seulement mon cœur est un mystère, un abîme, un roseau creux battu par le vent, mais tous les cœurs autour de moi sont aussi des abîmes inconnus. Cela ne concerne pas seulement les cœurs des femmes, même si la femme est plus disposée à écouter son besoin d’Autre chose (les femmes sont plus exposées au besoin et à la souffrance : on veut bien accoucher dans la douleur, mais à quel titre accepter la cellulite ?). Ces roseaux creux, ces cœurs sont incroyablement façonnés par ce qui les pénètre. Une seule chose remplit le cœur de l’homme, lui dit qui il est, lui permet de dire vraiment « je » pour rendre ensuite possible
de dire « nous ». L’unique réponse, la véritable plénitude, l’accomplissement, c’est le monachisme.
Le monachisme, que l’on porte l’habit, que l’on soit pharmacien ou maçon, c’est avant tout se lancer dans une vie spirituelle sérieuse. Une vie de foi qui unifie la personne, qui soit à la source de chaque respiration. Ce n’est pas une tâche facile, cela exige un choix, un jugement, une décision, et les moines le savent bien. Les moines sont des combattants, des guerriers, qui luttent depuis leurs tranchées pour placer cette vie de foi au centre de leur cœur, et l’y maintenir. Pour la placer au plus profond de leur intériorité, et là, pouvoir entrer en contact avec Celui qui nous est le plus intime. Et quand un moine pénètre dans ce lieu d’intériorité, alors il est totalement unifié : c’est ce que signifie le mot « moine ». Il n’est pas seul, comme le pensent la plupart, mais il est unifié, c’est-à-dire qu’il pense, dit et fait la même chose. Cela suppose de bien se connaître ! Le moine est celui dont toutes les actions ont un centre unique et tendent toujours à y revenir. Cela constitue le premier motif – mais pas le seul – pour lequel je désire tant le monachisme. Je crois que c’est la réponse à toutes les questions que je me pose dans ma vie, y compris celles du temps présent. Là, maintenant.
Oui, je me rends bien compte qu’à première vue, ma situation d’aujourd’hui ne ressemble pas vraiment à celle de saint Pacôme, l’un de ces Pères du désert qui furent les initiateurs de ce type de vie. Il est 3 heures du matin et je n’ai pas encore fait la moitié de ce que je devais faire aujourd’hui, devenu hier depuis quelques heures d’ailleurs. Je porte un vêtement de sport fuchsia – typique du monachisme
occidental – avec une crème antirides à ma droite (la conscience des achats inutiles se manifeste surtout les nuits d’été, et la voix des pharmaciens d’autrefois me murmure avec sagesse : « Combien de traitements auraient pu être achetés à la place de cette crème qui ne freinera pas ta déchéance ? »).
À ma gauche, des livres de Groucho Marx et de la nourriture recommandée par la Fédération mondiale contre le cholestérol. Pour expier, face à moi, une petite bouteille de boisson drainante (nous, aspirants moines, tenons en haute considération la lutte contre la rétention d’eau). Autour de moi, en ordre dispersé, une pince à épiler, un correcteur (pas celui qui corrige tes textes, mais une crème rose clair qui cache tes cernes), trois chapelets, la fiche d’inscription en deuxième année de lycée classique, deux amendes, des fleurs agonisantes, un missel, une dizaine de livres commencés et abandonnés, toujours pour ce même motif agaçant : les journées comptent vingt-quatre heures seulement, elles finissent quand tu t’y attends le moins, puis reprennent, toujours plus courtes. Et il faut recommencer tout ce qui se représente à nouveau, avec obstination, chaque jour. Par exemple, préparer le déjeuner et le dîner, car malheureusement, avec les enfants, on ne peut pas s’en tirer de la même façon qu’avec les chats… en leur présentant un bol de croquettes aux crevettes.
Pourtant, dans le chaos de ces journées surbookées, de listes toujours trop longues et régulièrement non éclusées, je veux devenir moniale. Car la prière est la force la plus puissante au monde, celle qui nous change nous d’abord, puis qui change le monde. Un jour, tout nous semblera très clair, quand tout sera dévoilé, après la mort. Nous rirons alors de voir que
l’arrière-grand-mère Irma, ou bien François et Jacinthe, petits bergers âgés de 9 ans, ont déplacé des armées, bien plus que Churchill ou Eisenhower. La seule chose nécessaire est d’avoir un cœur monacal, entraîné comme un ranger, pour trouver le moyen de prier dans nos vies hyperconnectées où il n’y a aucun temps mort, où tout semble se liguer contre la prière et le silence.
Pour moi, le plus grand symbole du luxe n’est certainement pas une paire de chaussures de Roger Vivier, mais ma mère qui fait La Semaine des mots croisés devant le feu. Il faut être un véritable chirurgien pour parvenir à isoler un espace qui serait préservé des mots et des relations inutiles ! Et cela, je n’y parviens pas. Ajoutons que je serais une véritable catastrophe en tant que chirurgienne : quand je tombe et qu’un petit caillou s’incruste dans mon genou, je ne peux même pas regarder et, à chaque fois, je préférerais mourir rapidement de septicémie plutôt que de l’extraire avec une pince à épiler. En général, je choisis d’aller aux urgences. Voilà, c’est un peu ce que je cherche en ce moment : un chirurgien qui fasse pour moi, ou mieux encore, avec moi, ce sale travail. Creuser dans ma chair et enlever ce qui ne sert pas à la vie véritable. Isoler un espace de silence et de rencontre. Car, si nous ne pouvons pas faire se lever le soleil, nous pouvons au moins être présents quand il se lève. Si nous n’isolons pas un espace, en le préservant du bruit de fond, de nos pensées, des urgences et des demandes extérieures, de la voix des autres et de notre propre voix, nous n’entendrons pas Dieu qui nous parle. Car lui, il ne crie pas.
Je veux devenir moniale, parce que c’est vraiment à nous de choisir notre vie, de la prendre en main sans nous laisser
guider par les circonstances. La majorité d’entre nous s’adaptent aux situations sans trop se poser de questions, sans avoir véritablement posé de choix, avançant dans la vie sans projet, un peu comme quelqu’un qui traîne dans un centre commercial un jour de soldes, et non comme quelqu’un qui souhaite construire quelque chose. Celui qui avance à tâtons, outre de belles bêtises, risque de s’apercevoir, après coup, qu’il a manqué l’objectif principal de sa vie. Et c’est bien plus douloureux que d’avoir fait un mauvais achat ! En revanche, celui qui a un vrai projet prévoit de réserver un moment dans des journées bien remplies et, s’il s’y tient fidèlement, une pierre après l’autre, un coup de scalpel après l’autre, il pourra faire de sa vie une cathédrale, parfois même sans être pleinement conscient de l’œuvre d’art accomplie. Voilà, c’est cela, le projet décisif de notre vie. C’est cela qui vaut la peine d’investir le meilleur de nous : quel temps donner à Dieu ? Quand ? Comment ? Avec une feuille en main, un agenda, un crayon, pour empêcher que les urgences du quotidien ne nous dissimulent le plus important.
Le fait est que, comme le dit la Didachè, la plus ancienne catéchèse, nous ne pouvons emprunter qu’un seul des deux chemins, celui du bien ou du mal, de la sainteté ou du péché. La majorité d’entre nous croient pouvoir s’en sortir en trouvant une voie médiane, qui n’existe pas, et le vivent donc très mal. Ceux-ci ne se prennent pas en main, mais ils n’acceptent pas non plus leur mal-être, pleinement et consciemment. Ils cherchent seulement à éviter les tracas, vautrés sur le canapé avec la télécommande, pour finalement découvrir qu’en voulant esquiver les ennuis, ces derniers
arrivent tout de même par-derrière. Et ils sont alors beaucoup plus compliqués à affronter.
Le moine, lui, choisit sa route et ne se laisse pas entraîner par le cours des choses. Cela ne veut pas dire qu’il peut en éviter la complexité. Un moine comme nous, laïcs qui vivons dans le monde, brode sa vie avec une foule de fils entrelacés, peut-être cassés et renoués, mais il tient bon car c’est son choix, et il en est pleinement conscient. De cet amas de fils, il fait une broderie. Un moine comme nous voudrait prier dans le silence mais, dès qu’il essaie de sortir le chapelet de sa poche, le voilà convoqué pour une grosse dispute autour de patins à roulettes, pour la traduction de phrases de latin ou pour un pot de Nutella terminé. Un moine comme nous a toujours une réunion de travail très urgente juste au moment où il voulait faire une adoration. Parfois, au moment où il ouvre enfin la Bible, son mari – d’ordinaire loquace comme un porte-parapluies – a soudainement envie de parler (et comme cela arrive une fois par an comme la floraison des cerisiers au Japon, il faut saisir l’instant). Un moine comme nous rêve d’héroïsme, de martyre, et parfois, s’il a peu dormi et bu beaucoup trop de café, imagine même être un fondateur, ou enseigner quelque chose à quelqu’un. Mais la réalité de ce monachisme se résume à demeurer dans la médiocrité, cette croix passive qui te change si tu l’acceptes pleinement. Il s’agit de rester présent pour tes enfants qui te déçoivent, pour les personnes âgées qui retombent en enfance, de vivre une vie imparfaite, dans une maison avec des traces de moisissure et de la peinture écaillée. Car la réalité est ainsi : la moisissure apparaît, la peinture s’écaille.
Mais si le moine s’attache toujours à la réalité, il l’accueille avec gratitude. La peinture est écaillée ? Cela signifie que tu as une maison, ce qui est une bonne nouvelle. Le moine est, avant tout, reconnaissant pour ce qu’il a. Il ne fait pas comme moi, qui dirige le comité d’amélioration du monde et ressens ce besoin suprême de dire à ceux qui me sont chers ce qui leur manque pour atteindre la perfection. (Tout en écrivant ces lignes, j’ai demandé à mes enfants de me définir : casse-pieds, vantarde, miss perfection. « Allez, pas que des défauts les enfants ! » « D’accord, tu es affectueuse, voire trop. Tu nous épuises. » Mon expérience de ces dernières années aurait dû m’apprendre à ne pas poser de telles questions aux enfants, pas sans avoir établi une grille de réponses au préalable.)
Je veux devenir moniale car la vie est difficile. Inconfortable. Faite de sacs qui tombent du siège de la voiture quand tu freines, de Tupperware dont le contenu tombe sur le précieux matériel vidéo avec lequel tu viens de tourner (mais le glaçage de vinaigre balsamique sur les formulaires à retourner à l’école fait aussi très bien, un must pour toute maman qui travaille).
La vie est difficile, pas parce que l’oncle Gaultier m’a dit une fois que ma cousine était plus belle que moi – ce dont j’ai énormément souffert. La vie est difficile, c’est ainsi, jusqu’à ce que tu places ton cœur au bon endroit, parce qu’aucun d’entre nous n’est aimé de la bonne manière. Et ce n’est la faute de personne. Comme a dit ma fille Lavinia, inconsolable après une mystérieuse histoire avec des petites amies de l’école :
« Seul Jésus m’aime parfaitement, comme je veux être aimée. »
(Je prends note de son attitude mystique, je la respecte infiniment, mais je le dis officiellement : je ne suis pas prête
pour une quatrième adolescence. Je me mets dans le coma et j’attends que cela passe.) Ce serait magnifique si la moitié, ne serait-ce qu’un quart, des adultes parvenaient à ce degré de conscience d’une enfant de l’école élémentaire et renonçaient à quémander de l’affection aux mauvais endroits. L’affection, et tous ses succédanés comme avoir une Aston Martin, présider des conseils d’administration ou garder la ligne de ses 16 ans dans un corps de plus de 50 ans ou bien encore avoir un CV de bosseur hyper-fourni… Comme si quoi que ce soit pouvait garantir l’affection ! Le problème n’est pas de mendier, ce qui est notre condition existentielle étant donné notre besoin de relations pour être heureux. Le problème consiste à mendier aux mauvais endroits. Et donc à remplir le vide par le vide.
Je veux devenir moniale parce que je crois – enfin, je suppose – que cela vaut mieux que le napalm, solution à laquelle aimerait recourir régulièrement la part la moins noble de moi. Je voudrais parfois faire table rase de bureaux dont je tairai le nom, faire disparaître les routes où les gens stationnent en triple file et jalonnent les trottoirs de canapés éventrés. J’aimerais faire pareil aussi pour certaines écoles et certains ministères. Il m’arrive aussi de remercier le ciel de ne pas avoir de kalachnikov sous la main sinon je ferais sauter la tête du voisin qui verse des seaux d’eau sale dans le jardin.
de la politique et de la culture actuelles me saute aux yeux, je me rappelle l’époque à laquelle saint Benoît a fondé le monachisme.
Cette époque-là n’était certainement pas plus facile que la nôtre. Quand il arriva à Rome, et bien que bouleversé par les
À tous ces moments et aussi quand l’absurdité
mœurs dissolues, il ne se mit pas à tenir de grands discours à la police municipale comme une certaine casse-pieds. « Il se mit en retrait » et décida de se consacrer à la vie monastique. Face à la fin d’un empire, aux invasions barbares, à l’incertitude, à l’absence de Dieu, à la nécessité de sauver le grain avant qu’il ne soit balayé par le déluge, Benoît fit une seule chose : il resta trois ans dans une grotte. Il comprit que celui qui se change lui-même change le monde. Après ces trois ans, il établit et observa, le premier, une règle pour une « école au service du Seigneur », une règle pouvant être suivie par tous, tout en valorisant les talents de chacun. Un génie.
Le temps présent est un temps nouveau pour le monachisme : personne n’aime plus le monde que le moine. C’est justement pour cela, parce qu’il voit le bien et la beauté possibles sur la terre, qu’il veut en prendre soin comme un paysan le fait de son champ. On a donc besoin de légions de moines dans cette époque de grande crise, cette époque où la foi est reléguée dans un coin, où hommes et femmes déprimés, écœurés, fatigués de tout (regardez le visage des gens dans la queue du supermarché) ne refusent même pas Dieu, mais ne lèvent tout simplement pas la tête pour le chercher, et où leur hystérie se déclenche si quelqu’un leur rappelle que la vie continue après la mort. C’est un concept dont même les cultures préchrétiennes étaient familières, mais qui, pourtant, déclenche une crise de panique chez nos contemporains.
J’en ai eu l’illustration quand j’ai proposé à mes amis sur mon blog, comme c’était l’année du Jubilé, de demander l’indulgence plénière pour les victimes du tremblement de terre d’Amatrice. J’ai reçu des milliers et milliers d’insultes
sur les réseaux, pour la seule raison que j'avais rappelé que nous croyons en une vie après la mort. Nous croyons aussi que le jugement sera miséricordieux, qu’il prendra en compte nos faiblesses. Nous croyons qu’il sera davantage demandé aux chrétiens qu’à celui qui ne connaissait pas le Christ. Malgré cela, cette perspective terrorise l’homme moderne et le rend agressif (l’agresseur est toujours celui qui a peur). Comment annoncer qu’avec le Christ, Dieu fait homme, l’homme peut devenir comme lui, devenir infiniment plus lui-même ? Et donc heureux ? Comment se pencher sur ces cœurs fatigués et apeurés car ils ne savent pas qu’ils sont tendrement aimés ? Comment parler de Dieu à un monde qui ne croit pas mériter la résurrection et qui donc supprime la mort ?
Parfois, nous sommes tentés par la croisade culturelle. Certes, il ne convient pas d’arrêter de parler quand il y a des choses à dire, d’arrêter de se lever ou de combattre quand c’est nécessaire. Mais, avant tout, je dirais qu’au même moment, il nous est demandé de travailler sur nous-mêmes. C’est ce que demande saint Benoît : pénétrer dans notre grotte personnelle – laquelle, à première vue, pourra ressembler à un coin de chambre (là, sous un boa en plumes d’autruche et des gants à paillettes, il y a une icône, et même si l’ambiance n’est pas tout à fait celle du mont Athos, ce n’est pas grave), ou à l’habitacle d’une Ford Ka, la voiture que je partage avec Katiuscia, ma poule imaginaire chargée de picorer les reliefs de mes repas tombés sur le tapis. Il faut donc entrer dans nos cellules, là où nous nous trouvons, même en pleine ville. Et là, il faut travailler sur notre cœur, afin que nos paroles soient
mûries dans la prière, crédibles et fondées, puis intégrées à notre chair, pétries de chair avant d’être exprimées, quand cela s’avère vraiment nécessaire.
On n’est plus à l’époque d’une foi acquise culturellement et transmise au rabais. C’est mieux ainsi, ajouterai-je. Le chrétien du futur sera mystique ou ne sera pas. Le chrétien du futur ne sera pas celui qui a grandi dans la foi par transmission familiale. Ce sera celui qui aura fait une rencontre véritable avec le Christ. Cette rencontre, personnelle, doit cependant être faite au sein de l’Église. C’est elle la seule à garantir que tu n’alimentes pas ta propre folie en projetant sur la foi ton monde intérieur et que tu n’es pas en train de construire un Dieu à ton image. Dans ce moment très particulier pour l’Église où chacun veut être lui-même – y compris ceux qui devraient guider les fidèles avec la responsabilité de ne pas trahir mais de transmettre ce qu’ils ont reçu – voilà l’étymologie de traditio, voilà que, dans ce temps d’individualisme, même ecclésial, il faut remonter à la source, retrouver un chemin, une morale et une liturgie. C’est le problème actuel des pasteurs, et ce n’est pas un léger problème. Quant à nous, qui ne sommes pas papes, il nous est seulement demandé le travail patient et caché d’utiliser un scalpel sur nous-mêmes. Comme les artisans qui, sous les voûtes des cathédrales, polissaient la pierre, créaient incrustations et sculptures, parfois petites et cachées, que personne ne remarquait, il nous est demandé un travail de ciselure sur notre cœur (cela fait des années que je voulais placer ce mot, c’est même la raison pour laquelle j’écris des livres ; quand est-ce qu’on peut dire « ciselure » dans la vie ?).
Je veux devenir moniale, enfin, car je veux demeurer dans un monastère avec tous mes amis, et ils sont nombreux. Rencontres uniques ou régulières, amis réels ou images sur un réseau social, amis qui se mêlent à ma vie avec un seul mot ou bien avec un torrent de paroles, amis proches ou dépositaires de séances quotidiennes d’auto-analyse, amis qui savent se rendre présents par des gestes concrets, et en partageant les moments difficiles. Je veux rester encordée avec eux. Il y a un royaume à conquérir et notre petite armée ne pourra y parvenir qu’unie, face à face avec Dieu, coude à coude avec ses frères. Ce monastère est uni par le téléphone, par Internet, par la chair, ou même seulement par la prière –je dis « seulement » car peut-être ne réussit-on pas à se voir souvent, peut-être même que parfois on ne se voit plus... Mais quand les âmes se sont mises à nu, elles sont unies pour toujours, et la prière est la force la plus puissante. Comme cette amie que j’ai écoutée après une réunion dans le Nord, jusqu’à 3 heures du matin. Nous nous sommes parlé comme des sœurs sans nous être jamais vues auparavant. Nous nous sommes téléphoné parfois. Pour me remercier du peu que je lui avais donné – de l’écoute et rien de plus –, elle m’a envoyé une icône merveilleuse, écrite (comme on dit) pour moi par une sœur. Je prie devant chaque jour. Une semaine après, elle est morte dans un accident. Pour moi, c’est une consœur que je sens plus vivante que jamais, dans ce monastère wifi. Et même si les dictionnaires disent que wireless fidelity n’est pas la traduction exacte de ce nom commercial, pour moi elle est parfaite : une fidélité sans fil. Nous sommes fidèles à notre monastère sans être liés par aucun autre fil que le seul
désir d’aimer et de faire aimer Dieu, d’être ensemble dans cette aventure. C’est avant tout un combat avec nous-mêmes. Et l’on n’a jamais vu d’armée formée d’un seul soldat. Et puis, évidemment, une consœur moniale wifi peut se révéler très utile pour te conseiller des graines de chia pour le ventre plat, ou une crème qui marche comme tel cosmétique hors de prix mais n’en coûte que le dixième. Entre consœurs et confrères, on se prête maisons et vêtements (si vous voulez, on peut également se prêter des enfants : en ce moment, je serais prête à échanger un jeune de 15 ans contre deux de 6 ans et un de 3 ans). Une consœur sait quand c’est le moment de te crier dessus ou bien de te faire un compliment, même s’il est faux ou s’il a déjà été dit – ne pinaillons pas trop. Pour cela, les confrères sont légèrement moins intuitifs : ils peuvent parfois t’aider pour ta déclaration de revenus (pendant que je discute des soldes avec la femme de l’expert-comptable, et ce n’est pas un stéréotype), ou pour des avis médicaux, ou encore pour t’aider à trouver un chemin grâce à tes indications extrêmement vagues (« Où es-tu ? » « Je ne sais pas, je vois un lampadaire »). L’important est de le savoir, de ne pas se faire expliquer la route par une consœur, ni de s’exposer à des risques inutiles avec des confrères (ne pas demander à un homme si, par hasard, cette couleur de cheveux te vieillit, car il risque de te dire la vérité).
Savoir que l’on fait partie d’un monastère wifi est une grande consolation. Celui qui décide de passer un peu de son temps seulement avec le Christ, pour ensuite parvenir à passer tout son temps avec le Christ et ses frères, transforme son cœur. Il apprend à soutenir les autres. Il ne désire pas ce
qui est aux autres. Quand un monastère fonctionne, quand il y a une véritable rencontre entre les personnes, cela donne vraiment l’impression d’être au paradis.
Voilà, j’aimerais que ce monastère soit ouvert à tous ceux qui désirent y entrer. Si je pouvais même choisir, je mettrais comme mère abbesse sainte Thérèse d’Avila, et comme maîtresse des novices sainte Thérèse de Lisieux. Sainte Catherine de Sienne pourrait gérer les relations avec les hiérarchies ecclésiastiques, elle qui avait l’habitude de donner des coups de pied aux fesses, mais contrairement à nous, elle pouvait se le permettre et savait ce qu’elle disait. Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix pourrait être de la partie : elle pourrait nous donner des cours, elle qui a compris l’essence de tout dans sa scientia crucis. Sans parler de ses écrits sur la femme. Je m’aperçois que je n’ai donné de rôle qu’à des femmes, mais on sait que la communion des saints englobe tout le monde. Nous pouvons peut-être rappeler à saint Benoît de jeter de temps en temps un coup d’œil sur nous et à saint Joseph de nous garder comme un époux. C’est d’ailleurs ce que fit Thérèse d’Avila lorsqu’une fois, contrariée de son retard à lui obtenir une grâce, elle tourna sa statue en punition vers le mur.
Enfin, si je pouvais donner un nom à ce monastère, je lui donnerais celui de sainte Marie-Madeleine, parce que nous, moines et moniales, sommes pécheurs au moins autant qu’elle. Et, comme elle, nous voulons être des chercheurs de Dieu : nous arrêterons de le chercher seulement lorsque nous le verrons. Car, comme l’écrit saint Grégoire le Grand – lui aussi est des nôtres, bien sûr – « il advint cependant que
PETIT MANUEL D'IMPERFECTION SPIRITUELLE
celle-là seule qui était restée pour le chercher pût le voir. […] Elle le chercha une première fois, mais ne le trouva point ; elle persévéra dans sa recherche, et il lui fut donné de trouver.
[…] C’était lui qu’elle cherchait dehors, et c’était encore lui qui la guidait intérieurement dans sa quête. […] Il l’appelle par son nom ; comme s’il voulait dire : tu reconnais celui qui te reconnaît. Moi je te connais, non pas comme on connaît n’importe quelle personne, mais de manière tout à fait spéciale. »
Du marécage à la cathédrale
Je me rends bien compte que je ne suis pas pleinement légitime pour tenter de vous exposer ce que je souhaite dans ce chapitre, étant donné que je viens à l’isntant de prier les vêpres d’hier après-midi. Je l’ai fait cette nuit, à 4 h 17, donc avec presque douze heures de retard, à l’heure où les moines du Barroux sont déjà debout pour les laudes du jour. Le jour d’après. En outre, avec l’esprit obscurci par la fatigue, je ne suis pas sûre d’avoir choisi les bonnes pages. Cela te dit le niveau. Mais finalement, l’important n’est-il pas d’essayer ?
Il est fondamental d’avoir un programme, une règle que l’on aime et que l’on cherche à respecter, convaincu qu’elle nous mène au bonheur, même si l’on sait qu’elle ne sera parfois pas du tout respectée. Non pas parce que nous aurons dû faire face à des urgences réelles comme convaincre un suicidaire de changer d’avis, ou bien amener un enfant aux urgences, mais parce qu’on aura perdu notre temps sur Facebook ou à lire les articles du Foglio2 – ce qui revient un peu à ne prendre que les cerises dans une salade de fruits. Parfois, nous y parviendrons, mais mal. Je n’envisage même pas l’option « super luxe » : cela concerne ceux qui tiennent tous leurs engagements, le font même bien, peut-être même vaguement à l’heure (je considère qu’on est à l’heure quand on ne dépasse pas trois heures de retard). Il y aura également des moments
où l’on y parviendra presque, mais où surgiront des éléments incontrôlables, comme les poux. Le seul jour où tu envisages avec orgueil de consulter le dépliant « Choses à faire si vous avez du temps à perdre » (que j’ai depuis le collège, même si j’y ai apporté quelques modifications, comme d’avoir rayé les secrets de beauté de Candy), avant que le soleil ne se couche, un pou gras comme un moine va apparaître dans les cheveux de l’une de tes filles, généralement juste avant que n’arrive une petite amie dont la mère a un scanner antilentes à la place de l’œil. Voilà un moyen drôle et gratifiant de perdre trois heures. Mon père spirituel estime cependant que ce sont des grâces. Selon lui, plus aucun parasite ne s’attaquera à moi au purgatoire, et donc, si quelque chose me gratte maintenant, cela signifie qu’il me reste encore du temps pour me convertir et me sauver. (Selon lui, il n’y aurait pas non plus de moustiques… ce ne doit pas être si mal alors, ce purgatoire.) Le fait est, de toute façon, que les poux et les acariens, les erreurs de certificats et les bureaux où il faut retourner plusieurs fois, les cahiers perdus, les recherches de groupe à faire à la maison, les aérosols, le parallélisme des pneus et les impôts à payer dans un délai de six minutes ne rentrent pas dans la catégorie des imprévus qui entravent la vie spirituelle. Pour nous, laïcs, ils en sont, au contraire, la matière première. La trame dont sont tissées nos journées est le fil qui peut broder une prière pour Dieu, non pas malgré tout ce que nous devons faire, mais justement grâce à tout ce que nous devons faire.
C’est très certainement la grande nouveauté du concile
Vatican II : proposer une vie spirituelle sérieuse à portée de tous, une vie ayant tout autant de valeur que celle des consacrés. Pour
tous ceux qui la désirent profondément. Il était effectivement curieux de penser que Dieu rendrait indispensables certaines choses pour que l’homme vive sur terre (ainsi je ne travaille pas pour passer le temps), et que ces choses, en même temps, l’éloigneraient de lui. Un peu comme si je pensais que mes enfants sont mes enfants seulement quand je les allaite ou les tiens dans mes bras (laissons tomber le fait que c’est ce que je voudrais, un autre de mes problèmes psy… Je ne comprends pas comment, alors que je venais tout juste de nettoyer la bouche de ma fille à la fin d’un petit pot, elle a pu me demander juste après de se faire percer les oreilles : j’ai dû être distraite pendant un quart d’heure). On doit, au contraire, regarder nos enfants agir dans la liberté, contempler le travail accompli et savourer… sauf quand ils te déclarent que ce serait merveilleux d’être irlandais pour pouvoir se saouler avant le coucher du soleil, ou quand ils espèrent que le service de sécurité de l’église va arriver et les mettre dehors… Et dans de nombreuses autres situations en fait, maintenant que j’y pense. Effectivement, on ne se réjouit pas si souvent, mais ce sont tes enfants, et tu ne peux pas espérer les allaiter toute ta vie (si tu le souhaites, évite au moins de le dire devant leurs amis).
En fait, je veux juste dire que Dieu nous aime d’un amour infiniment plus grand que l’amour que nous éprouvons pour nos enfants (ou celui de nos parents pour nous), et qu’il nous aime dans la liberté. C’est dans cette liberté – et dans tout ce que nous faisons chaque jour, même quand nous ne sommes apparemment pas avec lui – que nous pouvons le trouver. Il doit y avoir un moyen de le trouver, même chez le dentiste ou dans une réunion de rédaction. Notre monastère wifi est
plongé dans la vie jusqu’au cou. Nous autres laïcs sommes essentiels pour l’Église : c’est encore le concile Vatican II qui le dit (Lumen Gentium). Maintenant, à nous de transmettre cette parole en dehors des églises, puisqu’elles sont de moins en moins remplies !
Il existe des moments sacrés qui n’appartiennent qu’à Dieu. Dans ces moments-là, nous devons ôter nos sandales car nous foulons une terre sainte. Une terre habitée par Dieu. Ce sont les moments de la rencontre. Demeurer avec lui, même quand tu essuies le vomi de ta fille (et de sa jumelle prête à prendre le relais), ou peu après. Demeurer avec lui, même au milieu d’un cocktail. Demeurer avec lui.
Il est nécessaire de consacrer des moments à Dieu, seulement et exclusivement à Dieu, de rester devant le buisson ardent. Nous aussi laïcs sommes appelés à donner la primauté à l’adoration de Dieu (ce que confirme Sacrosantum Concilium3).
C’est seulement en s’enracinant dans ces moments que l’on peut transformer toute notre vie en une seule et unique grande prière. Mais comment trouver, chercher, mendier, implorer ces moments de rencontre ? Le bienheureux Égide d’Assise4 nous conseille de demander par oraison, de chercher avec un désir amoureux, de combattre sans trêve. Demander sans relâche, oui, mais quoi exactement ? Et comment ?
Celle qui a prononcé des vêpres à la mauvaise heure, de manière dystopique et même peut-être un peu dyslexique, n’a pas de grands conseils à donner. Je suis sûre d’une chose
3. La constitution Sacrosanctum Concilium est l’une des quatre constitutions conciliaires promulguées par le concile Vatican II.
4. Ou Gilles d’Assise, un des premiers compagnons de saint François d’Assise.
cependant. Ces moments doivent être pensés, planifiés, organisés et il faut se battre pour les préserver. Si l’on attend, au prétexte qu’il est possible de prier à tout moment de la journée : « Quoi ? Moi, je ne trouverais pas un quart d’heure pour prier à un moment ou l’autre ? », alors c’est mathématique : il est certain que tu ne le trouveras pas. Du moins, c’est ainsi que cela se passe pour moi. Car c’est parfois fatigant de prier. Pour moi, ça l’est même toujours. Il faut être réellement présent, alors que toute autre activité propice au vagabondage de l’esprit (comme repousser les cuticules autour de l’ongle) nous semblera plus urgente que la prière. Urgente et incontournable.
Ainsi, il est nécessaire de ne pas y aller au hasard, de ne pas se perdre dans le marécage qu’est notre inconscient, mais d’avoir un plan. Nous avons l’air de nous porter très bien dans notre marécage, à dire vrai. Au moins à première vue. Il est humide, tiède, en mouvement. Il s’adapte aux circonstances et à nos exigences. Il nous donne toujours raison. Ainsi, moi, je peux toujours me dire que ce n’est pas moi qui perds patience avec mes enfants car je suis égoïste et que je ne veux pas me laisser entièrement dévorer par eux, mais parce que quelqu’un ne m’a pas aimée suffisamment (je peux sûrement trouver quelques exemples à l’appui). De la même façon, ce n’est pas que je doive rester au téléphone plutôt que régler le conflit épuisant entre les trois frères, c’est simplement que je n’en ai pas envie. J’entendrai distinctement en moi une voix me dire que je fais bien, que j’ai bien le droit de me réserver des petits moments, en tant que femme qui travaille. La syndicaliste qui sommeille en moi est toujours plutôt réactive quant à
l’affirmation de ses droits. (Quand elle était encore petite, une de mes filles m’a appelée une fois en disant : « Maman, où t’es-tu sauvée ? » Les enfants comprennent tout, et elle avait parfaitement compris que je m’étais mise à repasser simplement pour échapper à leurs demandes.) La syndicaliste que je suis, sur le modèle du mineur anglais, s’active aussi quand je décide que c’est le moment de prier. Est-ce que tu ne mériterais pas maintenant ta part de chocolat fondant 65 % devant un épisode de Mad Men (Dieu bénit toujours Don Draper) ? Tu l’as bien mérité après une journée pareille ! Allez, tu diras ton chapelet plus tard. Mais quand, plus tard ? Au fond, tout est relatif, s’empresse de déclarer mon inconscient, toujours épaulé par la syndicaliste qui veut m’éviter toute fatigue. (J’ai également une Thatcher intérieure, mais je ne sais si elle mène les bons combats : c’est elle qui m’envoie courir à 10 heures du soir par zéro degré.) En résumé, c’est le moment Mad Men, et quel mal y a-t-il à prendre un chocolat ? Évidemment, il n’y a rien de mal, si ce n’est qu’en agissant ainsi, je perds encore aujourd’hui la seule chose qui me rende véritablement heureuse.
La foi catholique offre la possibilité de transformer le marécage de l’inconscient en une cathédrale. Car, pour nous, la vie a un sens, une direction. Les jours forment un chemin, notre édifice intérieur. L’histoire même n’est pas cyclique mais orientée vers un but précis : elle a une fin – c’est la grande nouveauté du judéo-christianisme. Le mot même « fin » vient du latin findo, « fendre », c’est-à-dire quelque chose qui coupe, qui sépare, qui permette le discernement. Le but de l’histoire est le moment où « Il viendra juger les vivants et les morts ».
Notre histoire est soumise à un discernement. Chaque jour,
nous faisons un choix, mieux encore, nous devrions le faire. C’est là que réside toute la différence : se laisser vivre au jour le jour, au rythme des urgences, des événements extérieurs et des demandes des autres, ou bien décider de ce que l’on fait entrer dans sa vie. Et de ce qui n’y entrera pas. En admettant que nous ayons pour objectif conscient de nous occuper de notre vie spirituelle, nous le faisons peut-être à l’aveugle. Ou bien superficiellement.
Quand il s’agit des études, de notre vie professionnelle, ou plus encore, quand l’argent rentre en jeu, nous sollicitons toute notre intelligence, notre inventivité et notre capacité d’organisation. Même pour les régimes : à dire vrai, nous sommes capables d’engager des dépenses, des efforts et une fatigue incroyables. Si nous savions que prier le chapelet permet de maigrir et de lutter contre la rétention d’eau, qu’il multiplie au centuple notre compte en banque – chacun a ses idoles –, ou bien qu’il assure une sorte de protection magique pour nos enfants, nous le suivrions avec beaucoup de rigueur. En réalité, il nous apporte beaucoup plus (on nous a promis le centuple ici-bas, ainsi que la vie éternelle, et non deux sous), mais fondamentalement, nous n’y croyons pas vraiment. De la même façon, au lieu de réfléchir, d’utiliser toutes les ressources de notre intelligence pour chercher à comprendre comment vivre, comment entrer en relation avec Dieu, ce que nous pouvons apprendre sur lui, sur ce que l’Église et deux mille ans de patrimoine d’intelligence ont à nous apprendre, nous préférons demeurer de gros naïfs, crédules, inconstants et farfelus.
Pourtant, il nous faut utiliser notre cerveau, entièrement. Dans la chapelle Sixtine, le manteau de Dieu est une coupe sagittale du cerveau (Michel Ange était passionné d’anatomie) : c’est encore le père Emidio qui me l’a fait remarquer et je suis allée le contrôler en personne cet été. Dieu a créé le cerveau, et celui qui croit devrait l’utiliser au mieux, pour chercher à connaître Jésus, qui n’est pas un croisement entre une personne simple, mais pleine de bon sens, et une statuette religieuse décorée de petits oiseaux et de cœurs (c’est plus ou moins la vague idée qui ressort de l’opinion commune).
Dans la foi, l’émotivité sert peu. Ce qui touche à notre liberté est lié à l’activité du cortex cérébral, alors que notre part animale est dominée par l’émotivité et par les réflexes. Quand tes réflexes te poussent à t’écarter à l’approche d’un deux-roues, tu les écoutes sans lancer une grande réunion avec toi-même. Pourtant, dans la majorité des cas, l’émotion est très mauvaise conseillère. Au mieux, nous pouvons parfois lui laisser libre cours, par exemple lors des longues conversations téléphoniques avec mon amie Paola, protégées par un bouclier magnétique et par un logiciel crypté que même Dieu n’écoute pas. Lors de ces appels protégés de toute interception, nous pouvons exprimer toutes nos émotions, même les plus méprisables. Par définition, mon amie Paola ne me jugera jamais mal, puisque : 1) tu as raison ; 2) tu as bien fait ; 3) tu es très en forme ; 4) si tu t’es trompée, de toute façon, ce n’est pas grave ; 5) tu peux trouver une solution ; 6) c’est la faute de quelqu’un d’autre ; 7) tout se terminera bien ; 8) tu es encore plus en forme qu’au début de la conversation. Donc, après avoir parlé pendant trente-huit minutes de la difficulté de notre vie, tenté de comprendre
pourquoi personne ne prend en charge nos problèmes (ce n’est pas vrai, mais nous sommes sur une ligne protégée et nous pouvons tout dire), répété combien c’est injuste qu’une telle charge nous incombe à nous, nous pouvons sereinement nous mettre à développer le sujet. Se plaindre ne sert pas à changer les choses, mais seulement à nous sentir mieux. Ce concept est d’ailleurs totalement incompréhensible pour les hommes. Si vous vous plaignez auprès d’un homme, il vous répondra invariablement – au lieu de vous exprimer sa compréhension et quelques rares compliments : « Qu’est-ce que je dois faire ? », et vous aurez irrésistiblement envie de le frapper. Je pense que je devrais mettre mon numéro de téléphone à la fin du livre, pour les femmes provisoirement dépourvues d’amies : je suis une grande auditrice de lamentations.
Donc, grâce à l’intelligence – qui est un don de Dieu – et peu d’émotion – une très mauvaise conseillère –, il faut avoir pour projet d’édifier une cathédrale. Même s’il faut une vie entière pour cela. Pour construire, il faut toute une vie, mais pour détruire, il suffit d’une bombe et de quelques secondes. Peut-être ce projet ne soulèvera-t-il pas l’enthousiasme autour de nous. Certains nous prendront pour des fous. Il y a quelque temps, lors d’un voyage, j’ai demandé à une employée de Subdued5 (une belle blonde de trois kilos maximum) s’il y avait une messe dans les environs. Elle m’a regardée comme si je cherchais deux licornes.
Effectivement, peu nombreux sont ceux qui ont un projet sérieux de vie spirituelle. Et parmi ceux-là, peu s’y tiennent
vraiment. Cela explique les visages tristes que nous croisons. Peut-être ne croyons-nous pas réellement que la porte du bonheur se cache là, dans la découverte que nous sommes aimés. Comme le dit sainte Catherine, les âmes se convertissent, mais « retournent ensuite à leur vomi ». Elle n’y va pas de main morte, Catherine, mais l’image du vomi est appropriée : le vomi, c’est ce que nous avons en nous, les sensations, les sentiments, les passions, les émotions. Avoir un projet, c’est exercer notre jugement sur ce que notre monde intérieur plein d’erreurs continue à nous suggérer. C’est décider d’écouter une autre voix que la nôtre, et la faire passer avant.
Le projet, c’est ce qui fait la différence au sein de nos vies. Le projet, c’est ce que nous décidons de faire du terrain qui nous a été confié pour notre vie – tout ce que nous possédons, même nos qualités, ne nous appartient pas, nous le recevons. Nous pouvons transformer ce terrain en y mettant des arbres fruitiers, ou bien un potager, une vigne, une roseraie... Ou bien le laisser inculte.
Quand je pense, quand je parle et j’agis – possiblement dans cet ordre (l’ordre est important : par exemple, j’achète un top à franges et je l’essaye : cela ne fonctionne pas ; le fait est que je ne l’essaye pas aujourd’hui parce que je sais que je maigrirai demain et qu’il m’ira parfaitement ensuite) –, cela change tout si je le fais en me fondant sur un projet, ou bien sur ce que je ressens, sur la dernière stimulation ou sollicitation. Le christianisme, ce n’est pas ressentir quelque chose. Mon cher père Emidio dit : « Si tu dois ressentir quelque chose, roule-toi un joint » (tandis que ma devise est celle de don Dario : « Si tu n’as pas le courage, trouve-le. »)
La vie est un grand travail de transformation. Nous passons de l’état animal à celui d’homme. Un enfant nouveau-né est plein de désirs qui exigent une satisfaction immédiate : téter sa mère, être dans les bras, être l’objet d’une attention continue (il est inutile de lui offrir le meilleur tabac à priser ou le meilleur porto du Portugal : il ne veut que toi). Ensuite, les désirs et les demandes deviennent différents et il y a de multiples façons de demander de l’amour. Grandir, en revanche, c’est mettre de l’ordre dans ses désirs : le péché n’est pas une offense ou un tort que nous faisons à Dieu, mais c’est mettre le plaisir à la mauvaise place. Il y a le plaisir un peu simple de regarder un feu d’artifice et il y a des plaisirs qui nous tirent vers le haut. Ces plaisirs-là s’installent un peu plus profondément en nous et confèrent une plénitude qui dure. Apprendre à élever ses désirs, c’est ne pas écouter cette part de nous où résident, par exemple, l’égoïsme stupide, la précipitation, la paresse. J’ai tenté de l’expliquer à mon fils quand il m’a dit : « Maman, je suis face à un dilemme. D’un côté, je me vois me consacrer à la science et construire un lance-patates. De l’autre, je me vois bien en pyjama jusqu’à midi, en train de manger devant la télévision. » Pour moi, le lance-patates était le plus mauvais choix. La vie de débauche semble parfois être la meilleure chose à laquelle aspirer, la plus simple en tout cas : une vie dont le principe serait de ne jamais faire aujourd’hui ce qu’on peut remettre au lendemain ou refiler à quelqu’un d’autre, ou de faire semblant de n’avoir rien entendu. Celui qui éduque, parent ou enseignant, n’a pas besoin qu’on le lui rappelle : il est entouré de sujets souhaitant seulement se vautrer sur n’importe quel type de surface horizontale, à partir du
moment où il y a un écran (on les appelle ici les « avachis » : j’ai donné naissance à quatre avachis sur quatre enfants, une bonne moyenne donc). Des sujets prometteurs pour nous, mères anxieuses persuadées qu’ils finiront comme George Best : « J’ai dépensé une grande part de mon argent en alcool, femmes, et voitures de sport. Le reste, je l’ai gaspillé. »
À cette manière mensongère de concevoir notre vie et notre relation aux autres s’ajoute ensuite, en plus du mal intérieur que nous appelons « péché originel », l’intervention extérieure de l’ennemi, le malin. Il nous hait et veut que nous ne nous aimions pas, que nous soyons antipathiques à nousmêmes et lourds à porter. Si l’on enlève Dieu, seule reste l’idée d’un homme mauvais – ce qui est majoritairement la pensée d’aujourd’hui – depuis les philosophes du soupçon, comme Friedrich Nietzsche selon lequel « Tu n’es rien », jusqu’à avec Sigmund Freud, qui t’explique que c’est vrai, tu n’es rien, et qu’en réalité, tu es en conflit avec ta mère.
Pourtant, nous voulons parier que la réalité ultime de l’homme est la beauté et que la vie est, au contraire, pleine de sens. Toute action – de l’aiguille que nous ramassons par terre à celui que nous épousons, en passant par chacun de nos actes –a un sens. Car même les cheveux de notre tête sont comptés, nos actions résonnent pour l’éternité. (J’aimerais savoir si les poux sont également comptés, ce qui me permettrait d’espérer que mon épopée puisse connaître un terme. Avant que je ne meure, évidemment.)
Nous pouvons choisir ce que nous voulons faire de notre vie. Nous pouvons la concevoir comme un exutoire, un vol,
une occasion de prendre tout ce qui nous permet de nous sentir un peu mieux, pour le jeter ensuite après l’avoir utilisé. Ou bien nous pouvons envisager notre vie comme quelque chose à construire, où rien ne se jette, où tout trouve sa place, s’ajuste et recommence. C’est ainsi que l’on apprend à protéger la vie, comme le dit Luce Irigaray en faisant référence à la vocation des femmes (mais cette façon de vivre concerne tout le monde, y compris les hommes). Je me permets seulement une parenthèse dans ce noble discours pour préciser que ce n’est pas toujours une erreur de jeter. À dire vrai, je n’aurais rien, bien au contraire, contre le fait que mes enfants apprennent à jeter les canettes de thé glacé à la pêche que je retrouve cachées dans le panier à journaux (le premier lieu de forme concave accessible depuis le canapé grâce à un effort musculaire minime). Ce qu’il ne faut pas jeter ou gâcher, c’est ce qui bonifie notre vie. Les sandwiches de l’année scolaire précédente, toujours emballés dans le papier alu, ceux-là, oui, on peut les jeter, avant même que ne commence l’année suivante.
Nous pouvons choisir, disais-je donc, ce que nous souhaitons faire de notre vie, parce que c’est vrai, nous sommes faits à l’image et à la ressemblance de Dieu. Pourtant, si l’image nous est donnée gratuitement, la ressemblance dépend quant à elle de notre oui, de notre adhésion. Nous sommes enfants de Dieu, et nous le sommes réellement. Nous devons être fiers de cette noblesse et nous comporter en conséquence. Si nous essayons de penser à cela, cela donne le vertige. Nous sommes de famille royale, ne l’oublions jamais. Quand Bakhita, la petite fille enlevée à 7 ans par un marchand d’esclaves au Soudan, a été amenée en Italie pour devenir gouvernante, elle
a entendu dire qu’elle aussi, une enfant noire, esclave, était fille de Dieu puisqu’elle avait été baptisée. Elle s’est réjouie, a tout laissé tomber et a vécu heureuse malgré sa vie de cauchemar.
« Pauvre, moi ? Je ne suis pas pauvre car j’appartiens au Seigneur et à sa maison : ceux qui ne suivent pas le Seigneur, ce sont eux les vrais pauvres. »
Notre projet consiste donc à ressembler à Jésus Christ. Ne nous a-t-on pas donné cinq rochers, cinq pierres sur lesquelles fonder l’édifice dans lequel nous pourrons l’accueillir ? Ces pierres servent à le connaître, à dialoguer avec lui, à nous transformer en lui – comme deux amis qui se ressemblent à force de passer du temps ensemble. Elles nous aident à lui donner de la place dans notre vie, à lui demander pardon quand il le faut. Et ainsi, à devenir comme lui, à aimer comme lui, à créer avec lui, parce que notre Père a créé les galaxies, les glaciers, les lacs, la crème fouettée… plus précisément, il a créé une humanité tellement prodigieuse qu’elle a su inventer la crème en bombe, le top coat qui sublime le vernis à ongles et toutes les autres inventions qui rendent possible notre vie sur terre.
Alors, si nous sommes les fils très aimés de ce Père qui peut tout – et même bien plus que ce que nous osons demander –, si tout déjà nous appartient, nous pouvons tendre l’autre joue, partager notre sandwich, donner à l’autre une deuxième chance, ramasser la pierre qu’on nous a lancée et demander :
« Tu l’as fait tomber ? », et ainsi faire fondre son cœur. Il n’est pas question de suivre des normes morales mais d’agir pour obtenir en surabondance la joie et la plénitude.
Table des matières