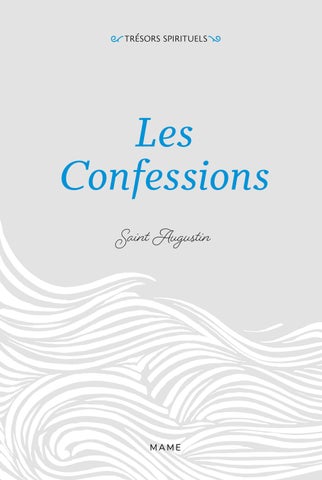PRÉFACE
Pourquoi lisons-nous les Confessions de saint Augustin ?
Rien ne prédisposait Augustin à devenir, pour des siècles, la lumière de l’Occident chrétien.
Il était né, le 13 novembre 354, loin des centres urbains les plus actifs du bassin méditerranéen, dans une petite cité de l’Afrique romaine, à Thagaste – aujourd’hui Souk Ahras, en Algérie –, dans la province de Numidie, aux confins algéro-tunisiens, à 180 km à l’est de Constantine, à 100 km au sud d’Annaba. Thagaste, qui fut colonie française dans la seconde moitié du xixe siècle, n’a guère entretenu la mémoire d’Augustin. Quand Flaubert, au cours de son voyage en Orient, y fait étape en 1858, c’était une grosse bourgade qu’il décrit comme une « ville neuve, atroce, froide, boueuse ». La capitale, bruyante et cosmopolite, la ville universitaire, le siège du proconsul romain, Carthage, qui était la « seconde Rome » selon la formule de Salvien, était à quelques jours de voyage de là. Rome gouvernait alors l’Afrique, et ce depuis la chute de Carthage prise par Scipion l’Africain, six siècles plus tôt, en 202 avant J.-C. L’empereur chrétien Constance II, le fils de Constantin, disparu en 337, y était représenté par le proconsul d’Afrique, lui-même représenté par son légat de Numidie, en poste dans la capitale régionale Hippo Regius, Hippone ou Bône, aujourd’hui Annaba. Thagaste était alors depuis deux siècles au moins un municipe, c’est-à-dire une cité, une commune de plein exercice, avec ses
institutions calquées sur celle de l’Vrbs (on y voyait un forum, une curie, une basilique, quelques temples). Tous les homme libres y étaient citoyens romains, bien avant que l’édit de Caracalla de 212 n’étendît la citoyenneté à tous les habitants de l’Empire, une mesure si naturelle qu’elle était passée pour ainsi dire inaperçue desLacontemporains.familled’Augustin
cultivait un peu de vigne et entretenait des oliviers, son père participait à la vie de la petite cité. Patricius était un païen endurci, qui, quand il mourut, était néanmoins, peut-être, sur le point de recevoir le baptême. Tout le contraire de Monique, la mère d’Augustin, qui parfois se plaignait auprès de ses voisines de la dureté de son mari, mais chérissait son fils préféré et l’élevait en lui lisant les Évangiles. Car Monique avait la foi chevillée au corps. En 370, il y avait déjà quelques églises dans le paysage de l’Afrique du Nord et Monique avait habitué Augustin dès son enfance à assister aux offices.
Augustin fut écolier à l’école primaire de Thagaste jusqu’à l’âge de sept ans, fit ses études secondaires à Madaure, le bourg le plus proche, qui était la patrie d’Apulée, puis ses études supérieures à Carthage, la métropole de l’Afrique romaine, la plus grande ville de l’Occident latin après Rome. Augustin excella dans ces études et devint « uir eloquentissimus atque doctissimus » selon les canons cicéroniens, soit un maître de l’éloquence. C’était un élève qui promettait… Aussi devint-il, quelques années plus tard, lui-même professeur à l’université de Carthage, avant de partir pour Rome, sans doute dans le secret espoir d’y acquérir à son tour cette gloire toute profane promise aux rhéteurs qui égalaient en prestige les magistrats les plus hauts placés.
Augustin enseigna moins de deux années à Milan où on lui demandait de rédiger des panégyriques officiels. Augustin refusa
de se compromettre davantage avec le pouvoir et se réfugia au nord de Milan, à Cassiciacum, dans une villa confortable où, entouré de sa mère et d’amis proches, il composa ses premiers dialogues philosophiques, d’inspiration néoplatonicienne. C’est là qu’il reçut, à l’été 386, la révélation au cours de la scène fameuse du Jardin, le « Tolle ! Lege ! », « Prends et lis ! » (Confessions 8, 28 à 30), à travers la lecture de saint Paul (Romains 13, 13-14), avant de recevoir collectivement le baptême des mains de l’évêque de Milan, Ambroise, à la pâque 387. Quatre ans plus tard, revenu en Afrique après le décès de Monique, il était ordonné prêtre à Hippone, puis évêque en 395, une fonction qu’il n’abandonna plus jusqu’à sa mort en 430 dans la cité d’Hippone assiégée par les Vandales.
Les Confessions nous offrent le récit de nombreux épisodes de la vie d’Augustin, des souvenirs du sein de la nourrice à la mort de Monique – à la veille du retour en Afrique en 388. Ces mémoires, bien que rédigées entre 397 et 401, ne disent rien du prêtre ni de l’évêque, presque rien du jeune chrétien, puisque la conversion précède de deux années seulement la clôture chronologique de l’ouvrage. Et pourtant, ces pages sont toutes emplies de Dieu à qui Augustin les adresse, ne cessant, avec constance, de lui parler, à la deuxième personne, du premier au dernier mot latin. Il n’a qu’un interlocuteur, Dieu, mais parle, lui, à la première personne. C’est qu’Augustin est élève des philosophes, que la lecture des néoplatoniciens, dans une traduction latine (probablement celle du grand rhéteur Marius Victorinus) a été pour lui une première révélation, et que par essence la philosophie, depuis Socrate et Platon, est dialogue.L’usage de la première personne interroge : les Confessions sont-elles la première autobiographie de la littérature occidentale ? Il y aurait quelque abus à l’affirmer puisque dans les poèmes
homériques, déjà, Ulysse fait le récit devant Alcinoos, roi des Phéaciens, de ses aventures depuis la chute de Troie, que déjà les élégiaques latins, de Properce à Tibulle, privilégiaient l’expression personnelle et mettaient leur petite personne au centre de leurs préoccupations, que les empereurs romains, d’Auguste à Hadrien, avaient publié le récit de leurs hauts faits et que, très près d’Augustin, vers 390, le rhéteur païen Libanios avait rédigé le récit de sa vie auquel il avait donné précisément le titre de Bios, ou Autobiographie. Mais aucun de ces textes antérieurs n’a servi de modèle à Augustin. Et dans leur essence, les Confessions en diffèrent profondément. Car si Augustin n’a pas inventé l’autobiographie, il a, le premier, découvert et pratiqué l’introspection : l’art de porter sur soi un regard tourné vers l’intériorité. Augustin ne cherche point à écrire les Mémoires de son temps ; le monde extérieur compte peu pour lui : d’ailleurs on chercherait en vain une description de Rome, de Milan ou de Carthage dans les Confessions.
Il se trouve que les Confessions d’Augustin sont inouïes – en cela réside la vraie spécificité de l’ouvrage – non pas tant parce qu’elles ont Dieu pour seul lecteur avoué, mais parce que jamais personne avant Augustin n’avait su dire les tourments de la culpabilité ni exploré avec autant de lucidité la part d’ombre qui habite chacun, personne n’avait compris comme lui la nécessité d’entrer en soi-même. « L’intériorité » – la plus profonde, celle qui est « plus enfouie en lui que son intimité » (« interior intimo meo » : Confessions 3, 11) – préoccupe Augustin comme aucun écrivain avant lui. De Montaigne à Mauriac, en passant par Pascal ou Camus, sans oublier Gide ou Muray (dont le journal porte un titre évocateur : Ultima necat), il n’est pas un auteur de journal ou de mémoires (sous toutes ses formes, y compris romanesques) qui ne soit habité par le souvenir des Confessions. Dans les Soliloques (1, 26), Augustin
demande à la Raison (son autre moi-même) d’interrompre l’enquête qu’elle mène en lui et de cesser de le torturer :
Augustin. – Tais-toi, je t’en prie, tais-toi ! Pourquoi me torturer ? Pourquoi creuses-tu si profond en moi, descends-tu si bas ?
Plus tard, c’est l’évêque qui reprendra la recherche, comme si ses nouvelles fonctions le protégeaient désormais des découvertes, effrayantes, qu’il allait faire. Car l’exploration intérieure a quelque chose de formidable, c’est-à-dire, selon l’étymologie latine, qui inspire la crainte qui précède les découvertes.
On sait que le titre des Confessions s’explique doublement. Il s’agit de dire à haute voix devant témoin ses fautes (la chair et le doute : une jeunesse dépravée, une hésitation à s’engager) : les Confessions sont une exomologèse ; il s’agit de proclamer la bonté de Dieu qui éclaire puis pardonne : les Confessions sont une laudatio, une louange. La profondeur du mal est abyssale mais, du fond de ce cœur, Dieu sait comme « vider » la corruption : « Mais, toi, Seigneur, tu es bon et miséricordieux, et, en sondant (respiciens : du verbe latin « voir en détail ») de ta main droite, tu voyais la profondeur de la mort, et du fond de mon cœur tu vidais (exhauriens) un abîme de corruption » (Confessions 9, 1).
Il faut bien percevoir la radicalité nouvelle du projet augustinien dans les Confessions : non seulement raconter et dire ses doutes, mais creuser cet abîme intérieur jusqu’à sa profondeur extrême, qui est celle de la faute et de l’iniquité. Ni les platoniciens ni les stoïciens ne sont jamais descendus aussi bas dans l’âme humaine. La conscience de la faute est, dit Augustin, refoulée en chacun par le poids de la culpabilité et ce refoulement se traduit par le silence : «En effet, la fosse, c’est-à-dire la profondeur de l’iniquité, ferme sa bouche sur l’homme, non seulement lorsqu’il gît dans le péché, mais aussi lorsqu’il perd l’accès à la
confession» (Commentaire sur le psaume 68 [2], 1). Vaincre ce silence se fait par une offrande, non pas tant celle du cœur pécheur, que celle du cœur secret : «Ecce cor meum, Deus meus, ecce intus ! », «Voici mon cœur, mon Dieu, voici ce qui est dedans» (Confessions 4, 11). Augustin ne creuse pas seulement sa vie intérieure, il y atteint «ce qui est plus intérieur que tout mystère» («omni secreto interior», Confes sions 11, 1), l’endroit où jaillit la lumière de la vérité.
Car Augustin pensait que la vérité ne saurait être confondue avec la croyance, l’opinion ou le mythe. Il n’est pas exact qu’il n’y aurait de vérité que contextuelle, inscrite dans l’Histoire ou dans des esprits marqués par une époque et leurs représentations. À l’opposé du relativisme historicisant de la pensée postmoderne, Augustin a défini la vérité comme le fit Platon dans le Ménon : si le jeune esclave ignorant, mis en scène dans ce dialogue, parvient, guidé par de bonnes questions, à mettre au jour une vérité aussi indiscutable que 3 et 7 font 10, c’est donc que la vérité n’est pas produite par une pensée qui en serait le seul auteur, mais bien que la raison humaine est capable par elle-même de découvrir ce qui lui est extérieur.
Sans doute Augustin est-il le grand inventeur de la synthèse qui nourrira la pensée occidentale pendant des siècles, celle de fides et de ratio, de la foi et de la raison. Augustin fut non seulement l’explorateur impitoyable de son âme, mais aussi un grand mystique, ce qu’a compris l’artiste qui le peignit levant les yeux vers le ciel lors de l’extase d’Ostie en compagnie de sa mère (Confessions 9, 23). Cette scène est, en effet, le sujet du célèbre tableau du peintre romantique Ary Scheffer, aujourd’hui au musée du Louvre (1855) : Augustin en rouge (il est revêtu d’un manteau pourpre quasiment impérial, un paludamentum, digne en tout cas du prénom que lui choisirent ses parents et qui signifie « petit Auguste »), Monique, voilée, tout en blanc, tient la main gauche d’Augustin
entre ses deux mains, leurs regards extatiques sont dirigés vers le haut, selon la mystique apollinienne (on songe à certains bustes de l’empereur Constantin, le regard tourné vers le haut) ou néoplatonicienne qui considère que lever les yeux (suscipere oculos) est la façon idéale de chercher à voir la divinité. Devenu évêque, Augustin n’oubliera jamais un thème qui nourrit toujours ses sermons, par exemple celui qu’il prononça en 410-411 : seul l’œil de l’âme est susceptible de voir certaines vérités. Et Augustin de s’écrier : « J’ai dit cela dans mon extase. J’ai vu alors, dans mon extase, ce que j’ignore, ce que je n’ai pu supporter longtemps. Et retourné à mes membres mortels et aux multiples angoisses des mortels qui appesantissent l’âme, j’ai dit : Quoi ? J’ai été rejeté loin de ton visage et de ton regard. Tu es trop loin, je suis trop bas » (Sermon 52, 16).
Mais cet aspect de la pensée d’Augustin ne doit pas oblitérer qu’il fut le précurseur et comme l’inventeur du cogito cartésien. La connaissance de soi est le fil directeur des Confessions. Le point d’appui sûr et qui ne peut jamais être soumis au doute est que je pense. Dans les Soliloques, en 387, on trouve ce dialogue avec la Raison (2, 1) :
La Raison. – Toi qui veux connaître, sais-tu que tu es ?
Augustin. – Je le sais.
La Raison. – D’où le sais-tu ?
Augustin. – Je ne sais pas.
La Raison. – Te sens-tu simple ou multiple ?
Augustin. – Je ne sais pas.
La Raison. – Sais-tu que tu te meus ? Augustin. – Je ne sais pas.
La Raison. – Sais-tu que tu penses ?
Augustin. – Je le sais.
La Raison. – Donc il est vrai que tu penses ?
Augustin. – C’est vrai.
Augustin retrouve ainsi le sens d’un passage stupéfiant du traité de Lactance « Sur la colère de Dieu » qui mérite d’être cité : « L’homme, debout, le visage rayonnant, contemplant enthousiasmé le monde, tourne les yeux vers Dieu et sa raison y reconnaît la raison » (De ira dei 7, 5).
Les Confessions , par leur exemple, appellent à l’examen intérieur et, en cela, ouvrent à la liberté, car « la volonté naîtra à l’intérieur » dit Augustin dans un sermon ( Sermon 112, 8). Les mots latins éclairent le sens réel de la formule : la nécessité est une force venue de l’extérieur, foris . Il s’agit dans la pensée d’Augustin de ce que symbolise le « forum » romain : le droit, la force des lois, les institutions civiques. Que désigne alors « l’intérieur », intus en latin ? Eh bien l’inverse du forum, ce lieu politico-civique, à savoir le « for intérieur » dit un français un peu vieilli mais si évocateur. Il s’agit exactement de la conscience, cette liberté intérieure qui fait qu’une décision est pleinement nôtre. Or, il n’est pas abusif de dire que l’un des apports majeurs du christianisme et de ses textes saints est précisément l’invention de cette liberté intérieure de conscience. Rémi Brague, dans son ouvrage Sur la religion , en voit la naissance dans la Genèse, au moment où Dieu laisse au premier homme, Adam, l’initiative de nommer lui-même les animaux (Genèse 2, 19). Quant au mot grec de liberté, il n’apparaîtra dans la tradition chrétienne qu’au sein du Nouveau Testament avec saint Paul, dans l’Épître aux Galates (5, 1), et celui de conscience dans cette page décisive de l’Épître aux Romains (2, 15) où l’apôtre des Gentils établit que chrétiens, juifs et non-croyants ont tous le devoir de faire valoir leur liberté personnelle de conscience ou, en grec, suneidèsis .
Augustin a pris la liberté dans les Confessions d’inventer un genre littéraire nouveau, la liberté de s’y montrer à nu, la liberté de verser des larmes sur sa misérable condition, sur la mort de ses amis, de sa mère, mais aussi des larmes de joie en recevant le réconfort divin, c’est-à-dire la grâce. Augustin a combattu l’arbitraire impérial, s’est affranchi du forum et du regard des hommes de son temps pour mieux dire aux hommes de tous les temps qu’il leur ressemblait. Et c’est la raison pour laquelle nous lisons aujourd’hui les Confessions.
Stéphane RattiProfesseur d’histoire de l’Antiquité tardive Université de Bourgogne Franche-Comté
REPÈRES CHRONOLOGIQUES
354 (13 nov.) Naissance d’Augustin à Thagaste. 365-369 Études d’Augustin à Madaure. 370-373 Études supérieures à Carthage. Entrée dans la secte des Manichéens.
371 Mort du père d’Augustin, Patricius. 371 ou 372 Naissance du fils d’Augustin, Adeodatus.
373-374
373-374
Augustin professeur à Thagaste.
Symmaque proconsul d’Afrique en poste à Carthage.
Augustin professeur à Carthage. 380-381 Dédicace du De pulchro et apto à Hierius. 383 Départ d’Augustin pour Rome.
374-383
384 Rencontre de Symmaque. Nomination d’Augustin comme rhéteur à Milan.
385 Monique rejoint Augustin à Milan.
385 (janv.)
Augustin prononce le panégyrique de Bauto.
385 (nov.) Augustin prononce le panégyrique de Valentinien II.
386 Lecture par Augustin des livres des platoniciens en traduction latine.
386 (juin)
Invention des reliques de Gervais et de Protais par Ambroise.
386 (août) Scène du Jardin à Milan.
386 (oct.)
Démission officielle d’Augustin de son poste de rhéteur à Milan.
386 Monique renvoie la concubine d’Augustin en Afrique.
386-387
Otium à Cassiciacum (de novembre 386 à mars 387). Rédaction des dialogues.
387 (Pâques) Baptême d’Augustin à Milan (le Samedi saint, 24 avril).
387 (août) Extase d’Ostie. Mort de Monique à Ostie.
387-388 Augustin à Rome.
388
388-390
Retour d’Augustin en Afrique.
Otium à Thagaste. Échange épistolaire entre Augustin et Nebridius.
389 Mort d’Adeodatus, fils d’Augustin, et de Nebridius.
391 Départ pour Hippone.
391 (janv.) Augustin nommé prêtre à Hippone.
391 (mars) Premier prêche.
393 Concile d’Hippone.
395 (été) Augustin nommé évêque coadjuteur d’Hippone par Valerius.
395
Lettre d’Augustin à Licentius. 396 Mort de Valerius.
397-401 Rédaction des Confessions.
410 (août) Sac de Rome par Alaric.
411 Concile de Carthage. Condamnation du donatisme.
411-412
Début de la rédaction de la Cité de Dieu. 412 Lettre de Volusianus à Augustin et réponse d’Augustin.
413 Exécution de Marcellinus à Carthage.
426
Début de la rédaction des Rétractations.
430 (28 août) Mort d’Augustin à Hippone, assiégé par les Vandales. Ses écrits sont sauvés par son secrétaire Possidius.
LIVRE PREMIER
PRIÈRE LIMINAIRE
L’Homme veut louer Dieu, mais il hésite sur la forme où doit s’exprimer sa prière.
I. 1 – « Vous êtes grand, Seigneur, et infiniment digne de louanges ; grande est votre puissance et incalculable votre sagesse. »
Et c’est vous que veut louer l’homme, chétive partie de votre création, l’homme, qui porte partout avec soi sa mortalité, qui porte avec soi le témoignage de son péché et la preuve que « vous résistez aux superbes ».
Et pourtant il veut vous louer cet homme, chétive partie de votreC’estcréation.vousqui l’engagez à chercher sa joie dans vos louanges, car vous nous avez fait pour vous et notre cœur est inquiet jusqu’à ce qu’il se repose en vous1.
Donnez-moi, Seigneur, de savoir, de comprendre, si l’on doit d’abord vous invoquer ou bien vous louer, si l’on doit d’abord vous connaître ou bien vous invoquer. Mais qui vous invoque sans vous connaître ? Celui qui vous ignore, peut toutefois en
1. Cette phrase, dont on rencontre une réminiscence dans l’Imitation (III, 21, 1), résume tout l’esprit des Confessions. Les passions éparpillent l’âme ; l’intelligence se disperse dans la variété des systèmes. C’est dans l’amour de Dieu, dans l’assujettissement à la foi, que réside la véritable quiétude intellectuelle et morale.
invoquer un autre à votre place. Ou, bien plutôt, n’êtes-vous pas invoqué pour être connu ? « Mais comment invoquer Celui en qui on ne croit pas ? » Et « comment croira-t-on, s’il n’y a pas de prédicateur ? » « Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Qui le cherche le trouvera », et qui le trouve le louera. Puissé-je vous chercher, Seigneur, en vous invoquant, et vous invoquer en croyant en vous ! Car vous nous avez été prêché. Elle vous invoque, Seigneur, cette foi que vous m’avez donnée, que vous m’avez inspirée par l’humanité de votre Fils, par le ministère de votre prédicateur1.
Invoquer Dieu, c’est lui demander de venir en soi (inuocare). Si Dieu est immanent au monde créé, une telle demande se comprend-elle ?
II. 2 – Cependant comment invoquerai-je mon Dieu, mon Dieu et mon Seigneur, puisque l’invoquer, cela implique que je l’appelle en moi-même ? Y a-t-il en moi une place où mon Dieu puisse venir ? Où Dieu puisse venir en moi, le « Dieu qui a créé le ciel et la terre » ? Se peut-il, Seigneur mon Dieu, qu’il y ait en moi quelque chose qui puisse vous contenir ? Est-ce que le ciel et la terre que vous avez créés, et au sein desquels vous m’avez créé, vous contiennent ? Ou bien, du fait que rien de ce qui est ne serait sans vous, s’ensuit-il que tout ce qui est vous contient ? Puisque moi-même je suis, pourquoi vous demander de venir en moi, qui ne serais pas si vous n’étiez en moi ? Je ne suis pas encore dans les régions infernales2, et
1. Ce « prédicateur », c’est sans doute saint Ambroise, principal ouvrier de la conversion d’Augustin. Une allusion précise se mêle ainsi à la paraphrase du Xe chapitre de l’Épître aux Romains.
2. La leçon iam inferi, que fournissent la plupart des manuscrits et que P. Knöll retient, n’est guère intelligible au point de vue grammatical. En tout cas, le sens
Je ne serais donc pas, ô mon Dieu, je ne serais absolument pas, si vous n’étiez en moi. Ou plutôt je ne serais pas si je n’étais en vous, « de qui, par qui, et en qui toutes choses sont ». C’est bien cela, Seigneur, oui, c’est bien cela. Où donc vous appeler, puisque je suis en vous ? D’où viendriez-vous en moi ? Où faudrait-il me retirer par-delà le ciel et la terre, pour que, de là, vienne jusqu’à moi mon Dieu qui a dit : « C’est moi qui remplis le ciel et la terre » ? Même question.
III. 3 – Le ciel et la terre vous contiennent-ils donc, puisque vous les remplissez ? Ou bien les remplissez-vous, mais reste-t-il encore quelque chose de vous, parce qu’ils ne vous contiennent point ? Et où reversez-vous ce qui reste de vous, une fois remplis le ciel et la terre ? Ou bien n’avez-vous nul besoin d’être contenu par quoi que ce soit, vous qui contenez tout, puisque ce que vous remplissez, vous le remplissez en le contenant ? Ce ne sont pas les vases pleins de vous qui vous donnent votre stabilité : viendraient-ils à se briser, vous ne vous répandriez pas au-dehors. Quand vous vous répandez sur nous, vous ne tombez pas à terre, vous nous relevez ; vous ne vous éparpillez pas, vous nous rassemblez.
Mais tout ce que vous remplissez, le remplissez-vous de votre Être entier ? Ou bien, les choses ne pouvant vous contenir tout entier, ne contiennent-elles qu’une partie de vous et toutes ensemble la même partie ? Ou chaque chose contient-elle une partie appropriée, les plus grandes une plus grande, les plus petites ne prête à aucune équivoque, fixé qu’il est par la citation du Ps 138.
une moindre ? Y aurait-il donc en vous telle partie plus grande, telle partie plus petite ? Ou bien êtes-vous tout entier partout, et nulle chose ne vous contient-elle tout entier1 ?
Augustin proclame les louanges de Dieu, louanges infiniment inégales à leur objet, mais qu’il serait pourtant coupable de taire.
IV. 4 – Qu’êtes-vous donc mon Dieu ! Qu’êtes-vous, je le demande sinon le Seigneur Dieu ? « Qui est Seigneur en dehors du Seigneur ? Ou qui est dieu en dehors de notre Dieu ? » Ô très haut, très bon, très puissant, très omnipotent, très miséricordieux et très juste, très caché et très présent, très beau et très fort, stable et impossible à saisir, immuable et changeant tout, jamais nouveau, jamais ancien, renouvelant tout, « amenant à leur insu les orgueilleux à la décrépitude » ; toujours actif, toujours en repos ; amassant sans avoir besoin de rien ; portant, remplissant, protégeant, créant et nourrissant, parachevant, cherchant, bien que rien ne vous manque ! Vous aimez, mais sans emportement ; votre jalousie est sans inquiétude, votre repentir sans douleur ; votre colère reste paisible ; vous modifiez vos œuvres, non vos desseins. Vous recouvrez ce que vous trouvez sans l’avoir perdu ; vous n’êtes jamais pauvre et vous aimez le gain ; jamais avare et vous exigez des usures. On vous donne plus qu’on ne vous doit, afin que vous deveniez débiteur. Et qui, pourtant, possède quelque chose qui ne soit à vous ? Vous payez vos dettes sans devoir à personne ; vous les remettez sans en rien perdre.
1. Ces raisonnements en forme d’interrogations ne sont point rares dans les parties philosophiques des Confessions. On ne les supporte pas toujours sans quelque lassitude.
Et qu’avons-nous dit, ô mon Dieu, ma vie, ma sainte douceur, que peut-on dire, quand c’est de vous qu’on parle ? Et pourtant malheur à ceux qui taisent sur vous, car leur parlage n’est alors que mutisme !
V. 5 – Qui me donnera de me reposer en vous ? Qui me donnera de vous voir entrer dans mon cœur pour l’enivrer, pour que j’oublie mes maux, et que je vous étreigne, vous, mon unique bien ?
Qu’êtes-vous pour moi ? Ayez pitié de moi, que je puisse parler. Mais que suis-je moi-même à vos yeux, pour que vous me commandiez de vous aimer, et, qu’à défaut de cet amour, vous vous irritiez contre moi, et me menaciez de terribles misères ? N’est-ce donc déjà qu’une médiocre misère de ne vous aimer point ? Ah ! dites-moi dans votre miséricorde, Seigneur mon Dieu, ce que vous êtes pour moi. Dites à mon âme : « C’est moi qui suis ton salut ». Dites cela, que je l’entende. Voici que l’oreille de mon cœur est devant vous, Seigneur. Ouvrez-la et dites à mon âme : « C’est moi qui suis ton salut. » Je veux courir après cette voix, et vous saisir enfin. Ne me dérobez pas votre face ; que je meure – pour ne pas mourir – mais que je la voie !
6 – Trop étroit est l’habitacle de mon âme pour que vous y puissiez entrer : élargissez-le. Il est tout délabré : réparez-le. Certaines choses y pourraient choquer vos yeux : je l’avoue, je le sais. Mais qui le purifiera ? À qui, si ce n’est à vous, crierai-je : « Purifiez-moi, Seigneur, de mes défauts cachés, épargnez à votre serviteur ceux dont l’occasion lui viendrait d’autrui. Je crois, et c’est aussi pourquoi je parle. » Seigneur vous le savez. Ne vous ai-je pas, contre moi-même, raconté mes péchés, et n’avez-vous pas « amnistié
Appel à l’amour divin à qui il appartient de purifier l’habitacle intime que lui offre Augustin.
PREMIÈRE ENFANCE
Les dons de Dieu au petit enfant. VI. 7 – Cependant, Seigneur – laissez-moi parler en présence de votre miséricorde, moi, terre et cendre ; laissez-moi parler puisque c’est à votre miséricorde que je parle, et non pas à l’homme, qui se rirait de moi. Et vous aussi, peut-être, vous riez-vous de moi ; mais tournez-vous vers moi, et vous aurez bientôt pitié. Qu’est-ce donc que je veux dire, Seigneur, sinon que j’ignore d’où je suis venu ici – dois-je dire en cette mourante vie, ou bien en cette vivante mort ? Je ne sais. Et j’ai été accueilli par les consolations de vos pitiés, comme je l’ai appris des père et mère de ma chair, de qui et en qui vous m’avez formé au moment voulu ; car, moi, je ne m’en souviens pas.
J’ai donc été reçu par les consolations du lait humain. Ce n’est ni ma mère, ni mes nourrices qui s’emplissaient les mamelles ; c’est vous, Seigneur, qui me donniez par elles l’aliment de la première enfance, selon votre plan qui répartit vos richesses jusqu’au plus humble niveau de la création. Vous me donniez aussi de ne pas vouloir plus que vous ne me donniez, et à mes nourrices de vouloir me donner ce que vous leur donniez ; car c’était par une affection prédisposée qu’elles me voulaient donner de ce qu’elles avaient en
8 – Et puis, je commençai à rire aussi, en dormant d’abord, ensuite éveillé. Tout cela m’a été dit de moi, et je l’ai cru, car il en est ainsi des autres enfants ; de tout ce passé je n’ai d’ailleurs nul souvenir. Et peu à peu je remarquais où j’étais, et je voulais montrer mes volontés à ceux qui pouvaient les accomplir ; mais en vain ; elles étaient au-dedans, eux, ils étaient au-dehors ; et nul sens ne donnait à autrui accès dans mon âme. Aussi je me démenais avec des cris, avec ce peu de signes, semblables à mes volontés, que je pouvais notifier tant bien que mal, mais qui ne les exprimaient pas exactement1. Et quand je n’étais pas obéi, soit qu’on ne m’eût pas compris, soit qu’on eût peur de me faire du mal, je m’emportais contre ces grandes personnes insoumises qui, libres, refusaient de se faire mes esclaves ; je me vengeais d’elles en pleurant. Tels j’ai vu les petits enfants que j’ai pu étudier et ils m’ont mieux révélé, à leur insu, ce que j’ai dû être alors, que ne l’ont fait, avec toute leur expérience, ceux qui m’ont nourri.
1. Ces observations, très simples et très justes, Augustin indique lui-même à la fin du paragraphe (et au § 12) qu’elles sont de première main ; qu’il a conjecturé, en étudiant les façons de faire des petits enfants, ce qu’il dut être lui-même. Mais il ne les formule que pour en tirer des conclusions théologiques, obsédé qu’il est dès cette époque (le De diuersis Quaestionibus ad Simplicianum est de 397) par le problème du péché originel.
9 – Et voici que depuis longtemps, mon enfance est morte, et moi je vis. Mais vous, Seigneur, vous vivez toujours, et rien ne meurt en vous, parce qu’avant la naissance des siècles et avant tout ce qui peut être nommé d’antérieur encore, vous êtes, et vous êtes Dieu et Seigneur de tout ce que vous avez créé ; en vous demeurent les causes de tout ce qui passe, les immuables origines de toutes les choses changeantes, et les raisons éternelles de toutes les choses temporelles et privées de raison. Dites-moi, dites à votre suppliant, dites, ô mon Dieu, dans votre miséricorde à votre misérable serviteur, si mon enfance a succédé à quelque vie mienne expirée déjà. Ou bien cet âge serait-il celui que j’ai passé dans le sein de ma mère ? On m’en a dit quelque chose, et j’ai vu moi-même des femmes enceintes. Mais qu’étais-je avant ce temps, mon Dieu, vous, ma douceur ? Ai-je été quelque part ou quelqu’un ? Je n’ai personne qui puisse me répondre là-dessus ; ni mon père, ni ma mère, ni l’expérience des autres, ni mes propres souvenirs. N’allez-vous pas vous moquer de moi, à de telles questions, et m’ordonner de vous louer et de vous glorifier seulement de ce que je connais1 ?
10 – Je vous glorifie, Seigneur du ciel et de la terre, et vous rends hommage des commencements de ma vie et de mon enfance. Je ne m’en souviens pas : mais vous avez permis à l’homme de conjecturer ce qu’il fut par ce qu’il voit en autrui, et de s’en rapporter sur bien des choses qui le concernent au témoignage de simples femmes. Enfin j’étais alors, je vivais déjà en ce temps, et déjà, vers
1. La question de l’origine de l’âme est aussi de celles qui ont tourmenté Augustin, et il n’a jamais réussi, non pas même à l’époque où, vers la fin de sa vie, il rédigeait ses Rétractations, à y apporter une solution définitive.
la fin de ma première enfance, je cherchais des signes pour faire connaître aux autres mes sentiments.
Et de qui un être animé, tel que celui-là, aurait-il reçu l’existence, sinon de vous, Seigneur ? Et qui donc serait l’artisan de lui-même ? Est-il une autre source d’où l’être et la vie puisse s’épancher en nous, en dehors de celle d’où vous nous tirez, Seigneur, vous pour qui être et vivre, c’est tout un, parce que l’être souverain et la souveraine vie, c’est la même chose ?
Car vous êtes l’Être suprême ; vous ne subissez aucun changement ; en vous, il n’y a point d’aujourd’hui qui s’achève, et cependant c’est en vous qu’il s’achève parce que tout cela est aussi en vous ; et tout cela ne trouverait pas quelle route suivre, si vous n’étiez là pour le contenir. Et comme « vos années n’ont pas de fin », vos années sont un perpétuel aujourd’hui ; et par cet aujourd’hui qui est vôtre, combien de nos jours, combien des jours de nos pères ont passé et en ont reçu leur mesure, les modalités de leur être ! D’autres jours passeront encore et en recevront également leur mesure, les modalités de leur être. Mais vous, vous êtes toujours le même « vous-même » ; toutes les choses de demain et de l’avenir, c’est aujourd’hui que vous les ferez ; toutes les choses d’hier et du passé, c’est aujourd’hui que vous les avez faites.
Si quelqu’un ne comprend pas cela, qu’y puis-je ? Qu’il se réjouisse aussi celui-là et qu’il dise : « Quel est ce mystère ? » Oui, qu’il se réjouisse même ainsi et qu’il préfère trouver en ne trouvant pas, plutôt que – en trouvant – de vous trouver point !
Où est l’innocence de l’enfant au berceau ?
VII. 11 – Écoutez-moi, ô mon Dieu. Malheur aux péchés des hommes ! Et c’est un homme qui parle ainsi, et vous avez pitié de
lui, parce que c’est vous qui l’avez fait, lui, mais non le péché qui est en lui.Qui va me rappeler le péché de mon enfance1 ? « Car personne n’est pur de péché devant vous, pas même le petit enfant qui n’a vécu sur la terre qu’un jour. » Qui va me le rappeler ? N’est-ce pas n’importe quel enfant, si petit soit-il, en qui je vois ce dont je n’ai nulle souvenance à mon propre sujet ?
Quel était donc mon péché, d’alors ? Était-ce de pleurer avidement après le sein ? Car, si je convoitais aujourd’hui avec une pareille avidité, non pas le sein maternel, mais la nourriture de mon âge, on se moquerait de moi et l’on me blâmerait à juste titre. J’étais donc, dès lors, répréhensible. Mais comme je n’aurais pu comprendre la réprimande, ni les usages ni la raison ne permettaient de me reprendre. Et pourtant ces premières impatiences, en grandissant, nous les déracinons, nous les rejetons loin de nous ; or, je n’ai jamais vu personne, pour retrancher le mauvais, jeter sciemment le bon. – Était-il donc bien, même pour un temps, de demander en pleurant ce qu’on ne pouvait me donner sans me nuire ; de m’emporter avec violence contre des gens de condition indépendante et libre, d’âge déjà mûr, contre mes propres parents et autres personnes de sens rassis, quand ils ne se prêtaient pas à mes moindres caprices ; de les frapper, en tâchant de leur faire tout le mal possible, pour m’avoir refusé une obéissance qui ne m’eût été concédée qu’à mon dam ?
1. Augustin est à ce point persuadé de la perversité foncière de la nature humaine, gâtée par le péché originel, qu’il va s’appliquer à noter l’éveil des inclinations mauvaises jusque dans le cœur de l’infans : petites colères effrénées, chantage rageur des larmes, pour asservir les grandes personnes à des caprices parfois nuisibles, etc.
Ainsi, ce qu’il y a d’innocent chez l’enfant, c’est la faiblesse de ses organes, mais son âme, non pas1 ! Un enfant que j’ai vu, que j’ai observé, était jaloux. Il ne parlait pas encore, et il regardait fixement, pâle et amer, son frère de lait. C’est là un fait connu. Les mères et les nourrices prétendent conjurer ce mal par je ne sais quelles pratiques. Va-t-on appeler aussi innocence, quand la source du lait maternel s’épanche si abondamment, de n’y pas souffrir près de soi un frère qui en a tant besoin et dont ce seul aliment soutient la vie ? L’on tolère ces défauts avec indulgence, non qu’ils soient légers ou sans importance, mais parce qu’on compte qu’ils disparaîtront avec les années. C’est là l’unique raison, car on ne manque jamais de s’en irriter, lorsqu’on les surprend chez un adulte.
12 – C’est donc vous, Seigneur mon Dieu, qui avez donné au petit enfant, avec la vie, ce corps tel que nous le voyons, muni de sens, composé de membres bien assujettis, paré de formes gracieuses ; c’est vous qui avez mis en lui toutes les impulsions de la vie, pour qu’il se conserve sain et sauf en son intégrité. Vous m’ordonnez de vous louer pour ces dons, « de vous confesser, de chanter votre nom, ô Très-Haut ». Car vous êtes le Dieu toutpuissant et bon, n’eussiez-vous fait que ces choses que nul autre que vous ne peut faire, ô Dieu Un, d’où dérive toute mesure, ô Forme parfaite, qui formez tout et ordonnez tout selon votre loi.
Or cet âge, Seigneur, je ne me souviens pas de l’avoir vécu ; je n’y crois que sur la foi d’autrui ; c’est d’après l’observation d’autres petits enfants que je l’ai imaginé, conjecture des plus probables au surplus ; aussi ai-je quelque peine à le compter dans la vie que je mène en ce siècle-ci. Dans la région ténébreuse de mes oublis, il
1. Augustin a longuement développé ces vues dans le De Peccatorum meritis et remissione, I, xxxv, 66 et s. (P. L., t. xliv ; Corp. Script. eccl. lat., t. lx).
est tout pareil à celui que j’ai passé dans le sein de ma mère. Mais si « j’ai été conçu dans l’iniquité », si « c’est dans le péché que ma mère m’a nourri dans son sein », où donc, je vous prie, ô mon Dieu, où ai-je été, Seigneur, moi, votre serviteur, où et quand ai-je été innocent ? Au surplus, je laisse de côté cette période. Quel rapport d’elle à moi, puisque je n’en retrouve plus en moi la moindre trace ?
LA SECONDE ENFANCE
Comment l’enfant apprend à parler.
VIII. 13 – N’est-il pas vrai que, m’acheminant vers le point où je suis, j’ai passé de la première enfance à la seconde ? Ou n’est-ce pas plutôt la seconde elle-même qui est venue en moi, prenant la place de la première ? Non que celle-ci soit partie : où serait-elle allée ? Pourtant elle n’était déjà plus. Je n’étais déjà plus le bébé qui ne parle point, mais l’enfant doué de la parole. De cela je me souviens ; et comment j’avais appris à parler, c’est plus tard que je m’en suis rendu compte.Cene
fut pas le fruit d’un enseignement donné par les grandes personnes, qui m’auraient fourni les mots, selon un ordre méthodique, comme elles devaient le faire peu après pour l’alphabet ; non, je m’instruisais moi-même, grâce à l’intelligence que vous m’avez donnée, ô mon Dieu, quand je voulais produire au-dehors les sentiments de mon âme par des gémissements, des cris divers, une gesticulation variée, afin qu’on obéît à mes volontés ; je ne réussissais pas toutefois à me faire comprendre pour tout ce que je voulais, ni de tous ceux que je voulais. Je saisissais (les mots) avec ma mémoire1,
1. Toute cette analyse des premières opérations de l’intelligence des enfants est fort intéressante. On remarquera les divergences des mss. sur le mot «prensabam»
quand on nommait un objet quelconque, et que le mot articulé déterminait un mouvement vers cet objet : j’observais et je retenais qu’à cet objet correspondait le son qu’on faisait entendre, quand on voulait le désigner. Le vouloir d’autrui m’était révélé par les gestes du corps, par ce langage naturel à tous les peuples, que traduisent l’expression du visage, les clins d’yeux, les mouvements des autres organes, le son de la voix, par où se manifestent les impressions de l’âme, selon qu’elle demande, veut posséder, rejette ou cherche à éviter. Ainsi ces mots qui revenaient à leur place dans les diverses phrases et que j’entendais fréquemment, je comprenais peu à peu de quelles réalités ils étaient les signes, et ils me servaient à énoncer mes volontés d’une bouche déjà experte à les former.
C’est de cette façon que je communiquais les signes, interprètes de mes volontés, à ceux au milieu desquels je vivais, et que, assujetti à l’autorité de mes parents, au bon plaisir de mes aînés, j’entrai plus avant dans les agitations orageuses de la société humaine.
L’ÉDUCATION
Les misères d’Augustin écolier.
IX. 14 – Ô Dieu, mon Dieu, quelles misères, quelles déceptions n’ai-je pas subies là, à cet âge où l’on ne proposait à l’enfant que j’étais d’autre règle de bien vivre que d’obéir à mes maîtres, afin de briller dans le monde et d’exceller dans cette science verbeuse qui (memoria). Pensabam (je considérais avec soin) paraît moins significatif et moins heureux que prensabam, qui exprime «l’appréhension» toute spontanée des mots par la mémoire puérile. Praesonabam (je répétais d’avance) ne serait pas mauvais, mais implique que l’enfant sait déjà le mot et se le répète à lui-même. Praestabat serait aussi une leçon acceptable («ma mémoire me venait en aide»).
devait me procurer prestige aux yeux des hommes et menteuses richesses ! Puis on me mit à l’école pour apprendre mes lettres ; pauvre que j’étais, je ne voyais pas à quoi cela servait, et pourtant quand je me montrais paresseux à apprendre, je recevais des coups. Les grandes personnes trouvaient cela parfait. Nos nombreux devanciers dans la vie nous avaient préparé ces sentiers douloureux par où il nous fallait passer, au prix d’un surcroît de labeur et de souffrance pour les enfants d’Adam1 ! Nous trouvâmes alors, Seigneur, des hommes qui vous priaient, et d’eux nous apprîmes, tout en vous comprenant comme nous pouvions, qu’il y a quelqu’un de grand qui peut, sans apparaître à nos sens, nous entendre et nous secourir. Tout enfant, je vous priais déjà, vous « mon refuge et mon asile », et, à vous invoquer, je rompais les liens de ma langue, et je vous priais – avec quelle ferveur, si petit que je fusse ! – afin de n’être point battu à l’école. Et quand, pour mon bien, vous ne m’exauciez pas, les grandes personnes – mes parents eux-mêmes, si éloignés de me vouloir la moindre peine – riaient de mes férules, ma grande et douloureuse peine d’alors.
15 – Est-il, Seigneur, un cœur assez haut placé, un cœur dont l’amour vous enlace d’une assez forte étreinte (car il est une insensibilité stupide qui arrive parfois au même résultat), en est-il un qui puise dans cette sainte union assez d’énergie, pour ne plus jeter qu’un œil indifférent sur les chevalets, les ongles de fer, et ces
1. « Le travail auquel on contraint les enfants par les punitions, remarque ail leurs Augustin (Cité de Dieu, XXI, xiv) est quelque chose de si pénible qu’à l’ennui de l’étude, ils préfèrent quelquefois l’ennui des punitions. D’ailleurs, qui n’aurait horreur de recommencer son enfance et ne préférerait mourir, si le choix lui en était donné ? » (Quis autem non exhorreat, et mori eligat, si ei proponatur, aut mors perpetienda, aut rursus infantia ?)
autres instruments de torture qui inspirent tant d’effroi que, pour y échapper, l’on fait monter vers vous des supplications de toutes les parties de l’Univers ? Et cela, encore qu’il chérisse ceux qui en ont la terreur, de même que mes parents riaient des châtiments que m’infligeaient mes maîtres ? Car je ne les redoutais pas moins que la torture même, et je ne vous priais pas moins de me les épargner ; et je péchais toutefois, faute d’écrire, de lire, de réfléchir à mon travail autant qu’on l’exigeait de moi.
Ce n’était pas que je manquasse, Seigneur, de mémoire ou de vivacité d’esprit ; votre bonté me les avait assez libéralement départies pour cet âge. Mais j’adorais le jeu, et j’en étais puni par qui faisait, bien entendu, tout comme moi. Seulement, les jeux des hommes, on les appelle « affaires », et ils punissent ceux, tout pareils, des enfants, et personne n’a pitié ni des enfants, ni des hommes, ni des uns et des autres. Un juge équitable pourrait-il cependant approuver qu’un enfant fût châtié pour s’être laissé détourner par le jeu de paume d’apprendre des leçons qui devaient devenir, entre ses mains d’homme fait, un jeu autrement nuisible ? Et que faisait donc celui qui me frappait ? Une insignifiante discussion, s’il y était vaincu par quelque docte collègue, lui infligeait plus de dépit rageur que je n’en éprouvais moi-même, quand j’étais battu au jeu de paume par un de mes camarades1 !
X. 16 – Et, néanmoins je péchais, Seigneur mon Dieu, Régulateur et Créateur de toutes les choses naturelles, à l’exception des péchés dont vous n’êtes que le Régulateur ; Seigneur mon Dieu,
1. Augustin s’est rarement permis ce ton ironique dans les Confessions. Mais ses polémiques prouvent que, selon l’expression de M. Monceaux, « il avait de l’esprit à revendre ». (Voy. Hist. litt. de l’Afr. chrét., VII, 269.)
je péchais en agissant contre les prescriptions de mes parents, de mes maîtres ; car j’aurais pu bien user dans la suite de ces connaissances qu’on m’imposait, quel que fût l’esprit dans lequel on me les imposait. Ce n’était pas un choix meilleur qui me rendait désobéissant, c’était l’amour du jeu ; j’aimais dans les luttes l’orgueil de la victoire ; les récits fictifs, qui, chatouillant mon oreille, y allumaient une plus avide flamme ; une curiosité chaque jour plus forte pétillait dans mes yeux, et m’entraînait aux spectacles, divertissements des grandes personnes. Au surplus, ceux qui les donnent recueillent par là tant de prestige qu’ils souhaitent presque tous que leurs enfants puissent faire de même : ce qui ne les empêche pas d’admettre fort bien que ces enfants soient châtiés quand les spectacles les détournent d’études grâce auxquelles ils arriveront un jour (les parents y comptent) à en donner à leur tour !
Voyez ces faiblesses avec miséricorde, ô Seigneur, délivrez-nous, nous qui déjà vous invoquons ; délivrez aussi ceux qui ne vous invoquent pas encore, pour qu’ils vous invoquent et que vous les délivriez !
Les premières influences chrétiennes.
XI. 17 – Encore tout enfant, j’avais entendu parler de la vie éternelle, promise par l’humilité du Seigneur notre Dieu, qui s’est abaissé jusqu’à notre orgueil. J’étais déjà marqué du signe de sa croix, déjà assaisonné du sel divin, dès ma sortie du sein de ma mère – qui a tant espéré en vous.
Vous avez vu, Seigneur, lorsque j’étais encore enfant, un jour qu’une subite oppression d’estomac accompagnée d’une forte fièvre me mettait à deux doigts de la mort, vous avez vu, puisque vous étiez déjà mon gardien, de quel élan de cœur, avec quelle foi je réclamai de la piété de ma mère, et de votre
Et déjà, toute bouleversée, la mère de ma chair, dont le chaste cœur enfantait avec plus d’amour encore mon salut éternel en votre foi, se préoccupait en toute hâte de me faire initier au sacrement salutaire, où j’allais être lavé en vous confessant, Seigneur Jésus, pour la rémission de mes péchés – quand soudain je me sentis soulagé. Aussi ma purification fut-elle différée comme si je dusse nécessairement me souiller de nouveau, en recouvrant la vie. Sans doute jugeait-on que si, après le bain baptismal, je retombais dans la fange du péché, ma responsabilité serait plus lourde et plus périlleuse.
Ainsi, déjà je croyais, et ma mère croyait, et toute la maison, mon père seul excepté, dont l’exemple pourtant ne put jamais faire échec en moi aux droits de la piété maternelle, ni me détourner de croire en Jésus Christ, en qui il ne croyait pas encore. Ma mère désirait passionnément que vous me fussiez un père, mon Dieu, plutôt que lui, et ici vous l’aidiez à l’emporter sur son mari, à qui, en dépit de sa supériorité morale, elle obéissait, parce qu’en cela aussi elle vous obéissait, à vous qui avez prescrit cette subordination.
18 – Dites-moi, ô mon Dieu, je voudrais savoir (si telle est votre volonté) à quelle fin mon baptême fut alors différé. Fut-ce, oui ou non, pour mon bien que les rênes du péché me furent pour ainsi dire lâchées ? D’où vient qu’aujourd’hui encore, cette phrase, à propos de tel ou tel, vient de tous côtés frapper mon oreille : « Laissez- le faire, il n’est pas encore baptisé ! » On ne dit pourtant point quand il s’agit du salut du corps : « Laissez-le se blesser davantage, il n’est pas encore guéri ! » Combien il eût été préférable pour moi d’être promptement guéri, et que
n’avons-nous, moi et les miens, déployé plus de zèle à placer mon âme munie de son salut, sous la sûre tutelle de Celui qui le lui aurait apporté !
Oui, cela eût mieux valu. Mais tout ce flot redoutable de tentations qui allait fondre sur moi, une fois mon enfance achevée, ma mère le voyait d’avance, et elle aimait mieux y exposer le limon de mon être, qui pourrait recevoir ensuite sa forme, que l’image sainte elle-même déjà restaurée1.
La contrainte scolaire : les goûts et les dégoûts d’Augustin.
XII. 19 – Dans cette période de mon enfance, que l’on redoutait moins pour moi que l’adolescence, je n’aimais pas l’étude, je détestais d’y être contraint. On m’y contraignait tout de même, et un bien en résultait pour moi, et c’est moi qui n’agissais pas bien, car je n’aurais rien appris si l’on ne m’y eût obligé. On n’agit pas bien quand on agit à contrecœur, même quand ce qu’on fait est bien en soi. Ceux qui me contraignaient n’agissaient pas bien non plus, mais bien m’en advenait, grâce à vous, mon Dieu. En m’obligeant à apprendre, ils n’avaient point d’autre visée pour moi que l’assouvissance des passions insatiables d’une opulente misère et d’une gloire ignominieuse. Mais vous, «qui savez le nombre de nos cheveux», vous vous serviez à mon avantage de l’erreur de tous ceux qui me pressaient d’apprendre, et vous vous serviez de mon erreur à moi, qui ne voulais pas apprendre, pour un châtiment que je méritais bien – si petit enfant et déjà si grand pécheur ! Ainsi, de ceux qui n’agissaient pas bien, vous tiriez du bien pour moi, et de mon propre péché la rémunération qui m’était due.
1. La clé de ce passage est au livre XIII, xii, 13 des Confessions. Interprétant selon la méthode allégorique le récit de la création dans la Genèse, Augustin identifie la « terre » avec l’« homme charnel » ; cette « terre » reçoit sa « forme » de la doctrine sainte, qui apporte à l’homme lumière et spiritualité.
Car vous avez ordonné, et il en va ainsi, que tout esprit qui n’est pas dans l’ordre, soit à lui-même son propre châtiment.
XIII. 20 – Pour quel motif avais-je en horreur le grec, que tout enfant, on m’inculquait déjà1 ? Aujourd’hui même, je ne m’en rends pas bien compte. Car j’aimais beaucoup le latin, tel que l’enseignent, non pas les tout premiers maîtres, mais les « grammairiens », comme on les appelle. En effet les premiers éléments, lecture, écriture, calcul, ne me paraissaient pas moins accablants et pénibles que le grec. D’où venait ce dégoût, sinon du péché, du néant de la vie ? « J’étais chair, j’étais le souffle qui passe et qui jamais ne revient. » Et pourtant ces études élémentaires, qui me rendaient possible, et auxquelles je dois encore, de lire n’importe quel écrit qui me tombe sous les yeux et d’écrire ce que je veux, elles étaient meilleures parce que plus pratiques que celles où l’on m’obligeait à apprendre par cœur les courses errantes de je ne sais quel Énée2 – oublieux moi-même de mes propres erreurs – à pleurer la mort de Didon qui se tue par amour, alors que, dans ma misère extrême, je n’avais pas une larme pour moi, que ces choses-là faisaient mourir loin de vous, ô mon Dieu, vous, ma Vie ! 21 – Quoi de plus pitoyable qu’un malheureux qui n’avait point pitié de soi-même, qui pleurait sur le trépas de Didon, morte de son amour pour Énée, mais qui ne pleurait pas sa propre mort,
1. «Et ego quidem graecae linguae perparum assecutus sum, et prope nihil», avouera-t-il dans le Contra Litteras Petiliani II, xxxviii, 91. Il en avait, en réalité, une connais sance suffisante pour le lire et le comprendre ; de nombreuses allusions le prouvent.
2. Formule d’un dédain quelque peu affecté, qu’Augustin reprendra plus loin à propos de Cicéron (III, iv, 7. librum cuiusdam Ciceronis). On peut poser en fait qu’il n’y a guère eu d’écrivain chrétien, dans les premiers siècles de l’Empire, chez qui, plus ou moins sincère, plus ou moins diplomatique, ne perce ou ne s’affirme une hostilité à l’égard des diverses formes de la culture profane, et des grands noms qui en étaient l’orgueil.
survenue faute d’amour pour vous, ô Dieu, lumière de mon cœur, pain de la bouche intérieure de mon âme, force qui féconde mon intelligence et le sein de ma pensée ? Je ne vous aimais pas, « je forniquais loin de vous », et parmi mes fornications j’entendais de toutes parts éclater les : « Bravo ! À merveille ! » car l’amitié de ce monde est une fornication, une infidélité à votre égard ; si l’on crie : « Bravo ! À merveille ! » c’est pour éveiller le respect humain de celui qui se refuse à y tomber. Ces faiblesses-là, je ne les pleurais pas ; mais je pleurais sur Didon « morte, après avoir cherché, le fer en main, la pire décision » ; moi-même je cherchais les pires objets de votre création, et je vous abandonnais – terre qui retourne à la terre. Et si l’on m’eût défendu de lire ces choses-là, j’aurais été consterné de ne pouvoir lire ce qui me consternait. Et l’on prend de telles folies pour un savoir plus relevé et plus fructueux que celui grâce auquel j’ai appris à lire et à écrire !
22 – Mais maintenant que mon Dieu crie dans mon âme, que votre Vérité me dise : « Cela n’est pas vrai ! Cela n’est pas vrai ! » Non, cette première formation est bien la meilleure, car me voici autrement disposé à oublier les courses errantes d’Énée et autres récits de ce genre, que l’écriture ou la lecture. Des voiles pendent au seuil des écoles de grammairiens : ce qu’ils symbolisent, c’est moins le prestige des secrets qu’on y apprend, que le mystère dont l’erreur s’enveloppe. Qu’ils n’aillent point crier contre moi, ceux que je ne crains plus, tandis que je vous confesse ce que veut mon âme, ô mon Dieu, et que, pour aimer vos voies honnêtes, je trouve mon repos dans la condamnation de mes mauvaises voies ; qu’ils n’aillent point crier contre moi, les vendeurs ou les acheteurs de grammaire. Si je leur posais cette question : « Est-il vrai ou non, comme le prétend Virgile, qu’Énée soit jadis venu à Carthage ? » les moins instruits répondraient qu’ils n’en savent rien, les plus doctes
que cela n’est pas vrai. Mais si je leur demande comment s’écrit le nom d’Énée, tous ceux qui l’ont appris me donnent la réponse juste, conformément au pacte, à la convention, par laquelle la société humaine a fixé la signification de ces signes. Et de même, ai-je demandé où serait le plus sensible dommage dans la vie, d’oublier la lecture et l’écriture, ou bien ces fictions des poètes, qui ne devine la réponse de quiconque n’a point totalement perdu le sensJe? péchais donc quand, enfant, je préférais ces futilités à des choses plus utiles, ou, pour mieux dire, quand je détestais les unes et n’aimais que les autres. « Un et un font deux, deux et deux font quatre », déjà ce refrain m’était odieux, tandis que j’adorais ces vaines imaginations : un cheval de bois plein de soldats armés, l’incendie de Troie, « et l’ombre de Creüse elle-même ».
Les causes de son antipathie pour le grec.
XIV. 23 – Pourquoi donc détestais-je la littérature grecque1 qui, pourtant, raconte des histoires du même genre ? Car Homère ourdit habilement des fables analogues, et dans sa frivolité même, il garde un charme infini ; néanmoins il paraissait amer à mon goût d’enfant. Je suppose que les enfants grecs ne pensent pas autrement de Virgile, quand on les force à l’apprendre comme on me forçait à apprendre Homère. C’était évidemment la difficulté, oui, la difficulté d’apprendre à fond une langue étrangère, qui mêlait pour ainsi dire son fiel à toute la douceur des fables grecques.
1. L’ars grammatica, ou litteratura, consistait, d’après Varron, à lire les poètes, les historiens, les orateurs, à les expliquer, à rectifier les fautes de texte, à juger le talent des auteurs (voy. Funaioli, Gramm. rom. fragmenta, Leipzig, 1907, p. 265 et s. (Bibliotheca Teubneriana).
Je n’en savais pas un mot, et pour me la faire apprendre on me menaçait avec emportement de châtiments cruels et effrayants.
Naguère, encore petit enfant, j’ignorais de même les mots latins, et cependant rien qu’à observer je les avais appris sans crainte, sans souffrances, au milieu des caresses de mes nourrices, parmi les plaisanteries et la gaieté de mon entourage, qui me riait et jouait avec moi. Je les ai appris sans la pression des insistances et des punitions ; mon esprit, à soi seul, me poussait à produire au-dehors ses pensées, ce que je n’aurais su faire, si je n’avais appris un certain nombre de mots, en dehors de tout enseignement didactique, des personnes qui causaient devant moi. Et pour qu’elles m’entendissent, je donnais moi-même le jour à tous mes sentiments.
Il ressort de là assez lumineusement que cette libre curiosité est autrement efficace qu’une contrainte toujours armée de menaces1. Pourtant cette contrainte, grâce à vos lois, mon Dieu, réfrène l’élan de la curiosité, oui, grâce à vos lois qui, depuis les férules des maîtres jusqu’aux épreuves des martyrs, savent doser leurs amertumes salutaires, pour nous rappeler à vous, loin des séductions mortelles qui nous ont détournés de vous.
Il souhaite de consacrer au service de Dieu ce qu’il a appris d’utile dans sa vie d’écolier.
XV. 24 – Seigneur, écoutez ma prière ; que mon âme ne défaille pas sous votre discipline ; que je ne défaille pas en vous confessant les miséricordes par lesquelles vous m’avez arraché à mes détestables voies. Ayez pour moi plus de douceur que toutes les séductions que je suivais. Que je vous aime du fond du cœur, que j’embrasse votre main de toute mon âme, pour que vous me tiriez
1. Ces vues pédagogiques ne sont pas insignifiantes.
de toute tentation jusqu’à mon dernier jour. N’est-ce pas vous, Seigneur, qui êtes « mon Roi et mon Dieu » ? Qu’à votre service soit consacré tout ce qu’enfant j’ai appris d’utile ; si je parle, si j’écris, si je lis, si je compte, que tout cela vous serve, car au temps où j’apprenais des choses vaines, vous, vous me donniez une discipline ; et la coupable jouissance que je prenais à ces choses vaines, vous me l’avez pardonnée. J’y ai appris bien des mots utiles ; au surplus, il est loisible de les apprendre aussi en des matières nullement frivoles, et c’est là la voie sûre dans laquelle on devrait engager les enfants.
Il condamne l’emploi, dans l’enseignement, des fictions corruptrices de la mythologie.
XVI. 25 – Malheur à toi, torrent de l’habitude humaine1. Qui te résistera ? Quand donc seras-tu desséché ? Jusques à quand rouleras-tu les fils d’Ève vers la vaste mer redoutable que peuvent à peine traverser ceux qui la passent sur la croix ? Porté par toi, n’ai-je pas lu l’histoire d’un Jupiter tonnant et adultère tout ensemble ? Il ne pouvait, bien entendu, faire l’un et l’autre à la fois. Mais la chose a été arrangée de telle manière qu’un adultère authentique pût s’en prévaloir, pour en faire autant, encouragé par ce tonnerre imaginaire.Parmices maîtres vêtus de la pénule , en est-il un seul qui puisse, sans se scandaliser, entendre un homme fait de la même poussière qu’eux s’écrier : « Telles étaient les fictions d’Homère ; il attribuait aux dieux les faiblesses humaines ; j’eusse préféré qu’il eût imputé aux hommes les grandeurs divines » ? Plus justement pourrait-on dire : « Oui, Homère créait des fictions, mais 1. La métaphore vient peut-être de Juvénal, Sat. IV, 89 « Jamais on ne vit Crispus se raidir contre le torrent, etc. » (« Ille igitur nunquam derexit bracchia contra tor rentem… »).
en attribuant la divinité à des hommes vicieux, pour empêcher qu’on ne considérât leurs turpitudes comme des turpitudes, et afin que quiconque en commettrait de semblables parût imiter, non pas des gens perdus de débauches, mais les dieux du ciel ! »
26 – Et pourtant, ô torrent infernal, on précipite dans tes flots les enfants des hommes avec l’argent des honoraires, afin qu’ils apprennent ces choses-là ! Et quelle importante affaire, quand cela se passe publiquement au forum, sous le regard des lois qui octroient (aux maîtres), un salaire (public), outre lesdits honoraires ! Tu bats les rochers de tes rives, et l’on entend dans ton fracas : « C’est ici qu’on apprend les mots ; ici que s’acquiert l’éloquence, si nécessaire pour opérer la persuasion et développer ses idées. » Ainsi donc nous ne connaîtrions pas ces mots « pluie d’or, sein, duperie, voûtes célestes, etc. » qui figurent dans le passage de Térence, si le poète n’avait mis en scène son jeune débauché, qui prend Jupiter pour modèle de luxure en regardant une peinture murale où le dieu est représenté, selon le mythe traditionnel, en train de faire tomber une pluie d’or dans le sein de Danaé, pour la duper de la sorte ? Voyez comme, sous le couvert de ce magistère divin, il s’excite à la débauche :
« Et quel Dieu encore ! Celui qui fait trembler d’un immense fracas les voûtes célestes. Et moi, chétif mortel, je n’en ferais pas autant ? Oui, je l’ai fait et je m’en félicite1 !»
1. Il s’agit du passage de l’Eunuque où Chaerea raconte comment il a pénétré chez la courtisane Thaïs sous l’accoutrement d’un eunuque pour prouver sa flamme à une jeune esclave dont la figure l’a ravi. On lui confie la jeune fille ; et la vue du tableau dont parle Augustin le décide à profiter de l’occasion.
Il n’est pas vrai, non, il n’est pas vrai qu’on retienne plus commodément ces mots-là grâce à des turpitudes de cette sorte. Seulement ces mots-là les font commettre plus hardiment. Je n’accuse pas les mots eux-mêmes, vases choisis et précieux, mais le vin d’erreur que nous y versaient des maîtres ivres. Et si nous ne voulions pas le boire, on nous frappait, sans qu’il nous fût permis d’en appeler à quelque juge de sang-froid.
Et cependant, ô mon Dieu, vous devant qui j’évoque ces souvenirs désormais sans alarmes, j’ai appris tout cela volontiers ; j’en faisais mes délices, malheureux que j’étais, et pour cela même on m’appelait un enfant de grande espérance.
Spécimen des exercices de classe où Augustin enfant excellait.
XVII. 27 – Permettez-moi, mon Dieu, de dire un mot de mes dons d’esprit, que je vous dois, et des niaiseries où je les gaspillais ! On me proposait, par exemple, une tâche qui compromettait passablement mon repos, soit par le prestige de la récompense escomptée, soit par la crainte du déshonneur ou des coups. Il s’agissait de faire parler Junon, sa colère, sa douleur de « ne pouvoir détourner de l’Italie le roi des Troyens ». Ces plaintes, je savais bien que Junon ne les avait jamais proférées. Mais on nous obligeait à nous égarer sur la piste de ces fictions poétiques, et à formuler en prose ce que le poète avait dit en vers1. Et celui-là emportait le plus de compliments qui, gardant au personnage décrit toute sa dignité, savait mettre en un plus frappant relief son courroux,
1. L’exercice scolaire auquel Augustin fait allusion avait été expressément recommandé par Quintilien, deux siècles et demi auparavant, dans son Institution oratoire (X, v, 2). Il ne voulait pas que ces paraphrases fussent simplement une sorte de calque, mais qu’il y eût lutte, émulation, autour des mêmes pensées. Et il admettait qu’elles portassent sur la prose aussi bien que sur la poésie.
sa douleur, et revêtir ces sentiments des phrases les mieux appropriées.Àquoi
me servait tout cela, ô vraie Vie, ô mon Dieu ? À quoi bon ces applaudissements qui saluaient ma déclamation, devant tant d’élèves de mon âge, mes condisciples ? Tout cela n’était-il pas vent et fumée ? N’y avait-il pas d’autres sujets où exercer mon esprit et ma langue ? Vos louanges, ô Seigneur, oui, vos louanges proclamées dans vos Écritures, eussent étayé le frêle sarment de mon cœur. Il n’eût pas été emporté au vent des frivolités, proie soufflée des oiseaux. Car il y a plus d’une manière de sacrifier aux anges prévaricateurs.
Les préoccupations morales subordonnées aux vanités du bien-dire.
XVIII. 28 – Quoi d’étonnant si je m’abandonnais ainsi aux vanités, et si loin de vous, mon Dieu, je me répandais au-dehors ? On me proposait comme modèles des hommes qui se sentaient consternés de se voir repris pour quelque barbarisme ou solécisme dans le récit d’une de leurs bonnes actions, mais que transportaient les louanges, quand ils avaient raconté en termes irréprochables et parfaitement assortis, avec toute l’abondance et la belle ordonnance requises, leurs propres débauches.
Vous voyez ces choses, Seigneur, et vous vous taisez, « longanime, plein de miséricorde et véridique ». Mais vous tairez-vous toujours ? Voici que maintenant vous retirez de cet abîme effrayant l’âme qui vous cherche, qui a soif de vos délectations, l’âme qui vous dit : « J’ai cherché votre visage, et je veux, Seigneur, le chercher encore. » Car on est loin de votre visage dans la passion ténébreuse. Quand on s’éloigne de vous ou qu’on revient à vous, ce n’est pas avec les pieds, et la question de distance n’intervient pas. A-t-il fallu que votre fils, dans la parabole, se procurât chevaux,
voitures ou navires ? Qu’il s’envolât sur des ailes visibles ou cheminât en mouvant ses genoux, pour vivre comme un prodigue, en lointain pays, et dissiper l’argent que vous lui aviez remis à son départ – père excellent, puisque vous le lui aviez donné, père plus tendre encore quand il revint manquant de tout ? Non, vivre dans la passion désordonnée, c’est vivre dans la passion ténébreuse, et c’est cela qui équivaut à vivre loin de votre visage.
29 – Voyez, Seigneur mon Dieu, voyez avec patience, selon votre ordinaire, l’exactitude que mettent les fils des hommes à observer les conventions des lettres et des syllabes que leur ont léguées ceux qui parlèrent les premiers, et comme ils négligent les pactes éternels de perpétuel salut qu’ils ont reçus de vous ! C’est au point que celui qui connaît ou enseigne cette antique convention des sons choque davantage les gens pour avoir, contrairement aux règles grammaticales, articulé sans aspiration de la première syllabe le mot « homme », que pour avoir, contrairement à vos préceptes, haï un homme, encore qu’il soit homme lui-même. Comme si le pire ennemi pouvait être plus dommageable que la haine dont on est embrasé contre lui ; comme si les blessures qu’on peut lui infliger en le pourchassant pouvaient être plus graves que celle qu’on fait à son propre cœur par cette animosité même. À coup sûr, il n’est pas de culture littéraire qui réside plus profondément en nous, que cette conscience qui y est inscrite et qui nous défend de faire à autrui ce que nous ne voudrions pas qu’on nous fît àCombiennous-mêmes.vous êtes secret, vous qui habitez au haut des cieux, dans le silence, Dieu seul grand, qui, par votre loi infatigable, semez les cécités vengeresses sur les passions illicites ! Un homme aspire à la gloire de l’éloquence ; devant un homme, un juge, en présence d’une multitude d’hommes, il s’acharne sur son ennemi avec une
Influence pernicieuse de cette éducation sur l’esprit d’Augustin.
XIX. 30 – Voilà l’école morale sur le seuil de laquelle, malheureux enfant, je gisais. Et dans cette arène-là, la lutte était ainsi pratiquée, que je redoutais plus de faire un barbarisme, que je ne me défendais de la jalousie quand j’en lâchais un, et que mes camarades n’en faisaient pas.
Je vous dis ces choses, mon Dieu, je vous confesse les faiblesses qui me valaient les louanges de ceux dont l’estime était pour moi l’honneur même de ma vie. Je ne voyais pas le gouffre de honte dans lequel « j’étais jeté loin de vos yeux ».
Quoi de plus haïssable que moi devant vos regards ! N’en étais-je pas arrivé à déplaire même à ces gens-là, par les innombrables mensonges dont je trompais pédagogues, maîtres et parents, dans mon amour du jeu, dans ma passion pour de sottes comédies, et ma turbulence joyeuse à les imiter ? Je commettais aussi des larcins dans la cave et sur la table de mes parents, soit pour obéir à ma gourmandise, soit pour pouvoir acheter ainsi le compagnonnage de jeu d’autres enfants qui y prenaient autant de plaisir que moi, mais me le vendaient tout de même. J’avais un si sot désir de supériorité que quand, dans le jeu, je me sentais battu, je captais souvent la victoire en trichant. Et pourtant s’il y avait une chose que je ne voulusse pas supporter et qui soulevât mes véhémentes réclamations, quand je prenais les autres en flagrant délit, c’était justement ce que je leur faisais moi-même. Étais-je pris à mon tour sur le fait et incriminé, j’aimais mieux faire le coup de poing que de céder.
Conclusion théologique.
Est-ce donc là l’innocence de l’enfant ? Non, Seigneur, non ; permettez-moi de le dire, ô mon Dieu ! Qu’on ait affaire aux pédagogues et aux maîtres pour des noix, des balles, des oiseaux, ou plus tard à des préfets et à des rois pour l’or, les domaines, les esclaves, la différence n’est pas grande. Un âge a beau succéder à l’autre, de même qu’à la férule succèdent des châtiments plus graves, c’est toujours la même chose.
C’est donc seulement le symbole de l’humilité, figurée par leur taille menue, que vous avez loué, ô vous, notre Roi, quand vous avez dit des enfants : « C’est à ceux qui leur ressemblent qu’appartient le royaume des cieux. »
Augustin remercie Dieu des aptitudes physiques et des dons intellectuels dont il bénéficiait dès cette époque.
XX. 31 – Et cependant, Seigneur, à vous le Créateur, le maître sublime et très bon de l’Univers, à vous notre Dieu, grâces mériteraient d’être rendues, quand même vous ne m’auriez pas permis de dépasser l’enfance. Car dès lors j’existais, j’avais la vie, le sentiment, et le souci de protéger l’intégrité de mon être, image de la mystérieuse unité d’où j’étais sorti. Je surveillais grâce au sens intérieur, le parfait exercice de mes sens, et au milieu même de mes petites pensées qui roulaient sur de petits objets, j’avais joie à trouver le vrai. Je ne voulais pas être trompé ; ma mémoire était vigoureuse, mon élocution déjà bien formée ; l’amitié me charmait ; je fuyais la douleur, l’abjection, l’ignorance. Tout cela n’est-il pas surprenant et merveilleux en un être comme celui que j’étais ? Mais tout cela, c’est Dieu qui me l’avait donné et non pas moi à moi-même : tout cela est bon, et tout cela constituait mon moi. Il est donc bon, Celui qui m’a fait ; il est lui-même mon bien
et je chante sa louange pour tous les biens grâce auxquels, même enfant, je vivais.
Là où je péchais, c’est en cherchant les plaisirs, les sublimités, les vérités, non en lui, mais dans les créatures, en moi-même et chez les autres ; je me précipitais ainsi dans les douleurs, les troubles, les erreurs. Grâces vous soient rendues, ô ma douceur, mon honneur, ma confiance, mon Dieu, grâces vous soient rendues pour vos présents, mais, vous, conservez-les-moi. Ainsi vous me conserverez moi-même ; et tout ce que vous m’avez donné recevra accroissement et perfection ; et je serai avec vous, puisque c’est vous qui m’avez aussi donné mon être.
LIVRE CINQUIÈME
Les désillusions d’Augustin manichéen
Augustin à Rome
Augustin à Milan. La rencontre de saint Ambroise
LIVRE SIXIÈME
La déroute des préjugés anticatholiques................................................139 Les perplexités d’ambition
Les incertitudes métaphysiques
Augustin et le néo-platonisme
LIVRE HUITIÈME
La contagion de l’exemple
La crise décisive
Lendemains de conversion La mort de Monique
Une nouvelle phase des Confessions
Augustin à la recherche de son Dieu
Augustin décrit son état moral à l’époque même où il rédige ses Confessions Résumé de ce Xe livre et conclusion
LIVRE ONZIÈME
LIVRE DOUZIÈME
LIVRE TREIZIÈME
Le