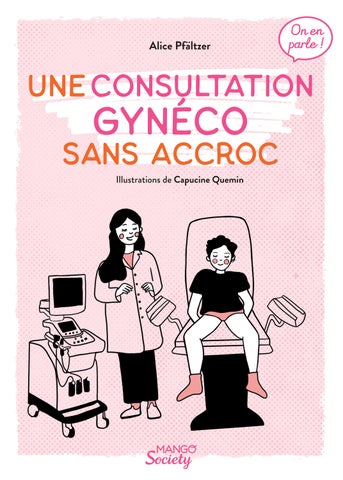Une consultation On
Gynéco SANS ACCROC


AVANT-PROPOS
Le suivi gynécologique représente une partie non négligeable de la vie médicale des personnes concernées. Pourtant, il est aussi souvent vecteur de stress, notamment du fait du caractère intime qu’il revêt. J’ai, comme beaucoup de personnes, été moimême victime de violences et maltraitances gynécologiques : pas de demande de consentement, pas d’explications sur mon état de santé, pilule imposée, refus de me poser un dispositif intra-utérin (DIU) sous prétexte que je n’avais jamais été enceinte (il n’y a pas besoin d’avoir eu de grossesse menée à terme ou non pour pouvoir avoir accès à cette contraception), obligation de me mettre intégralement nue même quand j’exprimais à demi-mot mon inconfort, jugement sur mes choix, insertion d’objets médicaux sans me prévenir, etc.
Le terme gynécologie vient des mots grecs gynéco (γυναιϰὸς), signifiant femme, et logie (λογία), signifiant doctrine, théorie. Ce terme désigne initialement ce qu’on pourrait qualifier de « science des femmes ». Évidemment, depuis l’époque où le grec n’était pas une langue morte, les mœurs et les savoirs ont évolué. Mais ce qu’il faut retenir ici, c’est que la gynécologie est un domaine médical qui s’intéresse à toutes les personnes qui ont une vulve, un vagin, une poitrine et/ou un utérus. Il n’est donc pas question de genre, mais bien de corps.
Ces maltraitances sont si courantes qu’elles semblent en devenir normales, ce qui n’est jamais le cas. Pour autant, aucune étude spécifiquement axée sur le sujet des violences gynécologiques n’a été réalisée aujourd’hui en France. Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes a pourtant alerté dès 2018 sur l’urgence que représentent les actes sexistes dans le suivi gynécologique et obstétrical. Dans un dossier complet sur le sujet (« Les actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical », par Danielle Bousquet, Présidente du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, Geneviève Couraud et Margaux Collet, rapporteuse et co-rapporteuse, rapport no 2018-06-26-SAN-034, voté le 26 juin 2018), il est dit que « Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes appelle à une prise de conscience des pouvoirs publics pour reconnaître les actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical, les prévenir, faciliter les procédures de signalements et condamner les pratiques sanctionnées par la loi ».
LES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES (IST)
INFECTIONS BACTÉRIENNES OU PARASITAIRES QUI PEUVENT ÊTRE GUÉRIES SI DIAGNOSTIQUÉES
souvent : pas de symptômes
souvent : pas de symptômes
SYMPTÔMES
COMMENT ÇA S’ATTRAPE ?
rarement : pertes vaginales inhabituelles ; démangeaisons au niveau du sexe ; sensations de brûlure au moment d’uriner ; douleurs au niveau de la vulve et/ou du périnée
rarement : 10 à 90 jours après l’infection, petite plaie ou bouton sur les muqueuses ; éruption cutanée (mains, pieds, organes génitaux et poitrine) ; jusqu’à 30 ans après, peut atteindre le foie, le cœur, les yeux, etc.
par contact lors de rapports sexuels sexe à sexe, sexe à bouche ou sexe à anus (pénétratifs ou non) ; par contact avec un objet humide infecté quelques heures avant (rare)
COMMENT S’EN PROTÉGER ?
DÉLAI POUR SE FAIRE DÉPISTER
COMMENT LA DIAGNOSTIQUER ET LA SOIGNER ?
le préservatif interne ou externe ; la digue dentaire (carré de latex)
1 à 2 semaines après le comportement à risque
prélèvement et/ou test urinaire ; se soigne au moyen d’antibiotiques
par contact lors de rapports sexuels sexe à sexe, sexe à bouche ou sexe à anus ; par contact avec les plaies ou éruptions cutanées ; par transmission de la personne enceinte à son enfant
le préservatif interne ou externe ; la digue dentaire
12 semaines après le comportement à risque, puis 6 mois plus tard
prise de sang ; se soigne au moyen d’antibiotiques
OÙ SE FAIRE DÉPISTER ?
Laboratoire privé avec ordonnance ;
PASS (permanence d’accès aux soins de santé pour personnes en situation de précarité), accessible aux personnes qui n’ont pas de droits ouverts (assurance maladie, AME ou CMU)
À vérifier en appelant avant celui proche de chez vous :
CeGIDD (centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic) ;
CPEF (centre de planification et d’éducation familiale) ;
PMI (protection maternelle et infantile)
GONORRHÉE CHLAMYDIA
souvent : pas de symptômes
rarement : 7 jours après le risque, sensation de brûlure au moment d’uriner ; pertes vaginales inhabituelles (jaunes et/ou verdâtres) ; perte de sang en dehors des règles ; douleurs au niveau de la vulve, de l’orifice vaginal ou urinaire, ou du bas-ventre
souvent : pas de symptômes
rarement : sensation de brûlure au moment d’uriner ; pertes vaginales inhabituelles (jaunes et/ou verdâtres) ; écoulement de pus par l’anus ; pigmentation des muqueuses vaginales ; rougeurs et/ou irritations au niveau de la gorge
par contact lors de rapports sexuels sexe à sexe, sexe à bouche ou sexe à anus ; après un partage de seringue ; par transmission de la personne enceinte à son enfant
par contact lors de rapports sexuels sexe à sexe, sexe à bouche ou sexe à anus ; après un partage de jouet sexuel ; par transmission de la personne enceinte à son enfant
le préservatif interne ou externe ; la digue dentaire
1 à 3 semaines après le comportement à risque
prélèvement vaginal, rectal ou par la gorge (ce dernier est souvent omis par les pros, n’hésitez pas à demander) ;
se soigne au moyen d’antibiotiques
le préservatif interne ou externe ; la digue dentaire
2 semaines après le comportement à risque
prélèvement vaginal, rectal ou d’urine ; se soigne au moyen d’antibiotiques

Les rendez-vous gynécologiques : des réalités contrastées
Dans ce chapitre, on essaiera de donner une vision claire de ce que peut être une consultation gynécologique, au travers de différents témoignages. Chaque cas de figure est introduit par un témoignage plus ou moins difficile et plus ou moins négatif concernant l’aspect dont il est question dans la sous-partie concernée. Le témoignage est ensuite analysé pour essayer de comprendre ce qui aurait pu mieux se passer, et un témoignage positif vient contrebalancer en fin de sous-partie.
Et si les consultations gynécologiques ne devaient pas nécessairement se dérouler comme on l’imagine ? Et si cette dernière expérience, qui vous a laissé un goût amer, était en fait une « violence gynécologique » ?
Qu’il s’agisse de toutes les questions que vous vous posez en amont ou que vous n’osez même pas formuler, des légendes urbaines concernant les IST et les contraceptions, ou encore des modalités qui encadrent ces consultations, ce guide vous apportera les outils nécessaires pour un suivi plus serein, inclusif et donc efficace.
En fil rouge, une enquête sur les violences gynécologiques met en lumière des habitudes passées sous silence, mais aussi le cadre légal des consultations et les possibilités qui s’offrent aux professionnel·les et aux patient·es, pendant et après les rendez-vous.
Curieuse depuis toute petite, Alice Pfältzer suit des études d’histoire à distance pour pouvoir mener une activité de journaliste puis d’animatrice et voyager sur plusieurs continents. En 2020, elle lance sa page Instagram @je.suis.une.sorciere, d’abord pour décrypter le pouvoir oppressif des insultes les plus courantes et par la suite s’intéresser plus largement aux sujets féministes.