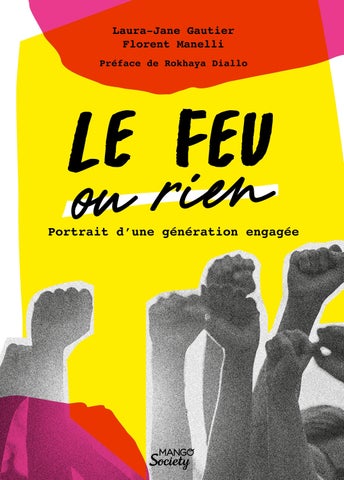11 minute read
Introduction
Le Feu ou rien est à la fois un hommage à notre génération1 mais aussi un appel à agir, à s’engager encore et toujours plus. Cet engagement est à l’origine de notre rencontre lors d’une interview pour un épisode du podcast Supplément d’âme2, qui s’est transformée en puissante amitié. Elle a donné naissance à une relation nourrie par l’envie d’agir et de penser le monde sous un prisme différent que celui imposé par notre système. Nos cercles activistes et relationnels respectifs, mais aussi nos expériences de vie et leurs lots de troubles, nous ont amené·es à nous questionner sur ce qui fait la singularité de notre génération. Cette génération en colère, déterminée et résiliente qui porte à bout de bras un système néfaste, usé et violent. Le temps de la jeunesse est probablement plus propice à la rébellion, à l’exaltation, à la radicalité et à la contestation. Chaque génération n’en demeure pas moins unique, façonnée par le contexte social et politique dans lequel elle grandit. Notre génération, elle, est la génération de toutes les crises : climatique, sociale, sanitaire, économique, démocratique, médiatique. Face à leur récurrence et à leur intensité, elle n’espère plus le changement, elle l’exige. En quête de vérité, elle ne supporte plus le mensonge, l’omerta, la manipulation, le silence, l’indifférence et l’oppression. L’urgence de ce que nous vivons renverse notre rapport au présent, et c’est précisément cette urgence qui nous amène à plus de radicalité. Certes, nous n’avons pas tout inventé : des droits civiques aux luttes LGBTQI+, en passant par les luttes féministes ou les premiers combats écologistes, on se doit de remercier nos aîné·es pour le chemin tracé jusqu’ici. Ce qui se joue désormais, c’est un changement de paradigme et l’ébranlement d’un système vieux comme le monde : celui dirigé par les hommes blancs, hétérosexuels, cisgenres, bourgeois et valides. Les détenteurs de ce pouvoir sentent que le vent tourne devant une génération plus que jamais résolue à les pousser vers la sortie. Nous faisons face à des hommes qui n’ont d’ailleurs pas intérêt à ce que les choses changent car leur situation privilégiée est née de ce système déséquilibré, violent et injuste, système qu’ils ont créé et voulu ainsi, à leur avantage. Malgré cela, nous ne sommes pas en guerre, et notre opposition a vocation à faire advenir le changement, entendre nos voix et non à exister pour le plaisir de la protestation. Ces nouvelles voix qui émergent dérangent. Peut-être parce que trop peu entendues par le passé, porteuses d’un point de vue qu’une partie de la population ne veut pas prendre en compte, volontairement silenciées et écartées de toute discussion, mises au placard parce que considérées comme
1 Dans cet ouvrage nous avons considéré la jeunesse comme allant de 18 à 35 ans, c’est-à-dire presque l’intégralité de la génération Y et une partie de la génération Z. 2 Supplément d’âme est un podcast animé et créé par Laura-Jane Gautier qui s’adresse à toute personne en quête de sens personnel ou professionnel, désireuse de contribuer à un monde meilleur et plus respectueux du vivant.
étant en dehors de la norme. Alors qu’est-ce qui a changé ? Comment ces nouvelles voix se sont-elles élevées ? D’où nous vient cette impression que l’engagement des jeunes se joue aujourd’hui à une plus grande échelle que dans le passé ? Et d’où vient cet intense sentiment que notre système commence à sérieusement prendre l’eau de toute part ? Les aspects patriarcaux et capitalistes de notre organisation sociale et économique sont intrinsèquement liés, et, si cette ritournelle tend à être de plus en plus entendue ces dernières années, comment les jeunes s’en emparent-ils aujourd’hui, en France ? Toutes ces questions nous brûlent les lèvres depuis des mois, et cet ouvrage se veut être une clé de réponse pour tenter de naviguer dans une époque parfois crispée mais profondément mouvante. C’est dans ce contexte que la jeunesse évolue et tente de se faire une place. Mais qu’est-ce que la jeunesse exactement ? Ce n’est pas une catégorie sociale homogène, ce n’est pas un bloc unifié, et sa définition peut être floue. Elle est multiple et nous ne cherchons pas, dans ce livre, à avoir une vision essentialiste3. Nous la voyons comme un groupement de personnes aux parcours de vie différents et riches, nourries de leurs histoires, de leurs origines, de leur classes sociales, de leurs genres, de leurs sexualités. Cependant, la définition de la sociologue et politologue Anne Muxel nous a semblé la plus juste pour tenter de décrire la jeunesse : « La jeunesse est un âge, elle est un temps de la vie. Elle est aussi un état qui renvoie l’image de la société, de ses espérances et de ses blocages, de ses projections et de ses impasses4 . »
Nous sommes une génération concernée, beaucoup moins manichéenne et beaucoup plus politisée que ne le sous-entendent certain·es, exprimant ouvertement son refus d’un système qui est devenu hors de contrôle. Nous levons le voile sur des années d’obstination à tenter de faire fonctionner une machine montée à l’envers, qui n’est plus une promesse d’un monde meilleur mais la réalité d’un monde malade de ses injustices, de ses inégalités et de l’exploitation du vivant. Nous nous organisons pour faire pencher la balance vers un monde plus juste et solidaire.
D’ounous’ vient ceeimpreion quel’engagement desjeunessejoue aujourd’huiaune plusgrandeechee ’ ’ quedanslepae? Internet a donné à notre génération hyperconnectée d’immenses ressources et a engendré une véritable révolution. Cette fenêtre ouverte sur le monde a complètement chamboulé notre rapport aux autres. Les personnes qui jusqu’alors n’avaient pas la parole, étaient moins visibles, voire invisibles, du reste de la société, peuvent désormais s’exprimer librement. Elles peuvent
3 L’essentialisation est l’acte de réduire un individu à une seule de ses dimensions. Source : franceculture.fr 4 Politiquement jeune, Anne Muxel, Éditions de l’Aube, 2018 11 /
mobiliser autour de leurs causes et prennent ce droit avec une détermination sans faille. À travers internet mais aussi la pop culture, quintessence du capitalisme et de notre société mondialisée, nous verrons dans ce livre comment notre génération s’engage dans un système bourré de paradoxes mais n’hésite plus à s’en servir pour mener ses combats. Elle travaille dur à se déconstruire. Et même si ce chemin semble long et sinueux, nous questionnons ce que nous avons appris depuis l’enfance et ce que nous avons acquis socialement, cette construction sociale qui nous a imposé ses codes et nous enferme dans des rôles étriqués. Nous prenons conscience de la violence de la norme, de la surconsommation, d’un modèle de réussite censé nous apporter le bonheur ultime mais qui provoque chez nous une perte de sens, des doutes profonds et des angoisses. Vous le verrez, le mot engagement est disséminé à de nombreuses reprises dans ce livre. Pour nous, ce mot définit le fait d’œuvrer pour le bien commun par l’action, de façon individuelle ou collective, que ce soit au sein d’associations et collectifs, de syndicats, d’organisations militantes ou de partis politiques, dans un laps de temps défini. Il n’y a pas un engagement, mais de multiples formes d’engagement. La définition est large, néanmoins, on retrouve derrière ce terme l’idée d’être dans l’action, de défendre un idéal, ses droits ou ceux des autres, de ne pas laisser faire et se laisser faire, de s’indigner par des mots et par des actes, de donner de son temps pour une action collective mais aussi pour soi. S’engager, c’est désirer au plus profond de soi-même un changement. Selon le dictionnaire Larousse, il s’agit de l’« acte par lequel on s’engage à accomplir quelque chose », mais nous préférons la définition de l’autrice et activiste Juliette Rousseau, qui parle de lutte : « Lutter c’est souvent se tenir bras tendus, comme écartelé·e, entre ce qui est et ce qui devrait être5 . » Nous ne ferons pas ici une liste exhaustive de toutes les formes d’engagement, mais nous parlerons de cette mosaïque si riche et si complexe en mettant au centre les témoignages de personnes qui sont elles-mêmes engagées dans des combats qui bien souvent les dépassent. Nous ne sommes ni sociologues, ni historien·nes, ni psychologues. Nous sommes simplement concerné·es par les enjeux de notre siècle. Nous avons, l’un ou l’autre, vécu du sexisme ou de l’homophobie dans nos vies, et avons été sensibilisé·es à différentes causes (climat, racisme, luttes queer, sexisme, validisme, grossophobie, justice sociale…), mais cela ne nous donne pas un totem d’immunité, n’annule pas nos potentiels angles morts. Nous sommes deux jeunes trentenaires, blanc·hes, issu·es de classes CSP+6 ,
S’engager, c’estdesirer ’ auplusprofond desoi-meme ’’ unchangement.
5 Lutter ensemble, Juliette Rousseau, Éditions Cambourakis, 2021 6 Catégorie socioprofessionnelle supérieure désignant la classe moyenne supérieure et les ménages aisés.
valides et cisgenres. Nous vivons dans de grandes villes françaises, avec une vision de ce que sont l’engagement et l’activisme à travers nos expériences de vie. Nous sommes deux personnes engagées, aux parcours militants riches de plusieurs années, c’est donc l’application de nos réflexions, de nos connaissances, de nos observations et de nos vécus qui prévalent dans cet ouvrage.
Nous sommes, nous-mêmes, deux jeunes faisant partie d’un mouvement bien plus grand que nous. Nous avons terminé le lycée alors que la crise des subprimes7 éclatait. Nous savions alors qu’à la fin de nos études supérieures nous trouverions difficilement du travail, le chômage jouait sa douce musique. En parallèle, la crise climatique s’est amplifiée, suivie d’une crise sanitaire sans précédent qui touche plus particulièrement les jeunes et les plus précaires. Les attentats de 2015 à Paris nous ont touché·es de près, mais aussi la crise des Gilets jaunes, catalyseur de la violence sociale vécue par une grande partie de la population de notre pays. Ce livre est un long fil déroulé de nos propres interrogations auxquelles nous avons tenté de répondre.
Ainsi, les interviews que contient cet ouvrage sont autant d’éclairages pour élargir notre vision et nos observations. Justice sociale et climatique, renouveau démocratique, entrepreneuriat social, violences faites aux enfants, dialogue interreligieux, luttes queers, féministes et antiracistes : treize activistes de 19 à 35 ans ont accepté de partager leurs réflexions sur notre génération, leurs modes d’action, les causes et les raisons de leur engagement. La sociologue Claire Thoury et le psychiatre Adrien Lenjalley, tous deux spécialistes de la jeunesse dans leurs domaines respectifs, nous ont également éclairé·es dans notre cheminement. Nous avons fait le choix de parler uniquement du cas de la France, tout en étant amené·es à prendre l’exemple des États-Unis car les luttes américaines ont des liens étroits avec l’activisme français, quand bien même nos histoires diffèrent. Ce livre est évidemment rédigé en respectant les règles de l’écriture inclusive, n’en déplaise à notre chère Académie française, cette institution si moderne8, parce que nous pensons que le masculin ne doit pas être la norme. Vous verrez également régulièrement dans ce livre les termes « militant·e » et « activiste ». Historiquement rattaché en France aux questions sociales, le terme « militant·es » définit celles et ceux qui croient en la capacité du collectif à pouvoir renverser l’ordre établi. C’est une posture sans cesse en mouvement qui cherche à créer un idéal de société. Dans l’activisme s’ajoute la notion de faire, d’action, d’agir. Dans cet ouvrage, nous utiliserons les deux
7 Les subprimes sont des prêts immobiliers accordés à partir des années 2000 à des ménages américains qui ne remplissent pas les conditions pour souscrire un emprunt immobilier classique. Ces ménages modestes sont ainsi appelés « subprimes ». L’endettement des ménages américains atteint ses limites après quelques années, et les prix de l’immobilier plafonnent avant de s’effondrer. Nombre de ménages ne peuvent plus honorer des mensualités qui devaient augmenter avec le temps. Les biens immobiliers d’une partie des ménages insolvables sont saisis, ce qui entretient la chute des prix immobiliers. La majorité des pays ont été affectés par la crise de 2008, dite aussi « crise des subprimes ». Source : lefigaro.fr/economie 8 Seulement dix femmes ont siégé ou siègent à l’Académie française depuis sa création. Source : academie-francaise.fr 13 /
termes pour désigner la même posture : la volonté de faire bouger les lignes pour provoquer le changement. Ce livre est aussi une réponse aux éditorialistes, politiques et chroniqueur·euses en tout genre qui caricaturent notre génération, ses propos, ses valeurs et ses espoirs, mais aussi à celles et ceux qui abandonnent leurs responsabilités sur le dos de la jeunesse sur laquelle repose désormais l’avenir de notre monde. Génération woke, cancel culture, islamo-gauchiste, on entend sans cesse ces mots utilisés pour tenter de discréditer cette jeunesse engagée, qui veut repenser notre système, inventer de nouvelles dynamiques entre les êtres humains et le monde, mais surtout exige un monde plus respectueux de chacun·e. Certain·es font de nous une génération victimaire, plaintive, offensée, nombriliste, narcissique, fainéante, mais nous sommes en réalité l’exact opposé. Ces mêmes personnes tentent de discréditer nos témoignages, nos propos, nos combats et nos vécus en nous faisant passer pour des êtres qui ne parlent que sous le prisme de l’émotion. Mais comment ne pas agir ainsi quand nos vies sont en jeu ? Notre émotion et notre détermination sont à la hauteur des enjeux auxquels nous devons faire face. C’est précisément notre sensibilité qui nous fait être en prise directe avec le monde qui nous entoure et qui nous rend si concerné·es.
’ Notreemotionet notredetermination sontalahauteur desenjeuxauxquels nousdevonsfaireface. ’ ’
Une fois que vous aurez refermé ce livre, nous espérons que vous aurez, vous aussi, envie de créer un monde dans lequel la justice sociale et environnementale sera le point de départ de toute réflexion. Un monde où toute personne marginalisée pourra vivre en paix, en étant elle-même, sans craindre les institutions du pays dans lequel elle vit. Un monde qui sera connecté au vivant, un monde de reliance, d’accueil et de partage. Un monde où l’on aura compris que l’être humain est l’élément d’un écosystème bien plus grand que lui et que sa volonté de dominer la nature et la biodiversité ne nourrit que sa chute. Un monde d’adultes responsables qui arrêteront d’imaginer des politiques court-termistes privilégiant la réélection, le pillage des ressources et l’enrichissement rapide. Un monde qui remettra l’humain au cœur de tout, à la place du profit et où le concept de réussite sera d’être une personne vertueuse pour les autres. Un monde que nous pouvons co-créer et dans lequel nous pouvons tous et toutes agir.