AFRICAN UNION UNION AFRICAINE
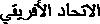
UMOJA WA AFRIKA

UNIÃO AFRICANA
UNIÓN AFRICANA
DÉPARTEMENT DE L’ÉDUCATION, DE LA SCIENCE, DE LA TECHNOLOGIE ET DE L’INNOVATION
Conférence panafricaine sur la formation des enseignants (PACTED) 2025 – Rapport
Thème: Promouvoir des stratégies pour la formation, la reconnaissance et le développement professionnel des enseignants.
Date: 1er – 3 octobre 2025
Lieu: Siège de l’Union africaine, Addis-Abeba, Éthiopie
Rapport de la conférence
Octobre 2025

1. INTRODUCTION
1.1 Contexte
La Conférence panafricaine sur la formation des enseignants (PACTED) 2025 a été organisée en tant qu’événement phare stratégique continental afin de placer la profession enseignante au cœur de la transformation éducative de l’Afrique. Reconnaissant le rôle déterminant des enseignants pour la réalisation des aspirations de l’Agenda 2063 de l’UA et de l’Objectif de développement durable 4 (ODD4 – Éducation de qualité), la PACTED 2025 a offert une plateforme essentielle pour s’attaquer aux défis persistants tels que la pénurie d’enseignants, une formation inadéquate, la faible motivation et une reconnaissance insuffisante.
La conférence a été positionnée de manière unique pour coïncider avec plusieurs initiatives majeures : le lancement officiel de la Décennie de l’Union africaine pour l’action accélérée en faveur de la transformation de l’éducation et du développement des compétences en Afrique (2025–2034), la célébration des Prix continentaux des enseignants de l’Union africaine 2025, le lancement de la plateforme de la Communauté de pratique (CoP) des enseignants, et la commémoration de la Journée mondiale des enseignants 2025. Ces événements ont collectivement souligné un engagement continental renouvelé à autonomiser les enseignants en tant que principaux agents du changement.
1.2 But et objectifs
La PACTED 2025 a été conçue pour catalyser des stratégies concrètes et favoriser une collaboration multipartite sous le thème « Promouvoir des stratégies pour la formation, la reconnaissance et le développement professionnel des enseignants ». Ses principaux objectifs étaient de:
1. Promouvoir des réformes pour renforcer les systèmes de formation des enseignants en alignant les politiques nationales sur les cadres continentaux (CESA 26–35, CTVET-34, STISA-34).
2. Renforcer les réseaux régionaux et le partage de connaissances grâce au lancement de la plateforme CoP des enseignants.
3. Promouvoir la reconnaissance, la valorisation et le développement professionnel des enseignants.
4. Favoriser la collaboration pour mobiliser des ressources et mettre en œuvre des stratégies éducatives intégrées.
5. Discuter des solutions aux défis cruciaux tels que la pénurie d’enseignants, l’égalité de genre et l’intégration des technologies.

2. DÉROULÉ ET POINTS CLÉS: JOUR 1 (1er OCTOBRE 2025)
2.1. Cérémonie d’ouverture et lancement de la Décennie de l’Éducationdel’UA
La conférence a débuté par une allocution de bienvenue prononcée par Mme Sophia Ashipala, Cheffe de la Division de l’Éducation (ESTI), qui a souligné la portée historique de cette rencontre, marquant la première fois que l’Union africaine se réunissait à une telle échelle pour définir les normes de la profession enseignante en Afrique.
Discours liminaires:
• S.E. Ayel Eshetu, Ministre d’État à l’Éducation, Éthiopie : a souhaité la bienvenue aux délégués et rappelé que l’éducation est la pierre angulaire du développement, les enseignants étant au cœur de cette mission. Elle a mis en avant les efforts déployés par l’Éthiopie, notamment une nouvelle politique de formation des enseignants touchant 100 000 enseignants. Elle a attiré l’attention sur la grave pénurie d’enseignants en Afrique, citant les projections de l’UNESCO selon lesquelles l’Afrique subsaharienne aura besoin de 15 million d’enseignants supplémentaires d’ici 2030, seuls 9 pays sur 46 étant en mesure de répondre à la demande d’enseignants du primaire.
• S.E. Perez, Ambassadeur de l’Union européenne auprès de l’Union africaine : a célébré la profession enseignante tout en reconnaissant les défis posés par les nouvelles technologies. Il a réaffirmé l’engagement de l’Union européenne en faveur de l’éducation en Afrique, annonçant un investissement additionnel de 150 million d’euros et se projetant vers le prochain Sommet UA-UE.
• S.E. Professeur Gaspard Banyankimbona, Commissaire de l’Union africaine pour l’Éducation, la Science, la Technologie et l’Innovation (ESTI) : a prononcé un discours inspirant, présentant les enseignants comme les « architectes du capital humain » et les « héros de l’économie du savoir ». Il a appelé à la mise en place d’un pacte continental visant à :
○ Revaloriser la profession enseignante par une rémunération équitable et un dialogue social constructif.
○ Promouvoir la mobilité des enseignants grâce au Cadre continental de qualification des enseignants (CTQF).
○ Soutenir les enseignants dans les contextes fragiles et d’urgence.
○ Instaurer une culture d’apprentissage tout au long de la vie pour les éducateurs.
Il a conclu sur un appel vibrant:« Lorsque nous investissons dans les enseignants, nous investissons dans les enfants de l’Afrique, dans l’économie de l’Afrique et dans la souveraineté de l’Afrique. »
Avant de déclarer officiellement la conférence ouverte.

2.2. Lancement symbolique de la Décennie et des cadres stratégiques
Mme Sophia Ashipala a présidé le lancement historique de plusieurs documents continentaux clés :
1. La Stratégie continentale de l’éducation pour l’Afrique (CESA 2026–2035): S’appuyant sur les réalisations antérieures, cette stratégie repose sur les piliers de l’apprentissage fondamental, de la professionnalisation des enseignants, du développement des compétences pour l’employabilité, de l’apprentissage numérique, ainsi que du renforcement de la gouvernance et du financement.
2. La Stratégie pour la science, la technologie et l’innovation en Afrique (STISA34): Un cadre visant à assurer le leadership de l’Afrique dans son propre agenda du savoir et de l’innovation.
3. Le Deuxième rapport continental sur la CESA et l’ODD4.
4. L’Initiative “Transformer le savoir pour l’avenir de l’Afrique”.
5. La Décennie de l’Union africaine pour l’action accélérée en faveur de la transformation de l’éducation et du développement des compétences (2025–2034): Lancée en tant que « cadre-parapluie », cette Décennie unifie l’ensemble des instruments continentaux dans un agenda cohérent et opérationnel, porté par un élan politique fort pour stimuler la transformation du continent africain.
2.3. Engagements des États membres et des partenaires
Une session modérée par le Prof. Saidou Madougou, Directeur du Département ESTI, a été marquée par des engagements concrets:
• Les États membres, à commencer par le pays hôte, l’Éthiopie, ont réaffirmé leur engagement à mettre en œuvre les cadres de la nouvelle Décennie.
• L’UNICEF a présenté six domaines d’appui prioritaires : l’élimination de la pauvreté des apprentissages d’ici 2035; l’innovation numérique; le développement des compétences des jeunes; le financement durable; l’éducation des filles; et le soutien à la mise en œuvre des politiques éducatives.
• L’UNESCO s’est engagée à poursuivre son partenariat étroit avec l’Union africaine et les États membres, en mettant l’accent sur la mise en œuvre de l’agenda de la CESA.
• Le HCR (UNHCR) a promis de se concentrer sur l’inclusion socio-économique des réfugiés et des personnes déplacées internes (PDI) à travers des programmes d’éducation de la seconde chance et d’apprentissage tout au long de la vie.
• L’Internationale de l’Éducation (IE) s’est engagée à plaider pour le droit de chaque enfant à l’éducation et à tenir les gouvernements responsables de la fourniture d’une éducation de qualité, inclusive, notamment pour les enfants en situation de handicap.
2.4. Groupes de travail – Transformer la formation des enseignants: innovation, équité, leadership

Les délégués ont participé à des sessions parallèles axées sur des thèmes essentiels.
Sessions du matin:
• Groupe A: Bonnes pratiques en enseignement et apprentissage en Afrique (Internationale de l’Éducation) – Modérée par le Dr Caseley Stephens du Département ESTI, cette session s’est concentrée sur la mise en œuvre d’une approche « apprendre en faisant » afin de garantir une éducation de qualité, adaptée aux contextes locaux. La discussion s’est appuyée sur les travaux du Panel des Enseignants et de l’Éducation concernant un cadre régional pour le développement des enseignants. Les principaux points à retenir incluent:
o La nécessité d’élaborer des normes d’enseignement généralisables, non spécifiques à un pays, afin d’orienter la conception des curricula et d’assurer des pratiques d’enseignement continues et efficaces.
o Le succès des cadres collaboratifs et complets qui vont au-delà du niveau national pour inclure les écoles, ayant déjà démontré des améliorations notables dans l’enseignement en classe.
o Une étape cruciale consiste à achever un cadre global pour l’apprentissage et à adapter les outils aux besoins spécifiques des pays, un élément essentiel pour l’apprentissage fondamental.
o L’Éthiopie a été citée en exemple pour son remarquable travail en matière de formation et d’accompagnement professionnel des enseignants, ayant abouti à des documents stratégiques définissant des plans d’action clairs.
o Le groupe a convenu de l’importance d’inscrire le développement professionnel dans l’ensemble de l’écosystème éducatif et de valoriser les cadres partagés entre les pays
o Recommandation: La prochaine étape clé consiste à créer un mécanisme d’assistance technique permettant aux pays de soumettre des demandes d’élaboration d’outils personnalisés et d’obtenir un appui d’une équipe dédiée.
• Groupe B: Façonner l’avenir de l’éducation à travers le curriculum (ESTI) –Également modérée par le Dr Caseley Stephens, cette session s’est penchée sur les aspects techniques de la conception des curricula et sur leur rôle central dans la structuration des concepts éducatifs. Il a été souligné qu’un curriculum est bien plus qu’un simple programme d’études : c’est l’outil fondamental guidant l’enseignement et l’apprentissage efficaces. La session a réaffirmé la nécessité pour les cadres curriculaires d’être à la fois visionnaires et adaptables aux contextes nationaux.

• Groupe C: Inclusion, leadership et égalité de genre (AU-CIEFFA) – La Directrice exécutive du Forum des éducatrices africaines (FAWE) a présenté des stratégies fondées sur des données probantes, notamment la pédagogie sensible au genre, les programmes de mentorat, la création d’espaces sûrs dans les écoles et la promotion de politiques soutenant l’éducation des filles et le leadership féminin.
• Groupe D: Leadership en éducation (UNESCO) – Les points clés ont souligné que le leadership éducatif doit être porteur de vision et de responsabilité, et non se limiter à l’administration. Les cadres doivent être accompagnés de dispositifs de mentorat et de soutien professionnel. Les pays ont été encouragés à établir des politiques de leadership scolaire et des cadres réglementaires pour les enseignants, y compris la délivrance de licences professionnelles.
• Groupe E: Autonomiser les enseignants pour mettre fin à la pauvreté des apprentissages (UNICEF) – La session a mis en évidence que les enseignants sont au cœur de la résolution de la crise de la pauvreté des apprentissages. Des études de cas, notamment les réformes du Ghana, ont montré que la formation collaborative en milieu scolaire améliore l’enseignement et les résultats d’apprentissage. Le manque d’enseignants qualifiés, particulièrement en développement de la petite enfance (DPE), a été noté, ainsi que la nécessité d’une formation en soutien psychosocial.
Sessions de l’après-midi: Transformer les politiques de formation des enseignants
• Session A: Harmoniser les cadres de qualification des enseignants à travers l’Afrique (ESTI) – Présentée sous le thème « accentuer les normes et la mobilité », cette session a exploré le Cadre continental de qualification des enseignants (CTQF). Dirigée par Mme Sophia Ashipala et comprenant des panélistes de l’UNESCO et d’institutions nationales, la discussion a mis en lumière:
o Défis: Un paysage marqué par la fragmentation des cadres nationaux, la mobilité limitée des enseignants et des lacunes dans la préparation et la certification des enseignants, entravant la libre circulation des éducateurs à travers le continent.
o Vision: L’établissement d’un système cohérent de reconnaissance mutuelle des qualifications afin de renforcer la mobilité, d’éliminer les pénuries d’enseignants et d’assurer un développement professionnel continu, y compris en compétences numériques. Le cadre est perçu comme un levier de confiance continentale.
o Voie à suivre : Une feuille de route claire de mise en œuvre a été présentée, soulignant que le succès dépend d’un engagement fort des États membres et des organismes régionaux. Le Prof. Saidou

Madougou a réaffirmé que l’UA travaille à la création d’une agence continentale chargée de normaliser et de reconnaître les qualifications des enseignants, passant ainsi de la politique à la pratique
• Session B: Renforcer les programmes de préparation des enseignants : innovations et bonnes pratiques (UNESCO-IICBA) – Cette session a déplacé l’attention vers le rôle de l’enseignement supérieur dans le développement des enseignants. La discussion s’est structurée autour de cinq axes clés :
o Harmonisation des curricula: Élaboration de cadres pour garantir une éducation de qualité dans les institutions académiques et professionnelles.
o Collaboration transfrontalière: Exploiter les communautés régionales et partager les ressources entre institutions.
o Développement de politiques numériques: Former le personnel académique aux programmes numériques afin de contextualiser les processus réels.
o Renforcement de la qualité de l’éducation: Un processus nécessitant une approche régionale, y compris l’établissement de programmes de mobilité des étudiants entre universités africaines.
o Recherche, innovation et partenariats: Appel à la définition d’un agenda de recherche et à l’utilisation des TIC pour établir des bonnes pratiques et évaluer les institutions.
• Session C: Façonner l’avenir de l’enseignement en Afrique: politiques, pratiques et partenariats (AFTRA) – Cette session a permis une analyse approfondie de la mise en œuvre des politiques. Une présentation clé de la Dr Ann Rita a souligné que l’harmonisation ne se limite pas à la normalisation, mais vise à bâtir un continent de confiance et une plateforme pour le développement des compétences des enseignants. Cela se traduirait par:
o La promotion de programmes académiques conjoints et collaboratifs.
o L’expansion des programmes d’échange d’enseignants.
o La réalisation d’études de cas conjointes et de recherches pour documenter les réussites et identifier les lacunes.
o La création de pôles de recherche à travers le continent. Un exemple de la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) a été présenté, illustrant comment un cadre juridique et le Protocole du Marché Commun sont utilisés pour la reconnaissance mutuelle des qualifications académiques, l’harmonisation des curricula et la mobilité des enseignants dans huit États partenaires.
• Session D: Renforcer la formation initiale et continue des éducateurs de la petite enfance (AfECN) – Cette session a abordé la base essentielle de l’éducation de la petite enfance (EPE). La discussion a mis l’accent sur la

nécessité de passer des cadres théoriques à l’application pratique. Les points clés incluent:
o Un appel à l’action pour traduire les discussions de haut niveau sur la paix, l’unité et la collaboration en mesures concrètes pour les enseignants d’EPE sur le terrain.
o L’importance de surmonter les obstacles pratiques tels que les barrières linguistiques et les différences contextuelles afin de favoriser une approche collaborative à l’échelle du continent.
o L’impératif de garantir la mise en œuvre effective des politiques et des programmes de formation dans les salles de classe pour construire une base solide pour les plus jeunes apprenants d’Afrique.
• Session E : Financement de l’éducation et des enseignants (IE, CME & Action Aid) – Cette session a mis en lumière une situation de financement critique: l’Afrique ne consacre que 3,5 % de son PIB à l’éducation tout en faisant face à une crise de la dette. Il a été souligné que les infrastructures ne suffisent pas sans enseignants qualifiés. La dépendance excessive à une aide étrangère fragmentée et en déclin souligne la nécessité de mobiliser des ressources internes. Les recommandations incluent : faire de l’éducation une priorité budgétaire claire et adopter une approche holistique du financement des enseignants couvrant les salaires, la formation et le recrutement, et non uniquement les infrastructures.
3. CONCLUSION ET RÉSULTATS ATTENDUS
La première journée de la PACTED 2025 a fixé un ton ambitieux et puissant pour la conférence et la Décennie à venir. Le lancement officiel des cadres stratégiques a tracé une feuille de route claire, tandis que les engagements de haut niveau des États membres et des partenaires ont révélé une volonté politique partagée.
Les discussions ont cristallisé plusieurs priorités cruciales pour la profession enseignante en Afrique:
1. Action urgente contre la pénurie d’enseignants: grâce à des cadres harmonisés et une mobilité accrue.
2. Accompagnement holistique des enseignants: au-delà des salaires, incluant santé mentale, DPC (développement professionnel continu) et bonnes conditions de travail.
3. Financement comme pierre angulaire : besoin d’investissement national accru et d’un usage mieux aligné des ressources.
4. Équité et inclusion: intégrer la pédagogie sensible au genre et l’inclusion au cœur de la formation et des politiques.

L’élan généré a posé des bases solides pour les jours suivants dédiés au renforcement des capacités, à la célébration des enseignants et à la formulation d’un plan d’action concret.
2. DÉROULÉ ET POINTS CLÉS: JOUR 2 (2 OCTOBRE 2025)
2.1. Récapitulatif du Jour 1 et introduction du Jour 2
Ouverture par Prof. Bolanle Akoredolu-Ale, Vice-rectrice de l’Université panafricaine (UPA/PAU). Elle a souligné que le Jour 1 a créé une dynamique forte pour une décennie d’action, ancrée dans le lancement de la Décennie de l’Éducation de l’UA et des cadres stratégiques, soutenue par un leadership politique fort et des engagements multipartites. Les échanges interconnectés sur l’innovation, l’équité, le leadership et le financement constituent un socle robuste. Elle a indiqué que le Jour 2 passerait « de la vision à la pratique et à la mise en œuvre », en mettant l’accent sur des outils concrets, l’amplification de la voix des enseignants, et les enjeux de développement professionnel et de bien-être.
2.2. Lancement de la plateforme de la Communauté de pratique (CoP) des enseignants
Présidence : Mme Sophia Ashipala, Cheffe de la Division Éducation (ESTI), et un consultant technique.
Session consacrée au lancement officiel et à la démonstration en direct de la plateforme continentale CoP des enseignants (https://africateachers.org/), initiative numérique phare destinée à connecter, autonomiser et amplifier la voix des enseignants africains.
Mme Ashipala a exposé la vision stratégique : créer un espace numérique dynamique facilitant la mobilité transfrontalière des enseignants, développant une communauté de pratique vivante, et servant de référentiel central de connaissances et de ressources. Le consultant Mich Seth a réalisé une démonstration, mettant en évidence les fonctionnalités clés :
• Multilinguisme : disponibilité en toutes langues officielles de l’UA (anglais, français, arabe, portugais, swahili) et langues africaines supplémentaires (haoussa, amharique), avec traduction en temps réel par l’IA pour garantir l’accessibilité.
• Hub des initiatives des enseignants : espace dédié pour publier des articles et partager des expériences en classe, alimenté initialement par 150+ contributions issues des Prix des enseignants de l’UA.

• Bibliothèque de ressources politiques: référentiel complet des politiques, cadres et normes professionnelles (continentaux, mondiaux, nationaux), à l’usage des décideurs et praticiens.
• Fonctionnalités interactives et de formation: section commentaires et intégration de Moodle pour héberger des cours de formation et de développement professionnel.
Points clés :
• La plateforme se veut un portail vivant pour tous les acteurs de l’éducation, avec les enseignants au centre.
• Son succès dépend d’une génération continue de contenus et de la participation active des enseignants du continent.
• Des partenariats stratégiques avec les ministères, les institutions de formation et les partenaires au développement sont cruciaux pour alimenter la bibliothèque et promouvoir l’adoption.
Suggestions des participants:
• Assurer une sécurité robuste des informations publiées.
• Intégrer des vidéos et ressources audio de bonnes pratiques.
• Créer des clusters par discipline pour une collaboration ciblée.
• Organiser des rencontres virtuelles régulières entre enseignants.
• Mettre en place un processus de validation des articles soumis par les utilisateurs.
• Traiter les défis d’accessibilité dans les zones rurales à connectivité limitée.
2.3. Panel 1: « Autonomiser les enseignants d’Afrique : innovation numérique, normes et communautés »
Modération: Dr Gertrude Namibiru, African Curriculum Association (ACA).
Résumé: le panel a exploré l’écosystème intégré nécessaire pour autonomiser les enseignants, en s’attachant aux rôles synergiques des outils numériques, des pratiques fondées sur les données, des communautés professionnelles, des normes d’enseignement et du soutien des communautés.
Intervenants et points clés:
• AU-IPED (Exploiter les outils numériques): mise en évidence d’un écart significatif dans la disponibilité et l’usage des outils numériques en Afrique ; seuls 3 % des pays d’Afrique subsaharienne disposent d’une stratégie nationale d’éducation numérique. Besoin urgent d’aligner curriculum et qualifications des enseignants pour une intégration efficace.
• ADEA (Utiliser les données pour améliorer les pratiques) : déficit de littératie des données aux niveaux national et scolaire, limitant l’identification des

problèmes et l’ajustement des pratiques. Les données relient politiques et pratiques, renforcent la redevabilité et aident les enseignants à suivre les progrès des élèves. Appel à des tableaux de bord conviviaux et à des espaces d’apprentissage entre pairs sur l’usage des données.
• Université panafricaine (Construire des communautés efficaces via la CoP) : la Vice-chancelière, Prof. Bolanle Akoredolu-Ale, a présenté des initiatives, dont un partenariat avec l’UNESCO-IICBA pour autonomiser les enseignantes et cheffes d’établissement dans cinq pays via l’apprentissage mobile. Les communautés de pratique réduisent l’isolement, favorisent le partage et la résilience (preuve éclatante durant la COVID-19).
• AFTRA (Établir et appliquer des normes d’enseignement) : les normes sont essentielles pour guider la pratique et la qualité. Rôle clé des Conseils nationaux de l’enseignement et nécessité d’un organe continental renforcé pour harmoniser les normes et faciliter la mobilité.
• UNICEF (Rôle de la communauté et de la famille): la participation communautaire accroît la scolarisation et la qualité. L’implication des familles et des communautés contextualise l’éducation, répond aux défis spécifiques et crée un écosystème favorable aux enseignants et aux apprenants.
2.4. Panel 2: « La voix des enseignants – défis et opportunités »"
Modération: Dr Dennis Sinyolo (Education International, EI) / Dr Caseley Stephens (ESTI).
Résumé: session puissante donnant directement la parole aux représentants syndicaux de tout le continent. Thème transversal: besoin critique d’un dialogue social substantiel et d’une implication réelle des enseignants à toutes les étapes des politiques.
Intervenants – Points clés par pays/organisations:
• Education International (EI): cadre plaidant pour institutionnaliser le dialogue social: bases juridiques claires, politiques harmonisées, égalité salariale, participation directe des enseignants à l’élaboration des politiques.
• Éthiopie: pénurie critique et nécessité d’autonomiser les enseignants comme condition de la qualité.
• Soudan du Sud & Tchad: difficultés des leaders syndicaux (manque de soutien, faible écoute). Le Tchad a noté des avancées (indemnités zones reculées) mais des obstacles structurels et un déficit de capacités au dialogue persistent.
• Nigeria: les enseignants doivent être impliqués dès l’amont des décisions (ex. révision récente du curriculum).
• Ouganda: difficultés marquantes : très faible salaire (1/127 de celui d’un député), ratio maître-élèves jusqu’à 1:300 en classes inférieures, mise en

œuvre défaillante, carrières limitées, DPC insuffisant. Appel à utiliser les syndicats comme partenaires de mise en œuvre.
• Kenya: avancées (recrutement de 36 000 enseignants, requalification pour un nouveau curriculum), mais déficit de 72 000 enseignants au collège inférieur, infrastructures insuffisantes, retards dans la titularisation des stagiaires. Recommandation : ressources accrues pour requalification continue, recrutement et motivation.
• Zimbabwe: existence d’un dialogue social formel et informel, mais souvent descendant (décisions prises avant consultation). Appréciation de la politique de porte ouverte du ministère ; recommandation d’une plateforme de dialogue permanente, inclusive et durable.
2.5. Sessions parallèles de l’après-midi: développement professionnel, santé et motivation des enseignants
Session A: Apprentissage numérique et formation des enseignants (UNICEF)
Résumé: politiques et pratiques pour intégrer l’apprentissage numérique dans la formation. Contributions de l’UNESCO, de la Fondation Gates et du Ministère de l’Éducation du Malawi: papier de cadrage sur l’intégration technologique, importance du coaching personnalisé, cadre national de compétences numériques. Exemples du Nigeria, de la Sierra Leone et de l’Ouganda sur des initiatives numériques évolutives.
Points clés:
• Les gouvernements doivent accroître et prioriser l’investissement dans l’apprentissage numérique des enseignants.
• Le numérique et l’IA sont indispensables et doivent travailler avec et pour les enseignants, en faisant d’eux des champions de la pédagogie numérique.
• Les solutions doivent être abordables, actionnables et simples d’usage dans des contextes divers.
• Les modèles d’entraide entre pairs et les capacités hors-ligne sont essentiels pour l’échelle et l’inclusion.
Session B: Santé mentale et soutien psychosocial (MHPSS) pour les enseignants (UNESCO-IICBA)
Résumé: intégration du MHPSS dans la formation et les politiques. Présentations du Burkina Faso, de la Tanzanie, du Kenya et du Soudan du Sud; lien direct entre bienêtre des enseignants et résultats éducatifs.
Points clés:
• La stratégie MHPSS de l’UA fournit un cadre vital pour des enseignants et communautés scolaires résilients.

• La formation MHPSS améliore la relation enseignant-élève et l’environnement d’apprentissage, y compris pour les apprenants déplacés.
• Défis: faibles salaires, conflits, déplacements.
• Engagement gouvernemental de haut niveau et participation communautaire indispensables pour une intégration réussie.
Session C: Politiques de recrutement et de rétention (AFTRA)
Résumé: politiques innovantes pour attirer et retenir des enseignants qualifiés. Ghana et Botswana: recrutement ciblé, crédits de DPC, incitations rurales, amélioration des conditions de travail.
Points clés:
• Des parcours de carrière clairs retiennent les experts en classe et évitent la fuite vers des postes administratifs.
• Les contraintes financières et la hausse de la masse salariale peuvent freiner des modèles viables.
• La mobilité transfrontalière, facilitée par des cadres continentaux, peut équilibrer surplus et pénuries nationales.
• Impliquer les syndicats dans la conception des politiques évite les conflits et renforce l’adhésion
Session D: Améliorer le statut des enseignants de la petite enfance (AfECN)
Résumé: défis spécifiques : faible statut, rémunération insuffisante, manque de reconnaissance professionnelle.
Points clés :
• Défis communs: gouvernance faible, qualité de formation variable, pénurie critique de données.
• Recommandations: harmoniser la reconnaissance professionnelle des enseignants de la petite enfance, améliorer nettement les conditions de travail, impliquer activement communautés et parents.
• Un financement durable et une collaboration multipartite sont essentiels pour renforcer tout le secteur.
Session E : DPC pour la pédagogie sensible au genre (FAWE)
Résumé: stratégies pour intégrer la pédagogie sensible au genre (PSG/GRP) dans la formation initiale et continue.
Points clés:
• La PSG doit être un noyau pratique et flexible de la formation initiale/continue.

• Établir des normes claires pour les Écoles normales/Universités sur la PSG est crucial pour l’assurance qualité.
• Partenariats solides avec universités, communautés et société civile pour financer, mettre en œuvre et pérenniser.
• Former les enseignants à identifier, prévenir et traiter les violences basées sur le genre.
2.6. Plénière et clôture de la journée
La journée s’est conclue par une plénière où les rapporteurs de chaque groupe ont présenté une synthèse des constats et recommandations. Les contributions sur le numérique, la santé mentale, les politiques de recrutement, l’éducation de la petite enfance et la pédagogie sensible au genre ont été consolidées pour alimenter directement le futur cadre continental de politique de formation des enseignants. La clôture a réaffirmé l’engagement collectif à convertir ces débats en actions concrètes et collaboratives, préparant le terrain pour le troisième jour de célébration et d’adoption des résultats.
3. DÉROULÉ ET POINTS CLÉS: JOUR 3 (3 OCTOBRE 2025)
3.1. Célébrer la profession enseignante: Journée mondiale des enseignants & Prix continentaux
Le Jour 3 a été consacré à une double célébration : la commémoration officielle de la Journée mondiale des enseignants 2025 et la remise des Prix continentaux des enseignants de l’Union africaine. La journée a souligné le lien fondamental entre hommage à l’excellence et réinvention de la profession.
A. Cérémonie historique de la Journée mondiale des enseignants
Cérémonie inédite : pour la première fois, les agences co-organisatrices des Nations Unies (UNESCO, OIT, UNICEF, Education International) ont tenu la célébration mondiale hors de Paris, dans le cadre de la PACTED.
• Message conjoint des agences: déclaration unifiée sur le thème « Réimaginer l’enseignement comme une profession collaborative ». Constat de la crise mondiale des enseignants: besoin de 44 millions d’enseignants supplémentaires d’ici 2030 pour l’éducation universelle et doublement des taux d’attrition. Appel à un changement de paradigme reposant sur trois piliers :
o Formation collaborative: apprentissage entre pairs, co-enseignement, mentorat au cœur de la formation initiale et continue;

o Technologies: outils numériques collaboratifs pour relier les éducateurs par-delà les distances et disciplines;
o Décision inclusive: intégration des enseignants dans l’élaboration des politiques et le leadership scolaire via un dialogue social robuste.
• Interventions clés:
o Représentant de l’UNESCO : nécessité d’une « mutation radicale » –passer de l’acte isolé à une force collective; les crises (climat, fracture numérique) exigent des réponses systémiques.
o Directeur UNICEF (Widu): engagement en trois volets: partenariat avec les ministères; production de nouvelles preuves pour la pratique; apprentissage entre pairs et plateformes numériques pour la collaboration transfrontalière.
o Président d’Education International: appel fort à rendre contraignantes les recommandations du Groupe de haut niveau de l’ONU afin de garantir salaire juste, autonomie professionnelle et bien-être. Il a affirmé l’irremplaçabilité des enseignants par la technologie : « Aucune application ne peut détecter l’étincelle de compréhension dans le regard d’un enfant », plaidant pour des systèmes éducatifs porteurs de liberté, de justice et de paix, guidés par le principe d’Ubuntu.
B. Prix continentaux des enseignants de l’Union africaine
La cérémonie a honoré des éducateurs exemplaires venus de tout le continent, réaffirmant la valeur de la profession.
• Discours du Commissaire de l’UA pour l’ESTI (Prof. Gaspard): félicitations aux lauréats, qualifiés de « phares pour des millions d’éducateurs »; réaffirmation de l’engagement de l’UA à porter des initiatives investissant dans les enseignants. Annonce significative: l’UA explorera la création d’un Prix rural/continental pour honorer spécifiquement les enseignants servant dans les zones reculées, défavorisées et à risque.
• Remise des prix: modérée par Mme Sophia. Neuf lauréats ont été distingués ; chacun a reçu 10 000 $, et cinq seront sélectionnés pour 2 000 $ supplémentaires. Annonce d’un nouveau partenariat avec Humana People to People pour répondre au besoin aigu d’enseignants qualifiés en milieu rural.
3.2. « De l’isolement à la force collective »
Panel de haut niveau, modéré par Prof. Saidou, sur l’état des politiques éducatives et de la collaboration en Afrique.
Aperçus par pays:
• Gambie: comités de coordination (CCM) réunissant enseignants, parents et parties prenantes pour retours et co-construction; collaboration étroite avec le

syndicat sur les documents de politique; introduction de bulletins et de programmes de mentorat.
• Nigeria: communautés d’apprentissage partagées où les enseignants expérimentés encadrent les nouveaux; le ministère organise des formations et partage l’information; reconnaissance des enseignants via prix et célébrations.
Organisations internationales:
• Education International: obstacles à la collaboration: compétition entre enseignants, surcharges de classe, charge de travail élevée, manque de structures de soutien. Proposition de la stratégie des « Trois P » :
1. Planifier: impliquer les enseignants à toutes les étapes (« Rien pour nous sans nous »);
2. Payer: garantir un financement adéquat des initiatives collaboratives;
3. Performer: passer des débats à l’action concrète.
• UNESCO: la collaboration doit s’étendre au-delà des enseignants pour inclure experts et communautés, et requiert un leadership politique fort et un plaidoyer soutenu pour des changements systémiques.
• UNICEF: interventions collaboratives pratiques: coaching entre pairs, lesson study, apprentissages par le jeu, initiatives inclusives pour les enfants et les enseignants en situation de handicap.
3.3. Recommandations de politique et clôture
La conférence s’est conclue par une session axée sur les résultats opérationnels.
• Présentation des recommandations: Mme Sophia a présenté le communiqué et les recommandations de politique, synthèse des délibérations des trois jours
• Remarques de clôture par le Prof. Saidou: la PACTED 2025 a été un formidable catalyseur d’engagement, mettant en lumière la résilience des enseignants africains. Trois impératifs:
1. Engagement des États membres: adopter et mettre en œuvre les stratégies continentales lancées (CESA, etc.);
2. Collaboration multipartite: entre gouvernements, partenaires et enseignants;
3. Investissement durable: dans l’enseignement (formation, rémunération, conditions de travail).

Appel final à convertir la célébration en action pérenne afin que chaque enseignant en Afrique soit valorisé, soutenu et autonomisé.
4. CONCLUSION GLOBALE DE LA CONFÉRENCE ET RÉSULTATS ATTENDUS
La PACTED 2025 a pleinement joué son rôle d’événement phare, catalysant un élan continental autour de la profession enseignante. La conférence a atteint ses objectifs centraux en:
1. Lançant une Décennie d’action: l’inauguration officielle de la Décennie UA de l’Éducation et du Développement des compétences (2025-2034) et de la CESA 2026-2035 offre une feuille de route unifiée et opérationnelle pour le continent.
2. Renforçant la collaboration: consolidation des réseaux régionaux et des partenariats multi-acteurs, illustrée par l’engagement de haut niveau lors de la Journée mondiale des enseignants et par les discussions substantielles des panels.
3. Portant la voix des enseignants: promotion forte de la reconnaissance et de la valorisation des enseignants, à travers les Prix continentaux et une focalisation constante sur le développement professionnel, la rémunération équitable et de meilleures conditions de travail.
4. Générant des stratégies actionnables: les ateliers et panels ont produit des recommandations claires sur des domaines critiques tels que l’harmonisation des qualifications, le financement, l’équité de genre et l’exploitation des technologies.
Résultat attendu: un effort collectif, renouvelé et durable de l’ensemble des parties prenantes gouvernements, partenaires internationaux, syndicats et enseignants pour traduire les cadres, engagements et stratégies discutés en politiques et programmes tangibles, permettant aux enseignants d’Afrique de devenir les véritables architectes d’un avenir prospère et durable, en ligne avec l’Agenda 2063.
