À CŒUR OUVERT
La retraite un mercredi midi
GESTION
La colère est-elle appropriée au travail ?
DROIT
Pharmacien en tout lieu et en tout temps ?

La retraite un mercredi midi
La colère est-elle appropriée au travail ?
Pharmacien en tout lieu et en tout temps ?
SUR LES CONSEILS ET RECOMMANDATIONS
Prise en charge de l’insomnie chronique en première ligne : introduction à la thérapie comportementale brève
LE PREMIER ET SEUL ANTAGONISTE NON HORMONAL DE LA NEUROKININE B (NKB)
INDIQUÉ POUR LE TRAITEMENT DES SYMPTÔMES
VASOMOTEURS ASSOCIÉS À LA MÉNOPAUSE1-3*.

ANTAGONISTE NON HORMONAL* DE LA NKB
VEOZAH (comprimés pelliculés de fezolinetant) est indiqué pour le traitement des symptômes vasomoteurs (SVM) modérés à sévères associés à la ménopause1
VEOZAH a obtenu des réductions statistiquement significatives de la fréquence des symptômes vasomoteurs modérés à sévères entre le début de l’étude et la semaine 12 (p < 0,001; paramètres d’évaluation principaux conjoints) par rapport au placebo1† Réduction de 63,5 % de la fréquence des symptômes vasomoteurs modérés à sévères par 24 heures avec VEOZAH par rapport à 43,1 % avec le placebo (variation moyenne par rapport aux valeurs initiales, calculée selon la MMC : -7,5 par rapport à -5,0 respectivement).
Utilisation clinique :
• Enfants (moins de 18 ans) : non indiqué.
• Personnes âgées (≥ 65 ans) : aucune donnée n’est disponible; par conséquent, aucune indication n’a été recommandée.
Contre-indications :
• Cirrhose avérée
• Insuffisance rénale sévère ou terminale
• Patientes qui utilisent de façon concomitante des inhibiteurs modérés ou puissants du CYP1A2
• Grossesse avérée ou présumée
Mises en garde et précautions pertinentes :
• Incidence sur d’autres affections malignes;
• Considération du rapport risque/bénéfice pour le traitement des femmes atteintes d’un cancer du sein avéré ou antérieur ou d’autres affections malignes œstrogénodépendantes;
• Risque d’hyperplasie endométriale et de carcinome endométrial;
MMC : méthode des moindres carrés.
* La portée clinique comparative est inconnue.
• Non recommandé en cas d’insuffisance hépatique chronique modérée (classe B de Child-Pugh); non étudié en cas d’insuffisance hépatique chronique sévère (classe C de Child-Pugh) et non recommandé pour cette population;
• Risque d’élévation des transaminases hépatiques et d’hépatotoxicité;
• Effectuer des analyses sanguines de base pour évaluer la fonction hépatique et vérifier l’absence de lésions (y compris les taux sériques d’alanine aminotransférase [ALT], d’aspartate aminotransférase [AST], de phosphatase alcaline [PA] et de bilirubine [totale et directe]), avant de commencer le traitement par VEOZAH. Effectuer des analyses de laboratoire hépatiques tous les mois pendant les 3 premiers mois, à 6 mois et à 9 mois après l’instauration du traitement;
• Non recommandé aux femmes qui allaitent.
Pour plus d’information : Consultez la monographie du produit à l’adresse www.veozahmonographie.ca pour obtenir des informations importantes sur les effets indésirables, les interactions médicamenteuses et la posologie. Vous pouvez également obtenir la monographie du produit en appelant le 1-888-338-1824.
† SKYLIGHT 2 était une étude de phase 3 à double insu, à répartition aléatoire, contrôlée par placebo, à groupes parallèles, dans laquelle des femmes ayant atteint la ménopause ont été réparties aléatoirement entre deux groupes : VEOZAH à 45 mg (n = 167) et un placebo (n = 167) une fois par jour pendant 12 semaines. Après la période de traitement à double insu de 12 semaines, toutes les patientes ont reçu du fezolinetant pendant une période de prolongation de 40 semaines. Les femmes participantes sous placebo ont été re-randomisées dans le groupe VEOZAH afin d’en évaluer l’innocuité pour un total de 52 semaines d’exposition. La population des études comprenait des femmes ayant atteint la ménopause présentant une moyenne minimale de 7 symptômes vasomoteurs modérés à sévères par jour. Les paramètres d’évaluation principaux conjoints de l’efficacité étaient la variation de la fréquence et de la sévérité des symptômes vasomoteurs modérés à sévères entre le début de l’étude et les semaines 4 et 12. Fréquence moyenne des symptômes vasomoteurs modérés à sévères sur 24 h au début de l’étude : 11,8 avec VEOZAH, 11,6 avec placebo1
RÉFÉRENCES : 1. Monographie de VEOZAH. Markham, ON : Astellas Pharma Canada, Inc. 2. The North American Menopause Society (NAMS). Menopause. 2023;30(6):573-590. 3. Données internes. Astellas Pharma Canada, Inc. 4.Yuksel N, Evaniuk D, Huang L, et al. Directive clinique no 422a : Ménopause : symptômes vasomoteurs, agents thérapeutiques d’ordonnance, médecines douces et complémentaires, nutrition et mode de vie. J Obstet Gynaecol Can. 2021 Oct;43(10):1188-1204.e1.
Toutes les marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
© 2025 Astellas Pharma Inc. ou ses sociétés affiliées.
MAT-CA-VEO-2025-00047 03/25
CP 83621, Montréal QC H2J 4E9 1 877 687-7321 n téléc. 1 888 889-9522 n www.professionsante.ca
GESTION DE LA MARQUE
PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE, CANADA, GROUPE SANTÉ
Donna Kerry 416 786-6315 dkerry@ensembleiq.com
ÉDITORIAL
RÉDACTEUR EN CHEF ET ÉDITEUR ADJOINT
Christian Leduc n cleduc@ensembleiq.com
RÉDACTRICE EN CHEF ADJOINTE
Aude Boivin Filion n abfilion@ensembleiq.com
JOURNALISTES
Anaïs Bouitcha n abouitcha@ensembleiq.com
Geoffrey Dirat n gdirat@ensembleiq.com
RÉVISION LINGUISTIQUE
Sylvie Gourde
COLLABORATEURS
Christophe Augé, pharmacien
Lyne Beausoleil, conseillère en ressources humaines
Line Blackburn, conseillère en ressources humaines
Mélanie Carrier, pharmacienne
Marie-Hélène Dufays-Marinescu, journaliste
Paul Fernet, avocat et pharmacien
Rachel Fournier, conseillère en ressources humaines
Lu-Ann Murdoch, pharmacienne
Laurie Noreau, journaliste
COMITÉ DE RÉDACTION
PROFESSION SANTÉ
Christophe Augé, pharmacien
Guylaine Bertrand, pharmacienne
Christine Larivière, pharmacienne
Céline Léveillé-Imbeault, pharmacienne
Mathieu Pelletier, médecin
Geneviève Tirman, pharmacienne
MEDACTUEL
Johanne Blais, médecin
Roger Ladouceur, médecin
Diane Poirier, médecin
VENTES ET PUBLICITÉS
DIRECTEURS DE COMPTES
Norman Cook 647 290-3967 ncook@ensembleiq.com
Scott Tweed n 416 230-4315 n stweed@ensembleiq.com
GESTIONNAIRE DES PROJETS
Tiffany Kim n tkim@ensembleiq.com
COORDONNATRICE, VENTES ET ÉDITORIAL
Sylvie Graveson 514 805-0634 sgraveson@ensembleiq.com
CONCEPTION/PRODUCTION/MARKETING
DIRECTRICE, CRÉATION
Nancy Peterman n npeterman@ensembleiq.com
DIRECTEUR ARTISTIQUE
Dino Peressini n dperessini@ensembleiq.com
GESTIONNAIRE DE LA PRODUCTION
Lisette Pronovost n lpronovost@ensembleiq.com
GESTIONNAIRE DU MARKETING
Aline Kirimli akirimli@ensembleiq.com
SERVICE DES ABONNEMENTS
Questions relatives à l’abonnement contact@professionsante.ca
ABONNEMENT IMPRIMÉ
Canada 118 $ par an, 15,40 $ l’exemplaire. ABONNEMENT NUMÉRIQUE
68 $ par an, 111 $ pour deux ans POUR NOUS LIRE EN LIGNE
Profession Santé se trouve sur le site sécurisé ProfessionSante.ca (inscription gratuite). Site accessible aux professionnels de la santé, aux étudiants en médecine et en pharmacie, ainsi qu’aux résidents.
DIRIGEANT(E)S
PRÉSIDENTE ET CHEFFE DE LA DIRECTION Jennifer Litterick
PREMIÈRE DIRECTRICE, FINANCES Jane Volland
PREMIÈRE DIRECTRICE, RESSOURCES HUMAINES Ann Jadown
CHEF DES OPÉRATIONS Derek Estey
Profession Santé est publié 7 fois par an par EnsembleIQ. Le contenu du magazine ©2025 par Stagnito Partners Canada Inc. ne peut pas être reproduit sans autorisation. Profession Santé reçoit de temps à autre des commentaires et des documents (y compris des lettres à l’éditeur) non sollicités. Profession Santé, ses sociétés affiliées et cessionnaires peuvent utiliser, reproduire, publier, rééditer, distribuer, garder et archiver ces soumissions, en tout ou en partie, sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit, sans aucune rémunération de quelque nature. Dépôt légal : Bibliothèque du Québec – 1980, Bibliothèque du Canada –1980, ISSN 0229-9429, Convention de la poste-publication N° 42940023
Y a-t-il vraiment un « choc des générations » ? 7 BRÈVES
L’indomptable Mammouth – Réflexions sur le système de santé au Québec
Hormonothérapie et santé urinaire des femmes : un lien complexe 11
Dr Thierry Petry – La retraite un mercredi midi 16

Urgence climatique – « Votre voix, votre engagement, peuvent faire la différence » 23
11 23
16

Ce que les patrons attendent vraiment de la relève Dans la peau (et le cerveau) d’un patron médecin
Portrait de la relève idéale en pharmacie
2025
SUR LES CONSEILS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE

49
Prise en charge de l’insomnie chronique en première ligne : introduction à la thérapie comportementale brève
Nouveaux produits, nouvelles indications et avis de Santé Canada
La colère est-elle appropriée au travail ?
Contribution stratégique unique – Un levier essentiel dans un milieu en transformation
Pharmacien en tout lieu et en tout temps ?

PrREXULTIMD est indiqué en appoint à des antidépresseurs pour le traitement du trouble dépressif majeur (TDM) chez les adultes ayant obtenu une réponse inadéquate aux traitements antérieurs avec des antidépresseurs prescrits pour l’épisode dépressif en cours3 .
COMME OPTION DE TRAITEMENT D’APPOINT DE 1,2*
Pour les patients ayant obtenu une réponse inadéquate au traitement antidépresseur pour l’épisode de TDM en cours
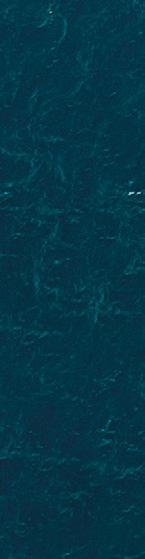




Les lignes directrices 2023 du CANMAT recommandent d’envisager sans délai une option d’appoint en cas de réponse insu sante au premier ou au deuxième antidépresseur utilisé1

Usage clinique :
Découvrez les médicaments d’appoint recommandés en première ligne contre le TDM dans les lignes directrices du CANMAT
Lorsqu’il considère le recours à REXULTI à titre de traitement d’appoint du TDM, le clinicien doit tenir compte des préoccupations relatives à l’innocuité associées aux antipsychotiques, qui constituent la classe de médicaments à laquelle REXULTI appartient. Les préoccupations relatives à l’innocuité de cette classe de médicaments comprennent : le gain pondéral; l’hyperlipidémie; l’hyperglycémie; la dyskinésie tardive et le syndrome malin des neuroleptiques. REXULTI ne devrait être prescrit à des patients atteints de TDM que par des cliniciens qui ont de l’expérience dans le dépistage précoce et la prise en charge des problèmes d’innocuité associés à cette classe de médicament et qui en connaissent l’importance.
L’e cacité et l’innocuité de REXULTI dans le traitement d’appoint du TDM ont été démontrées lors d’essais contrôlés par placebo de 6 semaines menés à double insu chez des patients adultes. On ignore donc la durée requise du traitement d’appoint par REXULTI. Lorsque REXULTI est prescrit en association avec des antidépresseurs pour traiter un TDM, ce doit être pour la période la plus brève qui est cliniquement indiquée. On ignore si l’e cacité de ce produit dans le cadre du traitement d’appoint est attribuable à REXULTI seulement ou si elle est le résultat du traitement d’appoint à un antidépresseur.
• L’innocuité et l’e cacité de REXULTI n’ont pas été évaluées de manière systématique chez les patients de 65 ans et plus atteints de TDM. Il faut administrer ce médicament avec prudence chez les patients âgés. • REXULTI n’est pas indiqué chez les enfants (de moins de 18 ans) et n’est pas recommandé chez ces derniers.
Mises en garde et précautions les plus importantes : Mortalité accrue chez les patients âgés atteints de démence : Les patients âgés atteints de démence traités par un antipsychotique atypique présentent un risque de décès plus élevé que ceux recevant un placebo. L’analyse des résultats de 13 études contrôlées par placebo utilisant divers antipsychotiques atypiques (durée modale de 10 semaines) menées auprès de tels patients a révélé que le taux de mortalité était 1,6 fois plus élevé en moyenne chez les patients traités. Même si les causes de mortalité étaient variées, la plupart des décès étaient soit d’origine cardiovasculaire (p. ex., insu sance cardiaque, mort subite), soit d’origine infectieuse (p. ex., pneumonie).
Autres mises en garde et précautions pertinentes :
• Régulation de la température corporelle
• Risque de chutes et de somnolence
• Contient du lactose
• Hypotension orthostatique
• Risque d’allongement de l’intervalle QT
• Les patients doivent faire l’objet d’une évaluation visant à déceler tout antécédent d’abus de drogue
• Conduite de véhicules et utilisation de machines
• Des cas d’hyperglycémie et d’acidose diabétique ont été signalés
• Gain pondéral
• Dyslipidémie
• Hyperprolactinémie
• Priapisme
• Risque de leucopénie/neutropénie
• Thromboembolie veineuse
• Réactions d’hypersensibilité graves
• Syndrome malin des neuroleptiques
• Dyskinésie tardive
• Risque de crises d’épilepsie/convulsions
• Risque de suicide
• Risque de comportements compulsifs/ troubles du contrôle des impulsions
• E ets indésirables cutanés graves
• Dysphagie
• Ne pas utiliser durant la grossesse ou l’allaitement
• Administrer avec prudence aux patients âgés vu la possibilité d’un risque accru d’événements indésirables cérébrovasculaires potentiellement mortels
• Surveillance et tests de laboratoire : la glycémie, le bilan lipidique à jeun et le poids corporel, de même que la formule sanguine complète, la numération et la formule leucocytaires, le taux de prolactine et la tension artérielle doivent être déterminés au début du traitement et vérifiés périodiquement par la suite.
Pour de plus amples renseignements : Consultez la monographie du produit au www.rexultimonographie.ca pour obtenir des renseignements importants sur les e ets indésirables, les interactions médicamenteuses et la posologie qui n’ont pas été abordés dans le présent document. Vous pouvez également obtenir la monographie en appelant au 1 877 341-9245
CANMAT : Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments.
* Consulter les lignes directrices pour connaître toutes les recommandations.
Références : 1. Lam RW, Kennedy SH, Adams C, et al. Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) 2023 Update on Clinical Guidelines for Management of Major Depressive Disorder in Adults. Can J Psychiatry. 2024;69(9):641-87.
2. CANMAT. Données internes. Lettre du CANMAT au CCPP.
3. Monographie de REXULTI. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
Toutes les marques de commerce suivies des mentions MD ou MC sont protégées (déposées ou non) par leurs propriétaires ou concédants de licence. Pour obtenir plus d’information, veuillez visiter le www.otsukacanadatm-mc.ca © Otsuka Canada Pharmaceutique et Lundbeck Canada Inc. Tous droits réservés.

On attribue au sociologue et philosophe allemand Karl Mannheim (1893-1947) la paternité de la notion de « choc des générations ».
En somme, les membres d’un même groupe d’âge partagent des expériences collectives qui font en sorte qu’une identité générationnelle se dégage. Cette nouvelle identité peut cependant entrer en collision avec celles des générations précédentes.
À titre d’exemple, on dit des nouveaux travailleurs qu’ils accordent une place plus importante à la conciliation travail-vie personnelle, quitte à changer plus rapidement de milieu de travail si les conditions d’emploi ne leur conviennent pas.
Dans le milieu de la santé, ce trait générationnel pose un défi aux gestionnaires de 40 ans et plus. Certains d’entre eux arguent que les patients ne choisissent pas lorsqu’ils sont malades et que le travail le soir et les fins de semaine est une nécessité.
Cette réticence aux heures de travail prolongées peut être vraie chez une partie de la relève, mais les nouveaux cliniciens arrivent aussi sur le marché du travail avec une tonne de nouvelles idées pour améliorer la prestation de soins et de services. Bref, comme tout phénomène de société, une myriade de nuances s’impose.
Dans notre dossier de une (à la page 23), nous avons donné la voix aux patrons des cliniques médicales, des unités de soins hospitalières et des pharmacies afin qu’ils partagent leurs attentes vis-à-vis des jeunes professionnels qu’ils supervisent en stage
ou en résidence. Que cherchent-ils exactement chez leurs successeurs ?
On y découvre notamment qu’un chef des soins intensifs comme le Dr François Marquis cherche chez les nouveaux cliniciens des traits de caractère différents de ceux que la Dre Guila Delouya, qui exerce en radio-oncologie, estime importants.
ticipation des patients-partenaires dans leurs cursus. Mais rien ne remplace le vécu en GMF, à l’hôpital, en pharmacie ou dans les autres milieux de soins.
Cette réalité du terrain constitue actuellement un véritable baptême de feu pour la relève. Les jeunes professionnels arrivent trop souvent dans des milieux de travail vétustes, aux prises avec des pénuries importantes de personnel et qui font l’objet de coupes budgétaires.
Les jeunes médecins entament d’ailleurs leur pratique au moment où le gouvernement envisage d’imposer des mesures « d’imputabilité » au corps médical qui seraient basées sur de nouveaux indicateurs de performance. Au moment d’écrire ces lignes, rien ne porte à croire que le projet de loi 106 sera modulé pour tenir compte de la réalité des jeunes médecins par rapport à celles des médecins ayant plus d’expérience.
ARRIVENT TROP SOUVENT
DANS DES MILIEUX DE TRAVAIL VÉTUSTES, AUX
PRISES AVEC DES PÉNURIES
IMPORTANTES DE PERSONNEL ET QUI FONT L’OBJET DE COUPES BUDGÉTAIRES.
La relève en pharmacie fait face à des défis différents. Avec la publication des règlements en lien avec la loi 31 (anciennement le projet de loi 67) le 11 juin dernier, les nouveaux pharmaciens commencent leurs carrières avec un rôle de clinicien passablement élargi. Avec la levée des contraintes légales précédentes, les pharmaciens se trouvent désormais face à une page blanche professionnelle. Cela est à la fois grisant et aussi intimidant. Un temps d’acclimatation sera nécessaire pour apprivoiser ce nouveau rôle et faire la pédagogie requise auprès des patients sur ce qui leur sera possible ou non de faire pour les aider.
De l’avis des patrons que nous avons interviewés, l’un des principaux défis auxquels est confrontée la relève demeure la communication avec les patients. À cet égard, il faut reconnaître que les facultés des sciences de la santé ont fait un pas de géant dans les dernières années afin de préparer les étudiantes et étudiants à la réalité du terrain, notamment avec la par-
C’est là que le mentorat des « anciens » est fondamental. Car, même s’il y a parfois un choc entre les générations, il y a aussi une transmission des savoir-faire et des savoirêtre pour accompagner la relève dans ce qu’elle s’apprête à accomplir pour les patients québécois. n
Recommandés comme traitement de première intention des douleurs musculosquelettiques aiguës1,2*



Voltaren est le seul AINS topique vendu sans ordonnance au Canada. Il contient un anti-inflammatoire puissant qui soulage les douleurs musculaires et articulaires1,9-11.
:
Recommandé comme traitement de première intention des douleurs migraineuses, des céphalées de tension, des douleurs dentaires et des douleurs menstruelles3-8†

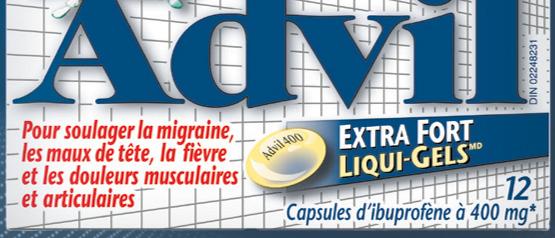





La tolérabilité et le profil d’innocuit ardiovasculaire d’Ad

JOIGNEZ-VOUS À LA COMMUNAUTÉ DU SOULAGEMENT DE LA DOULEUR ET TÉLÉCHARGEZ LE GUIDE SUR LES OPTIONS DE TRAITEMENT EN VENTE LIBRE
AINS : anti-inflammatoire non stéroïdien
* D’après les lignes directrices 2020 de l’American College of Physicians et de l’American Academy of Family Physicians
† D’après les lignes directrices de l’European Headache Federation (2019), de la revue Le Médecin de famille canadien (2015), de l’American Dental Association (2020), de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (2017) et de l’American Family Physician (2021).
RÉFÉRENCES : 1. VOLTAREN EMULGEL Extra fort et VOLTAREN EMULGEL Douleur articulaire Extra fort. GSK Soins de santé aux consommateurs SRI. 10 janvier 2022. 2. Qaseem A, et al Ann Intern Med. 2020;173(9):739-748. 3. ADVIL comprimés, caplets, et gélules; ADVIL ExtraFort; ADVIL Muscles et Articulations; ADVIL 12 Heures. GSK Soins de santé aux consommateurs SRI. 18 juin 2020. 4. Steiner TJ, et al J Headache Pain. 2019;20:57. 5. Becker WJ, et al Can Fam Physician. 2015;61(8):670-679. 6. Oral Analgesics for Acute Dental Pain. American Dental Association. Publié en 2020. Dernière mise à jour en septembre 2022. Consulté le 12 juin 2023. https://www.ada.org/resources/ada-library/oral-health-topics/oral-analgesics-for-acute-dental-pain. 7. Burnett M, Lemyre M. J Obstet Gynaecol Canada. 2017;39(7):585-595. 8. McKenna KA, Fogleman CD. Am Fam Physician. 2021;104(2):164-170. 9. Base de données sur les produits pharmaceutiques de Santé Canada, février 2024. 10. Predel HG, et al Med Sci Sports Exerc. 2012;44:1629-1636. 11. Duteil L, et al. Clin Exp Dermatol. 1990;15:195-199. 12. Moore N, et al Clin Drug Investig. 1999;18(2):89-98. 13. Andersohn F, et al Circulation. 2006;113(16):1950-1957. 14. García Rodríguez LA, et al J Am Coll Cardiol. 2008;52(20):1628-1636. 15. Van Staa TP, et al J Intern Med. 2008;264:48192. 16. Fosbøl EL, et al Clin Pharmacol Ther. 2009;85(2):190-197. 17. McGettigan P, Henry D. PLoS Med. 2011;8(9):e1001098.
Pour en savoir plus sur la façon d’évaluer les risques du produit par rapport à ses bienfaits, veuillez consulter la monographie. Indiquez toujours au patient de lire l’étiquette. et le profil d’innocuité cardiovasculaire d’Advil ont été bien étudiés et établis3,12-17.


Haleon Canada, Mississauga (Ontario) L5R 4B2
Marques de commerce détenues ou utilisées sous licence par Haleon.
©2024 Haleon ou son concédant de licence.
PM-CA-ADV-23-00161
L’INDOMPTABLE MAMMOUTH
Publié en avril dernier, l’essai L’indomptable Mammouth retrace un demi-siècle de réformes politiques du système de santé afin d’améliorer l’offre de soins aux Québécois.
MARIE-HÉLÈNE DUFAYS MARINESCU
Coécrit par la journaliste Marie-Michèle Sioui et l’ancien conseiller politique Pascal Mailhot, le livre de 270 pages repose sur les témoignages d’une trentaine de personnalités ayant contribué à façonner le réseau de la santé depuis plus de 50 ans.
Le ministre de la Santé, Christian Dubé, deux de ses prédécesseurs, les Drs Gaétan Barrette et Philippe Couillard, ainsi que la commissaire à la santé et au bien-être, Joanne Castonguay, ont été conviés à participer à un panel de discussion sur les réformes du réseau lors du lancement du livre, le 5 mai dernier. Le panel était animé par le directeur du quotidien Le Devoir, Brian Myles.
Santé Québec, un aboutissement ?
Lors du panel, Christian Dubé a affirmé que Santé Québec représente une occasion d’effectuer un grand nombre de changements qui n’ont pas pu être réalisés au cours des nombreuses réformes précédentes.
Ex-ministre de la Santé et ex-premier ministre du Québec, Philippe Couillard a souligné qu’environ dix années seront nécessaires pour vraiment évaluer l’impact de Santé Québec sur l’offre de soins à la population. Entre-temps, il suggère de ne plus entreprendre une nouvelle réforme de cette ampleur, mais plutôt de se concentrer à faire des ajustements en cours de route.
À titre d’exemple, Philippe Couillard a mis de l’avant l’importance de revoir la rémunération des médecins dans le réseau afin d’y inclure une composante en lien avec la qualité des services rendus à la population et non seulement le volume. Idem pour le financement des hôpitaux, qui devrait tenir compte des résultats pour les patients et ne pas reposer uniquement sur l’historique budgétaire.
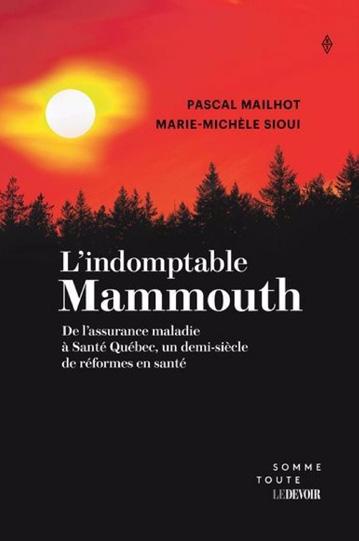
L’Indomptable mammouth : de l’assurance maladie à Santé Québec : un demi-siècle de réformes en santé
Marie-Michèle Sioui et Pascal Mailhot Édition Somme Toute 270 pages
Outre l’importance de revoir les mécanismes de rémunération du réseau, Joanne Castonguay estime également qu’un effort supplémentaire doit être apporté à l’intégration des services.
Actuellement, les indicateurs de performance, notamment de l’amélioration de la santé de la population, seraient toujours insuffisants, a poursuivi la commissaire. Elle a d’ailleurs annoncé qu’elle présentera en juin la première partie de ses travaux à ce sujet. Cette évaluation permettra de comparer le Québec aux autres provinces canadiennes, ainsi qu’au reste du monde.
Sans dévoiler tout le contenu du rapport, Joanne Castonguay a néanmoins précisé que le manque d’indicateurs pour mesurer la santé en matière de promotion et prévention est un élément qui en ressortira, de même que l’accès inadéquat aux soins malgré une augmentation du nombre d’inscriptions auprès des groupes de médecins de famille.
Selon Philippe Couillard, des indicateurs devraient être développés du point de vue des usagers qui obtiennent des services, notamment sur le plan de l’accessibilité, de la sécurité des soins, des résultats d’intégration et de continuité des soins. n
Donna Kerry, vice-présidente principale du Groupe Santé d’EnsembleIQ, est heureuse d’annoncer la nomination de Christian Leduc à titre d’éditeur adjoint. Il cumulera cette nouvelle fonction à celle de rédacteur en chef du magazine Profession Santé et du site ProfessionSanté.ca, qu’il occupait déjà.
Christian Leduc est devenu journaliste pour L’actualité pharmaceutique en 2007, puis chez Profession Santé en 2009. Il a été nommé rédacteur en chef adjoint à la fin de l’année 2016, puis rédacteur en chef en janvier 2021. Il est également directeur de la rédaction de Québec Pharmacie depuis 2018.
LAURIE NOREAU
La thérapie hormonale est considérée comme une solution potentielle dans le traitement ou la prévention des symptômes génito-urinaires. Pourtant, chez les femmes ménopausées, la prise d’hormones serait associée à une moins bonne santé de la vessie.
C’est ce que révèle une étude transversale menée auprès de 3126 femmes âgées de 18 ans ou plus à différents stades de la ménopause1. Les chercheurs ont pu brosser un portrait de l’effet des hormones sur la santé urinaire des femmes à différents moments de leur vie.
Il apparaît qu’en préménopause, la prise d’hormones semble plutôt inoffensive dans la santé et la fonction de la vessie des femmes ainsi que dans la prévalence des symptômes des voies urinaires inférieures. En se basant sur des échelles d’évaluation de la santé urinaire, les résultats des utilisatrices de contraceptif oral, d’anneau vaginal, de dispositif intra-utérin (DIU) ou de timbre contraceptif étaient similaires à ceux des non-utilisatrices.
En revanche, chez les femmes en périménopause et en postménopause, la prise d’œstrogène topique ou d’hormonothérapie systémique était associée à un résultat plus faible pour pratiquement tous les critères de santé de la vessie. En postménopause, la prise d’hormones entraînait une différence de 5 à 6 points pour chaque critère sur l’échelle BHS (Bladder Health Scales).
Tous les indices de la fonction urinaire étaient aussi significativement plus bas chez les utilisatrices d’hormones en postménopause. En périménopause, les résultats se sont révélés plus faibles dans la fréquence, la sensation et la rétention urinaire par rapport aux non-utilisatrices. Les symptômes d’incontinence urinaire d’urgence et d’incontinence urinaire d’effort étaient aussi plus fréquents.
Ces résultats n’ont toutefois pas permis d’établir de relation de cause à effet entre l’hormonothérapie et la santé urinaire. En
effet, les chercheurs ne peuvent écarter la possibilité que certaines femmes présentant davantage de symptômes d’incontinence urinaire ou une fonction urinaire plus faible se tournent vers l’hormonothérapie comme traitement potentiel, amplifiant le risque réel posé par la thérapie hormonale.
L’étude transversale ne tenait pas compte d’autres facteurs de risque, comme l’obésité, le tabagisme ou le niveau d’activité physique.
Près de 40 % (n=469) des femmes en préménopause ayant participé à l’étude ont rapporté la prise d’hormones. Chez les femmes en périménopause, 21,5 % (n=56) ont indiqué faire l’usage d’hormones et chez les femmes en postménopause, cela concernait 13,2 % (n=216) d’entre elles.
Deux outils de validation ont été utilisés pour établir la santé de la vessie, soit le BHS (Bladder Health Scales) et le BFI (Bladder Fonction Indices). La fréquence des symptômes cliniques des voies urinaires inférieures a été évaluée grâce au LURN Symptoms Index qui répertorie les dysfonctions urinaires s’étant produites dans les sept jours précédents.
Les effets d’une thérapie locale ou systémique
Comme l’ont montré des études récentes, la voie d’administration de l’œstrogène influencerait son effet sur la santé urinaire. Une hormonothérapie systémique pourrait exacerber ces symptômes, notamment l’incontinence urinaire, alors que l’œstrogène localisé apaiserait les symptômes de vessie hyperactive et certains symptômes génito-urinaires liés à la ménopause.
Selon les auteurs, ces résultats ne soutiennent donc pas une recommandation systématique d’hormones pendant la périménopause et en postménopause. Ils plaident également pour une stratégie de traitement plus personnalisée.
« Les efforts visant à promouvoir la santé de la vessie et à prévenir les symptômes des voies urinaires inférieures devraient cibler les femmes avant la ménopause pour l’évaluation des symptômes, le dépistage et les interventions de prévention », concluent les auteurs de l’étude parue dans la revue Menopause n
1. Vaughan C, Markland AD, et coll. Association of menopausal status and hormone use with bladder health and lower urinary tract symptoms in US women: results from the RISE FOR HEALTH study. Menopause. Publié en ligne le 29 avril 2025.
CABTREO (phosphate de clindamycine, adapalène et peroxyde de benzoyle) est indiqué pour le traitement topique de l’acné vulgaire chez les patients de 12 ans et plus.

GEL TOPIQUE À APPLICATION UNIQUOTIDIENNE
Veuillez consulter la monographie du produit pour obtenir les renseignements complets sur la posologie et l’administration recommandées.
Balayez le code pour en savoir plus sur CABTREO.

Consultez la monographie du produit à l’adresse https://bauschhealth.ca/wp-content/uploads/2024/08/CABTREOPM-F-2024-08-01.pdf pour connaître les contre-indications, les mises en garde, les précautions, les effets indésirables, les interactions, la posologie et les conditions d’usage clinique. Vous pouvez aussi obtenir la monographie du produit en téléphonant au 1-800-361-4261.
* La portée clinique comparative est inconnue.
Référence : Monographie de CABTREO. Bausch Health.
bauschhealth.ca/fr

Merci du vote de confiance!
La marque no1 de supplément de fer en vente libre recommandée à l’échellepancanadienne depuis 10 ANNÉES consécutives!†










Balayez ce code pour visiter la page Praticien de santé sur feramax.com/fr/
Mise en garde: Tenir hors de portée des enfants. L’emballage contient assez de fer pour causer de sérieux dommages à un enfant. Une dose de plus de 35 mg par jour peut causer de la constipation, de la diarrhée ou des vomissements. Consulter un professionnel de la santé avant l’utilisation en cas d’allergie aux préparations à base de fer ou à tout ingrédient de ces produits, en cas de grossesse ou d’allaitement ou en cas d’ulcère gastro-duodénal, d’entérite régionale ou de colite ulcéreuse. Cesser l’utilisation en cas de nausée, de vomissements, de douleurs abdominales, d’hématémèse (vomissement de sang) ou de diarrhée. Cesser l’utilisation en cas de réactions allergiques. Conserver à température ambiante (15-30 °C). Ne pas entreposer dans un endroit exposé à une forte humidité. † Enquête 2025 sur les conseils et recommandations en matière de médicaments en vente libre (MVL) de Pharmacy

DR THIERRY PETRY
Depuis 40 ans, le Dr Thierry Petry pratique une médecine empreinte d’altruisme et de bienveillance. Lauréat du prix Humanisme 2025 du Collège des médecins, cet anesthésiologiste se consacre à remettre les gens « à la verticale ». Rencontre avec un homme qui n’a jamais cessé de marcher vers l’autre.
GEOFFREY DIRAT
Le prix Humanisme du Collège des médecins du Québec (CMQ) est remis chaque année à un praticien qui se distingue « par la pertinence de son engagement social » et qui contribue « de manière significative au bien-être et à l’épanouissement de sa patientèle et de la communauté ». De plus, la carrière de cette personne « doit être marquée par le dévouement, le partage et l’entraide, tant auprès des collègues qu’à l’égard du public ».
Le lauréat de cette année, le Dr Thierry Petry, a été honoré pour « son parcours exem-
plaire, reflet d’un dévouement hors du commun ». Parcours que son entourage résume avec une formule bien sentie : « Un médecin de campagne à l’envergure planétaire. »
Depuis son arrivée au Québec il y a 40 ans, ce Français d’origine a toujours été proche de ses patients pour lesquels il a donné de son temps et de sa personne en fondant la Clinique de la douleur de l’hôpital de Gaspé. En parallèle, il a effectué de nombreuses missions humanitaires pour Médecins sans frontières (MSF) et il a travaillé régulièrement à Kuujjuaq, au Nunavik. Amoureux de la nature et d’aventures, il est également connu pour ses traversées à ski de la Terre de
Baffin et du Groenland, ou encore pour avoir atteint le pôle Sud en totale autonomie.
Lorsque le CMQ lui a annoncé la nouvelle, le Dr Petry a d’abord été surpris, y voyant même une « certaine dérision », lui qui garde en mémoire un mauvais souvenir de cette « institution très, très rigoureuse ». Après un début de carrière à Nancy, dans l’est de la France, il est embauché en 1985 à l’hôpital de Gaspé. « J’avais un permis d’exercice restrictif que je devais renouveler tous les six mois. Pendant longtemps, j’ai eu le Collège sur le dos deux fois par an pour avoir le droit d’exercer », se souvient-il.
Quant au prix Humanisme à proprement parler, le médecin avoue l’avoir reçu avec beaucoup d’humilité et de reconnaissance.
« C’est un magnifique cadeau qui m’a profondément touché », reconnaît le Dr Petry. Pour lui, cette distinction lui a été remise en raison de son empathie pour les plus vulnérables.
« J’ai toujours travaillé comme ça, avec une ouverture aux autres, une ouverture aux patients un peu marginaux qu’on peut retrouver en clinique de douleur parce qu’ils n’ont pas de médecin. Souvent, ils n’ont pas de carte d’assurance maladie. Parfois, ils ont des problèmes de dépendance. Mais peu importe, ça reste des personnes qui ont besoin d’attention et de soins. », insiste-t-il.
De garde pendant une décennie
Ce qui caractérise aussi sa pratique, c’est sa grande disponibilité. Pendant plus d’une décennie, le Dr Petry a été le seul anesthésiologiste en poste à l’hôpital de Gaspé.
« J’étais de garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 », se remémore-t-il avec un sourire espiègle. Car cette astreinte ne l’a pas empêché d’assouvir sa passion pour le plein air. « Ceux qui avaient besoin de moi savaient où me trouver en cas d’urgence », explique celui qui se décrit comme un homme des bois. « On m’a déjà ramené à l’hôpital en Ski-Doo ou en zodiac ! Un jour, je m’y suis même rendu à cheval parce que je n’avais pas le temps de m’arrêter à l’écurie », raconte-t-il avec truculence.
Depuis une dizaine d’années, Dr Petry ne fréquente plus les salles d’opération. Il se consacre entièrement à la clinique de la douleur où il se passionne pour la « verticalisation »; un néologisme qu’il définit comme la faculté à remettre les gens sur pied. « On était programmé pour marcher à quatre pattes, on s’est relevé, mais le bas de la colonne n’a pas vraiment suivi. Ça reste problématique pour beaucoup de monde, particulièrement pour les personnes âgées », explique l’algologue. « Quand j’arrive à les remettre debout et à augmenter leurs capacités, c’est considérable. Ça change leur vie ! »
À la clinique, comme à l’hôpital autrefois, le Dr Petry fait preuve de disponibilité en s’adaptant à ses patients. Il peut commencer ses journées à l’aube pour recevoir les pêcheurs et les forestiers avant qu’ils ne partent au travail. Il consulte aussi les same-
dis et dimanches où il lui arrive aussi de s’occuper de patients hospitalisés qui ont besoin d’une infiltration. Quant aux personnes marginalisées, « je me rends disponible pour les voir à différents endroits, même au bistro du coin », mentionne-t-il modestement. Ce besoin d’aider et servir son prochain, le Dr Petry l’a également comblé dans le Grand Nord. Durant plus de 20 ans, il s’est rendu régulièrement à l’Hôpital de Kuujjuaq, selon les besoins. « Je faisais un petit peu d’anesthésie avec un ORL et surtout la clinique de douleur », précise le médecin qui s’est bien entendu avec les Inuits, « des gens bien logiques, naturels, qui ne parlent pas beaucoup, mais qui aiment rire ». Ces patients-là, le Dr Petry a trouvé très gratifiant de « les revoir à la verticale, alors qu’ils arrivaient tout croche en consultation. Ils vivent de chasse et de pêche. Donc un Inuit qui peut marcher et courir, c’est un Inuit de sauvé », s’exclame-t-il.
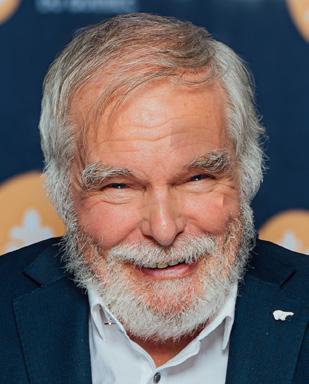
«
C’EST UN MERVEILLEUX
MÉTIER QUI ME
MOTIVE ENCORE. »
Dr Thierry Petry
Son côté baroudeur et aventurier l’a également conduit à s’impliquer auprès de Médecins sans frontières (MFS). Sierra Leone, Sri Lanka, Haïti ou encore Syrie, le praticien a effectué 26 missions dans des pays en guerre ou dévastés par des cataclysmes. Pour lui, « c’était quelque chose de tout naturel ». Comme médecin, il dit avoir vécu des « expériences exceptionnelles » en prenant en charge « des pathologies qui nous échappent dans nos pays développés ». En
tant qu’homme, il s’est « confronté aux besoins basiques de nos frères humains ».
L’anesthésiologiste a particulièrement été marqué par sa dernière mission en 2019 à Kaboul, la capitale de l’Afghanistan, un pays dont il garde un « excellent souvenir ». Aux côtés de six gynécologues et de quatre infirmiers anesthésistes, il pratiquait dans une maternité où une centaine de femmes venaient accoucher chaque jour. « Ça tournait, ça tournait. J’ai beaucoup aimé la densité de travail et l’organisation que ça exigeait pour rester fonctionnel et efficace. J’ai aussi aimé le contact avec ces patientes et ces consœurs gynécologues dans un pays où les relations homme-femme sont assez singulières. »
Le prix Humanisme du Collège vient aussi souligner les nombreux engagements du Dr Petry auprès de sa communauté. Dans sa région d’adoption, il s’est notamment impliqué dans la promotion de la culture du plein air et le développement de la pratique du ski de fond. Il fut ainsi une des chevilles ouvrières de la Grande Traversée de la Gaspésie à ski. Dernièrement, il a fait don de 100 000 $ à l’organisme sans but lucratif Han-Logement pour la construction à Gaspé de 32 logements abordables destinés aux personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel. Aujourd’hui âgé de 75 ans, le Dr Petry a toujours le feu sacré de la médecine. « Je ne sais pas si c’est le plus beau métier du monde, mais c’est un merveilleux métier qui me motive encore », déclare-t-il. Sa passion intacte est liée à la découverte scientifique, « bien sûr », mais aussi à la possibilité de surpasser les limites, « ces ornières forgées par nos éducations. Il y a des choses qui peuvent nous sembler impossibles à faire ici, mais qu’on peut accomplir ailleurs avec une équipe différente », souligne-t-il en ajoutant que « sans être perfectionniste, l’objectif reste de trouver une solution satisfaisante pour le patient, pour l’autre, donc pour nous ».
Malgré tout, le médecin voit poindre la retraite : « C’est sûr que j’y pense, parce que ça va s’arrêter tôt ou tard. » Il ne sait pas encore quand, mais il a décidé que ce serait un mercredi midi. « Parce que vous êtes là le matin, en milieu de semaine, et puis on ne vous trouve plus l’après-midi. » Une manière de partir « sans tambour ni trompette », en toute discrétion et humilité. Autrement dit, un départ à son image. n

Découvrez PhareClimat Santé, le premier répertoire public d’initiatives de lutte et d’adaptation aux changements climatiques mises en place dans des établissements de santé au Québec.
Vous aussi, faites briller vos projets et joignez-vous au virage écoresponsable du réseau de la santé.
Découvrez DAYVIGOMD et les considérations
Vos patients ont-ils des difficultés à s’endormir ou à rester endormis? DAYVIGO (lemborexant) est indiqué pour le traitement de l’insomnie, qui se caractérise par des difficultés à s’endormir et/ou à maintenir son sommeil1 .
COMPRENDRE LE CYCLE DU SOMMEIL
• Le cycle du sommeil est divisé en quatre stades : les stades N1 à N3 correspondant au sommeil lent (NREM) et le stade de sommeil paradoxal (REM)2,3
• La plupart des gens effectuent quatre à six cycles de sommeil par nuit 2,3 .
• Les stades du sommeil sont définis à partir de l’analyse de l’activité cérébrale pendant le sommeil et présentent des caractéristiques distinctes 2,3 .
Les stades du sommeil 2,3
Stade 1
Enregistrement EEG : ondes thêta - faible voltage. Le stade le plus léger du sommeil. Le tonus musculaire est présent dans les muscles squelettiques et la respiration est régulière.
Chaque cycle dure environ 90 minutes.
Enregistrement EEG : ondes bêta - semblables aux ondes cérébrales pendant l’éveil. Le REM est associé au rêve et n’est pas considéré comme réparateur. Mouvements oculaires rapides. Le rythme respiratoire est erratique et irrégulier.

DAYVIGO (lemborexant) est indiqué pour le traitement de l’insomnie, qui se caractérise par des difficultés à s’endormir et/ou à maintenir son sommeil1
MODE D’ACTION DE DAYVIGO*
DAYVIGO est un hypnotique. Il appartient à la classe pharmacologique des antagonistes doubles des récepteurs des orexines1. Les études suggèrent que les orexines, des neuropeptides, jouent un rôle important dans le maintien et la régulation de l’état de veille4.
• Types d’orexine : orexine A et orexine B 4
• Types de récepteurs de l’orexine : les actions des orexines dépendent de deux récepteurs : les récepteurs de l’orexine de type 1 (OX1R) et de type 2 (OX2R) 4
DAYVIGO est un antagoniste compétitif des deux récepteurs de l’orexine, OX1R et OX2R, avec une affinité plus élevée pour OX2R1
• Le système de signalisation du neuropeptide orexine est un système central qui favorise l’état de veille1
• L’inhibition de la liaison des neuropeptides favorisant l’éveil, l’orexine A et l’orexine B, aux récepteurs OX1R et OX2R supprimerait l’état de veille1
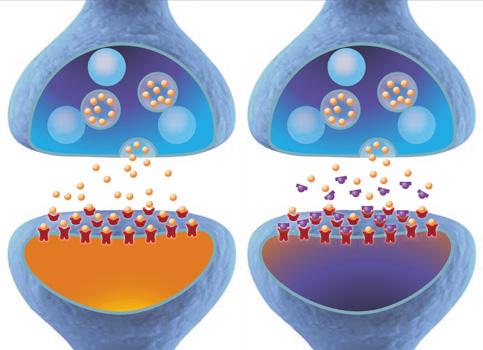



L’inhibition de la liaison des neuropeptides favorisant l’éveil, l’orexine A et l’orexine B, aux récepteurs OX1R et OX2R supprimerait l’état de veille.

Enregistrement EEG : fuseaux de sommeil et complexes K. Un sommeil plus profond que le stade 1. Le rythme cardiaque et la température corporelle diminuent.
Enregistrement EEG : ondes delta - fréquence la plus basse, amplitude la plus élevée. Également connu sous le nom de sommeil à ondes lentes (SWS). Le stade le plus profond du sommeil. Stade duquel il est le plus difficile de se réveiller.
Expliquer le fonctionnement de DAYVIGO à vos patients
DAYVIGO appartient à un groupe de médicaments appelés « antagonistes doubles des récepteurs de l’orexine ». Les orexines sont des substances chimiques qui se lient à certains récepteurs dans votre cerveau pour vous maintenir éveillé. DAYVIGO bloque temporairement les récepteurs de l’orexine. Cela peut vous aider à vous endormir plus rapidement et à rester endormi plus longtemps1
• Pendant la journée, les orexines nous aident à rester éveillés.
• La nuit, DAYVIGO bloque temporairement les récepteurs de l’orexine, ce qui peut vous aider à vous endormir et à rester endormi.
PHARMACODYNAMIE :
ARCHITECTURE DU SOMMEIL
Chez les patients souffrant d’insomnie, DAYVIGO a entraîné une augmentation du sommeil non REM et REM, d’après les résultats de la polysomnographie. L’augmentation du sommeil REM était significativement supérieure sur le plan statistique pour les deux doses de DAYVIGO par rapport au placebo, aussi bien au début (jours 1 et 2) qu’à la fin du traitement (jours 29 et 30)1
EFFICACE RAPIDEMENT, DÈS LES NUITS 1,2 (moyenne calculée sur les nuits 1,2)1† DAYVIGO 5 mg et 10 mg ont été supérieurs au placebo en termes de délai d’endormissement lors des nuits1, 2. Le principal critère d’efficacité était la variation moyenne de la latence avant le sommeil persistant (LASP) entre le début et la fin du traitement, mesurée objectivement par polysomnographie. La LASP était définie comme le nombre de minutes écoulées entre le moment où les lumières étaient éteintes et les 10 premières minutes consécutives de sommeil sans réveils.
• Chacun des 4 à 6 cycles de sommeil par nuit dure environ 90 minutes. Toutefois, la durée d’un cycle de sommeil peut varier au cours de la nuit 2,3
• Pendant la première moitié de la nuit, la majeure partie du temps est consacrée au sommeil profond : le stade N3 dure généralement entre 20 et 40 minutes. Cependant, au fur et à mesure que la nuit avance, le temps consacré au sommeil paradoxal augmente, tandis que celui consacré au sommeil profond diminue2,3 .
Architecture du sommeil : l’analyse des différents cycles et stades du sommeil est communément appelée « architecture du sommeil ». Elle fournit des renseignements sur les facteurs susceptibles de modifier l’architecture du sommeil, comme les troubles du sommeil2
Variation moyenne de la LASP par rapport aux valeurs initiales lors des nuits 1,2 :
DAYVIGO 5 mg : -17 minutes ( p < 0,01)
DAYVIGO 10 mg : -19 minutes ( p < 0,001)
placebo : -6 minutes
Réduction significative du temps d’éveil après endormissement1†
DAYVIGO 5 mg et 10 mg ont été supérieurs au placebo en termes de réduction du temps d’éveil après endormissement (TÉAE) lors des nuits 1,2. Le critère secondaire d’efficacité était la variation moyenne, entre le début et la fin du traitement, du temps d’éveil après endormissement (TÉAE), mesuré objectivement par polysomnographie. Le TÉAE était défini comme le nombre de minutes d’éveil entre le début du sommeil et le réveil.
Variation moyenne du TÉAE par rapport aux valeurs initiales lors des nuits 1,2 :
DAYVIGO 5 mg : -51 minutes ( p < 0,001)
DAYVIGO 10 mg : -60 minutes ( p < 0,001)
placebo : -18 minutes
DAYVIGO 5 mg a atteint une signification clinique par rapport au placebo
Dans le cadre de deux études, DAYVIGO 5 mg a démontré une efficacité clinique significative par rapport au placebo, aussi bien en termes de latence d’endormissement que de temps d’éveil après endormissement, évaluée de manière subjective par les patients et de manière objective par polysomnographie1†‡.
DONNÉES D’EFFICACITÉ À 12 MOIS
DAYVIGO a démontré une amélioration durable du sommeil sur une période de traitement de 12 mois1
* Portée clinique inconnue.
† Une étude de phase III multicentrique, randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, avec groupes parallèles, d’une durée d’un mois, menée auprès de 1006 patients (263 patients ont été randomisés pour recevoir le comparateur actif) âgés de 55 ans et plus et souffrant d’insomnie, à l’aide d’une polysomnographie et de journaux de sommeil tenus par les patients.
‡ Essai multicentrique à long terme, randomisé, en double aveugle, contrôlé par placebo, chez des patients adultes âgés de 18 ans ou plus répondant aux critères de l’insomnie du DSM-5. L’étude comportait deux périodes : une période de traitement de six mois contrôlée par placebo (période 1), suivie d’une période de six mois (période 2) au cours de laquelle les patients qui avaient reçu le placebo ont été re-randomisés en double aveugle pour recevoir uniquement le traitement actif : DAYVIGO 5 mg ou DAYVIGO 10 mg.
La somnolence a été l’effet indésirable le plus fréquent
Dans les essais cliniques menés chez des patients souffrant d’insomnie traités par DAYVIGO 5 mg ou 10 mg, l’effet indésirable le plus fréquent (signalé chez 5 % ou plus des patients traités par DAYVIGO et à un taux supérieur à celui du placebo) a été la somnolence (7 % pour DAYVIGO 5 mg, 11 % pour DAYVIGO 10 mg, 2 % pour le placebo). DAYVIGO a été associé à une augmentation de la somnolence liée à la dose1
Pourcentage de patients ayant éprouvé des effets indésirables apparus en cours de traitement1
(Incidence d’au moins 1 % dans n’importe quel groupe traité par DAYVIGO et supérieure à celle du groupe placebo, dans le cadre des études Sunrise 1 et Sunrise 2.)
Placebo DAYVIGO
Troubles
Infections et infestations
Troubles
Troubles du système nerveux
Troubles psychiatriques
Autres
Effet indésirable le plus fréquent entraînant l’arrêt du traitement
La somnolence a été l’effet indésirable le plus fréquent entraînant l’arrêt du traitement, avec une incidence similaire à celle du placebo : 1 % pour DAYVIGO 5 mg, 2 % pour DAYVIGO 10 mg et 1 % pour le placebo1
Innocuité à long terme
Sur 12 mois de traitement continu, les effets indésirables ont été comparables à ceux observés au cours du premier mois de traitement1
Dépendance physique et profil de sevrage
Lors des études cliniques menées sur DAYVIGO, il n’y a pas eu de signes évidents de dépendance physique ou de symptômes de sevrage à l’arrêt d’une utilisation prolongée de DAYVIGO, selon le questionnaire de Tyrer symptômes de sevrage benzodiazépines1
La prudence est de mise lors de la prescription de DAYVIGO aux personnes ayant des antécédents de dépendance aux médicaments ou à l’alcool, ou d’usage abusif de ces substances, en raison du risque de mésusage ou d’usage abusif1
CONSEILS POUR VOS PATIENTS PRENANT DAYVIGO
Posologie
Conseils d’utilisation de DAYVIGO1
• Prenez DAYVIGO juste avant le coucher : prenez DAYVIGO une fois par jour, quelques minutes avant de vous coucher.
• Accordez-vous le temps nécessaire : ne prenez DAYVIGO que lorsque vous pouvez dormir au moins sept heures.
• Évitez de manger à l’approche de la prise : le délai d’endormissement peut être retardé en cas de prise pendant ou peu après un repas.
• Ne pas mélanger : ne prenez pas DAYVIGO avec de l’alcool, des sédatifs ou des médicaments qui peuvent vous rendre somnolent.
• Utilisez selon la prescription de votre médecin : parlez à votre médecin si, après 7 à 10 jours, vos problèmes de sommeil ne s’améliorent pas ou s’aggravent; cela peut signifier qu’une autre affection est à l’origine de vos problèmes de sommeil.
• Ne prenez une dose oubliée que si vous avez le temps de dormir sept heures. Si vous oubliez une dose et que vous avez la possibilité de dormir pendant au moins sept heures avant de devoir vous réveiller, prenez votre dose comme à l’habitude. Si vous n’avez pas le temps de dormir pendant au moins sept heures avant de devoir vous réveiller, ne prenez pas votre dose. Prenez-la la nuit suivante lorsque vous pouvez vous assurer d’avoir au moins 7 heures avant de vous réveiller.
Voir la monographie du produit pour obtenir des renseignements complets sur la posologie et l’administration.
DAYVIGO est couvert par la plupart des régimes d’assurance privés canadiens¶.
Utilisation clinique :
DAYVIGO n’est pas recommandé pour les patients âgés de moins de 18 ans.
DAYVIGO n’est pas recommandé chez les patients présentant une insuffisance hépatique sévère.
Contre-indications :
• Hypersensibilité à ce médicament ou à tout ingrédient de la préparation, y compris tout ingrédient non médicinal, ou composant du contenant.
• Patients atteints de narcolepsie.



Doses de 5 mg et 10 mg
Commencez par la dose efficace la plus faible pour le patient1
• La dose recommandée de DAYVIGO est d’un comprimé de 5 mg à prendre au maximum une fois par jour, quelques minutes avant le coucher, et au moins 7 heures avant l’heure prévue du réveil1 .
• La dose peut être augmentée jusqu’à la dose maximale recommandée de 10 mg en fonction de la réponse clinique et de la tolérabilité1.
• La réponse doit être évaluée après 7 à 10 jours. Si les symptômes persistent après 7 à 10 jours, il faut envisager la présence d’un trouble psychiatrique ou physique susceptible d’en être la cause première1.
Ajustements posologiques1
Enfants (moins de 18 ans)
Personnes âgées (65 ans et plus)
Insuffisance hépatique
Ajustement de la dose Aucun ajustement Prendre uniquement 5 mg Non recommandé
Mises en garde et précautions pertinentes :
• Pensées anormales et modifications du comportement
• Dépresseurs du SNC (incluant l’alcool), altération de l’état de veille diurne et risque de chutes
• Comportements complexes liés au sommeil
• Paralysie du sommeil, hallucinations hypnagogiques/ hypnopompiques et symptômes semblables à la cataplexie
• Aggravation de la dépression/idées suicidaires
• Interactions médicamenteuses – inhibiteurs et inducteurs du CYP3A
• Patients présentant une intolérance au galactose
• Conduite de véhicules et utilisation de machines
• Patients ayant des antécédents de dépendance, tolérance et risque d’usage abusif
• Insomnie de rebond
• Patients présentant une insuffisance hépatique
• Patients présentant une altération de la fonction respiratoire
• Femmes enceintes ou qui allaitent
Pour obtenir de plus amples renseignements : Veuillez consulter la monographie du produit à l’adresse https://ca.eisai.com/fr-CA/our-products pour obtenir des renseignements importants sur les effets indésirables, les interactions médicamenteuses et la posologie qui ne sont pas abordés dans cet article. Vous pouvez également obtenir ce document en composant le 1 877 873-4724.
¶ Données internes, Eisai limitée.
Références:
Inducteurs du CYP3A
Dépresseurs du SNC
Lorsque DAYVIGO est pris avec des dépresseurs du SNC, il peut être nécessaire d’ajuster la dose de DAYVIGO et/ou des autres médicaments en raison d’effets additifs potentiels.
1. Monographie de DAYVIGO, Eisai limitée, 30 janvier 2025. 2. Suni E. Stages of Sleep: What happens in a Sleep Cycle. The Sleep Foundation 2023. www.sleepfoundation.org/stages-of-sleep (consulté le 10 mars 2025). 3. Patel AK, et al. Physiology, Sleep Stages. NIH, National Library of Medicine https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK526132/ (consulté le 28 mars 2025). 4. Mieda, M. The roles of orexins in sleep/wake regulation. Neuroscience Research 2017;118:56–65.


«
La Dre Claudel Pétrin-Desrosiers vient de publier un essai intitulé Santé planétaire – Prescriptions médicales pour un environnement sain. La médecin de famille y présente les multiples effets que les changements climatiques, la pollution atmosphérique et le déclin de la biodiversité ont sur la santé humaine.
PROPOS RECUEILLIS PAR GEOFFREY DIRAT*
Ces enjeux restent dans l’angle mort de la protection de notre environnement, observe l’omnipraticienne. Alors que, si l’on mettait la santé au cœur des préoccupations face aux crises écologiques, elle est convaincue qu’on pourrait « accélérer le virage et la mise en place des changements sociétaux requis en générant des bénéfices sanitaires et économiques majeurs ». Entrevue avec une clinicienne en quête de solutions pour « dessiner un avenir sain ».
En 2015, encore étudiante en médecine, vous vous positionniez déjà publiquement sur les liens entre santé et environnement. Depuis 2018, vous êtes la présidente de l’Association québécoise des médecins pour l’environnement. Pourquoi cet essai-là, maintenant ?
J’ai été chanceuse, car j’ai été contactée par une maison d’édition qui m’a donné carte blanche. Ça m’a aidée à me lancer et à travailler pendant deux ans sur ce projet. Je
trouvais qu’un tel livre manquait dans l’espace public. Il n’y avait pas en librairie d’ouvrage qui résumait adéquatement les impacts et les conséquences des changements climatiques, de la pollution et de la biodiversité sur notre santé. Cet aspect-là de la question environnementale est encore peu présent dans les discours publics. L’argument de la santé reste souvent négligé, relégué au second plan, probablement parce qu’on ne le connaît pas assez et qu’on le sous-estime. Avec ce >
livre, je veux vraiment offrir un regard actuel, avec des données probantes, dans une approche scientifique, pour que tous ces éléments soient pris en considération lorsqu’on prend collectivement des décisions écologiques.
« LA DIFFÉRENCE ENTRE UN RÉCHAUFFEMENT
PLANÉTAIRE DE 2,9°C ET DE 3,1° C EST IMPORTANTE EN TERMES D’IMPACTS SUR LES ÉCOSYSTÈMES.
CHAQUE FRACTION DE DEGRÉ
SUPPLÉMENTAIRE, ON DOIT TOUT FAIRE POUR L’ÉVITER. »
Dans la préface et la postface de votre livre, vous évoquez votre maternité récente. Le fait de devenir maman a-t-il changé votre perception des enjeux environnementaux ?
C’est clair que ça remet les choses en perspective. Je me demande quels défis mon garçon va devoir affronter dans 15, 30 ou 50 ans. On n’aura pas le choix d’éduquer nos enfants pour qu’ils aient une résilience plus grande et pour leur donner des outils afin qu’ils puissent s’épanouir dans un monde qui va être plus difficile que celui qu’on connaît. Ça, c’est mon engagement personnel comme maman. Mais après, il ne sera jamais trop tard pour essayer d’améliorer leur futur, pour faire un changement positif. On le sait, on s’enligne sur un réchauffement planétaire de plus de trois degrés. La différence entre le 2,9 et le 3,1 est importante en termes d’impacts sur les écosystèmes. Chaque fraction de degré supplémentaire, on doit tout faire pour l’éviter.
Ce qui ressort dans votre livre, c’est qu’en tant que médecin, vous atteignez une certaine limite dans le sens où vous ne pouvez pas prescrire un environnement sain.
Je travaille dans Hochelaga-Maisonneuve, un quartier de Montréal où il y a moins de verdure qu’ailleurs, plus d’îlots de chaleur, plus de pollution industrielle. Un quartier historiquement très ouvrier, pas très riche,
qui n’a jamais été adéquatement représenté, où l’espérance de vie est moindre pour une multitude de facteurs. Ce n’est pas à coups de pilules que je vais régler quelque chose. Du moins, les pilules ont leurs limites. Si mes patients ne peuvent pas bouger de façon sécuritaire parce qu’il n’y a pas de pistes cyclables protégées, parce qu’il n’y a pas d’arbres dans leur quartier ou que leur parc, c’est une bande de deux mètres en bordure d’une autoroute, je n’y arriverai pas. J’ai dernièrement pris en charge un garçon qui faisait de l’asthme. Ses parents venaient de déménager sur le bord de la rue Notre-Dame, qui est quand même une autoroute où circulent beaucoup de camions. Je n’ai pas eu le choix d’avoir une discussion avec eux sur l’influence de cet environnement qui va potentiellement contribuer à aggraver ou à fragiliser le contrôle asthmatique de leur enfant. Sauf que ce n’est pas donné à tout le monde de déménager. Trouver un logement à prix abordable qui a des dimensions adéquates pour une famille, c’est de plus en plus difficile, surtout quand on a des moyens limités. Mais moi, dans mon bureau, je ne peux pas régler la pollution sur la rue Notre-Dame.
Vous mettez de l’avant le concept de « santé planétaire ». En quoi consiste-t-il ?
C’est un concept avec lequel je suis littéralement tombée en amour parce qu’il répond à tout ce que je cherchais. Il a été développé dans le monde anglo-saxon, il y a une dizaine d’années environ, en réponse aux limites du concept Une seule santé et de celui de santé mondiale ou globale. La « santé planétaire » se définit comme « la santé de la civilisation humaine et l’état des écosystèmes desquels elle dépend ». Elle repose sur l’idée que notre santé est interdépendante non seulement des écosystèmes dans lesquels on évolue, mais aussi de leur vitalité. Cela revient à concevoir que la santé n’est pas seulement déterminée dans un cadre hospitalier ou d’un système de soins. Elle dépend d’une multitude d’éléments, comme la qualité de l’eau, la qualité de l’air, la qualité des sols, le modèle agricole, etc. Autrement dit, si l’on veut réduire le fardeau de la maladie, la mortalité, augmenter l’espérance de vie et surtout la qualité de vie, il faut considérer les déter-
minants écologiques. Et ça, malheureusement, ça ne se fait encore que trop peu. On en a plein d’exemples récents au Québec dans lesquels on espère réduire la maladie à coups d’investissements dans le système de santé. Mais ce n’est pas avec des technologies de quatrième ou cinquième ligne que l’on va agir sur le plus grand nombre de personnes. Surtout dans un contexte où l’on sait que les pressions écologiques vont continuer de s’aggraver.
« LA SANTÉ N’EST PAS SEULEMENT DÉTERMINÉE DANS UN CADRE
HOSPITALIER OU D’UN SYSTÈME DE SOINS. ELLE DÉPEND D’UNE MULTITUDE D’ÉLÉMENTS COMME LA QUALITÉ DE L’EAU, LA QUALITÉ DE L’AIR, LA QUALITÉ DES SOLS, LE MODÈLE AGRICOLE, ETC. »
Vous rapportez dans votre livre de nombreuses études qui montrent les liens évidents entre la santé, l’environnement en général et les changements climatiques en particulier. En dépit de cette littératie, pourquoi la santé restet-elle dans l’angle mort des enjeux écologiques ?
Cela tient selon moi à une méconnaissance généralisée. On commence à peine à intégrer ces réalités dans le cursus des médecins à l’Université de Montréal. C’est le fruit d’un travail de fond que nous avons mené ces dernières années avec Éric Notebaert et d’autres collègues. Je pense que, si davantage de professionnels de la santé étaient adéquatement formés sur la question, il n’y aurait pas vraiment de doute sur la pertinence de l’action environnementale pour améliorer la santé des gens. Ça permettrait également de contaminer un petit peu les autres sphères. Dernièrement, on a rencontré des attachés politiques, des ministres, des sousministres, etc. Ils ont été surpris de découvrir les bienfaits de la verdure en milieu urbain. C’était une information nouvelle pour eux. Je trouve cela hallucinant. >
Ça vous surprend d’autant plus que vous considérez que la santé peut être un axe de mobilisation pour inciter le grand public à agir en faveur du climat.
J’y crois à cent pour cent et c’est un élément central derrière ce livre. Je pense que la santé peut changer le cours des conversations. Il n’y a rien qui fait autant l’unanimité que la santé. Il n’y a personne, aucun politicien qui n’a pas la santé à cœur. À Noël, au jour de l’An, à nos fêtes, on se souhaite toujours une bonne santé. C’est une valeur commune à nos sociétés, peu importe les origines culturelles, religieuses ou les orientations sexuelles. La santé peut servir à mobiliser les gens dans l’action environnementale. Pour moi, réduire les émissions de gaz à effet de serre, c’est ni plus ni moins une politique de santé pour éviter les décès provoqués par la pollution de l’air et le réchauffement planétaire. La ligne est très claire, mais on doit la tracer sans cesse pour que d’autres la voient aussi clairement que nous.
«
DE GAZ
EFFET
SERRE, C’EST NI PLUS NI MOINS UNE POLITIQUE DE SANTÉ POUR ÉVITER LES DÉCÈS
PROVOQUÉS PAR LA POLLUTION DE L’AIR ET LE RÉCHAUFFEMENT
PLANÉTAIRE. »
Malgré tout, depuis la pandémie de COVID-19, la crise climatique est repassée sous les radars.
Il y a un enjeu de connaissance, mais aussi de communication. Cette question-là obsède les chercheurs dans différents domaines : pourquoi on n’arrive pas à transmettre adéquatement l’urgence de l’action climatique ? Il y a plusieurs hypothèses que j’aborde un peu dans le livre, mais c’est surtout une question de distance psychologique. Les gens ont de la misère à percevoir la menace comme réelle et proche. Mais cet été, on va revivre des canicules, on va revivre des feux de forêt et on
va ramener cette conversation-là dans l’espace public. Je pense aussi qu’il y a une forme de protection. C’est tellement difficile d’imaginer un futur qui serait différent du présent que l’on connaît. On espère encore une technologie miracle qui va nous sauver. Mais cette technologie-là n’arrivera pas. On n’a pas le choix de retourner à l’essentiel, de ralentir, de profiter de la nature, de produire moins et de consommer moins. On peut avoir du bonheur en sortant un peu de cette société de performance, de surconsommation. Quand on parle de réduire un petit peu, les gens ont souvent l’impression qu’on va revenir en 1850, se chauffer au bois et qu’on mangera du pain au souper. Il y a clairement un juste milieu, mais on manque de modèles qui montrent que c’est possible.
Dans ce contexte, quel rôle peuvent jouer les professionnels de la santé à leur niveau ?
Notre premier engagement est « d’abord, ne pas nuire ». On doit néanmoins reconnaître que l’on travaille dans un réseau de la santé qui pollue, qui consomme énormément d’énergie et dans lequel la gestion des déchets est défaillante. Donc, nos milieux de soins finissent par nuire en contribuant aux émissions de gaz à effet de serre. Cela dit, les possibilités de faire mieux sont multiples. La difficulté, c’est que les médecins, les pharmaciens et les dentistes se sentent un peu seuls dans leur coin. Ils ne savent pas trop par où commencer. Je les invite à venir voir ce qu’on fait à l’Association québécoise des médecins pour l’environnement. Depuis deux ou trois ans, on héberge une communauté de pratique écoresponsable qui s’appelle Éco Propulsion et qui est super active. L’ambition est de partager les bonnes pratiques un petit peu partout à travers le réseau. Les professionnels peuvent s’inspirer, prendre des idées et on va les aider à les mettre en œuvre. C’est plus stimulant quand on agit collectivement, ça crée un sentiment d’appartenance et ça donne du sens à notre engagement.

Santé planétaire – Prescriptions médicales pour un environnement sain
Claudel Pétrin-Desrosiers
Écosociété
224 pages
Au-delà d’adopter des pratiques respectueuses de l’environnement, les professionnels de la santé n’ont-ils pas aussi un devoir d’advocacy ?
Je ne m’attends pas à ce que tous les médecins aillent voir leur député demain. Il y a d’autres formes d’action. Je pense par exemple qu’on n’a pas le choix d’identifier nos patients qui sont vulnérables à la chaleur extrême ou à la fumée provenant des feux de forêt, de les conseiller et de les aider à trouver des solutions cliniquement appropriées à leur condition. Après, qu’on le veuille ou pas, on a, comme médecin, une certaine forme d’autorité éthique et morale. Pour moi, cela vient avec une certaine responsabilité qui dépasse un peu notre responsabilité clinique. Il y a trois ou quatre ans, la vingtaine de médecins de notre clinique s’est publiquement opposée contre un projet logistique dans le quartier. Nos patients ont eu le sentiment d’être entendus, d’être compris et que leurs médecins se souciaient d’un enjeu qui était important pour eux. Ça a créé des liens de confiance entre nous. Les gens veulent être pris au sérieux et compris. Même si on ne règle pas leur problème, ils se sentent plus respectés. n
* Les propos ont été adaptés par souci de clarté.







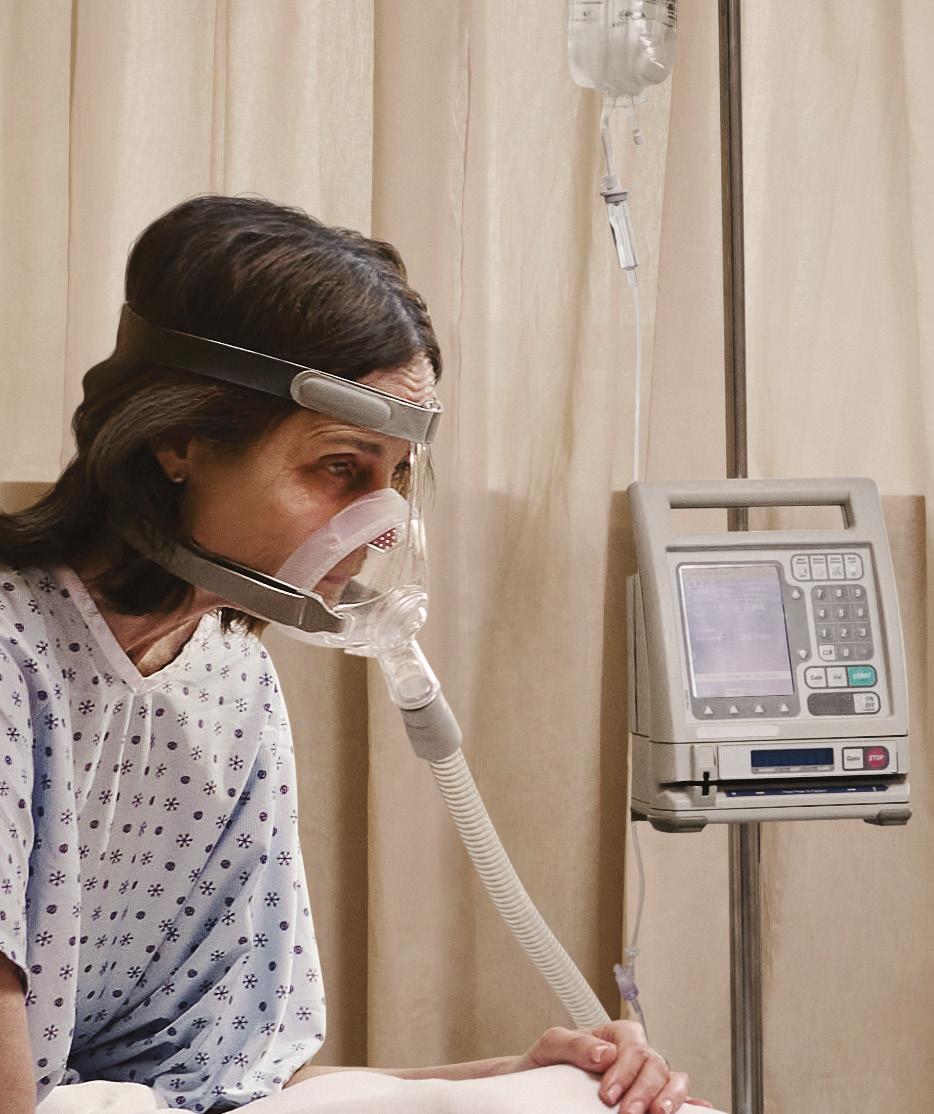

Pour les personnes âgées de 60 ans et plus ou celles qui ont des problèmes de santé chroniques ou un système immunitaire affaibli, le VRS peut avoir des répercussions graves, et même être fatal1,2 . Chez les adultes âgés hospitalisés en raison d’une infection par le VRS :
• ~1 patient sur 9 âgé de 65 ans et plus est décédé dans les 30 jours3*
• ~1 patient sur 7 âgé de 60 ans et plus a montré une perte d’autonomie au moment du congé de l’hôpital4†‡
Passez à l’action en amorçant la conversation dès aujourd’hui
Aidez à éviter les répercussions inutiles du VRS.
Numérisez le code pour connaître les faits ou visitez le site knowthetoll.ca
VRS = virus respiratoire syncytial.
* Toutes causes confondues. Étude de cohorte rétrospective de l’Ontario, au Canada. Données sur les hospitalisations recueillies pour les saisons 2010–2011 à 2018–2019 des virus respiratoires.
† Diff érence de 14 % : 40 % des patients vivaient de façon autonome avant l’hospitalisation (n = 122/302) comparativement à 26 % au moment du congé de l’hôpital (n = 79/302, p < 0,01).
‡ 302 adultes de 60 ans et plus hospitalisés en raison d’une infection par le VRS confi rmée par un laboratoire ont été inscrits. La situation de vie a été évaluée 2 semaines avant l’hospitalisation, au moment de l’inscription et au congé de l’hôpital.
1. Centers for Disease Control and Prevention. RSV in older adults fact sheet. Disponible au : https://www.cdc.gov/rsv/older-adults. Consulté en mars 2025. 2. Gouvernement du Canada. Virus respiratoire syncytial (VRS) : Pour les professionnels de la santé. Disponible au : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/ maladies/virus-respiratoire-syncytial-vrs/professionnels-sante.html. Consulté en mars 2025. 3. Branche AR, et al. Change in functional status associated with respiratory syncytial virus infection in hospitalized older adults. Infl uenza Other Respir Viruses 2022;16:1151–1160. 4. Hamilton MA, et al. Predictors of all-cause mortality among patients hospitalized with influenza, respiratory virus, or SARS-CoV-2. Influenza Other Respir Viruses 2022;16:1072–1081.
Les marques de commerce sont détenues ou utilisées sous licence par le groupe de sociétés GSK.

Médicament indiqué à la fois dans la gestion du poids à long terme et pour réduire le risque d’IM non mortel chez les adultes atteints d’une MCV établie et ayant un IMC ≥ 27 kg/m2*


Pour les adultes atteints d’obésité ± une MCV OU un surpoids + une MCV ou d’autres facteurs de risque
Quelles sont les indications de Wegovy® ?
Wegovy® (sémaglutide injection) est indiqué1 :
• en complément d’un régime alimentaire hypocalorique et d’une augmentation de l’activité physique pour la gestion du poids à long terme chez les patients adultes présentant un indice de masse corporelle (IMC) initial de 30 kg/m2 ou plus (obésité) ou de 27 kg/m2 ou plus (surpoids) en présence d’au moins un facteur de comorbidité liée au poids comme l’hypertension, le diabète de type 2, la dyslipidémie ou l’apnée obstructive du sommeil;
• afin de réduire le risque d’infarctus du myocarde non mortel chez les adultes atteints d’une maladie cardiovasculaire établie et ayant un IMC égal ou supérieur à 27 kg/m2 .
Wegovy® ne doit pas être utilisé en association avec tout autre médicament contenant du sémaglutide (p. ex., Ozempic® et Rybelsus®) ou tout autre agoniste du récepteur du GLP-1.
Quel est le mode d’action de Wegovy® ?**
Le GLP-1 est un régulateur physiologique de l’appétit et de l’apport calorique1. Le sémaglutide est à 94 % semblable au GLP-1 humain et agit comme agoniste du récepteur du GLP-1 qui se lie aux récepteurs du GLP-1 et les active. Comparativement au GLP-1 naturel, le sémaglutide a une demivie prolongée d’environ 1 semaine. Le principal mécanisme de la protraction est la liaison à l’albumine, qui entraîne une diminution de la clairance rénale et une protection contre la dégradation métabolique. Par ailleurs, le sémaglutide est stabilisé contre la dégradation par l’enzyme DPP-41.
Quelles sont les recommandations des lignes directrices?
Le sémaglutide à 2,4 mg est recommandé comme option de prise en charge de l’obésité par les Lignes directrices canadiennes de pratique clinique de l’obésité chez l’adulte2
Quelles ont été les données tirées des essais cliniques sur l’efficacité de Wegovy® ?
ESSAI STEP 5 : À la semaine 104, chez les adultes atteints d’obésité ou présentant un surpoids et au moins une comorbidité liée au poids, une puissante perte de poids à deux chiffres a été démontrée avec Wegovy® sur une période de deux ans, comparativement au placebo3£†.
* La portée clinique comparative n’a pas été établie.
**La portée clinique n’a pas été établie.
*
∆ Selon l’estimation de la politique de traitement.
† Plan de l’étude STEP 5 : Essai de phase 3, randomisé, à double insu, contrôlé par placebo, d’une durée de 104 semaines, mené auprès de 304 patients atteints d’obésité (IMC ≥ 30 kg/m2) ou présentant un excès de poids (IMC ≥ 27 à < 30 kg/m2) et au moins une comorbidité liée au poids; les patients diabétiques ont été exclus. Les patients ont été répartis aléatoirement selon un rapport 1:1 pour recevoir le sémaglutide 2,4 mg ou le placebo une fois par semaine, en complément d’un régime alimentaire hypocalorique et d’une augmentation de l’activité physique. Les co-critères d’évaluation principaux étaient la variation en pourcentage du poids corporel entre le début de l’essai et la semaine 104 et l’atteinte d’une perte de poids ≥ 5 % du poids initial à la semaine 1043 ‡ Plan de l’étude STEP 1 : Essai de phase 3, randomisé, à double insu, contrôlé par placebo, d’une durée de 68 semaines auquel ont participé 1961 patients atteints d’obésité (IMC ≥ 30 kg/m2) ou de surpoids (IMC ≥ 27 kg/m2 à < 30 kg/m2) et présentant au moins une complication liée au poids, qui ont été répartis aléatoirement selon un rapport 2:1 entre le sémaglutide à 2,4 mg et un placebo. Les patients diabétiques ont été exclus. Tous les patients ont suivi un régime hypocalorique et ont augmenté leur activité physique pendant toute la durée de l’essai. La majorité des patients présentaient au moins une complication liée au poids. Les critères d’évaluation principaux de l’efficacité étaient le pourcentage de variation du poids corporel entre le début de l’essai et la semaine 68 et le pourcentage de patients atteignant ≥ 5 % de réduction du poids corporel4
Wegovy® (n = 152)
Placebo (n = 152) +
et
Poids corporel moyen ± É.-T. à la semaine 0 = 105,6 ± 20,8 kg (Wegovy®) et 106,5 ± 23,1 kg (placebo). Population en IDT; analyse de l’IM.
D’après Garvey, WT et al. (2022)3
La dose d’entretien de Wegovy® est de 2,4 mg une fois par semaine1. Veuillez consulter la monographie de produit ou la section sur la posologie de ce document pour obtenir des renseignements plus détaillés sur la posologie recommandée.
ESSAI STEP 1 : À la semaine 68, chez les adultes avec l’obésité ou présentant un surpoids et au moins une comorbidité liée au poids, Wegovy® a montré des effets sur les paramètres cardiométaboliques sélectionnés, la maîtrise de la glycémie et le fonctionnement physique (critères d’évaluation secondaires)1,4‡.
Les critères d’évaluation secondaires de soutien n’ont pas été contrôlés pour la multiplicité. Wegovy® n’est pas indiqué pour traiter ces paramètres cardiométaboliques ni le fonctionnement physique.
Tour de taille
Tension artérielle systolique
Tension artérielle diastolique
HbA1C
Fonctionnement physique
Cholestérol total
Cholestérol LDL
Cholestérol HDL
Triglycérides
Paramètres cardiométaboliques et glycémiques à la semaine 68 (Wegovy® [départ], placebo [départ], différence en % vs placebo [MMC; IC à 95 %], respectivement) : Tour de taille : -13,5 cm (114,6 cm); -4,1 cm (114,8 cm); -9,4 (-10,3, -8,5) p < 0,0001 (analyse bilatérale non ajustée pour la supériorité). Tension artérielle systolique : -6,2 mmHg (126 mmHg); -1,1 mmHg (127 mmHg); -5,1 (-6,3, -3,9) p < 0,001 (analyse bilatérale non ajustée pour la supériorité). Tension artérielle diastolique : -2,8 mmHg (80 mmHg); -0,4 mmHg (80 mmHg); -2,4 (-3,3, -1,6). HbA1C : -0,5 % (5,7 %); -0,2 % (5,7 %); -0,3 (-0,3, -0,2). Cholestérol total : -3,3 % (4,9 mmol/L); 0,1 % (5,0 mmol/L); -3,3 (-4,8, -1,8). Cholestérol LDL : -2,5 % (2,9 mmol/L); 1,3 % (2,9 mmol/L); -3,8 (-5,9, -1,5). Cholestérol HDL : 5,2 % (1,3 mmol/L); 1,4 % (1,3 mmol/L); 3,8 (2,2, 5,4). Triglycérides : -21,9 % (1,4 mmol/L); -7,3 % (1,4 mmol/L); -15,8 (-18,8, -12,7)1,4.
analyse IM : analyse d’imputation multiple; É.-T. : écart-type; GLP-1 : glucagon-like peptide-1 (peptide-1 analogue au glucagon); HbA1C : hémoglobine glyquée; HDL : lipoprotéine de haute densité; IC : intervalle de confiance; IDT : intention de traiter; IM : infarctus du myocarde; IMC : indice de masse corporelle; MCV : maladie cardiovasculaire; LDL : lipoprotéine de faible densité; MMC : moyenne des moindres carrés.
La proportion des patients ayant obtenu des améliorations cliniquement significatives du fonctionnement physique était définie comme étant la proportion des patients ayant obtenu une amélioration du score de fonctionnement physique d’au moins 3,7 points selon le questionnaire SF-36v2 et d’au moins 14,6 points selon le questionnaire IWQOL-Lite-CT : respectivement (Wegovy® comparativement au placebo) : SF-36v2 : 39,8 % vs 24,1 %; IWQOL-Lite-CT : 51,8 % vs 28,3 %#.
ESSAI SELECT1,5§
• Parmi les 17 604 patients qui ont participé à l’essai SELECT, le délai moyen de suivi était de 39,8 ± 9,4 mois.
• Le critère d’évaluation principal était le temps écoulé entre la répartition aléatoire et la première survenue d’un événement cardiovasculaire indésirable majeur (ECIM), défini comme un critère d’évaluation composite consistant en : un décès d’origine CV, un infarctus du myocarde non mortel ou un accident vasculaire cérébral (AVC) non mortel.
• Un événement cardiovasculaire indésirable majeur (ECIM) est survenu chez 569 patients (6,5 %) dans le groupe Wegovy® et chez 701 patients (8,0 %) dans le groupe placebo (RR = 0,80; IC à 95 % [0,72, 0,90]; p < 0,001).
Chez les adultes présentant une MCV établie et un surpoids ou de l’obésité et recevant les soins usuels CV, une puissante réduction du risque relatif d’IM non mortel a été démontrée avec Wegovy® comparativement au placebo (critère d’évaluation secondaire de soutien, les deux en association avec des soins usuels)1,5§.
Réduction de 28% du risque relatif d’IM non mortel RR = 0,72; IC à 95 % [0,61, 0,85]; critère d’évaluation secondaire de soutien
+SoC
Temps écoulé depuis la répartition aléatoire (mois)
D’après la monographie de Wegovy®.
Wegovy® : 2,7 % (234 événements; n = 8803) p/r au placebo : 3,7 % (322 événements; n = 8801), les deux en association avec des soins usuels.
Données recueillies lors de la période de l’essai. Les estimations de l’incidence cumulée sont fondées sur le temps écoulé entre la répartition aléatoire et la survenue d’un premier IM non mortel confirmé par le CEE, les décès de toutes causes confondues ayant été modélisés comme risque concurrentiel à l’aide de l’estimateur Aalen-Johansen. Les sujets ne présentant pas d’événements d’intérêt particulier ont été censurés à la fin de leur période d’observation en cours d’essai.
Temps écoulé entre la répartition aléatoire et le premier ECIM, les composantes de l’ECIM et les critères d’évaluation secondaires de confirmation et de soutien.
Critère d’évaluation principal
Composantes du critère d’ECIM
Décès d’origine CV
IM non mortel
AVC non mortel
Critères d’évaluation secondaires confirmatoires
Critère composite de l’insuffisance cardiaque£
Décès toutes causes confondues
En faveur de Wegovy® 0,6 0,8 1,0 1,2 En faveur du placebo
D’après la monographie de Wegovy®.
Wegovy® n’est pas indiqué pour réduire le risque d’ECIM, de décès CV, d’AVC non mortel, d’insuffisance cardiaque ou de décès toutes causes confondues. Données recueillies lors de la période de l’essai. Le temps écoulé entre la répartition aléatoire et chaque critère d’évaluation a été analysé à l’aide d’un modèle à risques proportionnels de Cox avec le traitement comme facteur fixe catégorique. Les sujets qui ne présentaient pas d’événements d’intérêt particulier ont été censurés à la fin de leur période de participation à l’essai. Pour le critère d’évaluation principal, le RR et l’IC ont été ajustés en fonction de la conception séquentielle du groupe en utilisant l’ordre du rapport de probabilité. Les critères d’évaluation secondaires ne sont pas sous contrôle de multiplicité. Les décès d’origine CV comprennent les décès dus aux maladies cardiovasculaires et les causes de décès indéterminées.
AVC: accident vasculaire cérébral; CEE : comité d’examen des évenements; CV : cardiovasculaire; ECIM : évenement cardiovasculaire indésirable majeur; GI : gastro-intestinaux; IWQOL-Lite-CT : Impact of Weight on Quality of Life-Lite for clinical trials (questionnaire abrégé sur l’incidence du poids sur la qualité de vie spécifique à l’obésité pour les essais cliniques); MAP : maladie artérielle périphérique; RR : rapport de risques; SF-36v2 : Short Form Health Survey Version 2; SoC : standard de soins.
Quelle est la posologie de Wegovy® ?
Wegovy® a une posologie pratique d’une fois par semaine. L’augmentation progressive de la dose sur 16 semaines contribue à réduire la probabilité d’EI liés aux troubles GI1.



MOIS 1 (semaines 1 à 4) 0,25 mg une fois par semaine
DIN: 02528509

MOIS 2 (semaines 5 à 8) 0,5 mg une fois par semaine
DIN: 02528517

MOIS 3 (semaines 9 à 12) 1 mg une fois par
DIN: 02528525
Si votre patient ne tolère pas la dose de 2,4 mg de Wegovy® :
• Réduire temporairement la dose à 1,7 mg par semaine, pendant un maximum de 4 semaines.
• Les patients doivent reprendre l’augmentation progressive de la dose jusqu’à l’atteinte de la dose de 2,4 mg.
Si votre patient oublie une dose, conseillez-lui de :
• Prendre Wegovy® dès que possible si la prochaine dose prévue est dans 2 jours (48 heures) ou plus.
• Ne pas prendre la dose oubliée de Wegovy® et reprendre le traitement hebdomadaire comme prévu si la prochaine dose prévue est dans moins de 2 jours (48 heures).
Pour obtenir les renseignements complets sur la posologie, veuillez consulter la monographie de produit.
Quelle est la méthode d’administration de Wegovy® ? Wegovy® se présente sous forme de stylo prérempli FlexTouch®, conçu pour être facile à utiliser. Wegovy® est administré par injection sous-cutanée.

indiquant que l’administration de la dose est terminée
Muni d’un code de couleur : Aide à identifier la dose d’un stylo
Chaque emballage Wegovy® contient :
Dose unique, usage multiple : Quatre doses préétablies une fois par semaine dans chaque stylo
• 1 stylo injecteur FlexTouch® prérempli contenant 4 doses fixes d’une concentration de Wegovy® (soit 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 1,7 mg ou 2,4 mg)
• 4 aiguilles NovoFine®
Une ordonnance distincte est requise pour chaque concentration. Chaque stylo prérempli a un DIN différent selon la concentration des doses qu’il contient (0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 1,7 mg, 2,4 mg). Une ordonnance distincte est donc requise pour chaque concentration. Les aiguilles sont incluses dans l’emballage de tous les stylos (aucune ordonnance requise).

Regardez cette vidéo illustrant les étapes à suivre pour aider vos patients à apprendre à utiliser Wegovy® avec un stylo FlexTouch® prérempli.
# Scores de fonctionnement physique au départ selon le questionnaire SF-36v2 : 51,0 (groupe traité par Wegovy®) et 50,8 (groupe placebo). Scores de fonctionnement physique au départ selon le questionnaire IWQOL-Lite-CT : 65,4 (groupe traité par Wegovy®) et 64,0 (groupe placebo). § Plan de l’étude SELECT : Essai randomisé, à double insu, contrôlé par placebo et axé sur les événements, mené chez 17 604 patients présentant un IMC ≥ 27 kg/m2 et une MCV établie (antécédent d’IM, antécédent d’AVC et/ou MAP). Les patients ayant des antécédents de diabète ont été exclus. Les patients ont été répartis aléatoirement selon un rapport 1:1 pour recevoir le sémaglutide à 2,4 mg ou un placebo en plus des soins usuels CV. À la visite de référence, 92,0 % des patients recevaient des médicaments CV (70,2 % des bêta-bloquants, 45,0 % des inhibiteurs de l’ECA, 29,5 % des antagonistes des récepteurs de l’angiotensine et 26,9 % des inhibiteurs calciques); 90,1 % recevaient des agents hypolipémiants (principalement des statines [87,6 %]); et 86,2 % recevaient des agents antiplaquettaires. Le critère d’évaluation principal était le temps écoulé entre la répartition aléatoire et le premier cas d’ECIM, défini comme un décès CV, un IM non mortel ou un AVC non mortel1 £ Le critère d’évaluation composite de l’insuffisance cardiaque a été défini comme le temps écoulé avant le premier cas d’hospitalisation pour insuffisance cardiaque, de consultation urgente pour insuffisance cardiaque ou de décès d’origine cardiovasculaire.
Comment entreposer Wegovy® ?
Avant la première utilisation : Conserver le produit au réfrigérateur (entre 2 et 8°C).
Après la première utilisation : Conserver le produit à une température inférieure à 30°C ou au réfrigérateur (entre 2 et 8°C) jusqu’à 8 semaines.
• Protéger le produit de la chaleur excessive et de la lumière (laisser le capuchon sur le stylo). Ne pas congeler le produit.
• Retirer toujours l’aiguille d’injection après chaque injection et ranger le stylo sans qu’une aiguille y soit fixée.
• Après la dernière dose de Wegovy®, le stylo doit être jeté conformément aux exigences locales.
Quel est le profil d’innocuité de Wegovy® ?
Essais STEP 1-3 : Dans le cadre de trois essais cliniques sur la gestion du poids menés sur une période de 68 semaines et contrôlés par placebo, le profil d’innocuité de Wegovy® a été établi chez plus de 2000 patients1
Les effets indésirables le plus fréquemment signalés (survenant chez ≥ 10 % des patients traités par Wegovy®) étaient les suivants1 :
Nausée
Diarrhée
Constipation
Vomissements
Douleur abdominale
Maux de tête
Fatigue
La plupart des événements GI étaient légers ou modérés et transitoires, et n’ont pas abouti à l’interruption du traitement. L’interruption permanente du traitement en raison d’EI GI est survenue chez 4,3 % des personnes traitées par Wegovy® par rapport à 0,7 % des personnes recevant le placebo.
Essai SELECT : Le profil d’innocuité de Wegovy® dans l’essai SELECT était généralement semblable à celui signalé dans les essais de phase 3a sur la gestion du poids, à quelques exceptions près (n = 8803 utilisateurs de Wegovy®). Veuillez consulter la monographie de produit pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les EI comme les fractures du col fémoral, du fémur, de la hanche et du bassin survenues chez 1,0 % (24/2488) et 0,2 % (5/2424) des patients recevant Wegovy® ou le placebo, respectivement1
Le profil d’innocuité de Wegovy® a été établi chez plus de 2000 patients dans le cadre d’essais cliniques sur la gestion du poids et chez plus de 8000 patients lors de l’essai sur les résultats cardiovasculaires1
Aidez vos patients à gérer les effets secondaires GI grâce à des conseils sur le mode de vie. Encouragez-les à6 :
• Prendre des repas plus petits.
• S’abstenir de manger quand ils sont rassasiés ou qu’ils n’ont pas faim.
• Boire plus d’eau et consommer des aliments à haute teneur en fibres.
• Éviter les aliments épicés et riches en matières grasses.
• Limiter leur consommation d’alcool ou de boissons gazeuses.
Y a-t-il un programme de soutien aux patients pour Wegovy® ? Oui. Avant l’exécution de leur première ordonnance de Wegovy®, encouragez vos patients à s’inscrire au programme GRATUIT de soutien aux patients Novo Nordisk Care® pour Wegovy®, en allant à wegovy.ca¶ et en saisissant le DIN : 02528509.
Grâce au programme Novo Nordisk Care® pour Wegovy®, vos patients auront accès aux avantages suivants :
• Carte de rabais¥


• Orientation dans les couvertures d’assurance médicaments
• Soutien d’un éducateur (infirmière accréditée, diététiste accrédité ou pharmacien)
• Vidéos utiles
• Articles informatifs
• Ressources éducatives sur la gestion du poids

Allez à wegovy.ca¶ dès aujourd’hui pour en savoir plus sur la façon dont le programme Novo Nordisk Care® pour Wegovy® peut aider vos patients traités par Wegovy®!
Le programme Novo Nordisk Care® pour Wegovy® est exclusivement destiné aux résidents du Canada. La disponibilité de ce programme peut changer ou prendre fin à tout moment, à la discrétion du fabricant. Pour de plus amples détails, consultez les modalités du programme. L’admissibilité à la couverture est déterminée par le fournisseur d’assurance du patient et/ou le promoteur du régime. Novo Nordisk Canada Inc. ne peut pas garantir l’approbation de la couverture.
Utilisation clinique : Wegovy® ne doit pas être utilisé en association avec d'autres médicaments contenant du sémaglutide (par ex., Ozempic®, Rybelsus®) ni avec tout autre agoniste du récepteur du GLP1. L'efficacité et la sécurité d'emploi en association avec d'autres produits destinés à la gestion du poids n'ont pas été établies. Wegovy® n'est pas indiqué dans le diabète de type 1 ni dans l'acidocétose diabétique.
Contre-indications :
• Antécédents personnels ou familiaux de carcinome médullaire de la thyroïde (CMT) ou une adénomatose pluriendocrinienne de type 2.
• Grossesse ou allaitement.
Mises en garde et précautions les plus importantes : Risque de tumeurs des cellules C de la thyroïde : le sémaglutide provoque des tumeurs des cellules C de la thyroïde liées au traitement chez les rats et les souris des deux sexes. On doit informer les patients du risque de tumeurs de la thyroïde et les renseigner sur leurs symptômes.
Autres mises en garde et précautions pertinentes :
• Effets cardiovasculaires : augmentation de la fréquence cardiaque, allongement de l’intervalle PR et utilisation en cas d’insuffisance cardiaque
• Risque théorique de dépendance, de tolérance et/ou d’abus
• Risque d’hypoglycémie en cas d’utilisation concomitante d’insuline ou de sécrétagogue de l’insuline (la prudence est de mise lors de la conduite d’un véhicule ou de l’utilisation d’une machine)
• Événements indésirables gastrointestinaux entraînant une déshydratation
• Retard de la vidange gastrique
• Pancréatite aiguë
• Maladie aiguë de la vésicule biliaire
• Hypersensibilité
• Troubles de la rétine chez les patients atteints de diabète de type 2
• Comportement et idées suicidaires
• Aspiration en association avec une anesthésie générale ou une sédation
• Lésion rénale aiguë
• Utiliser avec prudence en cas d’insuffisance hépatique
• Ne pas utiliser en cas d’insuffisance rénale de stade terminal
• Fertilité
• Utilisation d’un moyen de contraception recommandée
Pour de plus amples renseignements : Veuillez consulter la monographie de produit sur www.wegovypmf.ca pour obtenir d’autres renseignements sur les effets indésirables, les interactions médicamenteuses et la posologie qui n’ont pas été abordés dans ce document. Vous pouvez aussi vous procurer la monographie de produit en appelant Novo Nordisk au 18004654334.
DIN : numéro d’identification du médicament; EI : événement indésirable; PSP : programme de soutien aux patients.
¶ Le site wegovy.ca est accessible au grand public.
¥ Des exclusions peuvent s’appliquer. L’utilisateur peut être responsable de coûts non couverts par sa carte de rabais Novo Nordisk Care®. Le fabricant se réserve le droit de modifier ce programme ou d’y mettre fin, à sa discrétion.
Références:
1. Novo Nordisk Canada Inc. Monographie de Wegovy®. 11 mars 2025.
2. Pedersen S, et al. Canadian Adult Obesity Clinical Practice Guidelines: Pharmacotherapy in Obesity Management. 2020. Disponible au : https://obesitycanada.ca/guidelines/ pharmacotherapy. Consulté le 1er février 2025.
3. Garvey WT, et al. Two year effects of semaglutide in adults with overweight or obesity: The STEP 5 trial. Nat Med. 2022;28(10):2083 2091.
4. Wilding JPH, et al. Once weekly semaglutide in adults with overweight or obesity. N Engl J Med. 2021;384(11):989 1002.
5. Lincoff AM, et al. Semaglutide and Cardiovascular Outcomes in Obesity without Diabetes. N Engl J Med. 2023;389(24):22212232.
6. Wharton S, et al. Canadian Adult Obesity Clinical Practice Guidelines: Obesity in Adults: A Clinical Practice Guideline. 2020. Disponible au : https://www.cmaj.ca/content/192/31/E875. Consulté le 10 septembre 2020.
Toutes les marques de commerce et les marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Wegovy®, wegovycare®, FlexTouch®, NovoFine®, Ozempic®, Rybelsus® et Apis Bull Design® sont des marques déposées de Novo Nordisk A/S utilisées sous licence par Novo Nordisk Canada Inc. Novo Nordisk Canada Inc., tél. : 905 629 4222 ou 1 800 465 4334. www.novonordisk.ca

Ce n’est pas écrit noir sur blanc dans les manuels de stage ou les guides du résident, mais les attentes des superviseurs sont bien réelles – et parfois inflexibles. En médecine comme en pharmacie, les patrons veulent plus que de la compétence clinique : ils observent l’attitude, la capacité d’adaptation, la posture professionnelle. Que faut-il comprendre, décoder, anticiper pour éviter les faux pas et tirer le meilleur de sa formation pratique ?
Quelles qualités sont appréciées par les médecins qui supervisent des externes et des résidents ? Quelles compétences cliniques ces derniers doivent-ils détenir ? Et quelles habiletés interpersonnelles doivent-ils démontrer ? Sept patrons de différentes spécialités médicales dévoilent leurs attentes vis-à-vis de la relève.
GEOFFREY DIRAT
De toute évidence, on ne demande pas les mêmes compétences cliniques à un externe qu’à un résident. Le niveau d’autonomie, la capacité à poser des diagnostics ou encore le traitement des patients : tout cela évolue conformément au cursus médical. En revanche, les qualités humaines attendues sont constantes. Qu’on vise le titre de docteur en médecine ou qu’on s’approche du permis d’exercice, les patrons observent ces aptitudes personnelles avec attention. Car pour eux, les savoir-être ne sont pas des options, ce sont des prérequis du référentiel CanMEDS.
Cela va sans dire, mais ça va mieux en le disant : être à l’heure, prévenir en cas de retard, signaler ses absences éventuelles, « ça demeure la base », souligne le Dr Mathieu Pelletier, professeur titulaire au département de médecine familiale et d’urgence de l’Université Laval. Une observation que l’omnipraticien au GMF-U du Nord de Lanaudière justifie par l’absentéisme qu’il constate « trop souvent ».
Sa consœur du GMF-U St. Mary, la Dre Isabelle Leblanc, estime que les étudiants et les résidents ont « plus de liberté dans leur horaire » qu’auparavant, mais qu’ils ont aussi tendance à moins le respecter. « Les patients ont des rendez-vous, il faut être à l’heure », rappelle si besoin la professeure adjointe au département de médecine de famille de l’Université McGill. En plus de la ponctualité exigée, « on s’attend à une certaine flexibilité », ajoute-t-elle, car « les horaires peuvent changer », au gré des aléas.
Au-delà de la politesse des rois, la Dre Leblanc observe surtout les aptitudes de communication chez les stagiaires en externat. « Ils n’ont pas encore eu de cours spécifiques à la médecine de famille, alors je m’intéresse à leur façon d’interroger les patients pour faire leur anamnèse, puis comment ils me racontent leur histoire. »
En pédiatrie, « le savoir-être avec le patient et ses parents, c’est la pierre angulaire », indique pour sa part le Dr Jean Sébastien Tremblay-Roy. Pour le directeur du département de pédiatrie de l’Université de Sherbrooke, le savoir clinique, « c’est le plus simple, car ça s’apprend dans les livres. La complexité se trouve plutôt dans la relation à créer avec un patient qui peut avoir 6 mois ou 15 ans. »
Esprit d’équipe
Aux soins intensifs, la communication avec le patient est généralement plus limitée. Le Dr François Marquis est plutôt sensible à l’esprit d’équipe. « On les initie très tôt à l’importance du travail multidisci-
plinaire », mentionne le professeur agrégé à l’Université de Montréal. Sa tournée matinale, il la fait avec les externes, les résidents, les infirmières, les ergothérapeutes et les inhalothérapeutes. « Chacun a son mot à dire. On cherche à briser le moule hiérarchique et à passer le message que sans équipe, ils ne vont aller nulle part », énonce le chef du service de soins intensifs à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Cette notion de joueur d’équipe est aussi importante aux yeux du Dr Mathieu Pelletier. Il ausculte « l’attitude collaborative » avec les travailleurs de la santé et particulièrement « le comportement avec les infirmières ». « Avant, on regardait moins ça », convient le clinicien qui déplore les postures « souvent hautaines » de certains aspirants médecins.
Le Dr Guillaume Lafortune apprécie également que la relève soit rigoureuse et consciencieuse. Plus spécifiquement, le chargé d’enseignement et de clinique au département de neurosciences de l’Université de Montréal considère qu’un résident doit « connaître ses limites. Des fois, on ne veut pas déplaire au patron, mais être capable de demander de l’aide, c’est un signe de maturité et de jugement », affirme le neurologue.
« Chercher de l’aide figure dans les algorithmes de décision », rappelle d’ailleurs le Dr Mony Chhiv. Le professeur agrégé au département de chirurgie de l’Université Laval souligne que sa discipline est de plus en plus surspécialisée. « Il y a toujours de garde quelqu’un de plus spécialisé que nous. Alors, il faut piler un peu sur son orgueil et l’appeler. Entre collègues, ça se fait bien », rapporte le chirurgien.
Soif d’apprendre
Outre l’humilité, la curiosité est une « belle qualité qui permet de se démarquer », signifie le Dr Jean Sébastien Tremblay-Roy. Selon lui, chaque opportunité d’apprentissage doit être saisie. « La médecine est une science infinie. Avec un patient, on peut apprendre des centaines de choses », certifie le pédiatre.
Le Dr Mony Chhiv escompte lui aussi que les étudiants, spécialement les externes, témoignent de l’intérêt pour les cas présentés. « On s’attend moindrement à un minimum de questions », convient le clinicien en précisant que le stage d’externat, effectué en troisième année, est « leur premier et seul contact avec la chirurgie » durant le cursus du doctorat.
En plus de l’appétence pour sa spécialité, le Dr Chhiv anticipe que ces stagiaires de l’externat junior connaissent la base des chirurgies possibles et la variété des pathologies couvertes, car en six semaines, « ils

:
« LE SAVOIR-ÊTRE AVEC LE PATIENT ET SES PARENTS, C’EST LA PIERRE ANGULAIRE. »
Dr Jean Sébastien Tremblay-Roy, pédiatre et directeur du département de pédiatrie de l’Université de Sherbrooke
vont pouvoir rencontrer un large éventail de situations cliniques ». En ce qui a trait aux compétences plus médicales, le questionnement pertinent du patient est pour lui un prérequis, les étudiants devant être en capacité « d’établir un diagnostic différentiel conséquent, de prescrire les examens initiaux et de commencer à les interpréter ».
« Ne pas nuire »
Dans d’autres spécialités, les exigences auprès des externes sont moindres en termes de compétences cliniques. Le Dr François Marquis, par exemple, déclare ne pas avoir d’attentes particulières, si ce n’est de ne « pas être une nuisance ». L’intensiviste précise que « c’est un stage très court, de deux semaines, plus deux autres en option. C’est essentiellement une sensibilisation à la reconnaissance de l’urgence », résume-t-il sommairement.
En neurologie, le Dr Guillaume Lafortune trouve également que le stage d’externat est assez bref : « Quatre semaines pour apprendre la neurologie, c’est impossible ! » Les étudiants vont toutefois découvrir tous les troubles cognitifs et, à tout le moins, « ils vont apprendre à faire les examens nécessaires et dans quelles circonstances ils doivent agir rapidement », précise le spécialiste qui exerce à l’Hôpital de Granby.
Comme le Dr Marquis, la Dre Guila Delouya n’a « pas vraiment d’attente » vis-à-vis des externes qu’elle accueille au département de radio-oncologie du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM). La professeure titulaire de clinique précise qu’en radiooncologie, il s’agit d’un stage à option. « On cherche avant tout à leur faire découvrir notre spécialité qui n’est pas très connue et qui est assez différente des autres, parce qu’elle est très technique, très technologique. » Au demeurant, la médecin est d’avis qu’« un patient reste un patient. Qu’on soit en chirurgie ou en médecine d’urgence, une histoire de cas reste une histoire de cas ».
Au GMF-U du Nord de Lanaudière, le Dr Mathieu Pelletier compte que les externes soient en mesure de « bien examiner les patients sur le plan physique ». L’omnipraticien est ainsi attentif à la collecte de données qu’ils réalisent et aux hypothèses de jugement clinique qu’ils peuvent ensuite formuler. La Dre Isabelle Leblanc

« ON VA “SIMPLEMENT” ALLER DE PLUS EN PLUS LOIN DANS LA PRISE EN CHARGE, AVEC DES PATIENTS PLUS DIFFICILES ET DES GESTES PLUS DÉLICATS, MAIS ON NE VEUT PAS QUE [LES RÉSIDENTS] SOIENT TÉMÉRAIRES NON PLUS. »
Dr François Marquis, médecin-chef des soins intensifs à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont
observe à ce sujet que « les étudiants ont toujours peur de ne pas aller assez vite ». Pourtant, « on n’a aucune attente en termes de productivité », indique-t-elle. En reprenant l’expression consacrée : la qualité prime sur la quantité.
Scotiabank Lighthouse, 100 Yonge St., 5thFloor, Toronto ON, M5C 2W1
File:5466556–MDQuebecphysician_D.LabrecqueProfessionSanté-ad_3.375x4.625-F
Workfront#: 5329350
Insertion: June 2025
Trim: 3.375” x 4.625” Colours: CMYK
Bleed: .125” Deadline: June 2025
Designer: JR Prod: N/A
Safety: n/a
Le CELIAPP, c’est un outil puissant, même si vous n’achetez pas de maison.
Si vous n’achetez pas de maison avec votre CELIAPP, vous avez toujours la possibilité d’en transférer les fonds, sans aucune incidence scale. Un conseiller qui connaît les rouages de la plani cation nancière et qui prend le temps de comprendre votre situation et vos objectifs peut vous aider à prendre des décisions éclairées pour maximiser les avantages scaux de votre CELIAPP, tout en évitant des pénalités potentielles.




David Labrecque Plani cateur nancier
Trouver un conseiller
Gestion nancière MD o re des produits et services nanciers, la famille de fonds MD et des servicesconseils en placement par l’entremise du groupe de sociétés MD et de Services d’assurance Gestion de patrimoine Scotia inc. Pour obtenir une liste détaillée du groupe de sociétés MD, rendez-vous à md.ca, et pour plus d’informations sur Services d’assurance Gestion de patrimoine Scotia inc., consultez gestiondepatrimoinescotia.com. • Gestion MD limitée – Membre du Fonds canadien de protection des investisseurs.

« ON
CONNAISSENT TOUT PAR CŒUR. »
Dre Isabelle Leblanc, médecin de famille au Centre de médecine familiale
St. Mary (GMF-U)
Montée en responsabilités
Une fois le doctorat en poche, les choses se corsent nécessairement et les expectatives sont plus élevées. En médecine de famille, les résidents prennent très vite en charge des patients. « Ils demeurent cependant des apprenants », souligne la Dre Leblanc. « On les questionne sur des trucs très précis, mais on ne s’attend pas à ce qu’ils connaissent tout par cœur. Savoir trouver l’info, c’est primordial », affirme-t-elle en ajoutant qu’« il y a tellement de matériel en médecine de famille qu’il faut aussi être capable de retrouver la ligne directrice en question ».
Aux soins intensifs, « on va “simplement” aller de plus en plus loin dans la prise en charge, avec des patients plus difficiles et des gestes plus délicats », indique le Dr François Marquis. L’intensiviste en devenir va par là même gagner en autonomie, « mais on ne veut pas qu’il soit téméraire non plus », souligne le médecin-chef en précisant qu’il se soucie aussi des habiletés communicationnelles des résidents. « Comment ils répondent aux questions des familles lorsqu’une cessation de traitement est envisagée, comment ils présentent le don d’organes, comment ils annoncent un décès, etc. »
En pédiatrie, l’aptitude à poser le bon diagnostic et la maîtrise des gestes techniques, telles l’intubation d’un nouveau-né ou la réalisation d’une ponction lombaire, sont naturellement incontournables. Le Dr Jean Sébastien Tremblay-Roy met aussi l’accent sur l’érudition. « Ils vont à leur tour devenir enseignants et superviser des étudiants », explique-t-il en insistant sur l’aspect « amélioration de la qualité », c’est-à-dire « la capacité d’un résident à analyser sa pratique et ses standards ».
S’adapter aux circonstances
Le Dr Guillaume Lafortune souligne quant à lui la particularité des stages de résidence qu’il supervise en milieu communautaire. « Dans les grands centres, les résidents sont attitrés à une seule tâche. Chez nous, ils vont en gérer deux ou trois en même temps. Ils doivent apprendre cette gymnastique pour organiser leur journée au mieux tout en priorisant les patients qui se présentent. »

:
« JE SUIS LÀ POUR FORMER DE MON MIEUX LES MEILLEURS RADIOONCOLOGUES POSSIBLE. »
Dre Guila Delouya, professeure titulaire de clinique et radio-oncologue au Centre hospitalier de l’Université de Montréal
En radio-oncologie, la Dre Guila Delouya met la barre assez haute. « Si un jour je suis malade, je veux que les résidents soient tous capables de me soigner », affirme-t-elle en précisant aussitôt que cette faculté relève de sa responsabilité en tant que patronne : « Je suis là pour former de mon mieux les meilleurs radio-oncologues possible. »
Dans les blocs opératoires du CHU de Québec-Université Laval, le Dr Mony Chhiv s’attend bien évidemment à ce que les résidents en chirurgie « réussissent leurs opérations », mais aussi à ce qu’ils « prennent tranquillement leur place et jouent un rôle de leadership ». Auprès des patients comme des équipes opératoires.
Malgré les responsabilités cliniques qu’on leur confie et leur implication dans la dispensation des soins, les résidents demeurent des apprenants, remarque toutefois le Dr Pelletier. « Ils sont encore en position d’apprentissage et doivent donc accepter les rétroactions », poursuit l’omnipraticien qui regrette la méfiance, voire la défiance de certains résidents vis-à-vis de leur superviseur. « Cela arrive assez souvent. Mais depuis que c’est nommé, c’est moins un tabou », observe-t-il en signifiant qu’il « n’est pas là pour les dévaluer. Être à l’écoute, se remettre en question, ce sont des façons de s’améliorer. » n
À lire sur ProfessionSanté.ca
L’éléphant dans la pièce : le rythme et la charge de travail en résidence

















































RBC contribue à financer des organismes comme Windmill Microlending, qui offre de l’accompagnement, du mentorat et des prêts abordables aux médecins formés à l’étranger qui cherchent à relancer leur carrière. Ce sont des idées comme celle-ci qui aident à combler la pénurie de médecins au Canada et à élargir l’accès aux soins de santé.
rbc.com/soutenirlessoinsdesante
Le premier et le seul inhibiteur de la PDE4 indiqué pour le traitement topique de la dermatite séborrhéique1,2*
Voici la mousse PrZORYVE® pour le traitement de la
Conçue pour une administration simple
• Peut être utilisée sur toutes les zones touchées de la peau, notamment le visage, le corps et/ou le cuir chevelu‡
• Application topique une fois par jour

Préparée avec la TECHNOLOGIE HYDROARQMC†

Quelle est l’indication de la mousse ZORYVE ?
ZORYVE (mousse de roflumilast, 0,3 %) est indiqué pour le traitement topique de la dermatite séborrhéique chez les patients âgés de 9 ans et plus1
Quelles ont été les données sur l’efficacité de la mousse ZORYVE au cours des essais cliniques ?
Au cours de l’essai de phase 3 STRATUM, l’efficacité de la mousse
ZORYVE a été démontrée dans le traitement topique de la dermatite séborrhéique1,3¶
TAUX DE RÉUSSITE DU TRAITEMENT
À la semaine 8 de l’étude, un nombre significativement plus grand de patients traités par la mousse ZORYVE ont satisfait au critère de réussite du traitement selon le score IGA par rapport au groupe ayant reçu l’excipient1,3¶§
IGA
% de patients affichant un score de réussite
%
%
%
%
Différence de 20,6 % en faveur de la mousse ZORYVE p/r à l’excipient (IC à 95 % : 8,2 % à 33,0 %) 79,5 %
La mousse ZORYVE a démontré une amélioration significative selon le score IGA dès la semaine 2 (critère d’évaluation secondaire)
Départ Semaine 2 Semaine 4 Semaine 6 Semaine 8
ZORYVE (n = 191) EXCIPIENT (n = 101)
Durabilité de la réponse : Chez les patients qui ont poursuivi le traitement par la mousse ZORYVE dans les études de prolongation menées en mode ouvert pendant 6 et 12 mois, aucun signe de diminution de l’efficacité n’a été observé1
PDE4 : phosphodiestérase de type 4; IGA : Investigator’s Global Assessment (évaluation globale selon le chercheur); IC : intervalle de confiance; WI-NRS : Worst Itch Numeric Rating Scale (échelle d’évaluation numérique de l’intensité des pires démangeaisons).
* La portée clinique comparative n’a pas été établie.
† Portée clinique inconnue. ‡ Lorsque ces zones sont sèches.

Réussite du traitement selon le score IGA – Photos de patients de l’essai STRATUM (mousse ZORYVE n = 304; excipient n = 153)
Femme – 63 ans – Visage"




Fille – Patiente pédiatrique – 9 ans – Cuir chevelu"




Homme – 61 ans – Oreilles"




SOULAGEMENT DÉMONTRÉ DES DÉMANGEAISONS
Réussite du traitement selon l’échelle WI-NRS en fonction du temps (critère d’évaluation secondaire)1,3¶£ ~ 7 patients sur 10 (66,5 %) avaient signalé un taux de démangeaisons d’au moins 4/10 au départ (n = 206, mousse ZORYVE et n = 98, excipient)
Départ Semaine 2 Semaine 4 Semaine 6 Semaine 8
(n = 206)
¶ L’étude STRATUM était un essai de phase III, multicentrique, randomisé, mené en double insu et contrôlé contre excipient évaluant le traitement topique uniquotidien par la mousse ZORYVE contre la dermatite séborrhéique. Les patients (n = 457) ont été répartis aléatoirement dans un rapport 2:1 pour recevoir la mousse ZORYVE à 0,3 % (n = 304) ou l’excipient (n = 153) appliqué une fois par jour pendant 8 semaines.
§ Définie comme la disparition complète ou quasi-complète des lésions (score IGA de 0 ou 1) et une amélioration d’au moins deux grades au score IGA par rapport au départ.
Patient(e) de l’essai clinique STRATUM. Non représentatif/représentative de tous les patients.
£ La réussite du traitement selon l’échelle WI-NRS correspond à une diminution de ≥ 4 points à l’échelle WI-NRS chez les patients dont le score initial était de 4 ou plus.
# L’érythème a été évalué sur une échelle de 4 points, allant de 0 (aucun signe d’érythème) à 3 (grave : érythème intense [rouge feu], les scores supérieurs indiquant un érythème plus grave.
ø La desquamation a été évaluée sur une échelle de 4 points allant de 0 (aucun signe de desquamation sur les lésions) à 3 (grave : squames épaisses et rugueuses et pellicules sur les vêtements ou la peau).
RÉDUCTION DÉMONTRÉE DES ROUGEURS ET DE LA DESQUAMATION
Score de 0 à l’évaluation globale Score de 0 à l’évaluation globale de l’érythème à la semaine 8 de la desquamation à la semaine 8 (critère d’évaluation secondaire)1# (critère d’évaluation secondaire) 1ø
Score d’érythème de 0 Score de desquamation de 0
80,00 %
60,00 %
40,00 %
20,00 %
0,00 %
ZORYVE (n = 304)
Différence de 26,8 % en faveur de la mousse ZORYVE p/r à l’excipient (IC à 95 % : 17,36 à 36,27, p < 0,0001)
EXCIPIENT (n = 153)
Différence de 20,9 % en faveur de la mousse ZORYVE p/r à l’excipient (IC à 95 % : 11,07 à 30,82, p < 0,0001)
• ~9 patients sur 10 ont déclaré un score modéré d’évaluation globale de l’érythème au départ
• ~8 patients sur 10 ont déclaré un score modéré d’évaluation globale de la desquamation au départ
Comment est dosée la mousse ZORYVE ?

La mousse ZORYVE offre un dosage simple uniquotidien
• Elle peut être appliquée sur toutes les zones touchées de la peau, notamment le visage, le corps et/ou le cuir chevelu‡
Conseils d’application efficace de la mousse ZORYVE pour vos patients




ÉTAPE 1 : AGITER
• Agitez bien le contenant avant chaque utilisation.
ÉTAPE 2 : EXTRAIRE
• Tenez le contenant à l’envers, à la verticale, et appuyez sur l’embout.
• Faites sortir une petite quantité de mousse dans votre main
ÉTAPE 3 : APPLIQUER
• Utilisez une quantité suffisante de mousse ZORYVE pour couvrir toutes les zones touchées d’une mince couche et faites pénétrer complètement le produit en frottant.
• Si vous traitez le cuir chevelu, séparez les cheveux de façon à pouvoir appliquer la mousse ZORYVE directement sur les zones de peau touchées.
• Lavez-vous les mains après l’application.

La mousse ZORYVE (mousse de roflumilast à 0,3 %) est indiquée pour le traitement topique de la dermatite séborrhéique chez les patients âgés de 9 ans et plus1
Quel est le profil d’innocuité de la mousse ZORYVE ?
La mousse ZORYVE est généralement bien tolérée1
Effets indésirables déclarés chez ≥ 1 % des patients traités par la mousse ZORYVE pendant 8 semaines au cours de deux essais multicentriques, randomisés, à double insu et contrôlés par excipient1
ZORYVE (N = 458) (%)
Excipient (N = 225) (%)
Troubles gastro-intestinaux
Nausée 6 (1,3 %) 0 (0 %)
Infections et infestations
Rhinopharyngite 7 (1,5 %) 1 (0,4 %)
Troubles du système nerveux
Mal de tête 5 (1,1 %) 0 (0 %)
La mousse ZORYVE a démontré un excellent profil d’innocuité1
Taux observés d’interruption du traitement : 0,9 % avec la mousse ZORYVE p/r à 2,2 % avec l’excipient1
Étude de prolongation menée en mode ouvert : Chez les 408 patients qui ont poursuivi le traitement par la mousse ZORYVE pendant une période de 24 à 52 semaines, le profil des effets indésirables était semblable à celui observé dans les études contrôlées par excipient1
Usage clinique :
• Les données soumises portant sur l’innocuité et l’efficacité chez les patients âgés de 9 à 17 ans sont limitées.
• L’efficacité et l’innocuité du produit chez les patients de moins de 9 ans n’ont pas été établies.
Contre-indication :
• Patients atteints d’insuffisance hépatique modérée ou grave (Child-Pugh B ou C)
Mises en garde et précautions pertinentes :
• Usage topique uniquement (non destiné à un usage ophtalmique, oral ou intravaginal)
• Fertilité
• Femmes enceintes ou qui allaitent
Pour de plus amples renseignements : Veuillez consulter la monographie du produit à l’adresse www.arcutis.ca/zoryve-pm-fr pour obtenir des renseignements importants sur les effets indésirables, les interactions médicamenteuses et l’administration du produit qui n’ont pas été abordés dans le présent document. Vous pouvez aussi obtenir la monographie du produit en téléphonant au 1 844 692-6729.
Références :
1. Monographie de ZORYVE®. Arcutis Canada, Inc. Mars 2025.
2. Données internes. Arcutis Biotherapeutics, Inc.
3. Blauvelt A, Draelos ZD, Stein Gold L, et al. Roflumilast foam 0.3% for adolescent and adult patients with seborrheic dermatitis: a randomized, double blinded, vehicle-controlled, Phase 3 trial. J Am Acad Dermatol. 2024;90(5):986-993.
Arcutis Canada, Inc.

Ce Q&R est publié par EnsembleIQ, 2300 Yonge Street, Suite 2900, Toronto, ON M4P 1E4. Tél. : 416-256-9908. Ce Q&R ne peut être reproduit, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur. © 2025.
PRO GUÉRISONMC utilisent la technologie hydrocolloïde pour améliorer la guérison

Pour les coupures et éraflures légères sur tout le corps
• Testé en clinique
• Guérison améliorée de 60 % par rapport aux pansements ordinaires1†
• Imperméable à 100 %
• Aide à atténuer l’apparence des cicatrices
Qu’est-ce que la technologie hydrocolloïde?
Les hydrocolloïdes sont des substances solubles dans l’eau qui se transforment lorsqu’elles sont mélangées à des liquides2 Dans un pansement hydrocolloïde, ces substances se mélangent aux fluides qui s’écoulent de la plaie pour former un gel. Ce gel crée un environnement humide protecteur, qui contribue à accélérer la guérison et la cicatrisation2,3.
Comment fonctionnent les pansements adhésifs de marque
BAND-AID® PRO GUÉRISON MC
Les pansements adhésifs de marque BAND-AID® PRO GUÉRISONMC intègrent la technologie hydrocolloïde en superposant un coussinet de gel hydrocolloïde sur la matière souple et confortable des pansements traditionnels de marque BAND-AID.
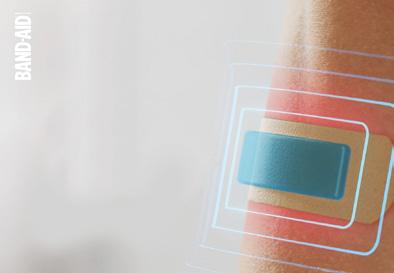
Le coussinet de gel hydrocolloïde scelle la plaie, la protégeant ainsi des bactéries, et crée un environnement humide qui facilite la guérison.


BAND-AID® PRO GUÉRISON MC : 3 étapes de guérison
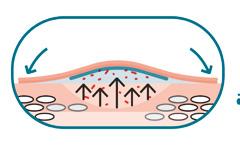
SCELLER absorbe le suintement et protège des bactéries
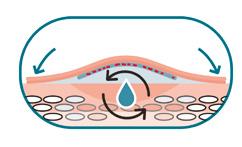
Une amélioration de la guérison cliniquement démontrée
▶ Les pansements adhésifs de marque BANDAID® PRO GUÉRISONMC ont démontré une amélioration de 60 % de la guérison des plaies par rapport aux pansements ordinaires, d’après une moyenne sur 7 jours du pourcentage de sujets montrant une amélioration de l’apparence générale des plaies1†
▼ Les pansements adhésifs de marque BAND-AID® PRO GUÉRISONMC ont démontré une amélioration significative de la guérison par rapport aux pansements ordinaires, à la fois d’après le score composite de guérison de la plaie§ et ses éléments distincts « apparence de la plaie »¶ et « confluence épithéliale »£ (p < 0,05)1†
Wound Appearance Scores
GUÉRIR une hydratation équilibrée aide la peau à guérir
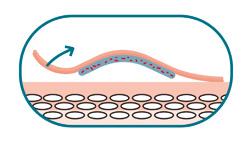
RÉVÉLER remplacer tous les 1 à 2 jours jusqu’à la guérison de la plaie
PANSEMENT ORDINAIRE PRO GUÉRISON

JOUR

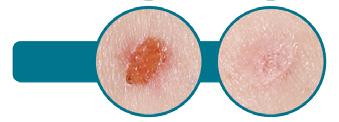
PROHEAL Demonstrated Better Healing Results than Using Bandage Alone
Wound Appearance Scores
Wound Appearance Scores
© Kenvue Canada Inc. 2025.
Mode d’emploi
Appliquer le pansement adhésif de marque BAND-AID® PRO GUÉRISONMC à la peau propre et sèche, en plaçant le coussinet audessus de la plaie.
• Remplacer le pansement tous les 1 ou 2 jours jusqu’à la guérison complète de la plaie.
• Pour retirer le pansement, décoller soigneusement une des extrémités du coussinet en l’étirant contre la peau.
• Les pansements adhésifs de marque BANDAID® PRO GUÉRISONMC peuvent être utilisés sur toutes les parties du corps.
Les personnes diabétiques et celles souffrant de mauvaise circulation ne doivent utiliser ces pansements que sous la supervision d’un médecin. Cesser l’emploi et consulter un médecin en cas de rougeur, d’enflure ou de réaction allergique. Ne pas appliquer sur une plaie profonde ou perforante, une peau fragile, des brûlures, des points de suture ou une région infectée, ni chez les enfants de moins de 2 ans.
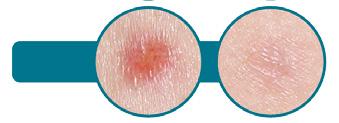
D’après les scores composites de guérison des plaies, une meilleure guérison a été constatée au jour 5 dans les plaies traitées avec les pansements adhésifs de marque BAND-AID® PRO GUÉRISON MC par rapport à l’état de guérison au jour 7 avec des pansements ordinaires ¥§
† Une étude de 16 jours, monocentrique, randomisée et contrôlée par un comparateur, portant sur 34 sujets et comparant la guérison des plaies avec les pansements adhésifs de marque BAND-AID PRO GUÉRISON à celle obtenue avec des pansements ordinaires. Chaque sujet avait 4 plaies induites par laser sur chaque avant-bras. Les pansements ont été appliqués une fois par jour et retirés après 24 heures. La guérison a été évaluée aux jours 1 à 7 et 16.
¥ Les photos et les scores représentent 1 patient de l’étude.
§ Score composite de guérison de la plaie, jours 0 à 7 : Total des scores d’apparence générale de la plaie, d’uniformité de la peau et de confluence épithéliale, moins le total des scores d’érythème, d’œdème et de croûte/cicatrice. Le score composite de guérison de la plaie, qui s’étend sur une échelle de 25 points (allant de -12 [aucune guérison] à +12 [en voie de guérison]), indique le degré de guérison des plaies. Il a été calculé pour chacune des plaies, à chaque jour de l’évaluation.
¶ Score d’apparence de la plaie : 0 = mauvaise (plaie nouvelle ou récente sans couche épithéliale, dont le lit paraît à vif, voire suintant); 1 = passable (croissance épithéliale amorcée et lit de la plaie sec); 2 = bonne (présence possible de cicatrice mais croissance épithéliale évidente et couleur du lit de la plaie indiquant tout au plus un érythème modéré); 3 = très bonne (présence possible d’une légère cicatrice, mais indentation du lit de la plaie à peine visible, et siège de la plaie presque entièrement recouvert de régénération épithéliale); 4 = excellente (présence possible d’une légère décoloration, mais guérison complète de la plaie et uniformisation de la surface de la peau). £ Score de confluence épithéliale 0 = aucune (aucune couverture épithéliale); 1 = légère (jusqu’à 30 %); 2 = modérée (31-60 %); 3 = étendue (61-90 %); 4 = complète ou quasicomplète (91-100 %). Un score supérieur indique un meilleur résultat.
Wound Journal 2008;5(5):602-613.
Au-delà des compétences cliniques, que faut-il pour être un bon pharmacien ou une bonne pharmacienne ?
Alors que les étudiants en pharmacie vont entreprendre leurs stages d’été ou rechercher des postes à temps partiel, quatre professionnels nous brossent le portrait de la relève idéale en pharmacie.
ANAÏS BOUITCHA
« Leur formation ne va pas les différencier, leur personnalité, oui », annonce d’emblée Jude Goulet, chef du département de pharmacie au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal. Alors que tous les stagiaires, étudiants et finissants sortent de la faculté avec, a priori, le même bagage académique, le premier critère de sélection en pharmacie – que ce soit en milieu communautaire, en établissement ou au sein d’un GMF – est bien souvent le savoir-être du candidat ou de la candidate.
« Il ne faut pas être quelqu’un de trop introverti, car pour être pharmacien, on a besoin de développer des compétences transversales, ce qui n’est pas simple, reconnaît Germain Chartier, pharmacien propriétaire d’une pharmacie affiliée au Groupe Jean Coutu, à Berthierville. C’est primordial de savoir échanger, sans gêne, de manière fluide. Ce ne sont pas des critères nécessairement recherchés par les facultés, et c’est étonnant de voir que certains ont du mal à dialoguer avec des gens alors qu’ils seront pharmaciens dans deux ou trois ans. »

« LORS D’UN RECRUTEMENT, JE M’ENTRETIENS AVEC LA PERSONNE, ET JE LUI
DEMANDE AUSSI DE VENIR
PASSER UN PEU DE TEMPS DANS LA PHARMACIE, PAS POUR TRAVAILLER, MAIS POUR OBSERVER LE MILIEU, DISCUTER AVEC L’ÉQUIPE. »
Beverly Solomon, pharmacienne propriétaire à Montréal
Un savoir-être indispensable, avant tout avec les équipes de la pharmacie, ajoute sa consœur Beverly Salomon, pharmacienne propriétaire à Montréal. « Lors d’un recrutement, je m’entretiens avec la personne, et je lui demande aussi de venir passer un peu de temps dans la pharmacie, pas pour travailler, mais pour observer le milieu, discuter avec l’équipe. Je veux voir si elle y est à l’aise physiquement et si l’énergie lui convient. Je prône un fonctionnement collaboratif, et je ne veux pas amener quelqu’un qui pourrait nuire à l’ambiance ou à l’énergie de la pharmacie. »
Savoir jouer collectif
L’esprit de groupe et la capacité à jouer collectif, deux critères que recherche aussi Anne Maheu, pharmacienne au GMF-U Bordeaux-Cartierville de Montréal. « Travailler en interprofessionnalité n’est pas donné à tout le monde. Je pousse les étudiants à sortir de leur coquille, à développer leur confiance en eux. J’attends qu’ils soient curieux, dégourdis et autonomes pour aller chercher de l’information et s’adapter rapidement. » Les quatre pharmaciens >

« ON PEUT AVOIR L’IMPRESSION DE TOUT CONNAÎTRE, MAIS PLUS ON EN SAIT, PLUS ON SE REND COMPTE QU’IL NOUS EN MANQUE. C’EST IMPORTANT DE RECONNAÎTRE
L’EXPÉRIENCE DE SON PHARMACIEN PRÉCEPTEUR. »
Jude Goulet, chef du département de pharmacie au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

« JE NE COMPTE PAS MES HEURES, JE DONNE BEAUCOUP POUR MON ÉQUIPE ET MES PATIENTS, ET JE M’ATTENDS À CE QU’UN STAGIAIRE FASSE DE MÊME. »
Anne Maheu, pharmacienne au GMF-U Bordeaux-Cartierville de Québec

neurones à kisspeptine, neurokinine B et dynorphine (KNDy) afin de moduler l’activité neuronale dans le centre thermorégulateur situé dans l’hypothalamus1**.
Quel a été le profil d’efficacité de VEOZAH au cours de l’essai clinique SKYLIGHT 2?
VEOZAH a permis d’obtenir des réductions cliniquement significatives de la fréquence des symptômes vasomoteurs modérés à sévères et des réductions statistiquement significatives de la sévérité des symptômes vasomoteurs modérés à sévères par rapport au placebo aux semaines 4 et 121†
SÉVÉRITÉ : Semaines 4 et 121†
Données à la semaine 52 :5,6†
VEOZAH a permis d’obtenir des réductions statistiquement significatives de la sévérité des symptômes vasomoteurs modérés à sévères (sur
Adapté de la monographie de produit de VEOZAH.
Une différence statistiquement significative entre VEOZAH et le placebo a été observée à la semaine 1 pour la fréquence des SVM (paramètre d’évaluation secondaire)5-7†. Variation moyenne (EcT) par rapport aux valeurs initiales de la fréquence des SVM avec VEOZAH : 3,91 (4,30) contre 2,34 (3,34) avec le placebo. Fréquence moyenne des SVM au départ (ÉcT) dans le groupe VEOZAH : 11,8 (8,26) contre 11,6 (5,02) avec le placebo.
Différence des moyennes MMC par rapport au placebo (ErT) : -1,71 (0,40); IC à 95 %; -2,51, -0,91; p < 0,001, sans analyse de multiplicité.
Données à la semaine 52 :5,6†
La durée de cette étude est plus longue que celle menée pour obtenir les données sur l’efficacité incluses dans la monographie de produit de VEOZAH. La variation moyenne de la fréquence et de la sévérité des symptômes vasomoteurs modérés à sévères entre le début de l’étude et chaque visite durant la phase de prolongation était un paramètre d’évaluation exploratoire. Les évaluations effectuées après la période de contrôle par placebo de 12 semaines étaient uniquement descriptives.
Graphique adapté de Johnson et al. 2023.
TROUBLES DU SOMMEIL
VEOZAH a permis de réduire considérablement les troubles du sommeil liés aux symptômes vasomoteurs et déclarés par les patientes tels que mesurés par le PROMIS SD SF 8B (paramètre d’évaluation secondaire clé). Dans la prise en charge des symptômes vasomoteurs, VEOZAH a permis d’améliorer les troubles du sommeil par rapport au placebo à la semaine 12 (p = 0,007).5†
Graphique adapté de Johnson et al., 2023.
ÉcT : écart type; ErT : erreur type; PROMIS SD SF 8b : Patient-reported Outcomes Measurement Information System Sleep Disturbance – Short Form 8b; IC : intervalle de confiance; MMC : moyenne des moindres carrés; SVM : symptômes vasomoteurs
* La portée clinique comparative est inconnue.
** La portée clinique n’a pas été établie.
† SKYLIGHT 2 : L’efficacité de VEOZAH a été évaluée durant les 12 premières semaines de l’étude SKYLIGHT 2 de phase III, randomisée, contrôlée par placebo et à double insu. Après les 12 premières semaines, les femmes ayant atteint la ménopause sous placebo ont été re-randomisées dans le groupe VEOZAH pour une prolongation de 40 semaines afin d’évaluer l’innocuité de VEOZAH pour un total de 52 semaines d’exposition. La population des études comprenait des femmes ayant atteint la ménopause présentant une moyenne minimale de 7 symptômes vasomoteurs modérés à sévères par jour. Les paramètres d’évaluation principaux conjoints étaient la variation moyenne de la fréquence et de la sévérité des symptômes vasomoteurs modérés aux semaines 4 et 12 par rapport aux valeurs initiales1
FRÉQUENCE : Mesurée comme une moyenne quotidienne et analysée comme une moyenne hebdomadaire (calculée comme la fréquence moyenne des symptômes sur 7 jours consécutifs)5
SÉVÉRITÉ : Mesurée comme une moyenne quotidienne et analysée comme une moyenne hebdomadaire (calculée comme la sévérité moyenne des symptômes sur 7 jours consécutifs)5
Moyenne calculée selon la MMC : moyenne des moindres carrés estimée à partir d’un modèle mixte pour l’analyse de la covariance des mesures répétées1 ‡ La supériorité par rapport au placebo est statistiquement significative au niveau de 0,05 avec ajustement pour la multiplicité1
'' Les femmes qui prenaient auparavant le placebo sont passées à VEOZAH à 45 mg.
§ Le PROMIS SD SF 8b évalue les troubles du sommeil autodéclarés dans les 7 jours précédents et inclut les perceptions de sommeil agité, la satisfaction à l’égard du sommeil, le sommeil réparateur, les difficultés à dormir, à s’endormir ou à rester endormi, ainsi que la durée et la qualité du sommeil. Les réponses à ces huit éléments vont de 1 à 5, et la somme des scores bruts peut aller de 8 à 40. Des scores plus élevés au PROMIS SD SF 8b indiquent un sommeil plus perturbé.
¶ Valeur de p bilatérale, non ajustée5
Quel est le profil d’innocuité de VEOZAH?
Le profil d’innocuité et de tolérabilité de VEOZAH a été montré jusqu’à 1 an1
Profil d’innocuité sur 12 semaines
Effets indésirables observés dans au moins 2 % des cas avec VEOZAH à 45 mg et supérieurs à ceux avec le placebo dans le cadre de deux études£
Troubles gastro-intestinaux
Douleur abdominale# 7 (2,1 %) 7 (2,0 %)
Examens
Augmentation des résultats des tests hépatiques¥ 11 (3,2 %) 9 (2,6 %)
Profil d’innocuité sur 52 semaines
Effets indésirables observés dans au moins 2 % des cas avec VEOZAH à 45 mg et supérieurs à ceux avec le placebo sur 52 semainesϕ
Troubles gastro-intestinaux
Douleur abdominale# 27 (4,4 %) 13 (2,1 %)
Diarrhée 24 (3,9 %) 16 (2,6 %)
Nausées 19 (3,1 %) 15 (2,5 %)
Troubles généraux
Fatigue 17 (2,8 %) 16 (2,6 %)
Examens
Augmentation des résultats des tests hépatiques∆ 32 (5,3 %) 29 (4,8 %)
Troubles du système nerveux
Céphalées, algie vasculaire de la face, céphalées sinusales et céphalées de tension 59 (9,7 %) 58 (9,5 %)
Troubles psychiatriques
Insomnie, insomnie de milieu de nuit 24 (3,9 %) 11 (1,8 %)
Troubles vasculaires
Bouffées de chaleur, rougissement 15 (2,5 %) 10 (1,6 %)
Un déséquilibre numérique a été observé dans l’incidence des autres tumeurs malignes entre le groupe VEOZAH et le groupe placebo dans l’étude sur l’innocuité à long terme (SKYLIGHT 4).
Aucune relation de cause à effet entre VEOZAH et l’augmentation du risque de tumeurs malignes n’a été établie1.
Veuillez consulter la monographie de produit de VEOZAH pour obtenir des renseignements complets sur les effets indésirables.
Quelle est la posologie de VEOZAH?
VEOZAH est offert en une dose pratique uniquotidienne
La dose recommandée de VEOZAH est de 45 mg par voie orale une fois par jour, avec ou sans nourriture. VEOZAH doit être administré à peu près à la même heure chaque jour, avec des liquides et avalé entier. Ne pas couper, écraser, ni croquer les comprimés1.
Dose oubliée
Si une dose est oubliée ou n’est pas prise à l’heure habituelle, la patiente doit alors prendre la dose oubliée le plus tôt possible, sauf s’il reste moins de 12 heures avant la prochaine dose prévue. Suivre le calendrier posologique habituel le lendemain1.
Populations particulières
Insuffisance hépatique1
VEOZAH est contre-indiqué chez les personnes atteintes de cirrhose.
VEOZAH n’est pas recommandé chez les personnes présentant une insuffisance hépatique chronique de classe B de Child-Pugh (modérée).
VEOZAH n’a pas été étudié chez les personnes atteintes d’insuffisance hépatique chronique de classe C de Child-Pugh (sévère) et n’est pas recommandé dans cette population.
Aucune modification de la dose n’est recommandée chez les personnes atteintes d’insuffisance hépatique chronique de classe A de Child-Pugh (légère).
Insuffisance rénale1
VEOZAH est contre-indiqué chez les personnes présentant une insuffisance rénale sévère (TFGe < 30 mL/ min/1,73 m2).
VEOZAH n’a pas été étudié chez les personnes présentant une insuffisance rénale terminale (TFGe < 15 mL/min/1,73 m2) et est contre-indiqué dans cette population.
Aucune modification de la dose n’est recommandée chez les personnes atteintes d’une insuffisance rénale légère (TFGe 60 à < 90 mL/ min/1.73 m2) ou modérée (TFGe 30 à < 60 mL/ min/1.73 m2).
Considérations posologiques1
Avant de commencer le traitement par VEOZAH, effectuer des analyses sanguines initiales pour évaluer la fonction hépatique et rechercher la présence de lésions, y compris les taux sériques PA, d’AST, d’ALP et de bilirubine (totale et directe).
Ne pas commencer le traitement par VEOZAH si le taux d’ALT ou d’AST est ≥ 2 x LSN ou si le taux de bilirubine totale est élevé (≥ 2 x LSN).
Procéder avec prudence si le taux d’ALT ou d’AST est > 1,5 et < 2 x LSN.
Pendant l’utilisation de VEOZAH, il faut effectuer des évaluations de suivi de la concentration des transaminases hépatiques tous les mois pendant les 3 premiers mois, à 6 mois et à 9 mois après le début du traitement.
Conseiller aux patientes d’arrêter immédiatement VEOZAH et de consulter un médecin, y compris pour des épreuves de laboratoire de la fonction hépatique en laboratoire, si elles présentent des signes ou des symptômes pouvant suggérer une lésion hépatique.
Les signes ou symptômes qui peuvent suggérer une lésion hépatique sont les suivants : fatigue nouvelle, diminution de l’appétit, nausées, vomissements, prurit, jaunisse, pâleur des selles, urines foncées ou douleurs abdominales.
Arrêter VEOZAH si les élévations des transaminases sont ≥ 5 x LSN ou si les élévations des transaminases sont ≥ 3 x LSN et si le taux de bilirubine totale est ≥ 2 x LSN.
En cas d’élévation des transaminases ≥ 3 x LSN, il convient d’effectuer des tests hépatiques de suivi plus fréquents jusqu’à la résolution.
Il faut exclure les autres causes d’élévation des tests hépatiques.
Veuillez consulter la monographie de produit de VEOZAH pour obtenir des renseignements complets sur la posologie et l’administration.
Y a-t-il un programme de soutien aux patients pour VEOZAH?
Oui. Le programme de soutien aux patients VEOZAH® Connect a été conçu pour faciliter l’accès au traitement VEOZAH. Les avantages comprennent une aide à l’inscription, un soutien financier, une assistance téléphonique accessible entre 8 h et 20 h, un appui à l’observance, ainsi que la communication régulière de mises au point et l’envoi de rappels aux patientes. Pour en savoir plus :
Téléphone : 1 855 283-6924 (1 855 2VEOZAH)
Télécopieur : 1 877 298-5167
Courriel : support@veozahconnect.ca
Usage clinique : Enfants (moins de 18 ans) : non indiqué; Personnes âgées (≥ 65 ans) : aucune donnée n’est disponible; par conséquent, aucune indication n’a été recommandée.
Contre-indications : Cirrhose avérée; Insuffisance rénale sévère ou terminale; Patientes qui utilisent de façon concomitante des inhibiteurs modérés ou puissants du CYP1A2; Grossesse avérée ou présumée.
Mises en garde et précautions pertinentes : Incidence sur d’autres affections malignes; Considération du rapport risque/bénéfice pour le traitement des femmes atteintes d’un cancer du sein avéré ou antérieur ou d’autres affections malignes œstrogénodépendantes; Risque d’hyperplasie endométriale et de carcinome endométrial; Non recommandé en cas d’insuffisance hépatique chronique modérée (classe B de Child-Pugh); non étudié en cas d’insuffisance hépatique chronique sévère (classe C de Child-Pugh) et non recommandé pour cette population; Risque d’élévation des transaminases hépatiques et d’hépatotoxicité;
Effectuer des analyses sanguines de base pour évaluer la fonction hépatique et vérifier l’absence de lésions, y compris les taux sériques d’alanineaminotransférase (ALT), d’aspartate aminotransférase (AST), de phosphatase alcaline (PA) et de bilirubine (totale et directe)], avant de commencer le traitement par VEOZAH. Effectuer des analyses de laboratoire hépatiques tous les mois pendant les 3 premiers mois, à 6 mois et à 9 mois après l’instauration du traitement; Non recommandé aux femmes qui allaitent.
Pour plus d’information : Consultez la monographie du produit à l’adresse veozahmonographie.ca pour obtenir des informations importantes sur les effets indésirables, les interactions médicamenteuses et la posologie. Vous pouvez également obtenir la monographie du produit en appelant le 1 888 338-1824.
PA : phosphatase alcaline; ALT : alanine aminotransférase; AST : aspartate aminotransférase; TFGe : taux de filtration glomérulaire estimé; LSN : limite supérieure de la normale.
£ Les études SKYLIGHT 1 et 2 étaient des études de phase 3 sur l’efficacité et l’innocuité conçues de manière identique, randomisées, contrôlées par placebo et menées à double insu pendant 12 semaines, suivies d’une nouvelle randomisation des femmes recevant auparavant le placebo vers VEOZAH (les femmes sous VEOZAH sont restées sous VEOZAH) pendant 40 semaines supplémentaires de traitement actif 1
# Les douleurs abdominales comprennent les douleurs abdominales basses, les douleurs abdominales supérieures et la sensibilité abdominale1 ¥ L’augmentation des résultats des tests hépatiques comprend les éléments suivants : ALT anormale/augmentée, AST anormale/ augmentée, PA sanguine augmentée, bilirubine sanguine augmentée, gamma-glutamyltransférase augmentée, enzyme hépatique anormale/ augmentée, transaminases augmentées et test de la fonction hépatique anormale/augmentée
ϕ SKYLIGHT 4 était une étude de phase 3 de 52 semaines, randomisée, contrôlée par placebo et à double insu sur l’innocuité à long terme1
∆ L’augmentation des résultats des tests hépatiques comprend les éléments suivants : ALT anormale/augmentée, AST anormale/ augmentée, PA sanguine augmentée, bilirubine sanguine augmentée, gamma-glutamyltransférase augmentée, fonction hépatique anormale, enzyme hépatique augmentée, transaminases augmentées et test de la fonction hépatique anormale/augmentée
Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. © 2025 Astellas Pharma Inc. ou ses sociétés affiliées.
Références : 1. Monographie de produit de VEOZAH. Markham (ON) : Astellas Pharma Canada Inc. 2. The North American Menopause Society (NAMS). Menopause. 2023;30(6):573-590. 3. Données internes. Première et unique réclamation. 4. Yuksel N, Evaniuk D, Huang L, et al. Directive clinique no 422a : Ménopause : symptômes vasomoteurs, agents thérapeutiques d’ordonnance, médecines douces et complémentaires, nutrition et mode de vie. J Obstet Gynaecol Can. 2021;43(10):1188-1204.e1. 5. Johnson KA, Martin N, Nappi RE, et al. Efficacy and safety of fezolinetant in moderate to severe vasomotor symptoms associated with menopause: a phase 3 RCT. J Clin Endocrinol Metab. (Epub) 02-03-2023. 6. Données internes. Plan de l’étude SKYLIGHT 2. 7. Données internes. Résumé sur l’efficacité clinique
valorisent également les expériences professionnelles hors pharmacie des étudiants, un bon indicateur selon eux de leur ouverture d’esprit et de leur débrouillardise.
De son côté, Jude Goulet attend aussi de ses résidents qu’ils fassent preuve d’humilité, manifestent une envie d’apprendre et sachent exprimer leur point de vue. « On peut avoir l’impression de tout connaître, mais plus on en sait, plus on se rend compte qu’il nous en manque. C’est important de reconnaître l’expérience de son pharmacien précepteur, et d’être capable de s’exprimer clairement auprès des équipes. »
La relation avec les patients est un autre point crucial d’une bonne intégration en pharmacie communautaire et en GMF. « On ne conseille pas un médicament, on conseille un patient, avec de vrais besoins, souligne Germain Chartier. Il faut donc être capable de dialoguer, sans gêne, de manière fluide. » Or, le pharmacien propriétaire estime aujourd’hui que la formation dispensée sur les bancs des facultés de pharmacie n’intègre pas suffisamment cette facette cruciale du métier.
En outre, des qualités comme l’écoute et la bienveillance, recherchées par Anne Maheu, sont indispensables pour prendre en charge un patient et l’amener sur la voie du changement.
« Un stage est un investissement » La formation universitaire, de plus en plus clinique pour coller à l’élargissement du champ de pratique, peut parfois même être un frein au jugement professionnel des jeunes pharmaciens, reprend Germain Chartier « Ils vont passer énormément de temps à analyser les dossiers et les tests de labo, car ils ont peur de passer à côté de quelque chose, de faire une erreur. » Un stage, une résidence ou un emploi à temps partiel est aussi un apprentissage de la confiance en soi et en son jugement clinique, assure le pharmacien. Par ailleurs, il s’agit de trouver un équilibre avec toutes les compétences que requiert la pratique communautaire, rappelle Beverly Salomon.
« Les connaissances cliniques, c’est bien, parce que la profession change. Mais la pharmacie communautaire, c’est aussi de la distribution. Il faut permettre aux nouveaux cliniciens de s’épanouir tout en assurant la survie de la pharmacie. »
Si les employeurs se disent plus conciliants avec les stagiaires de première ou deuxième année, tous les étudiants devraient se montrer intéressés par le milieu de soins qu’ils intègrent, qu’ils l’aient choisi ou non. « Normalement, les résidents en maîtrise de pharmacothérapie avancée ont choisi le milieu GMF, donc ils sont déjà intéressés par ce type de pratique et sont motivés, explique Anne Maheu. Mais j’attends beaucoup de mes étudiants. Je ne compte pas mes heures, je donne beaucoup pour mon équipe et mes patients, et je m’attends à ce qu’un stagiaire fasse de même. »
Selon elle, un stage est un investissement. « C’est donnant donnant. S’ils veulent avoir le meilleur retour possible, ils doivent s’en donner les moyens. » En d’autres termes : chaque étudiant est garant de la qualité de son stage, en adoptant la bonne attitude, mais aussi en respectant les échéances et en s’adaptant aux enjeux d’un projet de recherche notamment. n
Si les pharmaciens d’établissements se félicitent d’une « belle relève » prête à réaliser des actes cliniques en toute autonomie, la pénurie actuelle change la donne en matière de recrutement, reconnaît Jude Goulet, chef du département de pharmacie au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal. « Les finissants ont de plus en plus d’opportunités professionnelles, et veulent avoir une offre claire. Je ne dirais pas qu’ils sont plus exigeants, mais c’est une génération qui veut s’épanouir professionnellement et maintenir un équilibre avec leur vie personnelle. C’est un beau défi de gestion pour nous, car on doit s’assurer de toujours les alimenter pour ne pas qu’ils se lassent. »
Le tableau semble moins rose en pharmacie communautaire. Également aux prises avec une pénurie de main-d’œuvre persistante, Germain Chartier ne trouve tout simplement aucun candidat à recruter, même à temps partiel. « Je n’ai eu aucune candidature en cinq ans. C’est un phénomène nouveau, qui me surprend. » Le fait que sa pharmacie se situe loin des grands centres peut, selon lui, l’expliquer. Mais il confie aussi que la concurrence des agences de remplacement rend la tâche plus ardue. « Les étudiants sont courtisés de toutes parts par ces firmes, et ils vont logiquement préférer s’orienter vers une pratique à plus gros salaire avec un horaire plus flexible », déplore le pharmacien propriétaire de Berthierville. Un nouvel enjeu auquel est aussi confrontée Beverly Salomon, alors que sa pharmacie se trouve en plein cœur de Montréal. « Avant, les étudiants cherchaient un point d’ancrage. Ce n’est plus le cas. Désormais, ils veulent garder leur liberté pour faire plusieurs choses à la fois. »
Face à cette difficulté supplémentaire, les deux pharmaciens communautaires ont dû revoir leurs exigences au moment de recruter. « Avant, on pouvait être plus sélectif. Mais maintenant, si on a un candidat, on va parfois aller au compromis et discuter longuement de nos attentes respectives pour trouver un terrain d’entente. J’essaie parfois de m’adapter, mais je me mets des limites. C’est une danse à deux », reconnaît ainsi Beverly Salomon, tout en soulignant la qualité de formation de la jeune génération.
De son côté, Germain Chartier déplore un nivellement par le bas. « Un mauvais casting risque de faire fuir les pharmaciens déjà en poste. Mais si tu es un propriétaire à l’agonie, parfois, tu n’as pas le choix. »
CCECP N o 1329-2025-3963-I-P
Après avoir achevé avec succès ce programme de formation continue, vous aurez perfectionné les compétences suivantes :
1. reconnaître les symptômes vasomoteurs (SVM) chez les patientes en périménopause et en ménopause;
2. évaluer les cas dans lesquels les options thérapeutiques non hormonales peuvent être recommandées, plutôt que le traitement hormonal de la ménopause (THM);
3. résumer les dernières données probantes sur les traitements des SVM ne nécessitant pas de prescription (modifications du mode de vie et produits à base de plantes);
4. évaluer l’innocuité et l’efficacité des traitements non hormonaux sur ordonnance pour la prise en charge des SVM;
5. discuter du rôle du pharmacien dans l’accompagnement efficace des patientes concernant les options thérapeutiques non hormonales pour le traitement des SVM.
Instructions
1. Après avoir lu attentivement cette leçon, revoyez les questions du test. Répondez en ligne sur eCortex.ca.
2. Une note d’au moins 70 % est nécessaire pour réussir ce test et obtenir vos crédits de formation continue (5 bonnes réponses sur 6).
3. Remplissez le formulaire de commentaires pour cette leçon sur eCortex.ca.
DÉCLARATION
Déclarations disponibles sur ecortex.ca 1,5

SUIVEZ CETTE
FORMATION SUR :
Ordre des pharmaciens du Québec OPQ : 250258
par Cait Luther, MSCP, BSc, PharmD,



Le terme « ménopause » est couramment utilisé pour décrire les di érentes étapes de la périménopause, de la ménopause et de la postménopause. Le rapport du groupe STRAW+10 (Stages of Reproductive Aging Workshop, stades du vieillissement de l’appareil reproducteur féminin) dé nit la transition ménopausique comme la période à partir de laquelle les symptômes liés à la ménopause apparaissent ou le cycle menstruel devient variable, avant la dernière période menstruelle (DPM)(1). La périménopause est la période au cours de laquelle les changements endocriniens et somatiques ont commencé. Elle comprend la transition ménopausique jusqu’à 12 mois après la DPM(1). Cette période débute généralement à partir de la quarantaine et s’accompagne de symptômes chez de
nombreuses femmes. La ménopause est l’arrêt permanent des menstruations résultant d’une perte de l’activité folliculaire ovarienne. Elle est déterminée rétrospectivement après 12 mois consécutifs d’aménorrhée suivant la DPM(1,2). La postménopause est la phase de la vie qui suit la ménopause. L’échelle STRAW+10 (voir gure 1) dé nit les femmes en postménopause précoce (stades +1a, +1b et +1c) comme celles qui se trouvent dans les huit années suivant leur DPM, après quoi les femmes sont classées en postménopause tardive (stade +2)(1). Les femmes en ménopause tardive connaissent peu de changements, voire aucun, de la fonction endocrinienne reproductive par rapport aux femmes en ménopause précoce, mais les e ets du processus de vieillissement somatique sont plus importants(3).
Les symptômes caractéristiques de la ménopause sont les bou ées de chaleur et les sueurs nocturnes, qui sont collectivement désignés sous le nom de symptômes vasomoteurs (SVM)(4).
Le traitement hormonal de la ménopause (THM) englobe l’œstrogénothérapie, l’association œstroprogestative et les modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes en association avec les œstrogènes (pour former un complexe œstrogénique sélectif tissulaire, ou TSEC).
Les traitements non hormonaux des SVM comprennent des modi cations du mode de vie et des traitements non
Leçon à visée éducative financée par Astellas
FIGURE 1 Stades du vieillissement de l’appareil reproducteur féminin selon le système [STRAW+10] (Stages of Reproductive Aging Workshop + 10).
Premières règles
Précoce Apogée Tardif
DPM(0)
Précoce Tardive Précoce Tardive Périménopause
Durée variable variable 1 à 3 ans 2 ans (1+1) 3 à 6 ans Tout le reste de la vie
PRINCIPAUX CRITÈRES
Cycle menstruel Variable à régulier Régulier Régulier Changements légers dans le débit/la durée
CRITÈRES DE SOUTIEN
Endocrinien FSH HRM Inhibine B
Compte des follicules antraux
CARACTÉRISTIQUES DESCRIPTIVES
Symptômes
* Prise de sang les jours 2 à 5 du cycle ↑— élevée
Bas
Durée variable persistante ≥ 7 jours de différence dans la durée des cycles consécutifs
Intervalle d’aménorrhée de ≥ 60 jours
Se stabilise Très bas Très bas
Bas Très bas Très bas
Symptômes vasomoteurs probables
Symptômes vasomoteurs très probables
** Niveau approximatif attendu sur la base d’analyses utilisant la norme internationale actuelle pour l’hypophyse(67-69) HRM - hormone de régression müllérienne; FSH — hormone folliculostimulante; DM — dernière menstruation.
Augmentation des symptômes de l’atrophie urogénitale
Skokovic-Sunjic, Dragana, RPh BScPhm NCMP. Vous avez chaud? Il faut qu’on parle! Le rôle des pharmaciens pour pallier les lacunes dans la prise en charge de la ménopause au Canada. Conseil canadien de formation continue en pharmacie, sept. 2024, eCortex.ca.
hormonaux sur ordonnance. En 2024, Santé Canada a approuvé le fézolinétant pour le traitement des SVM modérés à sévères(5). La clonidine est également approuvée par Santé Canada pour le traitement des SVM, mais son utilisation n’est pas recommandée en raison de ses effets secondaires. Toutes les autres options thérapeutiques non hormonales sont considérées comme utilisées hors indication.
La ménopause dans les médias Depuis peu, la périménopause et la ménopause sont devenues un sujet plus répandu dans les médias, notamment avec « Small Achievable Goals », la nouvelle série de la chaîne CBC, qui met en lumière et contribue à normaliser le
discours sur la ménopause(6). Des données canadiennes montrent que 46 % des femmes ne se sentent pas préparées à la ménopause et qu’une femme sur dix quitte le marché du travail en raison des symptômes liés à la ménopause(4) Avec plus de 30 symptômes caractéristiques et l’absence d’éducation formelle sur la transition ménopausique ou la postménopause, de nombreuses femmes souffrent d’un grave manque de connaissances(4).
L’intérêt de traiter les SVM
La physiopathologie des SVM n’est pas entièrement comprise, mais on pense qu’elle est liée à de multiples processus physiologiques altérés par la perte de production des œstrogènes ovariens. Il
est peu probable que la perte d’œstrogènes explique à elle seule les SVM, car la corrélation entre l’estradiol circulant et les SVM est limitée(7). L’une des hypothèses veut que la zone thermoneutre soit rétrécie chez la femme ménopausée, de sorte que de légères variations de la température corporelle déclenchent une réaction aiguë de dissipation de la chaleur dans l’hypothalamus, qui affecte la vasoconstriction, la vasodilatation et les vaisseaux cutanés. Cela peut entraîner une augmentation de la fréquence cardiaque, de la tension artérielle, une instabilité des plaques molles ainsi qu’un risque cardiovasculaire accru(8,9). On a constaté une diminution de l’activité vagale à l’apparition des bouffées de chaleur et une diminution du flux
sanguin cérébral au cours d’une bouffée de chaleur(10). Une modification de l’hypothalamus après la ménopause est due à une augmentation des neurones à kisspeptine, neurokinine B et dynorphine (KNDy)(11). L’activation des récepteurs de la neurokinine 3 (NK3R) dans ces neurones provoque des SVM et l’inhibition du NK3R les réduit ou les élimine. Cette activation des neurones parasympathiques et sympathiques peut également être influencée par la sérotonine, la noradrénaline et l’adrénaline. À partir de la périménopause, 80 % des femmes seront confrontées à des SVM. Pour 30 % d’entre elles, les SVM seront le seul symptôme. Les 70 % restants présenteront également d’autres symptômes tels que des changements d’humeur, des troubles cognitifs, des insomnies, une dépression, de l’anxiété, voire des pensées suicidaires. La première étude SWAN a mis en évidence des différences ethniques dans la probabilité que les femmes présentent des SVM qu’elles considèrent comme gênants, les femmes noires étant les plus fréquemment et les plus sévèrement touchées, suivies par les femmes hispaniques et les femmes blanches(8, 13). Les femmes chinoises et japonaises étaient les moins susceptibles de déclarer des SVM(13)
Les femmes font état de SVM fréquents, modérés ou sévères pendant 7 à 11 ans, avec une médiane de 4,5 ans après la DPM(8, 14). Des études ont démontré les effets manifestes des SVM sur la qualité de vie (QdV), notamment sur le sommeil, les symptômes dépressifs et la fonction cognitive(15).
Une méta-analyse a révélé une tension artérielle plus élevée, des profils de cholestérol plus défavorables, des maladies cardiovasculaires et une plus grande résistance à l’insuline chez les femmes présentant des SVM par rapport à celles qui ne sont pas touchées(16). Des associations ont également été signalées entre les SVM et une plus faible densité minérale osseuse, l’ostéoporose et les fractures osseuses(17,18)
Les femmes âgées de plus de 40 ans représentent un quart de la population canadienne(19). Malgré l’importance de cette cohorte, les soins de la ménopause sont souvent ignorés et négligés(4). Au Canada, l’âge moyen de la ménopause est de 51 ans. Ces symptômes touchent donc les femmes dans la fleur de l’âge, alors qu’elles doivent souvent s’occuper de leurs enfants et de leurs parents vieillissants, tout en étant souvent au sommet de leur carrière(4). L’enquête de la Fondation canadienne de la ménopause a mis en évidence la réalité des femmes au Canada : 84 % des
personnes interrogées savaient que les bouffées de chaleur étaient un symptôme de la ménopause, mais seulement 44 % et 42 % d’entre elles savaient que la dépression et l’anxiété, respectivement, étaient des symptômes de la ménopause(4). Les données suggèrent que plus de trois quarts des résidents en médecine estiment qu’ils ont une formation limitée en ce qui concerne la ménopause et que 50 % d’entre eux se disent peu à l’aise avec la prise en charge des symptômes liés à la ménopause(20). Les médecins de famille et les gynécologues reconnaissent que les discussions sur les traitements non hormonaux sont souvent inadaptées et que les malentendus sur la ménopause et les options thérapeutiques constituent l’aspect le plus complexe de la communication avec les femmes en périménopause et en ménopause(21)
L’étude Women’s Health Initiative (WHI) de 2002 a suscité de vives inquiétudes chez les fournisseurs de soins et les patientes en concluant que l’utilisation d’acétate de médroxyprogestérone et d’œstrogènes conjugués chez les femmes ménopausées était associée à un risque accru de cancer du sein, de maladie coronarienne et d’accident vasculaire cérébral (22). Par la suite, les prescriptions de THM chez les femmes de plus de 40 ans aux États-Unis sont passées de 22 % à 5 % entre 1999 et 2010(23) L’étude a été conçue pour évaluer si les avantages du THM, notamment sur le plan cardiaque, s’appliquaient aux femmes plus âgées (63 ans en moyenne), comme l’avaient montré les études observationnelles menées sur des femmes plus jeunes. L’étude n’a pas mis en évidence de bénéfices au niveau cardiaque. Elle n’a pas été conçue pour évaluer correctement les risques liés au THM(22). Une nouvelle analyse des résultats et la publication de l’étude WHI sur les œstrogènes seuls suggèrent que les conclusions initiales étaient exagérées(24). Bien que des associations internationales, dont l’International Menopause Society (2016), la North American Menopause Society (2017), la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (2014) et l’American College of Endocrinology (2015), aient publié des lignes directrices favorables à l’utilisation du THM en première intention, les patientes peuvent hésiter à entamer un traitement en raison des points de vue négatifs sur le THM véhiculés par les médias ou les membres de leur famille, et peuvent avoir besoin de discuter en détail des avantages et des inconvénients de ce traitement, afin de prendre une décision éclairée.
Au Canada, les lignes directrices recommandent le THM comme traitement de première intention des SVM modérés à sévères chez les femmes âgées de moins de 60 ans ou dans les 10 ans suivant la DPM(25). Le recours au THM dans les 10 premières années suivant la ménopause peut réduire de 40 % le risque de maladie cardiaque et de mortalité toutes causes confondues(26). Si le moment est bien choisi, l’instauration d’une hormonothérapie se traduit par une mortalité toutes causes confondues plus favorable et par moins d’infarctus du myocarde (IM) que le placebo(26). Le THM systémique peut réduire les SVM de 70 à 95 % et améliorer la qualité du sommeil et les troubles de l’humeur, en particulier en périménopause et au début de la postménopause (stade STRAW+10 -2 à +1c)(26). Certaines femmes expriment une préférence pour des hormones d’origine naturelle. Par définition, les hormones bio-identiques ont la même structure moléculaire qu’une hormone produite de façon endogène(27). Le terme « hormonothérapie bio-identique » est souvent utilisé pour décrire des formulations composées sur mesure, mais de nombreux produits hormonaux réglementés sur ordonnance sont bio-identiques, notamment la progestérone micronisée, le 17-ß estradiol et l’estrone. La NAMS (North American Menopause Society) recommande l’utilisation de préparations bio-identiques réglementées par le gouvernement en raison du manque de contrôle de la qualité, de l’innocuité et de l’efficacité des composés non réglementés (magistrales)(26)
Les contre-indications du THM sont les suivantes : saignements vaginaux anormaux, hépatopathie aiguë, troubles de la coagulation, TVP/EP active ou antécédents de TVP/EP, maladie coronarienne, risque élevé de maladie coronarienne, antécédents personnels de cancer œstrogéno-dépendant (sein, endomètre, ovaire) ou risque élevé de cancer du sein(26). La migraine avec aura n’est plus considérée comme une contre-indication, mais il est recommandé de consulter un neurologue avant de débuter un THM(27)
Recommandations liées au mode de vie
La thérapie cognitivo-comportementale (TCC), en groupe ou en autonomie, permet de diminuer efficacement l’impact ou la sévérité des SVM gênants et des troubles du sommeil associés, mais non la fréquence des SVM chez 65 à 78 % des femmes, par rapport à
un placebo(28). Les stratégies psychoéducatives et la TCC peuvent réduire les symptômes dépressifs, les troubles du sommeil et les troubles sexuels et améliorer la qualité de vie et les fonctions globales après 3 mois de traitement(29-31) Les essais cliniques randomisés (ECR) portant sur la TCC chez les femmes ayant survécu à un cancer du sein et en périménopause ainsi que chez les femmes ménopausées sans cancer ont donné des résultats positifs en ce qui concerne la prise en charge des SVM(30). La réduction du stress basée sur la pleine conscience peut également réduire la gêne occasionnée par les bouffées de chaleur, mais non leur fréquence ni leur sévérité. Il existe peu de preuves concernant les techniques d’hypnose. Les données actuellement disponibles suggèrent que l’hypnose peut être efficace pour réduire à court terme la sévérité et la fréquence des SVM, sur une période de 5 semaines(32) L’obésité est associée à des taux plus élevés de SVM(33). La perte de poids dans le cadre de mesures comportementales peut donc réduire les SVM(34). Des études indiquent que la perte de poids peut être plus efficace chez les femmes au début de la transition ménopausique(35). Ceci est cohérent avec les observations selon lesquelles une adiposité élevée est associée à des SVM plus importants, principalement en début de transition, mais peut ne pas se poursuivre jusqu’à la ménopause tardive(33)
Les techniques de refroidissement, comme le port de vêtements respirants et l’utilisation de ventilateurs, en évitant les déclencheurs (alcool, caféine et nourriture épicée), ne sont pas suffisamment documentées, mais on peut raisonnablement les recommander(28). Il n’existe aucune preuve de l’efficacité de l’activité physique, du yoga, de la modification des habitudes alimentaires ou de l’acupuncture pour réduire les SVM. Cependant, le tabagisme est susceptible d’aggraver les SVM, l’arrêt du tabac peut donc être bénéfique.
Les produits de santé naturels pour le traitement des SVM
Les études systématiques n’ont pas identifié de produits à base de plantes efficaces pour le traitement des SVM modérés à sévères. De nombreuses études sur les isoflavones de soja (phytœstrogènes) ont donné des résultats mitigés et des effets variables sur les SVM. Une méta-analyse indique que les études actuelles n’ont peut-être pas été menées sur une durée suffisante, car les produits à base de soja peuvent mettre 48 semaines pour produire un
TABLEAU 1 Traitements non hormonaux de la ménopause et posologies suggérées
Type
Fézolinétant*
IRSN
Venlafaxine XR
Desvenlafaxine
Duloxétine
ISRS
Citalopram
Escitalopram
Paroxétine
Gabapentinoïdes
Gabapentine
Clonidine*
Oxybutynine
Oxybutynine à libération immédiate
Oxybutynine XL
Posologie suggérée
45 mg par voie orale 1 fois/jour
37,5 à 150 mg par voie orale 1 fois/jour
100 à 150 mg par voie orale 1 fois/jour
60 mg par voie orale 1 fois/jour
10 à 20 mg par voie orale 1 fois/jour
10 à 20 mg par voie orale 1 fois/jour
10 à 20 mg par voie orale 1 fois/jour
100 à 900 mg par voie orale au coucher
0,05 mg par voie orale 2 fois/jour
2,5 à 5 mg par voie orale 2 fois/jour
15 mg par voie orale 1 fois/jour
IRSN = inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, ISRS = inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine. * = Approuvé par Santé Canada pour le traitement des SVM modérés à sévères.
D’après Lega IC et al. CMAJ 15 mai 2023;195:E677-72. doi: 10.1503/cmaj.221438
effet complet ou 13 semaines pour un demi-effet(36). Malheureusement, les produits à base de soja, leurs dérivés ou leurs métabolites n’ont pas été différenciés. Les sources alimentaires peuvent être privilégiées, notamment le lait de soja ou le tofu. Environ un tiers des femmes nord-américaines ne sont pas en mesure de convertir l’isoflavone de soja daidzéine en S-equol, ce qui a conduit à la mise au point de produits contenant du S-equol. Les isoflavones de soja peuvent provoquer des diarrhées, une constipation, des ballonnements, des flatulences et des nausées. Elles présentent de nombreuses interactions médicamenteuses, notamment avec la théophylline, la lévothyroxine, le tamoxifène et la warfarine.
Une revue Cochrane de 16 ECR utilisant l’actée à grappes noires n’a pas montré de différence dans la fréquence ou la sévérité des SVM par rapport au placebo après 23 semaines(37). Les effets indésirables de l’actée à grappes noires sont notamment la sensibilité mammaire, les vertiges, les troubles gastro-intestinaux, les maux de tête, l’irritabilité et les éruptions cutanées.
La rhubarbe sibérienne a été étudiée en raison de ses propriétés œstrogéniques. La prise de 4 mg par jour par voie orale peut réduire les SVM après 12 semaines, mais les conclusions sont
limitées en raison du faible taux de rétention rétention dans l’étude (38) . La diarrhée, les nausées et les vomissements sont des effets indésirables courants.
Les options thérapeutiques non hormonales sur ordonnance
Les médicaments non hormonaux pour le traitement des SVM sont considérés comme des traitements de deuxième intention (voir le tableau 2) et peuvent être envisagés chez les patientes qui ne sont pas candidates au THM ou chez celles qui préfèrent les options non hormonales(28). Ils ont l’avantage de pouvoir être introduits en toute sécurité à n’importe quel stade et ne sont pas limités à un délai de 10 ans après la DPM ou avant l’âge de 60 ans(28)
Le fézolinétant, un antagoniste du récepteur de la neurokinine 3 (NK3), a permis de réduire la fréquence des SVM modérés à sévères d’environ 60 % sur 12 semaines de traitement dans le cadre des études SKYLIGHT 1 et SKYLIGHT 2, chez des femmes âgées de 40 à 65 ans, à une dose de 30 à 45 mg par voie orale une fois par jour(39, 40). Des améliorations de la fréquence et de la sévérité des symptômes vasomoteurs ont été observées après 1 semaine et maintenues pendant 52 semaines(39, 40) .
Ces essais ont également permis de constater une amélioration cliniquement significative de la qualité de vie grâce au fézolinétant(39). Les effets indésirables sont notamment les douleurs abdominales, les diarrhées et l’insomnie(41). Parmi les contre-indications figurent la cirrhose avérée, l’insuffisance rénale sévère ou la néphropathie terminale, l’utilisation concomitante d’inhibiteurs modérés ou puissants du CYP1A2 et la grossesse avérée ou suspectée(41). Deux revues systématiques et méta-analyses comprenant respectivement sept et six ECR ont constaté un bénéfice en termes de fréquence et de sévérité des SVM avec l’utilisation du fézolinétant par rapport au placebo(42,43). Il a été prouvé que les IRSN et les ISRS réduisent la sévérité et la fréquence des bouffées de chaleur de 27 à 65 %(44). Ces agents permettent de réduire les SVM à des doses inférieures à celles utilisées pour l’anxiété et la dépression, la réduction des SVM se manifestant souvent en quelques jours(44). La venlafaxine XR (37,5 à 150 mg) a une efficacité similaire à celle de la paroxétine par rapport au placebo, avec une réduction des SVM de 40 à 65 %(44, 45). La venlafaxine XR à raison de 37,5 mg par jour a amélioré les SVM en l’espace d’une semaine environ et la dose de 75 mg par jour a entraîné une amélioration du sommeil. Elle est considérée comme le traitement non hormonal de première ligne des SVM chez les patientes atteintes d’un cancer du sein en raison de sa supériorité par rapport à la gabapentine(45) La desvenlafaxine (100 à 150 mg)(46), la duloxétine (60 mg)(47), l’escitalopram (10 à 20 mg)(48) et le citalopram (10 à 20 mg)(49) ont permis de réduire de manière significative la sévérité et la fréquence des SVM dans le cadre d’ECR en double aveugle de grande envergure. La paroxétine en gélule à libération prolongée est l’option thérapeutique non hormonale la plus étudiée. Elle permet de réduire les SVM de 40 à 65 %(50). Ce produit n’est pas disponible au Canada et les formulations qui existent ne doivent pas être considérées comme directement interchangeables(51). La paroxétine peut faire baisser les concentrations de tamoxifène en raison de l’inhibition du CYP2D6, elle est donc contre-indiquée chez les femmes traitées par tamoxifène. Les nausées, les maux de tête, la somnolence, les vertiges, la sécheresse buccale et la baisse de la libido sont des effets indésirables fréquents des IRSN/ISRS(49). Une analyse groupée des données individuelles de 899 femmes symptomatiques a montré que
la venlafaxine (75 mg), l’escitalopram (10 à 20 mg) et le 17-ß estradiol à faible dose (0,5 mg) étaient tous efficaces et comparables pour réduire la fréquence des bouffées de chaleur après 8 semaines de traitement(44). Les études utilisant la fluoxétine et la sertraline n’ont pas montré d’efficacité par rapport au placebo(44).
En ce qui concerne les gabapentinoïdes, il a été démontré qu’une dose de gabapentine allant jusqu’à 900 mg par nuit réduisait la fréquence des bouffées de chaleur de 45 à 71 % avec un délai d’action d’une semaine(6). Ce médicament peut se révéler particulièrement utile si les bouffées de chaleur provoquent des insomnies ou des réveils nocturnes. Les effets secondaires, comme les vertiges et la somnolence, sont plus marqués au cours de la première ou des deux premières semaines, mais s’atténuent au bout de quatre semaines. Les gabapentinoïdes augmentent le risque de dépression respiratoire lié aux opioïdes, la prudence est donc de mise chez les patientes qui en font un usage concomitant. Il existe peu de preuves concernant l’utilisation de la prégabaline(52).
Dans le cadre d’études de faible envergure d’une durée de 6 à 12 semaines, l’oxybutynine a permis de réduire la fréquence des bouffées de chaleur de 60 à 77 % dans la semaine suivant le début du traitement(23). Les effets indésirables sont fréquents et comprennent la sécheresse buccale, les troubles gastro-intestinaux, la constipation et une vision trouble. Les données observationnelles suscitent des inquiétudes en ce qui concerne le déclin cognitif chez les femmes âgées. Un seul ECR a montré que 15 mg d’oxybutynine LP permettent de réduire efficacement la fréquence et la sévérité des SVM après une semaine, mais plus de 50 % des femmes traitées ont signalé une sécheresse buccale(53)
On dispose de peu de données probantes sur la clonidine, dont les résultats sont mitigés, mais qui peut réduire les SVM de 20 à 40 %. De manière générale, elle n’est pas recommandée en raison de ses effets indésirables et de sa moindre efficacité par rapport à d’autres options non hormonales(54) Les vertiges, la sécheresse buccale, l’hypotension, les effets sédatifs et les maux de tête sont des effets indésirables courants.
Lorsque l’on passe en revue les médicaments non hormonaux pour le traitement des SVM avec la patiente, il faut tenir compte des autres symptômes gênants, afin d’orienter les recommandations thérapeutiques et de favoriser la
prise de décision partagée. Par exemple, si la patiente est d’humeur maussade ou dépressive, il peut être préférable de lui prescrire un IRSN ou un ISRS.
Quelques ressources utiles pour une pratique fondée sur des données probantes
Le site web Menopause Quick 6 (MQ6), qui propose un outil d’évaluation validé, a été développé par un médecin de famille canadien, le Dr Susan Goldstein, et publié dans le journal Canadian Family Physician. Après un dépistage positif au questionnaire MQ6, les fournisseurs de soins de santé peuvent utiliser l’outil d’aide à la décision pour guider les patientes dans le choix des options thérapeutiques(55)
RxFiles est un programme de formation continue canadien qui comprend désormais des tableaux de comparaison de médicaments, des résumés d’essais et des outils cliniques. Cette ressource sur abonnement est accessible en ligne à l’adresse www.rxfiles.ca(56)
Le Guide de poche : gestion de la ménopause, publié par la Société canadienne de la ménopause, résume les lignes directrices de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC 2014), de l’International Menopause Society (IMS 2016), de la North American Menopause Society (NAMS 2017) et de l’Endocrine Society (ES 2015)(57)
Le rôle du pharmacien dans le traitement de la ménopause
Une enquête canadienne a montré que 77 % des femmes se sentaient à l’aise pour parler de la ménopause à leur médecin, mais seulement 27 % d’entre elles ont déclaré que leur médecin avait abordé le sujet de façon proactive. Les pharmaciens, qui font partie des professionnels de la santé les plus accessibles et les plus fiables, sont bien placés pour discuter de façon proactive de la ménopause avec les patientes et créer un espace sûr où les femmes peuvent poser des questions et en apprendre davantage sur cette phase de la vie(58). On peut envisager d’aborder le sujet de la ménopause en pharmacie avec des femmes âgées de plus de 40 ans qui se sont vu prescrire un traitement contre l’insomnie, un nouvel antidépresseur ou un nouveau médicament contre l’anxiété.
Cas d’une patiente - Dana Dana vient chercher un renouvellement pour son traitement de 17-ß estradiol (Divigel) 1 mg en application quotidienne et de Prometrium 200 mg par voie orale, au coucher. Lorsqu’on
l’interroge sur les résultats de son traitement, elle indique qu’elle a moins de bouffées de chaleur, mais qu’elles se produisent encore 2 à 3 fois par jour et que des sueurs nocturnes la réveillent au moins une fois par nuit. Dana nous apprend ceci : elle est âgée de 49 ans, les SVM perturbent ses activités au travail et à la maison, elle est parfois d’humeur maussade, son sommeil s’est amélioré depuis qu’elle a commencé à prendre le THM. Ses dernières règles remontent à 8 mois. Pas d’autres médicaments sur ordonnance ou en vente libre. Pas d’autres pathologies. Dana demande s’il existe d’autres produits à prendre pour atténuer ses symptômes.
Réponse : suggérez-lui de prendre 37,5 mg de venlafaxine XR ou 10 mg d’escitalopram par voie orale une fois par jour. Ces médicaments sont les
plus éprouvés et il n’est pas nécessaire de recourir à des sédatifs si l’on peut réduire les bouffées de chaleur nocturnes. D’autres IRSN ou ISRS pourraient être appropriés.
Cas d’une patiente - Linda Une femme d’âge moyen vous aborde à la pharmacie au sujet de produits en vente libre destinés à réduire les bouffées de chaleur. Après quelques minutes de conversation, vous apprenez que Linda est âgée de 58 ans, que sa DPM remonte à 4 ans, qu’elle a subi un N-STEMI il y a 2 ans et qu’elle souffre de plusieurs bouffées de chaleur par jour (ce qui affecte sa capacité à travailler). L’année dernière, son médecin lui a dit que l’IM était une contre-indication au THM et il lui a prescrit de l’escitalopram, qu’elle n’a pas pris. Elle estimait
en effet que ce médicament n’était pas adapté vu qu’elle ne présentait aucun symptôme dépressif.
Réponse : passez en revue avec Linda les preuves de l’efficacité de l’escitalopram pour réduire les SVM. Informez Linda de l’existence d’un médicament nouvellement approuvé, le fézolinétant, à raison de 45 mg une fois par jour par voie orale, qui pourrait réduire de 60 % ses SVM, comme alternative aux IRSN/ ISRS.
Références en ligne sur eCortex.ca.
Retrouvez les questions de cette leçon de FC sur eCortex.ca.
Recherche à l’aide du titre entier ou partiel de la formation
REMARQUE : L’ordre des réponses pourrait être différent dans la version publiée en ligne. Veuillez lire attentivement les énoncés lorsque vous répondez au test sur eCortex.ca.
1. Combien de femmes souffrant de symptômes vasomoteurs (SVM) présentent des changements d’humeur, de l’insomnie ou de l’anxiété en plus des bouffées de chaleur?
a) 30 %
b) 70 %
c) 50 %
d) 10 %
COLLABORATEURS
À PROPOS DE L’AUTEURE :
2. Quel groupe ethnique est le plus susceptible de présenter des symptômes vasomoteurs (SVM) gênants?
a) Les femmes chinoises
b) Les femmes noires
c) Les femmes japonaises d) Les femmes blanches
3. Lequel des traitements suivants est une option thérapeutique non hormonale pour le traitement des SVM?
a) L’œstrogénothérapie b) Le fézolinétant c) Le traitement progestatif d) Les modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes
4. Quel traitement non hormonal réduit la fréquence des SVM?
a) La clonidine b) Le fézolinétant
c) L’escitalopram
d) Toutes les réponses ci-dessus.
5. Quel est le principal avantage des options thérapeutiques non hormonales pour le traitement des SVM?
a) Elles soulagent immédiatement l’ensemble des symptômes.
b) Elles sont plus efficaces que les traitements hormonaux.
c) Elles peuvent être mises en œuvre à n’importe quel stade de la ménopause.
d) Elles ne présentent aucun effet indésirable.
6. Laquelle des interventions suivantes a permis de réduire l’impact des symptômes vasomoteurs (SVM) chez 65 à 78 % des femmes?
a) Les groupes de thérapie cognitivo-comportementale (TCC)
b) L’acupuncture d) La perte de poids dans le cadre de mesures comportementales d) L’arrêt du tabac
Cait Luther est pharmacienne clinicienne et praticienne accréditée par la Menopause Society (MSCP). Elle exerce dans un établissement de soins primaires au sein de l’équipe de l’Hamilton Family Health Team. Cait a participé à la formation des professionnels de la santé et des patients sur les approches fondées sur des données probantes pour soutenir la santé des femmes.
RÉVISEURS
Toutes les leçons sont révisées par des pharmaciens afin d’en assurer l’exactitude et la validité, ainsi que la pertinence pour la pratique pharmaceutique.
Directrice des projets de FC :
Rosalind Stefanac
Concepteur graphique de FC :
Shawn Samson
Cette leçon est publiée par EnsembleIQ : 20, avenue Eglinton Ouest, bureau 1800 Toronto (Ontario) M4R 1K8
Tél. : 1 877 687-7321
Téléc. : 1 888 889-9522
Information sur la FC : ecortex@professionsante.ca
Il est interdit de reproduire cette leçon de Formation continue, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur.
LES MARQUES LES PLUS RECOMMANDÉES PAR LES
Depuis plus de 30 ans, l’Enquête sur les conseils et recommandations en matière de médicaments en vente libre (MVL) de Profession Santé, The Medical Post et Pharmacy Practice + Business souligne le rôle incontournable que jouent les médecins dans les conseils qu’ils prodiguent aux patients qui les consultent.
Grâce à la participation de médecins à travers le pays, cette importante enquête annuelle permet de documenter les tendances sur les produits qui sont recommandés pour traiter différentes pathologies.
Dans les tableaux des pages suivantes, vous pourrez ainsi voir comment vous vous situez par rapport aux autres médecins en ce qui a trait à vos recommandations.
Merci à tous ceux et celles qui ont participé à cette nouvelle édition !
L’Enquête sur les conseils et recommandations en matière de MVL repose sur un sondage en ligne réalisé entre les mois d’octobre 2024 et de janvier 2025 par la division de recherche d’EnsembleIQ. Au total, 802 médecins canadiens ont répondu à l’enquête, dont 360 médecins québécois, ce qui représente une marge d’erreur de ± 3,45 à un niveau de confiance de 95 %.
Au total, 30 catégories de produits ont été présentées à l’échantillon global de médecins. Pour établir le classement des marques de médicaments en vente libre, une question ouverte a d’abord été posée aux répondants : 1) À quelle fréquence faites-vous des recommandations sur cette catégorie de produits chaque mois ?
Ensuite, les répondants ont reçu une liste complète de marques pour chaque catégorie et ont été invités à 2) Indiquer quelle(s) marque(s) vous recommandez habituellement.
Pour en savoir plus sur l'Enquête 2025 sur les conseils et les recommandations en matière de MVL, accédez
Seuls les produits en vente libre élus « marques les plus recommandées par les médecins » dans le cadre de l’Enquête sur les conseils et recommandations en matière de MVL peuvent afficher le logo ou la mention « marque la plus recommandée par les médecins ».
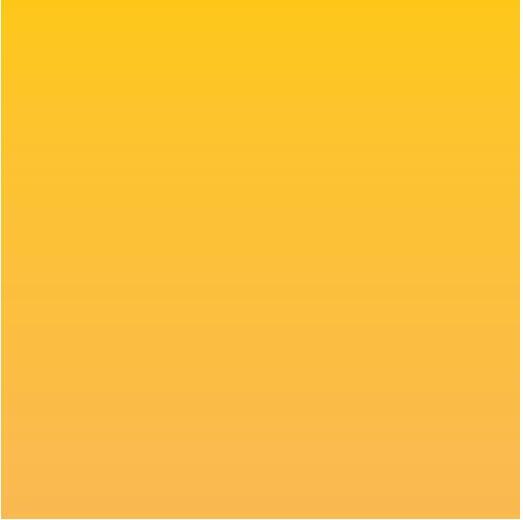
Catégorie
Les grandes marques classées selon le pourcentage de médecins qui les recommandent à leurs patients. Nombre moyen de fois par mois que les médecins font une recommandation dans cette catégorie.

Dans le cadre de l’Enquête sur les conseils et recommandations en matière de MVL, nous demandons aux médecins combien de fois par mois ils recommandent des produits populaires en vente libre. Vous trouverez ci-dessous les 20 produits qu’ils recommandent le plus souvent.







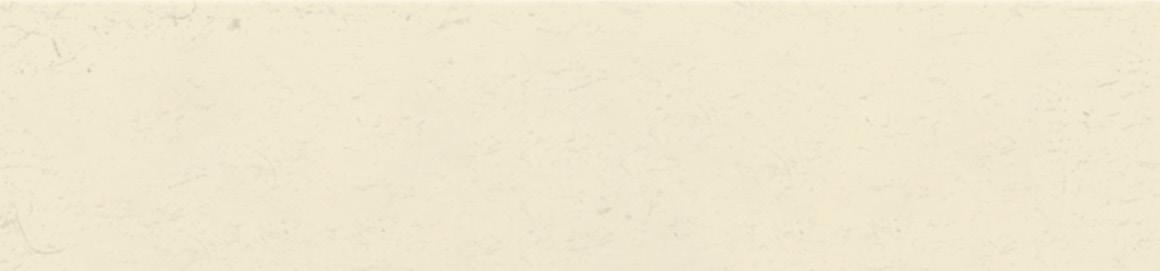
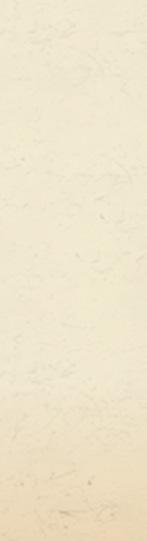















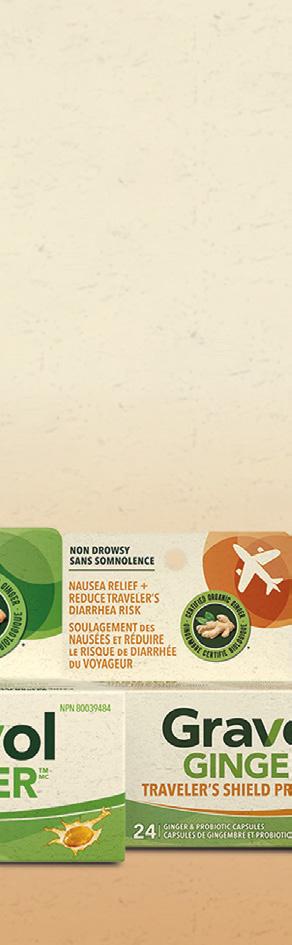

Mentions de moins de 2 % ignorées; n = 243; total peut être supérieur à 100 %; 68 % des médecins ont fait des recommandations dans cette catégorie.
MOYENNE DE RECOMMANDATIONS/MOIS
Base : Ils font au moins une recommandation par mois.



Mentions de moins de 28 % ignorées; n = 289; total peut être supérieur à 100 %; 80 % des médecins ont fait des recommandations dans cette catégorie.

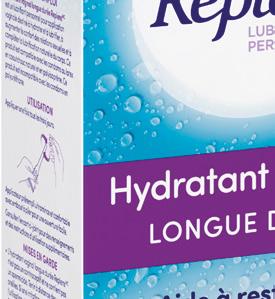
Mentions de moins de 12 % ignorées; n = 178; total peut être supérieur à 100 %; 49 % des médecins ont fait des recommandations dans cette catégorie.
MOYENNE DE RECOMMANDATIONS/MOIS
Base : Ils font au moins une recommandation par mois.



Mentions de moins de 9 % ignorées; n = 75; total peut être supérieur à 100 %; 21 % des médecins ont fait des recommandations dans cette catégorie.
MOYENNE DE RECOMMANDATIONS/MOIS
Base : Ils font au moins une recommandation par mois.





MERCI de faire de ReplensMC la marque de lubrifiant vaginal la plus populaire au Canada.
Sondage 2025 sur les recommandations en matière de MVL réalisé par Profession Santé et Pharmacy Practice + Business (Pharmaciens) Sondage 2025 sur les recommandations en matière de MVL réalisé par Profession Santé et The Medical Post (Médecins)

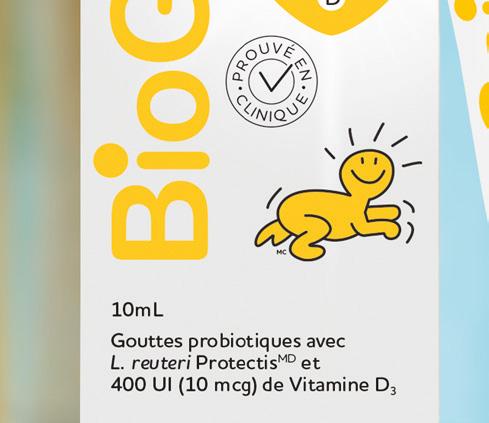














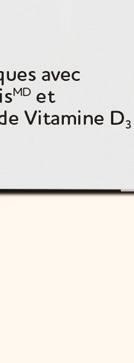


d'avoir fait de BioGaia le probiotique pédiatrique n°1 préféré des médecins et des pharmaciens au Canada pour les MVL, pour une deuxième année de suite !

• Sondage 2025 sur les recommandations en matière de MVL réalisé par Profession Santé et Pharmacy Practice + Business (Pharmaciens) • Sondage 2025 sur les recommandations en matière de MVL réalisé par Profession Santé et The Medical Post (Médecins)







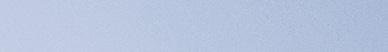


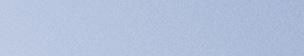
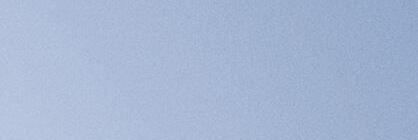
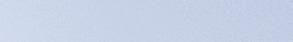















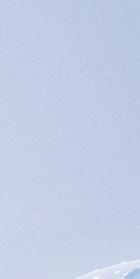





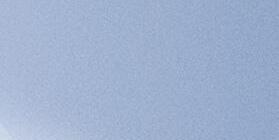







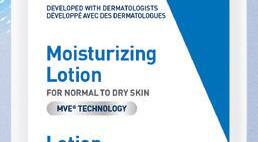




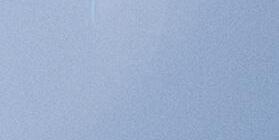





* Sondage 2025 sur les recommandations en matière de MVL réalisé par Profession Santé et The Medical Post (médecins)

Mentions de moins de 33 % ignorées; n = 273; total peut être supérieur à 100 %; 76 % des médecins ont fait des recommandations dans cette catégorie.
MOYENNE DE RECOMMANDATIONS/MOIS
Base : Ils font au moins une recommandation par mois.
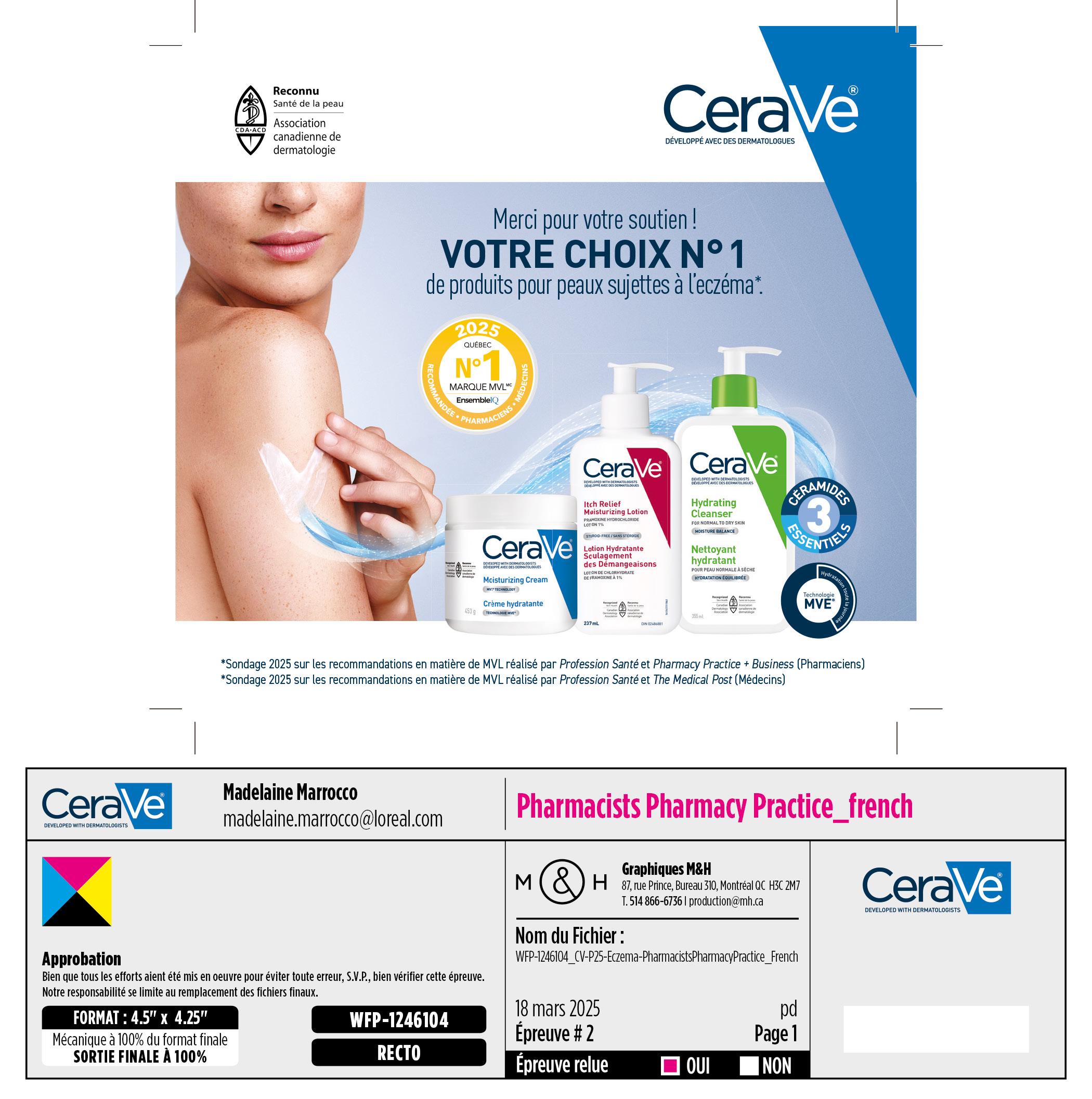
Mentions de moins de 35 % ignorées; n = 221; total peut être supérieur à 100 %; 61 % des médecins ont fait des recommandations dans cette catégorie.
RECOMMANDATIONS/MOIS 9 : Ils font au moins une recommandation par mois.
Traitements contre les hémorroïdes
d’avoir nommé AnusolMC la première marque de traitement des hémorroïdes recommandée par les Médecins au Canada.
Mentions de moins de 3 % ignorées; n = 202; total peut être supérieur à 100 %; 56 % des médecins ont fait des recommandations dans cette catégorie.
MOYENNE DE RECOMMANDATIONS/MOIS
Base : Ils font au moins une recommandation par mois.

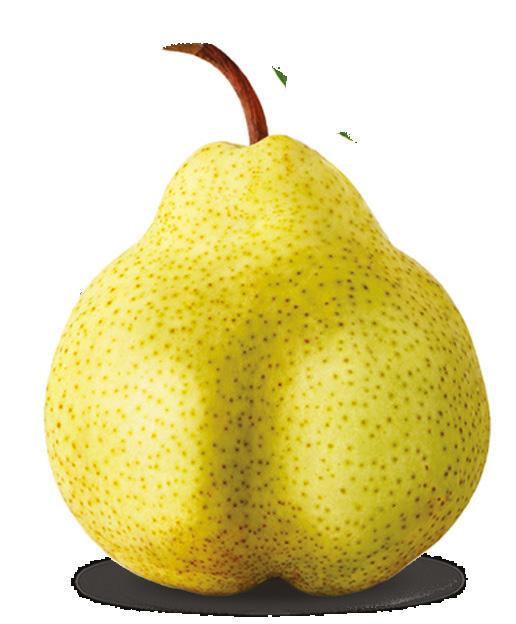


Sondage 2025 sur les recommandations en matière de MVL réalisé par Profession Santé et Pharmacy Practice + Business (Pharmaciens)
Sondage 2025 sur les recommandations en matière de MVL réalisé par Profession Santé et The Medical Post (Médecins)

Par Cait Luther, MSCP, BSc, PharmD, RPh
MOTS-CLÉS : SYMPTÔMES VASOMOTEURS (SMV)
DU
Leçon à visée éducative financée par Astellas Pharma Canada, Inc.

APPROUVÉE POUR
1,5 UFC
Ordre des pharmaciens du Québec
OPQ : 250219
CCECP N o 1329-2025-3957-I-P

Des données probantes à l’action : la gestion de l’obésité dans l’exercice de la pharmacie
Par Michael Boivin, Bsc. Phm, RPH, CDE
MOTS-CLÉS :
SOINS CENTRÉS SUR LE PATIENT
PRISE EN CHARGE DE L’OBÉSITÉ ET PHARMACOTHÉRAPIE
LE TRAITEMENT DES MALADIES CHRONIQUES
Soutenu par une subvention à l’éducation sans restriction de Novo Nordisk Canada

Accédez à cette leçon sur eCortex, la plateforme de formation continue de Profession Santé, Québec Pharmacie et ProfessionSanté.ca
INSCRIPTION
SIMPLE ET GRATUITE

ACCÉDEZ AU SITE D’INFORMATION N° 1 POUR LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
Ne manquez aucune actualité Partagez votre avis
Accédez à des milliers d’articles Abonnez-vous à des infolettres pertinentes pour votre pratique
INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT

1. Prendre en charge efficacement une plainte de sommeil selon une approche structurée.
2. Appliquer les recommandations comportementales de base dans le traitement de l’insomnie.
3. Optimiser la prescription et la déprescription des hypnotiques en intégrant les principes de la TCC-I.
Cette leçon est accessible sur

Introduction et mise en contexte
RÉDACTION
MÉLANIE CARRIER, B. SC., B. PHARM., PHARMACIENNE, CANDIDATE À LA MAÎTRISE EN SCIENCES PHARMACEUTIQUES, CLINIQUE CIRCA, GMF RIVE-DE-L’ETCHEMIN, CENTRE MÉDICAL LÉVIS-LAUZON RÉVISION
L’insomnie chronique touche plus de 10 % de la population et figure parmi les motifs de consultation les plus fréquents en première ligne1. Elle est associée à un risque accru de dépression, de déclin cognitif, d’accidents et de maladies chroniques2 , mais demeure souvent sous-traitée. Elle tend aussi à persister : environ 70 % des patients
présentent encore des symptômes après un an, et près de 50 % après trois ans3. Ne pas la traiter peut aggraver les symptômes anxiodépressifs, nuire à la qualité de vie et favoriser l’usage d’autres substances4.
Bien que la thérapie cognitivocomportementale de l’insomnie (TCC-I) soit recommandée depuis 2016 en première ligne 5 , les hypnosédatifs sont encore
DIANE POIRIER, M. D., MÉDECIN AUX SOINS INTENSIFS ET PROFESSEURE D'ENSEIGNEMENT CLINIQUE À L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE >
Vous revoyez Mme L.S., 72 ans, après 18 mois. Elle prend chaque soir de la zopiclone 7,5 mg depuis plusieurs années. À la dernière consultation, elle était peu ouverte à une réduction. Vous décidez tout de même d’aborder à nouveau la question. À votre surprise, elle se dit prête à essayer, mais craint de revivre des nuits blanches. Elle ne sait pas comment amorcer le changement ni quoi mettre en place pour l’aider à dormir. Même lorsqu’elle se sent fatiguée, elle rapporte tourner longtemps dans son lit avant de s’endormir.
souvent prescrits d’emblée. Le terme « hypnosédatif » désigne ici tout médicament utilisé pour traiter l’insomnie, peu importe sa classe ou son indication officielle. Or, ceuxci ne traitent pas les causes de l’insomnie chronique et leur efficacité tend à diminuer sans approche complémentaire. La TCC-I, qui cible les comportements, les croyances et l’hyperactivation du système nerveux6, demeure sous-utilisée, notamment en raison du manque de ressources7. Des formats abrégés comme le Brief Behavioral Treatment for Insomnia (BBTI) ont été conçus pour les soins de première ligne8
L’intégration de l’insomnie dans une approche interdisciplinaire en GMF favoriserait une évaluation structurée et une meilleure coordination des interventions pharmacologiques et non pharmacologiques.
Évaluation et dépistage des comorbidités associées à l’insomnie chronique
L’insomnie chronique se définit par une difficulté à initier ou à maintenir le sommeil, ou par des éveils précoces, survenant au moins trois fois par semaine depuis plus de trois mois, accompagnée de répercussions diurnes significatives (fatigue, troubles de concentration ou de l’humeur, irritabilité, préoccupations liées au sommeil). Un délai d’endormissement ou un éveil nocturne de plus de 30 minutes est généralement considéré comme cliniquement significatif. Le diagnostic suppose des conditions de sommeil adéquates et l’exclusion d’une autre cause primaire9,10
L’index de sévérité de l’insomnie (ISI-7) est l’outil de référence pour mesurer les symptômes et leur impact (voir la figure 1)11. L’ISI-3, plus bref, peut servir d’amorce en consultation12
L’insomnie coexiste souvent avec des troubles interreliés qui en compliquent
l’évaluation¹². Sur le plan clinique, il peut être utile de distinguer trois types de mécanismes perturbant le sommeil. Les éveils conscients sont fréquemment liés à l’apnée obstructive du sommeil (AOS), à la douleur, à la nycturie ou à certains troubles psychiatriques14. Les micro-éveils, souvent imperceptibles, peuvent résulter de troubles respiratoires ou moteurs. Enfin, l’hyperéveil nocturne, caractéristique de l’insomnie chronique, est également observé en contexte d’anxiété, de stress post-traumatique ou de trouble du rythme circadien43.
Ces mécanismes peuvent coexister et s’autorenforcer. Par exemple, le trouble du rythme circadien de retard de phase, caractérisé par un endormissement et un réveil retardés par rapport aux rythmes sociaux et professionnels, peut mimer ou aggraver une insomnie, notamment chez les adolescents, les patients ayant un trouble déficitaire de l’attention (TDAH) ou les travailleurs à horaires décalés10
Enfin, certains médicaments, notamment les antidépresseurs activateurs, les corticostéroïdes et les stimulants, sont associés à une activation physiologique accrue (métabolisme, cortisol, fréquence cardiaque) pouvant contribuer à la fragmentation du sommeil ou à une activation sympathique nocturne excessive15
En plus du dépistage des facteurs médicaux et psychiatriques, l’évaluation doit également inclure l’exploration des habitudes de sommeil, les croyances envers le sommeil, des ruminations nocturnes. Ces sujets seront couverts à travers les sections suivantes.
Une meilleure compréhension des mécanismes qui perpétuent l’insomnie guide
l’évaluation et oriente les interventions. Le modèle des 3P16 identifie des facteurs prédisposants (p. ex., anxiété, hypervigilance), précipitants (p. ex., stress, maladie), et surtout perpétuants, comme le temps excessif au lit, des horaires irréguliers, les ruminations nocturnes et certaines croyances dysfonctionnelles17. Ces éléments doivent être explorés lors de l’évaluation.
L’échelle des Croyances et Attitudes envers le Sommeil (CAS-16)18 peut aider à cerner ces croyances, bien qu’une restructuration formelle ne soit pas toujours requise.
Chez certains patients, l’insomnie persiste malgré des habitudes de sommeil relativement adéquates. Des études en neurophysiologie ont mis en évidence un hyperéveil central : activité EEG rapide, tonus sympathique élevé, hyperactivité du cortex préfrontal15,19. Ce déséquilibre du système nerveux autonome est fréquent dans la fibromyalgie, le syndrome de stress post-traumatique (SSPT), les douleurs chroniques et d’autres troubles fonctionnels. Des questions sur la nature et l’intensité des ruminations nocturnes et des approches ciblant la régulation autonome peuvent alors être nécessaires.
Mécanismes et architecture du sommeil
Le sommeil est régulé par trois mécanismes interdépendants : la pression homéostatique (accumulation d’adénosine favorisant l’endormissement), le rythme circadien (synchronisé par la lumière, les repas, l’activité physique et les horaires réguliers) et le conditionnement lit-sommeil. Une pression homéostatique insuffisante – causée par une sieste tardive ou un temps d’éveil trop court – et des signaux circadiens affaiblis perturbent l’endormissement. Passer du temps éveillé au lit altère aussi cette régulation par association négative. Une efficacité du sommeil (temps dormi ÷ temps au lit × 100) inférieure à 85 % en témoigne et justifie une intervention comportementale20
Le sommeil comprend 4 à 5 cycles de 90 à 120 minutes. Les premiers sont plus riches en sommeil lent profond (NREM3), associé à la récupération physique, tandis que les derniers sont dominés par le sommeil
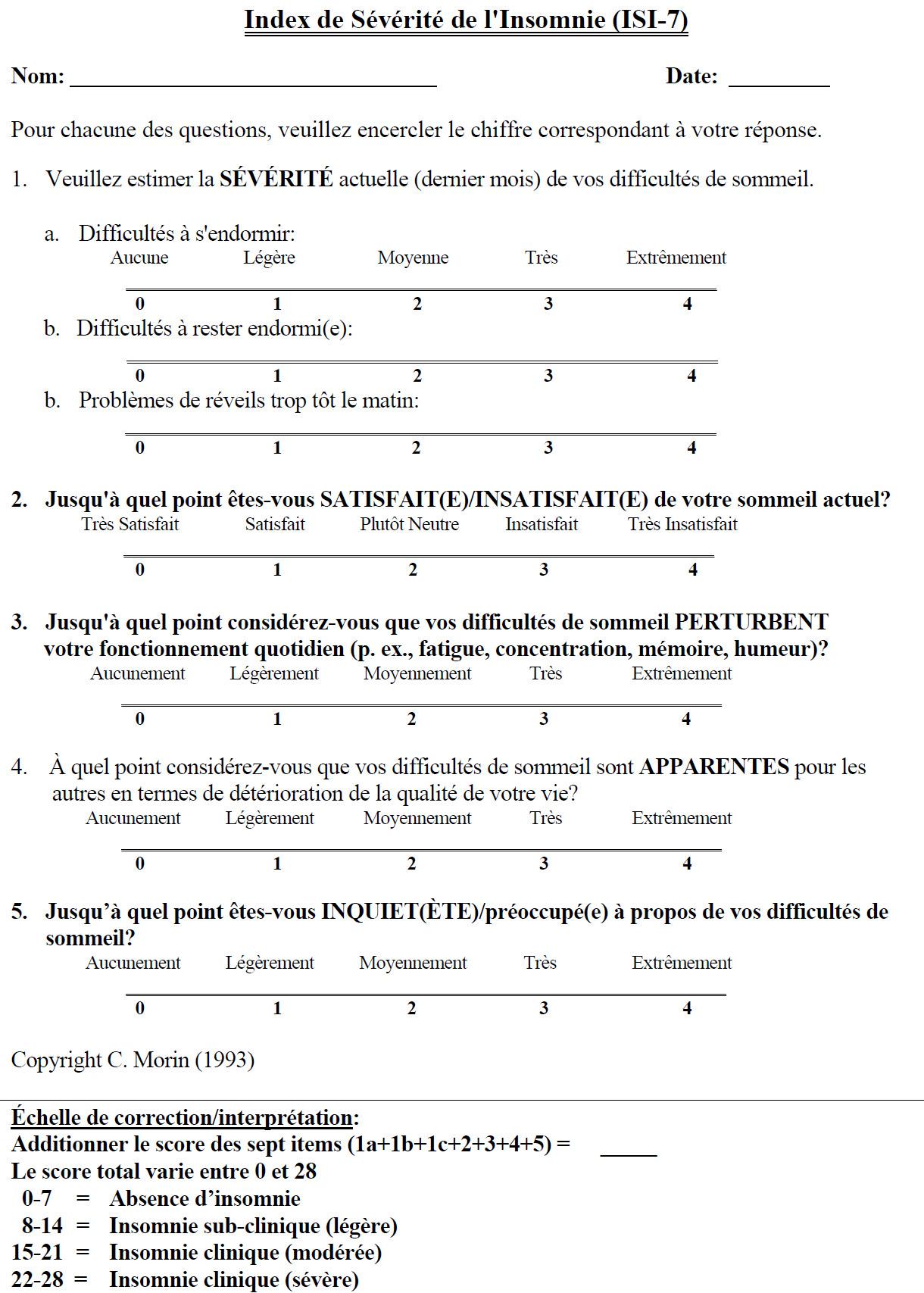
* Morin, 1993; Morin et al., 2011). En gras, les questions 2, 3 et 5 composent la version ISI-3, dont le seuil cliniquement significatif est de ≥ 7-points. (Thakral et al., 2021
paradoxal (REM), impliqué dans la régulation émotionnelle et la consolidation mnésique21. Un patient qui se réveille systématiquement dans les trois premières heures de sommeil pourrait avoir un déficit en sommeil profond. Des éveils brefs entre les cycles sont physiologiques, en particulier en fin de nuit, lorsque la pression homéostatique diminue et que les signaux circadiens d’éveil s’intensifient15
La prévention de l’insomnie repose sur des habitudes régulières : horaire stable, activité physique adaptée, alimentation équilibrée et bonne santé psychologique. L’anxiété et la dépression sont fréquemment associées à l’insomnie22.
En soirée, la baisse des stimuli externes favorise les ruminations, surtout si les inquiétudes sont mal régulées. Plusieurs facteurs activent le système nerveux sympa-
thique et nuisent au sommeil : stress chronique, exposition aux écrans, travail mental tardif, consommation de stimulants ou conditions médicales sous-jacentes14
Les mesures d’hygiène du sommeil, telles que limiter les stimulations, éviter les excitants en soirée, optimiser l’environnement et instaurer une routine apaisante, devraient être systématiquement recommandées. Bien qu’elles ne suffisent pas à traiter l’insomnie chronique, elles en préviennent souvent la chronicisation22,23
Traitement de l’insomnie chronique
Le traitement de l’insomnie vise à réduire sa sévérité (score ISI), raccourcir la latence d’endormissement et les éveils nocturnes, et améliorer la continuité du sommeil. Les objectifs secondaires incluent la réduction de la consommation des hypnosédatifs, des symptômes anxiodépressifs, des croyances erronées et un meilleur contrôle des comorbidités.
Même en cas d’insomnie comorbide ou secondaire, les stratégies demeurent essentiellement les mêmes10 . Si la TCC-I est recommandée en première ligne, une pharmacothérapie peut être justifiée temporairement. Sans modification des habitudes de sommeil, ses effets s’estompent souvent à l’arrêt. À l’inverse, en contexte de détresse psychologique marquée, son effet peut être partiel.
Dans tous les cas, l’ajout d’une approche éducative et comportementale (avec ou sans volet cognitif) augmente les chances d’un soulagement durable et devrait être accessible en soins primaires.
Plusieurs classes de médicaments, avec ou sans indication officielle en insomnie, sont couramment prescrites pour l’insomnie chronique, bien qu’aucune ne soit approuvée pour un usage à long terme24. La majorité cible un nombre restreint de récepteurs (GABA-A, H1, orexine)25. Le choix du traitement dépend du type d’insomnie (initiation vs maintien), des effets indésirables, des comorbidités (p. ex., apnée obstructive, surpoids, syndrome des jambes sans repos), du risque de dépendance et de l’historique de réponse24. Un changement de classe peut être envisagé en cas d’échec antérieur. À ce jour, seuls les antagonistes des récepteurs de l’orexine (DORA) et la doxépine >
Plutôt que de proposer un sevrage immédiat, vous explorez ses habitudes de sommeil. Elle passe environ neuf heures au lit, mais dort en moyenne sept heures. Lors de ses éveils nocturnes, elle reste au lit en ruminant, croyant augmenter ses chances de se rendormir. Vous lui proposez quelques ajustements simples : réduire le temps passé au lit, structurer sa routine du soir et sortir du lit en cas d’éveil prolongé. Trois semaines plus tard, elle observe une amélioration et, se sentant plus en contrôle, vous demande d’entamer une déprescription graduelle.
RESSOURCES UTILES SUR LE TRAITEMENT
MÉDECINS
Guide de thérapie brève de TCC Montréal (2025) www.tccmontreal.com/guides-de-pratique-selonles-diagnostics/
Prescription pour l’insomnie –Choisir avec soins Québec www.choisiravecsoinquebec.ca/outils-et-ressources/prescriptions-non-pharmacologiques/
Clinique Circa www.Cliniquecirca.ca/
Guide Bien dormir sans médicament https://www.reseaudeprescription.ca/sommeil
Vaincre les ennemis du sommeil – Charles M. Morin (Éditions de l’Homme, 2013)
Mieux Dormir (version francophone de SleepWell) www.mieux-dormir.ca/
à très faible dose ont démontré une efficacité soutenue jusqu’à 12 semaines, sans développement de tolérance ni perte d’effet25-27, ce qui contraste avec les autres classes, dont l’efficacité tend à diminuer après quelques semaines. Selon une méta-analyse de l’American Academy of Sleep Medicine25, les hypnotiques réduisent la latence d’endormissement de 10 à 20 minutes et prolongent le sommeil de 20 à 40 minutes, sans égaler les effets durables de la TCC-I.
Agonistes GABA-A (benzodiazépines et hypnotiques en Z)
Les benzodiazépines (BZD) sont généralement efficaces pour l’initiation et le main-
Guide pratique sur la thérapie comportementale de l’insomnie, adapté aux soins de première ligne
Outil pratique et visuel pour prescrire les stratégies comportementales
Journaux du sommeil et consignes, stratégies de relaxation
Document pratique pour accompagner la déprescription des hypnosédatifs
Livre de référence pour mieux comprendre et traiter l’insomnie chronique
Site d’information canadien vulgarisé sur l’insomnie et les options de traitement
tien du sommeil, avec un effet anxiolytique utile en contexte de détresse. On privilégiera les molécules à demi-vie intermédiaire sans métabolites actifs (lorazépam, oxazépam, témazépam). Toutefois, elles altèrent significativement l’architecture du sommeil (diminution du sommeil lent profond et paradoxal) et présentent un risque élevé d’effets indésirables : dépendance, chutes, troubles cognitifs, insomnie de rebond 25. Leur usage prolongé est associé à un risque accru de déclin cognitif et possiblement de démence, en lien avec la dose et la durée de traitement 28,29 .
La zopiclone est surtout utilisée pour l’initiation du sommeil, tandis que le zolpidem et l’eszopiclone sont efficaces à la fois
pour l’initiation et le maintien. Leur impact sur l’architecture du sommeil est moindre que celui des BZD, mais ils exposent à des effets secondaires notables : parasomnies (particulièrement avec le zolpidem), amnésie antérograde, somnolence résiduelle et troubles cognitifs, surtout chez les personnes âgées. Le risque de dépendance est inférieur à celui des BZD, mais demeure présent.
Autres médicaments à propriété sédative
Certains antihistaminiques (diphénhydramine), antidépresseurs (mirtazapine, trazodone, doxépine) et antipsychotiques à faible dose (quétiapine) sont utilisés hors indication. Leur action multirécepteurs (histaminique, muscarinique, α-1, sérotoninergique) entraîne des effets indésirables fréquents : somnolence diurne, prise de poids, effets anticholinergiques, hypotension 30 . L’effet anti-H1 peut aggraver un syndrome des jambes sans repos. Malgré son effet anxiolytique potentiel, la mirtazapine est souvent mal tolérée. L’efficacité modeste de la trazodone et de la quétiapine ne compense pas leurs risques. En raison d’un profil bénéfices/risques défavorable et d’un manque de données robustes, leur usage est déconseillé24. Seule la doxépine à très faible dose (1-6 mg) a démontré une efficacité prolongée avec un bon profil d’innocuité26
Antagonistes des récepteurs de l’orexine (DORA)
Les DORA (daridorexant, lemborexant, suvorexant) ciblent l’orexine, un neuromodulateur clé de l’éveil. Contrairement aux hypnosédatifs classiques, ils induisent le sommeil sans sédation immédiate ni altération majeure de l’architecture du sommeil. L’absence d’effet sédatif rapide peut surprendre certains patients. Leur profil pharmacologique suggère une bonne innocuité : faible impact cognitif, peu de dépendance, pas d’effet rebond, et efficacité démontrée jusqu’à 12 semaines27,31 Dans la pratique, toutefois, leur efficacité perçue varie. L’effet plus progressif, la fenêtre thérapeutique étroite et l’absence de sédation immédiate peuvent réduire la satisfaction initiale. Le daridorexant, à demi-vie plus courte, est souvent mieux
toléré au réveil, alors que le lemborexant, plus long, peut être utile en cas d’éveils nocturnes. Le profil idéal de répondeur reste à mieux définir27
Mélatonine
La mélatonine a un effet très modeste sur l’initiation et le maintien du sommeil32. Elle est utile surtout dans les troubles du rythme circadien (retard de phase, décalage horaire, travailleurs de nuit)33 ou en cas de sécrétion réduite (âge avancé, troubles neurologiques)34. Une dose de 0,5 à 1 mg, prise 1 à 2 heures avant le coucher, est généralement suffisante. Une prise trop tardive pourrait aggraver un retard de phase.
Déprescription
Avant d’amorcer un sevrage, il est essentiel d’avoir évalué les facteurs pouvant nuire à sa réussite : symptômes nocturnes persistants, mauvaises habitudes de sommeil, hyperéveil ou comorbidités non stabilisées. Ces éléments, abordés dans les sections précédentes, orientent les interventions à prioriser.
Le sevrage doit être progressif, individualisé et supervisé. Il gagne à être combiné à une approche non pharmacologique, en particulier la TCC-I, pour maximiser les chances de succès 35 . Le guide Bien dormir sans médicament propose un calendrier utile36. Il est préférable d’éviter de simplement remplacer un hypnosédatif par un autre. Toute réduction, même partielle, mérite d’être soulignée.
À retenir
n Les hypnosédatifs doivent être prescrits pour une durée limitée, avec un plan de déprescription individualisé. Leur efficacité est inférieure à celle de la TCC-I à moyen et long terme.
n Les médicaments hors indication ont un rapport bénéfices/risques souvent défavorable.
Thérapie cognitivo-comportementale de l’insomnie (TCC-I) et interventions comportementales
Recommandée en première intention5,37, la TCC-I combine des interventions comportementales (régulation circadienne, restriction du sommeil, contrôle des sti-
muli) à un travail cognitif sur les croyances. Des formats abrégés, comme le BBT-I, ont été conçus pour les soins de première ligne. Ces approches ciblent des stratégies simples, sans volet cognitif, et montrent une efficacité comparable à court terme38
Même sans offrir la TCC-I complète, plusieurs de ces interventions peuvent être amorcées dès la première consultation. Le journal du sommeil permet d’ajuster les recommandations aux données réelles du patient et favorise l’engagement. Un hypnosédatif peut être maintenu temporairement, à condition de prévoir une déprescription graduelle. Pour optimiser l’adhésion, il est conseillé de définir les consignes avec le patient, de les adapter progressivement, et d’assurer un suivi régulier, notamment pour ajuster la restriction du sommeil.
Le tableau 2 présente les principales ressources utiles pour soutenir les professionnels et les patients en soins de première ligne. Le nouveau guide produit par TCC Montréal est particulièrement bien conçu.
Cette stratégie consiste à limiter le temps passé au lit à la quantité réelle de sommeil, afin d’augmenter la pression de sommeil et améliorer sa continuité. Elle repose sur les données du journal du sommeil. Une fenêtre minimale de 6,5 heures est recommandée pour limiter les effets de privation lorsque le suivi est moins fréquent. Lorsque l’efficacité du sommeil atteint 90 % (temps dormi ÷ temps au lit), la fenêtre peut être élargie de 15 minutes par semaine39. Cette intervention est contre-indiquée en cas de trouble bipolaire, d’épilepsie ou de professions nécessitant une vigilance constante.
Contrôle des stimuli
Cette technique vise à réassocier le lit au sommeil en rompant le conditionnement négatif. Le lit doit être réservé au sommeil (et aux relations sexuelles) et le patient doit se lever après environ 20 minutes sans endormissement40. Il est utile de planifier à l’avance des activités calmes et un lieu confortable hors du lit. Le lever à heure fixe et l’exposition à la lumière naturelle dès le matin renforcent l’effet. Éviter la lecture ou les écrans au lit en soirée favorise également l’endormissement.
Méditation, relaxation et respiration
Chez les patients souffrant d’hyperéveil, la relaxation, la respiration lente et la pleine conscience facilitent le passage vers un état parasympathique propice au sommeil7. La méditation améliore le contrôle des pensées envahissantes, et la cohérence cardiaque, pratiquée quotidiennement, soutient la régulation autonome. Ces approches sont aussi utiles en cas d’anxiété, de fibromyalgie ou de douleurs chroniques.
Restructuration cognitive
Certaines croyances, comme « je dois dormir huit heures » ou « je ne peux dormir sans somnifère », entretiennent l’insomnie. Le questionnaire CAS-16 en identifie les principaux thèmes. Une restructuration formelle est parfois nécessaire41, mais les interventions comportementales et l’éducation suffisent souvent à faire évoluer ces croyances.
Éducation sur le sommeil
Comprendre les mécanismes du sommeil aide à ajuster les attentes, à normaliser les éveils nocturnes, et à identifier les comportements nuisibles (siestes prolongées, horaires irréguliers, anticipation anxieuse)42 L’éducation soutient grandement l’adhésion aux stratégies proposées.
Conclusion
L’insomnie chronique est un trouble multifactoriel qui exige une évaluation rigoureuse et une prise en charge individualisée. Les stratégies comportementales peuvent être amorcées dès la première rencontre, même sans accès direct à une TCC-I complète. Leur intégration est essentielle, surtout en contexte de déprescription. Grâce à des outils pratiques et à une meilleure collaboration interprofessionnelle, la première ligne est bien placée pour offrir un traitement efficace, durable et centré sur le patient. n
Une version complète de l’article, incluant un exercice de réflexion et les références, est disponible en scannant le code QR avec votre appareil mobile.
CHRISTOPHE AUGÉ, PHARMACIEN, M. SC., PH. D., FOPQ
RÉVISION SCIENTIFIQUE
LU-ANN MURDOCH, RPH, BSCPHM, ACPR
BIOGEN CANADA INC.
Solution injectable de tofersen à 100 mg/15 mL (6,7 mg/mL), pour utilisation intrathécale
Indication
Pour le traitement des adultes atteints de sclérose latérale amyotrophique (SLA) associée à une mutation du gène de la superoxyde dismutase 1 (SOD1). Bénéficie d’une autorisation de mise en marché avec conditions.
Mécanismes
Les patients atteints de SLA-SOD1 présentent des mutations dans le gène SOD1. Cette mutation entraîne l’accumulation d’une forme toxique de la protéine SOD1, ce qui provoque des lésions axonales et une neurodégénérescence. Il en résulte une faiblesse musculaire, des difficultés à se mouvoir, à respirer et à avaler. Le tofersen est un oligonucléotide antisens qui réduit la synthèse de la protéine SOD1. Cela peut réduire la perte de cellules nerveuses et ralentir la perte de force et de fonction musculaires.
La dose recommandée est de 100 mg (15 mL), le traitement doit être débuté avec trois doses de charge administrées à des intervalles de 14 jours (Jour 0, Jour 14, Jour 28). Une dose d’entretien doit être administrée tous les 28 jours par la suite (Jour 56, Jour 84, etc.).
Note
La SLA-SOD1 est une forme génétique rare de la SLA, qui touche environ 2 % des personnes atteintes de cette maladie. Le tofersen est la première thérapie qui cible la cause profonde de la maladie.
Suspension de microbiote fécal vivant. 150 mL [1 × 108 à 5 × 1010 unités formant colonies (UFC)/mL] pour administration par voie rectale
Indication
Pour prévenir la récurrence de l’infection à Clostridioides difficile (ICD) (anciennement Clostridium difficile) chez les adultes suivant un traitement antibiotique pour une ICD récurrente. N.B. : N’est pas indiqué pour le traitement de l’ICD.
Mécanismes
Le mode d’action exact n’a pas été établi.
Posologie
Administrer une dose de 150 mL de suspension par voie rectale de 24 à 72 heures après la dernière dose des antibiotiques pour l’infection à Clostridioides difficile (ICD). Ne pas administrer pendant l’antibiothérapie pour l’ICD. Les patients ne doivent pas prendre d’antibiothérapie orale jusqu’à huit semaines après l’administration, sauf avis contraire.
BIOGEN CANADA INC.
Capsules d’omavéloxolone à 50 mg par voie orale
Indication
Pour le traitement de l’ataxie de Friedreich chez les patients âgés de 16 ans et plus.
Mécanismes
Le mécanisme précis est inconnu. Dans des études précliniques, il a été démontré que l’omavéloxolone active le facteur nucléaire (dérivé des érythroïdes 2) de type 2 (Nrf2) in vitro, qui est impliqué dans la réponse cellulaire au stress oxydatif, et peut jouer un rôle dans la restauration de la fonction mitochondriale.
Posologie
La dose recommandée est de 150 mg (3 capsules de 50 mg chacune) par voie orale une fois par jour.
PFIZER CANADA SRI
Capsules de talazoparib à 0,1 mg, 0,25 mg, 0,35 mg, 0,5 mg et 1 mg, pour administration orale
Indication
En association avec l’enzalutamide pour le traitement des adultes atteints d’un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration et porteurs d’une mutation d’un gène de réparation par recombinaison homologue (RRH).
Mécanismes
Inhibe les enzymes poly(adénosine diphosphate ribose) polymérase (PARP), ce qui entraîne une diminution de la prolifération des cellules cancéreuses et une augmentation de leur mort.
Posologie
La dose recommandée est de 0,5 mg, une fois par jour par voie orale, en association avec l’enzalutamide à 160 mg, une fois par jour par voie orale, jusqu’à la progression de la maladie, à moins d’effets toxiques inacceptables. Les autres doses offertes permettent des ajustements. Les patients qui reçoivent Talzenna en association avec l’enzalutamide doivent également recevoir un agoniste de la gonadolibérine (GnRH), à moins d’avoir subi une orchidectomie bilatérale.
Note
Il est également indiqué dans le traitement du cancer du sein localement avancé ou métastatique, mais Pfizer ne commercialisera pas le médicament pour cette indication.
Dans le numéro précédent, il aurait dû être indiqué que CresembaMD est fabriqué par Avir Pharma. Nos excuses.
ASTRAZENECA CANADA INC.
Concentré en solution pour perfusion de durvalumab à 50 mg/mL
Nouvelles indications
1) Pour le traitement de première intention des patients adultes atteints d’un CPNPC métastatique ne présentant aucune mutation sensibilisante du gène EGFR (récepteur du facteur de croissance épidermique) ni aberration génomique tumorale du gène ALK (kinase du lymphome anaplasique) en association avec le trémélimumab et une chimiothérapie à base de sels de platine;
2) Pour le traitement, en monothérapie, des patients adultes atteints d’un cancer du poumon à petites cellules de stade limité (CPPC-SL), dont la maladie n’a pas progressé après une chimioradiothérapie (CRT) à base de sels de platine.
Posologie
Consulter la monographie du produit pour connaître la posologie. Administré en perfusion intraveineuse pendant 60 minutes.
SANOFI-AVENTIS CANADA INC.
Solution à diluer pour perfusion intraveineuse d’ixatuximab à 20 mg/ mL
Nouvelle indication
Traitement du myélome multiple nouvellement diagnostiqué chez les patients qui ne sont pas admissibles pour une autogreffe de cellules souches (ASCT), en association avec le bortézomib, le lénalidomide et la dexaméthasone. (Également approuvé précédemment pour le traitement du myélome multiple récidivant et réfractaire.)
Posologie
10 mg/kg administré par perfusion intraveineuse, en association avec le bortézomib, le lénalidomide et la dexaméthasone; consulter la monographie du produit pour plus de détails.
ALK-ABELLÓ
Comprimé sublingual, 12 SQ-Bet : extrait d’allergène standardisé, bouleau blanc (Betula Verrucosa)
Extension d’indication
Désormais indiqué comme immunothérapie allergique pour le traitement de la rhinite allergique saisonnière modérée à sévère, avec ou sans conjonctivite, induite par le pollen de bouleau, d’aulne, de noisetier ou de chêne, chez les personnes âgées de 5 à 65 ans. Destiné aux personnes présentant des antécédents cliniques de symptômes de rhinite allergique, malgré l’utilisation de médicaments soulageant les symptômes, et un test positif de sensibilisation à un ou plusieurs pollens de bouleau, d’aulne, de noisetier ou de chêne (prick-test cutané ou IgE spécifiques) (le chêne a été ajouté à la liste des allergènes et le produit a été approuvé antérieurement pour une utilisation chez les adultes uniquement).
Posologie
La dose recommandée est d’un comprimé sublingual (12 SQ-Bet) par jour.
GLAXOSMITHKLINE INC.
Solution pour perfusion intraveineuse de dostarlimab à 50 mg/mL, flacon de 10 mL
Nouvelle indication
En association avec le carboplatine et le paclitaxel pour le traitement des patientes adultes atteintes d’un cancer de l’endomètre primitif à un stade avancé ou présentant une première récidive du cancer de l’endomètre primitif qui sont candidates à un traitement à action générale.
Posologie
La dose recommandée est de 500 mg administrés en perfusion intraveineuse de 30 minutes toutes les 3 semaines pendant 6 doses, suivis de 1000 mg toutes les 6 semaines pendant tous les cycles suivants. Consulter la monographie du produit pour plus de détails.
Inhibiteurs des kinases cyclines-dépendantes (abémaciclib, palbociclib et ribociclib) et inhibiteurs de l’HMGCoA réductase (atorvastatine, fluvastatine, lovastatine, pravastatine, rosuvastatine et simvastatine) (statines)
Résumé de l’examen de l’innocuité –Évaluation du risque potentiel de rhabdomyolyse due à une interaction médicamenteuse
Santé Canada a examiné le risque potentiel de rhabdomyolyse ainsi que l’interaction médicamenteuse entre les IKCD et les statines. L’examen de l’innocuité a été entrepris à la suite d’une enquête menée par l’Agence européenne des médicaments (EMA) sur le risque lié au palbociclib et aux statines.
Cet examen a permis d’établir un lien possible entre le risque de rhabdomyolyse et l’interaction médicamenteuse entre les IKCD et les statines.
Santé Canada collaborera avec les fabricants pour mettre à jour les renseignements sur l’innocuité du produit dans la monographie de produit canadienne (MPC) pour tous les IKCD afin d’y inclure le risque de rhabdomyolyse due à une interaction médicamenteuse avec des statines.

Face à des patients nerveux, à un collègue un peu trop lent ou à un gestionnaire obsédé par le respect du budget, il peut être difficile de garder son calme, même dans un contexte professionnel. Pourtant, la colère au travail n’a pas que des défauts; elle peut servir à faire avancer les choses, pour peu qu’on sache la reconnaître et l’exprimer de la meilleure façon.
ANAÏS BOUITCHA
Dans le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre et de demande accrue de la part de la population, les professionnels de la santé sont d’autant plus vulnérables face aux émotions fortes au travail, observe d’entrée François Courcy, psychologue et professeur à l’Université de Sherbrooke.
« Ce sont des gens compétents et méticuleux, qui ont un très haut niveau d’engagement envers leurs patients, mais aussi sous pression et stressés. » Ajoutez à cela des situations familiales parfois exigeantes, une pandémie mondiale pendant laquelle les personnels soignants n’ont pas pu se réfugier dans le télétravail, et un certain nombre de dossiers ramenés à la maison…
« C’est un excellent cocktail pour vivre de la colère, de la frustration, du ressentiment ou du désarroi en contexte de travail », ajoute l’expert.
Sauf que ces émotions intenses n’ont, selon lui, pas leur place ou leur voie de sortie dans un contexte de soins. Paradoxalement, des métiers aussi humains que ceux de la santé laissent souvent peu de place aux émotions de ceux et celles qui les exercent. « L’émotion devrait pourtant servir de baromètre pour évaluer notre milieu de travail », souligne Nirvishi Jawaheer, pharmacienne propriétaire et coach certifiée. « Par exemple, la colère indique qu’une limite a été franchie. » Même si certaines personnes y sont davantage perméables que d’autres, note-t-elle.
Ces limites peuvent être franchies de différentes façons et par différentes personnes : patients, collègues, supérieurs, voire le système de santé lui-même. Et,
selon vers qui est tournée cette colère, les solutions pour l’appréhender et en tirer le meilleur parti sont différentes. « On va davantage se permettre d’être désagréable avec des collègues, car ce sont des professionnels au même niveau que soi, souligne François Courcy. On va être moins tolérant aux erreurs et avoir plus d’attentes qu’envers un patient en souffrance qui va difficilement exprimer son besoin. »
Et comme la colère n’a pas sa place dans le cadre professionnel, elle va très peu s’exprimer, poursuit l’expert. « Il y a un souci de l’autre, de la qualité des soins, et les professionnels de la santé vont veiller à ne pas ajouter de la peine à la charge de leurs patients ou de leur équipe. » En résulte une série de micro-comportements qui vont trahir cette colère : impatience, réactions exaspérées, expressions faciales, rythme de travail ralenti. « Or, une mauvaise ambiance de soins va avoir un impact sur le ressenti des patients », ajoute le psychologue.
Surtout, une colère non exprimée et non résolue va durer dans le temps, affectant la capacité de la personne à travailler et à interagir calmement, et s’immisçant aussi dans sa vie personnelle s’il s’agit d’une colère latente. « Certaines personnes vont tourner la colère vers leurs proches ou vers eux-mêmes, en adoptant des conduites à risque, qu’il s’agisse de la pratique excessive d’un sport à la consommation de substances », explique le psychologue. Si elle internalise cette colère, la personne peut en souffrir sur le plan relationnel, avec une difficulté à s’exprimer, ou sur le plan physique avec une altération de sa santé.
Heureusement, plusieurs solutions existent pour apprendre à gérer cette colère en contexte professionnel.
Reconnaître son état émotionnel
Tout d’abord, François Courcy et Nirvishi Jawaheer rappellent que la colère est une émotion naturelle et légitime, sur laquelle on n’a pas forcément de prise si l’on n’a pas une grande conscience de soi. « La colère active notre système nerveux sympathique, et on n’arrive pas toujours à prendre le dessus, affirme ainsi la pharmacienne et coach. Mais on peut prendre conscience de ce qui se passe en nous, qu’on est en train de ruminer par exemple. »
S’il s’agit de la colère d’un ou une collègue, il faut lui apporter son soutien. La simple question « Comment te sens-tu ? » lui permettra d’abord de se reconnecter à son propre état émotionnel. Mais attention, soutenir ne signifie pas acquiescer, rappelle François Courcy. « Quand un collègue a besoin de valider, on a tendance à valider sa perception, à lui donner raison. C’est une erreur, puisqu’on va continuer sur cette lancée de colère et de frustration. Au contraire, il faudrait lui demander ce qu’il ou elle compte faire avec cette émotion-là. Ce n’est pas ce qu’il ou elle voudra entendre, mais c’est ce qui va l’aider. »
Désamorcer la colère au lieu de la contenir
« Il faut trouver une façon constructive d’exprimer sa colère, pour ne pas la déplacer, la retarder ou la proscrire », conseille François Courcy. Si cette colère est tournée vers un patient, il s’agit de tenir compte de
ses limitations psychologiques, cognitives, émotionnelles et physiques, prévient le psychologue. « Ensuite, on peut formuler des demandes à ce patient. Au lieu de dire : “Vous me retardez”, dire plutôt : “La prochaine fois, pourriez-vous amener votre liste de médicaments s’il vous plaît ? Cela m’aiderait beaucoup.” » Alors que la plupart des professionnels de la santé sont d’ordinaire accommodants avec les patients, il faut ici les mettre à contribution selon lui. « S’ils sont en capacité de le faire, ils le feront. » Dans tous les cas, mieux vaut prendre le temps de s’apaiser avant de délivrer son message.
Cela peut toutefois se révéler plus délicat avec un supérieur hiérarchique… François Courcy préconise là encore de passer par la case des questions. « Si un gestionnaire vient nous demander de faire une tâche et qu’on est déjà submergé de travail, on peut le sensibiliser en lui disant : “j’aimerais que tu m’aides à prioriser, car j’ai déjà beaucoup à faire, y a-t-il une tâche qu’on peut retarder ?” » S’il faut répondre à une urgence immédiate, la liste des tâches devrait pouvoir être réorganisée en cohérence avec les priorités perçues du gestionnaire, affirme le psychologue.
Prévenir au lieu de subir
Il est aussi possible de prévenir une colère récurrente si on sait détecter son déclencheur, ajoute Nirvishi Jawaheer. « Si une

« [LORSQUE LA COLÈRE EST RÉCURRENTE], IL FAUT AGIR. ON NE PEUT PAS RESTER DANS UNE ZONE DE PRÉOCCUPATION. »
François Courcy, psychologue et professeur

patiente particulièrement agressive ou désagréable entre dans la pharmacie, on peut se demander si un collègue saura la gérer mieux que moi. On peut aussi aller s’aérer, ou éloigner la personne en colère du reste du groupe pour éviter la contagion émotionnelle », propose-t-elle. Il est aussi important de savoir reconnaître ses torts, mais de ne pas prendre tout le blâme sur soi lorsqu’une autre personne est en cause, observe la pharmacienne.
De la même manière, les gestionnaires devraient bien connaître les gens avec lesquels ils travaillent, ainsi que leurs tempéraments, pour pouvoir anticiper les émotions fortes. Mais aussi instaurer un climat de travail ouvert à la discussion et au partage des émotions, et proposer des ressources de soutien à leurs employés, soulignent les deux experts.
Activer le mode solution
Comme pour l’organisation du travail, transformer sa colère en action requiert un plan de match réfléchi au préalable, indique François Courcy. Pourquoi suis-je en colère ? Que puis-je faire pour changer cela ? « On a tendance à minimiser l’impact de cette émotion, et de ne pas prendre le temps de l’analyser. Mais lorsque c’est récurrent, il faut agir. On ne peut pas rester dans une zone de préoccupation. » Cela peut ainsi prendre la forme d’une rétroaction à la personne concernée, qu’il

« L’ÉMOTION DEVRAIT SERVIR DE BAROMÈTRE POUR ÉVALUER NOTRE MILIEU DE TRAVAIL. PAR EXEMPLE, LA COLÈRE INDIQUE QU’UNE LIMITE A ÉTÉ FRANCHIE. »
Nirvishi Jawaheer, pharmacienne propriétaire et coach certifiée
s’agisse d’un collègue ou d’un supérieur immédiat. « On peut commencer par dire : “voici comment je me sens après ce qui s’est passé” et arriver avec des solutions au problème. » Selon lui, les gestionnaires peuvent parfois arriver à saturation à force d’entendre les frustrations de leurs employés. Mais si l’un d’eux arrive avec des solutions à mettre en place, un dialogue constructif pourra s’amorcer.
La colère comme moteur
Contrairement à ce qu’on pourrait croire, toute colère n’est pas forcément négative, souligne François Courcy. « La colère, c’est de l’énergie, et elle peut permettre de construire autre chose. » Encore faut-il la canaliser vers quelque chose de positif, une fois qu’on l’a reconnue et apaisée. Cela peut signifier apprendre à poser des limites à certaines personnes, en passant par la voie de la sensibilisation et de l’éducation.
Mais que faire si on ressent de la colère vis-à-vis non pas d’une personne, mais du système tout entier ? Là encore, il s’agit de réfléchir à nos possibilités d’action. « Une fois que ma colère a été exprimée et peutêtre entendue, je peux me demander si je veux avoir une contribution sociale plus importante. » n
CONTRIBUTION STRATÉGIQUE UNIQUE
Dans un environnement professionnel en perpétuelle évolution, marqué par une compétition accrue et une accélération des transformations, il devient impératif pour chaque acteur de bien comprendre et de bien définir ce qu’il apporte d’unique.
LINE BLACKBURN, M. SC., CRHA, COACH PCC, RACHEL FOURNIER, M. SC., CRHA, COACH PCC, EN COLLABORATION AVEC LYNE BEAUSOLEIL, M. SC., CRHA, COACH PCC
Cette contribution stratégique unique (CSU) désigne la valeur ajoutée distinctive, c’est-à-dire le plus haut niveau de contribution qu’une personne peut offrir, en tenant compte des besoins de ses équipes et des objectifs de l’organisation. Dans le secteur de la santé et des services sociaux, en pleine mutation avec la création de Santé Québec, cette réflexion est plus que jamais essentielle, puisque les règles de fonctionnement sont appelées à changer.
Dans ce contexte, les médecins, les professionnels et leurs collaborateurs doivent s’interroger : quel leadership incarner ? Quels talents mobiliser dans mon équipe ? Comment générer des résultats positifs et durables ? Cet article propose une réflexion approfondie sur la CSU, sur son appropriation et sur son application concrète, inspiré du livre de Cloé Caron1.
Premièrement, pour identifier sa CSU, la démarche commence par une introspection sincère. Peu importe sa fonction ou son niveau hiérarchique, chaque acteur sait précisément quelle est sa contribution unique et comprend ce qu’il apporte réellement à ses équipes et à son organisation. Ce processus d’introspection demande de cultiver un esprit de développement continu, ce qui nécessite un regard honnête sur soi, en validation constante avec son milieu. Il ne s’agit pas de viser la perfection, mais de cultiver une ouverture à soi-même et aux autres. Ainsi, chaque acteur développe une capacité à s’adapter face aux défis, en relativisant les sources de stress et en adoptant une perspective plus sereine de développement et de résilience.
Deuxièmement, la CSU nécessite le développement d’une agilité mentale : la capacité de repenser ses actions, de réinventer ses façons de faire et d’apprendre continuellement. Le défi majeur réside également dans l’équilibre : rester suffisamment connecté aux réalités opérationnelles, tout en consacrant son énergie à des responsabilités à valeur ajoutée; activités que personne d’autre ne peut réaliser.
Troisièmement, incarner sa CSU, c’est aussi comprendre que l’on ne peut pas tout faire soi-même. La délégation devient donc un acte stratégique, indispensable pour préserver son énergie, maximiser son impact, optimiser son efficacité personnelle et favoriser l’engagement de ses collaborateurs. Pour déléguer, il faut choisir le bon collaborateur, établir des objectifs mesurables, lui offrir du soutien et, surtout, dans le cours de l’exécution, assurer un suivi méthodique. Finalement, il importe de mesurer les résultats et les impacts sur une base continue.
En résumé, la CSU consiste précisément à concentrer son attention et ses ressources limitées en temps et en énergie sur ce qui compte vraiment, sur les leviers où son influence peut être porteuse et bénéfique pour l’ensemble des parties prenantes. Il s’agit de choisir délibérément où diriger son énergie pour exercer l’influence souhaitée, en favorisant l’agilité, la responsabilisation, l’innovation de ses équipes, tout en demeurant aligné sur les priorités de son organisation.
Une démarche en deux temps : évaluer et projeter
Pour cheminer vers sa CSU, il est utile de structurer sa réflexion en deux temps : éva-
« CHOISIR
SIGNIFIE CULTIVER LE COURAGE D’ÊTRE IMPARFAIT, DE FIXER DES LIMITES ET DE PERMETTRE À NOTRE VULNÉRABILITÉ D’EXISTER. »
Brené Brown, chercheuse en sciences humaines et sociales, dans son livre audio The Power of Vulnerability: Teachings of Authenticity, Connections and Courage (2012)
luer honnêtement la situation actuelle et se projeter vers la situation désirée. En répondant à ces questions, chacun peut tracer une feuille de route claire pour maximiser sa contribution stratégique unique et son impact, en cohérence avec ses valeurs, ses ambitions et les priorités de l’organisation.
1. Faire le point sur sa situation actuelle : les constats
n Quels sont les éléments de mon travail sur lesquels je concentre mon attention ?
n Quelles fonctions absorbent la majeure partie de mon énergie ?
n Quelles sont les trois principales zones de responsabilités dans mon rôle actuel ?
n Quelle est ma gestion du temps en fonction des priorités déjà établies ?
n Qu’est-ce qui justifie l’importance stratégique de ces activités ?
n Quel est mon niveau d’impact et d’influence ?
2. Se projeter vers la situation souhaitée : conserver l’équilibre et mon attention sur l’essentiel
n Quels sont les éléments sur lesquels je devrais diriger prioritairement mon attention ?
n Quelles tâches pourrais-je déléguer pour mieux me concentrer sur ma CSU ?
n Comment faire pour maintenir mon attention sur ma CSU ?
« LES MANAGERS
SAVENT CE QU’ILS
DOIVENT FAIRE ET LES LEADERS SAVENT CE QU’IL FAUT FAIRE. »
Warren Bennis, expert en leadership et coauteur du livre Leaders: Strategies for Taking Charge (1985)
n Comment puis-je soutenir mon énergie et mon équilibre au quotidien ?
n Quelle posture relationnelle devrais-je adopter envers mes collaborateurs ?
Finalement, la notion de contribution stratégique unique constitue un levier puissant afin de s’affirmer et de réussir dans un environnement professionnel en mouvance. En cultivant la connaissance de soi tout en faisant preuve d’agilité mentale ainsi qu’en maîtrisant l’art de la délégation, chaque professionnel peut réussir à maximiser son impact sur son équipe et dans son organisation, grâce à son plus haut niveau de contribution stratégique. En outre, cette démarche invite à passer de l’introspection à l’action, pour devenir un acteur clé du changement dans son milieu. En identifiant et en incarnant sa CSU, chaque acteur devient non seulement plus performant, mais aussi plus aligné, plus influent et plus épanoui au sein de l’organisation.
Votre CSU correspond à une signature professionnelle, faites-la briller ! n
La diffusion de ce texte est rendue possible grâce à un partenariat entre Profession Santé et Médecins francophones du Canada
Pharmacien(ne) à temps plein et/ou partiel
Pharmacie Isabelle Gingras inc., pharmacie Uniprix située à St-Hyacinthe, Lun au Vend 9h-19h00, Sam 9h-17h Dim 10h-17h00, salaire à discuter
Besoin d’un nouveau défi ? Mûre pour un changement ?
Rejoignez notre équipe et exercez votre profession dans un milieu bienveillant et convivial. Nous recherchons un pharmacien temps plein et/ou partiel pour compléter notre équipe de pharmaciens. Nous désirons un candidat motivé à participer aux développements des services professionnels ainsi qu’à établir un contact privilégié avec nos patients.
courriel isabell-g@hotmail.com – téléphone (514) 835-0799


Joignez-vous à notre équipe ! MÉDECIN DE FAMILLE
Située au cœur des Basses-Laurentides, la clinique médicale privée Santé Rosemère, établie depuis plus de 30 ans, offre un grand éventail de services médicaux où vos talents seront mis à profit.
Consultation médicale sur rendez-vous seulement
Horaire de jour, du lundi au vendredi
13 employés à votre service
DMÉ performant (Myle)
Équipe de 5 médecins sur place
Équipe de 4 infirmières sur place
Pour tous renseignements, contacter Sonia Lemay 450 621-1292, poste 215 sonia.lemay@santerosemere.com 400, Grande-Côte, Rosemère santerosemere.com
Chaudière-Appalaches, St-Georges
Lanaudière, Mascouche
Lanaudière, Terrebonne
Lanaudière, Terrebonne
Laurentides, Mont-Laurier
Mauricie, Trois-Rivières
Montérégie, Granby
Montérégie, L’Île-Perrot
Montérégie, Longueuil
Montérégie, Sorel-Tracy
Montérégie, Sorel-Tracy
Montérégie, St-Bruno-de-Montarville
Montréal, Centre-ville
Montréal, Lachine
Montréal, Outremont/Mile End
Outaouais, Buckingham
Québec, Ancienne-Lorette
Québec, Cap Rouge
Québec, Quartier Montcalm
Québec, Quartier St-Sauveur
Daniel Lavoie
dalavoie@pjc.jeancoutu.com
Marc Leclerc mleclerc@pjc.jeancoutu.com
François Otis fotis@pjc.jeancoutu.com
Anne-Marie Coté amcote@pjc.jeancoutu.com
Julie Forget jforget9@pjc.jeancoutu.com
Eric Benoît ebenoit@pjc.jeancoutu.com
Maxime Daoust-Charest mdaoust@pjc.jeancoutu.com
Jonathan Carrier jcarrier3@pjc.jeancoutu.com
Trisan Giguère tgiguere@pjc.jeancoutu.com
Julie Pelletier jpelletier@pjc.jeancoutu.com
Sylvain Roy-Boisselle sroy2@pjc.jeancoutu.com
Catherine Archambault carchamba2@pjc.jeancoutu.com
Odile Terzibachi oterzibach@pjc.jeancoutu.com
Aboud Georges ageorges@pjc.jeancoutu.com
Tro Pascal Cotchikian trocotchikian@me.com
Roch Valiquette rvaliquette@pjc.jeancoutu.com
Pierre-Olivier Sirois posirois@pjc.jeancoutu.com
Caroline Trudel ctrudel@pjc.jeancoutu.com
Philippe Nadeau pnadeau@pjc.jeancoutu.com
Christine Paquet cpaquet@pjc.jeancoutu.com
514-577-8137 X
514-825-7224 X
450-585-4105 X
819-623-2296 X X
819-370-6022 X X
450-522-3259 X X
514-453-2896 X X
514-813-3990 X X
450-742-3783 X X
450-746-7840 X X
450-653-1528 X X
514-963-9350 X X
514-634-7231 X X
514-895-3423 X X
819-360-4369 X X
418-872-2864 X
418-658-1445 X X
418-522-1235 X X
418-525-4981 X X
Parce que mieux soigner est au cœur de notre mission, nous offrons une pratique professionnelle enrichissante assortie de ressources et de reconnaissances spécialement adressées aux professionnels. Pour plus de détails sur la profession de pharmacien·ne chez Jean Coutu, consultez le emploi.jeancoutu.com Les pharmacien•ne•s propriétaires affilié•e•s à

Marie-Claude Demers
Notre pharmacie, située dans le quartier Rosemont, est à la recherche d’un(e) pharmacien (ne) passionnée(e) pour rejoindre une équipe dynamique et soudée. Rosemont est un secteur en pleine évolution, avec une clientèle variée et engagée. C’est l’endroit idéal pour pratiquer dans un environnement stimulant, humain et chaleureux.
Ce que nous offrons :
Une ambiance de travail collaborative et bienveillante
Une équipe stable et expérimentée
Une clientèle fidèle et diversifié
Une gestion à l’écoute et des horaires flexibles
L’opportunité de contribuer activement à la santé de la communauté
Pratique clinique en constante évolution
Périodes de clinique en bureau à chaque semaine (pour vos notes, interventions, etc)
Dispills en CPO
DVCC chaine et piluliers
Référence en Télépharmacie Jean Coutu pour les conseils téléphoniques.
Infirmière 2 jours/semaine
4770 rue St-Félix
St-Augustin de Desmaures G3A-0K9
Possibilité Accessa, si tu as envie de développer les médicaments de spécialité
Horaires : fin de semaine/4 1 soir par semaine vendredi soir en rotation
Heures d ouverture 9-21h en semaine, 9-20h fins de semaine
Avantages: cotisation OPQ assurances formation
Bonus pour prise en charge d étudiants en pharmacie, etc
Partage d'honoraires pour loi 41

Personne à contacter : Samar Mouré, samar.moure@gmail.com
Nous croyons à l’importance du travail d’équipe, au respect et à l’épanouissement professionnel Si tu veux évoluer dans un cadre où ton expertise est reconnue et valorisée, on aimerait te rencontrer
�� Emplacement : Rosemont -Montréal

880 Avenue Painchaud Québec G1S 0A3
DIRECTION GÉNÉRALE
Mme Nathalie Côté nathalie.cote@cotejardins.ca marie-claude.abran@cotejardins.ca T 418-688-1221 / F 418-688-0105
L’un situé au cœur de Québec et l’autre aux abords du fleuve à St-Augustin de Desmaures, les CHSLD Côté Jardins (281 lits) et les Jardins du Haut St-Laurent (207 lits) sont 2 milieux de vie chaleureux et sécuritaires où vous côtoierez des équipes de travail dynamiques, axées sur la compétence, le dévouement et la compassion.
Que ce soit pour un hébergement transitoire ou permanent, les CHSLD accueillent une clientèle variée provenant principalement des CH afin d’y recevoir des soins actifs allant jusqu’aux soins de fin de vie. Afin d’optimiser la prise en charge des résidents, vous pourrez compter sur le soutien de nombreux autres professionnels tels que : pharmaciens, infirmières, conseillères en soins, ergothérapeute, nutritionniste, travailleurs sociaux, techniciens en éducation spécialisée et techniciens en réadaptation physique.
• Autonomie de votre horaire
Joignez-vous à l’équipe médicale et bénéficiez de :
• Présence infirmière 24 hrs/24, 7 jrs/7
• Admissibilité aux AMP
Côté-Jardins_202506-07.indd 1
• Partage de la garde en disponibilité
• Respect de votre mode de rémunération
• Espace de travail réservé aux médecins
• Facturation garde FDS par établissement
• Excellentes conditions de travail
• Stationnement gratuit
Joignez-vous à une équipe passionnée et passionnante
2025-06-09 13:55

Dans une lettre adressée récemment à un pharmacien, le syndic l’exhortait à la prudence, lui rappelant : « Vous demeurez pharmacien en tout temps et en tout lieu. »
Sans marquer la surprise sur cette expression, je me suis interrogé à savoir sur quelles bases légales l’énoncé se voulait véridique…
PAUL FERNET, AVOCAT, LJT AVOCATS
En effet, on s’accorde généralement sur le fait qu’à l’extérieur de la pharmacie, le syndic et même l’Ordre des pharmaciens du Québec n’a pas compétence. Pourtant, l’Ordre, dans son « Guide sur les aspects déontologiques de l’utilisation des médias sociaux », recourt à nouveau à cette expression : « Vous êtes un pharmacien en tout lieu et en tout temps ! »
On y précise que du point de vue de vos obligations déontologiques, « votre vie personnelle et votre vie professionnelle sont difficilement dissociables ».
Au risque de susciter quelques angoisses, l’affirmation dans son sens large (et poétique !) est rigoureusement vraie. Mais rassurez-vous, elle n’est pas sans limites. En effet, toute la question est de savoir si le péché commis est suffisamment en lien avec l’exercice de la profession, comme nous le rappelle par exemple l’article 12 du Code de déontologie, moins fréquemment cité :
12. Le pharmacien doit s’assurer qu’aucune des activités qu’il exerce dans le cadre d’une fonction ou d’une entreprise, et qui ne constituent pas l’exercice de la pharmacie, ne compromette le respect de ses obligations déontologiques, notamment celle de préserver l’honneur, la dignité et l’intégrité de la profession.
Encore ici, vous me direz : « Mais comment mesure-t-on l’honneur et la dignité ? Où s’évalue l’intégrité de la profession ??? » Ces questions sont certainement en tête de liste des interrogations adressées à leur avocat par les pharmaciens. Mais en ce qui
concerne les infractions déontologiques pouvant être commises dans la sphère de votre vie privée, voyons ce qu’en dit la jurisprudence.
La Cour d’appel, dans une décision de 20061 reprenant la jurisprudence classique en la matière, résume le concept comme suit :
« La faute disciplinaire professionnelle est liée à l’exercice de la profession. Lorsque ce lien existe, il peut même arriver que la faute inclue “des actes de sa vie privée dans la mesure ou ceux- ci sont suffisamment liés à l’exercice de la profession et causent un scandale [portant] atteinte à la dignité” de celle - ci. » (Références omises)
Il faut donc que le comportement reproché soit en lien, ait une connexité avec la profession du membre déviant. On comprendra mieux le principe en prenant connaissance des motifs rendus par le Tribunal des professions dans l’affaire Lessard c. Barreau, datant de 19992
Dans cette affaire, l’avocat avait participé à l’organisation des Grands Frères et s’était vu présenter un enfant sur lequel il avait commis des actes sexuels. Il avait été reconnu coupable au criminel et le Barreau souhaitait le sanctionner en vertu de la Loi sur le Barreau et du Code des professions :
« Il appert au Tribunal que l’infraction criminelle de l’appelant n’a aucun lien avec l’exercice de la profession d’avocat et que le Comité ne pouvait, en conséquence, prendre la mesure qu’il a prise. Le geste hautement répréhensible
auquel l’appelant a plaidé coupable devant le juge de la chambre criminelle de la Cour du Québec n’a pas de lien avec l’exercice de sa profession d’avocat, car la jeune victime n’était pas un client de l’avocat, ni lié à un client, ni lié à un employé ou n’était lié d’aucune façon à l’exercice de la profession d’avocat. De plus, ces malheureux incidents font partie du domaine de la vie privée de l’appelant et n’ont eu aucun lien lors de leur survenance avec le fait que l’appelant était un avocat. Enfin, le fait que Pierre Lessard était un avocat n’a rien eu à faire avec le fait qu’il devienne membre de l’organisation des Grands Frères. PROCÉDANT à rendre la décision qui aurait dû être rendue, le Tribunal constate l’absence de lien entre l’infraction criminelle à laquelle l’appelant a plaidé coupable et l’exercice de sa profession; »
Cela étant, mentionnons tout de même que la jurisprudence n’est pas avare de tisser des liens entre les comportements déviants et la commission d’infractions déontologiques en invoquant le concept de « l’honneur et la dignité de la profession ». Mais le concept est loin d’être sans limites ! À l’instar de Pierre Elliott Trudeau qui affirmait que « l’État n’a rien à faire dans les chambres à coucher de la nation », concluons en affirmant que l’expression « pharmacien en tout temps et en tout lieu » mériterait sans doute d’être nuancée lorsque le comportement déviant n’a rien à voir avec l’exercice de la profession ! n
1. Tremblay c. Dionne, 2006 QCCA 1441 (CanLII).
2. Lessard c. Barreau, 1999 Q.C.T.P. 074.
Taro fait maintenant partie de Sun Pharma. Voilà rassemblées nos compétences collectives acquises au fil des décennies dans la fabrication de produits génériques, de produits de marque et de produits grand public. Nos capacités et ressources mondiales font de nous la quatrième plus grande société au monde dans le domaine des produits et spécialités pharmaceutiques génériques. Dorénavant unies, nous pourrons mieux répondre aux besoins variés du secteur des soins de santé canadien en pleine évolution.

Scannez le code QR pour en savoir plus à propos de Sun Pharma
Génériques • Produits de marque • Santé grand public


Un iPDE4 topique ayant des indications pour le traitement des 3 affections cutanées suivantes : le psoriasis en plaques, la dermatite séborrhéique et la dermatite atopique légère à modérée*

POUR LE TRAITEMENT DU PSORIASIS EN PLAQUES
ZORYVE® (crème de roflumilast, 0,3 %) est indiqué pour le traitement topique du psoriasis en plaques, y compris le traitement du psoriasis dans les zones intertrigineuses, chez les patients âgés de 12 ans et plus.


POUR LE TRAITEMENT DE LA DERMATITE SÉBORRHÉIQUE
ZORYVE® (mousse de roflumilast, 0,3 %) est indiqué pour le traitement topique de la dermatite séborrhéique chez les patients âgés de 9 ans et plus.
UNIQUOTIDIEN iPDE4 SANS STÉROÏDE*


POUR LE TRAITEMENT DE LA DERMATITE ATOPIQUE LÉGÈRE À MODÉRÉE
ZORYVE® (crème de roflumilast, 0,15 %) est indiqué pour le traitement topique de la dermatite atopique légère ou modérée chez les patients âgés de 6 ans et plus.
Conçu pour une administration simple
• Peut être utilisé sur toutes les zones touchées
• Application topique une fois par jour
Veuillez consulter la monographie du produit à l’adresse www.arcutis.ca/zoryve-pm-fr pour connaître les contre-indications, les mises en garde, les précautions, les effets indésirables, les interactions, la posologie et les conditions d’usage clinique. Vous pouvez aussi vous procurer la monographie du produit en téléphonant au 1-844-692-6729.
Le programme d’aide aux patients Assistance ZORYVEMC est conçu pour offrir une aide financière aux patients admissibles qui ont reçu une ordonnance de ZORYVE†
iPDE4 : inhibiteur de la phosphodiestérase de type 4
* La portée clinique comparative n’a pas été établie.
† Des restrictions peuvent s’appliquer. Pour connaître les modalités et conditions du programme, allez à l’adresse www.zoryveassist.ca et cliquez sur Conditions générales.
EXPLOREZ LE SITE
Référence : 1. Monographie de ZORYVE®. Arcutis Canada, Inc. Mars 2025.