

LE RIGUET-MINARRO
les architectes randonneurs - TOME I
- AVANT PROPOS -
Ce guide en architecture a été écrit dans le cadre d’un projet de fin d’études entrepris par deux étudiants en architecture au parcours singulier. Antoine a étudié à la Cambre-Horta avant de venir à Versailles pour poursuivre ses études. Après avoir obtenu un bac STD2A, Mélissa obtient une licence professionnelle en architecture à l’EPSAA, ouvrant les portes à l’ENSA Versailles. Cette équipe est bâtie sur une sensibilité particulière.
Nous avons choisi de marcher et de partir en quête de notre diplôme à travers la Suisse. Pays de l’architecture et de l’archétype, nous avons traversé sur un rythme doux les cantons de Vaud et du Valais. Chaque étape a révélé ses particularités. Nous avons été sensibles à l’égard des éléments qui composent l’architecture. Cette sensibilité nous a permis de mieux comprendre et apprécier la profondeur et la subtilité de chaque bâtiment, qu’il soit ancien ou contemporain.
Ce guide est conçu pour partager avec vous les leçons que nous avons apprises. Que vous soyez étudiant en architecture, professionnel du domaine ou simple amateur éclairé, nous espérons que ce guide vous offrira une source précieuse de connaissance et d’inspiration, tout en éveillant en vous une sensibilité architecturale renouvelée.
Bonne lecture et bon voyage à travers l’architecture Suisse.
- édité le Lundi 17 Juin 2024 à Versailles,
01.
VIA FRANCIGENA
PAGE 07
Présentation du chemin du pèlerinage historique et de notre organisation avant le départ, ainsi que la synthèse de notre expérience.
02.
VFS : VIA FRANCIGENA SUISSE
PAGE 35
La Via Francigena Suisse détaille étape par étape avec les cartes IGN mettant en parallèle des références architecturales et picturales. Les étapes sont séparées en quatre environnements.
03.
VFCC : VIA FRANCIGENA CULTURE CONSTRUCTIVE
PAGE 203
Nous avons choisi d’analyser quatre sujets le long du trajet. Parfois une méthode de construction, un bâtiment ou un mode de vie.
04.
VFP : VIA FRANCIGENA PROJET
PAGE 333
Cette dernière partie révèle nos propositions à la suite de la culture constructive que nous avons acquise. Les projets s’accrochent à un existant et aux éléments environnants en reprenant les archétypes et les modes de constructions locales.
P09 IL ÉTAIT UNE FOIS SIGÉRIC
P11 NOTRE RANDONNÉE
P13 NOUS SOMMES
P18 NOTRE MATÉRIEL DE RANDONNÉE
P27 TROUVER REFUGE
VIA FRANCIGENA
DÉPART :
- IL ÉTAIT UNE FOIS SIGÉRIC -
Depuis l’antiquité, la Via Francigena est la liaison la plus courte entre la mer du nord et Rome. Cette voie historique passait par la Suisse. Elle était l’épine dorsale du système routier de l’Europe Occidentale du temps de Jules César. La Via Francigena permit ainsi à Rome de devenir la principale destination de pèlerinage chrétien jusqu’au Xè siècle.
La Via Francigena fut surtout utilisée par les marchands, les soldats, les pèlerins et les brigands ! Il faut remonter en 990 au moment de la visite de l’Archevêque de Canterbury, Sigéric, au pape Jean XV à Rome, pour découvrir son existence. Selon les écrits de l’archevêque, le parcours était constitué de 79 étapes sur un parcours long de quelques deux mille kilomètres. Aujourd’hui le parcours se constitue de 49 étapes.
Entre le premier et le deuxième millénaire, la pratique du pèlerinage se développa de façon croissante en Europe. La Via Francigena représentait alors la voie de conjonction de toutes les grandes routes de la foi. Elle a permis un essor du commerce et de nombreux centres urbains situés le long de son parcours, Son rôle était stratégique, notamment dans le transport vers les marchés du nord de l’Europe.
La Via Francigena a également constitué une voie de communication de la plus grande importance pour la réalisation de l’unité culturelle européenne au Moyen-Âge. Elle a non seulement facilité le déplacement des personnes et des marchandises, mais aussi la diffusion de la connaissance, des idées, de la spiritualité et des expériences, ceci avec le rythme lent et profond de celui qui se déplace à pied.
« Aujourd’hui, nous réalisons, si nous considérons la réalité et regardons attentivement l’histoire, qu’il y a quelque chose de plus important que les soldats et les marchandises qui passent sur les routes ; ce quelque chose, ce sont les cultures. C’est la que la Via Francigena peut, je pense être considérée essentiellement, comme un chemin des cultures. »
- Jacques Le Goff, historien médiéviste.
CANTON DE VAUD

- NOTRE RANDONNÉE -
CANTON DE FRIBOURG
ARRÊT N°2 VEVEY
ARRÊT N°1 : LAUSANNE
CANTON DE BERNE
CANTON DE VAUD
ARRÊT N°3 AIGLE
ARRÊT N°4 : ST MAURICE
CANTON DU VALAIS
ARRÊT N°5 MARTIGNY
ARRÊT N°6 ORSIÈRES
FRANCE
CANTON DU VALAIS
ARRÊT N°7 : BOURG ST PIERRE
ARRÊT N°8 :
La découverte de ce chemin de pèlerinage s’est faite par l’étude de la capitale italienne : Rome. Au semestre dernier, nous avons étudié cette ville et notamment son réseau de transport en commun. Notre conclusion a été que pour arpenter Rome, il vaut mieux être à pied. Et puis, vous connaissez le dicton, « tous les chemins mènent à Rome ». Et bien : OUI ! Nous avons découvert ce grand chemin de pèlerinage qui part d’Angleterre et qui arrive à Rome : la Via Francigena.
Nous avons décidé de partir en Suisse pour plusieurs raisons. La première raison était liée à la nature des sentiers, en Italie le chemin est très routier et pas très bien balisé. La Suisse romande nous a attirée par la diversité des environnements
« Les adeptes des très longs parcours généralement effectués à pied, de traversées des jours, voir des semaines durant, de région en région, avec toujours en ligne de mire un objectif défini avant même leur départ, un but précis, un exploit : atteindre une basilique, arriver en bord de mer, remonter un fleuve, franchir une frontière, un massif ou une chaîne de montagnes. »
- De la Soudière Martin, Arpenter le paysage, Anamosa, 2019.
Nous nous sommes fixé un objectif avant de partir ; atteindre le col du Grand Saint Bernard, la frontière entre la Suisse et l’Italie. Pour notre première expérience de voyage en sac à dos, nous avons choisi un terrain de moyenne difficulté, une rive de lac, une plaine. L’ascension vers le col commence à Martigny, ce sont des étapes plus difficiles avec un dénivelé positif de 900 m en moyenne sur chaque journée.
ITALIE
RANDONNEUR EN AUTONOMIE n.m
DÉFINITION : Un randonneur en autonomie est un marcheur transportant son matériel et son équipement de vie dans son sac à dos afin d’assurer un confort minimal.
mot associé AUTONOMIE n.f
DÉFINITION : Capacité de quelqu’un à être autonome, à ne pas être dépendant d’autrui; caractère de quelque chose qui fonctionne ou évolue indépendamment d’autre chose.
DURÉE DE LA MARCHE : planifier en amont, durée déterminé pouvant varier selon les envies et les objectifs.
STYLE VESTIMENTAIRE : un sac à dos volumineux avec ceinture ventrale, de bonnes chaussures de randonnée, des bâtons de marche selon le type de terrain.

- NOUS SOMMES -
Nous sommes deux étudiants en architecture qui n’ont pas d’expérience dans la randonnée itinérante et autonome. Mélissa a fait du camping avec sa famille et ses amis, elle a randonné auprès de ses parents dès le plus jeune âge aux quatre coins de la France, notamment dans les Gorges du Verdon, les Pyrénées et les Alpes. Son père est un sportif qui pratique le trail et l’ultra trail en montagne, il marche aussi beaucoup pour faire de la photographie.
Antoine pratique la montagne principalement l’hiver, il part au ski en famille. Adepte des sports de raquettes, il a cette fois décidé de les chausser pour aller gravir le Col du Grand Saint Bernard. Cette expérience est le tremplin de futures randonnées, et notamment le célèbre GR20 en Corse prévu cet été.
Nous sommes partis avec des amis qui nous ont soutenus et appris quelques notions du trekking. Léonor Delcroix, qui a une très grande expérience et affinités avec la vie mobile. Elle a aménagé un van avec une copine pour partir faire un tour en Europe. C’est une sportive qui pratique la randonnée et la course à pied.
Un autre camarade, nous a rejoint, Erwan Aumont. C’est un garçon avec une âme d’aventurier, adepte du trekking avec le strict minimum, il a dormi à la belle étoile de nombreuses fois. C’est un habitué de la vie simple. Lorsqu’il part en aventure, il dort dans un hamac suspendu dans les arbres, il sait faire du feu en frottant des cailloux, connaît les techniques pour rendre l’eau potable. Il nous a partagé son savoir pour améliorer notre confort simplement.

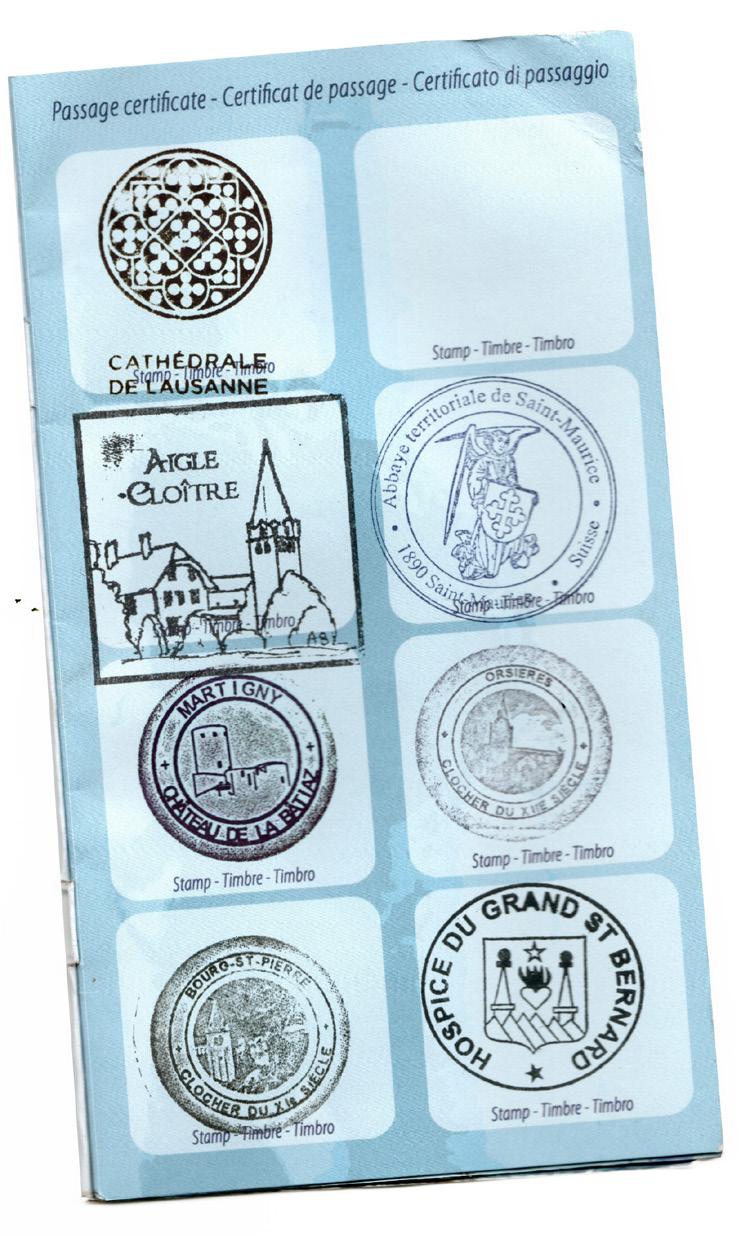
- NOUS NE SOMMES PAS -
PÈLERIN n.m
DÉFINITION : Un pèlerin est un voyageur croyant qui fait un voyage vers un lieu de dévotion, vers un lieu sacré selon sa religion.
DURÉE DE LA MARCHE : Plusieurs mois, plusieurs années et parfois pour toujours.
STYLE
VESTIMENTAIRE : À l’époque le pèlerin portait la robe de bure, un chapeau et des sandales. Aujourd’hui il s’habille comme un scout, avec un béret, un foulard, une chemise rentré dans le short, les chaussettes sortant des chaussures de marches. Il porte des badges et des écussons ainsi que des croix.
mot associé PÈLERINAGE n.m
DÉFINITION : Voyage à un lieu saint dans un esprit de dévotion. Voyage pour rendre hommage à un lieu, à un Homme.
Marcher sur un chemin de pèlerinage, ne fait pas de nous des pèlerins. Nous ne pratiquons aucune religion. Pèlerins ou non, libre à tous de parcourir la Via Francigena et d’en faire la durée qu’il souhaite. Cette randonnée s’effectue sur le long d’un itinéraire balisé. C’est une activité physique, un sport et un loisir de découverte et de contemplation.

- AVANT DE PARTIR -
Avril. 2024. Nous sommes partis, sac sur le dos. Les conditions climatiques étaient idéales. Très peu de pluie, pas beaucoup de vent, pas de très grosses chaleurs. Mais un grand delta de température entre les premières et les dernières étapes. Les conditions climatiques ont été la clé pour organiser notre sac à dos et planifier nos lieux de couchages.
Faire son sac à dos pour la première fois n’est pas un exercice facile. Il existe de nombreux retours d’expérience en ligne, via des comptes Instagram, des livres etc. Le trekking et le bivouac sont des disciplines en pleine expansion. De plus en plus de voyageurs partent découvrir un pays à pied, d’autant plus dans le contexte actuel où l’on cherche à voyager en réduisant son empreinte écologique.
C’est notre première expérience à pied et en bivouac, c’est la première fois que nous constituons un sac à dos. Nous avons fait et défait notre sac à plusieurs reprises. Avant de partir, chaque objet est analysé afin d’estimer sa nécessité, le « au cas où ».
Dans l’équipement de base du trek, cinq objets majeurs sont les clés d’une bonne aventure.
1. LE SAC À DOS
Le poids et le confort du sac à dos. Il est important d’avoir un sac à dos en proportion de son poids. C’est le premier conseil que l’on nous a donné, notre sac doit représenter 10 à 15% de notre poids maximum.
2. LES CHAUSSURES
Il y a deux types de chaussures de randonnées : les montantes, au-dessus de la cheville et les basses, tout juste au niveau de la cheville. Il est recommandé de prendre des chaussures hautes pour des marches sur des terrains escarpés avec un poids sur le dos.
Le matériel suivant est une balance à trouver entre la qualité, le poids et son prix pour optimiser son confort la charge du sac à dos. Il est important de questionner son confort avant de partir pour éviter de vivre dans l’inconfort.
3. LE DUVET
Il faut des duvets en forme de sarcophage lors d’aventures en trek durant cette saison. Pour choisir son duvet, il faut estimer à l’avance. En partant au mois d’Avril, les nuits sont encore fraîches en moyenne 10° lors des nuits en extérieur. Nous avons alors prêté attention à la «température de confort», permettant d’estimer le modèle à choisir.
4. LE MATELAS
C’est la première barrière contre le froid venant du sol. Il est important de regarder la R-Value, comme pour les isolants dans le bâtiment. Plus le coefficient est élevé et plus le matelas est isolant.
5. LA TENTE
Encore une affaire de poids et de confort. Nos tentes se montent et se démontent facilement. Elles étaient plutôt compactes pour ne pas prendre trop de place.
Les pages suivantes détaillent notre matériel commun à tous les deux. Sans compter les chargeurs de chaque appareil électronique et batteries externes. Antoine avait un poids supérieur, dû à son gabarit plus robuste. Il portait en plus un drone, un appareil photo, une enceinte. Mélissa avait des provisions et une trousse de pharmacie.


3.
1. Sac à dos
2. Bâtons de marches
Tente
4. Couteau Suisse
5. Gourde
6. Savon
7. Serviette microfibre 8. Casquette
9. Crème solaire
10. Lampe frontale
11. Réchaud à gaz 12. Matelas 13. Duvet
14. Pantalons
15. T Shirt manches longues
16. T-shirt manches courtes
17. Baskets
18. Chaussettes
19. K-Way
Hors sac:
20. Chaussures de randonnée
VFS07

Aigle à Saint Maurice, Réserve Forestière d’Ollon,


Aigle à Saint Maurice,
VFS08

Saint Maurice à Martigny, Marre du Torrent de l’Échelle,
- TROUVER REFUGE -
Partir en avril en Suisse a nécessité une organisation en amont. Le camping sauvage est limité dans les cantons de Vaud et du Valais. Et selon les environnements, il n’était pas facile de trouver un endroit pour installer le campement. Le long du lac Léman, la réservation d’un emplacement de camping était nécessaire. Nous avons dormi aux campings municipaux des villes de Lausanne et de Vevey, près du lac. Il n’y a pas de terrain sauvage pour s’installer, l’urbanisation des rives y est tellement intense. Les nuits ont été fraîches et l’air était humide.
Pour la suite des étapes, les trois nuits en plaine, nous avons également dormi dans nos tentes au camping des villes d’Aigle, de Saint Maurice et de Martigny. Ces trois nuits étaient mouvementées, des rafales de vents secouant les toiles de nos tentes et une nuit à entendre la pluie frapper ce léger tissu déperlant.
Nous étions les seuls à camper à cette période de l’année, les campings étaient remplis de voitures aménagées, de voitures avec caravane qui restaient plusieurs nuits et semblaient être présents en communauté. Nous avons fait le choix de dormir en camping pour assurer notre confort hygiénique. La douche après une journée d’effort était pour notre première expérience indispensable.
Pour les étapes suivantes, plus de campings. Soit ils n’étaient pas encore ouverts (seulement de mai à septembre), soit ils étaient inexistants. Nous avons trouvé refuge dans une auberge à Orsières puis au gîte des pèlerins à Bourg-SaintPierre. Pour la dernière étape, nous avons souhaité vivre l’expérience à l’Hospice du Grand Saint Bernard, le seul endroit où l’on peut dormir au col. Nous avons d’ailleurs dû réserver en avance pour nous garantir une place.
nuit calme

- SYNTHÈSE DE NOS HUIT NUITS -
10° nuit calme
ALT. 387m
NUIT 1 : pelouse ombragé

rafale à 30 km/h
NUIT 3 : pelouse 9°
ALT. 405m

3° pluie
0° neige
ALT. 383m NUIT 2 : pelouse en bord de lac
8° rafale à 35 km/h

ALT. 414m
NUIT 4 : terrain sec et rocheux

-5° très froid
ALT. 487m NUIT 5 : pelouse

ALT. 1632m NUIT 7 : gîte des pèlerins

ALT. 893m
NUIT 6 : auberge (chambre privée)

ALT. 2473m
NUIT 8 : dortoir à l’hospice
Lausanne à Vevey, Camping de la Maladaire à Vevey,


Vevey à Aigle, Camping de la piscine à Aigle,
Orsières à Bourg-Saint-Pierre, Refuge des Pèlerins à Bourg-Saint-Pierre,

Bourg-Saint-Pierre au Col du Grand Saint Bernard, Hospice du Grand Saint Bernard,

P37 LES RIVES DU LÉMAN
P79 LA PLAINE DU RHÔNE SUISSE
P123 LA VALLÉE D’ENTREMONT
P151 LE COL DU GRAND-SAINT BERNARD
SUISSE
VFS : VIA FRANCIGENA
LES RIVES DU LAC LÉMAN
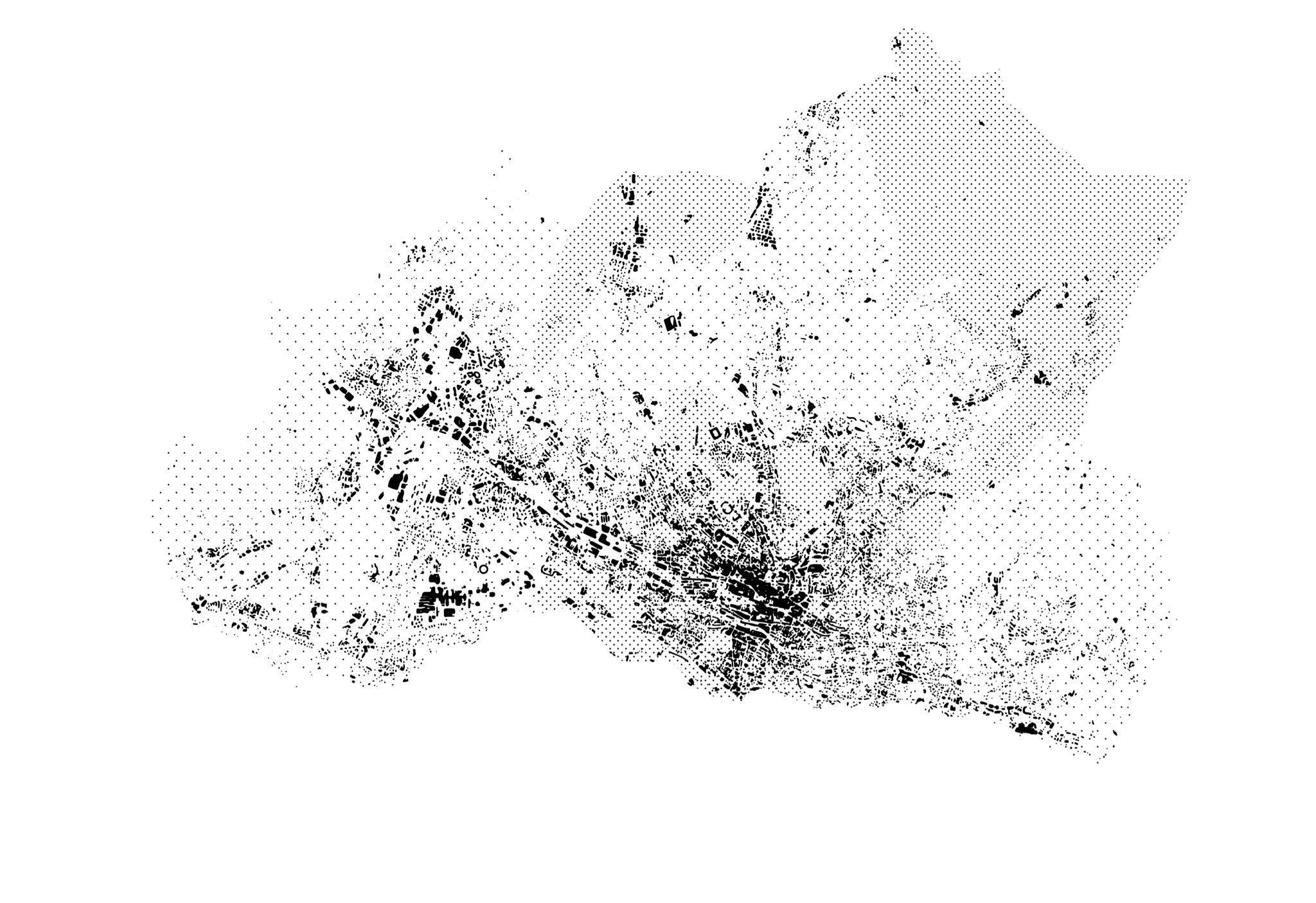
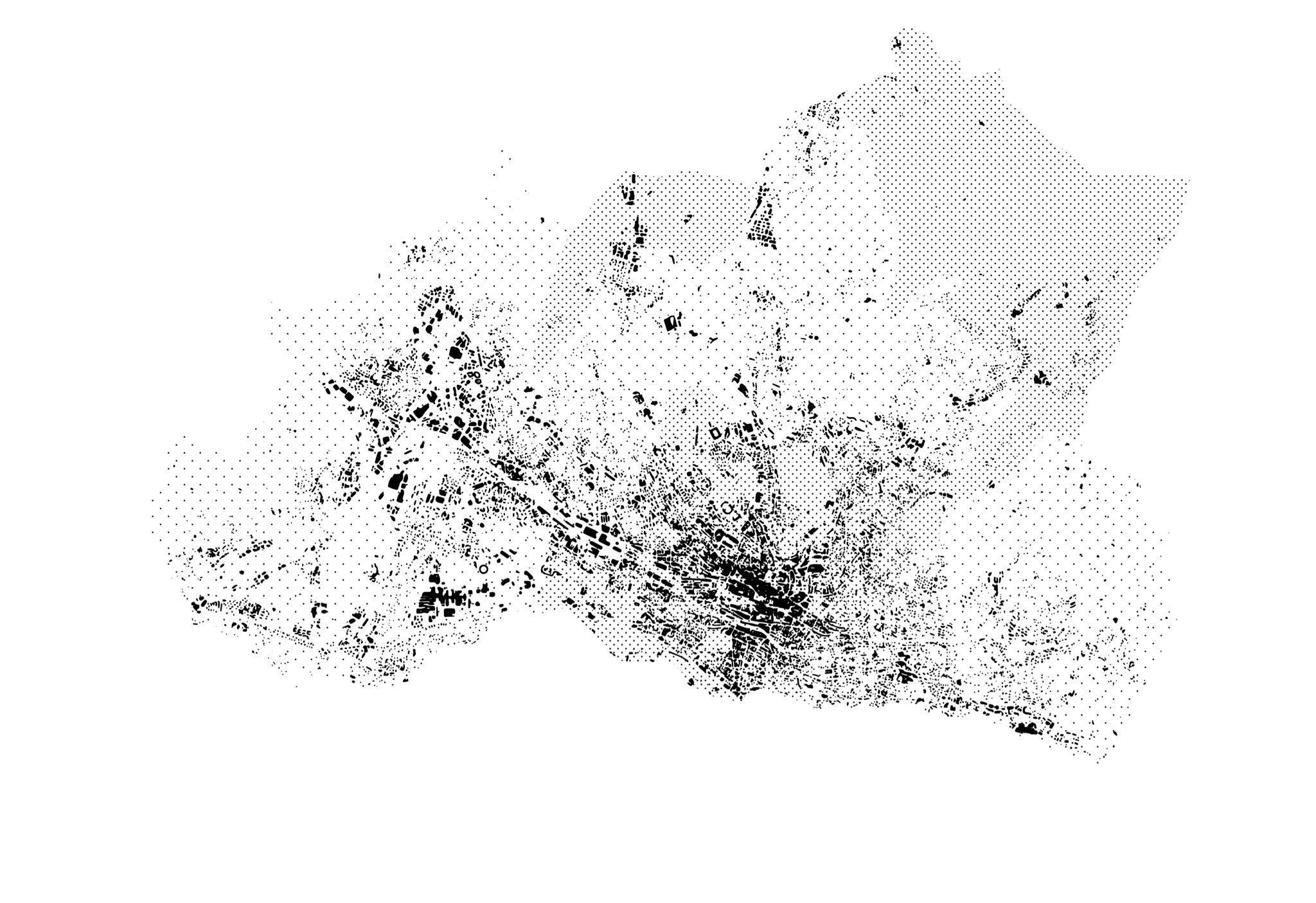

POPULATION
SUPERFICIE
DENSITÉ



POPULATION : 26 230 hab.
SUPERFICIE : 33.37 km²
DENSITÉ : 786 hab/km²
POPULATION : 5 960 hab.
SUPERFICIE : 32.04 km²
DENSITÉ : 186 hab/km²
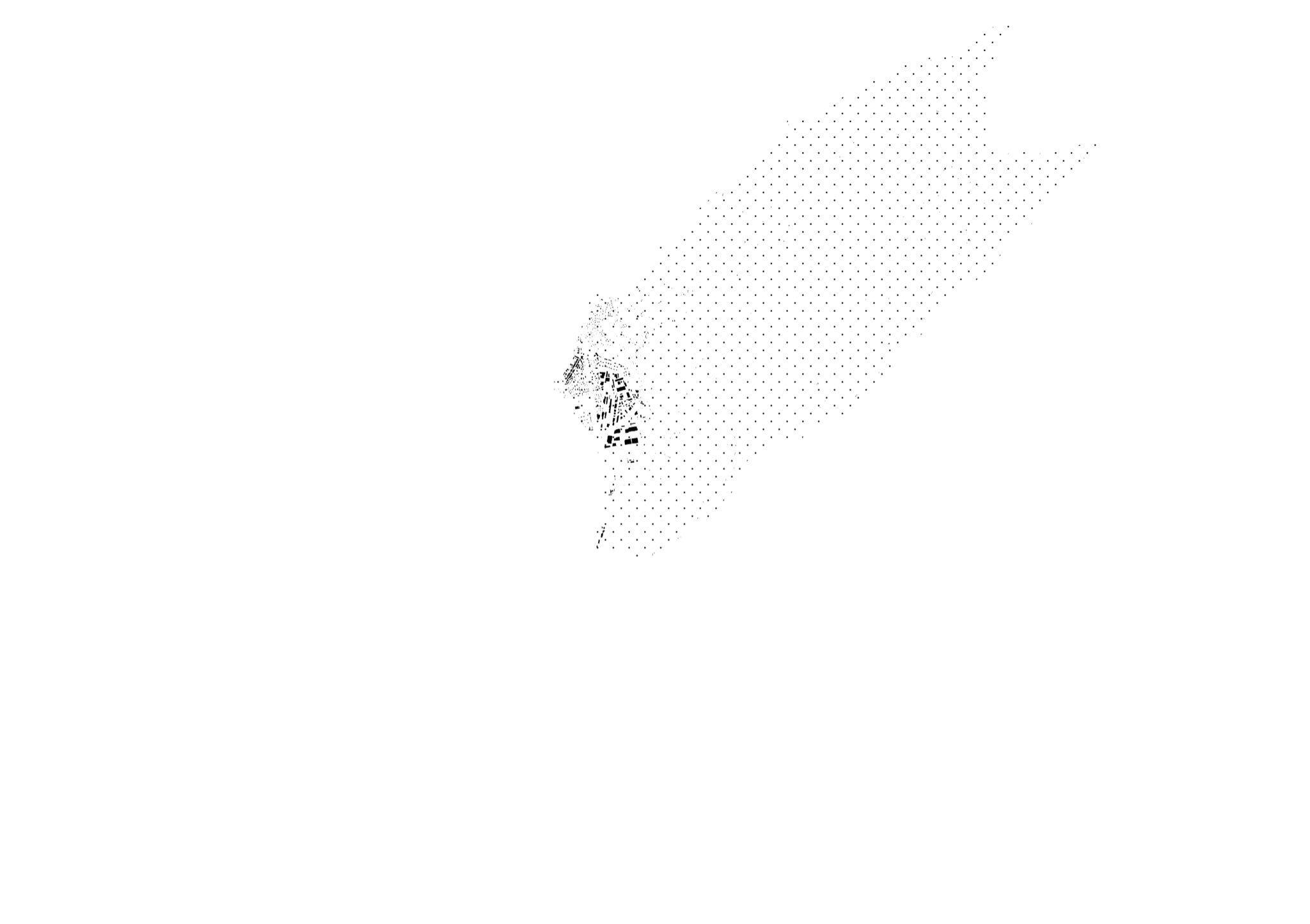

MONTREUX
VILLENEUVE

une grande diversité - MOYEN DE DÉPLACEMENT - - MIGRATIONS -

INFOS PRATIQUES
DISTANCE : 24,4 km
D+ : 350 m
D- : 330m
Durée : 6h
Difficulté : Moyenne -
De nombreux endroits de ravitaillements jusqu’à Lutry mais prévoyez à boire et à manger avant de vous lancer dans les vignes !
VFS05 : Lausanne - Vevey
Cette étape marque le début de votre aventure, elle débute à Lausanne, la ville olympique. Le chemin parcourt les quais d’Ouchy longeant les ports et les bateaux à voiles côtoyant les grandes bâtisses pittoresques.
Les chemins minéraux longent les rives du Lac Léman. La légion Lémanique est densément peuplée et les rives fortement aménagées. Seules 3% se trouvent encore à l’état sauvage. De nombreuses infrastructures touristiques ont conduit à l’artificialisation des rives.
Très rapidement, le chemin mène aux collines verdoyantes du vignoble de Lavaux. Vous traverserez de nombreux villages comme celui de Saint Saphorin et ses ruelles étroites, bâtiments en pierre et surtout son église médiévale. Vous traverserez les domaines agricoles les plus anciens, comme le célèbre Dézaley cultivé depuis des siècles. Ses sols argilocalcaires et le microclimat de la colline sont propices à la culture de la vigne.
En descendant vers la ville, vous passerez devant la villa du Lac construite par Le Corbusier pour ses parents en 1923. Vous arriverez à Vevey, ville commerciale et fluviale importante au Moyen-Age. Elle est aujourd’hui très culturelle grâce aux nombreux centres d’arts et son intérêt pour le cinéma grâce à Charlie Chaplin.

Les grandes maisons bourgeoises, les ports privés, les pontons. Bordés de jardins fleuris et de pelouses bien entretenues, les quais sont un lieu idéal pour se détendre, faire du jogging ou simplement profiter de la vue spectaculaire sur le lac et les montagnes environnantes.


Le long du Lac Léman, Chemin de la Flore,



- FERDINAND HODLER -
Le peintre du Léman.
Parmi les quelques six cents tableaux de paysages laissés par Hodler, un tiers représente des lacs, et plus de la moitié de ses œuvres ont pour sujet le Léman, un motif facilement accessible pour l’artiste. Hodler partage avec les impressionnistes un intérêt pour les séries, où chaque œuvre capture les subtils changements de notre perception induits par la saison, le temps ou l’heure du jour.
Cependant, Hodler va au-delà de la simple représentation visuelle, cherchant à atteindre un symbolisme qui transcende la réalité extérieure pour exprimer une vision intérieure du paysage. Ses œuvres, telles que celles du Grammont, évoquent davantage les expressionnistes que les paysagistes français, offrant des paysages qui sondent notre lien avec le monde, des «paysages planétaires» comme les appelait Hodler.
Son style artistique a été influencé par le symbolisme, mouvement artistique qui cherchait à exprimer des idées et des émotions à travers des symboles et des métaphores. Hodler a rapidement développé une palette de couleurs riches et une technique précise qui se combinent pour créer des compositions puissantes et émotionnelles.
Les thèmes récurrents dans l’œuvre de Hodler incluent la nature, la spiritualité, l’amour, et la mort. Il était particulièrement célèbre pour ses portraits et ses paysages, qui reflétaient souvent une profonde introspection et une recherche de vérité intérieure. Ses portraits étaient caractérisés par des formes simplifiées, des lignes claires et des expressions intenses, capturant l’essence même de ses sujets.
En plus de son travail pictural, Hodler a également joué un rôle central dans la promotion des arts visuels en Suisse, contribuant à la fondation de la Société suisse des artistes et sculpteurs en 1899. Son engagement envers l’art moderne et ses efforts pour unifier les différents courants artistiques de son époque ont eu un impact durable sur la scène artistique suisse.
Le Léman vu de Lutry, 1891,

- LE CORBUSIER -
LA VILLA DES PARENTS VEVEY
La villa «Le Lac» est une villa construite par Le Corbusier pour ses parents en 1923 à Corseaux près de Vevey. Perchée sur une pente légèrement inclinée, la villa «Le Lac» offre une vue imprenable sur le lac et les Alpes environnantes. Son design épuré et géométrique se fond harmonieusement avec le paysage environnant. Les lignes épurées, les formes cubiques et les grandes baies vitrées caractérisent l’esthétique minimaliste de Le Corbusier, tandis que les matériaux naturels comme le béton et le bois ajoutent une chaleur et une authenticité à la structure.
À l’intérieur, la villa est fonctionnelle. Les espaces sont ouverts et lumineux, avec un agencement fluide qui favorise la circulation et la connexion avec l’extérieur. Les grandes fenêtres inondent les pièces de lumière naturelle, tandis que les vues panoramiques sur le lac créent une sensation de calme et de sérénité.
Outre son importance architecturale, la villa «Le Lac» témoigne également de l’histoire personnelle du Corbusier. C’était sa résidence d’été, un refuge où il pouvait se retirer de l’agitation urbaine et puiser inspiration et créativité dans la beauté apaisante de la nature.
Les vignes de Lavaux sont les terres sacrées de la région Vaudoise. Elles représentent une grande importance historique et culturelle viticole, elles sont l’intégrité visuelle du paysage.

Les vignobles de Lavaux attirent de nombreux touristes venant visiter les caves des producteurs et goûter le vin. Le tourisme viticole contribue à dynamiser l’économie locale en générant des revenus pour les producteurs, les restaurateurs, les hébergements et autres entreprises touristiques de la région.

VIA FRANCIGENA CULTURE CONSTRUCTIVE :
LES MURS DE LAVAUX
14,800


15,250
Les Vignes de Lavaux, Chemin des Grands Crus Dézaley,
Les Vignes de Lavaux, Chemin des Grands Crus Dézaley,
«Marcher, c’est découvrir le monde à travers des paysages qui se déploient lentement, c’est laisser le temps graver dans notre mémoire chaque détail des villes et des chemins.»

C’est ainsi que nous quittons le chemin des vignes pour nous rendre à Vevey.
INFOS PRATIQUES
DISTANCE : 25,3 km
D+ : 395m
D- : 120m
Durée : 5h40
Difficulté : Moyenne
VFS06 : Vevey - Aigle
Votre dernière étape, le long des rives du Léman, ce soir vous dormirez en plaine ! Vous continuez votre chemin sur les contours sinueux du lac. Vevey est une ville chargée d’histoire qui existait bien avant que les Romains développent la ville. Au fil des siècles, Vevey prospère grâce aux commerces, notamment grâce à son port. La ville donne une grande importance au cinéma et à l’art influencé par l’écrivain britannique Charlie Chaplin qui a vécu de nombreuses années à Vevey.
Vous quittez Vevey pour atteindre rapidement Montreux aussi appelée La Riviera. Destination de choix pour l’aristocratie au XIXe siècle, les bâtiments sont généreusement ornés de l’architecture Belle Époque. La ville est le témoin de nombreuses époques. Le Château médiéval de Chillon datant du XIIe siècle contraste avec le Centre de Congrès et le casino.
Enfin Villeneuve, dernière ville du Léman, fait la transition avec la vallée du Rhône. Vous traverserez ce que l’on appelle une entrée de ville, une zone industrielle et commerciale, un nœud de transport avec des infrastructures routières qui se croisent.
Puis tout à coup, vous sentirez le revêtement sous vos pieds changer. Le premier sentier fait de granulats provenant probablement des premières carrières de la vallée situées sur votre gauche.
L’environnement a changé, les montagnes sont désormais de part et d’autre et l’horizon n’est plus aussi dégagé. De l’eau accompagne toujours le chemin, un cours d’eau timide. Un premier village authentique, Roche. La nature est calme jusqu’à votre arrivée à Aigle.



Le Château de Chillon,
Francigena,

- KONRAD WITZ
-
«La Pêche Miraculeuse» est une peinture emblématique qui trouve son origine dans un passage biblique du Nouveau Testament, où Jésus accomplit un miracle en faisant une pêche miraculeuse, remplissant les filets des pêcheurs de poissons après une nuit infructueuse.
À travers la peinture, le peintre a cherché à capturer l’essence même du miracle, mais aussi à transmettre des messages symboliques plus profonds. «La Pêche Miraculeuse» est souvent interprétée comme une métaphore de la foi et de la confiance en Dieu, où les pêcheurs représentent l’humanité confrontée à l’incertitude et aux défis de la vie, et où Jésus incarne la capacité à surmonter ces défis avec foi.
Dans les interprétations plus contemporaines, le tableau peut également être vu comme une allégorie de l’abondance et de la grâce divine, ou même comme un commentaire sur la nature de la foi et du doute. Quelle que soit l’interprétation, «La Pêche Miraculeuse» demeure une œuvre fascinante qui continue d’inspirer et de susciter la réflexion.
La Pêche Miraculeuse, 1444, détrempe sur bois, 132 x 154 cm


P85 VFS07 : AIGLE - SAINT MAURICE
P103 VFS08 : SAINT MAURICE - MARTIGNY
P115 VFS09 : MARTIGNY - ORSIÈRES
LA PLAINE DU RHÔNE SUISSE
LES TÂCHES URBAINES
7 AGGLOMÉRATIONS TRAVERSÉES
1 : 150 000



POPULATION
SUPERFICIE


POPULATION
SUPERFICIE : 59.56 km
DENSITÉ : 134 hab/km

POPULATION : 1 490 hab.
SUPERFICIE : 6.63 km²
DENSITÉ : 299 hab/km²

MASSONGEX
SE DÉPLACER

une grande diversité - MOYEN DE DÉPLACEMENT - - MIGRATIONS -

INFOS PRATIQUES
DISTANCE : 22,3 km
D+ : 602 m
D- : 420m
Durée : 5h30
Difficulté : Moyenne
VFS07 : Aigle - Saint Maurice
En partant vers Saint Maurice, vous passerez à côté du château d’Aigle au milieu des vignes. Une route puis un sentier monte dans la forêt de la Glaive. Fort dénivelé à prévoir sur de courtes portions, récompensé par de larges panoramas sur la vallée. La descente vous emmène vers le village d’Ollon.
Ollon offre une pause, des fontaines sont dispersées à travers le village. L’activité du vin y est encore largement répandue, vous allez d’ailleurs rejoindre les coteaux et reprendre de la hauteur. Le chemin du pèlerin, nommé ainsi, traverse un bois, avant de déboucher sur une vue dégagée. Encore des vignes. Le sentier descend à travers les vignes, vous marchez sur les traces des vignerons qui travaillent, vous n’avez jamais été aussi près des pieds de vignes.
Vous changez de cap et vous traversez la vallée dans sa largeur, le long de la rivière de la Gryonne jusqu’à son embouchure dans le Rhône. Vous passez au-dessus de l’autoroute A9. Vous longez le Rhône jusqu’à Massongex où cette fois vous traversez le fleuve, prenant conscience de sa puissance qui peut être dévastatrice.
Il vous reste ainsi un peu moins de cinq kilomètres avant d’apercevoir l’église historique de Saint Maurice.

Château d’Aigle, Chemin de la Poya du Chateau,,


Réserve forestière d’Ollon, Chemin de Sans Souci,



Cette région bénéficie d’un microclimat très favorable, du soleil et un vent chaud et sec. C’est l’effet de Fœhn. Les vignes, introduites par les Romains, puis développées dès le Moyen-Âge par les seigneurs et les abbayes, s’élèvent sur la rive ensoleillée, plein sud, du Rhône entre 350 et 800 mètres d’altitude. Les anciens vignerons ont construit à flanc de montagne des réseaux de canaux d’irrigation en bois, appelés les bisses. Morcelé en de multiples parcelles escarpées, soutenu par 1 600 km de murettes, murs en pierre sèche, c’est un vignoble créé par des bâtisseurs.
Des populations restées nomades jusqu’au début du XXe siècle se déplaçaient selon les saisons, entre plaine et montagne, culture des vignes et des champs, élevage du bétail. Après les vendanges, elles remontent dans la vallée leur production pour élaborer un vin issu de plusieurs millésimes, selon le système de la « solera ».


Les Fontaines, Via Francigena,
L’Abbaye de Salaz, Rue de l’Abbaye,


De nombreuses carrières se placent à flanc de montagnes ou comme ici sur la falaise d’un bloc erratique. Les blocs erratiques sont des énormes rochers qui se sont décrochés du haut de la montagne et qui ont été transportés par un glacier.
Ici la carrière de Sous-Vent est placée stratégiquement au plus près de l’un des échangeurs de l’A9 qui traverse la plaine dans son axe Nord-Sud. La voie ferroviaire traverse le Rhône sur un pont en arc.


INFOS PRATIQUES
DISTANCE : 16,3 km
D+ : 410m
D- : 284m
Durée : 4h20
Difficulté : Facile
VFS08 : Saint Maurice - Martigny
Profitez de cette étape pour reprendre des forces. C’est l’étape avant l’entame de l’ascension. Ce parcours présente moins de curiosités, ce qui laisse plus de temps pour méditer et rêver. La vallée se resserre. Après avoir traversé une industrie plutôt spécialisée sur l’extrait de matériau. Cette deuxième partie de la plaine utilise ses ressources hydroélectriques aux pieds des montagnes.
A la sortie de Saint Maurice, un barrage et son usine. Le long du Rhône, deux sites célèbres, la cascade de la Pissevache et les gorges du Trient. La cascade est alimentée par une usine de force motrice. Cette chute d’eau varie en fonction de la production d’électricité de l’usine.
Vous passerez par des vignobles, des champs et des zones boisées. Située au cœur du canton du Valais en Suisse, Martigny est une ville dynamique et stratégique, connue pour son emplacement au «Coude du Rhône». Cette particularité géographique où le Rhône change brusquement de direction, fait de Martigny un carrefour naturel. Cette particularité géographique place la ville en première ligne lorsqu’il s’agit de gérer les risques de crues du Rhône.


Entre Villeneuve et Martigny, il y a des barrages hydrauliques sur le Rhône. Cette section du Rhône est exploitée pour la production hydroélectrique, et plusieurs installations permettent de gérer le débit et de produire de l’électricité.
C’est le seul barrage présent dans le secteur du Rhône suisse. Mis en service en 1902, le barrage est amélioré d’année en année afin de s’inscrire dans le plan environnemental de la vallée du Rhône. Ce barrage et son usine produisent près de la moitié des besoins en électricité des services industriels de la plaine.

«L’expérience du paysage ne se réduit pas à la vue : elle implique aussi le corps»- Martin De La Soudière, Arpenter le paysage.


Gravière dans le fleuve,
du Rhône,
Cascade de la Pissevache, Via Francigena,
Usine d’éléments de préfabrication en béton, Chemin de la Lantze,


Réserve Forestière de l’Arpille, Chemin de la Bâtiaz,
INFOS PRATIQUES
DISTANCE : 21,7 km
D+ : 878 m
D- : 210m
Durée : 6h20
Difficulté : Moyenne
VFS09 : Martigny - Orsières
C’est le début de l’ascension vers le Col du Grand-SaintBernard, les trois prochaines étapes ont un bon nombre de dénivelés positifs. L’étape entre Martigny et Orsières est une belle journée de randonnée de 18 km à travers les Alpes valaisannes, qui devrait vous prendre environ 5 à 6 heures. Quittez la ville en suivant les panneaux de la Via Francigena, qui vous guideront le long du Rhône. Vous serez bientôt entourés de vignobles en terrasses, une vue magnifique surtout aux premières lueurs du jour. En quittant Martigny, le chemin monte progressivement. Vous passerez par les villages de Vétroz et Charrat. À mi-chemin, vous atteindrez le village de Sembrancher, situé à environ 717 m d’altitude.
Après Sembrancher, vous entamez une montée progressive vers Orsières. Le chemin devient plus alpin et vous traverserez des forêts et des prairies verdoyantes. Les vues sur les montagnes environnantes deviennent de plus en plus impressionnantes à mesure que vous gagnez en altitude.
Vous arriverez enfin à Orsières. Ce joli village alpin est l’endroit parfait pour terminer votre journée de randonnée. Orsières offre une atmosphère accueillante avec ses rues pittoresques, ses commerces et ses restaurants où vous pourrez savourer des spécialités locales.



Vallée de Sembrancher, Via Francigena,
LA VALLÉE D’ENTREMONT
SE DÉPLACER
une grande diversité - MOYEN DE DÉPLACEMENT -
DÉPLACER
grande diversité


- MIGRATIONS -

JUSQU’À ORSIÈRES
INFOS PRATIQUES
DISTANCE : 14,2 km
D+ : 936 m
D- : 222 m
Durée : 5h30 min
Difficulté : Difficile
VFS10 : Orsières - Bourg-Saint-Pierre
Depuis le centre du village d’Orsières, vous partez en direction de la vallée d’Entremont. La route monte progressivement dès la sortie d’Orsières.
La route forestière serpente vers le sommet. De gros tuyaux descendent vers la plaine, ces tuyaux précipitent une grande quantité d’eau sur plusieurs hauteurs vers les turbines des centrales. Plusieurs exploitations agricoles, des fermes avec le bétail sur la route qui devient peu à peu un sentier forestier. Des ruisseaux traversent le chemin, souvent franchissables à pied sur des ponts pour les passages les plus délicats. Les forêts d’épineux sont à perte de vue.
La vallée est plutôt étroite, le chemin suit la Dranse que vous traversez sur un pont près de la rivière, puis sur un autre haut perché après avoir monté un bon dénivelé. La Dranse prend sa source près du Col du Grand Saint Bernard et rejoint le Rhône à Martigny. Vous quittez la Dranse et montez au village de Liddes où l’architecture de montagne se fait ressentir, le bois de construction est très présent, les toitures sont désormais en pierre plate et débordent généreusement du bâtiment. L’environnement a changé, la nature est plus sauvage, vous aurez peut-être la chance de voir des marmottes et bouquetins qui sont très répandus.
Vous arrivez à Bourg-Saint-Pierre par la route principale, l’entrée du village est marquée par l’hôtel-restaurant du Napoléon, bâtiment mythique du hameau. Le nom de ce bâtiment nous évoque la traversée du petit Caporal.



Fontaine Dessous, Route de Fornex,


La Dranse, Via Francigena,
Vichères, Via Francigena,
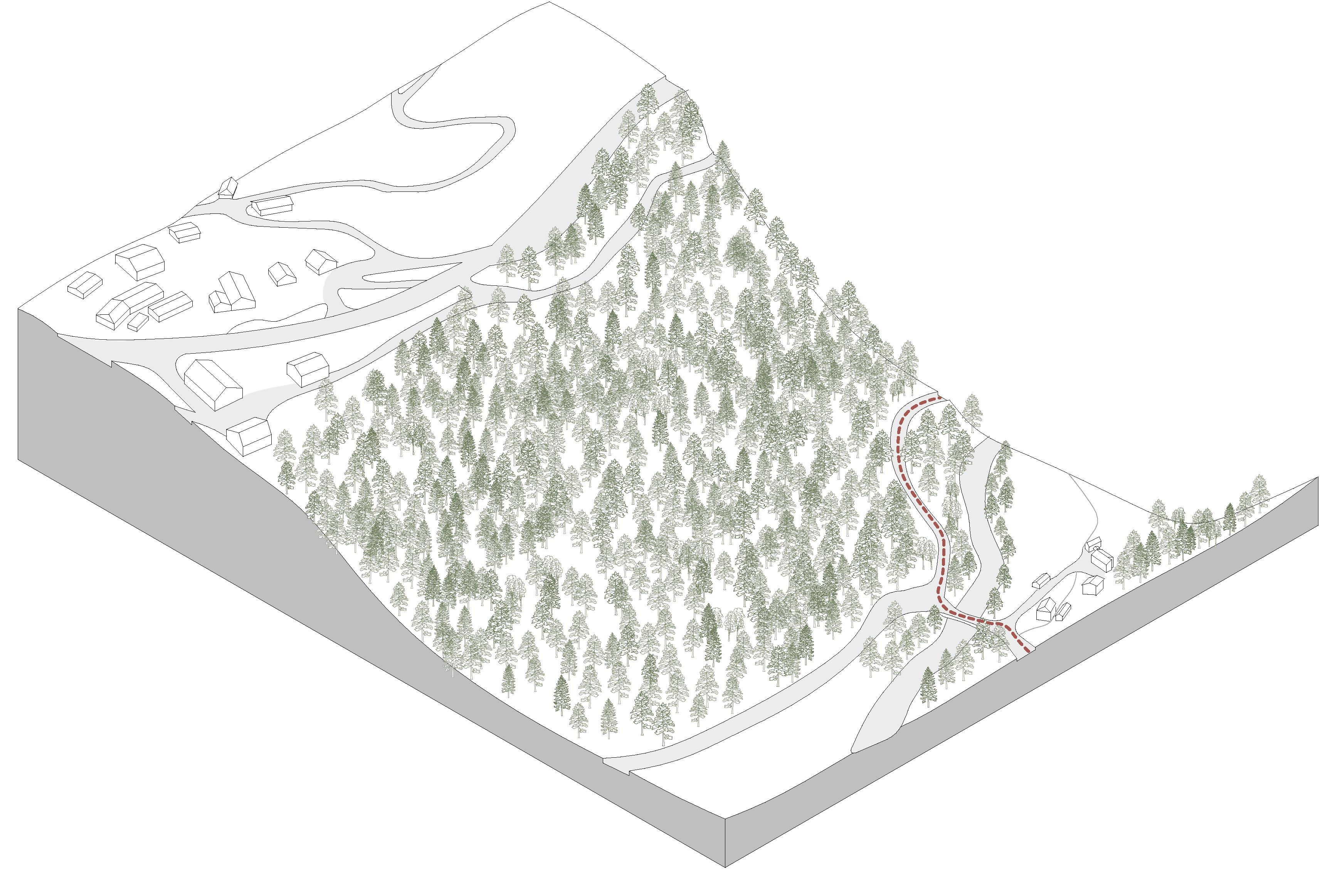
Sur la route du Grand-Saint-Bernard qui relie la Suisse occidentale au Piémont, la commune de Liddes occupe la partie médiane du val d’Entremont entre Orsières et BourgSaint-Pierre. La ville longe la Dranse sur plus de six kilomètres. Les usines aux fonctions multiples ont abondé dans toute l’Europe occidentale et centrale. En Valais, en descendant du Grand-Saint-Bernard, une trentaine de Bourg-Saint-Pierre à Orsières qui utilisaient une centaine de roues à eau.
Parmi elles, le complexe usinier du Glarey, les Moulins de Liddes.
+ VFCC03
VIA FRANCIGENA CULTURE CONSTRUCTIVE :
LES MOULINS DE LIDDES



- FRÉDÉRIC RÉGAMEY -
« Dans les chalets primitifs des montagnes, le touriste difficile et prétentieux ne trouvera pas ce qu’il désire. Mais le touriste robuste et expérimenté y sera parfaitement bien logé et ils lui rendront ordinairement de bons services. » p54
« Là, comme dans toute la région, se trouvent des raccards, greniers paraissant construits d’une ingénieuse façon. Ces chalets en bois, isolés des habitations, à cause des incendies possibles, posent sur des piliers de deux pieds de haut couronnés de chapiteaux faits d’une grande pierre plate qui les débordent largement et interdisent l’accès aux rats et autres pilleurs de grains. Le sol creusé procure à peu de frais une sorte de remise et d’abri pour les volailles. » p58
« Vieille église dont le clocher date du onzième siècle. Près de la tour, sur le mur, une borne milliaire romaine. C’est là qu’était, lors du fameux passage effectué du 15 au 21 mai 1800 par Bonaparte et ses 30 000 hommes, la dernière étape de l’armée avant l’arrivée au sommet, et une auberge. » p62
« Ce village n’est composé que de baraques couvertes de planches, avec des granges d’une grandeur immense où nous couchâmes tous pêle-mêle. Là, on démonta tout notre petit parc, le Consul présent. L’on mit nos trois pièces de canon dans une auge ; (chaque demi- brigade avait alors son artillerie) au bout de cette auge il y avait une grande mortaise pour conduire notre pièce gouvernée par un canonnier fort et intelligent qui commandait quarante grenadiers. » p75
1894, Frédéric Régamey, Une excursion au Grand Saint Bernard la route - l’hospice.
La traverse de Rive-Haute, 1894, Gravure , 21x30 cm
A Bourg Saint Pierre, 1894, Gravure , 21x30 cm


Palasuit,
Chemin des Moulins,


119,050


Vallée d’Entremont,
- MOYEN DE DÉPLACEMENT - - MIGRATIONS -


INFOS PRATIQUES
DISTANCE : 13,9 km
D+ : 1 200 m
D- : 120 m
Durée : 4h18 min
Difficulté : Difficile -
Pour une ascension en hiver, consultez les bulletins d’avalanches pour connaître les tendances du terrain. Équipez-vous de ski, ou de raquettes et d’un kit DVA.
Prévenez des personnes de votre ascension et de votre descente, l’hospice par exemple.
VFS11 : Bourg-Saint-Pierre - Col du Grand Saint-Bernard
La dernière étape pour atteindre le Col ! Cette dernière marche demande beaucoup de concentration, le terrain est escarpée, et les chevilles très sollicitées. Prenez le temps de profiter de cette étape emblématique avant d’atteindre l’hospitalité promise des moines de l’hospice. Cette randonnée est une immersion dans l’histoire et la nature.
Le sentier commence par une montée douce à travers des prairies alpines et des forêts de conifères. Un ancien pont en pierre enjambe la Dranse. En montant, vous passerez par une série de petits lacs de montagne appelés Lacs de Fenêtre. Le plus impressionnant est le Lac des Toules.
Sur le chemin, vous pourrez voir les ruines d’un ancien hospice utilisé avant la construction de l’hospice actuel au col du Grand Saint Bernard. C’est l’hospitalet, il y a un téléphone pour appeler à l’aide en cas de besoin. Ces vestiges témoignent des efforts déployés depuis des siècles pour assurer la sécurité des voyageurs.
Une section du sentier, pavée de grandes dalles de pierre, rappelle l’importance stratégique du col à travers les âges. Cette étape est une randonnée marquante, alliant défis physiques, beautés naturelles et découvertes historiques.
C’est une émotion de marcher sur les traces des pèlerins et des grands voyageurs et conquérants d’antan, tout en profitant de l’hospitalité intemporelle de l’hospice.

Partir au mois d’Avril nous a permis de ne pas avoir trop chaud le long du Lac Léman et en plaine et d’être plutôt confortable avec nos équipements en montagne. Mais partir au mois d’Avril, c’est trouver un col sous des dizaines de mètres de neige. La route est déneigée jusqu’au parking d’une ancienne station de ski : le Super Saint-Bernard.
La période hivernale dure huit mois, de mi-Octobre à mi-Juin, la route est fermée et la seule manière d’accéder au col c’est à pied. Mais pour marcher sur la neige, il faut être équipé, soit de ski, soit de raquettes de randonnée.
L’ascension du Col du Grand-Saint-Bernard en hiver représente un véritable danger, le chemin d’hiver suit la route empruntée par les automobilistes l’été. C’est une route à flanc de montagnes, et l’hiver, les pentes à 30° forment un risque accru d’avalanche sur une grande partie des sept kilomètres pour rejoindre le col.
Alors pour cette ascension au col, il était essentiel de nous équiper et pourquoi pas d’avoir un accompagnateur, connaisseur du terrain. Avant de partir, Mélissa accroche une paire de raquettes à son sac, lourde et encombrante, on établit très rapidement que l’on va devoir en louer sur place.
Conscients du danger que représente la montagne, nous avons cherché un guide pour nous accompagner lors de notre montée au Col. Nous avons appelé le bureau des guides locaux, mais le prix de l’excursion était bien trop onéreux pour nous, étudiants en architecture. Un message posté sur le groupe de la Via Francigena, et Jean-Marc nous répond positivement. Enseignant, il ne sera finalement pas disponible le jeudi, jour de notre ascension. Il sera malgré tout de très bon conseil sur les conditions climatiques et les portions compliquées de notre futur parcours. C’est alors que nous contactons la gérante de notre refuge à Bourg-Saint-Pierre : Martine.
C’est une femme qui s’occupe de la Maison Saint-Pierre, très gentille elle nous propose de nous fournir quatre paires de raquettes et de nous accompagner au Col.
Le Jour-J, Martine nous donne rendez-vous à 10h au parking de la station de ski abandonnée à Bourg-Saint-Bernard. Nous ne sommes pas partis à pied depuis le Village de Bourg-SaintPierre car le sentier entre le bourg et le point de rendez-vous était lui aussi très exposé aux éboulements de terrains. Très chanceux d’avoir une météo clémente, le soleil augmente la fonte de la neige et donc le risque d’avalanche, il était important de ne pas monter après midi.
Sur le parking, nous rencontrons Martine et son fabuleux accent. Nous chaussons les raquettes gentiment prêtées, elle met des peaux de chamois sous ses skis. Nous commençons l’ascension, les premiers mètres, nous cherchons notre rythme avec nos raquettes. Pas facile de marcher avec des raquettes . Elle nous raconte pleins d’anecdotes, nous marquons des pauses pour prendre le temps d’échanger. C’est un moment important dans notre randonnée. Le rythme est encore plus lent, par le dénivelé, par l’inhabitude de marcher avec des raquettes, par le manque d’oxygène en montagne et tout simplement par l’épuisement de la semaine de marche.
Nous traversons la combe des morts où elle évoque le nombre importants d’accidents mortels qui a lieu chaque année. Pas plus tard qu’une semaine avant notre montée. Martine avait tenu à ce que l’on porte un kit DVA avec sonde et pelle pour être localisable en cas d’avalanche. Dans la combe, elle nous demande de nous espacer d’environ 15m les uns des autres pour que l’on ne soit pas tous emportés.


Infrastructrure du tunnel souterrain du Grand Saint-Bernard,
Un téléphérique rouillait et à l’arrêt depuis des années, comme plusieurs autres dans la région, de nombreux petits domaines skiables mettent la clé sous la porte. Les stations restent en état en raison du coût de démontage qui pose problème.

Juste avant de monter à l’hospice et en redescendant, vous croiserez cette rangée de pylônes d’un téléphérique rouillé qui est à l’arrêt depuis 2010. La station du Super Saint Bernard est pourtant placée à un endroit stratégique, trois vallées se rencontrent, un nœud routier permettant sa déserte.
Nous avons rencontré l’ancien directeur de la station qui est désormais le directeur du Napoléon, l’hôtel restaurant à Bourg-Saint-Pierre. « Pour le paysage, quand on arrive d’Italie par le Col du Grand-Saint -Bernard et qu’on voit ça... »


La Dranse en contre bas, Route du Grand Saint-Bernard,

- NOTRE GUIDE, MARTINE -
« Camarade de votre guide qui restera toujours, non pas humble, mais attentif et respectueux, vous éveillerez en lui un sentiment de reconnaissance qu’il vous témoignera par toutes sortes de soins et de prévenances. Il s’ingéniera à vous rendre les étapes non seulement moins pénibles, mais plus gaies, vous apprenant bien des choses de la vie des gens et des bêtes dans la montagne qui ne seront pas sans valeur. »
- Régamey Frédéric, Une excursion au Grand Saint Bernard : la route - l’hospice , Firmin-Didot éditeurs, 1894
Martine fait partie de la confédération des chanoines. « Ils m’ont proposé de discerner avec eux, alors je discerne, comme ils appellent ça...».
Elle multiplie les allers-retours entre sa première et sa deuxième maison : l’Hospice et sa maison en plaine. « Alors c’est sur quand je suis en plaine, des fois je me dis : Nan mais Martine, reste en plaine ! Oublie ça (l’Hospice ndlr.), pis d’un coup je suis tellement mal que je dois remonter ! C’est comme un appel... C’est vraiment ça... C’est un truc qui vient normalement en fait, c’est comme ont dit je vais devenir médecin ou je vais devenir ingénieur, c’est un truc qui est beaucoup plus fort en fait, c’est intérieur. Ça ne s’explique pas. »
Avant d’intégrer la confédération, Martine avait un autre métier ; « Je suis graphiste, je dessinais les timbres postes pour la Suisse, j’avais un poste incroyable, mais ça ne me correspondait plus, j’ai lâché.»
Nous demandons la date de sa première montée à l’Hospice. « En 2016, pour une période puis euh... Plus longue que prévu. Je suis restée trois semaines la première fois. C’est long là-bas au bout de trois semaines, c’est beaucoup plus intense en plaine où on a ce rythme, boulot, dodo, j’aurais envie de dire, avec des loisirs, avec une semaine à cinq jours...»


pour remonter quoi ». Ainsi que la difficulté à s’approvisionner sur cette longue saison. « Les boîtes (de conserve ndlr.), c’est bien joli mais on en a un peu marre hein. Parce que comme il y a la route en faite, avant de fermer la route, ils font le plein, ils remplissent les caves avec des patates, des carottes, des gros gros sacs, on fait vraiment le plein, les fromages aussi, les gros fromages, des grosses meules. On fait vraiment de grosses réserves, mais après il manque toujours quelque chose.»
Merci Martine
130,150
L’Hospitalet,


Les derniers mètres pour arriver à l’Hospice, Via Francigena,
Bourg-Saint-Bernard, Via Francigena,



« - Et cette montagne qui domine à gauche sombre et nue ?
- Monsieur, c’est le « Mont-Mort ».
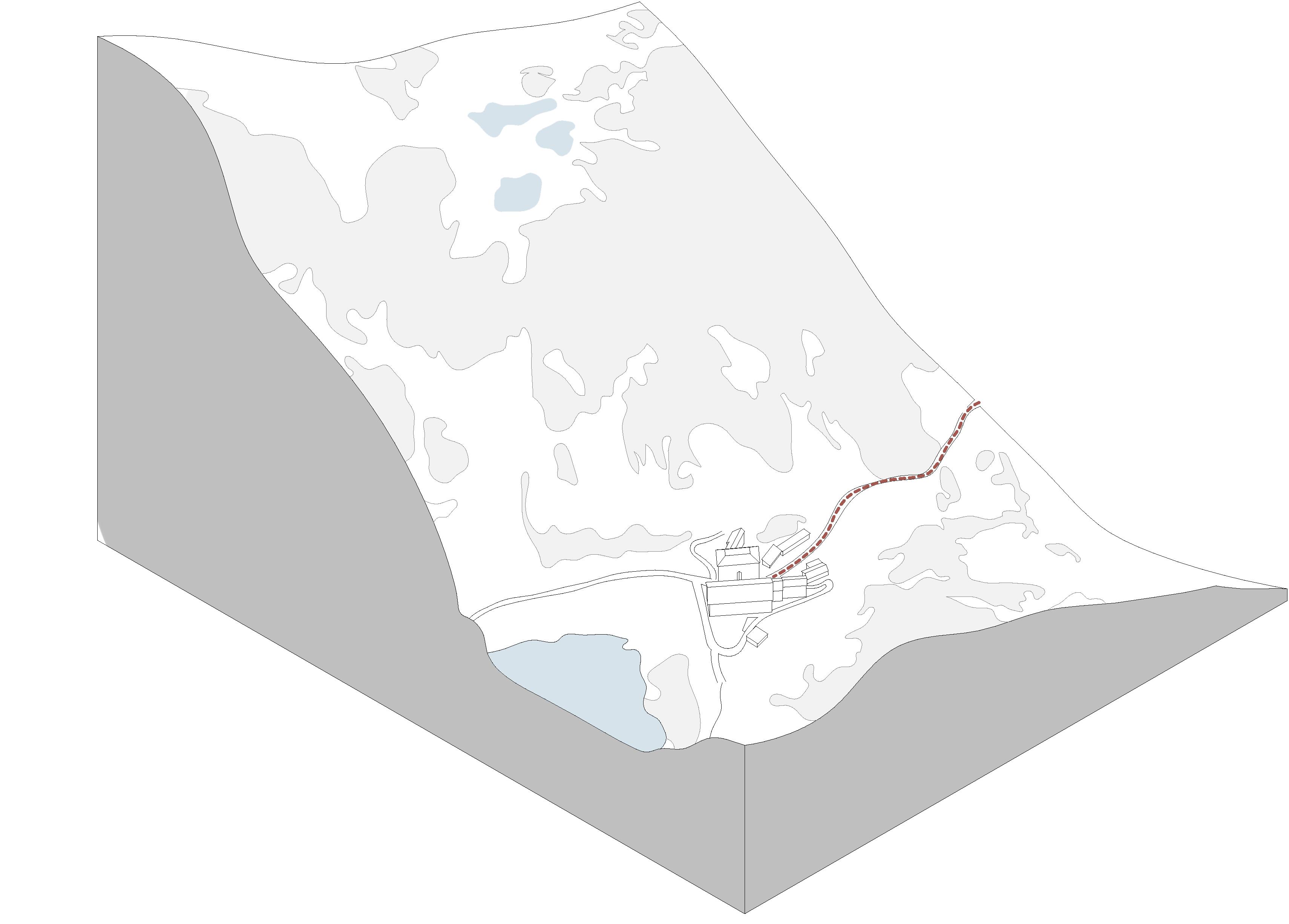
Les derniers gradins sont escaladés. Au pied de l’hospice sur le versant italien, un lac.
- Ça, c’est le lac des morts, Madame.
Il ne me reste plus qu’à s’approcher de ce petit bâtiment de pierre, la « Chapelle des Morts » et à regarder par la porte-fenêtre le caveau où sont rangés une quarantaine de squelettes. »
1894, Frédéric Régamey, Une excursion au Grand Saint Bernard la route - l’hospice, p94

- DAVID JACQUES LOUIS
-
La traversée du col du Grand Saint Bernard par Napoléon et son armée en mai 1800 était une manœuvre stratégique audacieuse pour surprendre l’armée autrichienne en Italie. Ce mouvement a conduit à la victoire française à la bataille de Marengo.
Cette œuvre monumentale représente Napoléon Bonaparte traversant le col du Grand Saint Bernard lors de la campagne d’Italie en mai 1800. Il existe plusieurs versions de cette peinture, mais elles partagent toutes des caractéristiques clés qui en font une image emblématique de l’héroïsme de Napoléon.
Napoléon Bonaparte est représenté sur un cheval cabré, vêtu d’un uniforme militaire flamboyant, avec un manteau rouge vif flottant au vent. Son visage est tourné vers le spectateur, affichant une expression déterminée et sereine. Le cheval est représenté dans une pose dramatique, avec les pattes avant levées, soulignant le mouvement et l’énergie de la scène.
Le fond du tableau montre un paysage montagneux escarpé et enneigé, évoquant les difficultés et les dangers de la traversée du col du Grand Saint Bernard. Les montagnes sont peintes de manière dramatique, avec des lignes anguleuses et des ombres profondes. Sur les rochers, près des sabots du cheval, les noms de Hannibal, Charlemagne et Bonaparte sont gravés, liant Napoléon aux grands conquérants de l’histoire qui ont également traversé les Alpes.
Le drapeau et les couleurs du manteau de Napoléon contrastent fortement avec les tons froids du paysage, attirant l’attention sur lui comme figure centrale.
ci-contre, Bonaparte, premier consul, franchissant le Grand-Saint-Bernard, 1800, huile sur toile, 271 x 232 cm

VIA FRANCIGENA CULTURE CONSTRUCTIVE : L’HOSPICE DU GRAND SAINT BERNARD
Col du Grand-Saint-Bernard, Via Francigena,


- NOTRE EXPÉRIENCE A L’HOSPICE -
Due au fort dénivelé, l’Hospice apparaît d’abord en contreplongée laissant timidement dépasser un bâtiment de faible hauteur. Les derniers mètres sont les plus durs. Notre objectif est là, alors chacun puise ses dernières forces pour donner l’impulsion aux jambes, pour oublier une dernière fois le poids du sac à dos.
Le soleil a réellement sublimé notre lente progression, nous avons été émerveillé par le contraste de la neige et du ciel bleu. L’Hospice se découvre enfin et l’on avait regardé des photos en amont, ce bâtiment nous a saisi. De nombreux skieurs arrivent en même temps que nous, mais l’endroit est silencieux. Seul le glissement des skis sur la neige, la fonte de la neige qui goutte de la toiture dans un rythme régulier, quelques discussions étouffées par les montagnes.
Nous passons tout juste sous la passerelle, puis le panorama des montagnes italiennes nous subjugue. Martine nous présente chacune de celles-ci. En hiver, le lac du Grand-SaintBernard est gelé, le paysage est totalement différent de celui de l’été. Des mètres de neige enfouissent le grand rez -de -chaussée de l’hospice. Nous sommes rentrés à niveau dans le bâtiment alors qu’en été il y a un escalier.
Les gens qui montent en hiver ne sont pas du tout les mêmes qu’en été. « En hiver, on doit fournir un effort important pour monter jusqu’à l’hospice depuis le bas du col. Cela permet d’éteindre l’agitation intérieure. Les passants de l’hiver se comptent par milliers, ils montent le matin et descendent le soir ou bien qu’ils restent plusieurs jours... »
- Chanoine Frédéric
ci-contre : le garage à ski situé sous le niveau de la neige.

« La vie se fait au rythme des montagnes, des humeurs que l’on apprend à respecter. Au sein de ce petit monde se vit une aventure humaine riche, intense, parfois fatigante, mais si intéressante. Et tout son intérêt se résume à une seule chose : vivre ensemble. On n’est jamais seul à l’hospice » - L’intendant de l’hospice, Pascal Catouillard
L’Hospice est un endroit religieux tenu par des chanoines qui vivent sur place. L’Hospice du Grand-Saint-Bernard est l’un des plus anciens et le plus renommé, avec une histoire riche et une tradition d’hospitalité qui perdure depuis presque un millénaire. Les chanoines s’occupent du fonctionnement de l’Hospice, ils assurent les repas, le nettoyage, la laverie des couettes, les réservations et les temps de prières.
Les prières et les repas dictent le rythme des journées, ce sont des horaires précis sur lequel tout le monde est réglée. La première particularité de cette hospice est sa grande église où se tiennent les grandes messes comme celle de Pâques ou encore Noël. Pour les prières quotidiennes, une chapelle plus intime située au premier niveau est utilisée. Les prières ne sont pas obligatoires.
Les repas sont organisés dans deux salles, « Le Poêle » et une autre pièce attenante. Le Poêle est une des pièces les plus anciennes de l’Hospice, c’est ici que les chanoines se sont toujours regroupés pour leurs activités collectives à occuper les longs hivers, ou durant les grosses tempêtes de neige où très peu de visiteurs passent à l’Hospice. A l’époque c’était la seule pièce pour se tenir chaud autour du poêle, alors tout les habitants s’y réunissaient, c’est pour cette raison que la pièce tient son nom, aujourd’hui il n’y a plus de poêle.
ci-contre : notre ticket de bienvenue avec notre numéro de dortoirs et le programme des temps de repas et de prières.
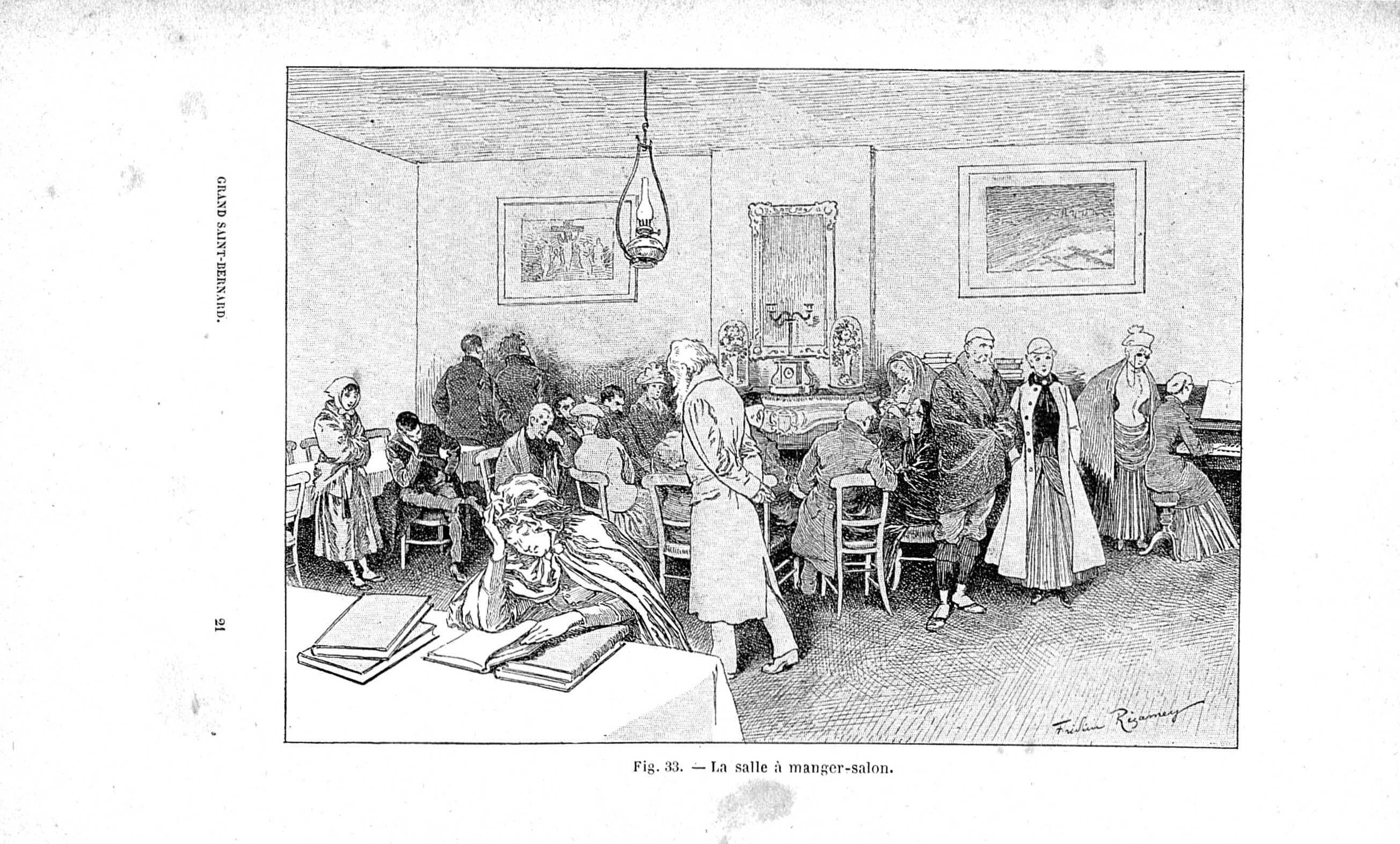

FRÉDÉRIC RÉGAMEY
« Dans la vaste salle à manger, seule pièce où il y ait un peu de chaleur, les voyageurs sont rassemblés. Le temps a marché ; ce sera bientôt l’heure du dîner. En effet, à onze heures et demi la cloche donne le signal du repas. Le dîner, servi lentement, se finit.. Les deux domestiques occupés à desservir puis à remettre la table pour une seconde fournée de voyageurs... Ils jouent aux cartes dans la salle du poêle avec de l’eau-de-vie. Bien que la cheminée soit vide ceux qui restent se groupent, s’assoient en cercle devant les cendres refroidies. »
« Le froid et cette tristesse, c’est plus que peuvent supporter les indifférents. Ils se glissent les uns après les autres et regagnent la salle à manger où, au moins, il fait presque chaud. De nouveaux voyageurs qui viennent d’arriver ont pris les places devant le feu. Ils racontent que, du côté de l’Italie, à une heure seulement plus bas il fait un soleil radieux, à peine un peu de vent. On s’exclame un moment, puis la même vie monotone reprend son cours. »
1894, Frédéric Régamey, Une excursion au Grand Saint Bernard la route - l’hospice, p94 -
à gauche, La salle à manger-salon, 1894, Gravure , 21x30 cm à droite, L’Église, 1894, Gravure , 21x30 cm

- SIR EDWIN LANDSEER -
Sir Edwin Landseer (1802-1873) était un peintre britannique célèbre pour ses représentations de scènes animalières et de portraits. Sa maîtrise remarquable de l’art animalier lui a valu une renommée internationale, et il était particulièrement habile à capturer l’expression et le caractère des animaux dans ses œuvres. Bien que l’œuvre de Landseer soit principalement axée sur les animaux, il a également réalisé des œuvres traitant de sujets humains, souvent avec une touche narrative et émotionnelle profonde.
Imaginez une scène basée sur le style et les thèmes de Sir Edwin Landseer : Deux hommes se promènent dans un paysage pittoresque, peut-être une lande écossaise ou une forêt dense. Ils découvrent un homme blessé, allongé au sol, entouré de la beauté sauvage de la nature. L’homme blessé semble vulnérable, mais il est entouré de la quiétude de son environnement, où les ombres et la lumière jouent sur la scène, créant une atmosphère à la fois dramatique et paisible.
Les hommes, habillés dans des vêtements d’époque, regardent avec préoccupation l’homme blessé, évoquant un sentiment de compassion et de réflexion profonde. Le paysage autour d’eux, peint avec les couleurs riches et les détails minutieux typiques de Landseer, renforce l’émotion de la scène et accentue la beauté naturelle qui contraste avec la douleur humaine.
Cette scène, inspirée par le style et l’approche artistique de Sir Edwin Landseer, illustre non seulement sa maîtrise technique mais aussi sa capacité à capturer l’essence même de la vie sauvage et humaine à travers l’art. Landseer était connu pour sa capacité à transcender la simple représentation visuelle pour exprimer des émotions complexes et des récits poignants à travers ses peintures, faisant de lui l’un des artistes les plus appréciés de son temps.
Deux hommes trouvant une homme blessé 1820, huile sur toile, 40 x 61 cm

- LE SAINT BERNARD -
Les premiers chiens ont été amenés à l’hospice au XVIIe siècle. On pense qu’ils descendent de mastiffs asiatiques, introduits en Europe par les Romains et croisés avec des races locales pour s’adapter aux conditions montagnardes. Le nom «Saint Bernard» est associé à l’hospice du Grand Saint Bernard, où ces chiens étaient élevés. Ils sont grands, robustes, avec un pelage épais adapté aux conditions hivernales rigoureuses.
Les chiens Saint Bernard étaient spécialement entraînés pour rechercher et secourir des personnes perdues ou ensevelies dans la neige. Leur puissant odorat et leur endurance en faisaient des sauveteurs naturels. Ils étaient souvent envoyés en patrouille par petits groupes, capables de retrouver des personnes ensevelies sous plusieurs mètres de neige. Lorsqu’ils trouvaient une personne ensevelie, les chiens creusaient pour dégager la victime et aboyaient pour alerter les moines ou d’autres membres de l’équipe de secours.
Aujourd’hui, les chiens Saint Bernard de l’hospice ne sont plus utilisés pour les sauvetages en raison des avancées technologiques dans les techniques de sauvetage en montagne. Néanmoins, ils restent des symboles vivants de l’histoire de l’hospice et de la bravoure de ces animaux.
Les chiens Saint Bernard incarnent l’esprit de secours et de bienveillance des moines de l’hospice du Grand Saint Bernard. Leur histoire illustre le courage et la dévotion nécessaire pour sauver des vies dans des conditions extrêmes. Ils sont devenus des emblèmes culturels, représentant la fidélité, le dévouement et le service à l’humanité.
ci-contre :
Saint-Bernard de l’Hospice du Grand Saint-Bernard, 1880, gravure, 28 x 35 cm

- BARRY -
Barry, un des chiens Saint Bernard les plus célèbres, a vécu au début du XIXe siècle à l’hospice du Grand Saint Bernard. Il est devenu légendaire pour ses nombreux sauvetages de voyageurs et de pèlerins perdus ou ensevelis dans la neige. Son histoire est emblématique de la bravoure et de la loyauté des chiens Saint Bernard. Barry a servi à l’hospice pendant environ 12 ans. Durant cette période, il a sauvé la vie de plus de 40 personnes. Grâce à son odorat exceptionnel, sa force et son endurance, il était capable de retrouver des personnes ensevelies sous la neige et de les dégager.
Une des histoires les plus célèbres de Barry raconte comment il a sauvé un enfant perdu dans une tempête de neige. Barry a trouvé l’enfant, l’a léché pour le réchauffer et l’a incité à s’agripper à son dos. Il a ensuite ramené l’enfant en sécurité à l’hospice. Ce sauvetage a particulièrement marqué les esprits et a contribué à la renommée de Barry.
Barry a été retiré de ses missions de sauvetage après une douzaine d’années de service, une durée exceptionnellement longue pour un chien de travail. Il a passé ses dernières années à Berne, en Suisse, où il est mort en 1814.
ci-contre : l’enfant sur le dos de Barry, 1880, gravure, 28 x 35 cm
P201 VFCC01 : LES MURS DE LAVAUX
P227 VFCC02 : LE VERNACULAIRE INDUSTRIEL
P253 VFCC03 : LES MOULINS DE LIDDES
P301 VFCC04 : L’HOSPITALITÉ AU COL DU GRAND SAINT BERNARD
VFCC : VIA FRANCIGENA CULTURE CONSTRUTIVE
Une grande partie de l’étape de la VFS05 vous emmène à travers les vignes de Lavaux, également appelés les terrasses de Lavaux. Le chemin serpente sur les terrains accidentés des vignes. Selon la saison, vous observerez les nombreux acteurs qui permettent d’inscrire ce site au patrimoine de l’UNESCO.
De nombreux promeneurs, les habitants des villages alentours, les vignerons qui travaillent méticuleusement les vignes tout au long de l’année. En hiver, il taille leur vignes, décompacte le sol et l’engraisse. Au printemps, il arque les baguettes pour que la sève circule jusqu’aux bourgeons. Le printemps est là, le viticulteur élimine les mauvaises herbes à chaque pied de vigne. Au début de l’été, les raisins commencent à se former, c’est un moment important car la qualité du vin dépend des conditions climatiques. Au milieu de l’été, le viticulteur et son équipe installent des fils pour guider les branches des vignes vers le haut. La période de véraison permet au raisin de mûrir jusqu’au début de l’automne. L’automne marque les vendanges, une période intensive de récoltes et de fêtes. Il s’agit de la première étape de la vinification.
La réputation du vin des terrasses de Lavaux et la vue imprenable sur les Alpes en font une étape incontournable. Mais ce patrimoine perché sur ses terrasses très en pente nécessite un entretien acharné. Que seraient les vignes de Lavaux sans leurs murs de pierres ? Les 450 kilomètres de murs sont façonnés par la main de l’homme, ils soutiennent 10 000 terrasses. Nous vous proposons une analyse de ces murs si particulière.
GLOSSAIRE P223


- LA CONSTRUCTION DES MURS -
Le patchwork de murs de soutènement et de chemins de dessertes constitue une configuration territoriale typique de Lavaux qui remonte au Moyen-Âge, les murs sont cependant difficiles à dater. Sur un terrain aussi escarpé, dont l’aménagement a débuté au XIIe siècle avec l’émergence des domaines viticoles monastiques, la construction de ces murs répondait principalement à une nécessité pratique immédiate. Elle représentait une forme d’architecture spontanée et traditionnelle, dont les traces étaient discrètes au cours des premiers siècles. De plus, la fonction de soutènement était souvent difficile à distinguer de celle de limite de propriété.
L’histoire remonte à l’époque romaine, lorsque les premières vignes ont été plantées sur des pentes escarpées. Cependant, c’est au Moyen-Âge, entre le XIè et le XIVè siècle, que les terrasses ont pris leur forme actuelle. À cette époque les moines bénédictins et cisterciens ont commencé à cultiver des vignes dans la région utilisant des techniques de terrassement ingénieuses pour maximiser l’espace disponible et exploiter le potentiel viticole des collines de Lavaux.
Les moines ont construit des murs de soutènement en pierre le long des pentes, créant ainsi des terrasses en gradins qui permettaient de planter et de cultiver les vignes. Ces murs ont été construits à la main, pierre par pierre, et leur construction a exigé une expertise acharnée. Des escaliers et des sentiers ont également été aménagés pour faciliter l’accès aux vignobles, ce qui a contribué à l’essor de la viticulture dans la région.
page précédente : Vendange à Lavaux, 1808, François Aimé Louis Dumoulin
ci-contre : Lavaux, premier printemps, 1942 huile sur toile 81 x 65 cm. Steven Paul Robert

- LES MURS DE PIERRES -
Les murs de pierre des vignes de Lavaux sont un témoignage vivant du savoir-faire traditionnel des artisans locaux et de l’histoire viticole de la région. Leur conservation et leur entretien sont essentiels pour conserver le patrimoine et la production viticole. C’est pour cela que les terrasses de Lavaux sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2007.
Bien que ces murs aient résisté à l’épreuve du temps, ils sont aujourd’hui confrontés à l’érosion, au vieillissement et au manque d’entretien. La restauration et la préservation de ces structures exigent donc une attention particulière pour assurer leur pérennité et maintenir l’intégrité du paysage de Lavaux.
Les murs sont construits à la main en utilisant les pierres locales, principalement calcaire extraite des carrières avoisinantes.
Ces murs servent à soutenir les terrasses de vignes en pente créant ainsi des niveaux de culture sur les collines abruptes de Lavaux. Ils permettent de protéger les vignes des vents forts et des érosions du sol tout en favorisant un microclimat propice à la culture de la vigne.
L’épaisseur du mur varie selon la hauteur de l’ouvrage, l’épaisseur représente généralement 1/3 de la hauteur. On nomme les deux faces «mur extérieur» et «mur intérieur», ce dernier est entièrement en terre. Les murs sont également une délimitation des propriétés viticoles.
ci-contre : coupe sur un mur de vigne production personnelle
- COMBATTRE L’ÉROSION -
Les 450 kilomètres de murs de vigne de Lavaux se distinguent comme l’un des traits les plus remarquables de ce paysage. Il est donc primordial d’exprimer notre gratitude et apporter un soutien sans faille au travail colossal des artisans qui, depuis des siècles, veillent à l’entretien des 10 000 terrasses qui confèrent à ce lieu son caractère exceptionnel.
ÉVALUER LES MURS À RÉNOVER
Il convient de démonter et de reconstruire le mur avant qu’il ne s’effondre. L’analyse des murs se fait à l’œil. Un mur en mauvais état se voit, on peut par exemple observer un déformement, ce que l’on appelle souvent un « ventre ».
C’est-à-dire que des pierres inférieures commencent à sortir de l’alignement des pierres supérieures. Après un grand orage également, des pièces peuvent s’effriter. Ce sont les pluies incessantes et par la suite le gel qui fragilise les murs.
De nombreuses reconnaissances sont organisées afin de prédire le temps restant avant la restauration d’un mur. Les travaux ont ensuite lieu de fin Octobre à fin Mars pour obtenir une meilleure prise du ciment.
Comme un dicton disait « Mur d’hiver, mur de fer ».

DÉMONTER LE MUR
Toutes les pierres sont mises de côté afin de pouvoir les réutiliser. Ils démontent le mur par étape en faisant des tas selon la localisation des pierres afin de pouvoir les replacer facilement à leur place. Une fois les pierres retirées, les maçons peuvent accéder aux fondations. Ils les protègent d’une bâche pour que la pluie ne ruisselle pas sur la terre. Un tuyau de drainage est posé pour évacuer l’eau vers une coulée.
Pour éviter que la terre s’effondre le temps des travaux, un biais est donné à la terre. La terre est stockée plus bas pour être remise par la suite.
MAINTENIR L’ÉTANCHÉITÉ
Le mur doit être protégé de la pluie afin d’éviter que l’eau puisse rentrer à l’intérieur. Cela abîme prématurément le mortier, l’eau peut également geler et provoquer des fissures. Le mur assure son étanchéité par la pierre couverte située au sommet du mur, elle distribue les eaux vers l’extérieur de la maçonnerie.


L’étanchéité verticale est assurée par l’enduit. Un relevé d’étanchéité est fait du côté intérieur du mur, pour que l’eau stagnante ne s’infiltre pas. L’eau est absorbée par la terre puis drainée par de petites pierres récupérées sur place. Enfin, l’eau est évacuée par les barbacanes.
Les vignes constituent un véritable réseau, les eaux ruissellent vers les coulées et les tranchées descendent vers le Léman.
Les murs extérieurs sont recouverts de chaux comme l’enduit des façades des maisons que l’on peut trouver dans les différents villages. La chaux assure une liaison naturelle avec les pierres et le patrimoine des villages.
LA PIERRE COUVERTE
La pierre couverte, au sommet, assure l’étanchéité.
C’est une couvertine. Il faut s’assurer qu’elle n’est pas gélive. Cette pierre est la plus difficile à placer car elle doit être plate. Un travail de calcul de longueur de pierre et d’épaisseur de mortier est fait avant de construire afin d’avoir une finition droite.
Les pierres couvertes sont rares, elles viennent parfois des carrières de Villeneuve.
1 4 2 3
Situé sur le mur intérieur, le relevé d’étanchéité fait barrière à l’eau stagnante au bas de la pente des récoltes. Le maçon enduit avec le crépis sur 50 à 60 centimètres de haut.
PIERRES DRAINANTES
Les plus petites pierres calcaires trouvées sur place sont disposées le long du mur, elles filtrent l’eau de pluie accumulée. Le terrain reste plus stable.
Ce sont de petites ouvertures laissées dans le mur pour permettre à l’eau de s’écouler vers le mur extérieur. Il n’y a pas de tuyau, ce sont des écartements de pierres recouverts légèrement de crépis pour limiter l’infiltration en partie inférieure.
LA BARBACANE
RECONSTRUITE LE MUR
Après avoir nettoyé les pierres, les maçons les positionnent de façon harmonieuse en alternant petites et grandes pierres pour avoir un mur hétérogène. Les pierres sont assemblés par un mortier en grande partie de chaux, de sables des carrières voisines et d’une très petite quantité pour assurer une bonne durabilité de la maçonnerie. Il applique le mortier à la truelle en le projetant sur le mur.
Parfois l’opération de reconstruction est périlleuse due à la grande hauteur de certains murs retenant une pente très escarpée. Les ouvriers installent des pontenages, une sorte d’échafaudage pour accéder aux niveaux supérieurs.
La dernière rangée doit être alignée. Ils s’aident d’une ficelle pour marquer la ligne haute du mur, cela permet d’avoir une finition à niveau. Les dernières pierres sont les plus difficiles à placer, les maçons doivent trouver des petites roches pour mettre à niveau la pierre couverte et les placer en dessous. Par la suite, le maçon recouvre de mortier pour combler les vides sur le mur intérieur. Il mettra par la suite du crépi pour faire le relevé d’étanchéité.


disposition de petites pierres pour stabiliser les grosses pierres application du mortier en partie supérieur du mur pour assurer l’étanchéité


- HABITER LES VIGNES -

LES MAISONS VIGNERONNES
Les maisons des villages vignerons sont étroites et contiguës, construites de la sorte pour laisser le plus d’espace possible pour la vigne. L’habitat vigneron est basé sur le principe de la superposition des locaux, construits en hauteur. Le rez-dechaussée accueille le pressoir et la cave.
Les premiers et deuxièmes étages sont les lieux d’habitations. Le deuxième étage était souvent utilisé pour la main d’œuvre saisonnière. Jusqu’en 1950, le dernier étage sous les toits étaient systématiquement utilisé comme galetas où l’on déposait des outils, des ceps, des échalas en bois etc. Un système permettait de monter les différents matériaux depuis la rue à l’aide d’une simple corde reliée à une poulie, car les escaliers des maisons vigneronnes sont trop étroits.
ci-contre : Vue du Lavaux depuis la corniche, 2022, huile sur toile 41 x 65 cm.
Alain Duplain

De nombreuses maisons sont adossées le long des murs de soutènement. Ces maisons permettent un renforcement des murs agissant comme un véritable contrefort. Elles forment une protection des murs fragiles.
Elles sont monorientées vers le lac et donc exposées au sud. Les habitations profitent de la fraîcheur de la terre pour s’autoréguler.
Comme les traditionnelles maisons des terrasses, elles sont étroites. Les volumes s’adaptent aux vignes, les hauteurs sont réglées en fonction des murs. Les maisons sont parfois éparpillés en plusieurs morceaux pour se glisser sur le dénivelé.



D’autres maisons sont au contraire en retrait du mur. L’orientation de la maison est alors étudiée afin de ne pas faire ombre sur les domaines.
Elles profitent d’une avancée ou d’un terrain défavorable pour la culture viticole pour s’installer. Leurs positionnements sont favorables au vent. De grandes ouvertures à l’Ouest et à l’Est permettent d’aérer et de faire circuler l’air.
Un jardin arboré au sud ombrage la façade largement exposée au soleil.
Enfin, l’emplacement des bâtisses offrent un panorama vertigineux sur le Léman.

Un autre type de maison que nous avons observé sur le chemin est une variante hybride des maisons troglodytes.
C’est un cas très spécifique observé à proximité de Puidoux le long de la Route Cantonale. Ce n’est pas une habitation mais une cave à vin.
Le grand volume principal s’intègre dans le paysage, le vignoble s’étale sur la toiture comme une toiture végétalisée. Cependant la maintenance de la vigne ainsi que la qualité de la terre interrogent. L’irrigation du terrain est plus compliquée à maîtriser.

Enfin le dernier type de bâtiment relevé sur le domaine de Lavaux, ce sont les capites. Ce sont de petites constructions qui servaient autrefois de remise à outils. Elles servaient également d’abris temporaires aux ouvriers de la vigne.
Leur petite taille limite le nombre des convives et confère à ces maisonnettes une charge affective importante faite d’intimité et de privilège, qui relie au terroir et au travail particulier de la vigne.
Elles sont aujourd’hui utilisées pour accueillir des clients privilégiés et connaisseurs de vins.


LES MURS ET LES VIGNES
BARBACANE
Ouverture horizontale étroite avec une légère pente dans la maçonnerie d’un ouvrage pour faciliter l’écoulement des eaux d’infiltration.
BARRIQUE
Fût de chêne, sert au stockage et à l’élevage du vin après la fermentation.
CHAUX
Substance utilisée dans la construction pour faire des mortiers, des enduits et du ciment.
CÉPAGE
Variété de vigne cultivée possédant des caractéristiques distinctes, telles que la forme et la taille des grappes et des baies, la couleur de la peau du raisin, ainsi que les arômes et les saveurs qu’il peut apporter au vin.
CHAI
Lieu d’entreposage où se déroule la vinification depuis les vendanges jusqu’à la mise en bouteilles des vins et des eaux-de-vie.
COULÉE
Petite vallée ou une pente douce favorable à la culture de la vigne, offrant des conditions optimales de drainage et d’exposition au soleil.
CRÉPI
Enduit de mortier appliqué sur une surface pour la protéger et lui donner un aspect esthétique. Le crépi est souvent utilisé sur les murs extérieurs des bâtiments, mais il peut aussi être appliqué à l’intérieur.
CEPS
Partie ligneuse de la plante de vigne qui est plantée dans le sol et à partir de laquelle les raisins poussent. Le cep de vigne est composé de plusieurs parties, y compris les racines, le tronc et les sarments.
CULTURE EN TERRASSE
Cultures pratiquées sur des terrains en pente découpés en paliers juxtaposés, limités par des murets de pierres sèches ou maçonnées.
DOMAINE VITICOLE
Territoire de production du vin, constitué de vignes et d’infrastructures permettant d’élaborer et transformer le raisin en bouteille.
ENDUIT
Couche de matériau appliquée sur une surface, généralement pour la protéger, la lisser ou pour des raisons esthétiques.
ÉCHALAS
Tuteur, généralement en bois, utilisé pour soutenir un jeune arbre ou une plante pendant sa croissance. Le terme est souvent utilisé dans le contexte de l’arboriculture fruitière.
ÉROSION
Lente détérioration du relief causé par un agent externe comme le climat, le relief, des facteurs écologiques, des actions humaines etc.
FRUIT
Inclinaison donnée à un ouvrage pour assurer une meilleure stabilité. Dans le cadre des vignes, le fruit donné au mur de soutènement permet de constituer un contrefort pour supporter le poids de la terre.
GALETAS
Logement ou une pièce située sous les toits d’un bâtiment, souvent caractérisé par des conditions de vie modestes et des aménagements rudimentaires.
MORTIER
Mélange de liant formant une pâte adhésive utilisée pour lier et sceller des unités de construction comme des briques, des blocs de béton, des pierres etc.
MICROCLIMAT
Conditions météorologiques spécifiques qui prévalent dans une petite zone, souvent à l’échelle locale et influencées par des facteurs topographiques, géographiques et environnementaux particuliers..
MUR DE SOUTÈNEMENT
Structure construite le long d’un terrain incliné ou en pente pour résister à la pression des terres et maintenir le sol en place. Il est conçu pour retenir le sol derrière lui et éviter les mouvements de terrain, l’érosion ou l’affaissement.
VITICULTURE
Ensemble des techniques agricoles et des pratiques de gestion appliquées à la culture des vignes, principalement en vue de produire des raisins destinés à la fabrication de vin.
Le chemin traverse la vallée du Rhône, dans un premier temps le long des villages à l’Ouest puis vous mettez le cap à l’est en coupant la vallée. Un pont vous permet de traverser le Rhône.
La vallée du Rhône tient son nom du fleuve qui traverse la plaine. Auparavant ligne de rupture du fait de la présence de terrains marécageux difficilement franchissables, le Rhône construisait aussi une frontière entre rive droite ensoleillée et rive gauche à l’ombre. Elle sépare d’ailleurs encore aujourd’hui deux cantons : le Vaud et le Valais.
Son axe vers l’Italie et la Suisse orientale fait de la vallée un lieu privilégié pour l’implantation des activités industrielles et commerciales. La pression exercée par les activités humaines compromet ses valeurs esthétiques et écologiques.
Le Rhône semble avoir été le maître de la planification de cette vallée. Le Rhône au centre, l’activité économique, menée par les secteurs de l’industrie et l’agriculture, de part et d’autres du fleuve.
Alors que de nombreuses villes sont traversées par des fleuves, le Rhône donne l’impression de repousser les villages en pied de montagnes.
GLOSSAIRE P249
Les grands bouleversements du Rhône commencent avec ses origines glaciaires. Pendant les périodes glaciaires, les glaciers ont sculpté la vallée, laissant derrière eux un paysage caractérisé par des moraines et des vallées en forme de cuvette. Au fur et à mesure que les glaciers se retirent, ils libèrent de vastes quantités d’eau, alimentant le fleuve et modelant son cours. En amont du lac Léman, le Rhône parcourt près de 170 kilomètres et reçoit les eaux d’environ deux cents torrents (vaudois et valaisans).
Pendant la période de domination française, le canton de Vaud est formé en 1803. Le canton du Valais intègre la Confédération en 1815. Ces changements politiques ont pour conséquence une volonté de développer le Valais, notamment par un renforcement de l’agriculture. Ainsi, des routes sont tracées et des ponts construits à travers le canton. En 1850, une ligne de chemin de fer est construite pour relier le lac Léman et Sion. La protection de la vallée du Rhône contre les crues du fleuve est donc de plus en plus envisagée.
En 1860, des inondations ont provoqué la destruction des récoltes mais aussi celle de plusieurs villages. Les habitants de la vallée du Rhône tentent de se protéger contre les inondations. La vallée du Rhône, incite à entreprendre la première correction du fleuve entre 1863 et 1894. Cependant, leurs moyens étant restreints, les travaux ne se limitent qu’aux périmètres des commues et sont réalisés sans grande coordination.
Une deuxième correction est réalisée entre 1930 et 1960. Le lit est resserré et le tracé est tendu avec de longues lignes droites et des virages à grand rayon de courbure. Les berges sont constituées de digues de protection. Ces modifications ont favorisé le dessèchement de plusieurs marais, le défrichement de grandes surfaces et ainsi a permis de procurer à la population de la terre arable.
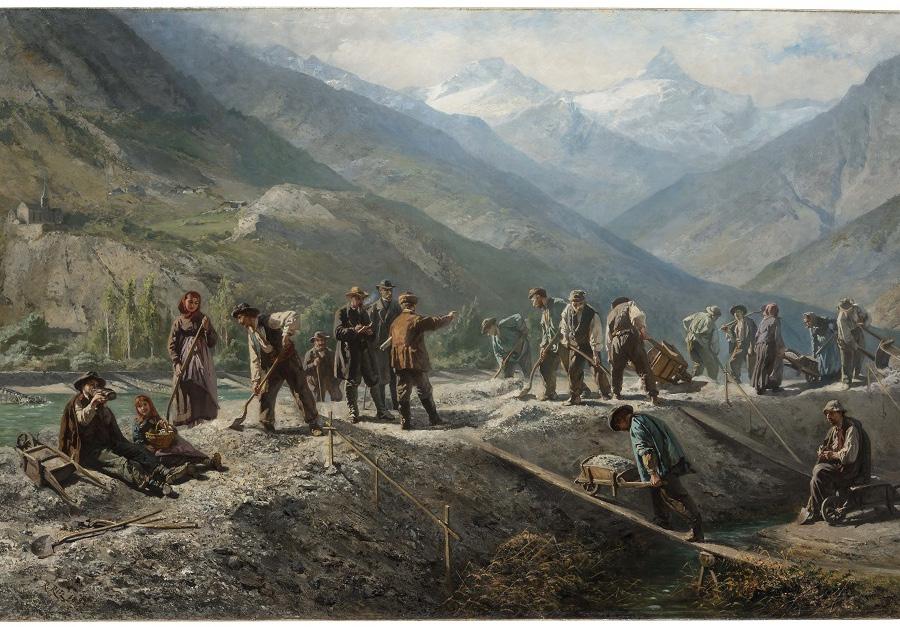
- RAPHAEL RITZ -
Le tableau se veut être une représentation fantasmée du travail colossal effectué pour l’endiguement de la centaine de kilomètres du glacier du Rhône au Léman. Des travaux qui n’auront pas domptés le Rhône.
Ce tableau, peint vers la fin du XIXe siècle, capture un moment crucial dans l’histoire de la région du Valais : les travaux de correction du Rhône. Ces travaux, entrepris pour maîtriser les crues dévastatrices du fleuve, ont profondément transformé le paysage et la vie des habitants.
Le tableau de Raphael Ritz montre une scène animée de travaux de génie civil. Au premier plan, des ouvriers sont occupés à creuser et à construire des digues. Leur travail acharné et leur concentration sont palpables, reflétant la dureté des conditions et l’importance de la tâche. Les pelles, les pioches et autres outils sont peints avec un souci du détail qui témoigne de la précision et du réalisme de l’artiste.
À l’arrière-plan, on aperçoit le Rhône lui-même, serpentant à travers la vallée. Le fleuve, autrefois sauvage et imprévisible, est représenté ici comme un géant dompté par l’effort humain. Les montagnes majestueuses, typiques du paysage valaisan, se dressent à l’horizon, encadrant la scène et ajoutant une dimension de grandeur et de permanence.
La « Correction du Rhône » représente non seulement un exploit d’ingénierie mais aussi un symbole de la lutte humaine contre les forces de la nature. Pour les habitants du Valais, ce projet a marqué le début d’une nouvelle ère de sécurité et de prospérité, permettant une agriculture plus stable et un développement économique accru. Le tableau est un témoignage visuel de l’interaction entre l’homme et la nature, un rappel du pouvoir de la collaboration et de l’ingéniosité humaine face aux défis environnementaux.
Aujourd’hui, «La correction du Rhône» de Raphael Ritz est plus qu’une simple représentation d’un événement historique; c’est un hommage visuel à un moment décisif de l’histoire
du Valais. Il continue d’inspirer et d’éduquer, rappelant l’importance des efforts collectifs pour façonner et protéger notre environnement.
En conclusion, le tableau de Raphael Ritz sur la correction du Rhône est une œuvre d’art riche en détails et en émotions, capturant un chapitre essentiel de l’histoire du Valais avec une profondeur et une beauté qui résonnent encore aujourd’hui.
Correction du Rhône, 1888, huile sur toile, 88,5 x 137,5 cm
- LES CRUES DÉVASTATRICES -





















































































































































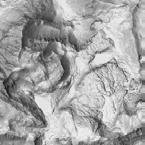





















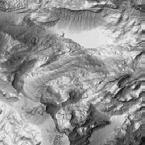












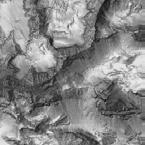








FRANCE
MARTIGNY




Le Rhône a fait l’objet de nombreux aménagements visant à maîtriser son cours et à atténuer les effets néfastes de ses crues. L’un des aménagements les plus répandus sur le Rhône est la construction de barrages hydroélectriques au XXe siècle. Ces infrastructures ont non seulement permis de contrôler les crues, mais aussi de produire une énergie renouvelable essentielle pour le pays.
En septembre 2000, le Grand Conseil valaisan décide de lancer la troisième correction du Rhône, de Gletsch au Léman, en collaboration avec le Canton de Vaud. En 2008, la Confédération Suisse annonce la levée de fonds pour cette troisième correction, dont les travaux devraient durer entre 25 et 30 ans.
La solution retenue combine le renforcement des digues avec l’abaissement du fond et l’élargissement. La taille de l’élargissement est basée sur le besoin sécuritaire. Il varie de secteur en secteur et correspond environ à 50 % de la largeur actuelle, ce qui permet d’évacuer 50 % de débit supplémentaire et atteindre le niveau de sécurité fixé. Des élargissements ponctuels d’une largeur de deux à trois fois la largeur actuelle sont également prévus.
Cependant, ces interventions humaines ont aussi eu des conséquences écologiques. La régulation du fleuve et la construction de barrages ont perturbé les écosystèmes locaux, affectant la faune et la flore aquatiques.
Plus de 11 000 hectares de terres sont aujourd’hui menacés d’inondation dans la plaine du Rhône en Valais, et les dégâts potentiels cumulés dépassent les dix milliards de francs suisse. Cela n’empêche pas la vallée du Rhône d’être une région dynamique où l’agriculture, notamment la viticulture, et le tourisme jouent des rôles essentiels. Les vignobles en terrasses, typiques de cette vallée, profitent des sols riches et bien drainés, héritage des bouleversements passés du Rhône.
- L’ACTIVITÉ DES SOLS -


- LA PRODUCTION DU RHÔNE -
La maîtrise progressive du fleuve a participé à façonner un espace caractérisé par de grandes potentialités agronomiques désormais exploitable. La plaine du Rhône constitue le seul espace accessible et desservi par divers moyens de transport, une plaine étroite dont la largeur n’excède pas 8 km de large.

L’AGRICULTURE
Favorisée par le climat et par des terres riches en minéraux, la plaine est exploitée pour la production agricole. On y retrouve de nouveau la viticulture perchée sur les flancs de montagnes profitant d’une exposition favorable. Parmi les cépages, on y retrouve du vin rouge et du vin blanc.
De nombreux vergers cultivent des poires, des pommes, des abricots et des prunes. L’eau souterraine permet aux fruitiers de ne pas manquer

d’eau malgré le climat sec. Les sols fertiles favorisent la production de légumes principalement sous les serres. Tomates, salades, courgettes et poivrons sont les plus courants. Il y a aussi les fleurs et les plantes qui sont cultivées sous serre.
De nombreuses fermes élèvent des bovins pour produire du lait et de la viande. Elle associe leur production bovine à la culture de céréales comme le blé, le maïs et l’orge. Aussi la production de fourrage pour le bétail.
LES CARRIÈRES
Ici la carrière d’Arvel extrait et concasse le calcaire siliceux pour la production du ballast de chemin de fer, du sable et du gravillon. Pour les roches dures comme le calcaire, des trous sont forés et des explosifs sont utilisés pour fragmenter la roche. Des machines comme des bulldozers sont utilisées pour retirer les matériaux. Les matériaux sont ensuite transportés vers les installations de traitement. Soit par train, par voie routière et par le Rhône. Des systèmes d’arrosage et d’enclosure sont utilisés pour limiter la poussière et le bruit. Le site est par la suite reboiser pour limiter la destruction du paysage. Les matériaux sont stockés en tas ou en silos sur le site. Ils sont vendus aux entreprises de construction. Une station de stockage à l’embouchure du Rhône est placée stratégiquement pour charger des barges. Elles naviguent ensuite sur le lac Léman pour fournir les sites industriels lémaniques.

LE BARRAGE
Entre Villeneuve et Martigny, il y a des barrages hydrauliques sur le Rhône. Cette section du Rhône est exploitée pour la production hydroélectrique, et plusieurs installations permettent de gérer le débit et de produire de l’électricité.
L’exploitation du Rhône a tardé à être mise en place, notamment due au caractère capricieux du fleuve. Également le fait que l’État cantonal n’avait pas les ressources financières pour investir dans ce secteur.

C’est le seul barrage présent dans le secteur du Rhône suisse. Mis en service en 1902, le barrage est amélioré d’année en année afin de s’inscrire dans le plan environnemental de la vallée du Rhône.
Ce barrage et son usine produisent près de la moitié des besoins en électricité des services industriels de la plaine.
LA RAFFINERIE
Le long du Rhône, une raffinerie de pétrole est construite sur le territoire Suisse pour des sociétés italiennes. Le pétrole est livré brut à travers l’oléoduc depuis le port de Gênes à travers l’oléoduc de Gênes, une pipeline traverse les Alpes. Les produits finis sont ensuite livrés par train et par camionciterne. La raffinerie produisait de l’essence sans plomb 95, du kérosène, du gazole, du fioul et du gaz liquide.
La raffinerie a permis d’alimenter de nombreuses centrales thermiques
situées dans la plaine. Les unités de traitement et production d’énergie s’étendent sur 80 hectares. Des incidents techniques sont survenus sur le site de la raffinerie. Des centaines de litres d’essences ont été déversés durant deux jours. Le Rhône et les nappes phréatiques environnantes ont été pollués. Les autorités cantonales ont mis fin aux activités de la raffinerie.
Les travaux de démolition ont débuté, et la raffinerie est peu à peu démantelée.

LES MAISONS VACATAIRES
Conscients des risques de crues liée au Rhône, les habitants de la vallée ont construit des maisons vacataires. Nombreuses ont été bâties selon le modèle illustré ci-dessus. Le bétail est abrité au rez de chaussée, le foin est stocké à l’étage. Un petit logement sommaire avec un lit et un fourneau permettait d’occuper le logement de Juin à Septembre le temps des récoltes. Le reste de l’année, la maison est inoccupée.
C’est une sorte de consortage, la maison est une copropriété où se regroupent des usagers pour l’exploitation des terres.

LES MAISONS INDIVIDUELLES
La partie centrale de la vallée constitue un espace économique, dynamique maîtrisé par le fleuve. La vallée du Rhône se caractérise par un climat particulier, plus chaud et sec que dans les régions avoisinantes. Le vent est fort, sec et chaud : c’est l’effet de Foehn. Les maisons individuelles ne sont pas nombreuses et sont très souvent associées à une activité agricole. Il y a un bâtiment d’habitation. Plusieurs bâtiments de stockage, des silos, des hangars,
aussi des abris pour le bétail. Beaucoup de maisons sont organisées en consortage. Malgré le risque face au débordement du fleuve, des habitations sont habitées à l’année. L’architecture ne s’adapte pas aux risques et au climat. Elle ne présente pas de spécificités pour répondre à ses risques. Le rez de chaussée semble être occupé par un garage, ou stockage alimentaire, cave. Les maisons se situent le long d’une route pour rejoindre les villes et ne pas être totalement isolé.
La question de l’architecture vernaculaire en Valais est en manque d’interprétation. L’architecture vernaculaire n’a pas réellement trouvé sa place dans la vallée. De nombreux villages ont disparu. L’histoire de la colonisation des Alpes s’inscrit dans le vieux clivage entre l’urbanité et la ruralité. Avant même d’être désignée comme «alpine» ou simplement «montagnarde», cette colonisation représentait surtout l’instauration d’une exploitation spécifique des terres, partagée avec les régions de plaine. Le clivage initial entre ville et campagne trouve ses racines dans un contexte sacré. Il remonte aux sociétés primitives qui ont délimité un espace habité, un lieu de rituel et de protection, tout en préservant la fertilité des terres agricoles extérieures. En s’appuyant sur cette origine, à la fois mythologique et historique, on peut soutenir que la séparation entre un espace habité et des terres non habitées marque la naissance de la ville moderne, et par extension, du genre architectural.
Depuis le XIIIe jusqu’au XIVe siècle, et même jusqu’à la première moitié du XXe siècle dans un état de dégradation, la plaine du Rhône et ses vallées latérales ont vu coexister plusieurs types de propriétés : les pâturages ou «mayens», les forêts, les terres incultes, ainsi que les canaux d’irrigation (bisses) et les chemins reliant les communes. Cette diversité dans le régime foncier a nécessité une gestion complexe, qui, d’une part, a caractérisé l’économie alpine traditionnelle et, d’autre part, a constitué des obstacles solides à l’urbanisation du territoire. Cependant, à partir des années 70, ces pratiques urbaines ont également commencé à affecter ces terres.
La particularité du système économique, distingue nettement des types d’exploitation du sol comme l’agriculture sédentaire, le nomadisme. La place centrale et structurelle du foin dans le cycle qui alterne et articule le secteur agricole au secteur pastoral. Le cycle de fenaison implique, en outre, la construction de modèles bâtis spécifiques répondant aux nécessités de diverses formes de stockage selon la saison, l’altitude.
L’économie se base aussi sur un système complexe de répartition des charges pour les différentes tâches saisonnières entre les multiples composants d’une famille et entre des collectivités plus grandes se réunissant en corporations gérées de manière communautaire et statuant des droits et devoirs de chaque consort. Ce système de corporation, que l’on nomme «consortage» en Valais, reprend les logiques des corporations médiévales.
BARRAGE
Structure en béton construite directement dans le courant d’un cours d’eau naturel pour servir de réservoir d’énergie potentielle.
BISSE
Long canal d’irrigation conduisant l’eau des montagnes aux terrains cultivés.
CARRIÈRES
Lieu où l’on sont extraits des matériaux de construction tels que la pierre, le sable ou différents minéraux non métalliques ou carbonifères. Il y a les carrières à ciel ouvert, les carrières souterraines et les carrières sousmarines.
CONSORTAGE
Forme de corporation dans laquelle des copropriétaires ou des usagers se regroupent pour exploiter en commun un bien, typiquement un alpage, un bisse, une forêt mais aussi des logements. Originaire du Valais, il est encore très présent dans le canton.
COUDE DU RHÔNE
Virage dans le cours d’une rivière ou d’un fleuve qui change de direction d’environ 90°, celui-ci se produit à Martigny.
CRUE
Forte augmentation du débit et de la hauteur d’eau d’un fleuve, une rivière ou d’un cours d’eau. Le mot s’utilise pour évoquer le débordement du lit mineur.
DÉBÂCLE
Processus de transformation d’un terrain couvert de végétation naturelle, telle que des forêts, des prairies ou des marécages, en un terrain dégagé et utilisable pour l’agriculture, l’habitat humain ou d’autres activités.
DÉFRICHEMENT
Phénomène météorologique de rupture brusque de la couverture de glace, suivie de son départ massif en blocs dans un fleuve, une rivière ou en mer.
FENAISON
Ensemble des opérations agricoles qui consistent à faucher, sécher et récolter le foin.
FENAISON
Ensemble des opérations agricoles qui consistent à faucher, sécher et récolter le foin.
MARAIS
Nappe d’eau recouvrant un terrain partiellement envahi par la végétation.
MORAINE
Accumulation de débris rocheux, tels que des blocs, des graviers, du sable et des argiles, transportés et déposés par un glacier.
PIPELINE
Infrastructure de transport spécialement conçue pour le transport à longue distance de liquides ou de gaz à travers des conduites souterraines ou subaquatiques.
PLAINE
Grande étendue de terrain sans relief ou légèrement ondulée, d’altitude peu élevée par rapport au niveau de la mer ou d’altitude moindre que les régions environnantes.
TERRE ARABLE
Terre qui peut être labourée et cultivée, elles sont affectés à des cultures maraîchères et potagères mais aussi aux prairies temporaires à faucher ou à pâturer.
SILOS
Cuves de stockage verticales utilisées pour conserver et gérer différents matériaux en vrac tels que les produits chimiques, les ciments, les granulés plastiques, les aliments pour animaux.
VALLÉE
Espace allongé entre deux zones plus élevées, également un espace situé de part et d’autre du lit d’un cours d’eau.
VERNACULAIRE
Référence aux styles de construction traditionnels, utilisant des techniques et des matériaux locaux. C’est une architecture qui reflète les pratiques et les besoins locaux. Cela renvoie à tout ce qui est propre à un lieu, une culture ou une communauté particulière, souvent en opposition à ce qui est universel ou savant.
D’AMONT EN AVAL DE LA DRANSE:
P259 01. LA DRANSE et son déversoir de crue.
P261 02. LES USINES DISPARUES ; la clouterie, le foulon à drap et la tannerie
P263 03. LES MOULINS AMONTS et l’écluse
P269 04. LA MAISON et l’étable
P271 05. LE RACCARD
P273 06. LA SCIERIE
P287 07. LA RIBE
P293 08. LE
- LES MOULINS -
Sur la route du Grand-Saint-Bernard qui relie la Suisse occidentale au Piémont, la commune de Liddes occupe la partie médiane du val d’Entremont, entre Orsières et BourgSaint-Pierre. Elle longe la Dranse sur plus de six kilomètres entre le torrent de Pont-Sec et celui d’Allèves.
L’économie locale ne profite guère de l’axe routier du GrandSaint-Bernard. Sa célébrité, son importance internationale suscitent un tourisme de transit, et non une implantation hôtelière comparable à celle de Zermatt ou de Saas. Les besoins des rares estivants ne compensent pas le déclin démographique. Les usines voient leur clientèle s’amenuiser de décennie en décennie. Celles qu’une inondation, qu’une avalanche ou qu’un incendie détruisent ne sont plus reconstruites.
Le complexe usinier du Glarey, aujourd’hui: « Les Moulins » tirait son nom de la clairière graveleuse où il est bâti sur la rive gauche de la Drance d’Entremont, au pied de la forêt de Martenna. La maison, la grange, l’écurie, le raccard et les usines forment un petit hameau à proximité du pont qui relie Fornex à Fontaine- Dessous et à Rive-Haute.
à gauche : les moulins de Liddes par Paul Boesch en 1944
LA CLOUTERIE ET LE FOULON A DRAP
VANNE OUVERTURE ET FERMETURE DU CANAL DEVERSOIR DE CRUE ENTRÉE
Construit sur plusieurs siècles, le complexe s’est construit autour de la scierie, bâtiment le plus ancien et datant de 1412. Quelques années plus tard, les moulins d’amont sont construits pour contrôler le débit de la Dranse. La maison d’habitation est construite en 1741. Les autres usines se développent jusqu’au 19è siècle. Aujourd’hui, la tannerie, la clouterie et le foulon à drap sont en ruine, probablement emportés par une inondation.
CLOUTERIE ET FOULON A DRAP
VANNE OUVERTURE ET FERMETURE DU CANAL

01. LA DRANSE, SON DÉVERSOIR DE CRUE ET SES VANNES
Dès la construction de la scierie, un bras de la Dranse est déviée pour entraîner le moulin des scies. En amont, à l’entrée de la Dranse déviée, il y a deux blocs de béton avec des rainures qui permettent d’insérer une place pendant les périodes de faible débit pour capter l’eau de la Dranse nécessaire aux usines. Le débit de la rivière diminue en hiver, mais entre le hameau de Dranse et le Glarey, les torrents de l’A, d’Aron et des sources compensent cette baisse.
Cette diminution du débit n’élimine pas le risque de crues soudaines lors de la fonte des neiges. Seule la mise en service du barrage des Toules en amont de Bourg-Saint-Pierre a fait disparaître ce danger. Avant cela, chaque année, à partir du 25 juillet, la fonte des glaciers apportait une eau boueuse, chargée de limon. Un grand déversoir, «la Petite Dranse», évacuait cette eau à 18 m de la prise d’eau.

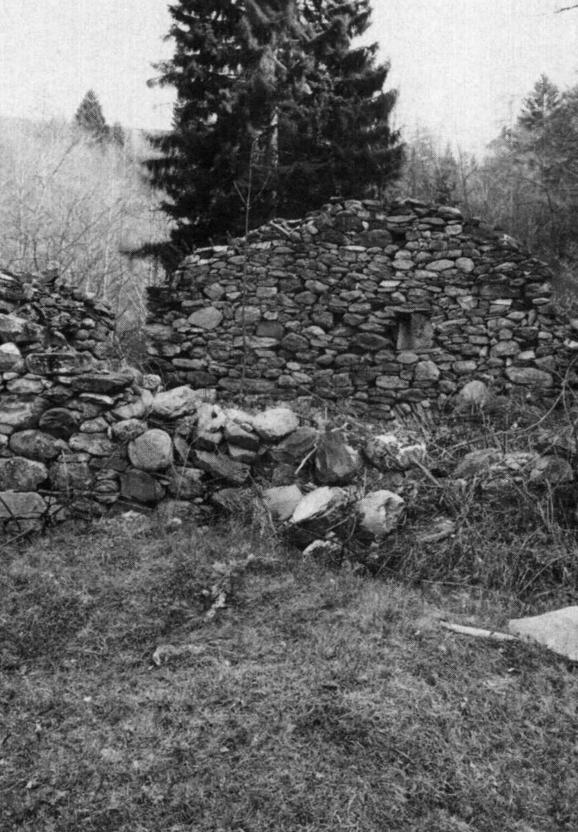
02. LES USINES DISPARUES,
LA CLOUTERIE, LE FOULON A DRAP ET LA TANNERIE
LA CLOUTERIE
Pourtant de construction plus récente, la clouterie a été désaffectée pour des raisons économiques. Les cloutiers ont été soumis aux taxes industrielles. L’usine produisait des clous pour les planches en bois et les souliers. La clouterie subsiste jusqu’à la fin du 19è siècle. La ruine est encore coiffée d’un toit d’ardoises mais sans entretien se détériore. Le local pouvait servir d’entrepôt pour les outils mais aussi pour des personnes de passage venant scier et fendre le bois.
LE FOULON A DRAP
Le foulon à drap est une machine utilisée pour le textile. La foulage est une opération importante dans la production de draps de laine, qui consiste à épaissir et renforcer le tissu en feutrant les fibres de laine ensemble. Il n’en reste seulement que quelques pans de mur. Le foulon à drap était actionné par une roue verticale actionnée en dessous du bâtiment. Le drap s’enroulait autour d’un plateau de mélèze. C’était un modèle assez particulier, les bras étaient robustes chevillés au sol, il allongeait dans l’axe des maillets le drap aux deux extrémités.
LA TANNERIE
Elle aussi désaffectée, la tannerie a subi des dégâts après les inondations de 1856, la débâcle du Valsorey. Mais là aussi, les taxes industrielles ont rendu la poursuite de l’activité plus compliquée. Il n’y a presque plus aucune trace de la tannerie, elle regroupait un atelier appelé «tines», là où les peaux étaient lavées. Il y avait un logement sommaire qui était occupé lorsque la tannerie était en activité.


Les moulins d’amont sont les installations principales. Laissant un passage étroit vers la grange et l’écurie, le bâtiment est construit en pierres et borde au sud la cour de la maison d’habitation. Il abritait à l’origine trois moulins. Aujourd’hui deux moulins sont encore en activité. Il y avait un four à pain fonctionnant comme un consortage, sa boulangerie et son espace de travail. La toiture à deux pans est couverte d’ardoise.
Le moulin fonctionne grâce aux vannes qui retiennent l’eau ou la dirigent vers les roues. Il y a une trémie qui verse le grain, la trémie est soutenue par un châssis. Enfin l’anille entraîne la meule tournante.
LES MOULINS AMONTS
Le meunier a une journée très rythmée et applique un rituel journalier. Il remplit la trémie : trois sacs de cinquante kilos environ. Entre 8h et 10h du soir, le meunier charge les moulins, trois sacs dans le grand et deux dans le petit. Puis, avant d’aller dormir, il revient au moulin pour ensacher la farine. Il se réveillera une nouvelle fois à 2 heures pour voir si tout a bien fonctionné puis à 5h.

Il peut y avoir des pannes, le meunier change alors le disque. Une fois le moulin réparé, il retourne rapidement se réchauffer dans l’étable. Le moulin fonctionne grâce aux vannes qui retiennent l’eau ou la dirigent vers les roues. Il y a une trémie qui verse le grain, la trémie est soutenue par un châssis. Enfin l’anille entraîne la meule tournante.


- MOUDRE A LIDDES -
Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, les Entremontains mangent essentiellement du pain de seigle, d’une excellente conservation. On le cuit à Liddes tous les deux mois. Le désir de chacun est de le rendre plus savoureux et plus digeste en y mêlant de la farine de froment. Mais le climat ne s’y prête pas partout. La décadence de la culture des céréales, générale en Valais dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, s’accentue dans le quart de siècle suivant. En 1975, seuls deux districts ouvrent davantage de terres à blé qu’en 1950 : Monthey et Saint-Maurice. Les autres les délaissent. La vigne et l’arboriculture fruitière conquièrent la plaine, les activités du secondaire et du tertiaire attirent les montagnards.
Après la Seconde Guerre mondiale, les villages les plus élevés ou les moins ensoleillés renoncent aux céréales. En 1967 elles ne se cultivent plus qu’à Liddes, Fontaine, RiveHaute et autour des Moulins. Mais des clients nouveaux apparaissent, venus des écarts d’Orsières. En 1980, malgré la mise en service d’un moulin électrique à Orsières, des clients viennent de Som-la-Proz (moulin désaffecté en 1972) et même de Charrat, dans la plaine du Rhône. L’amélioration du réseau routier et la multiplication des véhicules à moteur rendent possible ces déplacements. Dès le début du siècle, avec l’amélioration de la route cantonale, les habitants de Liddes-Ville, de Rive-Haute et des Fontaines apportent leur grain sur des chars à bancs.
Le four est chauffé tous les deux mois, du lundi au mardi de la semaine suivante. Il fonctionne jusqu’en 1965. Comme le pain est meilleur lorsque la farine est fraîchement moulue, certains clients arrivent lorsque le four est déjà chaud. Les jours de cuisson sont pour le meunier des jours de presse. Les sacs s’accumulent : il faut les marquer, les reconnaître, les mettre à l’abri de l’humidité et des souris. Des locaux exigus sont vite encombrés. La diminution de la clientèle, dans les dernières décennies, ne résout pas le problème de l’encombrement : les clients apportent de plus grosses quantités à la fois, et toute l’activité tend à se concentrer entre octobre et janvier.

04. LA MAISON ET L’ÉTABLE

STOCKAGE ORGE



06. LA SCIERIE
La scierie borde la meunière en face de la ribe. Long d’une quinzaine de mètres, le bâtiment, entièrement construit en planches, selon la tradition. Jusqu’en 1918, la scierie du Glarey est actionnée par une roue verticale. Un chariot aux roulettes de bois permettait d’amener le bois à l’intérieur.
Un menuisier venu d’Orsières, réputé pour son savoir-faire, effectue des travaux de modernisation. Le chéneau est très soigneusement ajusté pour perdre le moins possible le débit de l’eau permettant à la roue de tourner plus vite.
Le mécanisme du moulin de la scierie est modifié pour être plus fiable, plus rapide et surtout plus rentable. Le besoin
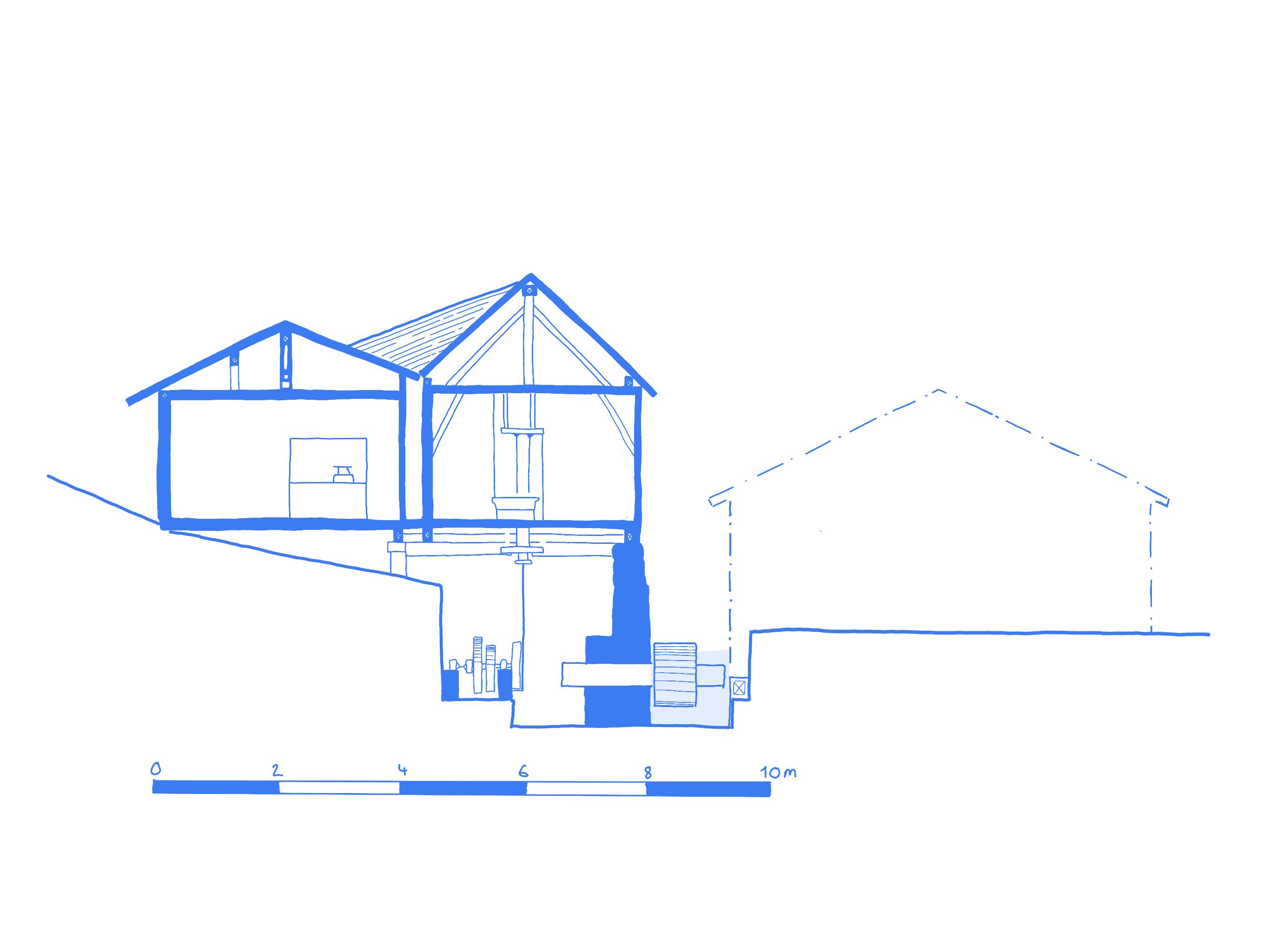
COUPE

- COUPER A LIDDES -
La scierie livre des pièces façonnées dans un choix limité d’essences ; 98% des arbres abattus sont des résineux : sapin (68%) et mélèze (30%). Parmi les feuillus, seul le bouleau revient à plusieurs reprises. Un peuplier, un tremble, un cerisier sont mentionnés. La provenance des arbres est marquée soigneusement et l’on peut en tirer la rotation des coupes dans la commune et le peuplement forestier.
Suivant où la provenance du bois, on estimait la valeur de la matière en proportion d’un bois qu’on achetait pour la commune, pour la bourgeoisie, au bord de la route, prêt à charger. Entre 1950 et 1970, le propriétaire trouve sans trop de peine des bûcherons, des tailleurs d’ardoise ou pâtres en été, qui s’engagent à la journée pendant la mauvaise saison.
Le scieur n’attend pas les commandes pour préparer : des plateaux et des carrelets de coffrage pour les grands barrages : Grande-Dixence, Mauvoisin, puis Les Toules et pour le tunnel du Grand-Saint-Bernard ; des planches et des poutres, pour la clientèle locale et surtout pour les chalets de Verbier. Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, les planches servent principalement aux réparations des étables. Plus tard, le bois servira de plus en plus au rénovation des maisons aux alentours et notamment la maison présente dans l’ensemble du complexe.
Des gros mélèzes sont coupés pour refaire les planchers des granges attaqués par la pourriture. Tout au long du demisiècle, le sapin, dominant en forêt, reste cependant l’essence la plus utilisée.
Le commerce des bois assure la vie de sa famille. Après 1975, la main-d’œuvre occasionnelle devient plus rare, et les ouvriers préfèrent abandonner leur maigre domaine agricole pour s’assurer un travail à l’année. L’âge venu, une santé déficiente et le dépérissement de l’agriculture de montagne conduisent à l’arrêt des moulins en 1982. Le départ du dernier ouvrier ralentit le rythme de travail de la scierie.


1 - FIG. 2 : MÉCANISME DE LA ROUE SOUS LA SCIERIE


FIG.
FIG. 2
FIG. 1
FIG. 4 : LA PONCEUSE

SCIE CIRCULAIRE
ROUE MOTRICE
SCIE MANCHOTE
WAGON QUI AMÈNE LES TRONCS


ANCIENNE ROUE CIRCULAIRE DE LA SCIERIE

INTÉRIEUR DE LA SCIERIE: SCIE À DEMI-CADRE ET SCIE CIRCULAIRE
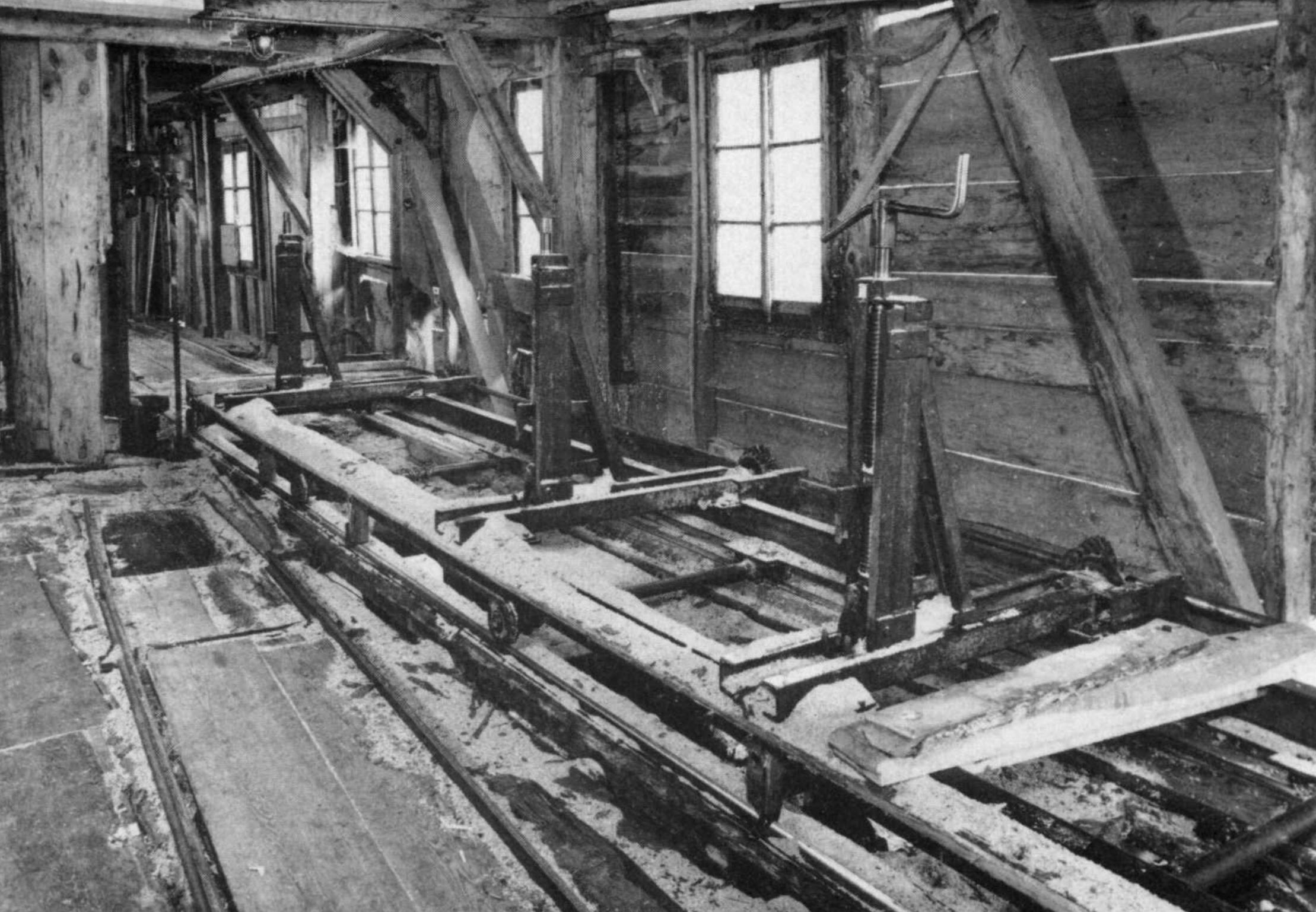
INTÉRIEUR DE LA SCIERIE: SCIE À DEMI-CADRE ET CHARIOT

RIBE

07. LA RIBE
La ribe est un dispositif composé d’une meule tronconique qui roule dans une cuve de pierre. Dans le district d’Entremont, elle est appelée «mounet». Elle était utilisée de façon occasionnelle pour écraser les pommes ou les grains sauvages afin de produire du cidre. La clientèle vient surtout y préparer l’orge pour la soupe. Elle l’amène de bonne heure le matin, en même temps que les céréales à moudre. L’orge est entreposée à l’écart, au rez-de-chaussée de la maison d’habitation.
Dans le Valais Romand, on compte une ribe pour deux ou trois moulins à farine. Mais dès les années 50, les paysans renoncent à préparer leur orge; ils l’achètent au magasin

SCIERIE
COUPE


Le bras horizontal qui fait tourner la meule tronconique traverse l’arbre vertical. Le bras garde une certaine mobilité : une fente plus haute que large permet un balancement

LA RIBE À MEULE TRONCONIQUE


LA RIBE
LA MEULE TOURNANTE ET LE PALAN DE LEVAGE

08. LE MOULIN AVAL
Le moulin aval, également connu sous le nom de moulin en cascade. C’est une petite maisonnette dotée d’un toit à un pan, juste assez haut pour permettre de lever la meule tournante à l’aide d’un palan ou de remplir la trémie. Il est équipé d’une roue horizontale à pale obliques, similaire à celles utilisées dans les autres usines du complexes. En outre, quelques petites sources viennent s’ajouter à l’eau provenant du canal de fuite de la scierie et de la ribe. Les trois moulins amont, le moulin aval, la ribe sont actionnés par des roues hydrauliques horizontales, placées en sous-sol dans une fosse constamment inondée.
Le moulin est devenu inutilisable avec le temps. Il a été cédé

COUPE

ANILLE
Pièce de fer intégrée et fixée dans la meule d’un moulin, reliée à l’axe ou à la manivelle qui permet son entraînement.
AVAL
Désigne la partie d’un cours d’eau située du côté où il s’écoule, c’est-à-dire en direction de l’embouchure ou du point le plus bas. On l’oppose à amont.
BIEF
Canal d’irrigation creusé dans la terre et le roc. Ces canaux servent à amener l’eau aux turbines de moulins, de scieries ou usines de tissage.
CLOUTERIE
Englobe les techniques, les outils, et les procédés utilisés pour produire divers types de clous, qui sont des pièces métalliques utilisées principalement pour l’assemblage de matériaux tels que le bois ou le métal.
DRANSE
Rivière qui afflue dans le Rhône pour ensuite rejoindre le Léman. La rivière résulte de la confluence de plusieurs ruisseaux.
ÉTABLE
Bâtiment destiné à abriter les bêtes, notamment ceux qui vivent en troupeaux comme les vaches et les bœufs.
FOULON DE TANNERIE
Grand tonneau tournant sur son axe, il permet de battre et fouler la laine tissée dans la terre à foulon (une sorte d’argile) pour l’assouplir et la dégraisser. Il pouvait servir pour les cuirs et les peaux.
LAUZE
Pierre plate, généralement en schiste ou en calcaire, utilisée traditionnellement pour les toitures. Appréciée pour sa durabilité, son efficacité et son esthétique, particulièrement dans les régions montagneuses.
LIMON
Boue épaisse et visqueuse formée par des dépôts de boue et de sédiments sur les berges des rivières ou des lacs.
MAYEN
Pâturage d’altitude moyenne avec bâtiment où séjourne le bétail au printemps et en automne. Très typique dans le canton du Valais, un fleuve, une rivière ou d’un cours d’eau. Le mot s’utilise pour évoquer le débordement du lit mineur.
MEULE
Cylindre à axe vertical servant dans les moulins anciens à écraser le grain. Les moulins possèdent deux meules, l’une fixe, l’autre tourne au-dessus de la précédente.
MEUNIER
Personne qui possède et exploite une meunerie ou un moulin.
MÉLÈZE
Phénomène météorologique de rupture brusque de la couverture de glace, suivie de son départ massif en blocs dans un fleuve, une rivière ou en mer.
MOULIN
Dispositif ou une installation conçue pour broyer, moudre ou pulvériser diverses substances, en utilisant différentes sources d’énergie telles que l’eau, le vent, ou même des moteurs mécaniques dans un contexte plus moderne.
RACCARD
Bâtiment traditionnel des régions alpines, construit en bois sur pilotis et utilisé pour le stockage des récoltes. Il est caractérisé par sa structure adaptée pour protéger les récoltes des intempéries et des nuisibles, et fait partie intégrante du patrimoine architectural et culturel alpin.
RIBE
Petite pièce de bois utilisée principalement dans la charpente et la menuiserie pour renforcer ou stabiliser des structures. Au complexe des moulins de Liddes, la ribe est un bâtiment pour moudre le grain.
SCIERIE
Établissement où le bois brut est transformé en produits finis ou semi-finis, prêts à être utilisés dans la construction, la menuiserie, et d’autres industries.
SEIGLE
Céréale robuste cultivée principalement pour ses grains utilisés dans l’alimentation humaine et animale. Il est particulièrement adapté aux climats froids et aux sols pauvres, et joue un rôle important dans diverses pratiques agricoles et culinaires.
TRÉMIE
Entonnoir, souvent en forme de pyramide renversée, destiné au stockage ou au passage de matières solides en vrac. La trémie n’est pas un réservoir fermé.
VANNES
Panneau vertical mobile disposé dans une canalisation pour régler le débit. Elles sont fabriquées à partir de planches taillés pivotant sur un axe horizontal.
Les chanoines vivant au Grand-Saint-Bernard aiment à dire qu’à l’hospice, il n’y a que deux saisons : l’hiver d’avant et l’hiver d’après. Durant les sept mois de l’hiver, l’hospice n’est atteignable qu’après une marche de deux heures à skis de randonnée ou en raquettes à neige.
Parabole évocatrice de la Résurrection, l’itinéraire emprunté traverse la combe des Morts, où s’engouffrent les avalanches, et oriente le voyageur vers l’hospice: ce refuge au service de l’espérance, solidement ancré sur le rocher.
Après plus de neuf cents ans d’activité au service des passants qui franchissaient l’immense barrière des Alpes, l’hospice du Grand-Saint-Bernard vécut une redoutable remise en question lors de la construction du tunnel ouvert en 1964. Semblable à Bartimée, assis et désœuvré sur le bord du chemin, l’hospice ne voyait plus le sens de sa mission : plus besoin d’un refuge au sommet du col puisque la voie transalpine passait désormais quelque cinq cents mètres plus bas.
GLOSSAIRE P327

- L’HISTOIRE DE L’HOSPICE -
Avant de s’appeler col du Grand Saint-Bernard, le col s’appelait le Mont-Joux. Parmi les divers passages qui à travers les Alpes faisaient communiquer les Gaules et l’Italie, le plus célèbre, le plus fréquenté était le Mont-Joux.
Jules César le gravit, avec ses légions, et constamment depuis, les Romains le traversèrent pour aller, de l’autre côté des Alpes, combattre les Gaulois, les Celtes, les Germains, les Helvètes.
Dans la ville d’Aoste située dans l’autre versant de la vallée, en Italie, un certain Bernard vivait et travaillait au service de l’évêque. Il avait reçu la responsabilité d’accueillir les marchands, les pèlerins et tous les voyageurs qui avaient dû franchir, à pied ou parfois à dos de mulet, l’immense barrière des Alpes qui sépare aujourd’hui la Suisse et l’Italie.
Bernard écoutait le récit de leurs mésaventures, combien la tempête les avait éprouvés alors qu’une marche souvent harassante avait déjà épuisé les voyageurs souvent transis par le froid. Et surtout ils devaient tenter d’échapper aux Sarrasins qui étaient retranchés dans leurs repères alpins et sur les cluses, ils semaient la mort, le feu et la panique. Ils n’hésitaient pas à s’en prendre aux voyageurs et aux pèlerins.
Bernard prit la décision de quitter le confort de la ville pour aller construire un refuge sur la montagne. Pour réussir ce projet audacieux, Bernard avait besoin d’aide, c’est pourquoi il fit appel à une communauté de religieux.
ci-contre, l’Hospice en 1777, par Besson gravure, 28 x 38 cm

1894, Frédéric Régamey à propos de la construction de l’Hospice ; « On trouvait dans les ruines du temple et de l’ancien hospice, des matériaux sur place ; les cimes des montagnes attenantes n’y masquent dans aucune saison, les rayons du soleil. Le local y est spacieux, à l’abri des avalanches, et les vents, moins concentrés, y sont moins violents. Une source abondante y fournit l’eau sans beaucoup de frais. Mais toutes ces raisons ne prévalent pas sur le but principal que le fondateur se propose. Il veut indistinctement soulager tous les voyageurs, en leur épargnant, autant que possible, et à tous également, les fatigues et les dangers ; or pour un tel but, l’emplacement du temple n’était pas celui qui pouvait convenir. »
L’emplacement actuel de l’Hospice n’est pas un hasard. Sur les contreforts de la Chenalette, une humble source murmure le chant de l’hospitalité en ce lieu de passage qui fut si longtemps celui de la désolation. Chaque hiver, l’hospice héberge des milliers de randonneurs grâce à ce précieux filet d’eau. C’est pourquoi, tout au long de l’histoire, la source a mobilisé l’attention des confrères.
Plusieurs constructions ont été construites avant l’Hospice mais de l’autre côté du lac et de la frontière, en Italie. Le temple de Jupiter, une bâtisse fragilement assemblés de pierre trouvée sur place. Il avait été bâti par les Romains. Il n’en reste que les fondations. Le temple a été enfoui sous la neige dès le premier hiver.
L’Hospice est bâti au point culminant du col, ce point est dominé par deux hautes cimes dont l’une qui lui dérobe le soleil pendant plus d’un mois. Les pierres provenant des débris de l’ancien temple ne suffisant point à la nouvelle construction, il dut ramasser la plus grande partie des matériaux parmi les rochers des environs. Il ne trouvait que du bois et de la chaux. C’est ainsi qu’il affréta des matériaux depuis la vallée d’Aoste vers le col à dos du mulet.

Bernard donne la mission aux religieux d’offrir l’hospitalité à tous ceux qui passent. Ce refuge reçut le nom d’hospice, car les religieux accueillent tout étranger comme s’il était un frère : c’était leur manière de se mettre au service de Dieu.
L’Hospice s’est construite en plusieurs étapes, une petite grotte est construite pour permettre aux ouvriers de passer la nuit à l’abri du froid pendant le chantier du premier hospice. Deux des pierres, en marbre blanc proviennent des ruines du Temple de Jupiter. Cette pièce est encore existante et fait partie du stockage actuel de l’Hospice. Dans les murs de la maison mère se trouvent les pierres de l’hospice primitif. C’est au courant du XIIIè siècle que le premier noyau est agrandi au Nord et à l’Ouest. En 1555, un incendie ravage le bâtiment. La grandeur de l’église impressionne, lors de sa construction en 1685, le sol est surélevé d’un étage. L’ancien chœur est devenu le cœur de la crypte actuelle.
La construction à l’ouest d’un premier bâtiment indépendant de l’Hospice vient briser les avalanches tombant depuis la Chenalette. D’abord une bergerie, il devient par la suite le bâtiment Saint Louis. Entre l’Hospice et le bâtiment SaintLouis, la construction d’une annexe hospitalière pour accueillir la recrudescence de passants en cette période de famine. Le bâtiment est achevé en 1899, une passerelle sera ajoutée un an plus tard. L’Hospice est toujours un hospice, c’est le seul bâtiment du Col à être ouvert l’hiver. L’annexe hospitalière est devenue un hôtel moderne en 1925. Le bâtiment Saint-Louis est aujourd’hui un musée avec une salle de projection, ouvert un soir sur deux en hiver pour des restrictions d’électricité. Au rez-de-chaussée de l’ancien bâtiment Saint-Louis se trouve le refuge des chiens Saint-Bernard, désormais présent uniquement l’été.
à suivre : fusain de l’hospice, auteur inconnu et taille inconnu, environ dans les années 1900. L’hospice est prise par la neige comme au moment où nous y étions.

- LA GRANDE MAISON -

L’Hospice s’est construite au cours des siècles. De l’abri primaire à la grande maison des chanoines. Le bâtiment principal de quatre étages s’organise sur un plateau principal qui accueille les personnes de passage, les pèlerins et randonneurs dormant à l’hospice. Ce plateau public participe à la rencontre des personnes venus de différents horizons et raisons à l’hospice. Environ quinze à vingt milles personnes passent chaque année à l’Hospice du grand Saint-Bernard, on en compte quelquefois cinq cent dans une seule journée.
Le bâtiment s’étend sur soixante-quinze mètres de long et environ vingt-deux mètres de large.
ÉGLISE
LATRINES
01. L’ENTRÉE
La porte de l’hospice n’est jamais fermée à clé, elle laisse entrer n’importe quand il souhaite. La porte d’accès a été conservée depuis le XIIIè siècle. Le niveau d’entrée varie selon les deux saisons : l’été et l’hiver.
En hiver, la neige est si haute que les randonneurs munis de skis et de raquettes entrent à niveau. Le marcheur ne se rend pas compte que sous ses pieds se trouvent des escaliers qui permettent d’accéder au bâtiment en été. La porte d’entrée ouvre sur un sas avant de rejoindre le couloir central qui donne accès à toutes les pièces.
A l’entrée, le caractère de la grande maison se dévoile, les murs de pierres semblent froids à la première impression mais l’atmosphère se réchauffe très rapidement au contact des premiers chanoines. Ils nous invitent à descendre au rez-dechaussée et à empiler des chaussons. Ainsi toutes les personnes marchant à l’intérieur ont un marqueur d’appartenance à l’hospice. C’est la première forme d’hospitalité que nous avons rencontré.
ci-contre à gauche : deux skieurs rentrant à l’hospice


02. LA CUISINE

02. LA CUISINE
La cuisine fait partie de l’engrenage pour faire fonctionner la grande maison. Elle a toujours été au même endroit depuis la construction de l’hospice. Un chef de cuisine qui fait partie de la congrégation des chanoines dirige son équipe de commis saisonnier qui se renouvelle à la fin de chaque hiver.
Les trois temps de repas rythment l’organisation des chanoines cuisiniers. Les horaires sont précisés. Les cuisiniers se lèvent plus tôt pour préparer le petit déjeuner servi à 8h, ils sont en cuisine à l’aube, en fin de matinée puis en fin d’après-midi. Dans les temps libres, les cuisiniers partent marcher dans les montagnes voisines.
A l’Hospice, les menus sont faits en fonction des aliments restants dans la cave. Les réserves de nourriture s’effectuent en septembre avant la fermeture de la route : solidement appuyé sur le roc, le rez-de-chaussée de l’hospice se transforme en garde-manger. 50 pièces de fromage, 1 300 kilos de pommes de terre, une tonne de viande, sans oublier les légumes coupés et surgelés, destinés à la préparation des litres de soupe servie chaque jour.
Les repas sont pris ensemble. Des grandes marmites et récipients sont posés sur la table et une personne de la table sert l’ensemble des personnes. Une soupe, un repas chaud, un dessert et du vin. Les grandes tables et les bancs rapprochent les personnes entre elles et facilitent les conversations.
Due à une grande influence de personnes, un deuxième réfectoire a été ouvert pour accueillir le plus de personnes possible. Il y a en moyenne 70 couverts en demi-pension. Le principal réfectoire s’appelle le poêle.
page précédente : le chef cuisinier prépare le repas
ci-contre à gauche : la grande tablée qui mangent dans la salle du poêle.

03. LE POÊLE
La salle du poêle se trouve à l’angle sud du bâtiment de l’Hospice avec la vue sur le lac du Grand Saint Bernard et la vallée italienne. A l’époque, un petit réchaud en cuivre doré était présent dans la pièce. C’était le poêle dont Bernard se servait dans les grands froids, qu’il portait sur la montagne pour réchauffer les mains du voyageur engourdies par le froid, et aussi pour se réchauffer lui-même.
Le poêle est la salle où se déroulent les repas et les temps calmes entre les repas. Le soir, nous étions à l’Hospice. Des jeunes jouaient à des jeux de sociétés, des randonneurs planifiaient leurs randonnées du lendemain, des personnes discutaient en prenant un thé...
Cette grande salle commune, une des pièces les plus anciennes de l’Hospice, c’est ici que les chanoines se sont toujours regroupés pour leurs activités collectives à occuper les longs hivers, ou durant les grosses tempêtes de neige où très peu de visiteurs passent à l’Hospice. A l’époque c’était la seule pièce pour se tenir chaud autour du poêle, alors tous les habitants s’y réunissaient, c’est d’ici que la pièce tient son nom, aujourd’hui il n’y a plus de poêle.
ci-contre à gauche : les grandes tables de la salle du poêle

04. LA CHAPELLE
Au même nombre que les temps de repas, les temps de prières rythment la vie de l’Hospice. Cette chapelle est située au rez - de -chaussée en été, et elle est totalement engloutie par la neige en hiver. C’est la plus haute d’Europe. A l’Hospice, il y a une chapelle et une église, l’une utilisée quotidiennement, l’autre est utilisée pour les fêtes spéciales comme Pâques ou Noël.
Les Laudes sont les prières du matin qui ont lieu tous les jours à 7h15 avant le petit déjeuner. Il y a une messe à 17h30, et les chants des complies à 21h.
L’Hospice a toujours été religieux, cette grande maison a pour but d’accueillir toutes les personnes venues demander l’hospitalité, et ce peu importe leur religion. Les messes sont libres d’accès. La chapelle, dédiée à Saint Bernard de Menthon, est un témoignage de la foi et de la dévotion des moines qui y ont résidé pendant des siècles. Elle est un havre de paix et de recueillement pour les pèlerins et randonneurs qui franchissent le col. L’architecture de la chapelle est simple et rustique, reflétant l’humilité et la spiritualité des lieux. À l’intérieur, des fresques et des statues relatent l’histoire religieuse et les traditions de l’hospice.
Les visiteurs de la chapelle peuvent y assister à des offices religieux, célébrés régulièrement par les chanoines du GrandSaint-Bernard. Ces moments de prière et de méditation offrent une pause spirituelle et un lien avec l’histoire profonde de la région. En hiver, la chapelle prend un aspect encore plus magique, entourée de neige, et symbolise la lumière et l’espoir au cœur des conditions souvent difficiles de la montagne.
ci-contre à gauche : la chapelle
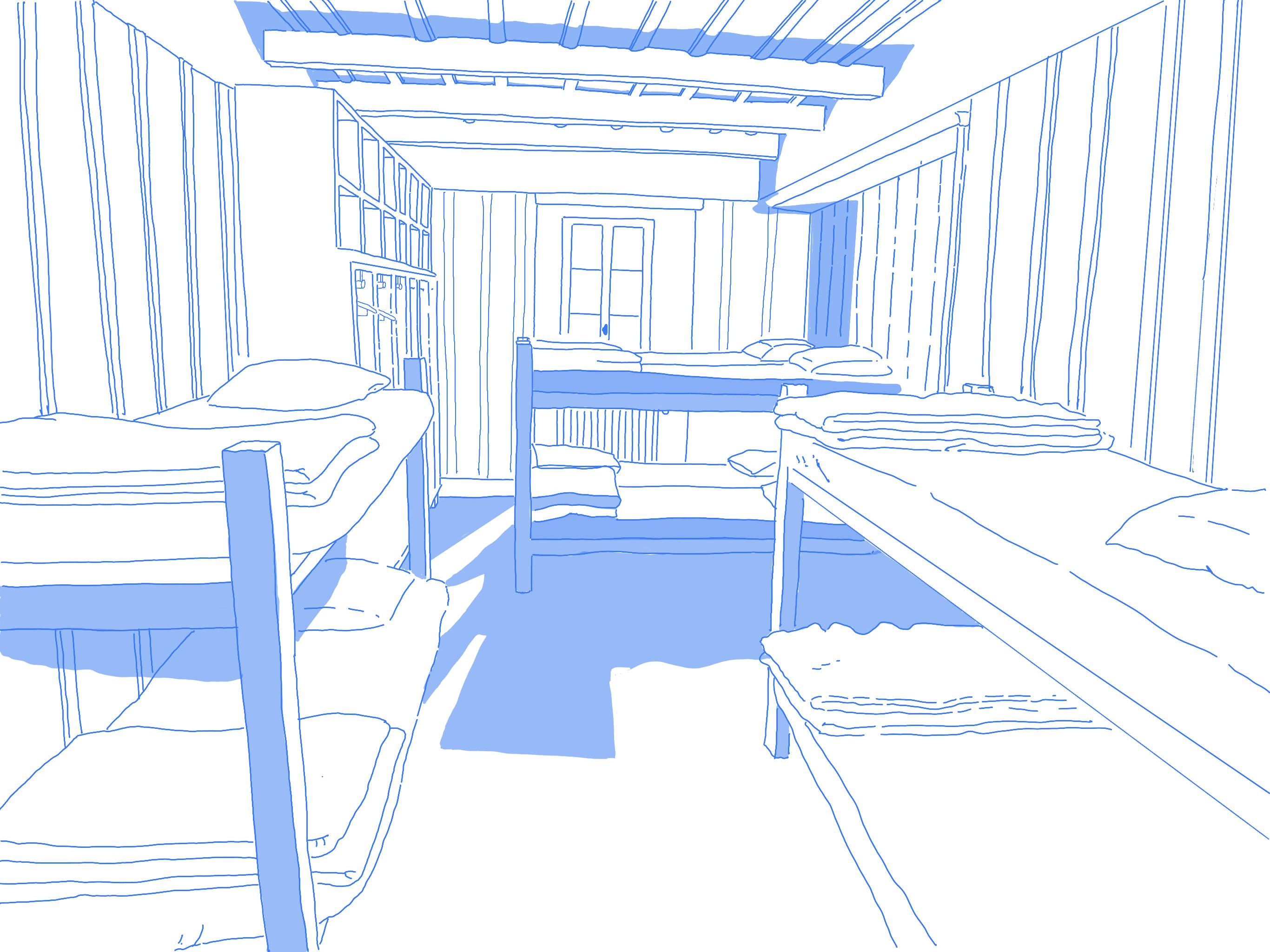
05. LES DORTOIRS
Les dortoirs sont aménagés avec simplicité et fonctionnalité, dans le respect de l’esprit de modestie et de bienveillance qui caractérise l’Hospice du Grand-Saint-Bernard. Les lits, souvent en bois massif, sont équipés de matelas confortables et de couvertures chaudes, assurant aux visiteurs un repos bien mérité après une journée de marche en montagne. La configuration en dortoir favorise les rencontres et les échanges, créant une ambiance conviviale et chaleureuse parmi les hôtes.
Les moines et les bénévoles de l’hospice veillent à ce que chaque séjour soit agréable et réconfortant. Ils offrent une hospitalité authentique, basée sur des valeurs de partage et de solidarité. Les dortoirs sont maintenus dans une propreté irréprochable, et des espaces de rangement sont disponibles pour les effets personnels des visiteurs.
Le dortoir du Refuge du Grand-Saint-Bernard est bien plus qu’un simple lieu de repos ; c’est un sanctuaire de réconfort et de convivialité, où chaque visiteur peut se ressourcer et se reconnecter à l’essentiel. C’est un lieu où la tradition d’hospitalité millénaire des chanoines continue de vivre, offrant un havre de paix au cœur des Alpes.
Des chambres privées sont disponibles pour les voyageurs souhaitant plus d’intimité. Il est indispensable de réserver pour s’assurer une place dans un dortoir.
ci-contre à gauche : les dortoirs

CHANOINES
Désigne à la fois des membres du clergé vivant en communauté dans une église ou une cathédrale, et parfois des dignitaires laïcs associés à des titres de noblesse historiques.
CONGRÉGATION
Groupe de personnes unies par des liens spirituels ou religieux, suivant une règle de vie commune sous la direction d’un supérieur., tel que les Franciscains, les Bénédictins, etc.
DORTOIR
Espace destiné au repos et au sommeil de plusieurs individus, souvent disposés côte à côte ou dans des compartiments individuels.
HOSPICE
Forme spécifique d’institution caritative ou sociale, souvent gérée par une communauté religieuse, qui offre des soins, un logement et un soutien spirituel à des personnes dans le besoin.
HOSPITALITÉ
Acte ou la qualité d’accueillir chaleureusement des invités, des étrangers ou des visiteurs, en leur offrant généralement confort, nourriture, logement et une atmosphère accueillante.
PÈLERINS
Personne qui effectue un voyage spécifique, appelé pèlerinage, vers un lieu saint, un sanctuaire, une relique ou un site religieux important dans le but de renforcer sa foi, de chercher la guérison spirituelle, ou d’accomplir un engagement religieux particulier.
VFP : VIA FRANCIGENA
SYNTHÈSE DES CONSTRUCTIONS
Cette synthèse montre les différentes influences des pays frontaliers, notamment l’Italie et l’Allemagne. Le centre de la Suisse est bâti en bois avec différentes techniques d’assemblage.
Tout au long de notre trajet, nous avons observés des constructions faites de pierre et de bois. Parti du Léman où les grandes bâtisses sont faites en pierres, nous sommes arrivés peu à peu dans la montagne. Ce milieu a assuré la transition avec bois.
Nous avons attachés une grande attention aux techniques de constructions développés dans les VFCC (Via Francigena Culture Constructive). Nous allons vous présenter les projets que nous avons développés le long de notre chemin.
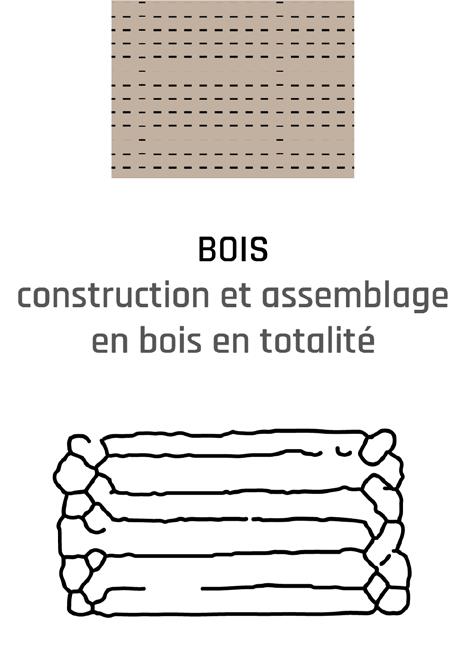






Situé au cœur des vignobles, le projet architectural s’inspire des traditions ancestrales et du riche patrimoine culturel de la région viticole. Il s’agit d’un ensemble de pavillons posés sur des murs en pierres, surplombant les canaux d’irrigation qui serpentent entre les vignes. Ce projet vise à créer un parallèle entre l’architecture contemporaine et les techniques de construction traditionnelle, tout en respectant l’esthétique et l’histoire des lieux.
Quelques pavillons offrent des espaces de refuge accueillants et confortables pour les saisonniers travaillant dans les vignes ainsi que pour les randonneurs explorant les sentiers environnants.
Pour célébrer la culture viticole locale, des espaces dédiés à la dégustation de vin sont intégrés dans notre conception. Ces zones permettent aux visiteurs de savourer les crus locaux, avec des vues imprenables sur les vignes et les canaux. L’aménagement de ces espaces vise à créer une ambiance conviviale et immersive, propice à l’appréciation des richesses œnologiques de la région.
Notre projet valorise les savoir-faire traditionnels en utilisant les mêmes techniques que les maçons locaux qui entretiennent les murs de pierres. Ces murs, constitués de pierres soigneusement choisies et empilées, apportent une authenticité indéniable à l’ensemble. De plus, nous utilisons de la chaux naturelle, teintée pour correspondre aux habitations locales, assurant ainsi une harmonie visuelle et une intégration respectueuse dans le paysage existant.
L’intégration de notre système de pavillons est pensée pour minimiser l’impact environnemental et permettre aux vignerons de perdre le moins de surface de culture possible.
En s’appuyant sur les canaux d’irrigation existants et en utilisant des matériaux locaux, nous réduisons notre empreinte carbone tout en soutenant l’économie locale. L’architecture est conçue pour être durable, capable de résister aux éléments tout en offrant un refuge sûr et agréable pour ses occupants.
Ce projet représente une fusion harmonieuse entre tradition et modernité, célébrant les vignobles et leur histoire tout en offrant des infrastructures contemporaines et fonctionnelles. En honorant les techniques de construction en utilisant des matériaux naturels et locaux, nous créons un espace unique qui invite à la détente, à la découverte et à l’appréciation des trésors viticoles de la région.



Le territoire de la plaine est planifiée en fonction du Rhône. Au centre, des usines, des terres agricoles, des fermes et autres productions économiques. Le Rhone traverse du Sud vers le Nord la plaine tout comme les principaux flux ferrovier et axe routier. Tandis que les villages bordent les montagnes.
Le projet vise à créer une passerelle traversant la plaine de la Valais du Rhône d’Est en Ouest. Ce pont, servira non seulement de point de passage, mais aussi de plateforme multifonctionnelle, intégrant divers programmes tels qu’une gare, un refuge et équipements de loisirs ainsi que des points de vues panoramiques.
La passerelle est située le long de la rivière de la Gryonne, qui prend sa source dans les montagnes, elle traverse la plaine et se déverse dans le Rhone. Le choix de cet emplacement permet de relier efficacement les différentes zones de la plaine tout en offrant des points de vue uniques sur le paysage environnant. La passerelle longe les terrains agricoles et franchit les trois axes majeurs (la voie ferroviaire du train R72, la grande Autoroute du Rhone ainsi que le Rhone).
L’un des grands enjeux de ce projet est également de pouvoir habiter la plaine sans craindre les crues importantes du Rhône.
Nous proposons des interventions sur plusieurs zones traversées. La nouvelle gare régionale, permet un accès aux transports et ainsi d’offrir de nouvelles migrations au sein de la plaine. La gare est imaginée comme une grande hall marchande pour la vente de produits locaux.
La deuxième intervention sur ce pont est un refuge qui un réel lieu d’interaction entre les différents acteurs de ce territoire. Un grand foyer ferait office de lieux de rencontre, de partage entre les nouveaux arrivants et les habitants de la plaine comme les agriculteurs qui partageraient leur savoir-faire et
leur produit en ayant eux-même la possibilité d’habiter la plaine et d’éviter de s’excentrer. La passerelle étant surélevée permet de protéger son pâturage et stockage agricole lors des crues.
Ce pont s’inscrit dans un paysage et permet de le traverser de manière fluide. Il offre la possibilité d’arpenter et de proposer plusieurs séquences paysagères permettant de comprendre pleinement le territoire.
Le vernaculaire industriel étant omniprésent dans cette plaine, le langage architectural du pont serait un rappel à cette architecture du territoire mettant en avant le dynamique économique de la plaine tout en respectant et valorisant le cadre naturel de la région.
Plusieurs sites d’extraction de granulats appelés les gravières font partie du paysage de la plaine. On y extrait des matériaux du fond des rivières ou des plans d’eau à l’aide de drague, puis on utilise des pelles mécaniques pour extraire les matériaux des bancs de graviers. La gravière fournit des granulats pour la fabrication de béton d’asphalte et de mortier.
L’utiliser du gravier extrait est une réelle ressource da la plaine que l’on retrouve dans ce projet.
Ce projet vise à améliorer la connectivité et à offrir des services variés aux usagers de la plaine et également aux randonneurs, marcheurs, visiteurs. Cette passerelle est conçu comme un véritable point de rencontre permettant ainsi d’apporter l’hospitalité, le confort et la migration que l’on retrouve dans chacun de nos projets.




VFP03 : SAVOIR
HORIZONTAL

En lisière de forêt, notre projet architectural prend racine sur le site d’une ancienne scierie, marqueur de son passé industriel. Ce bâtiment en longueur s’intègre harmonieusement dans le paysage naturel, tirant parti des techniques de construction locales et des matériaux indigènes pour créer un espace fonctionnel et serein.
Le bâtiment comprend une série d’espaces dédiés à l’apprentissage et au travail artisanal, répartis de manière à maximiser l’utilisation de la lumière naturelle et à offrir des vues apaisantes sur la forêt environnante. Une salle de classe, une bibliothèque et un atelier de travail offrent des espaces d’apprentissages près de la ressource et de l’atelier.
La lisière de la forêt et les espaces extérieurs jouent un rôle clé dans la transition entre les zones de travail et de repos. Cet espace naturel agit comme une frontière vivante, offrant un cadre de détente et de contemplation, où les occupants peuvent se ressourcer en pleine nature.
Ce projet levier est une architecture active qui abrite un atelier de formation et de travail et des organismes de gestion forestière. Nous avons développés un bâtiment en prolongeant la scierie vers la forêt. De la scierie à la forêt, du travail au repos. Le seuil est marquée par l’espace extérieur situé en lisière de la forêt. Ce lieu a pour vocation de croiser les compétences et les savoir-faire, anciens ou nouveaux. La gestion et la transformation du bois issu de ce bien commun.
Il a aussi pour vocation de développer la culture du bois. Le bâtiment est principalement construit en mélèze, une essence locale prisée pour sa durabilité et son esthétique naturelle. Utilisant des techniques de «moisage», le mélèze est travaillé de manière innovante pour former une structure robuste et élégante.
Cette méthode traditionnelle de construction est mise en œuvre pour assurer une structure solide tout en préservant l’intégrité naturelle du bois. Le mélèze, reconnu pour sa résistance aux intempéries, confère au bâtiment une longévité exceptionnelle et une beauté naturelle intemporelle.
Ce projet de réhabilitation d’une ancienne scierie en centre de travail et de repos illustre parfaitement la synergie entre tradition et modernité. En mettant en valeur les techniques de construction locales et en utilisant des matériaux durables, nous créons un espace multifonctionnel qui respecte et enrichit son environnement naturel. Le bâtiment, avec sa conception allongée et ses zones distinctes de travail et de repos, offre un cadre unique où les utilisateurs peuvent s’inspirer de la nature tout en poursuivant leurs activités professionnelles et éducatives.



VFP04 : RENAISSANCE DE L’HOSPITALITÉ

La station de ski Super Saint-Bernard est une petite station nichée dans la région du Grand-Saint-Bernard, réputée pour ses paysages alpins spectaculaires et son atmosphère tranquille. La station a été inaugurée dans les années 1960, bénéficiant de la popularité croissante des sports d’hiver en Europe. Située près du Col du Grand-Saint -Bernard, elle offre un accès facile aux pistes de ski depuis l’Hospice et les environs.
Initialement équipée de remontées mécaniques modernes pour l’époque, la station a constamment évolué pour améliorer l’expérience des visiteurs. Mais en 2020, la station a malheureusement fermé ses portes. Plusieurs facteurs ont contribué à cette fermeture, notamment les difficultés financières et la concurrence des grandes stations de skis environnantes.
Depuis la fermeture des remontées mécaniques, la région continue d’attirer les amateurs de montagne pour des activités comme la randonnée à ski et les raquettes. Il y a eu des discussions et des projets pour rouvrir la station, notamment en misant sur un tourisme durable et respectueux de l’environnement, mais aucune réouverture officielle n’a encore eu lieu. La station abandonnée constitue le point de départ et d’arrivée côté Suisse pour l’ascension du col du Grand-Saint -Bernard. Nous souhaitions redonner vie à cette station abandonnée en retrouvant l’atmosphère chaleureuse que nous avions rencontré lors de notre séjour à l’Hospice.
L’enjeu de ce projet est également de démontrer qu’il est possible de donner une seconde vie à ce bâtiment. Le projet vise à revitaliser la station Super Saint-Bernard en construisant une surélévation légère de la station. La rénovation de la station et de son restaurant, et également la possibilité d’accueillir des nouveaux arrivants au sein d’un foyer, d’un refuge permettant de se reposer avant de préparer l’ascension.
Prenant en considération les risques climatiques et météorologiques des environs, la station accueillerait
également un bureau des guides donnant les informations nécessaires et pouvant accompagner les randonneurs et skieurs. Un espace de location, vente de matériel ainsi qu’un atelier de réparation sont intégrés dans la station. Cette station complète également l’offre estivale existante basée sur la pratique de la randonnée, de l’escalade et du cyclisme.
A l’arrière de la station, à l’Est, un téléski ainsi qu’un cours d’eau venant des montagnes, se déversant ensuite dans la Dranse sont des éléments «cachés» par la station lorsque l’on se situe sur le parking. L’intérêt de ce projet et suivant notre démarche de franchissement nous souhaitions redonner vie à cette zone en offrant la possibilité de traverser la station pour les atteindre.
L’intérêt de ce site est également ses vues dégagées sur les montagnes environnantes et le lac des Toules. La partie extérieure est occupée par une terrasse exposée sud ouest permettant de profiter pleinement du paysage. Son exposition et notre démarche basée sur l’apport énergétique de nos interventions ont fait lien pour penser qu’une toiture avec des sheds accueillant des panneaux photovoltaïques captent ainsi un maximum d’énergie solaire dans le but de pouvoir possiblement rendre ce bâtiment autonome.
La trame poteau poutre en bois travaillée sur la base des séquences en façade de la station montre l’intérêt d’une légèreté dans notre intervention. La surélévation ne souhaitant pas à cacher le bâtiment mais plutôt le mettre en valeur à travers la reprise d’une trame existante.
Ce projet vise à faire renaître cette station abandonnée qui fait partie du patrimoine local, permettant de retrouver l’hospitalité, la convivialité et le confort de l’Hospice du Grand Saint Bernard. La station devient alors un réel point de rencontre entre les voyageurs, les guides, les chanoines de la congrégation du Grand Saint Bernard descendant de l’Hospice, créant des nouvelles situations de partage et d’échanges.



BIBLIOGRAPHIE
• RIVES DE LAC ; LES MURS DE LAVAUX
BIBLIOGRAPHIE
Kazemi, Y. (s.d.). Forêts et vignoble de Lavaux. Ingénieurforestier, 2018.
Reynard, E. (s.d.). Lecture géomorphologique du paysage et incidence sur la viticulture. Université de Lausanne, 2018.
Richards, M. (s.d.). Le monde vitivinicole. Guide du patrimoine de Lavaux, 2018
SITOGRAPHIE
Lavaux, vignoble en terrasses - Patrimoine mondial de l’UNESCO. (s.d.). Site officiel de Lavaux UNESCO. https://www.lavaux-unesco.ch
Lavaux, vignoble en terrasses - UNESCO. (s.d.). Site officiel de l’UNESCO. https://whc.unesco.org/fr/list/1243/
FILMOGRAPHIE
Lavaux Patrimoine mondial (LPm). (2024, 25 avril). 1. Introduction au projet et cadrage général | Murs de vigne à Lavaux [Vidéo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=foWVwd4a2U0
•
PLAINE ; LE VERNACULAIRE INDUSTRIEL
BIBLIOGRAPHIE
Baud, D., & Reynard, E. Géohistoire d’une trajectoire paysagère dans la plaine du Rhône valaisan, 2015.
Firreri, F. Patrick Giromini, Transformations silencieuses, étude architecturale du bâti alpin. Les Cahiers de la Recherche Architecturale, Urbaine et Paysagère, 2023.
Giromini, P. Désinences vernaculaires : architecture alpine en Valais. ARCHALP, 2021.
Rosselli, W., & Paulmier, E. Évolution de la qualité du paysage de la plaine du Rhône valaisan sur la base de cartes historiques. Revue Forestière Française, 2006.
•
MONTAGNE ; LES MOULINS DE LIDDES
BIBLIOGRAPHIE
Béguillet, E., Manuel du meunier et du charpentier du moulin ou abrégé classique de la mouture par économie, rédigé sur les mémoires du sieur César Buquet, Paris, 1775; 2e éd.,
Delacretaz, P. Les vieux moulins du pays de Vaud et d’ailleurs, Ed. Delplast, Romanel-Lausanne, 1986.
Dubler, A. Moulins, Dictionnaire historique de la Suisse, 1992.
Pelet, P., & Lattion, T. Survivre à la révolution industrielle. Bulletin Annuel de la Bibliothèque et des Archives Cantonales du Valais, 1989.
SITOGRAPHIE
Association suisse des Amis des Moulins, www.muehlenfreunde.ch
Fédération des Moulins de France, www.fdmf.fr
Plan régional du Grand Entremont, https://www.grand-entremont.ch
•
COL ; L’HOSPICE DU GRAND-SAINT-BERNARD
BIBLIOGRAPHIE
Blondel L. L’Hospice du Grand St Bernard, Vallesia éditions, 1946.
Quaglia L. La maison du Grand Saint Bernard des origines aux temps actuels, Piller Martigny imprimerie, 1972.
Regamey F. Une excursion au Grand Saint Bernard : la route - l’hospice, Firmin-Didot éditeurs, 1894.
Putallaz, P. Sur le passage du Saint-Bernard par Bonaparte en 1800. Annales Valaisannes : Bulletin Trimestriel de la Société D’histoire du Valais Romand, 157-201, 1975.
Putallaz, P. Sur le passage du Saint-Bernard par Bonaparte en 1800. Annales Valaisannes : Bulletin Trimestriel de la Société D’histoire du Valais Romand, 157-201, 1975.
• GÉNÉRALE
BIBLIOGRAPHIE
Ankaoua M. Kilomètre Zéro, Éditions Eyrolles, 2023.
Amphoux P. Vers une théorie des trois conforts. Annuaire 90, 1990, pp. 27-30.
Antoine J-M. La ressource montagne, Éditions l’Harmattan, 2011.
Bouhaouala M. La montagne en question(s) Enjeux et controverses à partir des Alpes. UGA Éditions, 2023.
De la Soudière M. Arpenter le paysage, Anamosa, 2019.
Lyon-Caen J-F. Montagnes, territoires d’inventions, École
d’Architecture de Grenoble, 2003.
Michelet J. La montagne, études, éditions Hachette, 2021.
Mortamet A. et Walther R. Le tour des matériaux d’une maison écologique, Éditions Alternatives, 2023.
Rudofsky B. Architectures sans architectes : brève introduction à l’architecture spontanée, éditions du Chêne, 1980.
MERCI
Nous tenons à remercier Magali Paris et Jean Patrice Calori pour le développement de ce guide. Tout nos échanges nous ont permis de construire une pensée sensible. Votre engagement à nos côtés nous a permis d’écrire ce guide et de bâtir une véritable réflexion pour notre futur.
Nous remercions les personnes de notre groupe de projet pour les échanges précieux, les réflexions de projets, le soutien et l’entraide.
Merci à l’École Nationale d’Architecture de Versailles de nous avoir offert les outils et un enseignement de qualité.
Et enfin merci à nos familles et amis respectifs pour leur soutien et motivations quotidiennes. Merci aux personnes qui nous ont soutenus et participer à l’aboutissement de ce projet de fin d’étude.
ERWAN A.
MATTHIEU B.
MATTHIEU LH.
ANA B.
LOUNA M.
LÉA S.
MARION C.
MATISSE P.
ALEXANDRE C.
VICTOR S.
MARGUERITE L.
RUBEN B.
SACHA H.
NICOLAS M.
MERCI AUX COPAINS
LEONOR D.
PAULINE G.

LOUNA, ANA ET PAULINE.

LE RIGUET-MINARRO
les architectes randonneurs - TOME I
Par Mélissa Riguet et Antoine Minarro
À travers quatre sujets de construction sélectionnés, explorez en profondeur les techniques architecturales, les matériaux utilisés et les défis relevés par les bâtisseurs d’hier et d’aujourd’hui. En tant qu’étudiants en architecture, nous partageons nos recherches, observations et réflexions sur l’importance de ces constructions dans le cadre de notre formation. Illustré de photos, de croquis, ce guide vous permet de visualiser les techniques de constructions que nous avons observé le long de la Via Francigena.
Que vous soyez un passionné d’architecture, un étudiant ou simplement curieux de découvrir les trésors cachés de la Via Francigena, ce guide vous offrira une culture constructive le long d’un parcours historique.
LE RIGUET MINARRO GUIDE
Disponible dès maintenant dans les librairies et en ligne.
