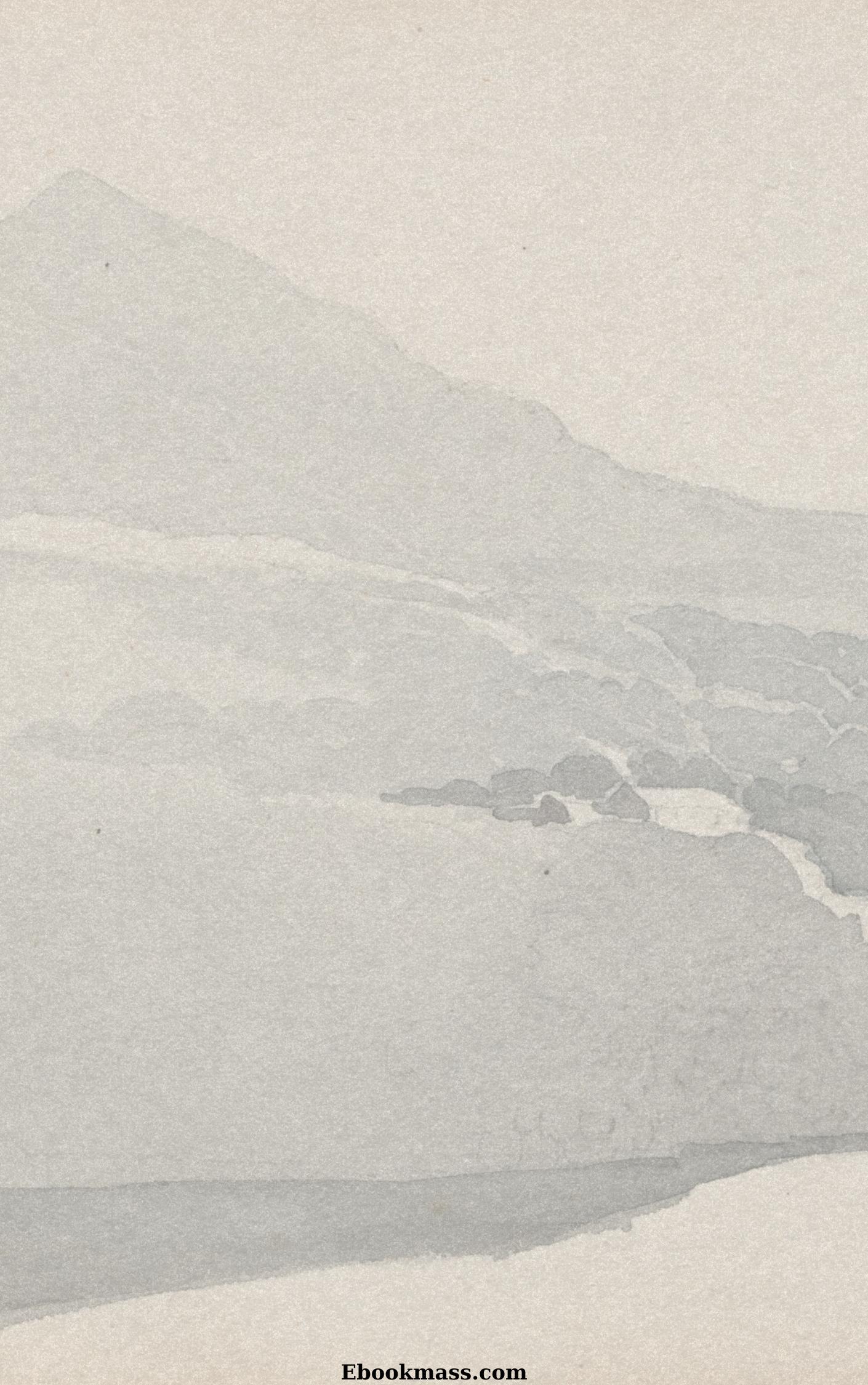
https://ebookmass.com/product/immunopathologie-2e-edition-
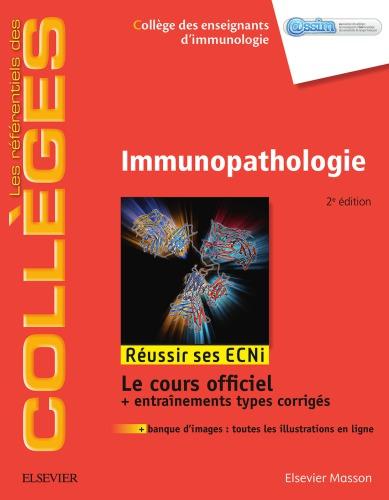

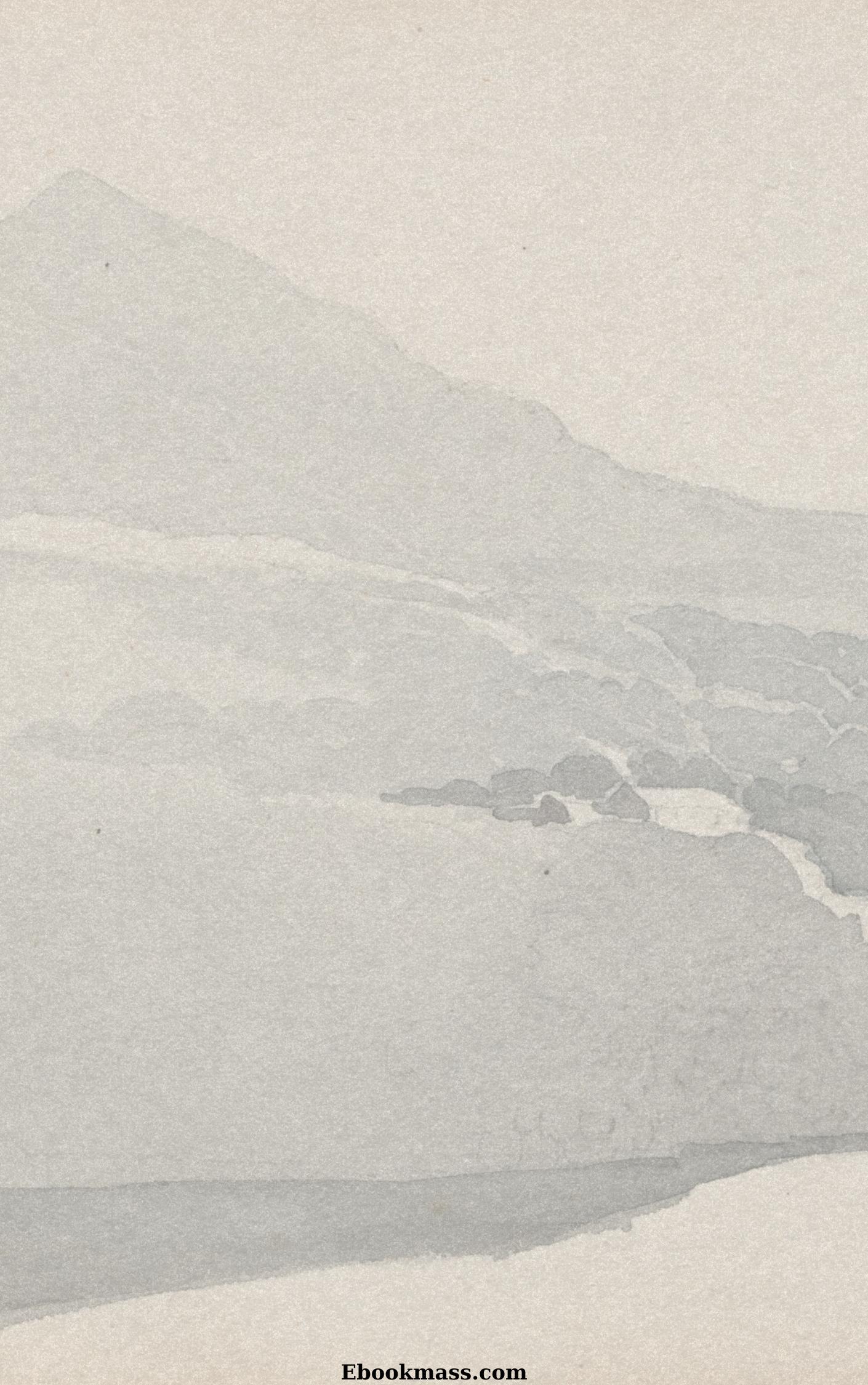
https://ebookmass.com/product/immunopathologie-2e-edition-
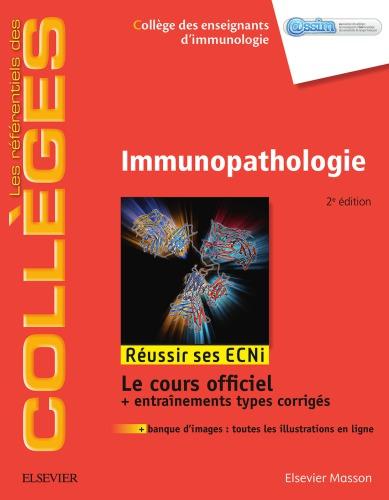
https://ebookmass.com/product/the-goddess-gets-her-guy-ashlyn-chase-3/
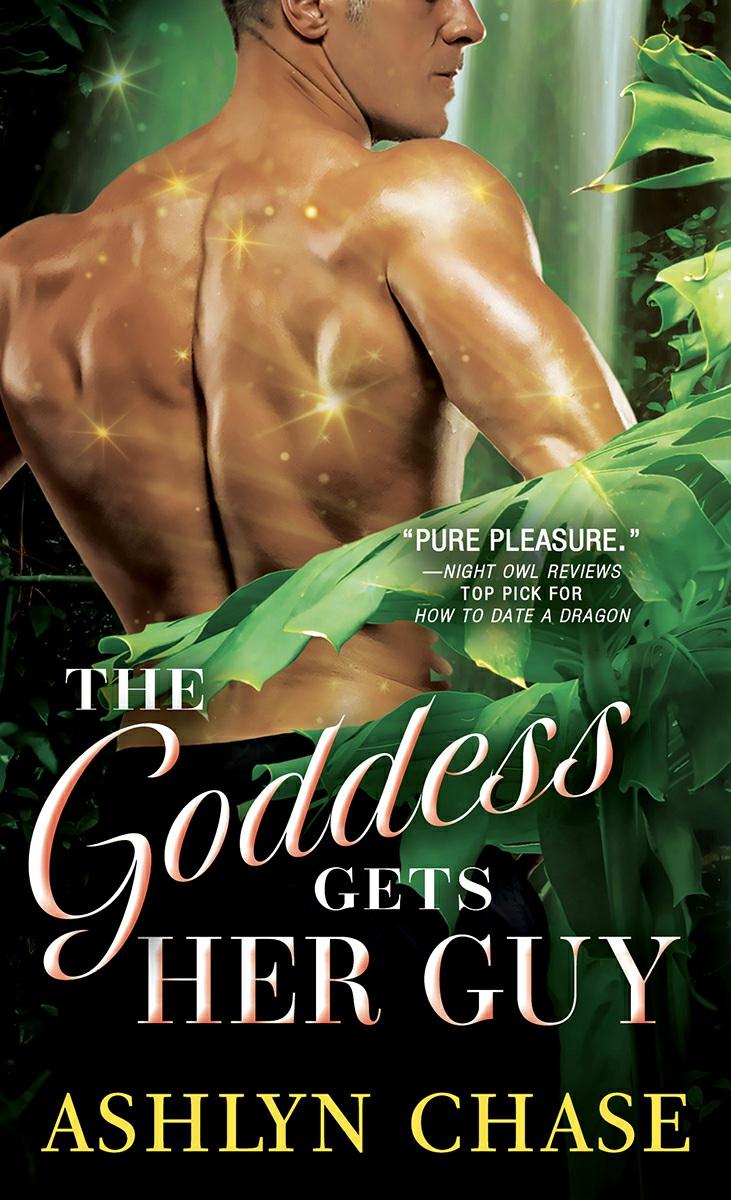
ebookmass.com
2e édition
Du même Collège
Immunologie fondamentale et immunopathologie. Enseignements thématique et intégré - Tissu lymphoïde et sanguin / Immunopathologie et immuno-intervention. 2e édition, 2018, 344 pages.
Dans la même collection
Anatomie pathologique, par le Collège français des pathologistes (CoPath). 2013, 416 pages.
Cardiologie, par le Collège national des enseignants de cardiologie – Société française de cardiologie (CNECSFC). 2e édition, 2014, 464 pages.
Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, par le Collège hospitalo-universitaire français de chirurgie maxillofaciale et stomatologie. 3e édition, 2014, 384 pages.
Dermatologie. Réussir les ECNi, par le CEDEF (Collège des enseignants en dermatologie de France). 7e édition, 2017, 440 pages.
Endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques, par le CEEDMM (Collège des enseignants d'endocrinologie, diabète et maladies métaboliques). 3e édition, 2016, 616 pages.
Gériatrie, par le Collège national des enseignants de gériatrie (CNEG). 3e édition, 2014, 276 pages.
Gynécologie – Obstétrique, par le Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF). 3e édition, 2014, 504 pages.
Hépato-gastro-entérologie, par la Collégiale des universitaires en hépato-gastro-entérologie (CDU-HGE). 3e édition, 2015, 512 pages.
Imagerie médicale - Radiologie et médecine nucléaire, par le CERF (Collège des enseignants de radiologie de France) et le Collège national des enseignants de biophysique et de médecine nucléaire (CNEBMN). 2e édition, 2015, 632 pages.
Immunopathologie, par le Collège des enseignants d'immunologie, 2015, 328 pages.
Médecine physique et de réadaptation par le Collège français des enseignants universitaires de médecine physique et de réadaptation. 5e édition, 2015, 312 pages.
Neurologie, par le Collège des enseignants de neurologie, 4e édition, 2016, 600 pages.
Neurochirurgie, par le Collège de neurochirurgie, 2016, 272 pages.
Nutrition, par le Collège des enseignants de nutrition. 2e édition, 2015, 256 pages.
Ophtalmologie, par le Collège des ophtalmologistes universitaires de France (COUF). 4e édition, 2017, 336 pages.
ORL, par le Collège français d'ORL et de chirurgie cervico-faciale. 4e édition, 2017, 432 pages.
Parasitoses et mycoses des régions tempérées et tropicales, par l'Association française des enseignants de parasitologie et mycologie (ANOFEL). 3e édition, 2013, 504 pages.
Pédiatrie, par A. Bourrillon, G. Benoist, le Collège national des professeurs de pédiatrie. 7e édition, 2017, 1016 pages.
Réanimation et urgences, par le Collège national des enseignants de réanimation (CNER). 4e édition, 2012, 676 pages.
Rhumatologie, par le Collège français des enseignants en rhumatologie (COFER), 2015, 560 pages.
Santé publique, par le Collège universitaire des enseignants de santé publique (CUESP). 3e édition, 2015, 464 pages.
Urologie, par le Collège français des urologues (CFU). 3e édition, 2015, 440 pages.
Retrouvez toute l'actualité relative aux Référentiels des Collèges en vous connectant à l'adresse suivante : http://www.blog-elsevier-masson.fr/2018/06/lactualite-referentiels-colleges/
Les auteurs de la présente édition
Les auteurs de la 1re édition
Avant-propos
Compléments en ligne : banque d'images
Abréviations
1 Allergies et hypersensibilités chez l'enfant et chez l'adulte
Aspects épidémiologiques, diagnostiques et principes du traitement
I Mécanismes physiopathologiques des hypersensibilités allergiques
Épidémiologie des hypersensibilités allergiques
Cet ouvrage a été rédigé sous l'égide de l'ASSIM, Association des Collèges des enseignants d'Immunologie des universités de langue française.
Coordination de l'ouvrage
Marie Christine Béné, PU-PH en hématologie, CHU de Nantes, faculté de médecine, université de Nantes.
Jean-Daniel Lelièvre, PU-PH en immunologie, hôpital Henri-Mondor, faculté de médecine, université Paris-Est Créteil.
Jean Sibilia, PU-PH en rhumatologie, CHU Strasbourg-Hautepierre, faculté de médecine de l'université de Strasbourg.
Auteurs
Bertrand Arnulf, hôpital Saint-Louis, faculté de médecine, université Denis-Diderot, Paris.
Frédéric Batteux, hôpital Cochin, faculté de médecine, université René-Descartes, Paris.
Marie Christine Béné, CHU de Nantes, faculté de médecine, université de Nantes.
Frédéric Bérard, Hospices Civils de Lyon, faculté de médecine, université Claude-Bernard.
Bernard Bonnotte, CHU le Bocage, Dijon, faculté de médecine, université de Bourgogne.
Sylvain Dubucquoi, CHU de Lille, faculté de médecine, université Lille 2.
Gilbert Faure, CHU de Nancy, faculté de médecine, université de Lorraine.
Bruno Fautrel, hôpital Pitié-Salpêtrière, faculté de médecine, université Pierre-et-Marie-Curie, Paris.
Jean-Paul Fermand, hôpital Saint-Louis, faculté de médecine, université Denis-Diderot, Paris.
Joëlle Goetz, CHU Strasbourg-Hautepierre, faculté de médecine de l'université de Strasbourg.
Guy Gorochov, hôpital Pitié-Salpêtrière, faculté de médecine, université Pierre-et-Marie-Curie, Paris.
Pierre-André Guerne, Hôpitaux universitaires de Genève.
Amélie Guihot, hôpital Pitié-Salpêtrière, faculté de médecine, université Pierre-et-Marie-Curie, Paris.
Cyrille Hoarau, CHU Bretonneau, université François-Rabelais, Tours.
Arnaud Jaccard, CHU de Limoges.
Sophie Jego-Desplat, hôpital de la Conception, faculté de médecine, université de la Méditerranée Aix-Marseille
Jean-Emmanuel Kahn, hôpital Foch, Suresnes.
Gilles Kaplanski, hôpital de la Conception, faculté de médecine, université de la Méditerranée Aix-Marseille.
Niloufar Kavian, hôpital Cochin, faculté de médecine, université René-Descartes, Paris.
Olivier Lambotte, hôpital Kremlin-Bicêtre, faculté de médecine, université Paris-Sud.
Yvon Lebranchu, CHU Bretonneau, université François-Rabelais, Tours.
Guillaume Lefèvre, CHU de Lille, faculté de médecine, université Lille 2.
Jean-Daniel Lelièvre, hôpital Henri-Mondor, faculté de médecine, université Paris-Est Créteil.
François Lemoine, hôpital Pitié-Salpêtrière, faculté de médecine, université Pierre-et-Marie-Curie, Paris.
Thierry Martin, hôpital de Strasbourg, faculté de médecine de l'université de Strasbourg.
Pierre Miossec, Hospices Civils de Lyon, faculté de médecine, université Claude-Bernard.
Makoto Miyara, hôpital Pitié-Salpêtrière, faculté de médecine, université Pierre-et-Marie-Curie, Paris.
Luc Mouthon, hôpital Cochin, faculté de médecine, université René-Descartes, Paris.
Jean François Nicolas, Hospices Civils de Lyon, faculté de médecine, université Claude Bernard.
Accédez à la banque d'images de cet ouvrage : l'ensemble des illustrations y sont regroupées et accessibles facilement via un moteur de recherche. Et retrouvez d'autres fonctionnalités. Pour accéder à cette base iconographique, connectez-vous sur www.em-consulte.com/e-complement/4756488 et suivez les instructions pour activer votre accès.
LHF lymphohistiocytose familiale
LMC leucémie myéloïde chronique
LPS lipopolysaccharide
MAIPA monoclonal antibody specific immobilization of platelet antigen
MAT micro-angiopathie thrombotique
MCP articulation métacarpophalangienne
MICI maladie inflammatoire chronique de l’intestin
MPA polyangéite microscopique
MPO myéloperoxydase
MTP articulation métatarsophalangienne
NET nécrolyse épidermique toxique
NFS numération-formule sanguine
NK natural killer
NOIA neuropathie optique ischémique antérieure
OACR occlusion de l’artère centrale de la rétine
OMS Organisation mondiale de la santé
PAN périartérite noueuse
PCR polymerase chain reaction
PGE2 prostaglandine E2
PLC progéniteur lymphoïde commun
PNE polynucléaires éosinophiles
PNRG Pôle national de répartition des greffons
PPC pyrophosphate de calcium
PPR pseudopolyarthrite rhizomélique
PR polyarthrite rhumatoïde
PRA panel reactive antibody
PSA prostate specific antigen (antigène prostatique spécifique)
PTI purpura thrombopénique immunologique
PTT purpura thrombotique thrombocytopénique
SAP serum amyloid component
SAPL syndrome des antiphospholipides
SDRC syndrome douloureux régional complexe
SEIPA syndrome d’entérocolite induite par les protéines alimentaires
SHE syndrome hyperéosinophilique
SHU syndrome hémolytique et urémique
SLICC Systemic Lupus International Collaborating Clinics
TCA temps de céphaline activée
TCR T-cell receptor
TDA test direct à l’antiglobuline
TDM tomodensitométrie
TEP tomographie par émission de positons
TIL tumor infiltrating lymphocytes
TLR toll-like receptors
TNF tumor necrosis factor
TP taux de prothrombine
TRAPS TNF receptor-associated periodic syndrome
Treg lymphocyte T régulateur
Abréviations
Abréviations
TSH thyroid stimulating hormone
TTR transthyrétine
VCA virus capsid antigen
VEMS volume expiratoire maximal par seconde
VGM volume globulaire moyen
VHB virus de l’hépatite B
VHC virus de l’hépatite C
VIH virus de l’immunodéficience humaine
VRS virus respiratoire syncytial
VS vitesse de sédimentation
XLP X-linked proliferative disease
I. Mécanismes physiopathologiques des hypersensibilités allergiques
II. Épidémiologie des hypersensibilités allergiques
III. Principales sources allergéniques
IV. Évolution de l'allergie
V. Manifestations cliniques de l'allergie
VI. Diagnostic des hypersensibilités allergiques
VII. Principes des traitements des maladies allergiques
Item 182 Hypersensibilités et allergies chez l'enfant et l'adulte : aspects physiopathologiques, épidémiologiques, diagnostiques et principes de traitement.
Item 183 Hypersensibilités et allergies cutanéomuqueuses chez l'enfant et l'adulte. Urticaire, dermatites atopique et de contact.
Item 184 Hypersensibilité et allergies respiratoires chez l'enfant et chez l'adulte. Asthme, rhinite.
Objectifs pédagogiques
Item 182
Expliquer la physiopathologie des réactions d'hypersensibilité : allergique et non allergique.
Expliquer l'épidémiologie, les facteurs favorisants et l'évolution des principales hypersensibilités de l'enfant et de l'adulte : alimentaire, respiratoire, cutanée, médicamenteuse et peranesthésique, venins d'hyménoptères.
Expliquer les principales manifestations cliniques et biologiques et argumenter les procédures diagnostiques.
Argumenter les principes du traitement et de la surveillance au long cours d'un sujet hypersensible, en tenant compte des aspects psychologiques.
Item 183
Expliquer la physiopathologie de l'urticaire et des dermatites atopique et de contact. Diagnostiquer une hypersensibilité cutanéomuqueuse aiguë et/ou chronique chez l'enfant et chez l'adulte.
Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient.
Identifier le caractère professionnel d'une dermatose allergique : démarche diagnostique étiologique, éviction du risque.
Selon les récepteurs de l'immunité adaptative impliqués, on différencie les allergies consécutives à la reconnaissance de l'allergène par des immunoglobulines (Ig) de type E (allergies IgE-dépendantes, ou hypersensibilité allergique immédiate), car les symptômes apparaissent très rapidement après l'exposition, de celles qui ne sont pas liées aux IgE (allergies non IgEdépendantes) qui sont retardées (plusieurs heures à plusieurs jours). Ces dernières impliquent le plus souvent des lymphocytes T, mais également des immunoglobulines.
La classification immunologique ancienne de Gell et Coombs reste encore largement utilisée du fait de sa simplicité. Elle différencie les allergies en, respectivement (tableau 1.2) :
• type I pour les allergies IgE-dépendantes ;
• type II pour celles dépendantes des anticorps des IgG et du complément ;
• type III pour celles dépendantes de complexes immuns ;
• type IV pour celles dépendantes des lymphocytes T.
Le chapitre 19 de l'ouvrage Immunologie fondamentale et immunopathologie. Enseignements thématique et intégré - Tissu lymphoïde et sanguin - Immunopathologie et immuno-intervention, par le Collège des Enseignants en Immunologie, est entièrement consacré aux mécanismes physiopathologiques des hypersensibilités. Nous n'aborderons ici que les types I et IV.
La HSI correspond cliniquement aux conséquences de l'activation brutale des mastocytes et des polynucléaires basophiles après reconnaissance de l'allergène par les IgE préalablement fixées à la surface de ces cellules.
Les IgE sont produites lors de la phase de sensibilisation et se lient à leurs récepteurs de forte affinité (RFcεI) sur les mastocytes et les basophiles. Cette liaison ne nécessite pas la présence de l'allergène correspondant.
Lorsque les IgE fixées sur leurs récepteurs de haute affinité (FcεRI) des mastocytes ou des polynucléaires basophiles sont spécifiquement agrégées par l'allergène, ces récepteurs transmettent un signal d'activation cellulaire rapidement amplifié, qui provoque en quelques minutes (caractère immédiat) l'exocytose du contenu d'un compartiment spécialisé, appelé granules sécrétoires. Ces granules contiennent des substances vasoactives, dont principalement l'histamine et la tryptase qui sont responsables de l'apparition en quelques minutes des symptômes de l'allergie. La stimulation du FcεRI induit également des cascades de signalisation par la voie des phospholipides membranaires et par l'induction de transcription génique. Cette activation correspond cliniquement aux manifestations tardives de l'hypersensibilité immédiate ou phase retardée de l'hypersensibilité immédiate (à ne pas confondre avec l'hypersensibilité retardée). Les symptômes apparaissent en quelques heures après le contact allergénique, liés à la libération des produits de dégradation de l'acide arachidonique de la membrane des granules (prostaglandines, leucotriènes), et à la production de cytokines proinflammatoires et de chimiokines. Il s'ensuit un recrutement de cellules inflammatoires dans le tissu concerné.
La stimulation chronique des effecteurs de l'hypersensibilité immédiate conduit au développement d'une réponse inflammatoire allergique chronique, à l'origine du remodelage du tissu atteint, par exemple le remodelage bronchique au cours de l'asthme. Plus récemment, d'autres effecteurs et médiateurs ont été mis en évidence dans les réactions d'hypersensibilités immédiates (polynucléaires neutrophiles et IgG). Compte tenu de ces deux derniers points (réaction tardive et implication des IgG et des polynucléaires neutrophiles), la classification de Coombs apparaît donc obsolète.