Version provisoire
MANUEL DE L'ÉLÈVE - RÉFÉRENTIEL
Culture et citoyenneté québécoise 5e secondaire


Version provisoire
MANUEL DE L'ÉLÈVE - RÉFÉRENTIEL
Culture et citoyenneté québécoise 5e secondaire

Direction de l’édition
Geneviève Bourbeau
Marie-Josée Charette
Direction de la production
Manon Boulais
Charge de projet
Anita Rathé
Révision linguistique
Karine Lavoie
Correction d’épreuves
Marie Théorêt
Conception graphique
Curcuma
Réalisation graphique

ILLUSTRATIONS
Maxime Bigras : p. 1 (haut, troisième à partir de la gauche) ; p. 19-21
Simon Bousquet : p. 1 (haut, deuxième et quatrième à partir de la gauche) ; p. 6, 22-23
Marie-Joëlle Fournier : p. 1 (haut, dernière à droite) ; p. 25-33
La Loi sur le droit d’auteur interdit la reproduction d’œuvres sans l’autorisation des titulaires des droits. Or, la photocopie non autorisée – le photocopillage –a pris une ampleur telle que l’édition d’œuvres nouvelles est mise en péril. Nous rappelons donc que toute reproduction, partielle ou totale, du présent ouvrage est interdite sans l’autorisation écrite de l’Éditeur.
Les Éditions CEC inc. bénéficient du soutien de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) pour l’édition de cet ouvrage. Gouvernement du Québec – Programme de crédit d’impôt pour l’édition de livres – Gestion SODEC.
Remerciements
L’Éditeur remercie les personnes suivantes pour leur contribution au développement de la collection grâce à leurs commentaires et suggestions :
Chanel Gagnon-Perreault, enseignante, Centre de services scolaire des Patriotes
Martin Lévesque, enseignant et formateur, Centre de services scolaire des Affluents
Audrey Magne, enseignante, Centre de services scolaire des Affluents
L’Éditeur remercie également les enseignantes et enseignants ainsi que les conseillères et conseillers pédagogiques qui ont pris part à des entretiens avec l’équipe éditoriale ou qui ont participé aux groupes de discussion, aidant ainsi à développer la collection en fonction des réalités et des pratiques de la classe.
Enfin, l’Éditeur remercie la sexologue Émilie Veilleux et la professeure
Sivane Hirsch, spécialiste de la diversité ethnoculturelle et religieuse et du traitement des thèmes sensibles, pour leur travail de consultation scientifique.
Enjeux citoyens (Manuel de l’élève-Référentiel) © 2025, Les Éditions CEC inc. 9001, boul. Louis-H.-La Fontaine
Anjou (Québec) H1J 2C5
Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire, d’adapter ou de traduire l’ensemble ou toute partie de cet ouvrage sans l’autorisation écrite du propriétaire du droit d’auteur.
Dépôt légal : 2025
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives Canada
ISBN 978-2-XXXX-XXXX-X
[Autres ISBN à venir]
Imprimé
2 Les finalités
3 Les fondements
4 Les thèmes et les concepts
6 La culture et les réalités culturelles
7 Des exemples de perspectives
8 La compétence 1 et La sociologie
13 La compétence 2 et L'éthique
18 Une comparaison entre la démarche sociologique et la démarche éthique
34 Les formes de dialogue
36 Les conditions favorables à l’interaction
37 Des moyens pour appuyer ses idées 40

19 Les biais sociocognitifs
22 Les types de jugement
24 Les types de raisonnement
25 Les erreurs de raisonnement
Le programme Culture et citoyenneté québécoise propose une réflexion structurée où le dialogue et la pensée critique sont des piliers fondamentaux pour favoriser le développement de connaissances, de savoir-faire et de savoir-être.
Le programme Culture et citoyenneté québécoise vise le déploiement de trois finalités. Les finalités 2 et 3 se situent à l’intérieur de la première.
Citoyenneté
Manière dont les individus vivent en relation dans leur société. La citoyenneté implique des droits, des devoirs et des responsabilités qui lient ensemble les individus, les différents groupes de la société et l’État.

1
Préparer à l’exercice de la citoyenneté québécoise
Viser la reconnaissance de soi et de l’autre
2
Poursuivre le bien commun
3
Dans le Programme, c'est la culture de la société québécoise qui constitue l'objet des apprentissages. Elle y est définie comme l'ensemble des manières de penser, de ressentir et d'agir qui s'expriment dans un groupe ou dans la société.

Le programme Culture et citoyenneté québécoise s'inscrit dans deux disciplines : la sociologie et la philosophie éthique
La sociologie est une science sociale qui s'intéresse aux relations entre les individus, les groupes et les institutions. Elle propose une démarche critique d'observation et d'analyse (voir p. 9) selon différentes perspectives pour mieux comprendre la culture et la citoyenneté au Québec.
L'éthique est un domaine de la philosophie qui étudie les repères qui orientent les comportements humains dans la société.
Elle porte sur les actions considérées comme étant acceptables ou à privilégier dans une situation. La démarche éthique (voir p. 15) permet de chercher des solutions qui visent le bien commun.
Les approches sociologique et éthique viennent éclairer la pratique du dialogue et le développement de la pensée critique
Le dialogue est un acte de pensée intentionnel qui se déroule à l’intérieur de soi ou en interaction avec les autres. Cet échange vise la reconnaissance et la compréhension des différents points de vue sur une réalité culturelle. Il prend la forme d’une progression de la pensée par l'intégration de plusieurs connaissances, de points de vue et d’expériences.
La pensée critique vient soutenir la construction de connaissances et la prise de décision. Elle nous aide à distinguer les informations sur lesquelles nous baser pour faire des choix. Est-ce que ces informations sont fiables, utiles et pertinentes ?
Le contenu est organisé en thèmes qui visent la poursuite des finalités du Programme. En 5e secondaire, les thèmes, les concepts principaux et les concepts particuliers sont les suivants :
CONCEPTS PRINCIPAUX

Construction de soi
Questions philosophiques existentielles
Agentivité sexuelle et affirmation de soi
Intégration sociale et culturelle Formes de savoirs
CONCEPTS PARTICULIERS
Réflexion et introspection Relations interpersonnelles, affectives et amoureuses
Rites de passage et expériences marquantes
Choix relatifs à l’âge adulte
Engagement social
Religions et spiritualités
Philosophies
Idéologies
Savoirs oraux, pratiques et expérientiels
Sciences
CONCEPTS PRINCIPAUX
Pouvoir
Inégalités sociales
Égalité et inclusion sociale Mouvement social Changement social
CONCEPTS PARTICULIERS
Sexisme et autres inégalités en lien avec le genre et la sexualité
Racisme et colonialisme
Inégalités socioéconomiques
Inégalités environnementales
Politiques publiques égalitaires
Pratiques égalitaires
Réconciliation
Chacun des thèmes du cours Culture et citoyenneté québécoise intègre des contenus liés à l’éducation à la sexualité. Ceux-ci s’inscrivent dans une progression des apprentissages qui présente une vision globale, positive et inclusive de la sexualité. L’objectif est de permettre l’acquisition de connaissances, mais aussi le développement d’attitudes ainsi que de comportements respectueux et égalitaires.
L’éducation à la sexualité repose sur des valeurs comme l’égalité de sexe et de genre, le respect de la diversité, le respect de l’intégrité physique et psychologique, le sens des responsabilités et le bien-être.
Les notions d’éducation à la sexualité liées aux thèmes sont les suivantes.
Construction de soi
Agentivité sexuelle et affirmation de soi
Réflexion sur soi et introspection
Intégration sociale et culturelle
Relations interpersonnelles, affectives et amoureuses
Choix relatifs à l'âge adulte

GROUPES SOCIAUX ET RAPPORTS DE POUVOIR
Inégalités sociales
Sexisme et autres inégalités en lien avec le genre et la sexualité
Égalité et inclusion sociale
Politiques publiques égalitaires
Pratiques égalitaires
La culture, c’est l’ensemble des manières de penser, de ressentir et d’agir qui s’expriment dans un groupe ou une société. Elle est le résultat d’une évolution passée et elle continue de se transformer au fil du temps. On distingue la culture première de la culture seconde.
1La culture première est composée des repères et des évidences du quotidien, souvent intériorisés depuis l’enfance. Elle est issue des interactions avec les proches (ex. : alimentation, langue parlée, habitudes de vie).
La culture seconde est constituée de l’ensemble des œuvres, des systèmes de signification et des symboles que l’humanité a produits pour réfléchir à la culture première. Elle découle des interactions avec d’autres individus, des groupes ou des institutions (ex. : lois, connaissances apprises à l’école ou via divers médias).
Une réalité culturelle, c’est un élément de la culture, ou encore des façons de faire dans une société à une époque donnée. Pour comprendre une réalité culturelle, on peut notamment l’étudier et la comparer avec des réalités culturelles d’autres sociétés.
Dans une société, les individus et les groupes peuvent avoir des perspectives différentes sur une réalité culturelle. Cela veut dire que selon leurs expériences et leurs différents groupes d’appartenance, les gens peuvent voir une réalité sous des angles différents. Selon les perspectives, l’objet d’étude n’aura probablement pas les mêmes significations
Perspective
Manière de regarder, de percevoir ou d'envisager le monde qui est située socialement et qui est reliée aux expériences et aux différents groupes d'appartenance.
Signification
Sens accordé à des pratiques, des faits observables, des événements, des relations, des objets, des données, etc.

La culture première est transmise dans les espaces de socialisation primaires (ex. : à la maison), tandis que la culture seconde se construit dans les espaces de socialisation secondaires (ex. : à l’école, au travail ou dans les lieux de loisirs).
Ici comme ailleurs, la société est diversifiée et la culture n’est pas uniforme. Toutefois, au Québec, certaines réalités culturelles sont partagées à divers degrés. Par exemple : les valeurs d’égalité et de liberté, la démocratie, la prise en charge des services sociaux par l’État, la laïcité de l’État, l’utilisation de la langue française, certaines activités sportives ou certains mets.
À la fin du secondaire, les élèves du Québec ont à faire des choix relatifs à l’âge adulte. Voici différentes perspectives sur cette réalité culturelle.
Gilbert, élève de cinquième secondaire
Quand je vais terminer mon secondaire, je souhaite prendre une année sabbatique pour voyager et découvrir le monde. Je suis trop jeune pour savoir ce que je veux dans la vie.
Kabir, père de famille
L’important, c’est de commencer de bonnes études rapidement. Le monde change tellement, c’est essentiel d’avoir plusieurs cordes à son arc pour réussir à se débrouiller quoi qu’il arrive !
Eve-Lyne, élève de quatrième secondaire
Je prévois m’inscrire au cégep, puis à l’université. Je sais que je veux devenir ingénieure, trouver un emploi avec un bon salaire et fonder une famille.
Maude, élève de cinquième secondaire
Tout le monde parle du travail comme si c’était la seule chose qui compte dans la vie. Moi, je préférerais rester à la maison pour me consacrer entièrement à l’éducation de mes futurs enfants.
Sylvain, conseiller d’orientation
Que vous choisissiez de faire des études universitaires ou d’aller dans un parcours professionnel, l’important, c’est de trouver une voie qui vous permettra de vous épanouir. Le travail est une facette si fondamentale de notre vie !
Véronique, mère de famille
Ma fille désire étudier en art et travailler à son compte. Elle ne souhaite pas avoir d’enfants et veut poursuivre ses rêves. Je vais l’encourager, même si j’aurais trouvé rassurant qu’elle choisisse un domaine stable comme l’éducation ou la santé !

Gisèle, grand-mère
Les jeunes d’aujourd’hui ont de la chance, ils peuvent choisir ce qu’ils veulent faire dans la vie. Mon mari a subi de la pression pour reprendre l’entreprise familiale et moi, pour rester à la maison et m’occuper des enfants.
Le programme Culture et citoyenneté québécoise s'articule autour de deux compétences. Voici la première.
La compétence 1 porte sur la compréhension de l’environnement culturel et social du Québec. Elle vise l’acquisition de connaissances et le développement de savoir-faire propres à la démarche critique de recherche en sociologie. Cette compétence s’exerce à travers quatre composantes qui, selon le contexte, peuvent être travaillées en passant de l’une à l’autre, dans l’ordre ou le désordre, et elles peuvent être répétées.
Circonscrire l’objet d’étude
Exposer une compréhension enrichie

Étudier des réalités culturelles
Analyser
les relations sociales
les savoirs
La sociologie est une science sociale qui étudie les relations entre les individus, les groupes et les institutions. La démarche sociologique permet l’étude de réalités culturelles et sert à : observer la société avec des données ou des faits ; mettre de côté nos préjugés, nos opinions, nos perceptions et ce que l’on pense savoir en identifiant nos biais sociocognitifs (voir p. 19) et nos limites ; mieux comprendre les diverses perspectives sur les réalités culturelles ; mieux saisir la société et ses dynamiques.

Voici une description des étapes de la démarche sociologique, accompagnée d’exemples liés à la mise en situation.
Dans le cadre d'une politique publique égalitaire, le gouvernement du Québec projette d’implanter un nouveau modèle de cafétérias scolaires dans les écoles secondaires québécoises. Il souhaite élaborer des menus abordables qui correspondent aux goûts et aux besoins alimentaires des élèves.
Formuler une question sur la réalité culturelle (l’objet d’étude).
Ex. : Quels sont les goûts et les besoins alimentaires des jeunes qui fréquentent les écoles secondaires québécoises ? 1
2
Formuler une réponse provisoire (compréhension initiale).
Ex. : Les jeunes aiment manger des aliments transformés (ex. : galettes, hot dogs, croquettes) qui ne répondent probablement pas à leurs besoins alimentaires.
Les jeunes du secondaire ont l’habitude d’éviter les allergènes (ex. : noix, arachides, œufs, fruits de mer), car c'était une règle au primaire.
La plupart des jeunes mangent de la viande.
Effectuer une démarche d’enquête pour recueillir des données ou des faits sur la réalité à l’étude.
La collecte de données peut se faire selon deux avenues : consulter des documents ou effectuer une recherche empirique
La démarche d’enquête peut consister en une collecte d’informations présentes dans divers documents (ex. : statistiques, articles, photographies, témoignages).
Ex. : Les données que j’ai recueillies lors de la consultation de documents révèlent que :
Les jeunes mangent des aliments variés et se soucient d’avoir une alimentation saine.
Des élèves souhaitent continuer d’éviter les allergènes pour des raisons de santé, et la liste d'allergènes est de plus en plus longue (ex. : gluten, fruits, noix, produits laitiers).
Certains jeunes ont des restrictions religieuses ou médicales.
Certains élèves suivent un régime particulier : végétarien, végane, biologique, etc.
Empirique
La collecte de données par la recherche empirique peut être réalisée selon différentes techniques.
Qui est fondé sur l’expérience, sur l’observation.

L’observation directe
L’observation peut être formelle (avec une grille d’observation) ou informelle (selon un processus méthodologique, mais sans grille d’observation). Elle permet de recueillir des informations observables à propos de comportements humains dans une situation donnée.
Ex. : J’observe ce que les adolescents et adolescentes de mon école mangent à l’heure du dîner. Je note les aliments et les plats qui sont les plus fréquemment consommés et ceux qui ne sont pas choisis.
Le questionnaire ou le sondage
Le questionnaire ou le sondage vise à collecter les réponses d’un échantillon de personnes sur une question donnée. Les gens répondent alors à des questions ouvertes ou fermées, qui peuvent être posées par écrit ou oralement. Les questions doivent permettre des réponses courtes pour pouvoir être compilées.
Ex. : Je remets un questionnaire aux élèves qui mangent à l’école pour qu’ils et elles indiquent les aliments qui composent leur dîner.
L’entretien
L’entretien, individuel ou en groupe, peut se faire de manière plus ou moins dirigée à l’aide de questions rédigées à l’avance. Il permet de recueillir des informations sur les expériences, les perceptions et les perspectives des personnes à propos de la réalité culturelle à l’étude.
Ex. : Je réalise un entretien avec quelques élèves de l’école. Je leur pose des questions qui les amènent à parler de leurs préférences alimentaires, de leurs habitudes, de leurs restrictions, etc.
À cette étape, il s’agit de décrire les relations sociales à partir des informations recueillies. On peut comparer les différentes perspectives sur la réalité culturelle et formuler des constats.
1

2
Identifier d’abord les personnes, les groupes ou les institutions impliqués.
Ex. : Les élèves
Leurs familles
Le ministère de l’Éducation
Les nutritionnistes et spécialistes de la santé
Les écoles
Décrire ensuite les relations entre ces personnes, ces groupes ou ces institutions.
Ex. : Les élèves souhaitent que l’école les consulte et offre des mets qui correspondent à leurs goûts (relation collaborative).
Les élèves allergiques s’attendent à ce que l’école assure leur sécurité (relation hiérarchique).
Les familles désirent que leurs pratiques religieuses puissent être respectées (relation collaborative).
Le ministère de l’Éducation doit voir à ce que chaque jeune puisse combler ses besoins nutritionnels (relation hiérarchique).
Les nutritionnistes et les spécialistes de la santé incitent les élèves à adopter une alimentation saine (relation hiérarchique [experts]).
Les écoles souhaitent offrir des mets que les élèves apprécient, et cela, dans le respect du budget (relation collaborative et relation de concurrence [aspect budgétaire]).
Formuler des constats.
Ex. : L’alimentation est un sujet complexe qui concerne plusieurs aspects de la vie (ex. : santé, convictions religieuses, habitudes culturelles, valeurs morales ou environnementales). Elle touche les valeurs, l’identité, les goûts et les besoins des gens.
Une fois les informations recueillies, on évalue leur pertinence et leurs limites. Dans cette analyse, il faut aussi tenir compte des biais sociocognitifs et déterminer les limites de notre interprétation (ex. : pièges de la pensée, éléments non couverts qui auraient pu être pertinents).

Les informations recueillies sont-elles pertinentes et fiables ?
Explication : Le questionnaire m’a permis d’obtenir des informations sur plus de jeunes que dans mon cercle d’amis. Cependant, les données recueillies sont représentatives de notre école uniquement, et non de toutes les écoles secondaires du Québec.
Quels sont les biais sociocognitifs (voir p. 19) à considérer ?
Exemples de réponses :
Biais d’ancrage : Je dîne avec les mêmes personnes depuis le primaire. Mes amis me ressemblent, partagent ma culture et mes valeurs. Je peux avoir l’impression que tout le monde pense et mange comme nous.
Biais de confirmation : Il se peut que j’aie accordé plus d’importance aux élèves qui ont des habitudes similaires aux miennes.
Biais de désirabilité sociale : Les élèves peuvent répondre ce qu’ils pensent qu’ils devraient répondre, sans tenir compte de leurs goûts et de leurs besoins.
À cette étape, on fait un retour sur notre compréhension initiale et on intègre d’autres perspectives à la nôtre. On peut alors comparer des interprétations en dégageant des similarités et des différences.
La réponse provisoire émise précédemment est-elle encore juste ?
Explication : J’avais raison sur le fait que la plupart des élèves veulent continuer d’éviter les allergènes, mais j’avais sous-estimé la diversité de leurs habitudes alimentaires. Il faudrait étendre l’analyse à plusieurs autres écoles secondaires afin d’obtenir un portrait plus juste des habitudes alimentaires des élèves du Québec.
Voici la seconde compétence du Programme.
La compétence 2 vise le développement de la capacité à cerner une situation sous l’angle de l’éthique. Cette démarche de réflexion s’appuie sur un examen approfondi des concepts, des points de vue et de leurs fondements à travers le dialogue. Le tout a pour objectif de choisir des repères et des réponses qui favorisent la reconnaissance de soi et de l’autre ainsi que la poursuite du bien commun.
Cette compétence s’exerce à travers quatre composantes, qui ne forment pas nécessairement un processus linéaire : elles peuvent être sollicitées dans différents ordres et peuvent être répétées.
la dimension éthique d’une situation
Réfléchir sur des questions éthiques

Examiner une diversité de points de vue
un point de vue
L’éthique est un domaine de la philosophie qui étudie les valeurs et les normes qui sous-tendent les conduites dans la recherche du bien, du bon et du juste.
La démarche de réflexion éthique porte sur les actions considérées comme acceptables ou à privilégier dans une situation en tenant compte des réalités de chaque personne et des effets sur soi et sur les autres.
Des questions éthiques émergent quand il y a des tensions concernant des repères comme des principes, des valeurs ou des normes. Ces tensions surviennent quand des personnes ou des groupes accordent une place différente à des repères ou qu’elles ou ils ont d’autres manières de vivre.
Les questions éthiques impliquent un problème à résoudre ou un choix d’actions à privilégier.
Un repère est une ressource de l’environnement social et culturel à laquelle on se réfère pour alimenter et éclairer une réflexion éthique. Ces repères peuvent être de différents types. Ex. :
Repères moraux (ex. : valeurs)
Repères légaux et réglementaires
(ex. : chartes, lois, normes)
Repères scientifiques (ex. : résultats de recherche)
Repères historiques (ex. : Seconde
Guerre mondiale)

Repères religieux (ex. : Bible)
Repères techniques (ex. : manuel de cours de conduite)
Repères artistiques (ex. : film, roman, œuvre d’art)
Repères expérientiels (ex. : rituel des premiers pas, méditation)
Une valeur est un repère moral qu’une personne peut considérer comme étant important. Elle sert de référence pour déterminer les comportements souhaitables. Cela peut être un idéal à atteindre ou une cause à défendre.
Les valeurs nous servent de guide dans une réflexion éthique. Ex. : Altruisme
Amitié
Amour
Bienveillance
Courage
Dépassement de soi
Éducation
Égalité
Engagement
Entraide
Famille
Générosité
Honnêteté
Justice
Liberté
Partage
Persévérance
Solidarité
Tolérance
Une norme est une règle, une manière de penser ou un comportement attendu dans une société ou à l’intérieur d’un groupe. Une norme peut servir de repère dans une réflexion éthique. Ex. :
Les lois et les règlements (règles écrites)
Le code vestimentaire (règle écrite ou non)
La politesse (règle non écrite, principe)
Faire la file pour attendre son tour (règle non écrite, principe)
Utiliser des ustensiles pour manger (règle non écrite)
La réflexion éthique permet d’examiner différents points de vue pour choisir des réponses qui visent le bien commun. Elle favorise l’ouverture à l’autre et la prise en compte des ressentis et des expériences de chaque personne.
Voici une description des étapes de la réflexion éthique, accompagnée d’exemples liés à la mise en situation.

Point de vue
Articulation des idées qu’il est possible d’avoir sur une question éthique. Ces idées s’appuient sur différents repères.
Dans une optique d’équité, certains centres de services scolaires mettent fin à l’interdiction des allergènes dans les boîtes à lunch. Ils souhaitent miser sur la prévention et l’éducation pour assurer la sécurité de tous.
Il s’agit de comprendre la situation et le contexte dans lequel elle s’inscrit.
1
2
De quoi est-il question ?
Ex. : Des centres de services scolaires n’interdisent plus les aliments allergènes dans les boîtes à lunch des élèves. Cela peut créer une tension entre ceux qui ne souffrent pas d’allergies et qui sont heureux de ne plus avoir de restrictions et ceux qui sont allergiques et qui doivent être protégés.
Qui est concerné ?
Ex. : Les élèves qui ont des allergies
Les élèves qui n’ont pas d’allergies
3
4
Les parents d’enfants allergiques et non allergiques
Le personnel de l’école
Certains centres de services scolaires
Quels sont les enjeux ou les tensions éthiques ?
Ex. : Dans ce cas, les tensions sont entre la liberté des élèves non allergiques et la protection des élèves allergiques.
Quelles questions éthiques ressortent de la situation ?
Ex. : Quelles règles doit-on mettre en place dans les écoles pour les aliments allergènes ?
Faut-il favoriser le bien-être des personnes allergiques ou celui des non allergiques ?
Comment pourrait-on favoriser le bien-être des personnes souffrant d’allergies alimentaires sans pénaliser celui des non allergiques ?
Cette étape consiste à étudier les points de vue des personnes impliquées dans la situation et à tenter de déterminer sur quels repères ils se basent. Il importe également d’évaluer si les points de vue comportent des erreurs de raisonnement.
Quels sont les points de vue et sur quels repères se basent-ils ?
Personnes ou groupes
Parents d’enfants allergiques

Points de vue
Ils veulent que les allergènes soient interdits pour réduire les risques de réactions.
Élèves allergiques Des élèves seraient rassurés si les aliments allergènes étaient interdits.
D’autres souhaitent que leurs camarades puissent manger ce qu’ils veulent.
Parents d’enfants non allergiques
Élèves non allergiques
Ils veulent avoir la liberté de préparer ou d’acheter les aliments de leur choix pour leurs enfants.
Des élèves veulent être libres de manger les aliments de leur choix.
D’autres souhaitent contribuer à un environnement sécuritaire pour tous.
Certains centres de services scolaires
Ils veulent miser sur l’éducation pour amener les enfants à se responsabiliser et à faire preuve de prudence.
Valeurs
Santé
Sécurité
Paix d’esprit
Sécurité
Liberté de choix
Repères
Normes
Il serait préférable de revenir aux anciennes règles qui interdisaient les aliments allergènes.
L’école doit être un environnement sécuritaire pour tous. Les choix alimentaires sont personnels.
Liberté de choix
Santé
Culture
Liberté de choix
Solidarité
Inclusion
Éducation
Prévention
Liberté
Santé
Les choix alimentaires relèvent de la famille.
Les choix alimentaires sont personnels.
L’école doit être un environnement sécuritaire pour tout le monde.
Les allergènes ne sont interdits nulle part en société (lieux publics, restaurants, etc.).
Quelles sont les erreurs de raisonnement (voir p. 25) possibles ?
Ex. : L’appel à la tradition : Les allergènes sont interdits depuis longtemps dans les écoles, donc nous avons l’impression que c’est la meilleure chose à faire.
La généralisation abusive : Les allergies peuvent être mortelles dans certains cas, mais il ne faut pas généraliser ce danger à tous les élèves.
À ce stade, il s’agit de déterminer différentes réponses possibles et d’évaluer les effets sur soi, sur les autres et sur la société.
1

2
Quelles sont les réponses possibles à la question éthique ?
Ex. : Les centres de services scolaires concernés doivent interdire de nouveau les aliments allergènes dans les écoles, pour la sécurité des élèves.
Les centres de services scolaires concernés doivent autoriser les aliments allergènes dans les écoles et responsabiliser les élèves à la prudence avec les allergènes.
Sur quels repères (valeurs ou normes) peut-on s’appuyer ?
Ex. : On peut s’appuyer sur la norme de la sécurité pour protéger les enfants qui souffrent d’allergies.
On peut s’appuyer sur la valeur de la liberté pour que les élèves puissent choisir leurs aliments.
3
Quelle réponse faut-il choisir ?
Ex. : Il serait préférable de maintenir l’interdiction des allergènes dans les écoles primaires, car il vaut mieux opter pour la prudence. Toutefois, dans les écoles secondaires, on pourrait miser sur la responsabilisation des jeunes à faire les bons choix.
4
Pourquoi opter pour cette réponse ? Quels sont les effets sur les groupes concernés ?
Ex. : Au primaire, les enfants n’ont pas tous la maturité pour gérer leurs allergies et cela peut les mettre en danger. Aussi, il est stressant pour le personnel de surveiller les allergènes. Au secondaire, les élèves peuvent s’éduquer à la prudence, car ils sont plus matures et responsables.
Dialoguer
À cette étape, il s'agit de communiquer son point de vue en considérant les points de vue et les ressentis de tout le monde et d’utiliser des moyens pertinents pour appuyer ses idées.
1
2
Considérer son ressenti et celui des autres.
Ex. : Je pense qu’il est primordial de ne pas exposer les enfants aux allergènes, car cela peut être dangereux pour leur santé. Je comprends aussi qu’interdire les allergènes peut être contraignant pour certains parents, qui peuvent avoir de la difficulté à remplir les boîtes à lunch d’aliments variés, sains et économiques.
Quels moyens pour appuyer ses idées sont utilisés pour exprimer le point de vue ?
Ex. : J’utilise des documents scientifiques pour définir ce qu’est un choc anaphylactique et les conséquences possibles. Je cherche dans l’actualité ou dans des statistiques des situations qui ont mené à une réaction allergique.
Démarche de recherche qui implique l’analyse de relations sociales selon différentes perspectives.
Objectif : Comprendre et expliquer les relations sociales dans la culture québécoise
Démarche
Se questionner et s’informer sur une réalité culturelle
Analyser les relations sociales
Réfléchir et évaluer les informations et leur interprétation
Enrichir sa compréhension
Exemples de questions sociologiques
Comment les jeunes Québécois et Québécoises s’impliquent-ils quand ils font du bénévolat ?
Pour quelles causes environnementales la population québécoise se mobilise-t-elle le plus ?
Démarche de raisonnement qui implique l’analyse de différents points de vue.
Objectif : Déterminer les réponses ou les actions possibles dans une situation où il y a des tensions éthiques
Démarche
Dégager la dimension éthique de la situation
Examiner une diversité de points de vue Élaborer un point de vue
Dialoguer dans un esprit d’ouverture
Exemples de questions éthiques
Est-ce que l’école devrait reconnaître l’implication bénévole des élèves par des crédits scolaires ou des récompenses ?
Quelles seraient les meilleures initiatives écologiques à mettre en place à l’école ?

Les deux démarches permettent des regards complémentaires sur les réalités culturelles et une compréhension nuancée de la société et de la culture québécoises. Elles favorisent : la prise en compte de différentes perspectives et de différents points de vue ; le développement de la pensée critique ; la pratique du dialogue ; l’exercice de la citoyenneté pour mieux vivre ensemble.
La pensée critique soutient la construction de connaissances et la prise de décision. On l’exerce en portant attention aux critères qui fondent nos choix selon le contexte. Cette section présente des outils pour favoriser le développement de la pensée critique et pour éviter certains pièges lors de nos réflexions.
Un biais sociocognitif est un raccourci de la pensée fondé sur des jugements et des impressions. Il permet le traitement rapide de l’information issue de l’environnement social et culturel.
Lorsqu’on traite de l’information trop rapidement, il arrive qu’on ne le fasse pas avec justesse. Pour reconnaître et déjouer les pièges des biais sociocognitifs, il faut être en mesure de les repérer.
Il consiste à accorder plus d’importance aux informations et aux sources qui confirment une hypothèse.

Une jeune qui navigue sur Internet : Tiens, un article qui parle des avantages des réseaux sociaux dans la vie des jeunes. Je vais montrer ça à ma mère la prochaine fois qu’elle me dira que je perds mon temps sur mon téléphone !
Une mère qui regarde avec son fils un reportage sur les impacts environnementaux de la production de viande : Tu vois, j’avais raison quand je te disais que manger du tofu était meilleur pour l’environnement !
Il s’agit de percevoir une information comme étant crédible du simple fait qu’elle est répétée, au détriment d’une information nouvelle.
1 2
Un adolescent : J’ai vu un reportage qui révélait que ces écouteurs étaient mal conçus… mais tous les élèves à l'école disent qu'ils sont très bien : ils ne doivent pas être si mauvais !
Un homme : Depuis l’annonce des ouragans, tout le monde fait des réserves de dentifrice. Peut-être que je devrais faire des réserves, moi aussi ? Si tout le monde le fait, il y a sûrement une bonne raison !
Il consiste à retenir une information en particulier comme référence parce qu’elle a été la première acquise sur un sujet ou qu’elle apparaît a priori comme étant particulièrement importante.
Un adolescent : Je vois de plus en plus mal au tableau, j’ai l’impression que ma vue baisse.
Son amie : Tu devrais manger plus de carottes. Ma mère m’a toujours dit que c’était bon pour les yeux.
Une enseignante : Dès la première journée, cet élève est arrivé sans son matériel. Je me doute déjà que son comportement va me donner du fil à retordre toute l’année.
Il s’agit de porter un jugement général sur une personne ou une chose à partir de la perception d’une caractéristique précise.
1 2
Un acteur : J’ai été engagé pour tourner la publicité de ce parfum, car les gens jugent que je suis beau, talentueux et charismatique. La compagnie dit que les gens vont attribuer ces mêmes qualités au produit que je présente.
Une personne au restaurant : Cet homme porte un costume chic et cher. Il occupe sûrement un poste important dans une entreprise prospère.
Il consiste à chercher à se présenter de façon favorable devant d’autres individus.
1

2
Une médecin : Mangez-vous beaucoup de fruits et de légumes ?
Le patient : Bien sûr, au moins huit ou neuf portions tous les jours ! (Dans sa tête : Bon, peut-être que j’exagère un peu, quand même…)
Un père qui rentre du travail : Depuis combien de temps joues-tu à ce jeu, aujourd’hui ? Ça fait longtemps, non ?
Sa fille : Rassure-toi, papa, ça fait à peine 45 minutes que je joue…
Il consiste à présumer du caractère fixe, immuable ou naturel d’un trait, d’une personne, d’un groupe ou d’un phénomène social.
1

2
Un adolescent : J’ai invité mon cousin à venir au parc pour faire de la planche à roulettes avec nous.
Son ami : C’est bien celui qui est un champion de jeux vidéo ?
Il ne viendra pas, les gamers ne font pas de sport. Ils restent toujours dans leur chambre et ne parlent à personne !
Fille 1 : Son nouveau chum est un joueur de hockey.
Ça va sûrement mal finir.
Fille 2 : Oui, les joueurs de hockey ne sont jamais sérieux en amour !
Il s’agit de considérer qu’un tort causé par une action est pire qu’un autre causé par l’inaction.
1
2
Une fille qui pense à aller visiter sa mère âgée : Si je vais visiter ma mère quelques minutes seulement, elle sera fâchée que je ne reste pas assez longtemps. Comme je n’ai pas beaucoup de temps, aussi bien ne pas y aller.
Un client à la pharmacie : Il paraît que ce traitement est très efficace, mais qu’il pourrait causer quelques effets secondaires. Peut-être que je ne devrais pas le prendre ?
Juger, c’est se forger une opinion ou prendre position sur quelque chose. Un jugement est une proposition qui privilégie une réalité (ou un fait), une valeur, une prescription ou une préférence. Savoir reconnaître les types de jugement permet de comprendre sur quoi se basent les idées énoncées.
Affirmation qui établit un constat qui se veut vraisemblable ou véridique par rapport à des faits observables, à un événement ou au témoignage d’une personne. Même s’il semble vrai, un jugement de réalité peut être faux.
Au Québec, il est obligatoire de parler français en tous lieux, car le français est la langue officielle. (Jugement de réalité qui est faux, appuyé sur un fait qui est vrai.)
Toutes les femmes ont une masse inférieure à celle des hommes, car elles ont un pourcentage d’eau corporelle (environ 52 à 55 %) moins grand que celui des hommes (environ 60 %). (Jugement de réalité qui est faux, appuyé sur un fait qui est vrai.)
L’été dernier, l’éclair a frappé un arbre dans ma cour. Maintenant, je suis en sécurité lors des orages, car j’ai lu que les éclairs ne frappaient jamais deux fois au même endroit. (Jugement de réalité qui est faux, basé sur un fait qui est faux.)

Affirmation qui privilégie une norme ou une valeur, un devoir ou une obligation morale.
Au Québec, on soupe plus tôt qu’en Italie ou en Espagne. C’est beaucoup mieux pour la digestion…
Dans une société qui se veut solidaire, il est essentiel de redonner aux personnes démunies.
Il est indispensable de contrer la maltraitance chez les personnes âgées.
Lutter contre la pauvreté chez les enfants est non seulement une obligation, mais aussi un investissement social.
Je te recommande d’épargner dès maintenant

Affirmation qui est émise sous la forme d’une recommandation, d’un ordre ou d’un conseil, et qui incite à faire une action, à modifier une situation ou à résoudre un problème.
Je te conseille de retenir les services d'un tuteur en français pour te préparer à l’examen du ministère.
Je te recommande d’épargner dès maintenant, parce que chaque personne doit assurer sa sécurité financière à la retraite.
Il est essentiel de faire l’entretien de sa voiture avant l’hiver pour éviter les problèmes.
Puisque tu viens de louer ton premier appartement, je te suggère de te faire un budget pour mieux gérer tes dépenses mensuelles.
Tu devrais faire du bénévolat dans ta communauté : tout le monde doit s’impliquer !
Affirmation dont le contenu exprime une appréciation ou une aversion personnelle à l’endroit de quelque chose.
Je préfère regarder des séries québécoises plutôt que des séries américaines.
J’aime mieux étudier au café étudiant le midi que dans ma chambre le soir.
Les repas avec du riz sont meilleurs que ceux avec du quinoa.
Vous ne me verrez jamais jouer au curling : je déteste ce sport.
J’évite à tout prix les films d’amour : ce n’est pas mon truc.
Un raisonnement est un enchaînement logique d’idées liées entre elles menant à une conclusion. Le raisonnement nous permet de passer d’un point de vue spontané à une prise de position réfléchie.
Raisonnement qui consiste à passer d’une règle générale à des situations particulières (spécifiques) ou singulières (uniques).
Exemple 1
1. Les gens qui étudient avant un examen ont plus de chances de le réussir.
2. Joaquim et Nabilla ont étudié pour leur examen.
3. Joaquim et Nabilla ont donc plus de chances de réussir leur examen.
Exemple 2
1. Les actions individuelles de réduction des déchets contribuent à la préservation de l'environnement.
2. Mia a commencé à composter ses déchets organiques.
3. Donc, les actions de Mia contribuent à la protection de l'environnement.

Raisonnement qui consiste à produire une règle générale à partir de l’observation de situations particulières ou singulières qui ont des caractéristiques communes.
Exemple 1
1. Chaque fois que Chan mange des légumes, il se sent plein d’énergie.
2. Quand ma sœur mange des légumes, elle se sent énergisée.
3. Manger des légumes donne donc de l’énergie.
Exemple 2
1. Plusieurs retraités du Québec partent pour le Sud l’hiver.
2. Plusieurs familles québécoises aiment voyager dans le Sud pendant le congé des Fêtes ou la semaine de relâche.
3. Donc, beaucoup de personnes qui habitent au Québec recherchent la chaleur du Sud l’hiver.
Raisonnement qui consiste à soutenir une idée en affirmant que deux situations se ressemblent, sont proportionnelles ou équivalentes puisqu’elles partagent suffisamment de caractéristiques similaires.
Exemple 1
1. Une voiture fonctionne mieux si elle a des entretiens réguliers.
2. Le corps humain fonctionne bien si on en prend soin.
3. Donc, prendre soin de son corps, c’est comme entretenir sa voiture.
Exemple 2
1. Une bonne maison doit avoir des fondations solides.
2. Une relation doit être fondée sur la confiance.
3. Donc, la confiance, c’est comme les fondations d’une maison : elle est essentielle pour qu’une relation soit solide.
Un raisonnement peut être erroné même s’il semble valable. Qu’elle soit intentionnelle ou non, l’erreur de raisonnement peut nuire au dialogue. Elle est commise quand un point de vue est justifié par des arguments mal développés ou lorsque l’information est inexacte, manquante ou mal utilisée. Se questionner et s’informer sur les idées reçues permet d’évaluer la pertinence et la validité de l’information.
Tenter de justifier un comportement en signalant que d’autres font la même faute ou pire encore.
Ce n’est pas grave si je copie un devoir. Plusieurs autres élèves le font régulièrement.
On me blâme pour mon retard au travail alors que des collègues arrivent plus tard que moi.
Pourquoi mes parents se fâchent-ils quand je télécharge illégalement des films ? Il y a des gens qui piratent des logiciels beaucoup plus chers !

Outre les deux idées mises en opposition, il existe souvent de nombreuses autres possibilités. Il serait pertinent de réfléchir à d’autres choix.
Une faute ne devient pas acceptable simplement parce que quelqu’un d’autre en a commis une semblable ou une pire !
Présenter deux options comme étant les seules possibles. Comme l’une est indésirable, l’autre est inévitablement le choix à faire.
Soit on augmente les taxes, soit on réduit les services offerts à la population.
Si tu n’acceptes pas cette promotion, tu n’auras jamais d’autres possibilités d’avancement.
Il faut cesser d’utiliser les réseaux sociaux. Sinon, nous devrons accepter qu’ils contrôlent nos vies.
Faire appel incorrectement ou abusivement à l’autorité d’une personne pour appuyer un argument.
La meilleure poutine du Québec se trouve à l’île d’Orléans. Un blogueur très connu l’a affirmé.
Le vin est bon pour la santé, un chef cuisinier réputé l’a dit à la radio.
Ce n’est pas un bon film. Mon père me l’a confirmé.

Ce n’est pas parce que tout le monde le dit que c’est vrai. Notre point de vue est parfois exagérément fondé sur notre besoin de faire comme les autres ou de suivre une mode.
La personne est-elle une autorité dans son domaine en raison de son expertise ou profite-t-on de sa renommée ou de son statut pour donner de la valeur à nos idées ?
Justifier l’idée que quelque chose est vrai ou acceptable par le simple fait qu’un grand nombre de personnes l’affirment, sans en avoir vérifié l’exactitude.
Si autant de gens fréquentent ce restaurant, c’est que la nourriture doit y être excellente.
Tout le monde de mon entourage investit dans la cryptomonnaie. Cela doit être un bon investissement. C’est ce que je vais faire.
Beaucoup de personnes disent que le dernier film Batman est génial. Il doit forcément l’être.
Faire appel à une image figée d’un groupe de personnes sans tenir compte des singularités. Cette image est généralement négative et basée sur des renseignements faux ou incomplets.
La classe politique est corrompue.
Les jeunes ne lisent plus de livres.
Les personnes âgées ne comprennent pas les nouvelles technologies.
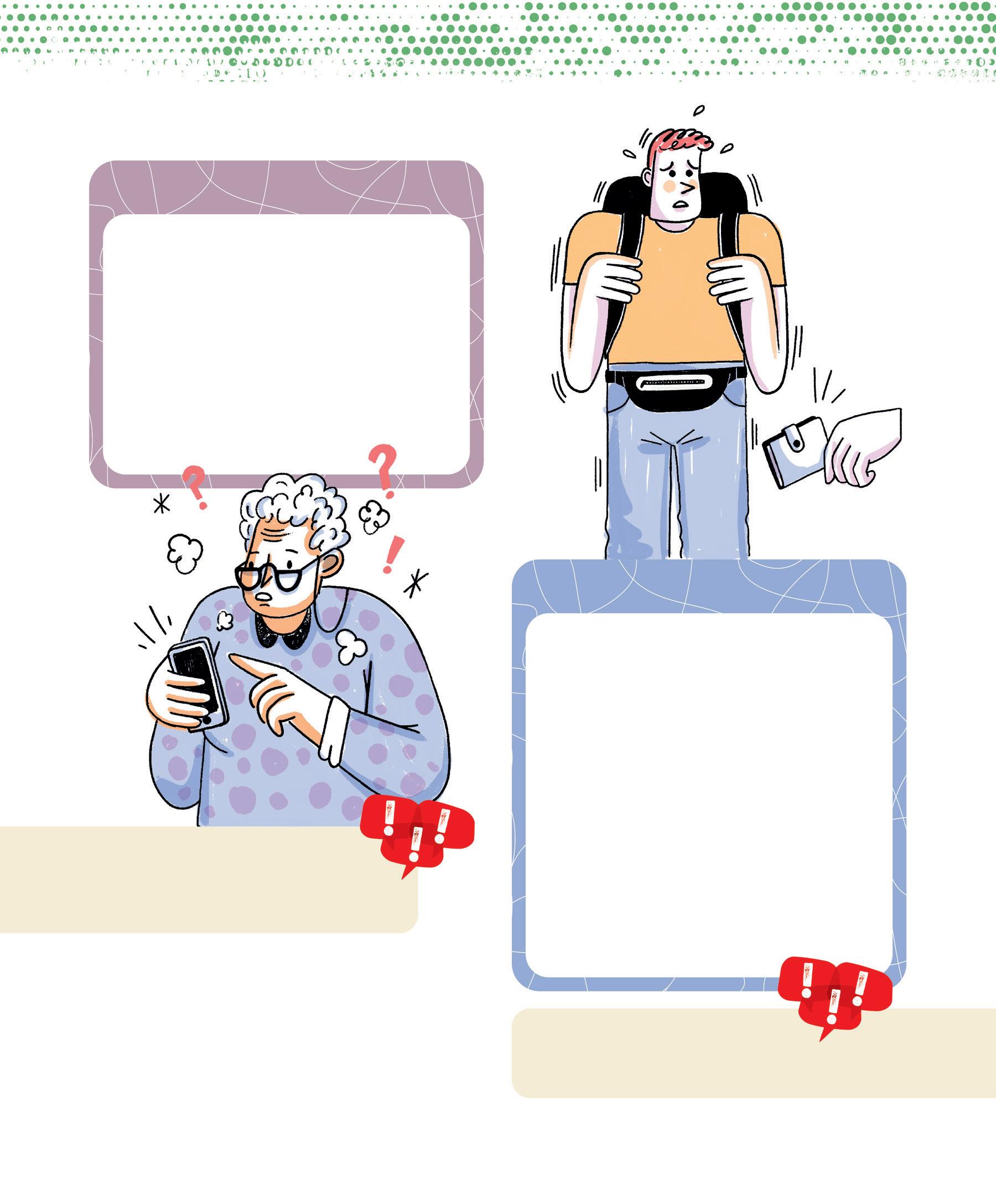
Chaque individu est complexe et unique. Les stéréotypes sont problématiques parce qu’ils renforcent des préjugés qui sont souvent utilisés pour maintenir des rapports de pouvoir.
Passer d’un jugement portant sur un ou quelques cas à une conclusion générale, sans s’assurer que l’échantillonnage est assez représentatif pour que la conclusion soit valide.
Un de mes amis s’est fait voler son portefeuille en voyage. Voyager est dangereux.
Ce midi, j’ai vu deux élèves qui passaient tout leur temps sur leur téléphone. Tous les élèves sont accros à leur portable.
Une adolescente a quitté son emploi après une semaine seulement. Les jeunes sont peu fiables et ne conservent pas longtemps un même emploi.
On ne peut pas établir une théorie sur la base d’une ou de quelques expériences. Celles-ci ne sont pas nécessairement représentatives d’une tendance.
L’attaque personnelle peut être très blessante. Se concentrer sur les arguments et les faits plutôt que sur la perception qu’on a des personnes est préférable.

Faire accepter ou rejeter un argument parce qu’il est soutenu par une personne ou un groupe de personnes jugées estimables ou non estimables.
Tu vas sûrement aimer ton nouveau beau-frère, car toute la famille l’aime déjà.
Tu devrais adopter cette nouvelle méthode d’entraînement. La plupart des athlètes de notre club l’utilisent.
Cette théorie sur le changement climatique est non recevable, car elle est soutenue par des complotistes.
Attaquer une personne de manière à détruire sa crédibilité plutôt que son argumentation.
Comment peux-tu parler de santé publique alors que tu manges tout le temps de la malbouffe ?
N'écoute pas Mirna, elle ne connaît rien en finance. C’est juste une influenceuse.
Ta vision de l’éducation est erronée. Tu n’as même pas terminé ton secondaire.
On peut prendre en compte les idées de nos proches sans pour autant les adopter. L’important, c’est de connaître les raisons qui motivent notre propre point de vue.
Les exagérations ou la simplification peuvent nuire au dialogue. Il importe de s’en tenir au point de vue de la personne avec qui l’on discute, sans exagérer certains aspects, pour ne pas détourner son propos.
Avancer une argumentation qui se présente comme étant justifiée du seul fait qu’elle est soutenue par une tradition.
On devrait continuer à imprimer tous les journaux. C’est la façon de faire depuis des siècles.
Il faut que le mariage ait lieu à l’église. Dans notre famille, c’est là que tout le monde se marie.
Les hommes de notre famille ont toujours joué au hockey. Tu dois en faire autant !
En plus, c’est notre sport national.
Déformer la position ou la pensée de quelqu’un, notamment en la radicalisant ou en la simplifiant, afin de la rendre non crédible.
Papa veut limiter notre temps d’écran. Autant nous envoyer vivre dans une grotte sans électricité !
Mon amie Thalia insiste pour qu’on réduise notre consommation de viande afin de protéger l’environnement. C’est ça, elle veut nous forcer à devenir végétariens.
Tu veux améliorer la sécurité dans l’entreprise ? Aussi bien faire travailler tout le monde dans des bulles de plastique !

Soutenir une idée ou une action parce qu’elle est adoptée ou réalisée depuis longtemps empêche parfois de se demander pourquoi cette tradition existe. Il est utile de remettre en question sa pertinence.
Avancer une argumentation qui se présente comme étant justifiée du seul fait qu’elle est nouvelle ou inédite.
On devrait acheter cette nouvelle sorte de céréales.
Elle est sûrement plus nutritive…
Cette application pour se faire livrer de la nourriture doit être meilleure que les autres, car elle vient tout juste de sortir.
Ce téléphone est tout nouveau sur le marché. Il est forcément supérieur à la version précédente.
Le fait qu’il s’agisse d’une nouveauté est souvent mentionné dans les publicités. Il convient alors d’évaluer les avantages et les inconvénients possibles de cette nouveauté.
Est-elle vraiment meilleure ?
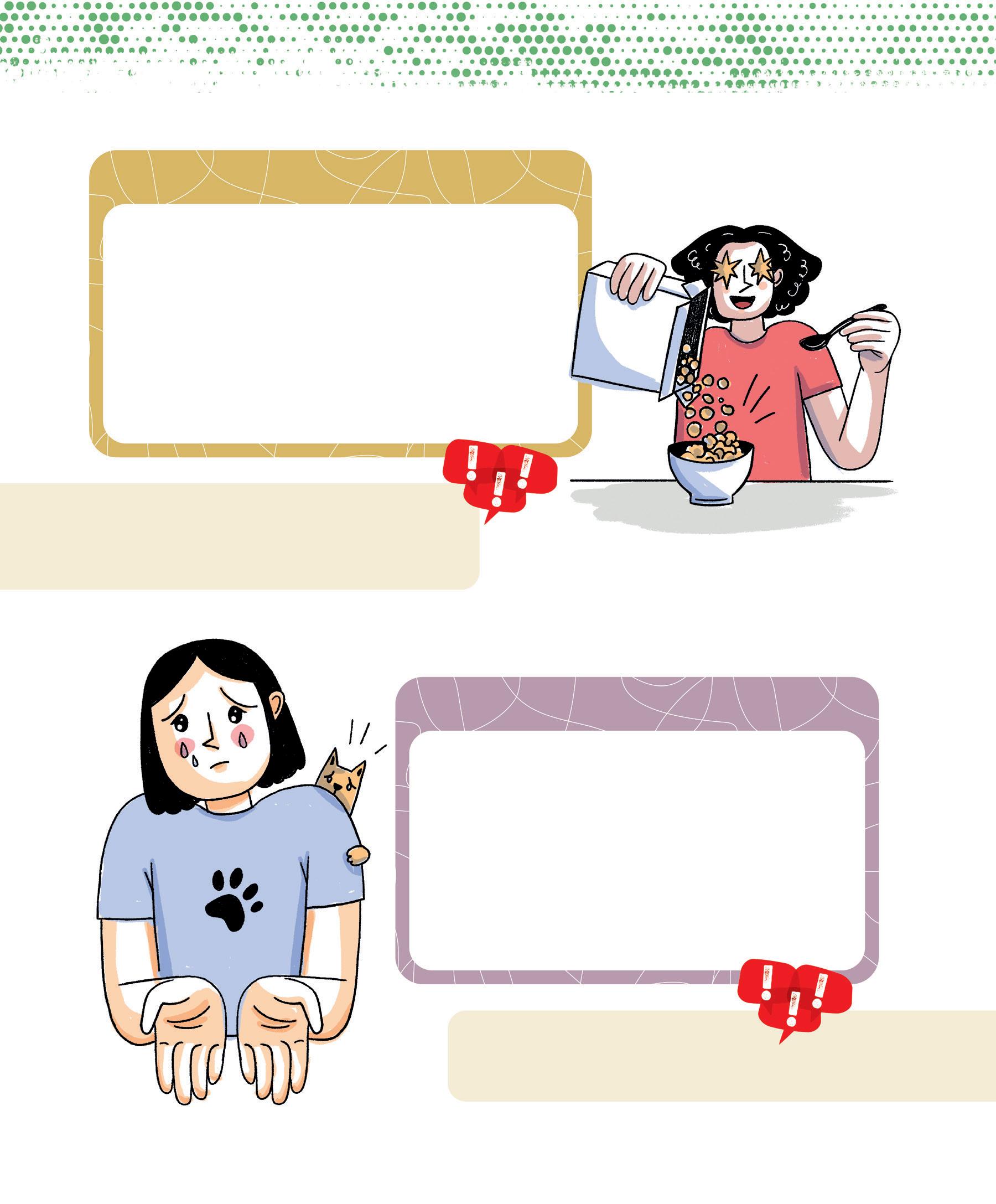
Détourner l’attention vers des réalités d’ordre affectif sans lien avec l’objet du débat.
Cette politique environnementale doit être adoptée : pensez à tous les animaux qui vont souffrir ou mourir.
Yumi, si tu n’appuies pas cette cause, c’est comme si tu abandonnais toutes les personnes qui souffrent en silence.
Si tu ne contribues pas à cette œuvre de charité, c’est que tu n’as pas de cœur.
L’appel aux émotions n’est pas un argument pour réfléchir, mais pour faire réagir. Il vaut mieux ne pas se laisser envahir par les émotions et se concentrer sur les faits.
Détourner l’attention vers l’idée selon laquelle la fausseté d’une argumentation n’a pas encore été établie.
Il paraît que les rêves pourraient prédire l’avenir. Personne n’a encore prouvé le contraire.
Personne du milieu scientifique n’a démontré que les fantômes n’existent pas. Ainsi, ils pourraient bien être parmi nous.
Ce nouveau type de plastique est sûrement écologique. On n’a pas encore démontré qu’il pollue l’environnement.

La comparaison de deux situations qui n’ont pas le même contexte ou les mêmes objectifs peut mener à des conclusions erronées.
Il ne faut pas inverser le fardeau de la preuve. L’absence de preuve négative n’équivaut pas à une preuve positive.
Tenter de justifier une conclusion à l’aide d’une similitude insuffisante entre deux phénomènes.
Avoir un animal de compagnie, c’est comme avoir un nouveau jeu : on peut jouer avec quand on veut et le laisser de côté quand on en a assez.
Diriger un pays, c’est comme diriger une entreprise. Un chef d’entreprise efficace devrait exceller comme premier ministre.
Pour gagner aux jeux de hasard, il faut jouer souvent. C’est comme le sport : plus tu en fais, plus c’est payant.
La pente fatale exagère les conséquences d’une action en faisant des liens discutables, alors qu’il est pourtant possible d’éviter la catastrophe.
Avancer une argumentation qui s’appuie sur un lien douteux de cause à effet entre deux phénomènes.
Puisque la lavande a un effet relaxant, si tu mets un sachet de lavande sous tes draps, tu n’auras plus de crampes aux jambes, la nuit.
Depuis que l’école a introduit les ordinateurs en classe, les résultats des élèves ont baissé. L’utilisation des ordinateurs cause des échecs scolaires.
Chaque fois qu’il y a une élection, les impôts augmentent. Donc, les élections causent l’augmentation des impôts.
Affirmer qu’une action entraînera une situation épouvantable en raison d’un enchaînement de causes et d’effets qui, après examen, se révèle douteux, voire impossible.
Si on commence à donner des subventions aux artistes, tout le monde voudra devenir artiste et cela contribuera au manque de main-d’œuvre dans les emplois techniques.
Si on n’impose pas de restrictions sur les jeux vidéo, on met en péril la santé et l'éducation des enfants.
Si je ne vais pas à cette fête, je vais perdre tous mes amis et ma vie sociale sera un échec.

La fausse causalité est un raccourci de pensée. Aucun lien démontré et vérifié n'a été établi entre la cause mentionnée et l'effet cité.

Conclure qu’une personne ou un groupe de personnes qui profitent d’une situation en sont l’origine ou la cause sans preuve suffisante.
Les résultats des élections sont truqués par certains groupes pour s’assurer que leurs candidats et candidates gagnent.
Les gouvernements contrôlent ce qui est enseigné dans les écoles en y intégrant des réalités parallèles pour que les jeunes adoptent leurs points de vue.
Des entreprises pharmaceutiques cachent des remèdes contre le cancer dans le but de continuer à vendre leurs traitements coûteux.
L’appel au complot semble pratique pour discréditer une affirmation, mais il mène à une conclusion qui ne s’appuie sur aucune preuve.

Le dialogue est un acte de pensée intentionnel qui se déroule à l’intérieur de soi ou en interaction avec les autres. Il vise la reconnaissance et la compréhension des différents points de vue sur une réalité culturelle.
Le dialogue prend la forme d’une progression de la pensée par l’intégration de connaissances, de points de vue et d’expériences. Il existe différentes formes de dialogue qui peuvent être privilégiées selon le sujet ou l’objectif de l’échange.
Récit détaillé, écrit ou oral, d’une suite de faits, d’événements ou d’expériences.
1 2
Un ami raconte en détail son voyage en Europe. Il décrit les lieux qu’il a visités, les rencontres qu’il a faites et les anecdotes qui ont ponctué son périple.
Une romancière décrit les événements d’une époque. Elle raconte comment son héroïne a vécu l’arrivée du droit de vote des femmes au Québec en 1940.
Échange entre deux ou plusieurs personnes, réalisé dans le but de partager des idées ou des expériences.
1
2
Deux amies partagent leurs impressions sur un film d’action qu’elles ont vu ensemble.
Deux voisins parlent de leurs projets de vacances. Ils mentionnent les destinations qu’ils aimeraient visiter.
Échange suivi et structuré d’opinions, d’idées ou d’arguments, réalisé dans le but d’en faire l’examen.
1 2
Deux travailleuses sociales discutent des moyens pouvant être mis en place pour aider un jeune homme sourd.
Lors d’un groupe de discussion, des consommateurs parlent des avantages et des inconvénients de différents modèles de téléphones dans le but de faire un choix.
Rencontre concertée visant à interroger une personne (ou plusieurs) sur ses activités, ses idées, ses expériences, etc.

Un médecin questionne une patiente pour mieux comprendre ses symptômes et note les informations recueillies dans son dossier.
Ma sœur est convoquée à une entrevue d’embauche. Elle se fait questionner sur ses forces et ses défis ainsi que sur ses expériences.
Rencontre tenue entre quelques personnes choisies pour leurs connaissances sur une question donnée dans le but d’exposer leurs points de vue respectifs, de dégager une vision d’ensemble et de permettre des échanges avec un auditoire.
1
Examen, réalisé en soi ou avec d’autres personnes, des différents aspects d’une question (faits, intérêts en jeu, normes et valeurs, conséquences probables, etc.) pour en arriver à une décision.
1 2
Après un procès, les membres du jury examinent les preuves et les témoignages pour rendre leur verdict.
Ma mère est allée réfléchir dans une autre pièce pour évaluer ma demande de faire un voyage avec mes amis cet été. J’ai bien hâte de connaître le résultat de sa délibération avec elle-même !
2
Lors d’un congrès, des chercheurs discutent devant public des défis de société pour atteindre l’égalité des genres au Québec. Puis, ils répondent aux questions des gens dans l’assistance.
Des expertes en intelligence artificielle parlent devant une assemblée d’étudiants de la montée en popularité de l’IA et des précautions à prendre dans ce domaine. Des étudiants leur posent ensuite des questions.
Échange encadré qui a lieu entre des personnes ayant des avis différents sur un sujet controversé et qui met en évidence les arguments soutenant chaque position.
1
Des personnes candidates à une élection prennent position sur des questions comme l’économie, la santé et l’éducation. Elles répondent aux divers arguments de leurs adversaires.
2
Les graffitis : art ou vandalisme ? Des artistes et des graffiteurs sont invités à en débattre dans une émission radiophonique.
Les conditions favorables à l’interaction contribuent à créer un échange efficace et respectueux.
1
Respecter les règles de fonctionnement de l’interaction
Se conformer à la procédure établie pour dialoguer.
Ex. : Je respecte les tours de parole.
3
Porter attention aux propos de ses interlocuteurs et interlocutrices
Bien se concentrer pour écouter attentivement.
Ex. : Je ne regarde pas mon téléphone quand quelqu’un me parle.
2
Cerner l’intention et l’objet du dialogue
Respecter le but de l’échange
(ex. : informer, expliquer, convaincre, raconter) et s’en tenir au sujet déterminé.
Ex. : J’évite de poser des questions hors sujet.

4
Faire attention aux manifestations non verbales de sa communication et à celles des autres
Porter attention à sa gestuelle et à ses expressions faciales ainsi qu’à celles des autres pendant les échanges.
Ex. : Je porte attention au regard, aux expressions du visage et aux gestes de la personne à qui je m’adresse pour noter tout signe d’incompréhension.
5
Répondre aux questions posées par les autres
Donner des réponses aux interrogations de ses interlocuteurs et interlocutrices afin de les aider à bien comprendre.
Ex. : J’écoute attentivement les questions des gens avec qui je discute et j’y réponds le plus précisément possible selon les informations que j’ai.
6
S’assurer de comprendre les idées émises par les autres
Demander aux autres de clarifier leurs propos quand cela est nécessaire.
Ex. : Je ne reste pas avec une incompréhension qui pourrait me faire perdre le fil des idées ; je demande tout de suite des éclaircissements.

Valider ou illustrer une idée en faisant référence à un acte, à un événement, à un personnage ou à une chose précise.
Kamal explique à ses élèves l’importance de l’engagement social. Afin d’illustrer cette idée, il donne en exemple les manifestations en Amérique du Nord pour les droits civiques de 2020, où des millions de personnes ont protesté contre les injustices raciales. Ces manifestations ont mené à des changements importants (réforme de politiques policières, prise de conscience de problèmes de justice sociale).
Relier une idée à une autre idée émise précédemment, que ce soit en cours de dialogue ou pour soi-même.
Jocelyn est un entrepreneur en construction qui veut diversifier les profils des personnes qu’il embauche Pendant sa présentation à l’équipe, une des employées fait un lien avec cette idée en mentionnant la nécessité d’inclure des séances de sensibilisation sur les stéréotypes de genre en construction
Préciser une idée en indiquant des caractéristiques principales et distinctives.
Amal, enseignante au secondaire, insiste sur l’importance du développement durable
Elle précise qu’il s’agit d’un concept visant à utiliser les ressources pour satisfaire les besoins du présent tout en préservant ces ressources pour répondre aux besoins futurs
Chercher à légitimer une idée en l’appuyant sur des arguments
L’éducation sexuelle permet de réduire les risques de grossesse non planifiée et les ITSS. En effet, cela fournit aux jeunes des informations précises et les aide à développer des compétences pour prendre des décisions éclairées sur leur santé sexuelle
Mettre en évidence des caractéristiques permettant de différencier deux éléments en apparence semblables
Bien que plusieurs les présentent comme étant des équivalents, les médicaments génériques ne sont pas toujours identiques aux médicaments de marque déposée Ils peuvent différer par leurs ingrédients inactifs, leur apparence (couleur, forme, inscriptions) et leur prix

Proposer une idée différente de celle d’une ou de plusieurs autres personnes. L’expression d’un désaccord doit être appuyée de raisons, d’exemples ou de contre-exemples.
Kimberly pense qu’un diplôme universitaire n’est pas indispensable pour réussir sur le plan professionnel Elle croit qu’il est possible d’avoir accès à plusieurs bons emplois grâce à des formations professionnelles. Par exemple, des métiers comme la coiffure ou la plomberie offrent d’excellentes perspectives de carrière
Donner un exemple pour invalider une idée (affirmation, règle ou énoncé) présentée comme étant universelle.
Éric mentionne que les adolescents et les adolescentes n’aiment pas étudier. Mei réplique qu’il y a plusieurs élèves dans son école qui participent avec motivation à des programmes de tutorat
Reprendre une idée dans ses propres mots afin d’en assurer la compréhension.
Émilie explique à son ami que l’utilisation des écrans avant de dormir peut rendre l’endormissement plus difficile Esteban reformule ses propos en disant que regarder des écrans le soir peut nuire au sommeil
Présenter une idée de façon concise en conservant ses éléments essentiels à des fins de compréhension ou de comparaison.
Dans son exposé sur les bienfaits du recyclage, Thiên fait référence à un article de journal qui traite en détail des avantages de cette pratique Il parle de l’article en mentionnant que le recyclage réduit les déchets, limite la pollution et économise les ressources.
Mettre à l’épreuve une idée en imaginant un point de vue opposé Cet exercice s’avère pertinent lorsqu’une idée fait consensus.
Au restaurant, Alain dit à Oumar : « La consommation locale est bénéfique pour l’économie et l’environnement. » Oumar lui répond : « Je suis d’accord avec ton idée. Cependant, certains produits importés peuvent être moins coûteux, ce qui réduit les dépenses des consommateurs »
Faire apparaître des variations dans quelque chose qui était auparavant perçu comme étant uniforme ou, au contraire, atténuer les contrastes ou les différences entre deux choses perçues auparavant comme étant différentes. L’habileté à nuancer permet d’éviter, entre autres, les généralisations et les préjugés.
Pendant le souper, le père de Laurie dit : « Les jeunes ne s’intéressent pas à la politique. » Laurie répond : « Les jeunes sont peu intéressés à la politique, c’est vrai, mais certains s’informent sur des enjeux sociaux importants D'autres participent même à des débats. »
Comparer deux situations différentes, mais dont certains aspects sont semblables. L’analogie sert souvent à faire comprendre quelque chose par un parallèle avec une situation plus connue
Ethan explique à sa mère sa philosophie en matière de finance. Il lui dit : « Avoir un budget équilibré, c’est un peu comme se nourrir : il faut ajuster sa consommation en fonction de ses besoins »
Mettre en évidence, dans les idées, ce qui est sous-entendu ou préalablement admis sans être dit
Juan discute avec sa sœur Guadalupe et lui dit : « C'est une bonne chose d'avoir une passion : tu devrais reprendre le piano. » Elle répond : « Donc, tu penses que je n'aurais pas dû arrêter de jouer du piano. »
Déterminer, à partir de critères, si des éléments sont en continuité (différence de degré) ou en rupture logique (différence de nature), s’ils relèvent du même phénomène ou non.
Différence de degré
Dara, éducatrice physique, parle de l’impact de l’activité physique sur la santé des gens. Elle mentionne qu’une marche de 30 minutes par jour améliore la santé cardiovasculaire. Si on augmente la marche à une heure par jour, les bienfaits pour la santé cardiovasculaire seront encore plus grands. Cela démontre que les bénéfices de la marche pour la santé varient en fonction de la durée de l’activité. (Différence de degré entre 30 minutes et une heure de marche)

Différence de nature
Au cours suivant, Dara présente les effets sur le corps des différents types d’activités. Elle prend en exemple la musculation et la danse La musculation aide à développer la force musculaire, tandis que la danse améliore également la flexibilité. En distinguant ces activités et leurs bienfaits, on comprend mieux l’importance de varier les exercices pour obtenir une meilleure santé globale. (Différence de nature entre les deux sports, bienfaits différents)

Curcuma : démarche sociologique, démarche de réflexion éthique, observation directe, questionnaire, entretien.
Shutterstock.com / C1 : élèves en classe © Rawpixel.com, 40488778.
iStock.com / p. 10 : jeunes à la cafétéria © Hispanolistic, 1411322814. Shutterstock.com / p. 1 : adolescent avec écouteurs © Ollyy, 86790025. p. 2 : groupe de jeunes © Jose Calcina, 2436846845. p. 3 : personnages en réunion © klyaksun, 2183470883. p. 5 : jeunes avec sacs à dos © chronicler, 773688853 ; enseignant devant sa classe © Monkey Business Images, 1332875000. p. 7 : Gilbert © Inside Creative House, 2505339787 ; Kabir © insta_photos, 2192136373 ; Eve-Lyne © Wayhome Studio, 2408565635 ; Maude © VH-studio, 2408897357 ; Sylvain © stockfour, 1016723167 ; Véronique © Anelo, 2197757639 ; Gisèle © Image Point Fr, 174171395. p. 8 : groupe de personnes de dos © oneinchpunch, 490906510. p. 9 : beigne, croquettes et frites © IDEA ROUTE, 2478397213. p. 11 : salade © lilik ferri yanto, 2512542933. p. 12 : plateau avec repas © Africa Studio, 1139822657. p. 15 : crevettes, arachides, œufs © New Africa, 1322462069. p. 24 : entonnoir © SPF, 2301838831 ; personnage balance avec ballons rouge et vert © kostasgr, 1961569669. p. 33 : silhouettes diversité © melitas, 1857402163. p. 34 : mains qui dialoguent © Roman Samborskyi, 2357375783. p. 35 : phylactères orange et jaune © Roman Samborskyi, 2357375783. p. 36 : mains qui pointent © Roman Samborskyi, 2285057785. p. 37 pictogrammes (de haut en bas) : © chocolat-10, 2440624205 ; © chocolat-10, 2418376737 ; © mi-vector, 2383077379 ; © chocolat-10, 2418376737 ; © Rvector, 1790019863. p. 38 pictogrammes (de haut en bas) : © chocolat-10, 2440624205 ; © Rvector, 1790019863 ; © chocolat-10, 2440624205 ; © Fourleaflover, 2133348541 ; © Fourleaflover, 2079740932. p. 39 pictogrammes (de haut en bas) : © Uswa KDT, 1928826860 ; © Fourleaflover, 2079740932 ; © smx12, 2474395423 ; © Kida, 2000657552 ; © Realstockvector, 2456066677. p. 40 égoportrait d'un groupe d'adolescents © Jose Calsina, 2506806499.


Conçue pour le cours Culture et citoyenneté québécoise en 5e secondaire, la collection
Enjeux citoyens a été créée par une équipe attentive aux besoins des élèves et des enseignants. Simple et complet, cet ensemble didactique facilite le développement des deux compétences du cours en abordant des sujets captivants pour les élèves.
La collection propose les composantes suivantes :
Un référentiel présentant les grandes lignes du Programme ainsi que les notions et concepts à l’étude :
• finalités, fondements, thèmes et concepts, compétences, etc. ;
• outils liés à la pensée critique : biais sociocognitifs, types de jugement, types et erreurs de raisonnement ;
• outils liés au dialogue : formes de dialogue, conditions favorables à l’interaction, moyens pour appuyer ses idées.
Quatre fascicules contenant chacun deux dossiers.
Un guide d’enseignement comportant une planification annuelle, des notes pédagogiques et des fiches reproductibles.
Sur maZoneCEC, accédez aux composantes de la collection en format numérique et à de nombreux enrichissements :
• des vidéos authentiques ainsi que d’autres, conçues spécifiquement pour la collection, mettant en scène différents spécialistes ;
• des fichiers audio, notamment des balados et des chansons ;
• des suggestions d’hyperliens menant à des ressources supplémentaires ;
• des exercices interactifs autocorrectifs