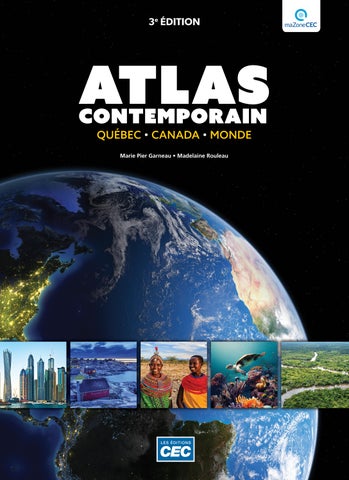ATLAS CONTEMPORAIN
QUÉBEC • CANADA • MONDE
Marie Pier Garneau • Madelaine Rouleau
Toponymes physiques
A l p e s
L e s Ap pa l a c h e s Atl as s a h a r i e n
S ahar a
D é s e rt de N ub i e
B assi n amazonie n
L a p o ni e
D e l ta d e l’Indu s
Logan 5 959
Challenger Deep -11 034
Ha w a ï
Île Maurice
Cap Horn
Chaîne de montagnes
Désert
Plateau, bassin, delta et vallée
Sommet
Fosse
Archipel
Cap Île
F o sse des Ma r ia n ne s Fosse et dorsale
Hydronymes
O CÉ A N
I N DI E N
M er d ’ Oma n M er No i r e M er de B al i
G o l f e du Bengale
Baie d’Hudson
G o l f e d A l a s k a
Banquise de Ross
Détroit d’Hudson
Canal de Panama
Gange
Lac Champ ain
Symboles des localités
NEW YORK
ALEXANDRIE
Marrakech
Monza
Avignon
Sorel-Tracy
VIENNE
Océan
Mer
Baie et golfe
Banquise
Détroit et canal
Fleuve, rivière et lac
5 000 000 hab. et plus
1 000 000 à 5 000 000 hab
500 000 à 1 000 000 hab
100 000 à 500 000 hab
50 000 à 100 000 hab
Moins de 50 000 hab
Capitale d’État indépendant*
* Dans certains cas, les capitales des provinces ou des régions sont soulignées. Dans les autres cas, seules les capitales d’État indépendant sont soulignées. Dans tous les cas, le symbole de localité des capitales d’État indépendant est en rouge
Classe (intervalle de valeurs)
Personnes ayant accès à l’eau potable (%), 2024
Moins de 50
50 à 70
70 à 80
80 à 90
90 et plus
Données non disponibles
Source Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde
Toponymes politiques
La limite inférieure d’une classe est toujours incluse, et la limite supérieure, exclue.
Centrales de production d’énergie
Centrale hydroélectrique (barrage)
I E
C ANAD A
MEXIQU E
F R ANC E
KO S OV O A S
Corse (Fr.)
QUÉBE C
B O UR GOG N E
MO N TÉRÉGI E
Ressources exploitées
Aluminium
Cuivre
Diamant
Fer et acier
Nickel
Or et argent Al Cu Fe Ni Au Ag
Continent
État indépendant
Territoire dépendant
Province, État ou département
Région administrative
Silice et sable
Terre rare
Zinc et plomb
Argile
Charbon Sel Zn Pb
*Dans les cartes combinant deux éléments (ex : Mines et ressources), l’utilisation des bornes rectangulaires représentant les éléments aurait rendu la lecture difficile. Pour cette raison, elles sont représentées par des boulets de couleur
Principales industries
Haute technologie
Industrie aéronautique
Industrie alimentaire
Industrie automobile
Altitudes et milieux naturels
Industrie chimique
Industrie électronique
Industrie navale
Industrie textile
Centrale hydroélectrique (marémotrice et par les vagues)
Centrale solaire
Éoliennes
Centrale thermique (charbon, gaz naturel, mazout)
Centrale nucléaire
Gisements, raffinage et transport
Gisement de gaz naturel
Gisement de pétrole
Raffinerie de pétrole
Gazoduc
Oléoduc
Limites
Frontière internationale
Frontière nationale
Frontière régionale
Frontière internationale contestée
Frontière nationale contestée
Communications
Route principale
Chemin de fer
Abréviations et sigles
AA Avant l’Actuel
AA Avant l’Actuel
BRICA Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud
BRICS+ Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, Égypte, Émirats arabes unis, Éthiopie, Indonésie, Iran
FAO Organisation des Nations Unis pour l'alimentation et l’agriculture
GINI1 Coefficient de Gini
FAO Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
GINI* Coefficient de Gini
IDH2 Indice de développement humain
MDMA 3,4-méthylène-dioxy-methamphétamine (ecstasy)
IDHI** Indice de développement humain ajusté aux inégalités
km2 Kilomètre carré
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
kt Kilotonne
OMC Organisation mondiale du commerce (OMC)
kV Kilovolt
OMS Organisation mondiale de la Santé (ONU)
m3 Mètre cube
PIB Produit intérieur brut
MW Mégawatt
PNUD Programme des Nations Unies pour le développement
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
RNB Revenu national brut
OMC Organisation mondiale du commerce
OMS Organisation mondiale de la santé
ONU Organisation des Nations unies
OTAN Organisation du traité de l’Atlantique Nord
1 Le coefficient de GINI est une mesure statistique développée par l'Italien Corado Gini utilisée pour mesurer l'inégalité des revenus dans un pays. Ce coefficient varie de 0 à 100, où 0 représente l'égalité parfaite et 100, l'inégalité parfaite
PIB Produit intérieur brut
PNUD Programme des Nations unies pour le développement
2 L'IDH est une mesure composite du développement humain contenant des indicateurs distincts représentant trois éléments du développement humain : la longévité (espérance de vie à la naissance), les connaissances (alphabétisation des adultes et moyenne d'années d'études) et le revenu (en parités de pouvoir d'achat exprimé en dollars par habitant).
PPA Parité de pouvoir d’achat
RNB Revenu national brut
SIGI*** Indice Institutions sociales et égalité des genres
UNESCO Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture
$ US Dollar américain
* Le coefficient de GINI est une mesure statistique développée par l’Italien Corado Gini, utilisée pour mesurer l’inégalité des revenus dans un pays. Ce coefficient varie de 0 à 100, où 0 représente l’égalité parfaite et 100, l’inégalité parfaite.
** L’IDHI est une mesure composite qui permet d’évaluer le niveau de développement humain des pays du monde, tout en tenant compte des inégalités relatives à l’espérance de vie à la naissance, au niveau d’éducation et au niveau de vie (revenu et pouvoir d’achat).
*** Le SIGI (Social Institutions and Gender Index) est un indice qui mesure les discriminations dans les institutions sociales qui affectent l’égalité des genres, notamment à travers des pratiques, normes et lois discriminatoires dans différents pays.
ATLAS CONTEMPORAIN
QUÉBEC • CANADA • MONDE
Direction de l’édition :
Janik Trépanier
Direction du développement éditorial :
Hugo Paquette
Direction de la production :
Manon Boulais
Direction adjointe à la production :
Dimitri Lesage
Charge de projet :
Alice Bergeron, 1re édition
Nathalie Le Coz, 2e édition
Yzabelle Martineau, 3e édition
Révision linguistique :
Yzabelle Martineau
Isabelle Renaud
Correction d’épreuves :
Danielle Maire
Marie Théorêt
Rédaction de La Terre dans l’Univers et Projections cartographiques :
Léo Larrivée, M. Sc. (Géomatique)
Révision cartographique :
Julie Benoit, Léo Larrivée, Julie Provost, 1re édition
Julie Benoit, 2e et 3e édition
Recherche et collecte de données :
Élyane Montmarquet
Nicolas Therrien
Direction de la géomatique et de la cartographie :
Yanick Vandal (Colpron),1re, 2e et 3e édition
Cartographie :
Yanick Vandal (Colpron)
Marie-Ève Fillion (Colpron),1re édition
Amélie Levasseur-Raymond (Colpron), 2e édition
Direction artistique :
Hugo Aubin (Colpron), 1re et 2e édition
Josée Lavigne (Catapulte), 3e édition
Conception et réalisation graphique :
Yanick Vandal, 1re et 2e édition
Josée Lavigne, 3e édition
Illustrations : Marie-Joëlle Fournier
La Loi sur le droit d’auteur interdit la reproduction d’œuvres sans l’autorisation des titulaires des droits. Or, la photocopie non autorisée –le photocopillage – a pris une ampleur telle que l’édition d’œuvres nouvelles est mise en péril. Nous rappelons donc que toute reproduction, partielle ou totale, du présent ouvrage est interdite sans l’autorisation écrite de l’Éditeur.
Les Éditions CEC inc. remercient le gouvernement du Québec pour l’aide financière accordée à l’édition de cet ouvrage par l’entremise du Programme de crédit d’impôt pour l’édition de livres, administré par la SODEC.
Atlas contemporain – Québec, Canada, monde, 3e édition © 2025 Les Éditions CEC inc. 9001, boul. Louis-H.-La Fontaine Anjou (Québec) H1J 2C5
Téléphone : 514 351-6010
Télécopieur : 1 800 363-0494 www.editionscec.com
Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire, d’adapter ou de traduire l’ensemble ou toute partie de cet ouvrage sans l’autorisation écrite du propriétaire du copyright.
Dépôt légal : 2025
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives Canada
ISBN 978-2-7662-1664-2
Imprimé au Canada
1 2 3 4 5 25 26 27 28 29
Révision scientifique :
Elisabeth Lefebvre, Cégep de Trois-Rivières
Eric Pouliot-Thisdale, Université de Montréal
Rédaction du complément pédagogique (ateliers et guide) : Félix-Antoine Simoneau, Cégep de Sherbrooke
Majorie Leblanc, Cégep de Sherbrooke
REMERCIEMENTS
L’éditeur et les autrices souhaitent remercier les personnes suivantes, qui ont participé à titre de consultants pédagogiques, pour leur professionnalisme et leurs judicieuses suggestions :
1re édition :
Marie-Pier Blanchard, Cégep André-Laurendeau
Denis Bruneau, Collège Montmorency
Michel Fabre, Cégep Beauce-Appalaches
Marilou Fleury, Cégep de Sorel-Tracy
Marie-Élaine Lambert, Collège Marie-Victorin
Élisabeth Lapointe, Cégep de Granby
Louise Marchand, Cégep Édouard-Montpetit
Éric Mottet, UQAM
2e édition :
Marie-Pier Blanchard, Cégep André-Laurendeau
Hélène Durocher, Cégep Édouard-Montpetit
Sonia Hachem, Cégep de Valleyfield
Olivier Lalonde, Collège Lionel-Groulx
Élisabeth Lapointe, Cégep de Thetford
Marie-Noëlle Lapointe, Collège Maisonneuve
Geneviève Ouellet, Cégep André-Laurendeau
David Pominville, Cégep de Saint-Jérôme
Martin Roy, Cégep de Granby
Félix-Antoine Simoneau, Cégep de Sherbrooke
3e édition :
Olivier Lalonde, Cégep Montmorency
Élisabeth Lapointe, Cégep de Sainte-Foy
Nathalie Bélisle , Cégep de l’Outaouais
Marie-Pier Blanchard, Cégep André-Laurendeau
Benjamin Boissoneault-Vaudreuil, Cégep de Rimouski
Sophie Brodeur, Cégep de La Pocatière
Caroline Côté, Cégep de Rosemont
Estelle Dricot, Cégep André-Laurendeau
Julie Émond, Collège de Maisonneuve
Isabelle Gagnon, Cégep de Victoriaville
Gaël Gauthier-Minville, Cégep de Rosemont
Denis Granjon, Collège Lionel-Groulx
Geneviève Guimont, Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
Maude Laroche, Cégep de Lanaudière
Elisabeth Lefebvre, Cégep de Trois-Rivières
Marianne Mathis, Cégep de Trois-Rivières
Sophie Noël, Cégep Gérald-Godin
Geneviève Ouellet, Collège Bois-de-Boulogne
David Pominville, Cégep de Saint-Jérôme
Martin Roy, Cégep Édouard-Montpetit
Katherine Sicotte, Cégep Édouard-Montpetit
PRÉFACE
Le monde est en perpétuel mouvement, et ce, autant à l’échelle temporelle que spatiale. Cette dynamique met en lumière à la fois la stabilité de certains phénomènes influencés par des processus millénaires – qui ne changent pas entre deux éditions de l’atlas – alors que certaines situations humaines ou environnementales changent rapidement. Dans ce contexte évolutif où l’information peut être sujette à interprétation ou manipulation dans certains cas, l’Atlas contemporain est conçu avec rigueur scientifique et neutralité intellectuelle. Les enjeux géopolitiques, les crises environnementales ou les dynamiques sociales y sont présentés avec nuance, rappelant que la complexité du monde ne saurait se réduire à une carte figée dans le temps. En croisant les échelles – du global au régional –, l’Atlas contemporain invite à contextualiser, à comparer, à réfléchir. Les cartes offrent certes des réponses, mais sont également des portes ouvertes vers le questionnement. La géographie, science des rapports entre les espaces et les humains, nous offre non seulement une compréhension des territoires, mais elle nous invite également à réfléchir à notre place et à notre impact sur cette planète. La cartographie, quant à elle, est le reflet d’un savoir construit au fil des siècles, nourri par l’observation, la recherche et l’analyse, qui tente de représenter, non sans défi, ces rapports à l’espace.
Dans une époque où l’information circule en abondance, il est essentiel de distinguer le savoir fondé sur la science de celui altéré par la désinformation ou de l’opinion. La géographie nous apprend que comprendre le monde passe par une approche critique et éclairée, où chaque carte, chaque frontière, chaque relief ou climat raconte une histoire vérifiée et documentée. C’est donc dans une volonté de proposer un ouvrage actuel, tant dans sa forme que dans son contenu, que nous avons conçu cette 3e édition de l’Atlas contemporain
Un atlas québécois pour le collégial
En plus de refléter les préoccupations actuelles, cet ouvrage est un outil polyvalent et varié s’adressant d’abord et avant tout aux lectrices et lecteurs s’initiant à l’outil cartographique et à la pensée géographique. Le découpage géohistorique préconisé depuis la première édition de l’Atlas contemporain permet la combinaison des propos sociologiques et politiques (découpage territorial, occupation du territoire, inégalités sociales, dynamiques urbaines, prépondérances culturelles, etc.), qui forment l’essentiel des thèmes présentés dans l’ouvrage. Ce dernier favorise une compréhension éclairée des réalités géographiques mondiales répondant ainsi aux exigences des cours d’initiation à la géographie au collégial et aux diverses attentes des enseignant.e.s de géographie. Mais, puisque le regard porté sur le monde et les préoccupations qu’il suscite est multiple, toute personne curieuse de comprendre le monde qui l’entoure y trouvera aisément son compte !
Nouveautés dans le contenu de l’atlas
D’une édition à l’autre, nous tentons d’innover et d’offrir une lunette d’analyse toujours plus ouverte et accueillante. D’ailleurs, nous n’avons jamais souhaité imposer une vision quelle qu’elle soit du traitement de l’information, mais plutôt offrir des clés de lecture pluralistes. C’est pourquoi nous abordons des thèmes d’actualité reflétant la réalité humaine globale – environnement, disparités sociales, contexte démographique – et les conséquences de ces différents facteurs sur le fait humain. En plus des nombreuses notes explicatives traitant de notions géographiques précises ainsi que de courtes synthèses de certaines réalités complexes, nous avons bonifié cette édition-ci d’un lexique, de schémas explicatifs et de dossiers thématiques. Ces ajouts visent à toujours mieux outiller les lectrices et les lecteurs dans leurs analyses et leur compréhension des phénomènes physiques et humains qui façonnent la planète. Encore et toujours, nous posons, au fil des sections, un regard sur les préoccupations actuelles, les documentons grâce aux données les plus récentes disponibles et les illustrons au moyen d’une conception et d’un traitement entièrement québécois.
Remerciements
Nous tenons à remercier dans un premier temps les étudiant.e.s qui sont, encore et toujours, notre source première de motivation à nous investir dans ce vaste projet. Que cet ouvrage puisse vous inspirer et alimenter votre curiosité. Une salutation sincère est de mise à l’équipe d’édition guidée par Janik Trépanier qui a fait, une fois de plus, un effort considérable pour offrir une information à jour grâce à un travail minutieux, attentif et rigoureux. C’est toujours un travail colossal de traduire en langage d’édition nos demandes cartographiques ! Sans oublier les consultant.e.s qui ont consacré du temps à l’examen de l’ouvrage et à l’expression de multiples suggestions et angles d’analyse. Finalement, un remerciement très senti à notre entourage personnel qui a souvent accepté de se livrer à des analyses et des relectures d’ébauches et qui nous encourage à poursuivre ce projet après plus de 10 ans. Parce que la géographie, sous tous ses angles d’analyse, est réellement vivante et passionnante ! Bonne lecture !
Madelaine Rouleau, géographe et M. Env. Spéc. EREDD Marie Pier Garneau, géographe et M. Éducation
20 Monde physique
22 Monde politique
24 Population
24 Répartition et densité brute de la population mondiale
24 Pays présentant un accroissement démographique élevé
25 Pays présentant un déclin démographique marqué
26 Tectonique et géologie
26 Formation des continents
26 Plaques lithosphériques
26 Profil topographique au 40o de latitude nord
27 Activités volcaniques et sismiques
28 Structure du globe
28 Dernier maximum glaciaire du Quaternaire
28 Périodes glaciaires et interglaciaires du Quaternaire
29 Reliefs
29 Sols
30 Climat
30 Températures
31 Pressions atmosphériques
32 El Niño et La Niña
32 Précipitations
33 Climatogrammes
34 Types de climats
35 Biomes
35 Biomes
36 Environnement
36 Changements climatiques 1800-2050
36 Émissions de GES
37 Pollution hydrique
37 Dégradation des sols
38 DOSSIER Changements climatiques
40 Bilan forestier
40 Hauts lieux de la biodiversité
41 Catastrophes naturelles
41 Catastrophes industrielles
42 DOSSIER Biodiversité
44 Ressources naturelles
44 Agriculture, élevage et pêche
44 Principales denrées des grandes régions du monde
45 Culture d’organismes vivants modifiés
45 Culture biologique
46 Mines et énergie
46 Production d’énergie
46 Consommation d’énergie
47 Production de minerais et d’engrais
47 Production de terres rares et de métaux précieux
48 Urbanisation
48 Le monde la nuit
49 Population urbanisée et accroissement urbain
50 Population
50 DOSSIER Autochtones
52 Langues
52 Aires religieuses
53 Natalité
53 Mortalité
53 Mortalité infantile
54 Espérance de vie
54 Jeunes
54 Personnes âgées
55 Accroissement naturel
55 Pyramides des âges
56 Conditions de vie
56 Indice de développement humain
56 Alphabétisation
56 Éducation des filles
57 Situation sanitaire
71 AMÉRIQUE DU NORD, AMÉRIQUE CENTRALE ET ANTILLES
72 Amérique du Nord – Couvert végétal
73 Amérique du Nord – Climat
74 Amérique du Nord physique
75 Amérique du Nord politique
76 Cartes thématiques
76 Cartes historiques
76 Répartition et densité brute de la population
77 Narcotrafic
77 Consommation de drogues
78 Canada
80 Ensembles physiographiques
80 Régions écoclimatiques
80 Anthropisation du territoire
81 Production de minerais
81 Énergie
82 Industries
82 Répartition et densité brute de la population
83 Réseau Grands Lacs – Voie maritime du Saint-Laurent
83 Profil du réseau Grands Lacs –Voie maritime du Saint-Laurent
83 Trafic des marchandises – Grands Lacs –Voie maritime du Saint-Laurent
84 Expansion du territoire
84 Vancouver
85 Toronto, Ottawa-Gatineau et Halifax
86 Parcs et réserves du Canada
57 Accès à l’eau potable
57 Sous-alimentation et insécurité alimentaire
58 Vaccination
58 Virus de l’immunodéficience humaine (sida)
58 Indice du bonheur
59 Économie
59 Stades de développement industriel
59 Produit intérieur brut
59 Croissance du produit intérieur brut
60 Emplois, secteur primaire
60 Emplois, secteur secondaire
60 Emplois, secteur tertiaire
61 Transport maritime
61 Internet
62 Tourisme
62 Tourisme
62 Revenus touristiques
62 Déplacements touristiques
63 Politique
63 Empires coloniaux en 1939
63 Aide au développement
64 Organisations politiques internationales I
64 Organisations politiques internationales II
64 Organisations économiques internationales I
65 Organisations économiques internationales II
65 Disponibilité en eau douce et conflits
65 Dépenses militaires
66 Guerres et paix
66 Population réfugiée
67 Murs, barrières et clôtures
67 Population carcérale
68 DOSSIER Migrations humaines
70 Peine de mort
70 Indice d’égalité de genre
70 Droits des personnes LGBTQ2+
87 Québec
88 Régions physiographiques
88 Déglaciation
88 Végétation
88 Anthropisation du territoire
89 Énergie
89 Industrie minière
89 Acériculture
89 Partenaires commerciaux
90 Hydrographie
90 Charge sédimentaire
91 Carte topographique et photo aérienne
92 Communauté métropolitaine de Montréal et Vieux-Montréal
93 Montréal et Québec vues de l’espace
93 Communauté métropolitaine de Québec et arrondissement historique de Québec
94 Répartition et densité brute de la population
94 Variation de la population
95 Communautés autochtones
96 États-Unis
98 San Francisco, Los Angeles et Washington (D.C.)
99 New York
99 Îlots de chaleur urbains de la ville de New York
100 Expansion du territoire
100 Régions économiques
101 Anthropisation du territoire
101 Mines et industries
101 Énergie
102 Répartition et densité brute de la population
102 Accroissement de la population
102 Revenus
103 Migration nette
103 Esclavage vers 1860
103 Groupes ethniques
104 Mexique, Amérique centrale et Antilles
106 Répartition et densité brute de la population
106 Mines et industries
106 Énergie
107 Anthropisation du territoire
107 Divisions administratives
107 Partenaires commerciaux du Mexique et de l’Amérique centrale
108 Échanges États-Unis – Mexique
108 Narcotrafic
109 Pauvreté
109 Mexico
109 Évolution démographique de Mexico
110 Cataclysmes
110 Déforestation d’Haïti
110 Canal de Panama
111 AMÉRIQUE DU SUD
112 Amérique du Sud – Couvert végétal
113 Amérique du Sud – Climat
114 Amérique du Sud physique
115 Amérique du Sud politique
116 Amérique du Sud tropicale
123 EUROPE
124 Europe – Couvert végétal
125 Europe – Climat
126 Europe physique
127 Europe politique
128 Cartes thématiques
128 Répartition et densité brute de la population
128 Réseaux de transport
129 Portrait économique
129 Anthropisation du territoire
130 Évolution territoriale de l’Europe (1000-2024)
131 Langues
131 Religions
132 Situation de l’énergie dans la mer du Nord
133 Royaume-Uni et Irlande
134 Répartition et densité brute de la population
134 Mines et industries
134 Énergie
135 Londres
136 Europe du Nord
137 Répartition et densité brute de la population
137 Mines et industries
137 Énergie
138 Benelux
139 Répartition et densité brute de la population
139 Mines et industries
163 ASIE
164 Asie – Couvert végétal
165 Asie – Climat
166 Asie physique
167 Asie politique
168 Cartes thématiques
168 Répartition et densité brute de la population
168 Sous-alimentation et insécurité alimentaire
169 Dépendance hydrique
169 Disponibilité en eau douce et conflits
170 Mosaïque ethnolinguistique
170 Narcotrafic et consommation de drogues
171 Droits des femmes
171 Portrait économique
189 AFRIQUE
190 Afrique – Couvert végétal
191 Afrique – Climat
192 Afrique physique
193 Afrique politique
194 Nord de l’Afrique
196 Sud de l’Afrique
206 Océanie – Couvert végétal
207 Océanie – Climat
208 Océanie physique
209 Océanie politique
210 Océanie
212 Océans Pacifique et Indien
118 Amérique du Sud australe
119 Cartes thématiques
119 Répartition et densité brute de la population
119 Urbanisation et pauvreté
119 Rio de Janeiro
120 Anthropisation du territoire
120 Déforestation
139 Énergie
139 Protection contre la mer
140 France
141 Répartition et densité brute de la population
141 Mines et industries
141 Énergie
142 Paris
143 Alpes suisses et autrichiennes
143 Profil topographique entre Milan et Munich
143 Répartition et densité brute de la population
143 Langues
144 Allemagne
145 Répartition et densité brute de la population
145 Mines et industries
145 Énergie
145 Berlin 1945-1989
145 Berlin
146 Bassin méditerranéen
148 Stress hydrique dans la Méditerranée
148 Portrait des ressources halieutiques de la Méditerranée
149 Urbanisation, agriculture et irrigation des pays du pourtour de la Méditerranée
149 Pollution de la Méditerranée
150 Espagne – Portugal
151 Répartition et densité brute de la population
172 Moyen-Orient
173 Anthropisation du territoire
173 Géopolitique de l’eau
174 DOSSIER Enjeux territoriaux
176 Israël et Palestine
176 Répartition et densité brute de la population
176 Géopolitique de l’eau
177 Monde indien
178 Répartition et densité brute de la population
178 Partenaires commerciaux
179 Bidonvilles et problématique socioéconomique
179 Anthropisation du territoire
180 Asie du Sud-Est
197 Cartes thématiques
197 Répartition et densité brute de la population
197 Le Caire et Johannesburg
198 DOSSIER Transition démographique
200 Anthropisation du territoire
200 Mines et industries
200 Portrait économique
214 Cartes thématiques
214 DOSSIER Montée des eaux
216 Répartition et densité brute de la population
216 Partenaires commerciaux
216 Mines et industries
216 Sydney
120 Partenaires commerciaux
121 Mines et énergie
121 Portrait économique
121 Narcotrafic et consommation de drogues
122 Colonisation et décolonisation
122 Mosaïque ethnique
151 Mines et industries
151 Barcelone
152 Italie
153 Répartition et densité brute de la population
153 Mines et industries
153 Rome
154 Europe du Sud-Est
155 Fédération de la Yougoslavie (avant 1991)
155 Mosaïque culturelle de l’ex-Yougoslavie (après 1991)
155 Grèce, Türkiye et Chypre – Mosaïque culturelle
156 Europe de l’Est
157 Répartition et densité brute de la population
157 Mines et industries
157 Mosaïque culturelle
158 Russie
160 Répartition et densité brute de la population
160 Mines et industries
160 Énergie
161 États postsoviétiques
161 Géopolitique du pétrole – Russie et pays voisins
162 Caucase – Mosaïque ethnolinguistique et état des conflits
162 Moscou
182 Asie de l’Est
184 Répartition et densité brute de la population
184 Partenaires commerciaux
184 Mines, industries et énergie
185 Anthropisation du territoire
185 Climat
185 Shanghai
186 Japon
187 Répartition et densité brute de la population
187 Mines, industries et énergie
187 Anthropisation du territoire
188 Morphotectonique du Japon et des pays voisins
188 Baie de Tokyo
201 Dépendance hydrique
201 Sous-alimentation et insécurité alimentaire
201 Mouvements de population
202 DOSSIER Urbanisation
204 Afrique en 1950 et décolonisation
204 Mosaïque ethnolinguistique
204 Droits des femmes
218 Arctique
219 Antarctique
220 Cartes thématiques
220 Enjeux territoriaux et environnementaux en Arctique
220 Enjeux territoriaux en Antarctique
A ÉCHELLES
Il y a différentes façons de se repérer sur une carte. Les lignes principales vues précédemment (méridiens, parallèles, lignes de navigation, etc.) donnent des précisions sur l’emplacement d’un lieu. L’échelle est le rapport entre les distances mesurées sur la carte et celles mesurées sur le terrain. Ainsi, une échelle de 1 : 100 000 indique que la représentation cartographique est 100 000 fois plus petite que la réalité. En effet, 1 cm sur cette carte équivaudra à 100 000 cm ou 1 km dans la réalité. La fraction de l’échelle (1/100 000) est en fait un rapport de nombres
DIFFÉRENTS TYPES D’ÉCHELLES ET DE CARTES
Exemples d’échelles
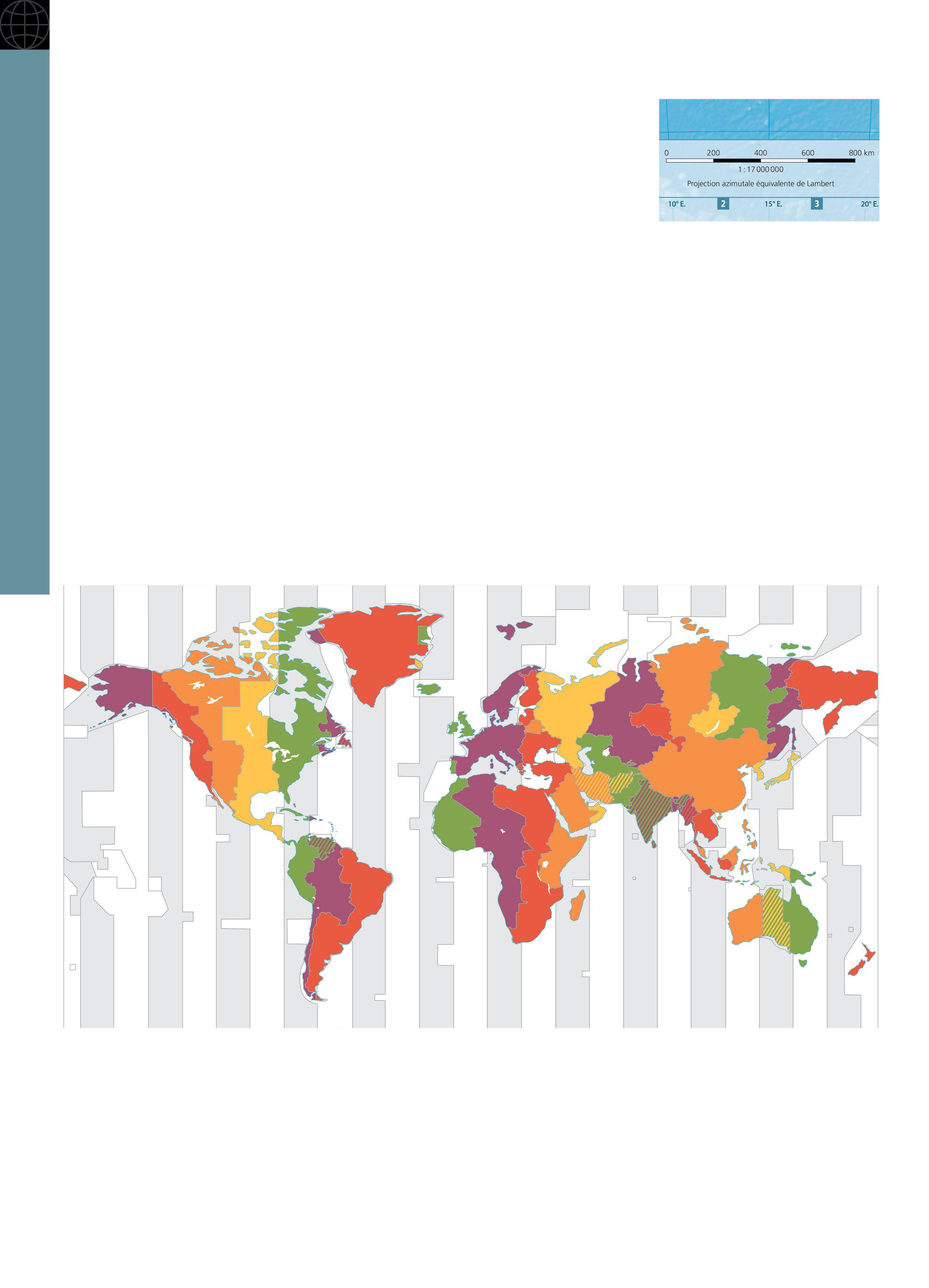
entiers (1 : 100 000) qui existe entre le nombre d’unités sur la carte (1) et le nombre d’unités auxquelles cette unité correspond dans la réalité (100 000).
L’échelle de construction d’une carte n’est vraie que par rapport à certains éléments représentés sur la carte tels le point ou les lignes de contact. Partout ailleurs sur la carte, l’échelle varie et varie d’autant plus que la surface couverte est grande et que le point observé est loin du centre de projection.
ÉCHELLE GRAPHIQUE
Est facile à utiliser.
Exemples de cartes
Grande échelle 1 : 1 à 1 : 50 000 Carte topographique, plans (de maison, de ville)
Moyenne échelle 1 : 100 000 à 1 : 1 000 000 Carte d’agglomérations, de régions
Petite échelle 1 : 1 000 000 à 1 : 10 000 000
Très petite échelle 1 : 100 000 000 et moins
Carte de pays, de continents
Carte du monde (planisphère, mappemonde)
Les différents types d’échelles doivent être utilisés avec circonspection, car si les échelles s’appliquent localement, il n’en demeure pas moins qu’elles sont trompeuses dans toutes les autres circonstances.
B FUSEAUX HORAIRES
Avant l’invention des fuseaux horaires, chaque région déterminait l’heure en fonction de la position du Soleil, ce qui causait une grande confusion, notamment pour les transports et le commerce. En 1880, l’heure de Greenwich, ville près de Londres, est adoptée comme référence mondiale, et en 1884, le méridien qui la traverse devient le méridien d’origine, base des 24 fuseaux horaires que l’on crée et qui correspondent aux heures de la journée. Chaque fuseau détermine une heure précise par rapport à Greenwich, mais chaque pays peut ajuster son heure selon le temps universel coordonné (TUC). Par exemple, les États-Unis et le Canada possèdent six fuseaux horaires, tandis que la Chine, malgré son étendue, en utilise un seul (+8). En se déplaçant vers l’est, on ajoute des heures, tandis que vers l’ouest, on en retranche.
Peut être trompeuse aux petites échelles, car elle s’applique généralement en un lieu (ex. : équateur) et dans une direction.
Donne une information limitée. Conserve sa valeur si la carte est extraite d’un document et subit des transformations (agrandissement ou rétrécissement).
ÉCHELLE
Est plus informative que l’échelle graphique.
Représente une région restreinte.
Est souvent l’échelle de construction.
Devrait être une valeur ronde (ex. : 1 : 100 000).
C ÉLÉMENTS DE GÉOGRAPHIE PHYSIQUE
Terre
ARCHIPEL Groupe d’îles.
CONTINENT Immense étendue de terre habituellement délimitée par un ou plusieurs océans ou mers.
ÎLE Étendue de terre entourée d’eau.
PÉNINSULE ET PRESQU’ÎLE Portions de terre presque entourées d’eau. Une péninsule est plus grande qu’une presqu’île.
Eau
AFFLUENT Cours d’eau qui se jette dans un autre. ANSE Petite baie.
BAIE OU GOLFE Partie de mer ou de lac avancée dans les terres. Une baie est moins grande qu’un golfe.
ESTUAIRE Embouchure où l’eau douce d’un fleuve rejoint l’eau salée de la mer.
FLEUVE Cours d’eau important qui se jette dans la mer ou l’océan.
LAC Étendue d’eau, habituellement douce, à l’intérieur des terres.
MER Grande étendue d’eau salée, moins grande et moins profonde qu’un océan.
OCÉAN Immense étendue d’eau salée.
RIVIÈRE Cours d’eau au débit moyen, recevant des affluents, qui se jette dans un autre cours d’eau plus important.
RUISSEAU Cours d’eau plus petit qu’une rivière.
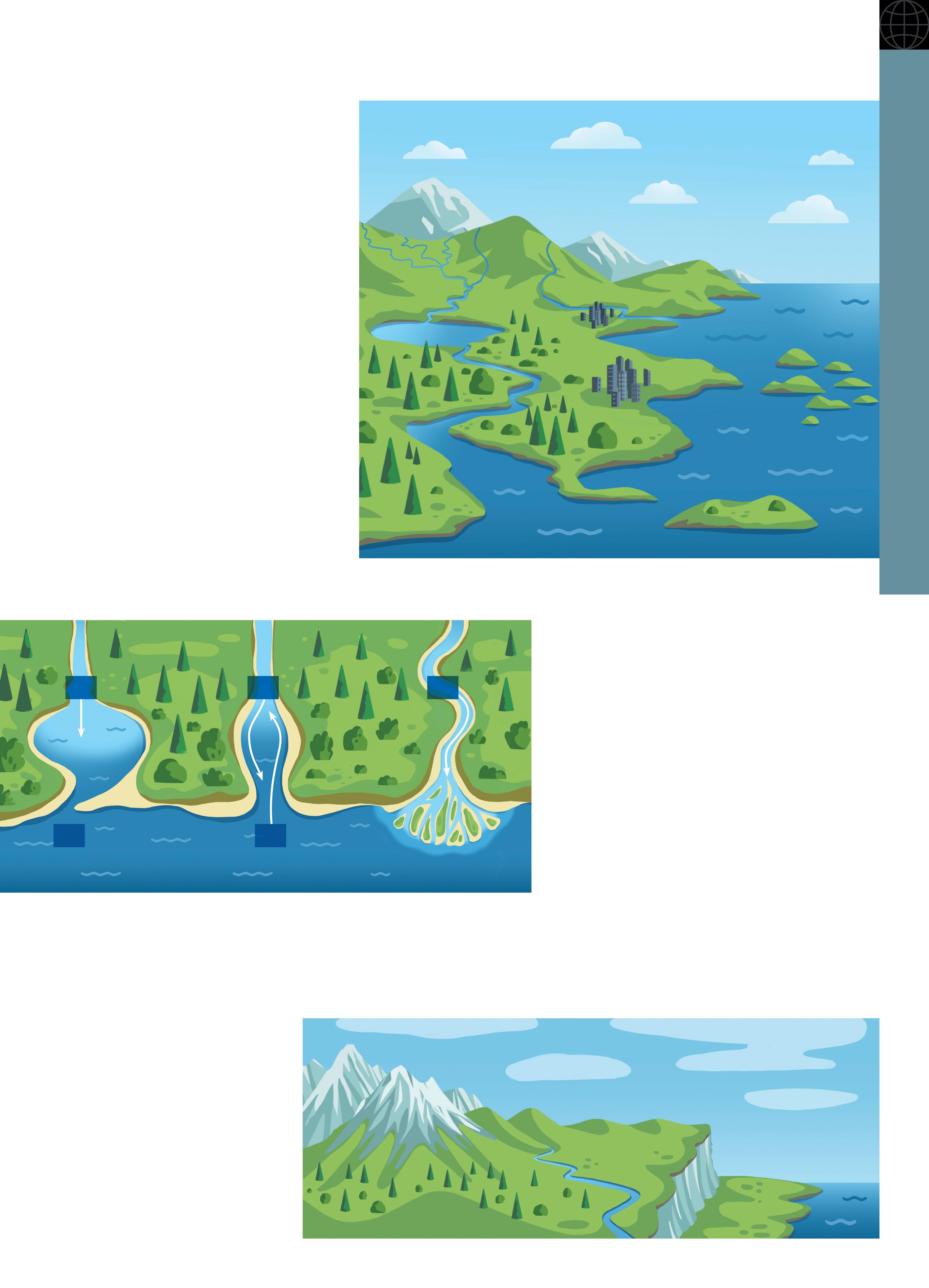
Relief
ALTITUDE Élévation verticale d’un lieu au-dessus du niveau de la mer.
CHAÎNE DE MONTAGNES Ensemble de montagnes reliées entre elles.
COLLINE Élévation modérée du sol, au sommet arrondi et aux versants en pente douce.
MONTAGNE Grande élévation du sol aux versants en pente raide.
PLAINE Grande étendue de terrain plate située à basse altitude.
PLATEAU Grande étendue de terrain assez plate située à une altitude plus ou moins élevée.
RELIEF Ensemble de formes (élévations, dépressions, pentes) sur la surface terrestre.
VALLÉE Creux entre deux zones plus élevées, généralement occupé par un cours d’eau.
Milieux de transition
BARRE D’EMBOUCHURE Accumulation de sédiments à l’embouchure d’un cours d’eau.
BARRE DE MÉANDRE Dépôt d’alluvions constitué de graviers, sable, galets, vase, argile ou limon qui se forme sur la berge intérieure d’un coude de rivière, là où le courant est plus faible.
CHENAUX DISTRIBUTAIRES Branches d’un cours d’eau qui se séparent du canal principal et transportent l’eau dans plusieurs directions, souvent dans un delta ou une plaine inondable.
CORDON LITTORAL Étendue de sable ou de galets qui s’étire le long d’une côte ou d’une rive, formant souvent une barrière naturelle qui isole une lagune.
DELTA Type d’embouchure fluviale caractérisé par un fort alluvionnement.
LAGUNE Étendue d’eau en liaison restreinte avec la mer et généralement fermée par un cordon littoral.
MÉANDRE Sinuosité d’un cours d’eau qui entraîne une érosion de la rive concave et une accumulation (barre de méandre) sur la rive convexe.
PLAINE ALLUVIALE Plaine formée par le dépôt d’alluvions provenant de l’érosion en amont.
Eau
Eau douce
Eau
douce
Continent
Île
Archipel
Péninsule
Océan
Mer Baie ou golfe
Anse
Estuaire
Lac Fleuve
Rivière
Ruisseaux Affluent
Chaîne de montagnes
Vallée
Plateau Plaine
Colline
Niveau de la mer
Altitude
Barres d’embouchure
Chenaux distributaires
DELTA
Méandre
Barre de méandre
ESTUAIRE
LAGUNE
Cordon littoral
Plaine alluviale
Rivière Fleuve Fleuve
Cryosphère
CALOTTE GLACIAIRE Glacier recouvrant une zone située en altitude.
GLACE DE LAC ET DE RIVIÈRE Glace qui résulte du gel de l’eau de lac ou de rivière qui se forme à leur surface.
BANQUISE Glace qui résulte du gel de l’eau de mer qui se forme à la surface de l’océan dans les régions polaires.
GLACIER Étendue de glace résultant de l’accumulation et de la compression progressive de couches de neige sur la terre ferme.
ICEBERG Grande masse de glace détachée d’un glacier, d’une calotte glaciaire ou d’un inlandsis, dérivant à la surface de l’eau.
INLANDSIS Énorme masse de glace continentale d’une superficie d’au moins 50 000 kilomètres carrés et de quelques milliers de mètres d’épaisseur.
NEIGE Vapeur d’eau congelée sous forme de cristaux dans les régions hautes de l’atmosphère et qui retombe sous forme de flocons.
PERGÉLISOL Sol qui reste gelé pendant au moins deux années consécutives, parfois depuis des millions d’années.
PLATEFORME GLACIAIRE Grand morceau de banquise relié à la côte et formé par l’avancée en mer d’un glacier.

Zone d’accumulation (névé)
CREVASSE Ouverture naturelle, étroite et profonde, à la surface d’un glacier.
EAU DE FONTE Eau libérée lors de la fonte de la glace.
FRONT DU GLACIER Extrémité basse du glacier qui marque la limite entre le glacier et le lac ou le ruisseau proglaciaire.
GLACIER SUSPENDU Masse de glace qui se forme sur les parois d’une vallée glaciaire et dont l’écoulement s’arrête avant d’atteindre le glacier principal en contrebas.
LAC PROGLACIAIRE Étendue d’eau alimentée par la fonte d’un glacier.
LAC SUPRAGLACIAIRE Étendue d’eau à la surface d’un glacier.
MORAINE DE FOND Accumulation de débris rocheux sous le glacier.
d’ablation
MORAINE FRONTALE OU LATÉRALE Accumulation de débris rocheux détachés d’un glacier et transportés dans ou sur la glace devant le glacier (moraine frontale) ou sur le bord du glacier (moraine latérale).
RIMAYE Crevasse qui sépare le glacier de la paroi rocheuse supérieure.
SÉRAC Bloc de glace de grande taille partiellement détaché du glacier.
TORRENT SOUS-GLACIAIRE Cours d’eau à débit irrégulier qui se trouve en dessous d’un glacier.
VALLÉE GLACIAIRE Vallée en forme de U qui a été occupée par un glacier ou formée par l’érosion glaciaire.
VERROU GLACIAIRE Rétrécissement accompagné d’un rehaussement du fond rocheux au sein d’une vallée glaciaire.
ZONE D’ABLATION Partie du glacier où la fonte est plus importante que l’accumulation.
ZONE D’ACCUMULATION (NÉVÉ) Partie du glacier où la neige, sous l’action de gels et dégels successifs, se durcit et se transforme en glace qui subsiste l’été.
Eau de fonte
Rimaye
Moraine latérale
Torrent sous-glaciaire
Moraine frontale
Crevasse
Zone
Glacier suspendu
Vallée glaciaire
Sérac
Verrou glaciaire
Front du glacier Lac proglaciaire
Lac supraglaciaire
Moraine de fond
Calotte glaciaire
Iceberg
Plateforme glaciaire
Glace de lac ou de rivière Banquise
Neige
Pergélisol
Eau de fonte
Mer
Inlandsis
Glacier
Cycle de l’eau
Le cycle de l’eau est en perpétuelle fluctuation : générée par l’évaporation, puis la condensation dans les nuages, l’eau parvient sur Terre sous forme de pluie, de neige ou de grêle, elle ruisselle en surface ou s’infiltre dans le sol avant de rejoindre les lacs, rivières et fleuves, qui à leur tour alimentent les mers et océans. Pourtant, l’eau douce liquide ne représente qu’une infime fraction de l’eau terrestre, soit seulement 0,6 %, dont l’essentiel est stocké dans des aquifères (nappes phréatiques). Seule une petite part circule dans les cours d’eau et les lacs, pourtant essentiels à l’équilibre des écosystèmes et au cycle de l’eau.

L’eau destinée à la consommation est parfois contaminée, la rendant impropre à l’usage. Chaque année, plus de deux millions de personnes décèdent de maladies liées à une eau insalubre, souvent polluée par l’absence de systèmes d’assainissement. À cela s’ajoutent d’autres sources de pollution, notamment les rejets industriels, les pesticides et les engrais, qui altèrent la qualité de l’eau en la chargeant de substances toxiques, métaux lourds et résidus chimiques.
Types de pollution
1 Pollution bactériologique
2 Pollution par les hydrocarbures
3 Pollution chimique
4 Pollution par le nitrate et le phosphate
D ÉLÉMENTS DE GÉOGRAPHIE HUMAINE
Aires urbaines
Modèle des zones
Espaces de la ville
Ville-centre
Banlieue
Pôle urbain Aire urbaine
Couronne périurbaine
Zone rurale
Mobilités
Routes principales
Déplacements pendulaires
Étalement urbain
Zones d’activités (industries)
Au fil du temps, les villes évoluent sous l’effet combiné de la croissance démographique, du développement économique et des progrès en matière de transport. En Europe et en Amérique du Nord, les villes étaient autrefois circonscrites et denses, conçues pour être parcourues à pied ou en voitures à chevaux. Mais à partir du 20e siècle, l’arrivée de nouveaux moyens de transport – tramways, métros, puis automobiles –a rendu les périphéries plus accessibles, amorçant l’expansion urbaine. C’est ainsi que les banlieues ont vu le jour, reliées au centre-ville par un réseau routier en pleine croissance. Dans la seconde moitié du 20e siècle, la construction massive d’autoroutes a amplifié ce phénomène, facilitant les déplacements vers les couronnes périurbaines et les villes satellites. Cette dispersion spatiale des activités – résidentielles, commerciales, industrielles et professionnelles – a mené à une fragmentation du tissu urbain, et, dans certains cas, au déclin démographique des centres-villes.
Utilisation du sol par activité
Quartier des affaires
Commerce de gros, industrie légère
Zone résidentielle (faible revenu)
Zone résidentielle (revenu moyen)
Zone résidentielle (revenu élevé)
Industrie lourde
Quartier des affaires périphérique
Banlieue
Parc industriel
AACCULTURATION Adoption par une personne ou un groupe de personnes d’éléments culturels provenant d’une autre culture, ayant pour effet la modification, voire l’effacement, de leur propre culture.
AGGLOMÉRATION Ensemble de bâtiments ou d’aires urbaines formé par un village, une ville et ses banlieues, où les activités économiques et sociales sont étroitement interconnectées.
AGRICULTURE BIOLOGIQUE Type d’agriculture favorisant la protection de l’environnement et de la biodiversité en excluant l’utilisation d’intrants chimiques ou industriels et d’organismes génétiquement modifiés (OGM).
AGRICULTURE DE SUBSISTANCE Type d’agriculture dont l’objectif est de satisfaire uniquement les besoins alimentaires des personnes qui le pratiquent.
AGRICULTURE EXTENSIVE Type d’agriculture à faible rendement dont l’objectif n’est pas d’optimiser la productivité alimentaire, et qui est pratiqué la plupart du temps sans machinerie.
AGRICULTURE INTENSIVE Type d’agriculture à haut rendement dont l’objectif est d’optimiser la productivité alimentaire grâce à la mécanisation, aux engrais et aux pesticides.
ALÉA Possibilité qu’un événement perturbant l’équilibre d’un environnement se produise, tel qu’une inondation ou un séisme. Ce phénomène, souvent imprévisible et échappant au contrôle humain, devient un facteur de risque lorsque des enjeux humains, économiques ou environnementaux sont en jeu.
AMÉNAGEMENT Planification, utilisation et modification d’un territoire par l’humain pour l’occuper, l’exploiter, le valoriser ou le préserver, et dont les résultats sont les villes, les réseaux routiers, les terres agricoles, etc.
ANTHROPISATION Processus par lequel les activités humaines modifient ou transforment l’environnement naturel, notamment par la déforestation, l’élevage, l’urbanisation et l’industrie.
ANTHROPOSPHÈRE Ensemble des éléments et systèmes, terrestres et spatiaux, modifiés par l’activité humaine, comme les villes, les infrastructures et l’agriculture. Elle inclut également les impacts humains sur les écosystèmes et les ressources naturelles.
ATMOSPHÈRE Couche de gaz qui entoure une étoile, un satellite ou une planète, comme la Terre. L’atmosphère terrestre fournit l’oxygène aux êtres vivants, protège des rayons UV du Soleil et maintient la chaleur nécessaire à la vie.
AUTOCHTONE Personne originaire d’un territoire où ses ancêtres vivaient déjà avant l’arrivée d’un peuple colonisateur. Au Canada, le gouvernement reconnaît trois groupes autochtones : les Premières Nations, les Inuits et les Métis.
AUTONOMIE Capacité à prendre des décisions et à agir de façon indépendante, en s’appuyant sur ses propres ressources et compétences. Par exemple, un pays est autonome sur le plan énergétique quand sa production d’énergie répond à ses besoins.
B
BANLIEUE Zone urbaine en périphérie d’une ville, généralement moins peuplée que le centre-ville, et dont les rôles peuvent être résidentiels, commerciaux ou industriels.
BANQUISE Étendue de glace formée par la congélation de l’eau de mer et qui se trouve reliée aux côtes ou flotte au gré des courants.
BASSIN VERSANT Zone géographique où toutes les eaux de pluie ou de ruissellement s’écoulent vers un même cours d’eau, lac ou océan.
BIDONVILLE Quartier informel dont les habitations précaires, construites de matériaux recyclés, souvent sans autorisation, n’ont ni eau courante ni égouts. Les conditions de vie y sont généralement précaires. 1
BIODIVERSITÉ Variété des formes de vie sur la planète, illustrant la diversité des écosystèmes, des gènes et des espèces animales, végétales, bactériennes, etc.
BIOMASSE Masse totale de la matière organique produite par les organismes vivants et qui devient une source d’énergie : bois de chauffage, déchets agricoles, excréments d’animaux, etc.
BIOME Zone écologique caractérisée par son climat particulier et les espèces animales et végétales qui s’y sont adaptées.
BIOSPHÈRE Ensemble des zones terrestres où la vie existe : lithosphère, atmosphère et hydrosphère. Elle regroupe tous les écosystèmes et les organismes vivants, allant des bactéries aux plantes et aux animaux.
CCANOPÉE (ou COUVERT FORESTIER) Ensemble des cimes des arbres qui forment ainsi une sorte de filtre au-dessus du sol.
CARTOGRAPHIE Science qui a pour but la représentation visuelle des informations géographiques relatives à des zones terrestres ou à l’Univers.
CATASTROPHE NATURELLE Événement d’origine naturelle, soudain et violent, qui entraîne des perturbations majeures et des dégâts potentiellement considérables, tant matériels qu’humains. Elle peut se manifester sous diverses formes : séisme, éruption volcanique, tsunami, feu de forêt, inondation, ouragan, avalanche, etc.
CENTRALE THERMIQUE Installation qui produit de l’électricité en brûlant des combustibles fossiles (charbon, gaz naturel, pétrole) ou de la biomasse (matières organiques).
CERCLE POLAIRE Un des cinq principaux parallèles tracés sur les cartes de la Terre. Il en existe deux : le cercle polaire arctique, au nord, et le cercle polaire antarctique, au sud, qui délimitent les régions proches des pôles.
CHANGEMENT CLIMATIQUE Variations à long terme de la température et des tendances météorologiques (précipitations, extrêmes, etc.) causées par des processus internes (naturels ou anthropiques) ou externes. Depuis le 19e siècle, les activités humaines constituent la cause principale des changements climatiques, surtout en raison de la l’utilisation de combustibles fossiles.
CLIMAT Ensemble des conditions météorologiques moyennes quotidiennes et saisonnières d’une région, observées sur une période d’au moins 30 ans.
COMBUSTIBLE FOSSILE Source d’énergie non renouvelable provenant de matières organiques anciennes (charbon, gaz naturel, pétrole) qui produisent de l’énergie en brûlant.
CONSERVATION Action visant à protéger et à préserver les ressources naturelles, la biodiversité et les écosystèmes pour en assurer la prospérité.
CONSTRUCTION PARASISMIQUE Structure ou bâtiment conçu pour résister aux tremblements de terre. 2
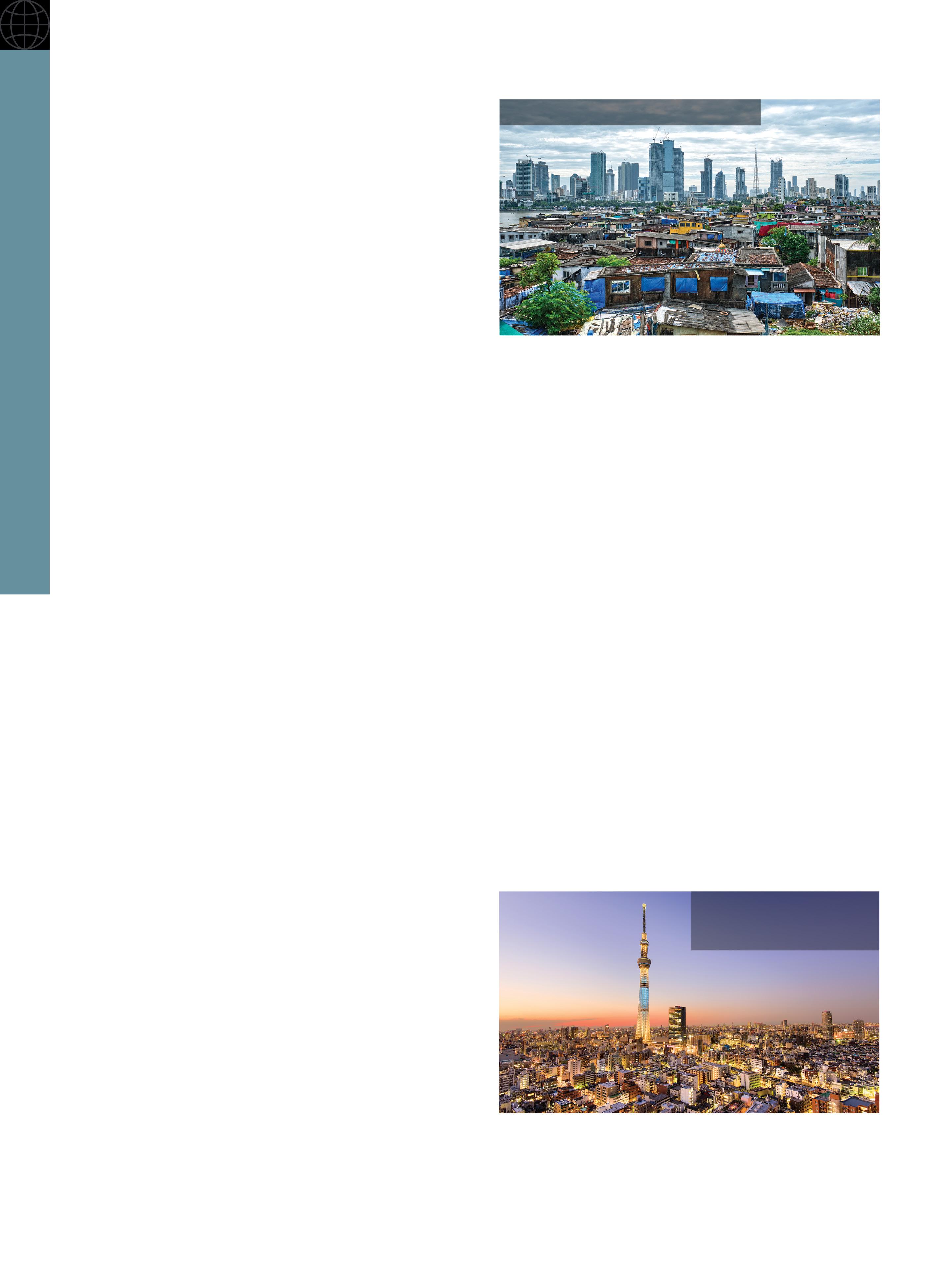
COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES Système de repérage qui permet de situer un endroit sur la surface de la Terre à l’aide de deux valeurs : la latitude (Nord-Sud) et la longitude (Est-Ouest). Elles sont exprimées en degrés et permettent de définir précisément n’importe quel point sur le globe.
CRUE Augmentation rapide et importante du niveau d’un cours d’eau en raison de la pluie ou de la fonte des neiges, pouvant causer des inondations si l’eau déborde de son lit.
2 La tour Tokyo Skytree, 2e plus grande tour au monde mesurant 634 mètres, a résisté en 2011 à un séisme de magnitude 9,1 (Mw).
1 Le bidonville de Bandra, en banlieue de Mumbai, Inde.
CULTURE Ensemble des connaissances, valeurs, traditions, croyances et pratiques artistiques propres à un groupe de personnes ou à une société et qui façonnent leur identité.
CYCLONE Tempête intense qui se forme généralement au-dessus des océans chauds et se déplace vers les côtes sous la forme de vents violents en rotation autour d’un centre de basse pression de faible étendue (l’œil du cyclone). On en mesure l’intensité à l’aide de l’échelle Saffir-Simpson, en fonction de la vitesse des vents et des dégâts potentiels. Le terme est utilisé pour l’océan Indien et le sud de l’océan Pacifique.
D
DÉCHET ORGANIQUE Résidu provenant de matières biologiques : déchets alimentaires ou du jardin, fumier, etc.
DÉFORESTATION Activité humaine qui consiste à réduire de façon importante la surface forestière pour des raisons économiques. 3
ÉMIGRATION Départ d’une personne ou d’un groupe de personnes de leur pays pour s’installer durablement dans un autre pays.
ENDÉMIQUE Espèce ou caractéristique propre à une région précise.
ÉQUATEUR Ligne imaginaire qui divise la Terre en deux hémisphères : Nord et Sud. Elle représente le degré de latitude 0, soit celui où la distance jusqu’au pôle Nord est égale à celle jusqu’au pôle Sud. 4
4 Le monument Mitad del Mundo (le milieu du Monde) est situé à San Antonio de Pichincha, en Équateur, et signale la ligne de partage entre l'hémisphère Nord et l'hémisphère Sud.
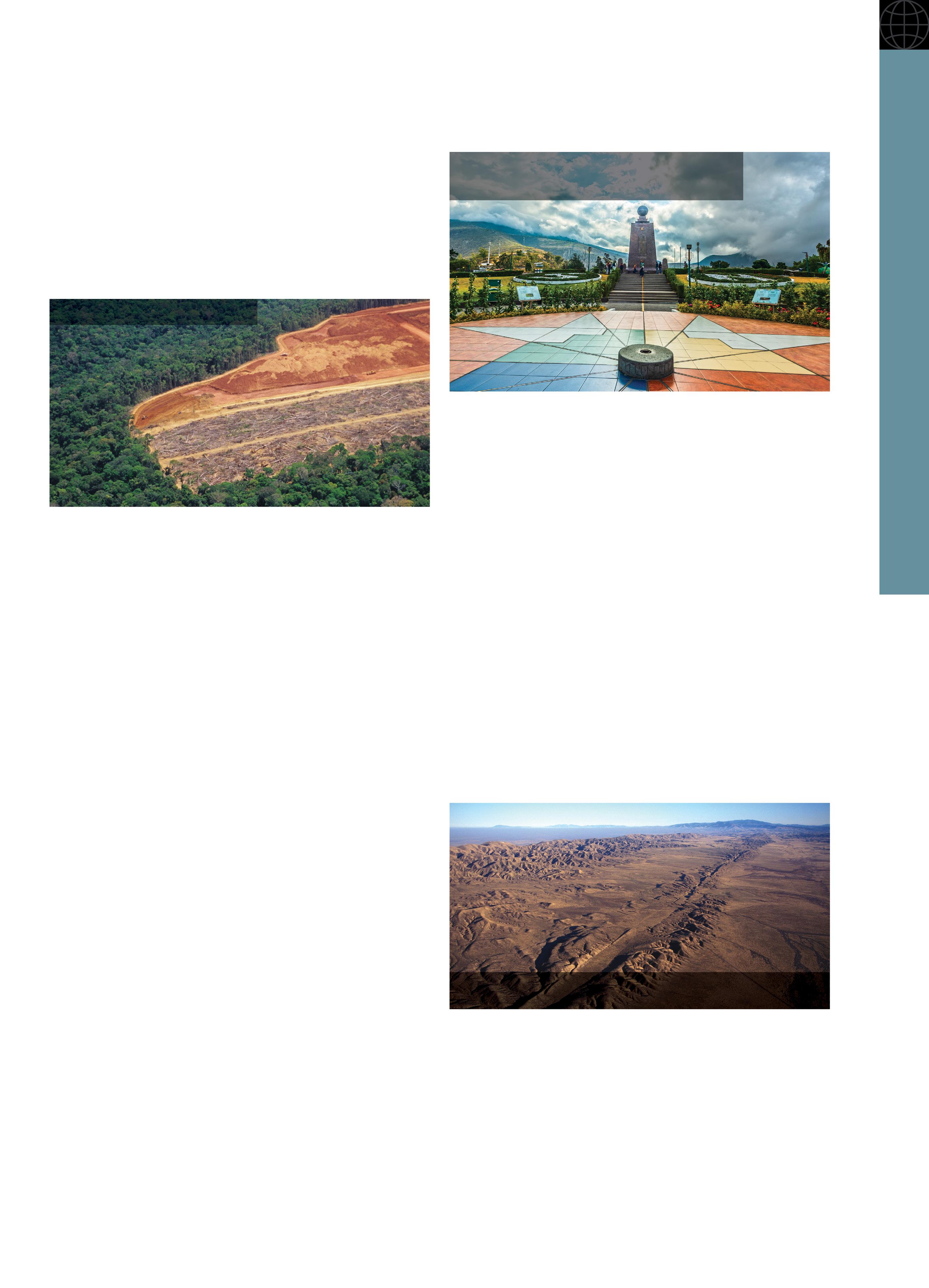
DÉLOCALISATION Processus par lequel une entreprise transfère sa production en entier ou en partie dans un autre pays pour en réduire les coûts.
DÉMOGRAPHIE Étude quantitative des populations humaines et de leurs dynamiques, à partir de leurs composantes : fécondité, statut matrimonial, migration, vieillissement et mortalité.
DENSITÉ Nombre d’habitants par kilomètre carré (km2). Le calcul se fait de la façon suivante : nombre d’habitants ÷ superficie (km2) = nombre d’habitants par km2
DÉSERTIFICATION Dégradation des sols, qui perdent leur fertilité et s’assèchent, surtout en raison de l’activité humaine et des changements climatiques.
DÉVELOPPEMENT Ensemble des processus économiques, sociaux et environnementaux visant à améliorer le bien-être et la qualité de vie des populations.
DÉVELOPPEMENT DURABLE Développement qui vise la satisfaction des besoins actuels sans nuire à celle des besoins futurs. Il doit donc se faire dans le respect de l’environnement, des gens et de l’économie.
DIASPORA Ensemble des personnes partageant une origine culturelle et régionale, mais vivant en dehors des frontières de leur patrie traditionnelle, souvent après en avoir été chassées. Elle désigne aussi la communauté issue de cette migration, souvent marquée par des liens culturels, sociaux et économiques entre ses membres.
DORSALE Très long relief océanique formé par l’éloignement de deux plaques tectoniques, laissant ainsi le magma s’échapper et former une chaîne de montagnes sous-marines.
DROIT ANCESTRAL Droit reconnu aux peuples autochtones et aux communautés locales. Il a pour base la tradition, l’histoire et le lien profond avec le territoire ou les ressources naturelles, transmis d’une génération à l’autre.
EEAUX USÉES Eaux qui résultent des activités humaines en contexte domestique (toilette, douche, laveuse, etc.) ou industriel (usines) et qui sont ensuite rejetées dans les égouts ou les fosses septiques.
ÉCOSYSTÈME Ensemble d’organismes vivants qui interagissent entre eux et avec leur environnement (eau, sol, air). Il fonctionne comme un système équilibré où chaque élément joue un rôle pour garder l’ensemble en vie.
ÉCOUMÈNE Ensemble des lieux habités ou exploités par les êtres humains sur la planète.
EFFET DE SERRE Phénomène qui se produit lorsque les rayons du Soleil entrant dans l’atmosphère de la Terre demeurent piégés par certains gaz qui empêchent la chaleur de s’échapper. Cela entraîne un réchauffement de l’atmosphère, et donc de la planète. Depuis le début de la révolution industrielle, le rejet de quantités importantes de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère a amplifié l’effet de serre.
ÉROSION Processus de dégradation des sols et des roches par des agents naturels (eau, vent, glace) ou l’action humaine, et qui déplace les particules de matière d’un lieu à un autre.
ÉRUPTION VOLCANIQUE Voir VOLCANISME
ESPÈCE INDIGÈNE Plante, animal ou micro-organisme qui vit naturellement dans un environnement donné, où son évolution et son adaptation se sont faites sans intervention humaine.
ESPÈCE INVASIVE Plante, animal ou micro-organisme non indigène introduit dans un nouvel habitat et qui se propage rapidement, causant des problèmes environnementaux, sanitaires ou économiques.
ESPÈCE MENACÉE Plante ou animal dont la population a tant diminué qu’elle risque de disparaître dans un avenir proche.
ÉTALEMENT URBAIN Extension progressive des zones urbaines sur les zones rurales environnantes.
EXODE RURAL Départ massif de populations rurales vers les zones urbaines, motivé par la recherche de travail ou de meilleures conditions de vie.
EXPORTATION Action de vendre des biens produits dans un pays à un autre pays et de les y transporter.
FFAILLE Fracture dans la croûte terrestre le long de laquelle deux blocs de roche se déplacent l’un par rapport à l’autre. 5
5 La faille de San Andreas, en Californie, est longue de 1 300 km et marque la zone de rencontre de deux plaques tectoniques : nord-américaine et du Pacifique.
FLUX TOURISTIQUE Déplacement d’un grand nombre de touristes d’un lieu à un autre.
FOSSE OCÉANIQUE Dépression profonde et allongée dans le fond des océans, formée par la subduction d’une plaque lithosphérique océanique sous une autre. Ces fosses sont les points les plus profonds des océans et peuvent atteindre des milliers de mètres de profondeur.
FOYER DE POPULATION Zone géographique de forte densité humaine, souvent caractérisée par des centres urbains et une forte concentration de personnes.
FOYER TOURISTIQUE Zone géographique qui attire un très grand nombre de visiteurs grâce à ses attractions et qui est aménagée pour les accueillir aisément.
FRONTIÈRE INTERNATIONALE Limite territoriale qui sépare deux pays et fixée par traité entre ces deux États.
3 Déforestation dans la forêt amazonienne.
FRONTIÈRE NATIONALE Limite territoriale qui divise des zones à l’intérieur d’un pays.
FUSEAU HORAIRE Zone géographique où l’heure officielle est la même, et qui est définie en fonction de sa position par rapport au méridien de Greenwich (méridien d’origine). La Terre étant divisée en 24 fuseaux, chaque zone correspond à un décalage horaire d’une heure par rapport à la suivante.
G
GAZODUC Tuyau utilisé pour transporter du gaz naturel sur de longues distances, soit du lieu de production jusqu’aux lieux de distribution.
GÉOGRAPHIE Science qui étudie l’aspect de la surface de la Terre, mais aussi les rapports des sociétés humaines avec les espaces qu’elles y occupent.
GÉOLOGIE Science qui étudie la structure, la composition et l’évolution de la Terre.
GLISSEMENT DE TERRAIN Mouvement de masse du sol et de roches se déplaçant le long d’une pente et qui peut entraîner des coulées de boue, de terre, de roches et de débris.
H
HECTARE (ha) Unité de mesure équivalant à 10 000 m2
HÉMISPHÈRE Chacune des deux moitiés de la Terre, divisées soit par l’équateur (hémisphère Nord et hémisphère Sud), soit par le méridien de Greenwich (hémisphère Est et hémisphère Ouest).
HEURE LÉGALE Heure officielle adoptée par un pays ou une région, généralement selon le fuseau horaire où ils se trouvent.
HEURE SOLAIRE Heure basée sur la position du Soleil dans le ciel, et mesurée à partir du midi solaire, c’est-à-dire le moment où le Soleil atteint le point le plus haut dans le ciel.
HYDROCARBURE Composé chimique constitué d’hydrogène et de carbone et utilisé comme source d’énergie. Le gaz naturel est un hydrocarbure et le pétrole contient des hydrocarbures.
HYDROÉLECTRICITÉ Électricité produite à partir de la force de l’eau en mouvement. Il s’agit d’une forme d’énergie renouvelable. 6
6 Le barrage Daniel-Johnson, le plus grand barrage à voûtes et contreforts du monde, est essentiel aux centrales Manic-5 et Manic-5-PA qui fournissent de l’hydroélectricité aux Québécois depuis 1970.
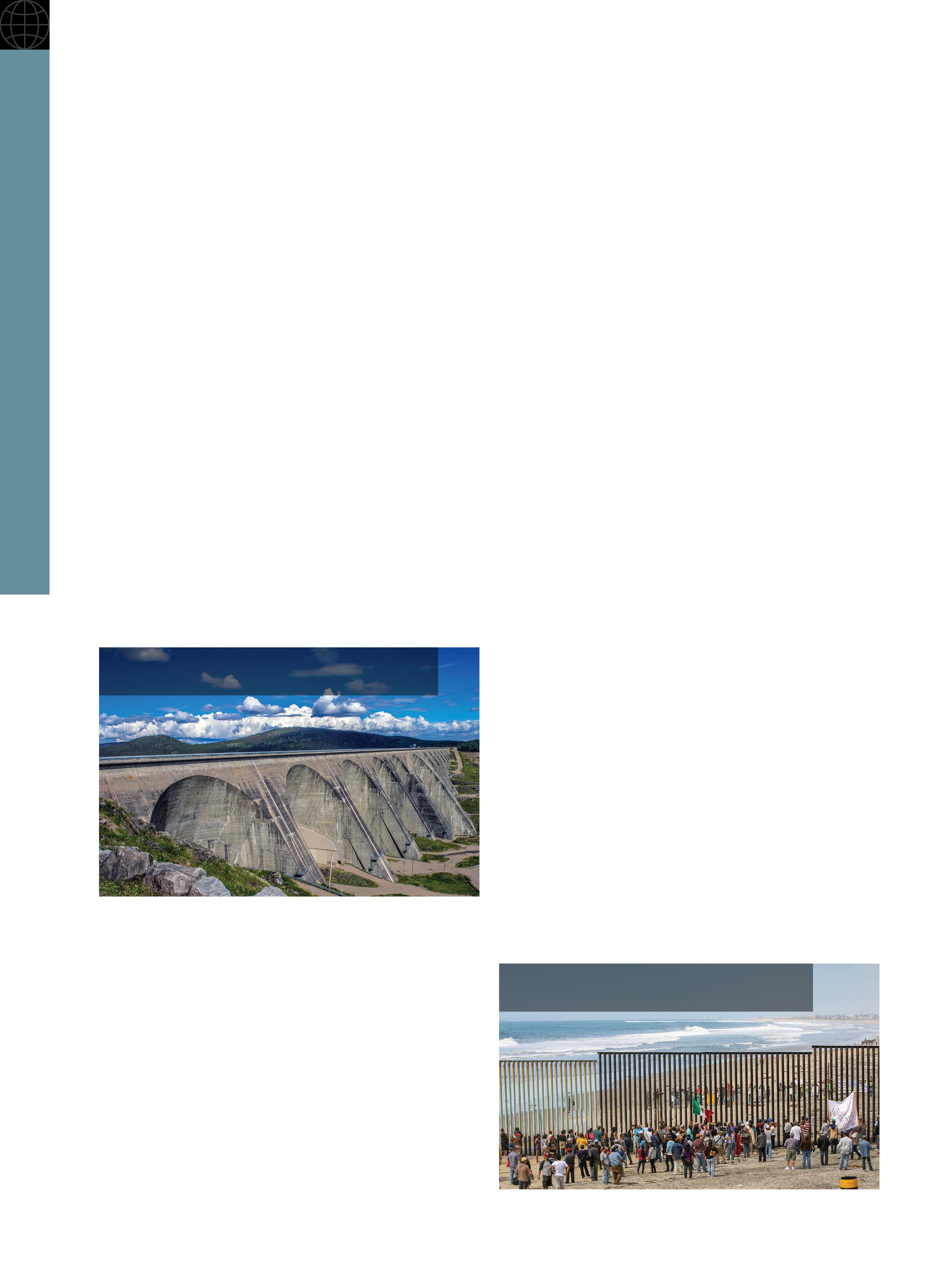
HYDROGRAPHIE Étude des eaux de surface (rivière, lac, océan, etc.) et souterraines (nappe phréatique) et de leur interaction avec l’environnement. Désigne aussi l’ensemble des cours d’eau d’une région donnée, organisés en bassins hydrographiques.
HYDRONYME Nom propre donné à une étendue d’eau (lac, mer, océan) ou à un cours d’eau (fleuve, rivière, etc.).
HYDROSPHÈRE Ensemble de l’eau présente sur Terre, sous toutes ses formes : liquide (océans, lacs, rivières), solide (glace, neige) et gazeuse (vapeur d’eau dans l’atmosphère). Elle couvre environ 71 % de la surface de la planète.
INFRASTRUCTURE Ensemble des installations et des services essentiels (routes, ponts, égouts, réseaux d’eau et d’électricité, etc.) qui soutiennent le fonctionnement d’une société ou d’une économie.
INLANDSIS Vaste calotte glaciaire recouvrant une surface terrestre et dont les dimensions dépassent 50 000 km2, comme dans l’archipel Arctique au Canada ou en Antarctique.
INONDATION Débordement d’un cours d’eau ou montée des eaux qui saturent rapidement le sol et pénètrent dans les bâtiments. Elle peut être causée par des pluies abondantes, la fonte rapide des neiges, un sol devenu imperméable (asphalte, béton), etc.
K
KILOWATTHEURE (kWh) Unité de mesure permettant d’exprimer l’énergie consommée en une heure. Un kilowattheure (kWh) correspond à 1 000 wattheures.
L
LATITUDE Position d’un point sur la surface de la Terre par rapport à l’équateur (parallèle 0°), exprimée en degrés nord ou sud.
LITHOSPHÈRE Couche externe solide de la Terre, c’est-à-dire la croûte terrestre et la partie supérieure du manteau de la planète. Elle comprend les continents, mais aussi les plaques lithosphériques des océans.
LONGITUDE Position d’un point sur la surface de la Terre par rapport au méridien de Greenwich (méridien 0°), exprimée en degrés est ou ouest.
M
MAGNITUDE Force d’un tremblement de terre. Elle est mesurée à l’aide de l’échelle de moment (Mw), qui évalue l’énergie libérée lors de la rupture d’une faille en tenant compte de la taille de la zone de rupture et du déplacement des roches.
MARÉE Mouvement quotidien de montée et de descente du niveau des eaux causé par l’effet des forces gravitationnelles de la Lune et du Soleil.
MATIÈRE PREMIÈRE Substance d’origine naturelle qui doit être transformée afin d’être utilisée dans la fabrication d’un produit.
MÉGALOPOLE Zone urbaine immense regroupant plusieurs agglomérations d’envergure aux économies interreliées et formant un pôle démographique, économique et politique très important. Elle possède une aire d’influence d’ampleur internationale, voire mondiale. Un exemple nord-américain est le BosWash, cette vaste étendue urbaine s’étendant de Boston à Washington D.C.
MÉGAPOLE Très grande ville qui dépasse 10 millions d’habitants et qui a une influence économique, sociale et culturelle importante, comme New York, Tokyo et Mexico.
MÉRIDIEN Ligne imaginaire qui relie les deux pôles et qui fait le tour de la Terre. Il sert à déterminer la longitude d’un lieu.
MÉRIDIEN DE GREENWICH Méridien qui divise la Terre en deux hémisphères : Est et Ouest. Il représente le degré de longitude 0. On l’appelle aussi « méridien d’origine » ou « méridien zéro ».
MÉTROPOLE Grande ville jouant un rôle central dans un pays ou une région par la taille de sa population ou son influence économique, politique et culturelle.
MIGRATION Tout mouvement de personnes quittant leur lieu de résidence habituelle, soit à l’intérieur d’un même pays, soit par-delà une frontière internationale pour des raisons économiques, politiques, environnementales, etc. 7
7 La barrière entre les États-Unis et le Mexique se termine à l’ouest à Playas de Tijuana, au nord du Mexique. Elle a été aménagée pour contrôler le flux de migration des Mexicains vers les États-Unis.
IICEBERG Bloc de glace détaché d’une banquise ou d’un glacier et qui flotte sur l’eau. Sa partie immergée est plus importante que sa partie visible.
IMMIGRATION Arrivée d’une personne ou d’un groupe de personnes dans un nouveau pays pour s’y installer durablement.
IMPORTATION Achat de biens ou de services produits dans un autre pays.
INDUSTRIALISATION Transformation d’une économie basée sur l’agriculture et l’artisanat en une économie basée sur la production industrielle, entraînant l’utilisation de machines et l’urbanisation.
MILIEU À RISQUE Zone ou environnement soumis à des événements dangereux qui menacent une population : inondations, séismes, accidents industriels, etc.
MONDIALISATION Processus en croissance des échanges économiques et culturels à l’échelle mondiale, propulsé par les progrès sur les plans de la technologie, des communications et des transports.
MOUSSON Changement saisonnier des vents dans les régions tropicales qui cause de fortes précipitations (pluie) pendant l’été et des conditions sèches pendant l’hiver.
MULTIETHNICITÉ Présence de personnes de différentes origines sur un même territoire.
MULTINATIONALE Grande entreprise qui exerce des activités commerciales, de production ou de services dans plusieurs pays.
N
NAPPE PHRÉATIQUE Couche d’eau sous la surface terrestre accumulée dans les pores et les fissures des roches et des sédiments.
NATION Groupe de personnes ayant une histoire et une culture communes et vivant sur un territoire qu’elles administrent.
NIVEAU DE DÉVELOPPEMENT Échelle qui sert à mesurer le progrès économique, social et technologique d’un pays ou d’une région et qui tient compte de l’éducation, de la santé et de la richesse de leur population.
NIVEAU DE VIE Quantité et qualité des biens et des services qu’une personne ou un groupe de personnes peuvent acquérir ou dont elles peuvent disposer.
NORD GÉOGRAPHIQUE Aussi appelé « pôle Nord ». Endroit où l’axe de rotation terrestre croise la surface de la Terre. Point fixe utilisé pour la navigation et la cartographie, il est situé au milieu de l’océan Arctique, à plus de 720 km au nord de l’île d’Ellesmere (Nunavut).
NORD MAGNÉTIQUE Point vers lequel les aiguilles des boussoles s’orientent, situé près du pôle Nord magnétique, qui se déplace lentement au fil du temps. Contrairement au nord géographique, qui est fixe, le nord magnétique varie en fonction de la position des pôles magnétiques de la Terre.
NORDICITÉ Caractéristiques du mode de vie des habitants des régions du Nord, adapté à des conditions particulières liées au froid et à la saisonnalité. 8
8 Le transport en traîneaux à chiens est une adaptation aux conditions climatiques nordiques de Spitzbergen, une île au nord de la Norvège, dans l’océan Arctique.
OOLÉODUC Grand tuyau (pipeline) servant au transport du pétrole brut sur de longues distances.
OURAGAN Voir CYCLONE. Le terme est utilisé pour le nord de l’océan Atlantique et le nord-est de l’océan Pacifique (Amérique du Nord, Europe).
PPARALLÈLE Ligne imaginaire parallèle à l’équateur qui fait le tour de la Terre. Il sert à déterminer la latitude d’un lieu.
PARC NATIONAL Zone protégée par un gouvernement en vue de la préservation de son écosystème, de ses paysages, de sa faune ou de sa flore, tout en permettant sa fréquentation par le public.
PATRIMOINE Ensemble des biens, traditions et valeurs du passé transmis d’une génération à l’autre.
PATRIMOINE CULTUREL Ensemble des biens matériels et immatériels d’une société, tels que des œuvres d’art, la langue, les monuments et la littérature, et qui en forment l’héritage. 9
PATRIMOINE NATUREL Ensemble des ressources et espaces naturels dont on reconnaît l’importance sur le plan de la biodiversité et de l’environnement, et qui peuvent être des écosystèmes, des paysages, des espèces vivantes, etc.
PAYS ATELIERS Pays qui produisent des biens manufacturés à bon marché pour le compte des pays plus développés.
9 Al-Khazneh (Trésor) fait partie du site archéologique de Pétra, en Jordanie, dont les édifices ont été désignés par l'UNESCO comme appartenant au patrimoine mondial.

PAYS DÉVELOPPÉS Pays dont l’économie est avancée et où la population a un niveau de vie élevé. Leurs infrastructures sont efficaces, et leurs systèmes de santé et d’éducation sont performants.
PAYS ÉMERGENTS Pays qui ont connu une forte croissance économique au cours des dernières décennies, ainsi qu’une industrialisation accrue, une meilleure intégration dans l’économie mondiale et une amélioration de leurs infrastructures et de leur niveau de vie. La Chine, le Brésil et le Mexique sont des exemples typiques de pays émergents. Ils sont encore en transition, mais leur développement économique les place dans une position intermédiaire entre les pays développés et les pays en développement.
PAYS EN DÉVELOPPEMENT Pays où la population a un niveau de vie relativement bas et dont l’économie repose sur une dépendance à l’agriculture, une industrialisation limitée et des infrastructures moins développées. Ils font généralement face à des défis importants sur le plan de la précarité, de la santé et de l’éducation.
PAYS LES MOINS AVANCÉS (PMA) Terme utilisé par l’ONU pour désigner les pays présentant des niveaux de développement économique et humain très faibles (pauvreté extrême, infrastructure limitée, accès limité aux services de santé et d’éducation).
PERGÉLISOL Sol des régions polaires ou alpines qui demeure gelé pendant au moins deux années de suite.
PHÉNOMÈNE NATUREL Événement se produisant dans la nature et ne résultant pas d’une intervention humaine : tremblement de terre, tsunami, aurore boréale, etc.
PLAQUE TECTONIQUE (ou PLAQUE LITHOSPHÉRIQUE) Morceau de la lithosphère qui se déplace lentement et interagit avec d’autres plaques, en s’écartant, se frottant ou se heurtant, provoquant ainsi des séismes, des éruptions volcaniques et la formation de montagnes.
POINT CHAUD Zone fixe de la croûte terrestre où le magma remonte du manteau profond, causant une activité volcanique qu’on appelle « volcanisme intraplaque ».
POINTS CARDINAUX Points de repère qui permettent de se situer dans l’espace (Nord, Sud, Est, Ouest). Ils servent entre autres à déterminer une position sur une carte.
POPULATION ACTIVE Ensemble des personnes en âge de travailler (de 15 à 64 ans) et qui sont disponibles sur le marché du travail, soit en étant déjà à l’emploi ou en cherchant un emploi.
PRODUIT INTÉRIEUR BRUT (PIB) Estimation de la richesse d’un pays basée sur la valeur des biens et des services produits dans ce pays en une année.
RRÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE Augmentation à long terme des températures moyennes de la Terre, amplifiée depuis le début de l’ère industrielle par des intrants anthropiques (émission de gaz à effet de serre). Le réchauffement climatique est un indicateur des changements climatiques.
RÉFUGIÉ Personne qui a fui son pays pour échapper à un conflit armé, à la violence, à une catastrophe ou à une persécution liée à son ethnie, à sa religion, à sa nationalité ou à ses opinions politiques, et qui cherche refuge, soit sécurité et protection, dans un autre pays.
RÉSERVE Au Canada, territoire réservé aux Premières Nations et géré de façon autonome par celles-ci, où les résidents conservent des droits particuliers. Les Métis et les Inuits ne gèrent pas de réserves au Canada.
RÉSILIENCE Capacité d’un territoire ou d’une population à se remettre d’une perturbation, comme une catastrophe naturelle ou une crise économique. Elle suppose l’adaptation et la récupération permettant de restaurer l’équilibre et de minimiser les impacts à long terme.
RESSOURCE NATURELLE Élément qui se trouve dans la nature (eau, terres fertiles, minéraux, forêts) et que les êtres humains exploitent pour répondre à leurs besoins ou pour le vendre à leur profit.
RESSOURCE NON RENOUVELABLE Élément naturel exploité par les êtres humains et dont la capacité de régénération est nulle ou trop faible, ce qui fait qu’une fois exploité, rien ne le remplace : combustibles fossiles (charbon, gaz et pétrole), minéraux, énergie nucléaire, etc.
RESSOURCE RENOUVELABLE Élément naturel exploité par les êtres humains et qui a la capacité de se régénérer naturellement assez rapidement pour que son exploitation puisse se faire à long terme : vent, Soleil, force de l’eau, arbres, etc.
REVENU NATIONAL BRUT Somme de tous les revenus (salaires, bénéfices, loyers, intérêts, etc.) des habitants d’un pays durant une période donnée.
RIFT Région où la croûte terrestre s’étire lorsque deux plaques tectoniques s’éloignent l’une de l’autre, formant ainsi un fossé (rift en anglais) où l’activité volcanique peut être importante. Le rift peut être continental ou océanique. 10
10 Le Grand Rift parcourt l'est de l'Afrique du nord au sud. Dans sa partie au nord, il creuse une vallée profonde en Éthiopie.
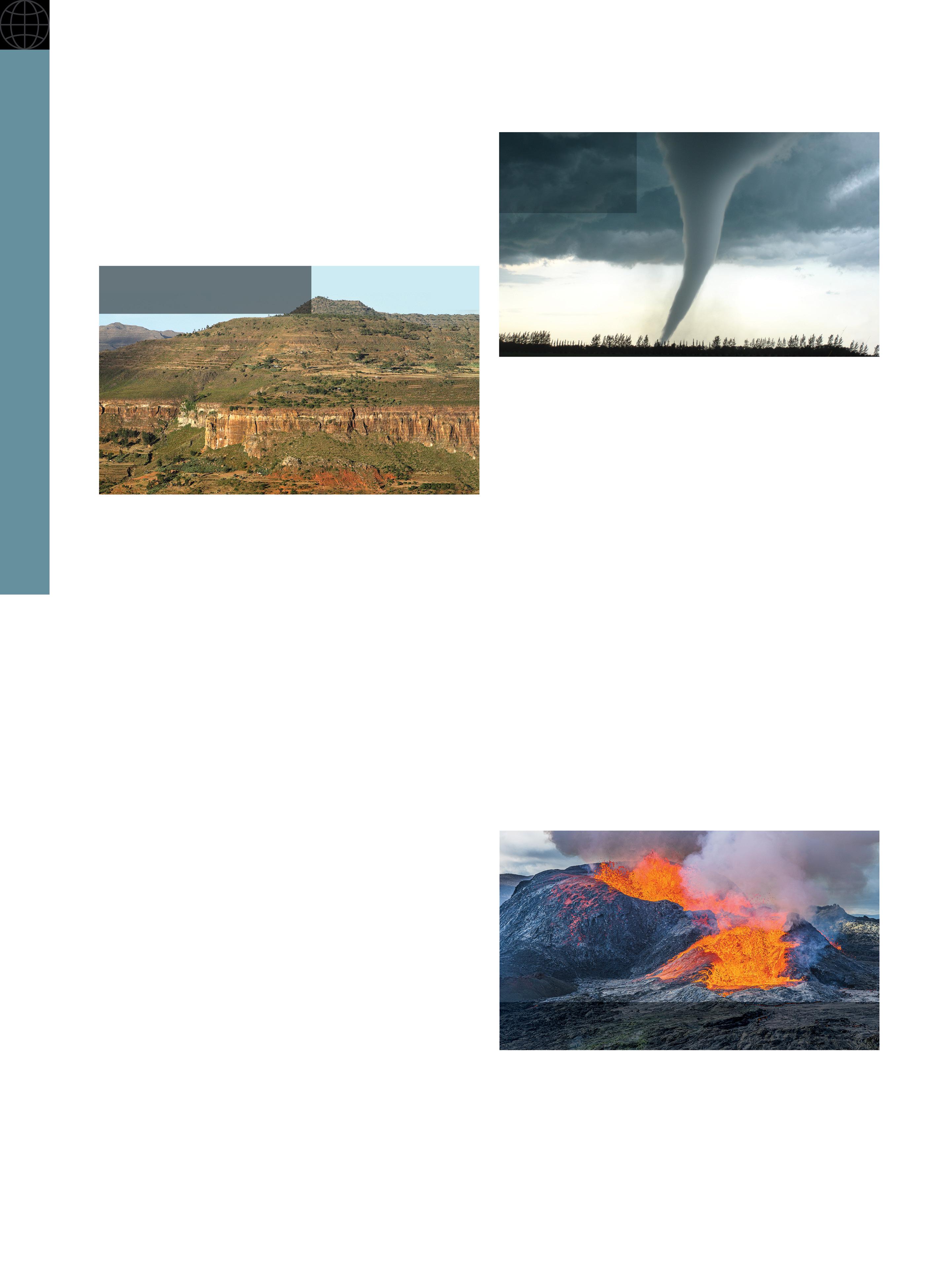
RISQUE ARTIFICIEL Probabilité qu’un phénomène dû à l’activité humaine et potentiellement dangereux pour une région ou une population se produise : explosion ou déversement de produits chimiques, surutilisation de pesticides ou d’antibiotiques, etc.
RISQUE NATUREL Probabilité qu’un phénomène naturel et potentiellement dangereux pour une région ou une population se produise : inondation, ouragan, séisme, etc.
RURALITÉ Caractéristiques du mode de vie des habitants de la campagne (un espace à faible densité de population), dont les activités sont liées à la nature, aux paysages et à l’agriculture.
S
SÉCHERESSE Insuffisance ou absence de précipitations pendant une période assez prolongée pour qu’il y ait des impacts environnementaux. Ce phénomène dépend des conditions locales : climat, températures, utilisation de l’eau par les êtres humains, etc.
SÉISME Secousse brusque de la croûte terrestre causée par le déplacement soudain des plaques tectoniques.
SMOG Mélange de brouillard et de pollution atmosphérique dont les particules fines sont néfastes pour la santé et l’environnement. Le terme est un mot-valise composé des mots anglais smoke (fumée) et fog (brouillard).
SOLDE DÉMOGRAPHIQUE Somme du solde naturel et du solde migratoire dans une population au cours d’une période donnée.
SOLDE MIGRATOIRE Différence entre le nombre d’immigrants (personnes entrant dans un pays) et le nombre d’émigrants (personnes quittant un pays) au cours d’une période donnée.
SOLDE NATUREL Différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès dans une population au cours d’une période donnée.
SOURCE D’ÉNERGIE Élément naturel ou procédé permettant de produire l’énergie nécessaire aux activités humaines : pétrole, Soleil, eau, vent, etc.
SYLVICULTURE Pratique visant la culture et l’exploitation de la ressource naturelle que sont les arbres et les forêts : conservation, reboisement, plan des coupes, etc.
TTAUX D’ALPHABÉTISME Aussi appelé « taux d’alphabétisation ». Proportion de la population de 15 ans et plus qui sait lire, écrire et comprendre un texte simple et court sur la vie quotidienne.
TAUX DE SCOLARISATION Proportion de jeunes d’un âge donné qui sont inscrits dans une école par rapport à l’ensemble de la population du même âge.
TERRITOIRE Zone géographique délimitée que des personnes occupent et gèrent pour y vivre et organiser leurs activités.
TOPONYME Nom propre donné à un élément géographique (ville, pays, chaîne de montagnes, etc.).
TORNADE Tourbillon de vents violents qui se forme entre la base d’un nuage et le sol. On en mesure l’intensité en fonction de la vitesse des vents et des dégâts qu’ils causent à l’aide de l’échelle Fujita. 11
TOURISME Ensemble des activités et des déplacements effectués par des personnes qui vont de façon temporaire dans des lieux pour y jouir du repos, de la découverte ou de loisirs.
TREMBLEMENT DE TERRE Voir SÉISME
TROPIQUE Parallèle situé à une latitude spécifique sur la Terre, marquant la limite où le Soleil peut atteindre sa position verticale. Il existe deux tropiques : le tropique du Cancer, situé à 23,5° au nord de l’équateur, et le tropique du Capricorne, situé à 23,5° au sud de l’équateur.
TSUNAMI Série d’immenses vagues océaniques provoquées par un événement géologique donné, comme un séisme sous-marin, et qui peuvent être dévastatrices lorsqu’elles frappent les côtes.
TYPHON Voir CYCLONE. Le terme est utilisé pour le nord-ouest de l’océan Pacifique (Asie, Asie du Sud-Est).
U
URBANISATION Processus de croissance d’une ville sur les plans de sa population, de ses infrastructures et de la zone qu’elle occupe, entraînant le développement de ses activités et services.
V
VÉGÉTATION Ensemble des végétaux et des plantes qui poussent naturellement dans un lieu. Elle varie d’un espace à un autre en fonction du climat, du relief et des types de sols.
VOLCANISME Ensemble des phénomènes géologiques se rapportant à l’activité des volcans et aux processus liés à leur formation : séisme, éruption de magma, pression de gaz, etc. 12
Volcan en éruption sur la péninsule de Reykjanes, en Islande, où l'on peut observer le magma en fusion et les gaz s’échappant du cratère. Le volcanisme de cette région permet l’utilisation d’une centrale géothermale d’électricité.
VULNÉRABILITÉ Susceptibilité d’une population ou d’un territoire à subir des impacts négatifs face à des risques ou des perturbations, comme des catastrophes naturelles, des crises économiques ou des conflits.
Z
ZONAGE Aménagement d’un territoire en différentes zones destinées à des activités précises : habitation, industrie, usage public, etc.
ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE (ZEE) Zone marine où un pays a des droits exclusifs pour exploiter les ressources naturelles, comme les poissons ou les minéraux. Elle s’étend jusqu’à 370 km des côtes, mais ne donne pas de contrôle sur la mer elle-même.
11 Tornade destructrice à Elie, au Manitoba, dont l’entonnoir a provoqué des vents de catégorie 5 sur l’échelle de Fujita, soit de 420 à 510 km/h.
12
MONDE
Monde physique 20
Monde politique 22
Population 24
Tectonique et géologie 26
Climat 30
Biomes 35
Environnement 36
Ressources naturelles 44
Mines et énergie 46
Urbanisation 48
Population 50
Conditions de vie 56
Économie 59
Tourisme 62
Politique 63
STATISTIQUES
Superficie de la surface de la Terre :
Superficie des terres émergées :
Superficie des mers et des océans :
Population : 8 200 000 000 habitants
Pays le plus grand : Russie (17 075 400 km2)
Fleuve le plus long : Nil (6 671 km)
Sommet le plus haut : mont Everest (8 848 m)

Coraux, mer du Japon.
Île de Svalbard, mer du Groenland.
Jatilwih, île de Bali, Indonésie.
Dubaï, Émirats arabes unis.
Région masaï, sud du Kenya.

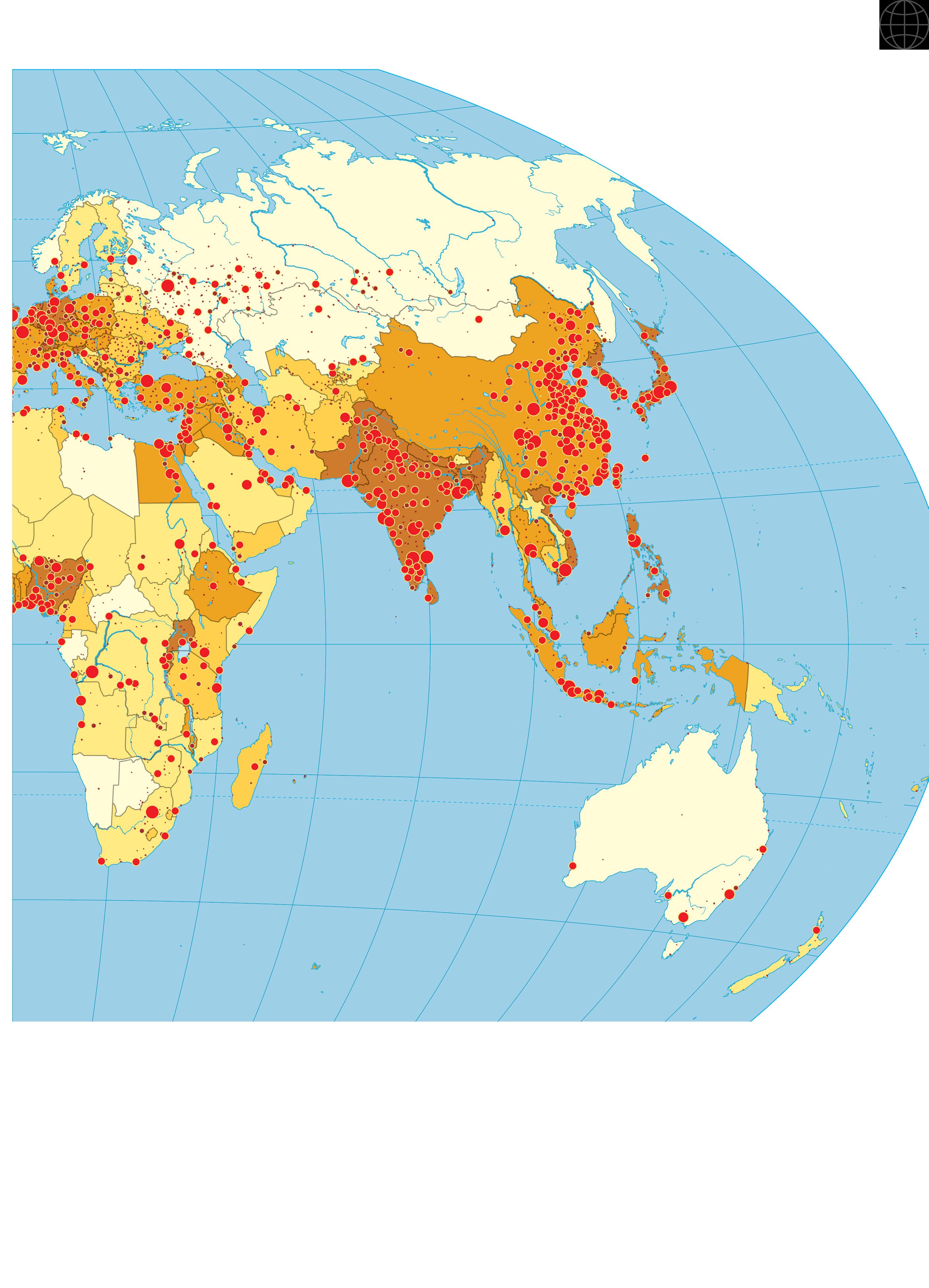
Cour a n t du Groe n l a nd oc c i d e n lat latneirote
éD ir v e n droeuqitnalta regnimrIdtnaruoC
Courant d u L a b r ad o r
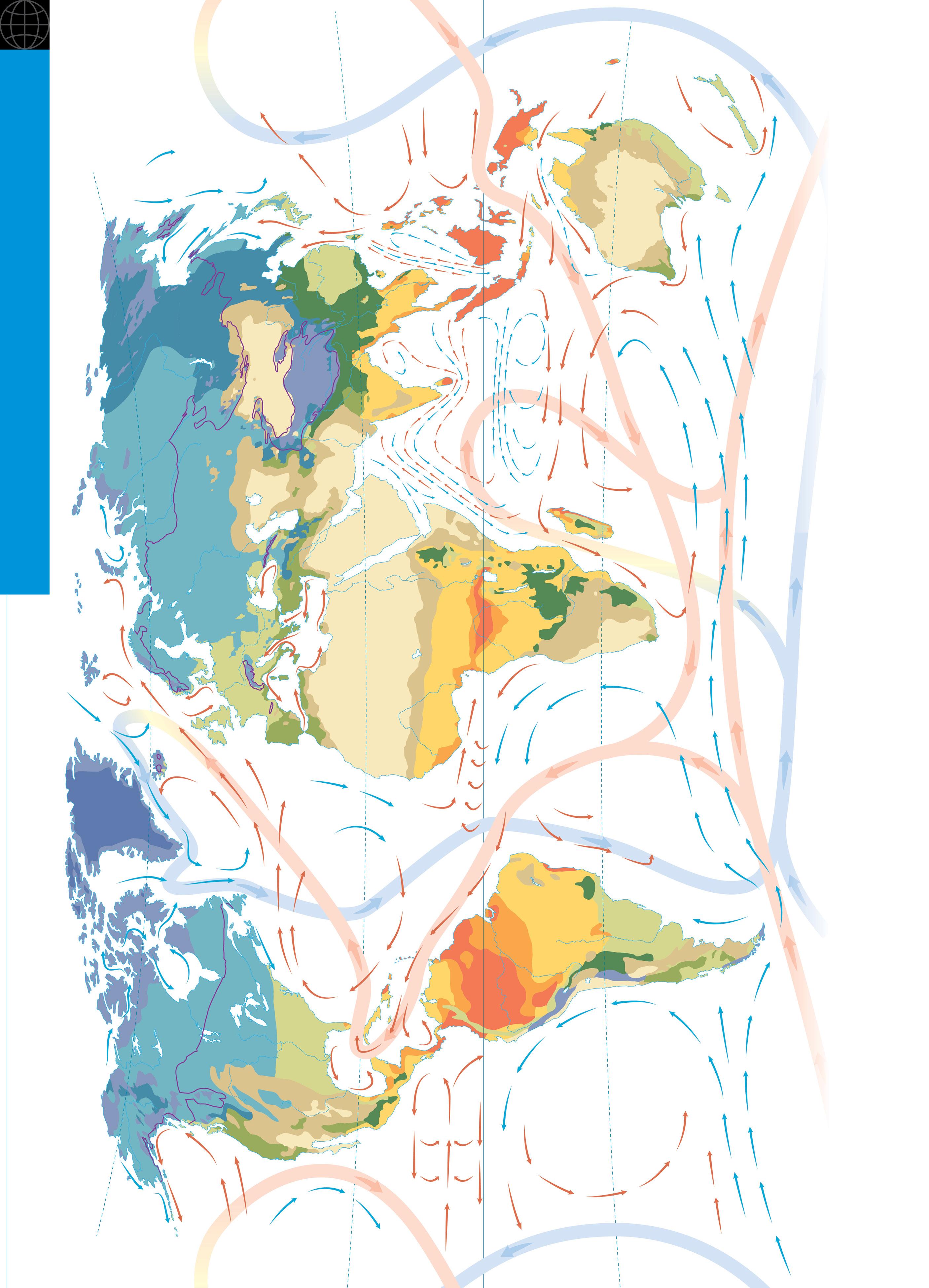
t
r n atif des moussons éD ir v e v e r s l E s t tnaruoC eilartsuAd latneiro
C
Co ur a n t s u dé q u a t o r a rtsuA’dtnaruoC a l i e latnedicco
oCtnaru sed sengieracsaM
sedtnaruoC selliugiA
Les premières lettres (de A à E) renvoient au type de climat, les deuxièmes (en majuscules ou en minuscules), principalement au régime pluviométrique, parfois à la température (F : gel, f : humide, m : pluie de mousson, S : steppe, s : sec en été, T : toundra, W : désert, w : sec en hiver). Les troisièmes lettres, qui précisent l’amplitude des variations de température, ne figurent pas sur cette carte.
Cdlo llaW
G u l f S t r e a m
C o u r a nt des C a r a ï b e s Courantdes Antilles
n t d u B r é s i l
Chivo
xériques
Déserts et brousses
Toundra Mangroves Récif corallien Calotte glaciaire
Prairies, savanes et brousses tropicales et subtropicales
Prairies, savanes et brousses tempérées Prairies et brousses d’altitude Prairies et savanes inondables
Forêts boréales et taïga Forêts de conifères tempérées Forêts de feuillus et forêts mixtes tempérées Forêts, bois et maquis méditerranéens
Un biome est une unité biogéographique comprenant un ensemble d’espèces animales et végétales caractéristiques d’un climat donné.

Biomes
Forêts de feuillus humides tropicales et subtropicales
Forêts de feuillus sèches tropicales et subtropicales Forêts de conifères tropicales et subtropicales
Source Fonds mondial pour la nature (WWF).
BIODIVERSITÉ
À cinq reprises au cours de l’histoire de la Terre, des extinctions de masse ont éradiqué une grande partie des êtres vivants, anéantissant des familles entières d’espèces en un laps de temps relativement court à l’échelle géologique. Malgré la disparition de 75 à 90 % des espèces lors de chaque événement, certaines ont réussi à survivre. Aujourd’hui, une bonne partie de la communauté scientifique tire la sonnette d’alarme : une sixième extinction de masse serait en cours, mais cette fois-ci, l’être humain en serait le principal responsable.
Limites planétaires
En 2009, le Stockholm Resilience Centre a proposé un tout premier cadre d’analyse qui met en valeur l’interdépendance de neuf phénomènes complexes influant sur l’évolution de la biodiversité et la stabilité de la biosphère : les limites planétaires. Il s’agit de seuils à ne pas dépasser pour assurer le maintien de la vie sur Terre et pour que l’humanité puisse vivre durablement
LIMITES PLANÉTAIRES
Érosion de la biodiversité
Déclin de la nature qui menace l’équilibre des écosystèmes et le bien-être des humains à la suite de la destruction d’habitats naturels et de la surexploitation des ressources provoquant la disparition de milliers d’espèces.
Perturbation des cycles biogéochimiques
Dégradation des milieux aquatiques attribuable à l’utilisation de trop grandes quantités d’engrais (azote et phosphore) pour les cultures, et qui entraîne l’eutrophisation des rivières et l’anoxie des océans.
Perturbation du cycle de l’eau douce
Perturbation du cycle de l’eau qui bouleverse les écosystèmes et qui est attribuable à la pollution et à la surexploitation de l’eau douce engendrées par les activités humaines.
Limite dépassée (risque élevé)
Limite dépassée (risque croissant)
Limite non dépassée selon les connaissances actuelles
Situation non quantifiée
dans un écosystème sécuritaire. Depuis 2015, nous avons franchi trois de ces limites planétaires, qui s’additionnent aux trois autres déjà franchies au cours des époques précédentes. Des neuf limites planétaires, il n’en reste plus que trois à franchir pour atteindre le seuil de l’extinction de la vie sur Terre.

La biodiversité est essentielle au bien-être humain, à la santé de la planète et à la prospérité économique de tous les peuples, notamment à la réalisation de modes de vie équilibrés et en harmonie avec la Terre nourricière.
Organisation des

Changements climatiques
Perturbation de l’équilibre climatique par les émissions anthropiques qui entraînent de nombreuses conséquences : hausse des températures, événements climatiques extrêmes, montée des eaux des océans, extinction d’espèces, etc.





Changements
d’utilisation des sols
Déforestation au profit de l’agriculture et de l’urbanisation, qui réduit la capacité des forêts à absorber le carbone, essentiel à la régulation du climat.
* L’eau bleue provient des précipitations qui s’écoulent vers les rivières, les lacs puis jusqu’à la mer, et correspond à celle que les humains utilisent. L’eau verte, quant à elle, est retenue dans le sol et sert à la croissance des plantes.
ÉCHELLE DES TEMPS GÉOLOGIQUES
* « Ma » signifie millions d’années.
Augmentation des aérosols dans l’atmosphère
Perturbation du climat attribuable à l’utilisation croissante d’aérosols.
Diminution de la couche d’ozone
Affaiblissement de la couche d’ozone permettant de protéger les humains et les écosystèmes des rayons UV, attribuable à une trop grande utilisation de certains produits chimiques (aérosols, gaz de climatisation, solvants industriels, etc.).
Acidification des océans
Réduction du pH de l’eau des océans, principalement attribuable à l’absorption d’une trop grande quantité de CO2 d’origine anthropique, et qui fragilise les coraux et diminue la capacité du plancton à se renouveler, ce qui met en péril plusieurs espèces aquatiques.
Introduction d’entités nouvelles dans la biosphère
Augmentation de la production de plastiques et de nouvelles substances chimiques (ex. : glyphosate) qui nuisent à la biosphère et à la santé de l’humain.
D’après le cadre publié par le Stockholm Resilience Center en septembre 2023 (Richardson et al.).
Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, 2022.
Forçage
Zone de sécurité
Hauts lieux de la biodiversité
La conservation des écosystèmes à l’échelle mondiale mérite un effort tout particulier dans les hauts lieux de biodiversité situés dans des zones riches, mais vulnérables (voir carte p. 40). Pour sauvegarder le patrimoine naturel et rétablir l’équilibre du système terrestre, la communauté internationale doit se mobiliser et procéder à des changements majeurs, entre autres dans les secteurs de l’énergie, de l’alimentation et de l’urbanisme.
DIVERSITÉ VÉGÉTALE

C’est dans cet esprit que des scientifiques de l’Université de Göttingen en Allemagne ont créé en 2022 une carte mondiale de la diversité végétale. Cette carte permet de visualiser l’emplacement et le nombre d’espèces sur la Terre. Cette initiative a pour but de soutenir les efforts en matière de conservation, notamment une meilleure planification de l’utilisation des terres, et d’aider à évaluer les bouleversements à venir en raison des changements climatiques.
JOUR DU DÉPASSEMENT
Chaque année, l’ONG Global Footprint Network évalue la date à laquelle l’humanité aura consommé l’ensemble des ressources que la planète peut générer en un an ou absorber sous forme de déchets. Ce calcul repose sur la comparaison entre la biocapacité, qui représente la capacité d’un territoire à produire des ressources renouvelables (alimentation, bois, fibres), à absorber des déchets et à accueillir des infrastructures, et l’empreinte écologique, qui estime la surface nécessaire à une population pour soutenir son mode de vie. En 2024, cette limite a été atteinte dès le 1er août, alors qu’en 1970, elle n’était franchie que le 29 décembre, ce qui illustre l’accélération inquiétante de la surexploitation des ressources naturelles.

Nombre d’espèces





Cette carte présente la répartition planétaire de 300 000 espèces végétales dans 830 flores régionales.
Source Cai, L., Kreft, H., Taylor, A., Denelle, P., Schrader, J., Essl, F., van Kleunen, M., Pergl, J., Pyšek, P., Stein, A., Winter, M., Barcelona, J.F., Fuentes, N., Inderjit, Karger, D.N., Kartesz, J., Kuprijanov, A., Nishino, M., Nickrent, D., Nowak, A., Patzelt, A., Pelser, P.B., Singh, P., Wieringa, J.J. & Weigelt, P. (2023). Global models and predictions of plant diversity based on advanced machine learning techniques. New Phytologist, 237, 1432-1445.
DÉFICIT ET RÉSERVE ÉCOLOGIQUE
Les bilans d’empreinte écologique montrent qu’en 2022, l’humanité a exigé de notre planète 75 % de plus que ce que ses écosystèmes pouvaient régénérer. Selon le biologiste E. O. Wilson, pour préserver 85 % de la biodiversité mondiale, l’humanité ne devrait pas exploiter plus de la moitié des ressources de la Terre. Autrement dit, la demande humaine est trois fois supérieure à un taux compatible avec une conservation durable, qui assurerait la stabilisation de notre climat.
Immeuble situé dans le Bosco verticale, à Milan, un complexe architectural conçu à l’aide des horticulteurs et des botanistes de la ville.



Réserve et déficit écologiques, 2023 (%)
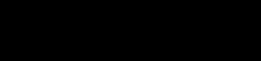
Réserve écologique*









territoire inférieure à l’empreinte écologique de la population.
Source : York University, Ecological Footprint Initiative et Global Footprint Network, National Footprint and Biocapacity Accounts, 2023.

Un déficit écologique se produit lorsque l’empreinte écologique d’une population dépasse la biocapacité du territoire disponible pour cette population. Un pays se trouve en déficit écologique quand il importe de la biocapacité, c’est-à-dire des actifs écologiques, d’autres pays ou quand il émet dans l’atmosphère plus de CO2 que ses propres écosystèmes en absorbent. À l’inverse, on parle de réserve écologique lorsque la biocapacité d’une région dépasse l’empreinte écologique de sa population.
La vaccination permet d’éviter près de 2,5 millions de décès par an liés à la diphtérie, au tétanos, à la coqueluche et à la rougeole. Pour maintenir l’immunité au niveau d’une population, il faut une couverture vaccinale d’au moins 92 %. Dans les pays industrialisés, de nombreux groupes de pression remettent en question l’innocuité des vaccins ou refusent la vaccination, ce qui fait que des foyers de maladie réapparaissent dans ces pays ou ailleurs.
Enfants immunisés contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (%), 2023 Moins
B VIRUS DE L’IMMUNODÉFICIENCE HUMAINE (SIDA)
Prévalence du VIH
Estimation de la population infectée (%), 2023 Moins de 0,5 0,5 à 1 1 à 3 3 à 10 10 et plus
Données non disponibles
Nouveaux cas d'infection par le VIH, 2023
Enfants de moins de 15 ans
Personnes de plus de 15 ans
200 000
Sources : La Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde ; Organisation mondiale de la santé, 2024. 1 000 000
25 000

Le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) est un rétrovirus qui s’attaque aux cellules du système immunitaire et les détruit ou les rend inefficaces. Le syndrome d’immunodéficience acquise (sida) est le dernier stade de l’infection à VIH. Il peut prendre de 10 à 15 ans pour se déclarer.
C INDICE DU BONHEUR
Le Rapport mondial du bonheur, publié depuis 2012 par le Réseau des solutions pour le développement durable des Nations unies en collaboration avec Oxford Wellbeing Research Centre, mesure le bonheur des citoyennes et des citoyens de 156 États à l’aide de plusieurs indicateurs dont le PIB par habitant, le soutien social, l’espérance de vie en bonne santé, la liberté dans les choix de vie, la générosité et la perception de la corruption gouvernementale. Le score de l’indice du bonheur est obtenu en demandant à un échantillon représentatif de la population nationale de penser à une échelle allant de 0 (la pire vie possible) à 10 (la meilleure vie possible).
Indice du bonheur, 2024
A STADES DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL
En 2009, le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine s’allient pour former le BRIC, un acronyme issu des initiales de ces puissances émergentes. Deux ans plus tard, en 2011, l’Afrique du Sud rejoint ce groupe, donnant naissance aux BRICS. L’objectif de cette coalition est de constituer un contrepoids au G7, qui rassemble les principales économies industrialisées. Le groupe s’élargit encore avec l’adhésion de l’Iran, de l’Égypte, des Émirats arabes unis, de l’Indonésie et de l’Éthiopie, marquant l’avènement des BRICS+.
Aujourd’hui, les 10 membres des BRICS+ et leurs 9 États partenaires représentent près de 51 % de la population mondiale et 40 % du PIB mondial, affirmant ainsi leur influence croissante sur la scène internationale.
Stade de développement industriel et niveau de revenu, 2025
Pays industrialisé à revenu élevé
Pays en voie d’industrialisation à revenu élevé
Pays industrialisé à revenu intermédiaire
Pays en voie d’industrialisation à revenu intermédiaire
Pays à faible revenu
Non classé
BRICS+
État membre
État partenaire
Source United Nations Industrial Development Organization, UNIDO Country Classification, Methodological document, Édition 2025.
B PRODUIT INTÉRIEUR BRUT
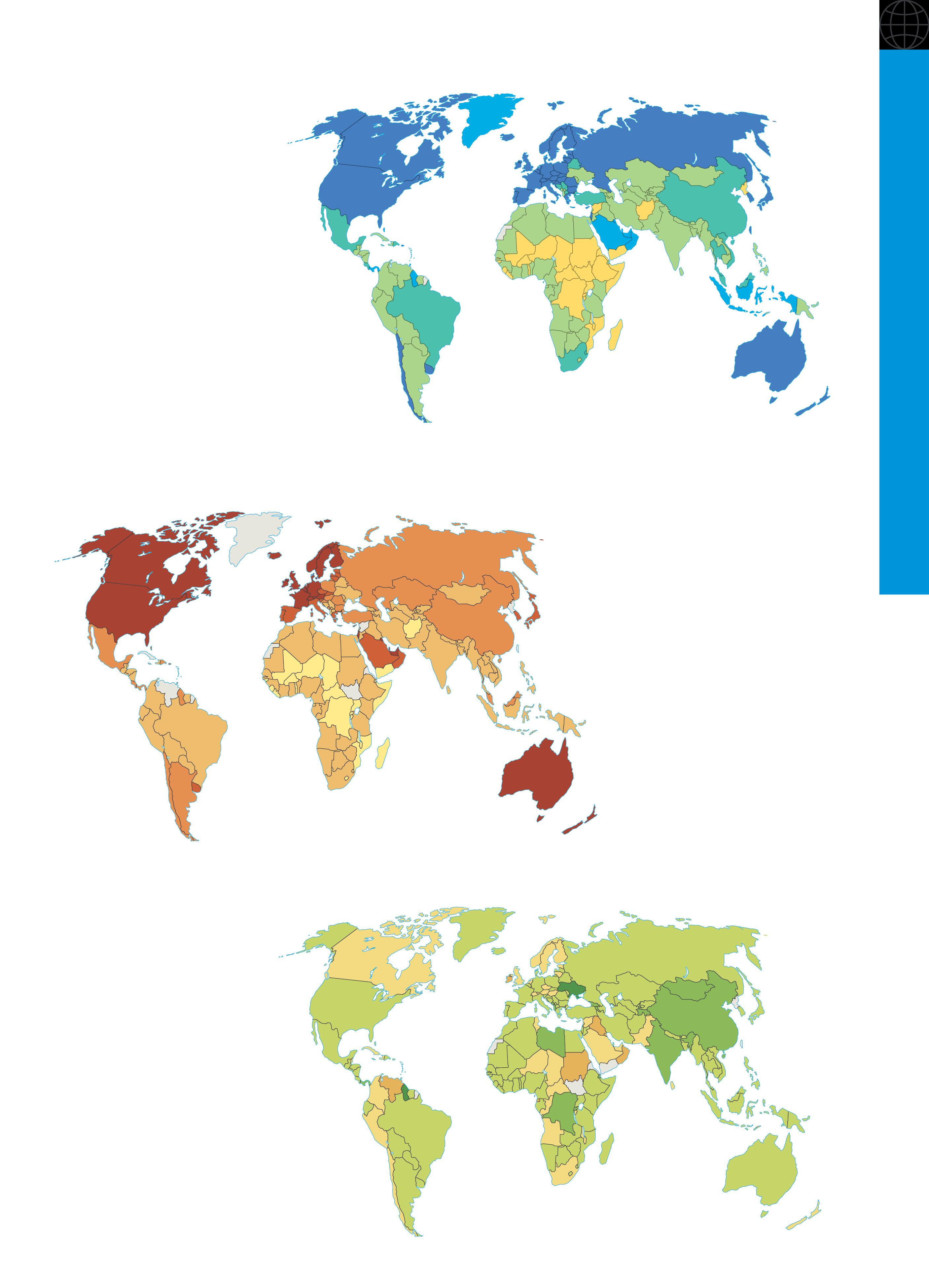
C CROISSANCE DU PRODUIT INTÉRIEUR BRUT
BIÉLORUSSIE
Croissance du PIB
(par habitant, %), 2022-2023
Moins de -5
-5 à 0 0 à 5 5 à 10 10 et plus
Données non disponibles
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde
KAZAKHSTAN
ÉGYPTE IRAN
AFRIQUE DU SUD
INDE CHINE RUSSIE
OUZBÉKISTAN
ÉTHIOPIE ÉMIRATS ARABES UNIS
OUGANDA
THAÏLANDE
MALAISIE
INDONÉSIE
Le produit intérieur brut par habitant est le PIB divisé par la population en milieu d’année. Le PIB est la somme de la valeur ajoutée brute de tous les producteurs résidents d’une économie plus toutes les taxes sur les produits moins les subventions non incluses dans la valeur des produits. La valeur ajoutée est calculée sans effectuer de déductions pour la dépréciation des biens fabriqués ou la perte de valeur ou la dégradation des ressources naturelles.
Produit intérieur brut ($ US, par habitant), 2022
Moins de 1 000
1 000 à 10 000
10 000 à 20 000
20 000 à 40 000
40 000 et plus
Données non disponibles
Source Banque mondiale Indicateurs du développement dans le monde.
BRÉSIL
BOLIVIE CUBA
NIGÉRIA
Le secteur primaire correspond aux activités liées à l’extraction des matières premières non encore transformées telles que les activités minières, agricoles, forestières ou halieutiques.
Population active, secteur primaire
(% du total des emplois), 2023
Moins de 10 10 à 30 30 à 50 50 à 70 70 et plus Données non disponibles
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde
B EMPLOIS, SECTEUR SECONDAIRE
Le secteur secondaire correspond aux activités liées à la transformation des matières premières en biens physiques. Il inclut la fabrication de biens de consommation et d’investissement ainsi que la construction.
Population active, secteur secondaire
(% du total des emplois), 2023 Moins de 10 10 à 15 15 à 20 20 à 25 25 et plus
Données non disponibles
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde
C EMPLOIS, SECTEUR TERTIAIRE
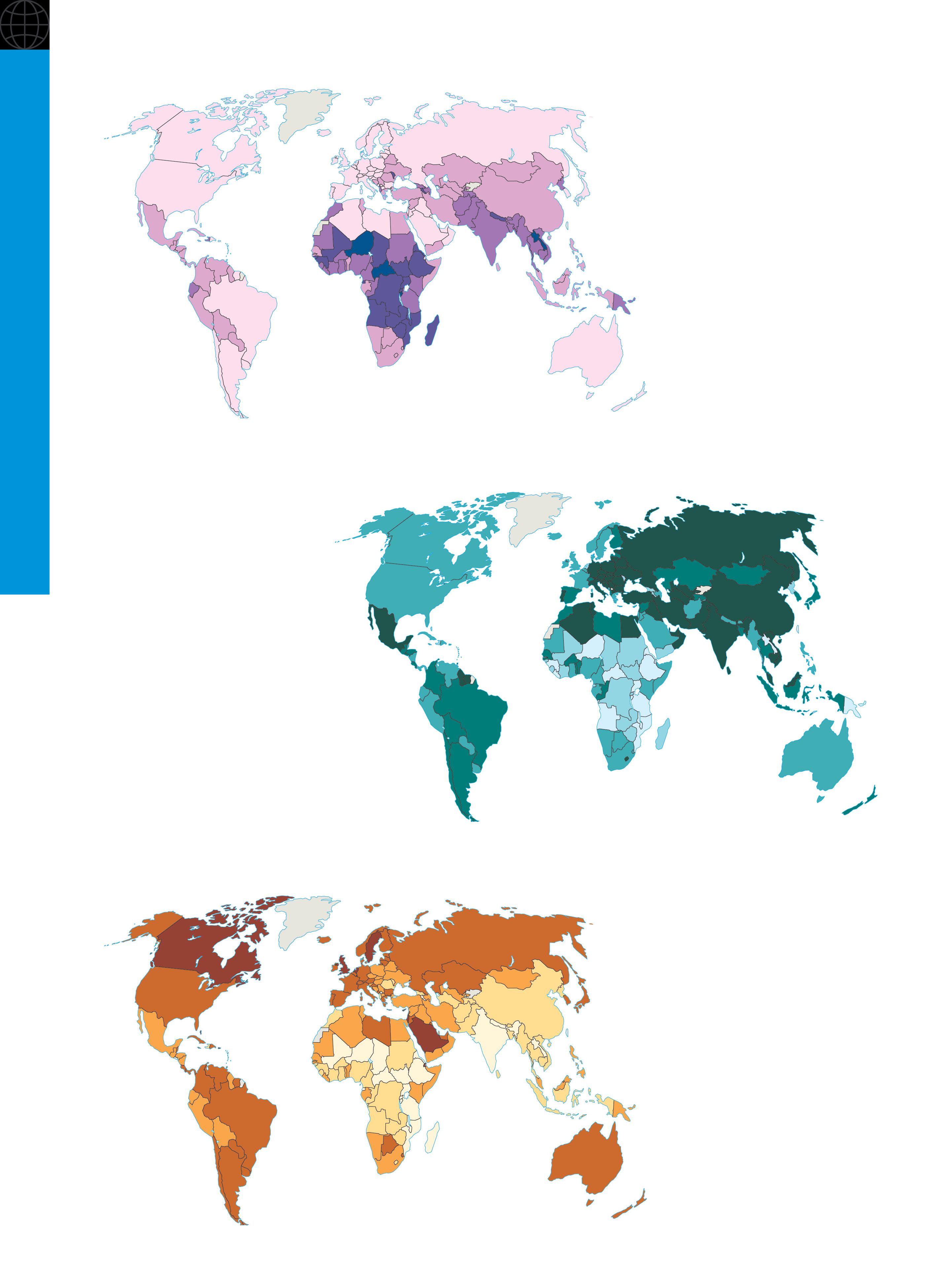
Le secteur tertiaire regroupe toutes les activités économiques qui ne font pas partie des deux autres, essentiellement le commerce, le transport et les services.
Population active, secteur tertiaire
(% du total des emplois), 2023 Moins de 35 35 à 50
à 65
à 80 80 et plus Données non disponibles
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde
OCÉAN PACIFIQUE

OCÉAN ARCTIQUE
New York
Détroit du Pas de Calais
Canal de Panama
OCÉAN PACIFIQUE
Los Angeles Long Beach Port Kelang
RotterdamHambourg
Anvers-Bruges
Détroit du Bosphore
OCÉAN ATLANTIQUE
Détroit de Gibraltar
Tanger Med
Canal de Suez
Détroit d’Ormuz
Jebel Ali
Détroit de Bab-el-Mandeb
Busan Dalian
Tianjin
Qingdao
Xiamen
Guangzhou
Shenzhen
Shanghai Hong Kong Kaohsiung
Ningbo-Zhoushan
Laem Chabang
Tanjung Pelepas
Détroit de Malacca
Singapour
OCÉAN INDIEN
E INTERNET
L’EVP (équivalent vingt pieds) est l’unité de mesure pour exprimer une capacité de transport en multiple du volume standard occupé par un conteneur 20 pieds.
Bandes passantes et serveurs, 2023
Bandes passantes
Serveurs sécurisés (million de serveurs securisés)
OCÉANIE
A GUERRES ET PAIX

Conflits
AMÉRIQUE LATINE ET ANTILLES
Très
Très élevé
Données non disponibles Opération de rétablissement ou de maintien de la paix
CANADA ET ÉTATS-UNIS
EUROPE ET ASIE CENTRALE
MOYEN-ORIENT
Nombre de morts dans des conflits en 2024
AFRIQUE
Le rapport annuel de l’indice de paix mondial (IPM), produit par l’Institut d’économie et de paix, un groupe de réflexion indépendant basé à Sydney, en Australie, classe 163 États et territoires indépendants en fonction de leur niveau de paix. Il s’agit de la principale mesure de la paix dans le monde. L’IPM présente une analyse fondée sur les tendances en matière de paix, sa valeur économique et la manière de développer des sociétés pacifiques. À l’aide de 23 indicateurs provenant de différentes sources, dont l’ONU et le Programme de données sur les conflits de l’Université d’Uppsala, en Suède, l’IPM mesure l’état de la paix mondiale en utilisant trois principaux domaines thématiques : le niveau de sûreté et de sécurité de la société ; l’étendue des conflits nationaux et internationaux en cours ; et le degré de militarisation. Un indice faible ou très faible représente les pays en guerre ou aux prises avec un conflit, tandis qu’un indice élevé ou très élevé est associé aux pays les plus pacifiques.
B POPULATION RÉFUGIÉE
Conflits les plus meurtriers en 2024
Nombre de morts Indice de la paix mondiale,
ASIE-PACIFIQUE
Nombre de réfugiés internationaux par pays d’accueil, 2023
Moins de 5 000
5 000 à 50 000
50 000 à 500 000
500 000 à 1 000 000
1 000 000 et plus
Données non disponibles
Nombre de demandeurs d’asile par pays d’origine, 2023
25 000 à 100 000
100 000 à 200 000
200 000 et plus
Le terme « réfugié », défini par la Convention relative au statut des réfugiés de l’ONU en 1951, désigne toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. Plus précisément, le terme « demandeur d’asile » désigne une personne dite réfugiée, mais dont la requête est encore en cours d’analyse. Une personne apatride, soit celle qui ne possède la nationalité d’aucun pays, peut être un réfugié reconnu ou une personne migrante selon la situation.
D MURS, BARRIÈRES ET CLÔTURES
SUÈDE Danemark (2015)
FRANCE ROYAUME-UNI (2016)

MEXIQUE, ÉTATS-UNIS Guatemala (2013)
ÉTATS-UNIS Mexique (2006) Enclave de Guantanamo ÉTATS-UNIS Cuba (1959)
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE Haïti (2021)
Enclave de Gibraltar ESPAGNE, ROYAUME-UNI (2001)
Enclave de Ceuta ESPAGNE Maroc (2001)
Enclave de Melilla ESPAGNE Maroc (1998)
Mur des sables MAROC Sahara-Occidental (1980)
BRÉSIL Bolivie, Paraguay (2007)
ALGÉRIE Maroc (2016)
BRÉSIL Colombie, Guyana, Pérou, Suriname, Uruguay, Venezuela
Murs, barrières et clôtures
ÉTATS-UNIS
Mexique (2006)
État initiateur du mur, de la barrière ou de la clôture
État subissant le mur, la barrière ou la clôture
Année du début de la construction
Mur, barrière ou clôture
Mur, barrière ou clôture en discontinu
Tracé prévu du mur, de la barrière ou de la clôture planifié
Sources Elisabeth Vallet (Chaire Raoul-Dandurand, UQÀM), Borders, Fences and Walls, 2014 Thierry Gauthé, Courrier international, 2016.
On dénombre près de 70 constructions frontalières (mur, barrière, clôture) dans le monde qui s’étendent sur une distance de plus de 40 000 kilomètres. Les principales raisons invoquées pour de telles installations sont la sécurité nationale, l’immigration, la contrebande, l’enjeu territorial et le trafic de drogues. Bien que ces murs revêtent une symbolique d’identité territoriale, de sécurité étatique ou encore de résistance, les recherches à ce sujet confirment que les murs « ne peuvent, à eux seuls, contrôler la circulation frontalière ; ils ne sont efficaces que lorsqu’ils sont conjugués à d’autres mesures de surveillance* ».
* Frontières et murs frontaliers, une nouvelle ère ?, Compte rendu du colloque international, Chaire Raoul-Dandurand, UQÀM, 2018.
AUTRICHE Slovénie (2016)
AUTRICHE Italie (2015)
SLOVÉNIE Croatie (2015)
ESTONIE Russie (2015)
LETTONIE Russie (2015)
UKRAINE Russie (2015)
INDE Chine
TUNISIE Libye (2015) ALGÉRIE Libye
KENYA Somalie (2015)
ZIMBABWE Zambie
NAMIBIE Angola
Parc national Kruger AFRIQUE DU SUD Mozambique (1975)
HONGRIE Croatie (2015)
HONGRIE Serbie (2015)
HONGRIE Roumanie
BULGARIE Türkiye (2014) GRÈCE Türkiye (2013)
ISRAËL Bande de Gaza (2005), Cisjordanie (2002), Égypte (2010), Jordanie (2016), Liban (1967), Syrie (1967)
ÉGYPTE Bande de Gaza (2008)
E POPULATION CARCÉRALE
BOTSWANA Zimbabwe (2005)
MYANMAR (BIRMANIE) Bangladesh (2014) INDE Birmanie (2003)
INDE Bangladesh (2014)
THAÏLANDE Malaisie (2007)
AFRIQUE DU SUD Zimbabwe
Ligne verte – ONU CHYPRE (ZONE ADMINISTRÉE PAR LES CHYPRIOTES GRECS) Zone administrée par les Chypriotes turcs (1974)
TÜRKIYE Syrie (2014)
TÜRKIYE Iran (2017)
IRAN Irak
ARABIE SAOUDITE Qatar (2003) JORDANIE Irak
ARABIE SAOUDITE Irak (2006)
ARABIE SAOUDITE Émirats arabes unis (2005)
ARABIE SAOUDITE Yémen (2004)
OUZBÉKISTAN TURKMÉNISTAN (2001)
Ligne de contrôle, Cachemire INDE Pakistan (2004) Vallée de Ferghana OUZBÉKISTAN KIRGHIZSTAN (2006) KAZAKHSTAN OUZBÉKISTAN (2006)
PAKISTAN Afghanistan (2016) IRAN Afghanistan (2015)
KOWEÏT Irak (1993)
IRAN Pakistan (2015)
OMAN Yémen (2014)
INDE Pakistan (1989)
ÉMIRATS ARABES UNIS OMAN (2005)
CHINE Corée du Nord (2006)
Zone coréenne démilitarisée CORÉE DU NORD CORÉE DU SUD (1953)
CHINE R.A.S. de Hong Kong
CHINE R.A.S. de Macao
BRUNEI Malaisie (2005)
Nombre de détenus pour 100 000 habitants, 2018-2023
Moins de
Source
En 2017, Amnistie internationale recensait au moins 993 exécutions dans 23 pays. La majorité des exécutions (par décapitation, pendaison, injection létale ou par balle) ont eu lieu en Chine, en Iran, en Arabie saoudite, en Irak et au Pakistan. En décembre 2018, pour une septième fois de son histoire, l’Assemblée générale des Nations unies adoptait un projet de résolution d’un moratoire sur l’application de la peine de mort en demandant « aux États qui ne l’ont pas encore fait d’envisager d’adhérer au deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, ou de le ratifier ».
Peine de mort, 2022
Abolitionniste
Abolitionniste en pratique
Abolitionniste pour les crimes de droit commun Non abolitionniste
Source : Amnistie internationale, 2023.
B INDICE D’ÉGALITÉ DE GENRE
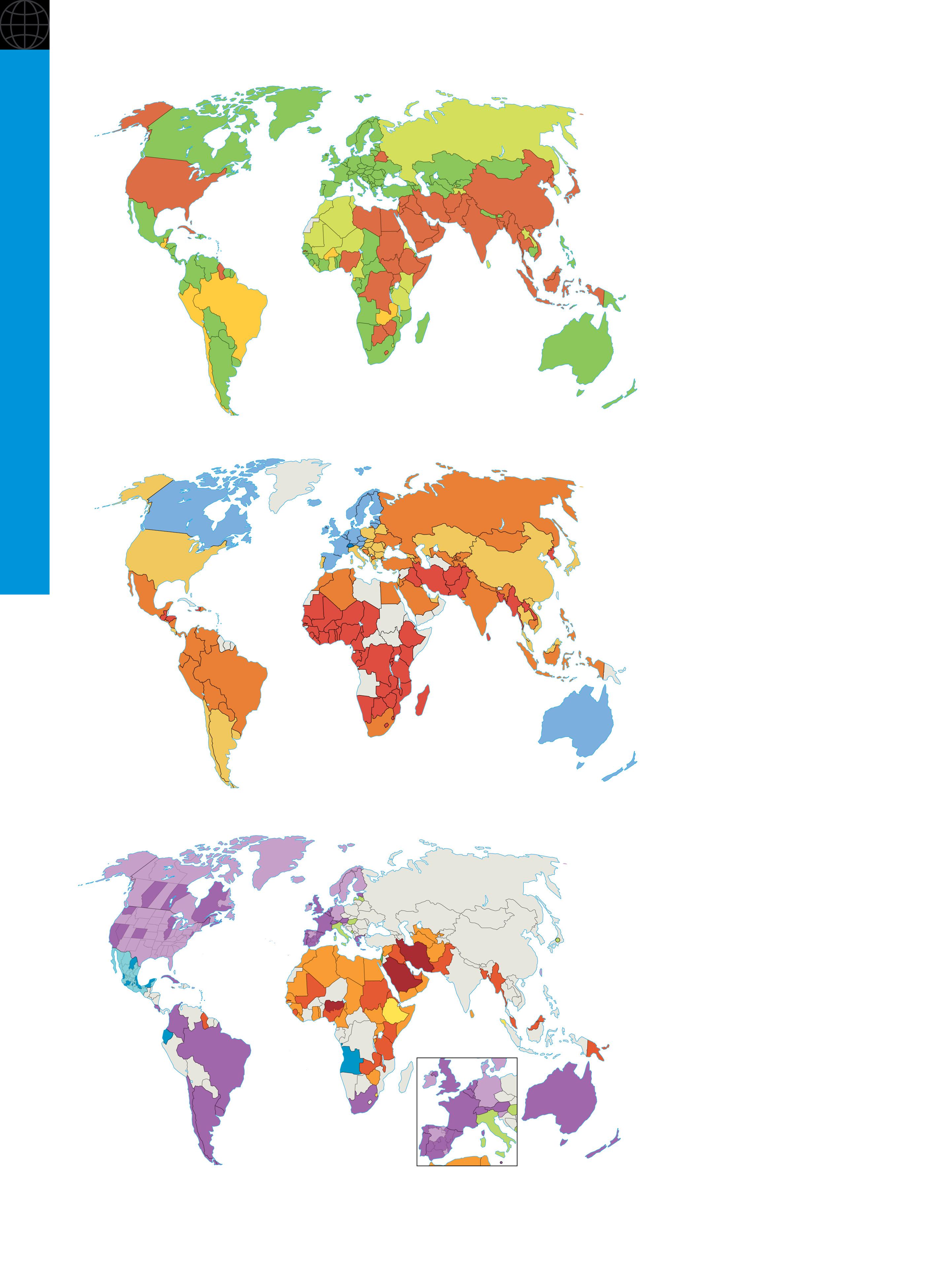
L’Indice de Genre des ODD a été conçu par Equal Measures 2030, une coalition internationale de leaders féministes, d’organismes de la société civile et d’acteurs du développement international qui relient données et actions en faveur de l’égalité de genre. Cet outil évalue les progrès réalisés d’ici 2030 dans 139 pays, représentant 96 % des filles et des femmes dans le monde. Chaque pays reçoit un score entre zéro et 100 sur 56 enjeux liés au genre, dans 14 des 17 objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU. Les indicateurs mesurent l’égalité de genre et des enjeux touchant particulièrement les filles et les femmes, tels que l’accès à l’eau potable, aux services sanitaires et à l’éducation.
En 2015, le score moyen mondial était de 63,7 et, en 2022, il n’avait progressé qu’à 66,1. Si cette tendance persiste, l’égalité de genre ne sera atteinte qu’au 22e siècle.
Indice d’égalité de genre, 2024
Moins de 60 (Très faible)
60 à 70 (Faible)
70 à 80 (Correct)
80 à 90 (Bon)
90 à 100 (Très bon)
Données non disponibles
Source Equal Measures 2030 Indice de Genre des ODD, 2024.
C DROITS DES PERSONNES LGBTQ2+
L’union civile entre les conjoints de même sexe est permise dans 21 des 47 départements du Japon.
L’adoption
Homosexualité et droit familial, 2025
Mariage, union civile et adoption
Mariage et adoption
Mariage et union civile
Mariage
Union civile et adoption
Union civile
Pas de statut légal
Répression de l’homosexualité, 2025
Homosexualité et droit familial, 2025
Mariage, union civile et adoption
Mariage et adoption
Mariage et union civile
Mariage
Union civile et adoption
Union civile
Pas de statut légal
Répression de l’homosexualité, 2025
Peine de mort
Longue peine d’emprisonnement
Courte peine d’emprisonnement (5 ans et moins)
Peine d’emprisonnement non précisée
Reconnaissance juridique du genre fondée sur l’autodétermination, 2025
L’homosexualité est légale dans 131 pays, mais elle est encore considérée comme un crime dans 61 autres pays. L’homosexualité est même passible de peine de mort dans 11 de ces derniers. Depuis 2020, la répression de l’homosexualité s’est accrue en Irak, en Ouganda et en Russie. De plus, en 2023, le gouvernement italien a donné l’ordre aux municipalités du pays de ne plus reconnaître les parents non biologiques sur les actes de naissance. De nombreux parents ont donc vu leur nom supprimé des certificats de naissance de leur enfant.
Homosexualité et droit familial, 2025
Mariage, union civile et adoption
Mariage et adoption
Mariage et union civile
Mariage
Union civile et adoption
Union civile
Pas de statut légal
Répression de l’homosexualité, 2025
Peine de mort
Longue peine d’emprisonnement
D’autre part, ce n’est que depuis 2019 que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ne considère plus le transsexualisme comme une maladie mentale. Selon l’Association internationale des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexuées (ILGA), 20 États membres de l’ONU autorisent la reconnaissance juridique du genre sans exigences prohibitives. La reconnaissance juridique du genre fait référence au processus par lequel les individus peuvent modifier leur sexe ou genre légalement reconnu pour qu’il corresponde au genre auquel ils s’identifient eux-mêmes sur des documents officiels tels que les cartes d’identité, les passeports et les certificats de naissance.
Courte peine d’emprisonnement (5 ans et moins)
Peine d’emprisonnement non précisée
Reconnaissance juridique du genre
fondée sur l’autodétermination, 2025
Reconnaissance du genre (homme/femme)
Reconnaissance du genre non binaire
Source : Association internationale des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexuées (ILGA).
est maintenant possible dans certains États du Mexique, dont Mexico, Coahuila, Campeche, Colima, Michoacán, Morelos, Veracruz, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Puebla et Querétaro.
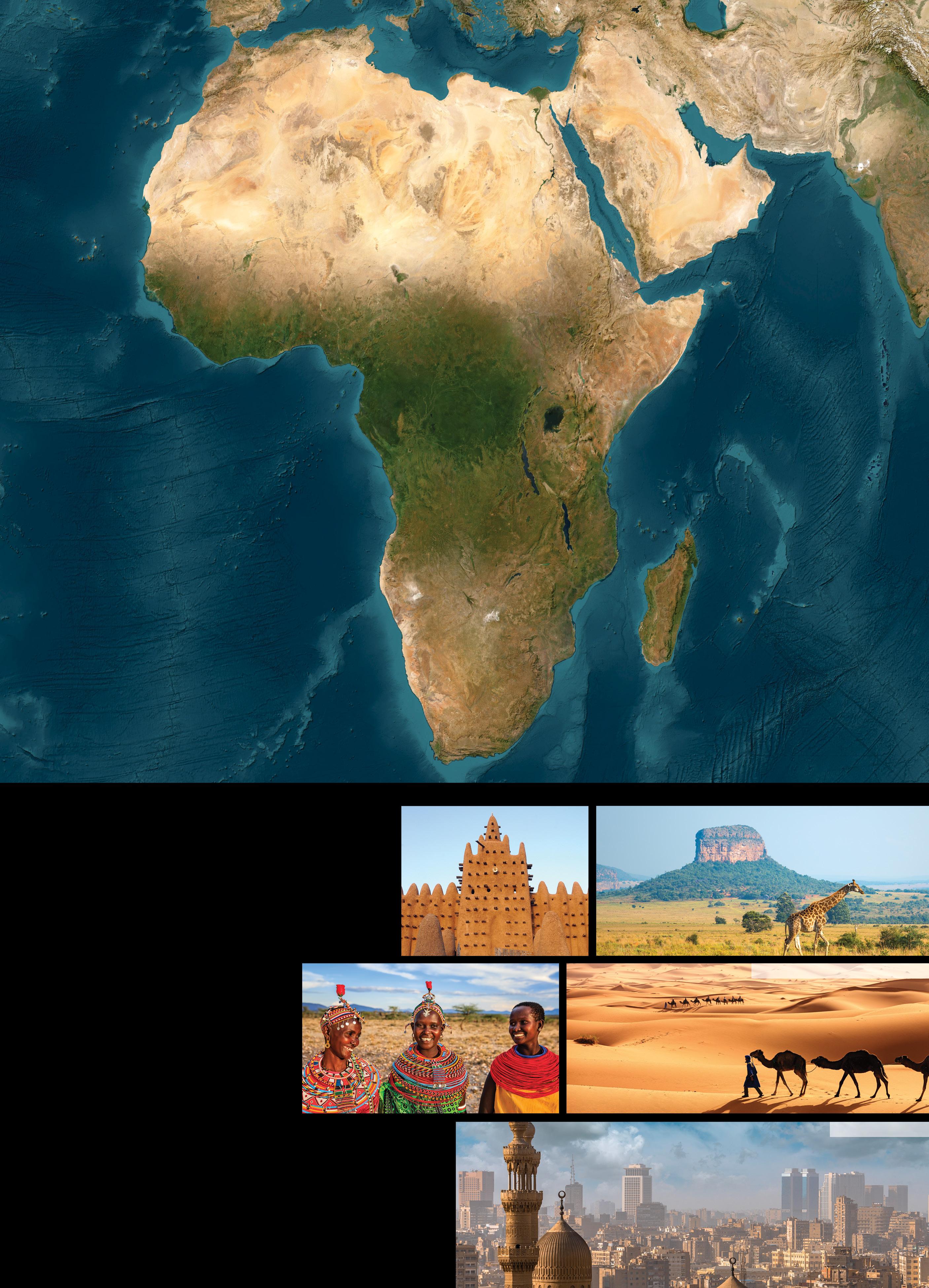
AFRIQUE
Afrique – Couvert végétal 190
Afrique – Climat 191
Afrique physique 192
Afrique politique 193
Nord de l’Afrique 194
Sud de l’Afrique 196
Cartes thématiques 197
STATISTIQUES
Superficie : 30 300 000 km2
Population : 1 525 777 000 habitants
Densité de population : 50,3 hab./km2
Fleuve le plus long : Nil (6 671 km)
Sommet le plus haut : mont Kilimanjaro (5 895 m)
Djenné, Mali.
Femmes Samburu, centre du Kenya.
Le Caire, Égypte. Caravane, désert du Sahara, Maroc.
Réserve Entabeni Safari Conservancy, Limpopo, Afrique du Sud.
OCÉAN ATLANTIQUE

La caractérisation de territoires à l’aide de données satellitaires permet dorénavant de produire des cartes des couverts ou des types de surfaces avec une précision remarquable. Ces cartes sont d’une grande utilité pour évaluer l’évolution et l’intégrité des écosystèmes dans le temps et pour constater les conséquences des changements climatiques. Chaque classe est déterminée en fonction de la nature de son couvert, mais aussi du pourcentage de ce couvert sur une surface donnée. Pour la production de cartes à l’échelle continentale, comme celle-ci, le nombre de classes retenu s’est imposé par la nécessité d’optimiser leur interprétation.
MerCaspienne GolfePersique
Tropique
Comores
Mer Noire
Classification de Köppen
A. Climats tropicaux
Climat équatorial (Af)
Climat de mousson (Am)
Climat de savane, hiver sec (Aw) ou été sec (As)
B. Climats secs
Climat désertique (BW)
Climat de steppe (BS)
C. Climats tempérés

D. Climats continentaux Climat
Détroit de Gibraltar
Canaries (Esp.)

Plateau de Guinée
Atlas
Plateaux éthiopiens Anti-Atlas Atlas saharien Haut Atlas T i b e s t i M a s s i f d e l ’A ï r A j j e r Mourzouk
Désert du Kalahari S a h a r a
é s e r t L i b y q u e
D elt a d u Nil
D é s e r t d e N u b i e
Marais du Sudd
d e n D e l t a d u N i g e r
V a l lé e du Rift
Plateau du Bié Plateau du Katanga
D r a k e n s b e r g
De lta du Za m bèz e
GUINÉEBISSAU

Îles Canaries (Esp.)
Sainte-Hélène (R -U )
TRANSITION DÉMOGRAPHIQUE
Les projections de l’Organisation des Nations unies (ONU) prévoient que l’Afrique comptera près de 2,5 milliards d’habitants d’ici 2050, soit plus du quart de la population mondiale. Si la croissance démographique du continent ralentit par la suite, celui-ci demeurera le principal moteur de l’essor mondial, représentant près de 40 % de la population planétaire à l’horizon 2100.
LES PHASES DE LA TRANSITION DÉMOGRAPHIQUE
PHASE 1
Forte natalité, forte mortalité, accroissement naturel faible
Taux de natalité et de mortalité
PHASE 2
Chute de la mortalité, forte natalité, augmentation de la population
PHASE 3
Chute de la natalité, mortalité basse, augmentation moins rapide de la population


PHASE 4
Natalité et mortalité basses, accroissement naturel faible, nul ou négatif, vieillissement de la population Prétransition
TRANSITION DÉMOGRAPHIQUE
EN AFRIQUE
GAMBIE
Phase de transition démographique, 2024
Phase 2
Phase 3
Phase 4
Source : Organisation des Nations unies, World Population Prospects 2024
La phase 1 (celle de prétransition) n’apparaît pas sur la carte puisque la transition démographique a été amorcée dans tous les pays d’Afrique.
PYRAMIDES DES ÂGES DE L’AFRIQUE DE 1950 À 2100
Transition démographique
La transition démographique désigne le passage d’un régime traditionnel, caractérisé par une natalité et une mortalité élevées qui s’équilibrent, à un régime où ces deux taux deviennent faibles tout en maintenant un certain équilibre. Ce concept modélise l’évolution progressive de ces indicateurs d’un état initial à un état final.
Taux de natalité
Taux de mortalité
Accroissement naturel
INDICE DE FÉCONDITÉ
En 2024, les deux tiers de la population de la planète vivaient dans des États ou régions dont l’indice de fécondité était inférieur à 2,1 enfants par femme. Cet indice demeurait supérieur à ce seuil en Afrique subsaharienne (4,3 enfants), en Océanie (3,0, à part l’Australie et la Nouvelle-Zélande), en Afrique du Nord et en Asie occidentale (2,7), ainsi qu’en Asie centrale et méridionale (2,2). À l’échelle mondiale, l’indice de fécondité a chuté de 3,31 enfants par femme en 1990 à 2,25 en 2024. Il devrait poursuivre son déclin pour atteindre 2,07 d’ici 2050.
Éducation et transition démographique
Il existe un consensus scientifique sur le lien entre l’éducation et la baisse de la fécondité. L’augmentation de la durée de scolarisation des filles a des effets directs sur leurs conditions de vie et sur l’indice de fécondité. Étant plus longtemps sur les bancs d’école, les femmes renforcent leur indépendance financière et ont tendance à repousser l’âge du mariage et d’une première grossesse.
Au Nigeria, par exemple, en 2010, 80 % des femmes de 20 à 24 ans sans éducation étaient mariées avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans, contre 16 % des femmes nigérianes ayant suivi un enseignement secondaire ou supérieur.
Croissance démographique
C’est sur le continent africain que l’on enregistre le taux de croissance démographique le plus élevé. Plus de la moitié de la croissance de la population mondiale d’ici 2050 devrait se produire en Afrique. Ce phénomène sera notamment porté par la République démocratique du Congo, l’Égypte, l’Éthiopie, le Nigeria et la Tanzanie.
Pour cette même période, la population de la région de l’Afrique subsaharienne devrait d’ailleurs doubler. D’ici 2100, deux humains sur cinq devraient être des Africains.
INDICE

Moyenne en Afrique subsaharienne : 4,41
Moyenne mondiale : 2,25
Moyenne mondiale : 2,07
Moyenne en Afrique subsaharienne : 2,78
de fécondité (nombre moyen d’enfants par femme)
L’indice synthétique de fécondité représente le nombre d’enfants par femme en âge de procréer (tranche d’âge allant de 15 à 49 ans).
On établit cet indice en divisant le nombre annuel de naissances vivantes chez les femmes d’un âge donné par le nombre de femmes de cet âge. Par exemple, le nombre d’enfants nés durant une année dont les mères avaient 25 ans est divisé par le nombre total de femmes
qui sont âgées de 25 ans dans la population étudiée. On établit à 2,05 enfants par femme le nombre d’enfants nécessaires pour le renouvellement naturel des générations. La différence entre le taux de natalité et l’indice de fécondité repose sur le fait que le nombre annuel de naissances est mis en relation avec l’ensemble des femmes en âge de procréer.
* Regroupe le Mexique, l’Amérique centrale, les Antilles et l’Amérique
URBANISATION
Le niveau d’urbanisation en Afrique est passé de 31 % en 1990 à 54 % en 2020. Au cours de la même période, le nombre de villes est passé de 3 290 à 8 999. L’émergence de ces nouvelles villes est possible grâce à une urbanisation in situ. En effet, celle-ci ne suit pas le modèle habituel, où les gens quittent les campagnes pour s’installer en ville. Elle se produit plutôt dans les zones rurales, où l’on voit cohabiter des activités agricoles et non agricoles, sans qu’il y ait forcément de migration vers les villes.
Planification de l’urbanisation
La forte croissance démographique en Afrique transforme profondément l’empreinte urbaine et accélère la formation de nouvelles agglomérations. À mesure que la population urbaine augmente, les villes s’étendent et leurs banlieues peuvent finir par se rejoindre, amenant l’étalement urbain à la création de conurbations (agglomérations formées de plusieurs villes rapprochées). Johannesburg-Pretoria en est un exemple. Plus frappant encore, l’espace côtier entre Abidjan (Côte d’Ivoire) et la conurbation de Lagos (Nigeria) constitue la région dont l’urbanisation est la plus rapide du monde, selon l’avis de nombreux experts. Traversant 5 pays sur une distance de 1 000 km, cette zone densément peuplée est en train de devenir une mégalopole. Ces regroupements urbains pourraient devenir des moteurs essentiels pour le développement d’économies régionales intégrées. Pour relever les nombreux défis urbains – qu’il s’agisse du logement, de la mobilité, de la sécurité, des changements climatiques ou du coût de la vie –, les autorités locales et nationales doivent s’engager dans une planification urbaine audacieuse et innovante.
POPULATION VIVANT
DANS UNE ZONE
URBAINE DE PLUS D’UN MILLION
D’HABITANTS, 2023

Population vivant dans une zone urbaine de plus d’un million d’habitants, 2023 (%)
Moins de 10
10 à 20
20 à 30
30 à 40
40 et plus
Données non disponibles
Source : Banque mondiale, Indicateurs de développement dans le monde
POPULATION VIVANT DANS UNE ZONE
URBAINE, 2023
Population vivant dans une zone urbaine, 2023 (%)
Moins de 20
20 à 40
40 à 65
60 à 80
80 et plus
Données non disponibles
Source : Organisation des Nations unies, Population Division, 2024.
URBANISATION DE L’AFRIQUE
ENTRE 1975 ET 2020
Les villages sont des groupes d’habitations avec une densité de moins de 300 habitants par km2
Les villes sont des groupes d’habitations qui comptent au moins 5 000 habitants avec une densité d’au moins
300 habitants par km2
Les grandes villes sont des groupes d’habitations qui comptent une population d’au moins 50 000 habitants avec une densité de plus de 1 500 habitants par km2
Source : Centre commun de recherche de la Commission européenne, 2024.
Le Caire, capitale de l’Égypte, est l’une des villes les plus peuplées d’Afrique.
URBANISATION
L’urbanisation est le processus de croissance d’une ville sur les plans de sa population, de ses infrastructures et de la zone qu’elle occupe, entraînant le développement de ses activités et services, mais aussi un empiètement considérable sur les zones rurales et agricoles.
Les villes africaines sont celles qui connaissent la croissance la plus rapide au monde, elles sont les plus jeunes et elles évoluent rapidement. Leur impact sur l’évolution et le développement économique, social et politique de l’Afrique au cours des prochaines décennies sera probablement profond.
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
POPULATION VIVANT DANS UNE ZONE URBAINE, 2050
Population vivant dans une zone urbaine, projection en 2050 (%)
20 à 40 40 à 60
60 à 80
80 et plus
Données non disponibles
Source : Organisation des Nations unies, Population Division, 2024.
Bidonville et urbanisation

Égypte
Kenya
Maurice
Togo
Congo
Burundi
Gabon
Lesotho
Libye
Afrique du Sud
Maroc
Algérie
Cameroun
Seychelles
Ouganda
Sao Tomé-et-Principe
Tunisie
Gambie
Comores
Botswana
Namibie
Cap-Vert
Rwanda
Djibouti
Angola
Guinée équatoriale
Nigeria
Bénin
Ghana
Côte d’Ivoire
République démocratique du Congo
Sénégal
République centrafricaine
Soudan
Somalie
Érythrée
Soudan du Sud
Eswatini
Sierra Leone
Guinée
Zambie
Mozambique
Mauritanie
Libéria
Burkina Faso
Guinée-Bissau
Tanzanie
Mali
Malawi
Tchad
Zimbabwe
Éthiopie
Madagascar
Niger
Niveau d’urbanisation (%)
La Namibie, l’Ouganda et le Lesotho figurent parmi les 10 pays où la population urbaine connaîtra la plus forte augmentation relative du taux d’urbanisation, témoignant de l’ampleur des dynamiques d’urbanisation sur le continent africain.
Dans son Plan d’action mondial lancé en 2022 pour transformer durablement les établissements informels d’ici 2030, ONU-Habitat souligne que l’urbanisation, en Afrique comme ailleurs, profite surtout aux élites politiques, aux fonctionnaires et aux plus riches –laissant des millions de personnes à l’écart.
Depuis 2007, un tournant historique a été franchi : pour la première fois, la population urbaine mondiale a dépassé celle vivant en milieu rural. Mais cette croissance rapide des villes s’accompagne de défis majeurs. Plus de 1,7 milliard de personnes dans le monde, soit plus de 13 % de la population globale, vivent aujourd’hui dans des logements précaires, surpeuplés et dangereux.
En Afrique subsaharienne, plus d’une personne urbaine sur deux (50,2 %) vivait dans un bidonville en 2020 – ce qui représente environ 230 millions d’individus. D’après les données d’ONU-Habitat et de la Banque mondiale, plusieurs pays d’Afrique présentent les taux les plus élevés de population urbaine vivant dans des bidonvilles, atteignant voire dépassant les 60 à 90 %. Parmi eux : l’Angola, le Bénin, le Burkina Faso, la République centrafrique, la République démocratique du Congo, l’Éthiopie, le Libéria, Madagascar, le Mali, Sao Tomé-et-Principe, le Soudan, le Soudan du Sud et le Tchad. PROJECTION DE L’ÉVOLUTION
POPULATION URBAINE VIVANT DANS DES BIDONVILLES, 2022
Population urbaine vivant dans des bidonvilles, 2023 (%)
Moins de 20
20 à 40
40 à 60
60 à 80
80 et plus
Données non disponibles
Source : Organisation des Nations unies, ONU-Habitat, 2024.
L’ONU-Habitat définit un ménage habitant un bidonville comme un groupe d’individus vivant sous le même toit et ne bénéficiant pas d’une ou de plusieurs des conditions suivantes : accès à l’eau potable, accès à des installations sanitaires améliorées, espace de vie suffisant, structure de bâtiment durable et sécurité foncière.
Le bidonville d’Agbogbloshie, dans la banlieue d’Accra, capitale du Ghana, s’est bâti sur la plus grande décharge illégale d’Afrique où s’accumulent déchets électroniques et plastiques provenant principalement de pays industrialisés. La rivière Odaw, que l’on voit sur la photo, est une zone de forte pollution environnementale, l’eau y étant devenue très toxique.
Source : OCDE/CSAO, 2024.
SOMALIE ÉGYPTE
MADAGASCAR GHANA NIGERIA
A AFRIQUE EN 1950 ET DÉCOLONISATION
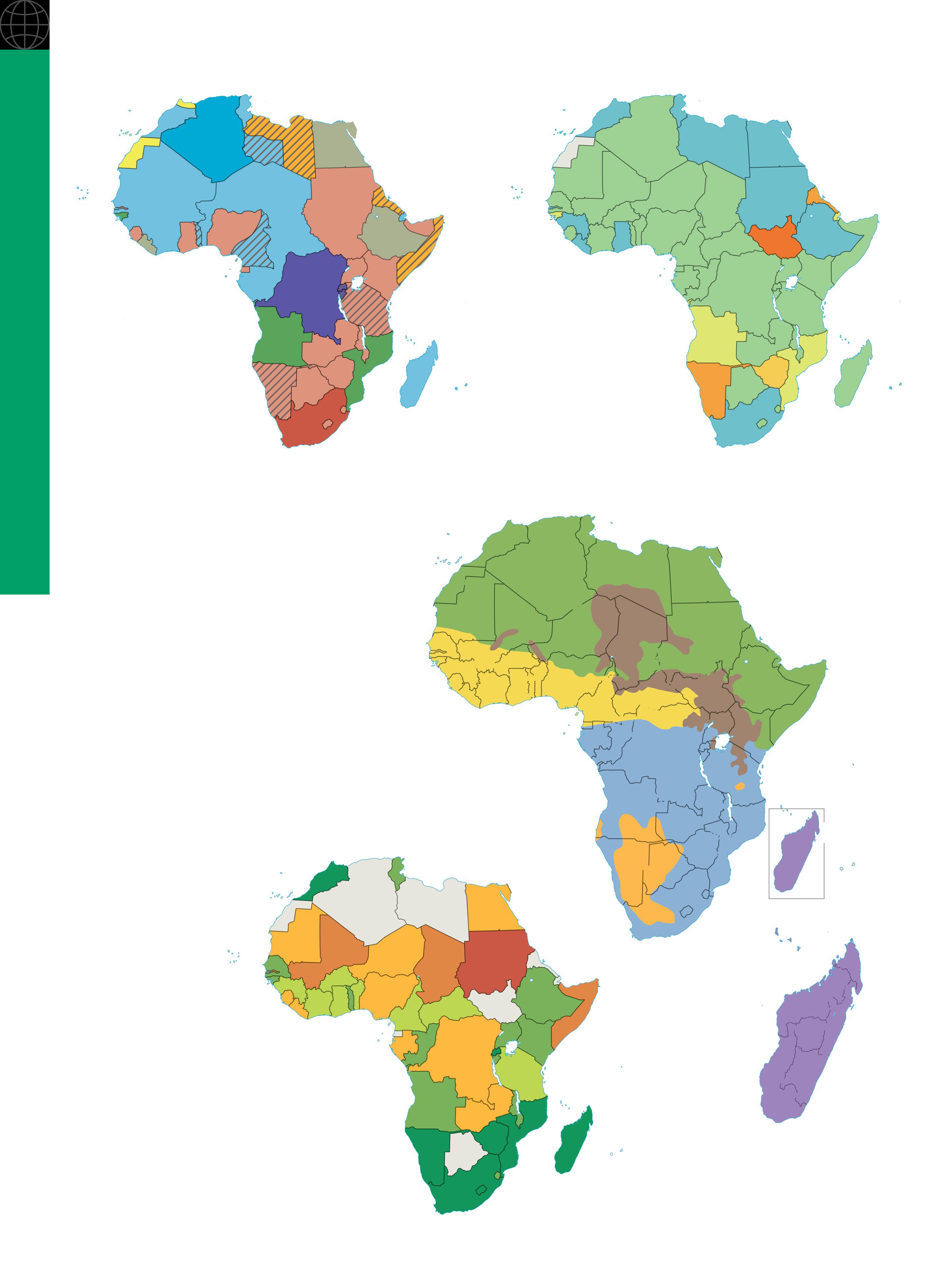
Afrique en 1950
Anciens territoires italiens États indépendants
Territoires belges
Territoires espagnols
Territoires français (colonies)
Territoires français (départements)
Territoires portugais
Territoires sous tutelle des Nations unies
Commonwealth britannique
Territoires indépendants
Territoires et protectorats
B MOSAÏQUE ETHNOLINGUISTIQUE
Le colonialisme laisse des traces dans la culture des peuples colonisés longtemps après leur accès à l’indépendance. Par exemple, il est possible de retracer l’histoire coloniale de l’Afrique par le statut de langue officielle du français, de l’anglais et du portugais, langues que les États colonisateurs ont imposées aux pays colonisés.
Les principales familles ethniques et linguistiques sont indiquées. Quelques autres langues officielles sont données à titre indicatif.
Groupes ethnolinguistiques
Peuples de langues afro-asiatiques
Peuples de langues austronésiennes
Peuples de langues bantoues
Peuples de langues khoïsanes
Peuples de langues nigéro-congolaises
Peuples de langues nilo-sahariennes
Peuls
Groupe ethnique
Langues parlées ayant aussi le statut de langue officielle
Anglais Français
C DROITS DES FEMMES
Le SIGI (Social Institutions and Gender Index) est un indice qui mesure les discriminations dans les institutions sociales qui affectent l’égalité des genres, notamment à travers des pratiques, normes et lois discriminatoires dans différents pays.
Le protocole de Maputo (2003) est un accord international qui garantit des droits aux femmes, incluant celui de participer au processus politique, l’égalité sociale et politique avec les hommes, une meilleure autonomie dans leurs décisions en matière de santé et la fin des mutilations génitales féminines.
Indice Institutions sociales et égalitédes genres (SIGI), 2023
Moins de 20
20 à 30 30 à 40
40 à 50
60 et plus Données non
Protocole de Maputo
Protocole de Maputo signé et ratifié
Année d’indépendance
Avant 1960
1960-1969
1970-1979 1980-1989 1990-1999
Depuis 2010
Territoire disputé

OCÉANIE
Océanie – Couvert végétal 206
Océanie – Climat 207
Océanie physique 208
Océanie politique 209
Océanie 210
Océans Pacifique et Indien 212
Cartes thématiques 214
STATISTIQUES
Superficie : 9 000 000 km2
Population : 48 976 200 habitants
Densité de population : 5,4 hab./km2
Fleuve le plus long : Murray (2 530 km)
Sommet le plus haut : mont Puncak Jaya (4 884 m)
Palaos, qui compte 340 îles.
Christchurch, Nouvelle Zélande.
Uluru, Territoire du Nord, Australie. Koalas, Australie.
Tari Gap, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
MONTÉE DES EAUX
Selon les dernières recherches de l’équipe scientifi que de la NASA sur le changement du niveau de la mer, les États insulaires du Pacifique tels que Tuvalu, les Kiribati et les Fidji connaîtront, d’ici 2050, une élévation du niveau de la mer d’environ 20 à 30 centimètres. Cette situation se produira indépendamment de l’évolution des émissions de gaz à effet de serre dans les années à venir.
Causes
L’élévation du niveau de la mer est l’une des conséquences directes du réchauffement climatique. L’augmentation des températures cause tout d’abord la fonte des glaciers et des calottes glaciaires, mais aussi un autre phénomène : la dilatation thermique de l’eau. En effet, depuis les années 1970, la température de la surface des océans a augmenté d’un peu plus de 0,1 °C par décennie. Cette hausse de la température de l’eau a provoqué une augmentation de son volume, soit cette dilatation thermique. La combinaison des deux manifestations entraîne une hausse du niveau de la mer.
Dans une étude parue en 2025 dans la revue Nature, une équipe de chercheurs révèle une
accélération de la fonte des glaciers dans la dernière décennie. Depuis 2000, les glaciers ont perdu 5 % de leur volume. C’est 273 milliards de tonnes de glace qui fondent chaque année. L’inlandsis du Groenland a quant à lui perdu environ 255 gigatonnes de glace par an entre 2003 et 2016. Depuis 1992, la fonte de l’inlandsis a contribué à une élévation de 14 mm du niveau de la mer. Quant à l’inlandsis de l’Antarctique, c’est plus de 3 000 milliards de tonnes qui auraient fondu de 1992 à 2017. Le rythme de fonte a été multiplié par trois au cours des 25 dernières années.
le
Le changement climatique est plus qu’une crise environnementale. Il s’agit d’une question de justice, de survie pour des nations comme Tuvalu et de responsabilité mondiale.

Alors que, de 1993 à 2023, la variation du niveau moyen de la mer à l’échelle mondiale a été de 9,4 cm [±1 cm], celle de la mer dans le Pacifique Sud-Ouest au cours de la même période a été supérieure à 15 cm [±3 cm] à certains endroits.
ÉLÉVATION DU NIVEAU DE LA MER PAR RAPPORT À 1900
Scénario* à faible probabilité mais à fort impact (SSP5-8,5 avec déstabilisation des calottes glaciaires)
SSP5-8,5 : Scénario* avec des émissions de GES très élevées ; forte augmentation des GES.
SSP3-7,0 : Scénario* avec des émissions de GES élevées ; augmentation des GES selon le rythme actuel.
SSP2-4,5 : Scénario* avec des émissions de GES intermédiaires ; stabilisation des GES à un niveau émission faible avant la fin du XXIe siècle.
SSP1-2,6 : Scénario* avec des émissions de GES faibles ; réduction importante de GES avant 2050.
SSP1-1,9 : Scénario* avec des émissions de GES très faibles ; réduction très importante de GES avant 2050. * Scénario développé par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
En 2021, le ministre des Affaires étrangères de Tuvalu, Simon Kofe, a filmé son discours à la COP 26 (sommet sur le climat), livré les deux pieds dans l’océan pour montrer à quel point le pays est vulnérable aux changements climatiques.
Grace Malie, jeune Tuvalienne engagée dans la Rising Nations Initiative menée par l’ONU.
Dans
village inondé d’Eita, situé sur l’atoll de Tarawa, dans l’archipel de Gilbert des Kiribati, un homme regarde les eaux qui envahissent sa maison.
ÉLÉVATION DU NIVEAU DE LA MER
États atolliens
Dans le Pacifique, les États atolliens (Tuvalu et Kiribati) seront probablement totalement inhabitables d’ici les prochaines décennies, avant d’être complètement submergés d’ici la fin du 21e siècle. Un projet lancé par les chefs de ces États en 2022 et soutenu par l’ONU, Rising Nations Initiative, vise à protéger le statut d’État des pays menacés de disparition, à préserver leur souveraineté et à sauvegarder les droits et le patrimoine des populations touchées.
ATOLL
Un atoll est une île de basse altitude en forme d’anneau constitué de récifs coralliens qui entoure un lagon. Ces reliefs biogéniques (produits par l’action d’organismes vivants) sont capables d’adapter leur taille, leur position et leur élévation à l’évolution du niveau de la mer. La plupart des atolls du monde sont situés en Océanie. États entièrement composés d’atolls, les Kiribati, Tuvalu et les îles Marshall baignent dans l’océan Pacifique, alors que les Maldives émergent de l’océan Indien.

L’atoll de l’île de Marakei, dans les Kiribati.
Réfugiés climatiques
En 2023, l’Australie a offert l’asile climatique aux habitants de Tuvalu. Le traité historique, prévoyant l’accueil de réfugiés climatiques si l’archipel en venait à disparaître, est entré en vigueur en août 2024. En effet, cet archipel du Pacifique, constitué de neuf atolls comptant 11 000 habitants, est menacé de disparaître d’ici la fin du 21e siècle en raison de la montée des eaux. Les signes ne trompent pas : deux de ses neuf récifs coralliens ont déjà été largement submergés. Le texte, qualifié de fondateur pour ce qui est des questions de mobilité climatique dans le Pacifique, souligne les enjeux géopolitiques en matière de sécurité des populations et de souveraineté.
POPULATION TOUCHÉE PAR LA MONTÉE DU NIVEAU DE LA MER
PERSONNES HABITANT À MOINS DE 1 KM DU LITTORAL
Îles
Mariannes du Nord (É -U )
Guam (É -U )
Récifs coralliens Dépôts coralliens
NAURU KIRIBATI ÎLES MARSHALL
OCÉAN PACIFIQUE
PAPOUASIENOUVELLEGUINÉE
TYPES D’ÎLES
Îles Mariannes du Nord (É -U )
Guam (É -U )
ÎLES MARSHALL
MICRONÉSIE
PAPOUASIENOUVELLEGUINÉE ÎLES SALOMON
VANUATU
AUSTRALIE
Hawaï (É.-U )
OCÉAN PACIFIQUE
PALAOS TONGA TUVALU SAMOA Wallis et Futuna (Fr.)
FIDJI
NouvelleCalédonie (Fr ) Niue (N -Z ) NAURU KIRIBATI
NOUVELLEZÉLANDE
Îles Cook (N -Z )
Samoa américaines (É -U ) Tokelau (N -Z )
Types d’îles
Île composite surélevée Continentale
Calcaire surélevée
Calcaire basse
Polynésie Française (fr.)
Îles Pitcairn (R -U )
Atoll Île volcanique Données non disponibles
Source : Pacif Data Hub.
VANUATU
FIDJI ÎLES SALOMON
NouvelleCalédonie (Fr )
NOUVELLEZÉLANDE
)
de sédiments
Dissipation de l’énergie des vagues
Guam (É -U )
PALAOS
Îles Mariannes du Nord (É -U )
MICRONÉSIE
PAPOUASIENOUVELLEGUINÉE
AUSTRALIE
ÎLES MARSHALL
TUVALU SAMOA Wallis et Futuna (Fr.)
Tokelau (N -Z )
Îles Cook (N -Z )
TONGA
Niue (N -Z )
Samoa américaines (É -U )
Polynésie Française (fr.)
POPULATION EXPOSÉE AUX INONDATIONS CÔTIÈRES EN 2050
OCÉAN PACIFIQUE
Hawaï (É.-U )
NAURU KIRIBATI
ÎLES SALOMON
VANUATU
NouvelleCalédonie (Fr )
NOUVELLEZÉLANDE
FIDJI
TUVALU SAMOA Wallis et Futuna (Fr.)
Tokelau (N -Z )
Îles Cook (N -Z )
TONGA
Niue (N -Z )
Samoa américaines (É -U )
Polynésie Française (fr.)
Îles
Pitcairn (R -U )
Caractéristiques morphologiques
Structure du récif
Sédiments dérivés du récif

Coraux vivants
ÉCOSYSTÈME DU RÉCIF ÎLE CORALLIENNE ÉCOSYSTÈME DU RÉCIF
1 Pentes externes
2 Crête du récif
3 Plateau récifal
4 Plage océanique
5 Crête de la plage
6 Dépression intérieure
7 Plage lagunaire
Paramètres des vagues
H Hauteur des vagues
de sédiments Frottement des vagues
Écosystème sensible aux variations du niveau de la mer
La pente externe et la crête du récif corallien de l’atoll fournissent à la fois un apport sédimentaire vers le rivage et une une protection aux îles coralliennes.
R Montée des vagues
Processus de construction
a Production de sédiments
b Injection de sédiments
c Transport de sédiments
d Zone de dépôt côtier
e Zone de dépôt par débordement
Régime de vagues quotidien
Régime des vagues extrêmes (tempête, tsunami)
AUSTRALIE
Îles Pitcairn (R -U )
Hawaï (É.-U
MICRONÉSIE
PALAOS
RÉFÉRENCE QUÉBÉCOISE POUR COMPRENDRE

ATLAS
CONTEMPORAIN
QUÉBEC • CANADA • MONDE
L’Atlas contemporain revient dans une troisième édition enrichie, proposant plus de 300 cartes physiques, politiques et thématiques, faciles à consulter et à exploiter. Élaborées à partir de données actualisées, ces cartes permettent d’analyser et de comprendre les grands enjeux contemporains à l’échelle régionale, nationale et internationale.
NOUVEAUTÉS DE CETTE ÉDITION
:
• huit dossiers thématiques sur les défis environnementaux, politiques, sociaux et culturels du monde actuel ;
• un lexique présentant plus de 165 entrées ;
• des schémas illustrant des concepts clés de géographie physique et humaine ;
• de nouvelles cartes thématiques ;
• des couleurs optimisées pour une meilleure lisibilité ;
• des mises à jour ;
• encore plus d’explications pour mieux comprendre les sujets complexes.
UN CONTENU NUMÉRIQUE RICHE ET VARIÉ
Sur maZoneCEC, accédez à l’ouvrage en format numérique ainsi qu’aux contenus suivants :
• plus de 200 exercices interactifs autocorrectifs ;
• des cartes interactives ;
• des hyperliens vers des contenus multimédias enrichissants ;
• des documents reproductibles (cartes muettes, exercices, ateliers) ;
• des animations
Avec cette édition repensée, l’Atlas contemporain demeure un outil indispensable pour explorer et comprendre le monde d’aujourd’hui !