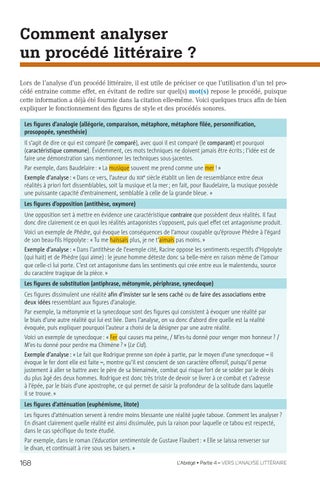Comment analyser un procédé littéraire ? Lors de l’analyse d’un procédé littéraire, il est utile de préciser ce que l’utilisation d’un tel procédé entraine comme effet, en évitant de redire sur quel(s) mot(s) repose le procédé, puisque cette information a déjà été fournie dans la citation elle-même. Voici quelques trucs afin de bien expliquer le fonctionnement des figures de style et des procédés sonores. Les figures d’analogie (allégorie, comparaison, métaphore, métaphore filée, personnification, prosopopée, synesthésie) Il s’agit de dire ce qui est comparé (le comparé), avec quoi il est comparé (le comparant) et pourquoi (caractéristique commune). Évidemment, ces mots techniques ne doivent jamais être écrits ; l’idée est de faire une démonstration sans mentionner les techniques sous-jacentes. Par exemple, dans Baudelaire : « La musique souvent me prend comme une mer ! » Exemple d’analyse : « Dans ce vers, l’auteur du xixe siècle établit un lien de ressemblance entre deux réalités à priori fort dissemblables, soit la musique et la mer ; en fait, pour Baudelaire, la musique possède une puissante capacité d’entrainement, semblable à celle de la grande bleue. » Les figures d’opposition (antithèse, oxymore) Une opposition sert à mettre en évidence une caractéristique contraire que possèdent deux réalités. Il faut donc dire clairement ce en quoi les réalités antagonistes s’opposent, puis quel effet cet antagonisme produit. Voici un exemple de Phèdre, qui évoque les conséquences de l’amour coupable qu’éprouve Phèdre à l’égard de son beau-fils Hippolyte : « Tu me haïssais plus, je ne t’aimais pas moins. » Exemple d’analyse : « Dans l’antithèse de l’exemple cité, Racine oppose les sentiments respectifs d’Hippolyte (qui hait) et de Phèdre (qui aime) : le jeune homme déteste donc sa belle-mère en raison même de l’amour que celle-ci lui porte. C’est cet antagonisme dans les sentiments qui crée entre eux le malentendu, source du caractère tragique de la pièce. » Les figures de substitution (antiphrase, métonymie, périphrase, synecdoque) Ces figures dissimulent une réalité afin d’insister sur le sens caché ou de faire des associations entre deux idées ressemblant aux figures d’analogie. Par exemple, la métonymie et la synecdoque sont des figures qui consistent à évoquer une réalité par le biais d’une autre réalité qui lui est liée. Dans l’analyse, on va donc d’abord dire quelle est la réalité évoquée, puis expliquer pourquoi l’auteur a choisi de la désigner par une autre réalité. Voici un exemple de synecdoque : « Fer qui causes ma peine, / M’es-tu donné pour venger mon honneur ? / M’es-tu donné pour perdre ma Chimène ? » (Le Cid). Exemple d’analyse : « Le fait que Rodrigue prenne son épée à partie, par le moyen d’une synecdoque – il évoque le fer dont elle est faite –, montre qu’il est conscient de son caractère offensif, puisqu’il pense justement à aller se battre avec le père de sa bienaimée, combat qui risque fort de se solder par le décès du plus âgé des deux hommes. Rodrigue est donc très triste de devoir se livrer à ce combat et s’adresse à l’épée, par le biais d’une apostrophe, ce qui permet de saisir la profondeur de la solitude dans laquelle il se trouve. » Les figures d’atténuation (euphémisme, litote) Les figures d’atténuation servent à rendre moins blessante une réalité jugée taboue. Comment les analyser ? En disant clairement quelle réalité est ainsi dissimulée, puis la raison pour laquelle ce tabou est respecté, dans le cas spécifique du texte étudié. Par exemple, dans le roman L’éducation sentimentale de Gustave Flaubert : « Elle se laissa renverser sur le divan, et continuait à rire sous ses baisers. »
168
L’Abrégé • Partie 4 – VERS L’ANALYSE LITTÉRAIRE