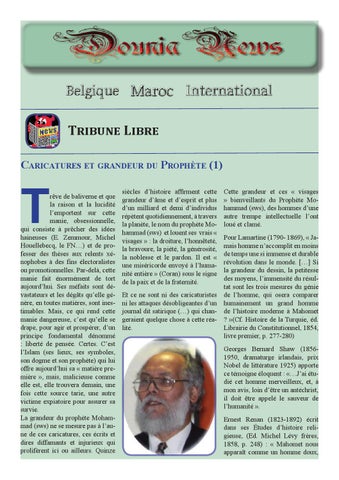Tribune Libre Caricatures et grandeur du Prophète (1)
T
rêve de baliverne et que la raison et la lucidité l’emportent sur cette manie, obsessionnelle, qui consiste à prêcher des idées haineuses (E. Zemmour, Michel Houellebecq, le FN…) et de professer des thèses aux relents xénophobes à des fins électoralistes ou promotionnelles. Par-delà, cette manie fait énormément de tort aujourd’hui. Ses méfaits sont dévastateurs et les dégâts qu’elle génère, en toutes matières, sont inestimables. Mais, ce qui rend cette manie dangereuse, c’est qu’elle se drape, pour agir et prospérer, d’un principe fondamental dénommé : liberté de pensée. Certes. C’est l’Islam (ses lieux, ses symboles, son dogme et son prophète) qui lui offre aujourd’hui sa « matière première », mais, malicieuse comme elle est, elle trouvera demain, une fois cette source tarie, une autre victime expiatoire pour assurer sa survie. La grandeur du prophète Mohammad (sws) ne se mesure pas à l’aune de ces caricatures, ces écrits et dires diffamants et injurieux qui prolifèrent ici ou ailleurs. Quinze
siècles d’histoire affirment cette grandeur d’âme et d’esprit et plus d’un milliard et demi d’individus répètent quotidiennement, à travers la planète, le nom du prophète Mohammad (sws) et louent ses vrais « visages » : la droiture, l’honnêteté, la bravoure, la piété, la générosité, la noblesse et le pardon. Il est « une miséricorde envoyé à l’humanité entière » (Coran) sous le signe de la paix et de la fraternité.
Cette grandeur et ces « visages » bienveillants du Prophète Mohammad (sws), des hommes d’une autre trempe intellectuelle l’ont loué et clamé.
Pour Lamartine (1790- 1869), « Jamais homme n’accomplit en moins de temps une si immense et durable révolution dans le monde. […] Si la grandeur du dessin, la petitesse des moyens, l’immensité du résultat sont les trois mesures du génie Et ce ne sont ni des caricaturistes de l’homme, qui osera comparer ni les attaques désobligeantes d’un humainement un grand homme journal dit satirique (…) qui chan- de l’histoire moderne à Mahomet geraient quelque chose à cette réa- ? »(Cf. Histoire de la Turquie, éd. lité. Librairie du Constitutionnel, 1854, livre premier, p. 277-280) Georges Bernard Shaw (18561950, dramaturge irlandais, prix Nobel de littérature 1925) apporte ce témoigne éloquent : «…J’ai étudié cet homme merveilleux, et, à mon avis, loin d’être un antéchrist, il doit être appelé le sauveur de l’humanité ». Ernest Renan (1823-1892) écrit dans ses Études d’histoire religieuse, (Ed. Michel Lévy frères, 1858, p. 248) : « Mahomet nous apparaît comme un homme doux,