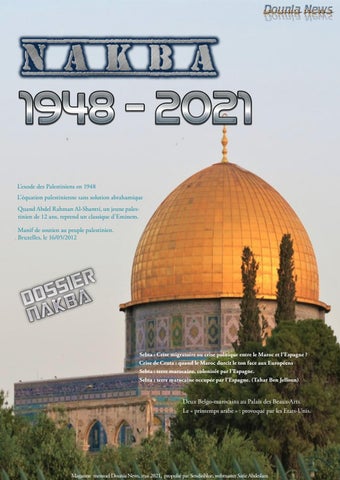7 minute read
Islam
by DouniaNews
Une vision musulmane de la laïcité
Dans cet article, Mohamed Bajrafil nous offre une des réflexions les plus abouties, par un auteur musulman en contexte francophone, sur la question du rapport de l’islam à la laïcité. S’appuyant sur une connaissance réelle des sources et des auteurs musulmans, M. Bajrafil montre que ce n’est pas l’islam qui est rétif à la laïcité mais les postures idéologiques, parfois fondées sur une sacralisation du fiqh (la jurisprudence musulmane), qui conduit à la non « séparation de la Mosquée et l’État ».
Advertisement
Ces derniers temps, la laïcité est sur les lèvres de tout le monde, en France, parce qu’on estime qu’elle est menacée. De sondage en sondage, depuis maintenant plus de dix ans, depuis précisément que des attentats frappent le territoire hexagonal, après ceux de la moitié des années 90, le constat semble correspondre aux désirs de ceux qui les commandent : l’islam serait foncièrement rétif à la laïcité et, subséquemment, nombre de ceux qui en sont les croyants, aussi. La tension croit, hélas, à mesure que les attentats terroristes font des victimes, ici, au nom de l’islam.
L’horrible assassinat du professeur Paty a radicalisé encore plus les positions de ceux que l’on appelle, par euphémisme, les tenants d’une laïcité de combat. On prête même à l’un d’eux le propos selon lequel il faudrait davantage taper sur l’islam, afin de le pousser à [entre guillemets] « entrer dans les rangs », comme on fit jadis avec le christianisme. D’aucuns pensent aujourd’hui le christianisme comme la mère naturelle de la laïcité, oubliant volontairement combien les échanges étaient rudes entre les pères de cette loi de liberté, qu’est la laïcité, et les responsables de l’Église catholique.
On l’aura compris, la question est donc le rapport de l’islam à la laïcité : comment est-il ? Y est-il vraiment rétif ? C’est à cela que je tenterai de répondre dans ce court écrit, sans prétendre épuiser le sujet. Et pour cela, je parlerai dans un premier temps des raisons du rejet et/ou de la méfiance apparente vis-à-vis de la laïcité chez certains musulmans. Il sera très rapidement question, ensuite, du caractère foncièrement laïc de l’islam, textes à l’appui. L’accent sera enfin mis sur la discussion de certaines des raisons avancées par les tenants d’un islam global (šumūliyya) pour montrer leur non-fondement théologique et rationnel. La présentation de la laïcité dans nombre de pays, notamment arabo-musulmans, est, me semblet-il, très différente de ce qu’on a dans nos lois en France. Et c’est là un des nœuds du problème. En effet, elle y est vue, sinon décrite, comme la lutte contre toute religion, quelle qu’elle soit. Le mot pour la désigner en arabe est ‘ilmāniyya, que la masse considère, parfois, voire souvent, comme une insulte, jetée à l’encontre des ennemis de la religion. Les partis islamistes, appelés ainsi, pour nous, parce que présentant un idéal sociétal et gouvernemental qui reposerait sur les préceptes de l’islam, affichent souvent leur opposition à la ‘ilmāniyya, ennemie de la religion, selon eux. Ainsi, le cheikh Qataro-Egyptien, figure théologique des Frères Musulmans, Youssef al-Qaradāwī consacre à la question un essai au titre évocateur : L’islam et la laïcité, le face-à-face (al’islām wa l‘ilmāniyya wahan bi wah)…
Cliquez sur le titre
Chez Hanouna, Lilia Bouziane, jeune étudiante, explique pourquoi elle porte le voile depuis ses 13 ans

Patrick Weil : «Mohammed a été bien plus tôt que certains ne le croient un prénom français»
Féminismes arabes séculiers et voile…
Leïla Tauil enseigne à l’Université de Genève (département d’arabistique) et est membre du « Centre interdisciplinaire d’études islamiques dans le monde contemporain » de l’UCL. Elle se spécialise dans la position de la femme musulmane (le Code de droit personnel et de la famille, et le discours islamique contemporain sur « la femme » à l’intérieur de l’Islam. dans les mouvements de femmes islamiques, les mouvements arabes de femmes laïques et le travail de Mohammed Arkoun. Elle est l’auteur de trois livres : Les féministes de l’Islam, de l’engagement religieux au féminisme islamique, Etude des discours d’actrices religieuses « glocales » (Ed. Pensées Féministes, 2011); Féminismes arabes : un siècle de combat. 2018) en Les femmes dans les discours fréristes, salafistes et féministes islamiques : une analyse des rapports de force genrés (Ed. Academia, 2020). Au cours de sa conférence Féminismes arabes séculiers et voilement du corps des femmes dans le processus de la réislamisation (mouvements de femmes laïques arabes et couverture du corps de la femme en cours d’herislamisation), elle déborde d’une part des mouvements de femmes laïques qui ont une place historique et sociologique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. D’autre part, elle analyse les idées et propositions des membres des Frères musulmans, des salafistes et des féministes islamiques sur la place des femmes dans la vie privée et publique, ainsi que sur la question du foulard.

Le statut du Coran à la lumière de l’Islamologie appliquée de Mohammed Arkoun : la thèse mu’tazilite du Coran créé : le théorem mustazilithic du Coran « créé » : le statut du Coran à la lumière de l’islamologie appliquée de Muhammad Arkoun), elle met en évidence le théorem de l’historicité de la raison coranique comme l’a préconisé Arkoun et défendu par le mouvement théologique rationaliste des omazilites (8ème siècle). Arkoun et les omazilites retirèrent le Corpus Coranicum du registre impénétrable de l’éternité, afin de mettre le Coran au service de la raison humaine. Une déclaration rejetée par l’orthodoxie sunnite, qui estime que les textes sacrés doivent être suivis littéralement et très strictement et qu’il n’y a pas de place pour des interprétations qui s’écartent de leur sens littéral.
Cliquez pour voir et écouter la VIDEO
Maroc : Des ONG montent au créneau contre la non-reconnaissance de filiation parentale
Le tissu associatif ne décolère pas, après une décision de la Cour de cassation décrétant le refus de filiation parentale à une enfant née hors-mariage. La décision, qui casse une précédente jurisprudence, est considérée comme rétrograde au regard des dispositions nationales. Le 29 septembre 2020, la Cour de cassation a refusé la filiation parentale à une enfant née hors-mariage en 2014, décrétant ainsi la nullité d’une jurisprudence rendue en 2017 par le tribunal de première instance de Tanger. Cette décision définitive appuye celle de la Cour d’appel de la ville. Mais c’est seulement depuis quelques jours que l’avis de la haute juridiction a fait parler, après que des organisations
de la société civile s’en sont saisies.

Sortie du livre «Marie dans la Bible et le Coran»
Les récits de l’Annonciation tels qu’ils sont exposés dans l’Evangile de Luc et dans le Coran ont conduit chrétiens et musulmans à reconnaître en Marie, la mère de Jésus, la figure spirituelle éminente qui permet de fonder le dialogue et la rencontre. De cette approche partagée est né le mouvement Ensemble avec Marie qui œuvre au-delà des différences doctrinales pour le dessein de Dieu, à la consolidation de la fraternité, à une civilisation de l’amour et de la paix à laquelle aspirent les croyants des deux religions.
Pourquoi parler de «communauté musulmane» est parfaitement absurde
Au-delà de la lecture d’un même livre jugé sacré, il existe de multiples islams, qui n’ont souvent presque rien à voir les uns avec les autres sur un plan pratique.
Les débats sur la nature de l’islam sont connus et nombreux. Certains commentateurs tentent de vous convaincre - peut-être en se référant à tel ou tel verset - que le véritable islam est pacifique et que les musulmans faisant de violence au nom de leur foi sont des marginaux. D’autres tenteront de vous convaincre - peut-être en citant d’autres versets - que l’islam est violent et que les musulmans pacifiques sont des marginaux qui ne comprennent pas la nature fondamentale de leur religion. Deux positions aussi intellectuellement pauvres l’une que l’autre. Pour les non-musulmans, l’islam n’a et ne peut avoir aucune nature fondamentale, car l’islam, tel que la plupart des non-musulmans ont tendance à le concevoir, n’existe et ne peut exister. Deux raisons à cela : l’une est linguistique et l’autre est ontologique. Le problème linguistique touche à l’utilisation de l’article défini. Lorsqu’on fait référence à la communauté musulmane, de quoi parle-t-on ? Des soufis de Liverpool, des chiites iraniens du centre de Londres, des wahhabites d’Arabie saoudite ? L’idée - que sous-entend le mot «la» - qu’il existerait une seule communauté islamique fournissant un point de référence commun n’a aucun sens…