2018 / printemps . . . clore sur un compte rond une décennie d’aventure, d’écriture et de partage . . . régénérer sa réflexion en se rendant plus disponible pour d’autres projets . . . autant de signes de la reconfiguration accélérée du monde à l’aune de l’idéologie unique du marché omniscient . . . susciter et faire vivre un débat sur l’architecture , élargissant le cercle de ceux qui s’y intéressent . . . adoptant à l’occasion une position iconoclaste . . . tentant de faire sauter quelques verrous . . . en les instruisant par la production ou l’exhumation de documents . . . l’architecture reste hélas cantonnée au rôle de supplément esthétique, de valeur éventuellement ajoutée à certains secteurs du marché (immobilier, touristique) et de prodigue pourvoyeur d’images, notamment pour le marketing politique . . . l’humour forme essentielle de la critique pour exprimer quelques vérités et surtout, le faire sans pesanteur . . . s’il est une idée liée de manière intrinsèque, quasi génétique , à la naissance de l’architecture dans la modernité, c’est bien celle-ci . . . à l’heure où l’orgie d’images numériques, vendeuses parce qu’hyperréalistes, qui a marqué le début du siècle, semble lasser, y compris ceux qui en vivent . . . dans un type de figuration peu usité à grande échelle, la coupe, est aussi une incitation à retendre les liens consubstantiels entre dessin et utopie . . .
analyse
point de vue
rencontre conférence carte blanche portrait album
compte rendu correspondance
Stéphanie Sonnette : Rendus d’architecture : les nouvelles icônes épinglées
Sam Jacob : Le dessin d’architecture après le numérique
Yves Bélorgey : Le peintre de la ville moderne
Françoise Fromonot : Éloge de la coupe, ou l’enseignement de Rotterdam
Gabriele Mastrigli : Ville abusive
Pierre Chabard : Fresh Classicism
Alexis Roy : Architectures communales
Jean-Baptiste Lestra : Profondeur de champ(s)
Lettre
L’une des images du rendu NP2F/OFFICE KGDVS pour le site Pitet-Curnonsky, Paris XVIIe, concours « Réinventer Paris », 2015.

L’esthétique 3D photoréaliste qui domine les rendus de concours depuis bientôt vingt ans est-elle à bout de souffle ? L’examen de quelques modes de représentation alternatifs, largement diffusés sur les réseaux de partage d’images, témoigne des enjeux qu’ils soulèvent pour les architectes et pour l’architecture.
Stéphanie Sonnette, juriste et urbaniste de formation, est membre de la rédaction de criticat
Stéphanie Sonnette
Rendus d’architecture : les nouvelles icônes épinglées
L’image est verticale, dans les tons pastel où dominent le blanc, le gris et le vert. Élévation autant que perspective, elle montre frontalement, dans un traitement graphique naïf, la façade d’un bâtiment hybride, mi-practice de golf, mi-immeuble de logements. Au premier plan, un carré de pelouse parsemé des petites balles que projettent, chacun depuis son tapis de putting, des golfeurs en tenue colorée répartis sur les trois premiers niveaux. Au-dessus, des appartements dont les baies vitrées parfaitement alignées ouvrent sur des balcons où apparaissent d’autres personnages, du linge qui sèche, un hamac et force plantes en pots, tandis qu’à l’arrière-plan les immeubles environnants recouverts d’une trame crayeuse se fondent dans les tonalités fades de l’image. Bien que le bâtiment soit seulement suggéré par des structures répétitives que figurent des lignes blanches, sans volume ni matérialité, sans reflet ni ombre, cette représentation exprime assez clairement, dans son traitement presque enfantin, ce que pourrait être le projet une fois réalisé.
L’image fait partie du rendu de l’équipe NP2F, jeune bureau parisien, associé à OFFICE KGDVS, un bureau belge un peu moins jeune, pour le site Pitet-Curnonsky dans le XVIIe arrondissement, et a été produite dans le cadre de « Réinventer Paris1 ». Un coup d’œil aux 358 autres projets exposés au Pavillon de l’Arsenal de février à mai 2016 suffit à mesurer ce qui la distingue des productions de la plupart des candidats qui se sont pliés à
l’exercice du rendu 3D chargé d’effets de lumière et de matière. En renonçant à livrer une vision consensuelle d’un avenir radieux, ce type d’image ouvre une brèche dans l’uniformité graphique qui prévaut dans le monde du rendu d’architecture depuis une vingtaine d’années. Faut-il pour autant y voir, par-delà le renouveau des outils de représentation, un changement de posture chez certains architectes, voire une évolution de l’architecture elle-même ?
Overdose numérique
Au début des années 1990, les techniques mixtes mêlant dessin, peinture, photographies trafiquées, collages, zips et usage intensif de la photocopieuse constituent encore l’essentiel des moyens à la disposition des architectes pour figurer leurs projets. L’apparition des logiciels de rendu et de retouche ouvre alors la voie à la fabrication de perspectives d’un nouveau genre, dont les architectes sous-traitent d’abord la réalisation à des officines spécialisées. Plus que tout autre peut-être, Jean Nouvel voit dans les images de synthèse un moyen de développer l’esthétique de la sensation qu’il revendique pour son architecture. Il travaille régulièrement avec Artefactory, une agence qui fixe en France, au début des années 2000, les standards de l’image hyperréaliste. Cette collaboration sans précédent trouve son aboutissement avec la rétrospective que le Centre Pompidou consacre en 2002 à l’architecte parisien. Ses projets y sont montrés à travers une profusion de renderings présentés comme autant de tableaux, au point qu’il est difficile pour le visiteur de savoir s’il s’agit de bâtiments réalisés ou de simulations. D’une manière générale, la multiplication des perspectives réalisées à l’ordinateur est le fait d’une nouvelle génération de persmen, issus parfois de l’univers du jeu vidéo, habiles à composer des mondes de plus en plus sophistiqués à partir des modèles en 3D construits par les architectes sur Autocad et quelques autres logiciels de dessin technique. Grâce à 3Ds Max, Maya ou Lightscapes, il leur est ensuite possible de produire des images de synthèse toujours plus spectaculaires, montrant des architectures vibrantes dans une aube blanche ou un crépuscule rougeoyant, entourées d’une végétation plus vraie que nature. Dans la mesure où matériel et logiciel coûtent encore très cher et où les spécialistes sont peu nombreux, la ligne « pers » rivalise alors dans le budget d’un concours avec les honoraires de l’ingénieur ou du paysagiste.
Progressivement, l’outil informatique, qui se plie à toutes les demandes des architectes, façonne également leurs projets. Le verre sérigraphié et le béton matricé s’imposent en façade, la végétation gagne les balcons et toitures, les bâtiments texturés se multiplient. La tentation est en effet
1. « Réinventer Paris » est un appel à projets urbains lancé par la Ville de Paris le 3 novembre 2014 sur 23 sites appartenant à la Ville ou à ses partenaires.
analyse
2. Le rendu du concours pour la place de la République, remporté en 2010 par le groupement mené par TVK Architectes Urbanistes, a été réalisé par Martin Étienne.
grande de conformer le projet d’une réalisation à venir aux possibilités de sa représentation, d’autant que les commanditaires publics et privés sont demandeurs de ces images idéalisées qui nourrissent le marketing urbain.
À mesure que son coût de production baisse, au milieu des années 2000, l’image de synthèse se démocratise puis se banalise. Les rendus s’uniformisent selon les types de projets et de clients, entre esthétique promotionnelle rassurante des concours de logements et visions futuristes dignes des productions hollywoodiennes à succès, calibrées pour les consultations internationales. Les images numériques envahissent le marché, indistinctes, jusqu’à l’overdose.
Dans ce contexte, les premières voix alternatives se font entendre, alors que la crise financière, économique et immobilière s’étend après 2008. La raréfaction de la commande laisse davantage d’espace à la réflexion, aux expérimentations et à la recherche, autant qu’elle attise la concurrence entre des agences qui doivent plus que jamais se distinguer tout en réduisant leurs dépenses. Celles-ci affirment ou redéfinissent leur positionnement, leur stratégie, leur identité en général, et leur identité graphique en particulier. Apparaissent de nouvelles esthétiques, issues d’autres techniques que celle du rendering 3D, traduisant des postures singulièrement différentes : didactique mâtinée d’opportunisme et de démagogie (les rendus illustrés à la main), pragmatique (le dessin comme outil de projet), théorique et critique (l’image icône illustrant des projets de papier) et artistique (quand l’image ne vaut plus que par elle-même).
L’architecture illustrée
En France, la résurrection du dessin à la main s’est d’abord manifestée à l’occasion de concours comme celui, très médiatisé, pour l’aménagement de la place de la République à Paris en 20102. La presse, notamment, a célébré un renouveau salvateur, une alternative bienvenue et rafraîchissante aux perspectives 3D. Réalisés par des architectes devenus dessinateurs et travaillant en free lance, ces dessins introduisent une représentation de l’architecture dans laquelle les détails, et surtout les matériaux utilisés et leur mise en œuvre, sont éludés. Ici, pas de texture et d’effet de transparence, mais des couleurs employées en aplat et avec parcimonie. Ce sont les usages qui sont mis en avant, souvent incarnés par les personnages au premier plan, mais aussi parfois le mode de construction des bâtiments, voire le montage des opérations. Ces dessins donnent également le sentiment qu’à travers eux, quelqu’un s’exprime, un auteur qui porte un regard particulier sur le projet et raconte une histoire. Tout les oppose aux images photoréalistes trop parfaites, déshumanisées, qui ne visent qu’à une séduction immédiate.
analyse
Si le rendu dessiné à la main permet d’abord à certains architectes de se distinguer, il donne aussi souvent à voir, grâce à un arsenal d’outils axonométries, éclatés, schémas ce que l’on ne montre pas d’habitude : les arrières, les intérieurs, les sous-sols, la tripaille… Il rompt avec l’obsession de faire vrai, pour mieux faire comprendre. Vertu communicante et surtout didactique des dessins qui, parce qu’ils rappellent les univers familiers de la bande dessinée ou de l’illustration enfantine, auraient vocation à expliquer l’architecture et l’urbanisme à tous, aux élus comme au grand public.
Ces rendus dessinés accompagnent ainsi l’évolution de la commande et des aspirations des maîtres d’ouvrage. Les nouvelles procédures du type « appels à projets3 » questionnent d’abord les candidats sur la programmation


3. « Réinventer Paris », « Réinventer la Seine », « Inventons la métropole du Grand Paris » en sont quelques exemples. Ces procédures de mise en concurrence d’opérateurs privés (groupements de promoteurs-concepteurs) par des personnes publiques échappent aux règles des marchés publics.
Illustration de Diane Berg pour l’agence Nadau Lavergne, concours de logements à Bordeaux, 2016. © Diane Berg
Illustration de Guillaume Ramillien pour l’agence Diener & Diener Architekten, concours pour la reconversion de l’entrepôt MacDonald, Paris XIXe, 2007. © Guillaume Ramillien
analyse
Vue aérienne dessinée par Martin Étienne pour l’agence TVK, dans le cadre du projet d’aménagement de la place de la République à Paris, 2011.

et les usages, deux registres que les schémas ou les croquis parviennent à exprimer avec simplicité. Plus abstrait que l’image de synthèse, le dessin convient également à l’incontournable concertation avec les habitants. Peu réaliste, il focalise l’attention sur les pratiques de l’espace et engage moins les maîtres d’œuvre et d’ouvrage quant à l’aspect final des bâtiments.
L’outil du praticien
4. Voir Pet Architecture Guide Book, World Photo Press, 2002, et Made in Tokyo: Guide Book, Kajima Institute Publishing, 2001.
Proches en apparence de ceux des professionnels du rendu à la main, les dessins produits par certains architectes dans le cadre de leur activité de conception en sont en réalité bien éloignés. Dans les années 2000, les architectes européens ont ainsi découvert l’Atelier Bow-Wow, agence japonaise dont la production graphique allait influencer durablement les modes de représentation de la ville et de l’architecture. D’une lecture un peu rapide de son travail, on pourrait ne retenir que l’esthétique épurée et séduisante des dessins au trait, vectoriels ou à main levée, en noir et blanc, et leur neutralité toute technique, filaire, d’une évidence implacable. Le graphisme n’a pourtant rien de cosmétique dans la démarche de l’atelier. Associé à des photographies et des plans de situation, le dessin est d’abord utilisé comme outil d’observation, de relevé et de restitution de scènes urbaines. Bow-Wow multiplie ainsi les axonométries de bâtiments autoconstruits dans les interstices des faubourgs résidentiels de Tokyo et les perspectives au trait d’architectures multiprogrammatiques4. À propos de cette approche, Momoyo Kajima, cofondatrice de l’agence, précise : « Je crois que cela fait partie du rôle de l’architecte de représenter et rendre visibles des situations

spécifiques. […] L’architecture est composée de différents phases et niveaux de détails, et de nombreuses relations. Nous souhaitons rendre compte de cette richesse dans nos dessins. Produire des images qui sont source de connaissance sur l’architecture.5 »
Créant ses propres standards de représentation, Bow-Wow propose un répertoire de formes et des codes graphiques simples que chacun semble être en mesure de se réapproprier. Les deux ouvrages montrant les projets de l’atelier6 ont révélé ses coupes perspectives horizontales et verticales si particulières, qui parviennent à articuler dans une même vision usages, architecture, paysage et contexte. Cette manière de représenter le projet, d’une apparente objectivité, dénuée de toute ornementation ou expression de sensibilité, amalgame dans un langage jusque-là réservé au détail technique des éléments qui vont bien au-delà, et réaffirme la portée de l’architecture dans tous les aspects de la vie.
S’inscrivant dans cette filiation, l’architecte Émilien Robin, invité en 2016 d’une rencontre au Centre Pompidou7, confiait utiliser le dessin comme un outil de dialogue avec l’ensemble des acteurs du projet. Lui-même fait un usage extensif du croquis à la main, pour relever le réel, concevoir des édifices et les représenter. Il développe un langage simple, au trait, le plus souvent en noir et blanc, qu’il utilise indifféremment pour un rendu ou un carnet de détails. Le graphisme, volontairement grand public afin de donner à comprendre les choses facilement, est néanmoins très précis. L’architecte déploie ainsi une palette de représentations variées, répondant chacune à un moment du projet et à un objectif clair, « sans jamais dissocier usages et
5. Entretien publié dans Créé nº 377, août–septembre 2016.
6. Voir Graphic Anatomy, Toto, 2007, et Graphic Anatomy 2, Toto, 2014.
7. Rencontre au Centre Pompidou le 30 novembre 2016 dans le cadre d’un cycle proposé par la revue criticat à l’invitation du service de la Parole : l’enquête, l’histoire, l’écriture, le dessin, quatre outils d’une critique d’architecture engagée.
analyse
8. Voir Émilien Robin, « L’imposture BIMBY », criticat nº 12, automne 2013, p. 82 – 103.
questions techniques ». Les coupes perspectives et les axonométries éclatées permettent de figer les prescriptions techniques, la matérialité et le mode constructif très tôt dans les études de maîtrise d’œuvre, en plus de montrer les volumes intérieurs, le rapport aux abords, aux voisins, et les possibilités d’usages. Les détails de construction sont pensés dès la conception parce qu’ils vont déterminer les coûts, la pérennité de l’ouvrage, l’énergie dépensée, tandis que les croquis de chantier servent à dialoguer avec les entreprises. Enfin, les relevés des usages, en révélant les pratiques existantes, peuvent amener à reconsidérer la commande8
Chez ces architectes qui font du dessin un instrument de perception, de conception et de représentation de la ville et de l’architecture, l’usage du médium est en phase avec leur démarche : attentive à l’existant, économe en moyens, consciente des données économiques, techniques, politiques des projets, critique aussi vis-à-vis de la production dominante. Les images, ostensiblement sans artifice et ne cédant pas aux facilités de la com, tentent d’exprimer la vérité du projet, son pragmatisme, sa faisabilité et ses possibilités d’usage. Elles parlent aux commanditaires, aux utilisateurs, aux entreprises. La pratique et la maîtrise du dessin montrent aussi la tentative de l’architecte de restaurer une proximité perdue avec les autres acteurs du projet, et peut-être une forme d’autorité intellectuelle, en signifiant qu’il sait tenir un crayon en réunion, sur le chantier, pour représenter un détail, préciser une intention.
Coupe perspective au stylo à encre d’Émilien Robin, concours de logements et crèche, Paris, Boidot & Robin architectes, 2015.

analyse

Le retour de l’architecture de papier
D’une autre façon, dans les cercles d’avant-garde, on assiste à l’apparition d’images que l’on aurait pu croire sorties des années 1970 et 1980. Celles-ci ont paradoxalement une certaine fraîcheur, d’autant qu’elles illustrent des postures théoriques aussi radicales que séduisantes pour une génération de jeunes architectes. Puisant dans le registre graphique du néoavant-gardisme et du postmodernisme, l’agence Dogma et l’un de ses fondateurs, Pier Vittorio Aureli9, ont ainsi fait du dessin à la main et des collages, de l’encre et du papier, leurs outils de représentation privilégiés. Leur iconographie cultive l’hermétisme, comme celle des générations précédentes dont l’héritage est revendiqué, de No-Stop City d’Archizoom au Monument continu de Superstudio, en passant par la série de dessins et collages Exodus, or the Voluntary Prisoners of Architecture de l’OMA. Ces images précieuses sont pensées moins comme des manifestes critiques que comme des œuvres destinées à finir au musée, montrées dans des biennales ou vendues dans des galeries. Les dessins à l’encre, au crayon graphite, au feutre, au pastel, et les collages sur papier du projet Stop City ont ainsi rejoint les œuvres postmodernes d’autres architectes confirmés dans la collection du Frac Centre qui, comme d’autres institutions fondées au tournant des années 1980 (CCA, DAM), a abondamment accueilli les productions de ce mouvement. Ce sont sans doute les collages des projets de la recherche Living/ Working10 qui influencent le plus l’esthétique graphique contemporaine. Moins radicales et plus pragmatiques que les visions autoritaires de leurs
A Simple Heart, Architecture on the Ruins of the PostFordist City, Atlas of a City, 25, Dogma. Encre, crayon graphite et collage sur papier, 2004, collection Frac Centre – Val de Loire.
9. Voir Pierre Chabard, « Utilitas, firmitas, austeritas », criticat nº 17, printemps 2016, p. 38 – 53
10. Living/Working, How to Live Together est une recherche menée par Dogma qui s’intéresse à l’espace domestique et à son potentiel de transformation. Elle repose sur l’idée que le logement pourrait être régi par une forme d’association coopérative entre les habitants, leur permettant de vivre ensemble et partager les espaces et les équipements servant aussi bien pour le logement que pour le travail.
analyse

The Continuous Monument: St. Moritz Revisited, projet, Superstudio. Collage, crayon de couleur et pastel gras sur carton, 1969, MoMA.
projets de papier, ces images d’intérieurs habités, composées symétriquement autour d’un point de fuite central, présentent dans leur cadre carré des espaces rationnels, génériques, non situés, faits d’éléments géométriques, carrés, cylindres, cubes. Les aplats de couleur façonnent un petit tableau mat et sans ombre, aux décors austères et fonctionnels, pauvres, peuplés de sacs-poubelles, serpillières, plantes vertes, éléments de chantier, tabourets et tables à tréteaux. Un habitat temporaire pour des nomades en transit qui ne transportent avec eux qu’un portable et quelques ustensiles de peu de valeur. Parfois des silhouettes, dans lesquelles on reconnaît par exemple un personnage d’un tableau de David Hockney, Booking a Picture on a Screen, s’encadrent dans une porte.
L’esthétique de ces saynètes rappelle les photomontages et les séries de photographies des jardins d’hiver de la tour Bois-le-Prêtre ou des bâtiments G, H, I à Bordeaux de Lacaton & Vassal : mêmes cadrages symétriques, même architecture de structure grise et translucide, trop vaste et trop froide (autoritaire ?), dans laquelle flottent des éléments de mobilier usuels et décalés plantes en pots, escabeaux, fauteuils vieux style… , que les nouveaux locataires positionnent comme ils peuvent dans le cadre, photographique et architectural, qui leur est proposé.
Stop City, Dogma. Encre, crayon graphite, feutre et collage sur papier, 2007, photographie : François Lauginie, collection Frac Centre – Val de Loire.

analyse
Exigeante, cultivée, volontiers absconse et élitiste, multipliant les références à l’histoire de l’art et de l’architecture, la production graphique de Dogma n’en est que plus attirante, notamment pour les jeunes architectes en quête de visions puissantes et originales.
Ces images chargées de signes déroutants, difficiles à appréhender en dehors des textes qui les accompagnent, sont massivement diffusées



Live Forever: The Return of the Factory, proposition pour une unité d’habitation de 1 600 habitants, Dogma, Biennale de Tallinn, 2013.
Like a Rolling Stone, proposition pour une pension de famille à Londres, Dogma avec Black Square, Biennale de Venise, 2016.
Tower and Plinth, proposition pour des logements abordables à Helsinki, Dogma, 2014.
analyse
Photomontage de la transformation d’un appartement de la tour Bois-le-Prêtre à Paris. © Druot, Lacaton & Vassal.

Jardin d’hiver et balcon, tour Bois-le-Prêtre à Paris, 2011. Photographie : Philippe Ruault.

11. « Everything architecture » à arc en rêve, en partenariat avec la AA School of Architecture de Londres et Bozar à Bruxelles (3 novembre 2016 – 2 avril 2017), « Drawings by OFFICE », Gta exhibitions à l’ETH Zurich (20 avril – 20 mai 2016), « Besides, History: Go Hasegawa, Kersten Geers, David Van Severen » au CCA (10 mai – 15 octobre 2017).
sur les réseaux d’images Instagram et Pinterest, mises en ligne par les passionnés qui constituent des albums thématiques, tout entiers consacrés à leurs maîtres.
Autres producteurs d’images alternatives, Kersten Geers et David Van Severen, d’OFFICE KGDVS, n’ont jamais succombé aux sirènes de la représentation 3D, ce qu’ils justifient par des raisons très pragmatiques (mais faut-il les croire ?). Incapables de maîtriser ces outils et de produire des renderings, ils ont dû inventer leur propre langage composé d’images-tableaux réalisées sous Photoshop, qu’ils utilisent avec succès dans leurs rendus et exposent comme des œuvres d’art11



Interrogés sur leur univers graphique12, ils évoquent une collection de références croisées, dont ils assument le caractère parfois contradictoire, issues de la Renaissance comme du Modernisme, de l’art moderne, contemporain, minimal, conceptuel, citant en vrac Bramante, Adolf Loos, John Baldessari, Sol LeWitt, Dan Graham, et surtout Hockney et Ruscha. À propos de David Hockney, Kersten Geers dit aimer « la façon dont [il] joue avec les perspectives, qui apparaissent toujours plutôt maladroites et sans profondeur, comme celles de la Renaissance. Des images très spatiales de manière contradictoire, tout en restant bidimensionnelles13 ».
Alors que les dessins de Dogma tournent en boucle dans le cercle fermé des initiés, ceux d’OFFICE se déploient aussi dans le monde de
Dar Al Jinaa et Dar Al Riffa, centres de musique traditionnelle à Muharraq (Bahrain), OFFICE KGDVS, 2016.
Le champ continu, concours pour le nouveau siège de la RTS à Lausanne (projet lauréat), OFFICE KGDVS, 2014.
12. Voir « How Brusselsbased OFFICE uses essential architectural elements to create its unique designs », https://archpaper.com /2017/02/brussels-based -office-profile/EVERYTHING ARCHITECTURE, février 2017.
13. Voir l’entretien de Kersten Geers avec Florian Heilmeyer : https://www .baunetz.de/talk/crystal /pdf/en/talk30.pdf, s. d.
analyse
la commande privée et publique. C’est, par exemple, avec des collages que le bureau a remporté le concours pour le siège de la RTS sur le campus de l’EPFL à Lausanne en 2014. Loin des rendus 3D, ces images ne visent à séduire ni les maîtres d’ouvrage, ni le public, mais sans aucun doute la petite communauté des architectes. Les vues en noir et blanc, relevées d’aplats colorés figurant les structures et les portiques, sont sévères. Les perspectives, complexes et foisonnantes, ne cherchent pas à faciliter la compréhension de l’observateur, pas plus que les surfaces tramées ne donnent d’indices sur la matérialité du bâtiment, ses lumières, ses ambiances.
D’Archigram à Instagram : l’image à l’heure des réseaux sociaux
L’exploration de Pinterest, l’un des réseaux sociaux sur lesquels s’échange l’iconographie à la mode, vient confirmer la circulation d’images d’architecture qui s’écartent des standards de la 3D photoréaliste. Issues des rendus les plus récents ou repêchées dans les archives, elles sont réunies par les utilisateurs en collections qui voient se côtoyer sans hiérarchie des diplômes d’étudiants, les dessins d’Aldo Rossi et de Peter Märkli, les collages d’OMA, de Dogma ou de NP2F. Dans ce catalogue de références en libre-service, les images défilent sans sous-texte et hors contexte, démocratiquement égalitaires, leur charge théorique et critique nivelée par Internet. Copiées, likées, épinglées, elles sont prises pour ce qu’elles sont : des représentations graphiques, détachées de leurs intentions comme de leurs destinations initiales, dans lesquelles chacun vient piocher pour reconstituer son patchwork personnel.
Dans le sillage de Dogma et OFFICE, une foule de followers se sont donc engouffrés. Sur les réseaux de partage d’images, dans les rendus de diplômes, on voit apparaître des images « à la manière de », édulcorées de toute posture idéologique ou simplement d’intentions précises : tableaux naïfs aux couleurs pastel, baignant dans des tons de gris rehaussés du vert des plantes en pots et des palmiers, petites scènes décoratives peuplées de figures étranges découpées dans des tableaux connus, dans lesquelles l’architecture n’apparaît pas de prime abord comme le sujet central. Un style est né.
Parmi les chefs de file de ces adeptes du collage référencé, Fala Atelier, jeune agence fondée en 2013 au Portugal, revendique une « architecture à la fois hédoniste et postmoderne, intuitive et rhétorique ». Alors que le bureau s’est essentiellement illustré par des projets privés de rénovation et d’aménagement intérieur type Airbnb dans le centre ancien de Porto, sa réputation a précédé son architecture. Ses collages, emplis de copies et de citations, sont des tableaux de format carré où l’on retrouve les personnages
analyse

de David Hockney : Peter (Peter Getting out of Nick’s Pool, 1967), ses vieux parents (My Parents, 1977) ou encore les jungles exubérantes du Douanier Rousseau. Conçus comme des outils de communication à diffuser généreusement sur les réseaux sociaux, ils valent aux architectes de Fala d’être régulièrement invités par des écoles, des institutions, des biennales (Chicago) et leur ouvrent les portes de quelques concours internationaux, notamment en Suisse. Les architectes précisent : « Nous sommes obsédés par le rôle de l’image dans la fabrication d’une architecture. Nous voyons toutes les productions du bureau, qu’il s’agisse de collages de préprojet, de photographies des réalisations, mais aussi les plans, les coupes, et même les textes, comme des éléments autonomes et dignes d’intérêt, tous au même niveau. Nous envisageons tout acte architectural comme un acte de curation. Notre site Internet est un outil réflectif, une espèce d’auto-musée en ligne, gratuit et ouvert jour et nuit.14 »
Fala fait partie d’une génération d’architectes qui déploient leur art dans d’autres espaces que celui de la ville et du territoire, en dehors de la commande traditionnelle. Point Supreme, Fosbury Architecture,
Maison privée à Porto (projet réalisé), Fala Atelier, 2017.
14. Voir « Fala dans une bulle », entretien avec Marc Frochaux, Tracés, https://www.espazium .ch/fala-dans-une-bulle, 12 octobre 2017.
analyse

Miniatura et d’autres exploitent les produits dérivés de leurs projets, réels ou plus souvent de papier, qu’ils exposent ou diffusent sur le Net, sur des plateformes dédiées. En quête peut-être de l’image manifeste, comme ont pu l’être les perspectives du Plan Voisin ou les aquarelles de New York Delire, ces architectes accordent à leurs œuvres une valeur pour elles-mêmes, au-delà du propos ou du projet qu’elles illustrent. Il n’est plus question d’architecture, d’usagers, de construction. Les images s’autonomisent et n’ont plus de comptes à rendre au réel.
Tous ces modes de représentation semblent traversés par une même volonté de réaffirmer la nécessité de l’architecture (ou de l’architecte ?) et de se réapproprier l’un de ses outils fondamentaux : le dessin. Mais alors que certains mettent cette volonté au service du projet, de la ville et de ses habitants, adoptant une posture modeste et pragmatique, d’autres cultivent une haute idée de la discipline, qui les conduit à consacrer plus d’énergie à produire des signes reconnaissables par la profession que des constructions. Ils se ménagent ainsi une échappatoire à la réalité, il est vrai parfois désespérante, de la commande. S.S.





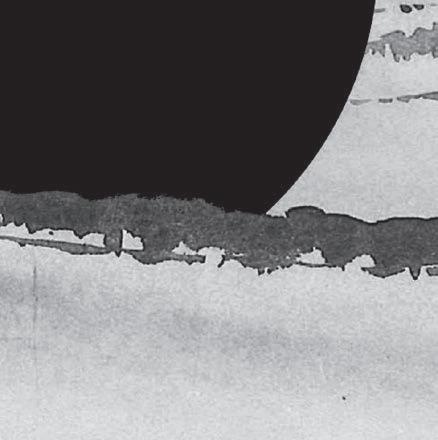
Coucher un projet sur le papier était autrefois l’un des actes fondamentaux de la conception architecturale. Depuis vingt ans, la culture du rendu informatique semble avoir tué le dessin. Et s’il retrouvait justement une nouvelle vie grâce à certains outils numériques ? C’est le pari d’un praticien nouvelle génération.
Le dessin d’architecture après le numérique
Dans les films d’horreur, c’est lorsqu’on croit le monstre mort qu’il revient pour clamer vengeance. La représentation architecturale ressemble aux histoires de zombies. Après des décennies d’absence, le dessin est de retour et il marque dans la culture architecturale un nouveau tournant de génération. Depuis le milieu des années 1990, c’est-à-dire au moment où les ordinateurs ont vraiment commencé à remplacer les planches à dessin, dessiner à la main était devenu de plus en plus anachronique. L’augmentation du pouvoir de calcul informatique encourageait la production de rendus numériques — les renderings — des visions léchées des projets à réaliser, où des bâtiments lustrés par les réfractions lumineuses trônaient sous un ciel bleu, au milieu d’une végétation luxuriante peuplée de groupes de personnages de dessin animé : les cartes postales d’un futur proche. En parallèle, le numérique poussait un autre type de dessin architectural dans une direction totalement différente. Les détails techniques se transformaient en « information de la construction », servie par des dessins obsédés par un « réalisme » d’un autre genre, non plus visuel cette fois, mais branché sur les systèmes et les protocoles de l’industrie.
Images réalité Jusqu’à présent, la culture numérique a distingué deux catégories de représentation, technique et illustrative, l’information constructive et
le ticket gagnant. Dans le processus, le rôle exploratoire du dessin s’est réduit. Par une ironie du pouvoir de calcul colossal mis à notre disposition par les suites logicielles, même les plus rudimentaires, le dessin en tant que tel a été dévoré par les outils que nous avons choisi d’utiliser. Les logiciels supersophistiqués de modélisation et de rendu ont réduit le champ d’action du dessin d’architecture, tout en augmentant exponentiellement sa précision. Ces applications piègent autant le dessin que la manière dont nous dessinons. Leur appareillage de commandes préprogrammées nous installe dans une idée prédéterminée de l’espace plutôt que dans l’ambiguïté féconde des possibles à construire. Dessiner devient un acte cartésien. Parce que les rendus adoptent le langage de la photographie au point que les logiciels les plus avancés permettent de concevoir une simulation numérique de l’appareil photo —, ils nous présentent une image apparemment « réelle » du monde. Et c’est justement cette idée de la réalité comme fait accompli que le retour du dessin semble bousculer.
Dans la grande tradition de l’architecture, c’était le dessin qui inventait l’espace de la page. Cela aura été vrai jusqu’aux années 1970 et 1980 et leurs architectures de papier : celle de Libeskind avant qu’il ne tourne commercial, de l’OMA à ses débuts, de Zaha Hadid dans son époque prénumérique, et de bien d’autres encore. À l’époque, le dessin était inséparable de la constitution de l’architecture comme discipline. Les dessins n’étaient pas des dessins d’architecture, ils étaient l’architecture. L’espace graphique y était compris au sens propre. Il s’inscrivait dans le temps long d’un lignage qui remontait bien avant les expérimentations de la génération précédente (Archigram, Superstudio, Archizoom, et al.) et renouait avec Ledoux, Gandy, Piranèse et tant d’autres, jusqu’au cœur même de l’architecture.
Quand ces architectes de papier se sont mis à construire, le dessin a peu à peu perdu de son importance à leurs yeux c’est une interprétation qu’en donne l’histoire récente de l’architecture. Avec l’essor de la technologie, le dessin en tant qu’acte architectural signifiant a perdu de son lustre au profit d’un rôle plus utilitaire lié à la communication.
Image matériau
Alors que le dessin d’architecture semblait voué à ne plus appartenir qu’à l’histoire, une autre génération puisait dans son anachronisme la possibilité d’une alternative. Chez FAT, l’agence que j’ai codirigée de 1995 à 2014, nous étions attirés par un ensemble d’outils numériques très différents de ceux qui promeuvent l’extrémisme de la 3D à tout prix. Pour nous, les logiciels Illustrator et Photoshop (ou plus précisément Macromedia Freehand, la version antérieure et inégalée d’Illustrator) rendaient possible une tout
point de vue

autre ligne : imaginer l’architecture en la dessinant. Les supercollages permis par Photoshop, l’aplatissement extrême des surfaces suggéré par Illustrator jetaient les bases d’un autre discours visuel, laissant entrevoir d’autres types d’espaces numériques, d’autres formes de qualité graphique, d’autres jeux de propositions architecturales.
Photoshop permet d’opérer à l’intérieur des images, et donc d’entretenir avec elles une relation très particulière. Cette relation a été fondamentalement modifiée par la culture numérique, principalement via Google Images. Photoshop permet d’intervenir dans l’univers iconographique qui nous entoure en y prélevant de l’information et en la recomposant suivant d’autres intentions. Autrefois, ce genre de découpages et de juxtapositions s’appelait des collages. Aujourd’hui, on peut avec ce logiciel explorer les images comme le ferait un médecin légiste, extraire, masquer, faire disparaître les raccords. Cette souplesse et cette absence d’aspérités offrent une palette de mélanges et d’amalgames infiniment nuancée. Plutôt qu’un objet constitué de fragments, on obtient un tout autre graphique indivisible, dont les éléments sont fondus les uns aux autres.
point de vue









































Illustrator, logiciel cousin de Photoshop, a été conçu comme une sorte de palette numérique. L’espace d’Illustrator suggère à la fois l’idée de surface et celle de stratification, tout en mettant l’accent sur les contours graphiques. Dans ce type d’espace numérique, les morceaux choisis se superposent les uns aux autres comme les pendants d’un décor de théâtre. En réalité, nous nous déplaçons avec fluidité entre ces différents types d’environnement en copiant, en collant et en disposant ce que nous en prélevons de manière à produire des collages de sens autant que de techniques.
La fabrication d’un dessin numérique un tant soit peu sophistiqué requiert des sources multiples ; il combine plusieurs techniques et des logiciels différents. La modélisation, le rendu, le dessin au trait, les fragments d’images trouvées sont assemblés en une seule entité continue. Le dessin apparaît sur l’écran où tout est fluidité : combinaisons à l’infini, élasticité, thixotropie et planéité à la fois. En naviguant de haut en bas, de droite à gauche, en zoomant et dézoomant, nous inventons de fait le dessin et son espace qui, par-delà la surface brillante de l’écran, constitue un univers alternatif.
point de vue
Elnaz Rafati, University of Illinois at Chicago, School of Architecture.
Si le retour du dessin d’architecture à l’âge du numérique redonne vie à la tradition graphique de l’architecture, les techniques, les outils et les supports de diffusion en font quelque chose de fondamentalement neuf. Techniquement et conceptuellement, un écran est bien différent d’une feuille de papier. Dérouler un calque sur sa table à dessin signifiait construire un espace bien distinct du monde : fixé par du ruban adhésif aux angles, le métrage de rouleau bien tendu sur la table, sa surface prête à recevoir l’encre stockée dans le barillet métallique du Rapidographe, laquelle serait grattée à la lame de rasoir en cas d’erreur.
À l’inverse, l’écran est intimement connecté au monde qui l’anime. Il est l’interface entre le monde, ou du moins une partie du monde, et nous. Ces dessins numériques que nous élaborons, nous en sommes aussi les spectateurs. En dessinant, on observe le dessin qui émerge, on le consomme autant qu’on le crée. Le site originel du dessin n’est jamais vraiment vide. Il est connecté aux flux des réseaux, c’est une surface qui peut se disperser ou entrer en éruption, devenir fuyante et intranquille, se recombiner ou fusionner, le sens et les associations entre les images y entrent en mouvement constant.
Images fiction
Avec cette résurrection récente du dessin, et du fait de cette proximité entre le dessin numérique et un nombre infini de références, de téléchargements et de flux d’images, ce ne sont pas seulement des fragments































































point de vue
iconographiques que nous voyons recomposés, mais aussi la structure du dessin lui-même. On pense par exemple aux évocations picturales de Point Supreme ou Fala Atelier, aux collages d’OFFICE KGVDS, dont les alternances de planéité et de profondeurs rappellent les constructions de Ruscha et de Hockney, ou aux délinéations nettes de Dogma et leurs résonances avec la précision des rationalistes. Au lieu de rechercher un pseudo-photoréalisme, le nouveau culte du dessin explore et exploite son artificialité. Il donne conscience au spectateur du caractère fictionnel des espaces qu’il regarde, en contraste total avec le désir que portent les rendus numériques : faire paraître la fiction « réelle ».
Le potentiel de la représentation postnumérique a été un secteur clé de recherche pour toute une série de studios que j’ai dirigés dans les écoles de l’Architectural Association de Londres, à Yale et à l’université d’Illinois à Chicago. Avec les étudiants, nous avons travaillé en lien direct avec des dessins d’architecture canoniques appartenant à un vaste corpus historique. Nous avons pris pour références Piranèse, Boullée, Mies, Stirling, Hejduk, Hadid et autres, en fonction de l’idée particulière que chacun d’eux se faisait de l’espace dessiné, de ses différentes techniques et représentations. Notre intention était de les explorer, de les décomposer et de les recomposer

point de vue
Andrew Jennings, University of Illinois at Chicago, School of Architecture.
Cet article a été publié le 21 mars 2017 sur le site Metropolismag sous le titre « Architecture Enters the Age of Post-Digital Drawing ».

en utilisant des outils numériques. Ce faisant, nous avons découvert de nouvelles formes d’hybridation entre la projection dessinée et l’espace de papier. Les techniques numériques permettent de produire des choses difficilement catégorisables, parce qu’elles sont à la fois numériques et faites main, rendues et gravées, pour partie peintures et pour partie collages. Curieusement, le numérique permet l’investigation intense des qualités graphiques spécifiques d’une représentation.
Nous avons cherché à développer une approche postnumérique de ce que le dessin pourrait signifier ou faire pour l’architecture. Nous voulions le restaurer comme une manière de construire le monde plutôt qu’une simple fenêtre sur le monde, un site premier où l’idée architecturale pourrait se mettre en scène. Ces réanimations numériques du dessin d’architecture ont abouti à des assemblages dignes de Frankenstein, des représentations qui mobilisaient, pour les mélanger, des techniques et des supports de plus en plus variés, et qui interrogeaient l’idée d’espace et celle d’auteur. Dit autrement, une forme numérique vivante de dessin d’architecture, revenu à nous enrichi, plus fort et plus provocant que jamais. S.J.
point de vue
Jacob :
 Yves Bélorgey dans son atelier à Montreuil. Photo : Martin Étienne.
Yves Bélorgey dans son atelier à Montreuil. Photo : Martin Étienne.
Depuis vingt-cinq ans, l’artiste Yves Bélorgey peint dans de très grands formats, avec ce qu’on pourrait appeler un certain réalisme, des immeubles d’habitation modernistes.
La rédaction de criticat est allée à sa rencontre, l’interroger sur ce sujet unique qu’il s’est choisi, son rapport à la photographie et les enjeux qu’implique la représentation de la ville contemporaine pour la peinture.
Yves Bélorgey est peintre (représenté par la galerie Xippas).
Il enseigne le dessin à l’ENsA Paris-Malaquais.
Entretien avec Yves Bélorgey Le peintre de la ville moderne
Criticat : Vous nous accueillez aujourd’hui dans votre atelier de Montreuil. Pouvez-vous nous le décrire, nous parler des œuvres qui nous entourent ?
Yves Bélorgey : Il y a de nombreux tableaux et des dessins accrochés aux murs, tous à peu près d’un même format, un carré de 240 centimètres de côté. Les dessins réalisés au graphite ne sont pas des études, ni des esquisses ou des projets de peintures, mais des œuvres à part entière. Je n’établis aucune hiérarchie entre ces deux médiums. Un peu partout dans l’atelier on trouve aussi des photographies, ou plutôt des photomontages épinglés à côté des tableaux et dessins. Ces miniatures sont des documents de travail, des enregistrements de choses vues dans des rues, dans des villes, autour de bâtiments et dans des appartements. Je travaille en ce moment sur trois tableaux montrant des intérieurs de l’immeuble des jardins Neppert conçu par Lacaton & Vassal à Mulhouse.
La plupart des peintures et dessins que l’on peut voir ici construisent des ensembles documentaires, sur l’œuvre d’un architecte par exemple Lucien Kroll , sur une rue comme celle des Pyrénées à Paris, sur une ville. Il y a là un dessin en cours d’un grand ensemble de Cologne, Chorweiler, qui est lié à deux autres dessins terminés et accrochés à l’entrée de l’atelier.
La différence entre les tableaux et les dessins est évidente : les premiers sont faits de matières colorées, alors que les seconds sont en noir et blanc. Les tableaux requièrent du spectateur un lent processus d’assimilation,
Bélorgey : Le peintre de la ville moderne
alors que les dessins ont un caractère plus photographique du fait de la réduction des données à percevoir, et se laissent ainsi plus immédiatement saisir. Je travaille simultanément sur plusieurs représentations d’un même lieu ou édifice, à partir de différents points de vue. J’essaie d’être précis et fidèle, comme si je peignais en répondant à une commande.
Vous représentez donc exclusivement des immeubles d’habitation modernistes, pour beaucoup construits dans les années 1960, 1970 et 1980. Pourquoi ce sujet ?
En 1992, j’ai exposé plusieurs tableaux à la villa Arson à Nice. L’un montrait une carrière, un autre une centrale électrique, un troisième une montagne, etc. Tous ces sujets étaient très emblématiques pour un peintre, mais je me suis dit que le monde ne se résumait pas à cela. Peu après, j’ai fait mon premier tableau d’immeuble, en l’occurrence celui dans lequel j’ai habité pendant mon enfance, dans la banlieue de Lyon, et où vivaient toujours des gens de la classe moyenne. Il avait été construit en béton armé en 1959, était mal isolé mais bénéficiait d’un grand jardin. J’ai trouvé là un sujet qui me donnait assez de force et une bonne raison de peindre, à savoir représenter la ville moderne que la plupart des gens n’aimaient pas, à une époque où paradoxalement on célébrait plus que jamais l’art moderne.
Mes tableaux suivants montraient peu de choses : des barres et des tours, que je représentais en perspective. Ils étaient encore trop simplistes, mais déjà mieux documentés puisque je m’appuyais désormais sur des photographies. Ils pouvaient faire penser aux dessins constructivistes d’Ivan Leonidov, à ceux de Ludwig Hilberseimer. Je suis d’ailleurs allé à Moscou comme à Chicago. Un peu plus tard, j’ai peint le grand ensemble brutaliste de Glasgow,
Red Road Court. À chaque fois, je ne représentais que les façades, des grilles, les ascenseurs, des fenêtres toujours identiques. Ce faisant, tous ces tableaux pouvaient être perçus comme participant à un rejet des grands ensembles d’habitat moderniste, lequel était et est encore courant dans le milieu de l’art contemporain.
Votre travail a néanmoins rapidement pris une autre tournure. Il est devenu manifeste d’une certaine empathie pour ces immeubles construits pendant les Trente Glorieuses… La plupart des artistes prétendent être moins compromis que les architectes qui travaillent pour l’État ou des promoteurs. Ils revendiquent la transgression des normes sociales, se veulent pseudo-critiques, même si bien sûr le marché fait son miel de la douce ironie qu’ils aiment afficher depuis l’époque du Pop Art. Les artistes d’aujourd’hui comme la plupart des gens d’ailleurs envisagent ainsi le plus souvent l’architecture moderniste avec distance, voire défiance.
Pour ma part, je n’ai jamais voulu suivre cette voie, et il se trouve que j’étais touché et intéressé par ces immeubles. Je me suis rapidement dit qu’il était impossible de les montrer de manière réductrice. Des gens les habitent, ils ont une histoire. Il y a là un problème à résoudre pour un artiste. Comment pouvais-je, avec les moyens de la peinture, traduire cette vie sociale sans la simplifier ?
Vos tableaux pourraient être qualifiés de réalistes. Comment vous positionnez-vous alors vis-à-vis des photographes qui ont fait de la ville moderne leur sujet de prédilection ?
Depuis une dizaine d’années, Eugène Atget est mon artiste préféré. Cela peut sembler paradoxal au vu de ce qui nous sépare sur la forme. Son
rencontre

Jardins Neppert
Architectes : Lacaton & Vassal Mulhouse, France
Janvier 2018
Graphite sur papier 240 × 240 cm
Bélorgey : Le peintre de la ville moderne rencontre

Wohnpark Alt-Erlaa
Architecte : Harry Glück
Vienne, Autriche
Octobre 2017 – février 2018
Huile sur toile en couleur 243 × 243 cm
rencontre
œuvre tient sur des plaques en verre de petite taille et ses clichés sont en noir et blanc, tandis que je peins de grands tableaux colorés. En fait, c’est son projet de collectionner l’identité parisienne alors en pleine transformation qui m’a intéressé. Il n’a pas photographié les chantiers de l’haussmannisation ou les monuments comme les gares ou la tour Eiffel, mais les petits commerces et les immeubles ordinaires. Il savait voir et surtout sélectionner. C’est ce qui rend son travail sur le détail si important. Ses clichés attestent d’une critique de son temps qui n’est pas sans lien avec la montée du socialisme. Comme Camille Pissarro ou Georges Seurat, il avait de l’empathie pour ses sujets et il documentait avec soin la ville de son époque sans chercher à se justifier.
Ce que je reproche beaucoup aux photographes contemporains, c’est de ne plus savoir dans quel format ils travaillent. Ils semblent tributaires des machines de reproduction comme du marché de l’art qui décide pour eux. Les
tirages luxueux de Thomas Ruff, de Margherita Spiluttini ou d’Andreas Gursky m’agacent, car ils esthétisent et dramatisent leurs sujets. La célèbre photographie que Gursky a prise de la grande barre d’habitation conçue par l’architecte Jean Dubuisson et située en surplomb de la gare Montparnasse est bien trop homogène, tous les détails ont disparu, il ne reste plus qu’une structure, un motif. C’est lisse, même si c’est spectaculaire.
Dans mes tableaux, les rapports d’échelle et les proportions sont essentiels. Atget faisait exactement cela. Il capturait un maximum de choses sur ses plaques photographiques, choisissant les détails qu’il voulait mettre en avant, établissant ainsi l’ensemble des rapports au sein de l’image. Les intérieurs qu’il a photographiés sont foisonnants. On découvre des habitations confinées, petites-bourgeoises, qui
nous renseignent sur la vie à Paris au début du XXe siècle.
Depuis quelques années vous peignez de plus en plus d’intérieurs, lesquels sont comme pris sur le vif, comme si les habitants venaient tout juste d’en sortir. Est-ce un moyen d’enrichir l’expérience qu’on peut faire de l’architecture moderniste ? Avant, je ne voulais pas représenter d’intérieurs, car je considérais qu’un artiste n’est pas de facto habilité à entrer chez les gens. Pour peindre les immeubles, je circulais dans l’espace public et cela suffisait à mon travail documentaire. J’ai changé d’approche à l’occasion d’une exposition en 2011 à Genève. J’avais fait des tableaux du grand ensemble des Avanchets, où vivent plus de 5 000 personnes. Dans le cadre de la médiation organisée par le musée d’Art moderne et contemporain (Mamco), des habitants m’ont demandé d’exposer les tableaux sur place, dans un local. J’ai accepté et j’ai proposé de faire des dessins des intérieurs. Puisqu’ils m’invitaient, nous étions de fait en relation et je me sentais autorisé à visiter les appartements. J’ai donc réalisé plusieurs dessins et j’ai compris qu’il y avait là un enjeu pour ma peinture que je ne pouvais éluder.
Quand on prend des photos à l’intérieur d’un logement, on ne parvient pas à établir de rapport avec l’extérieur. C’est trop lumineux dehors, trop sombre dedans, il y a des problèmes de temps de pose. En revanche, nos yeux, eux, font la mise au point, accommodent en permanence. Peindre me permet de retrouver un juste équilibre entre ce qui est sous-exposé et surexposé, et de créer un continuum entre intérieur et extérieur. Lorsque je fais un tableau, j’arrange les choses pour donner la sensation la plus proche de l’expérience que j’ai eue de l’endroit. En recomposant la scène, je suis dans la fiction, c’est certain, même si je ne m’éloigne jamais beaucoup de la réalité.

Kolumba Haus
Architecte : Willem Koep
Glockengasse 2
Cologne, Allemagne
Mars 2018
Graphite sur papier 240 × 240 cm
rencontre

Stadttor am Chlodwigplatz
Cologne, Allemagne
Janvier 2018
Graphite sur papier 240 × 240 cm
Bélorgey :
Les photographies que j’utilise à l’atelier me permettent de me rappeler les détails. Elles sont des documents objectifs, des preuves, alors que mes dessins et mes peintures représentent des choses qui pourraient ne pas exister.
Au fil des années, vos tableaux d’intérieurs comme d’extérieurs se sont enrichis de beaucoup d’éléments. Par-delà votre tentative d’inventaire des constructions modernistes, qu’essayez-vous désormais de capter ?
Il y a dans mon travail une évolution dans laquelle les dessins ont joué un rôle important. Ils m’ont permis de regarder les bâtiments avec frontalité, de me rapprocher. Les entrées d’immeuble sont devenues un sujet récurrent. Au gré de mes voyages à Varsovie, à Caracas ou au Mirail à Toulouse, j’ai ajouté de plus en plus de matière et de détails, qui me permettent de résister aux effets décoratifs et à l’homogénéisation. Au Mexique, j’ai commencé à intégrer la végétation qui prolifère, et puis la vie à travers les interventions des habitants. J’ai représenté la manière dont ils modifient les bâtiments modernistes jusqu’à produire une sorte d’architecture vernaculaire. Ensuite, je me suis intéressé non seulement aux immeubles de banlieue anonymes, mais aussi à ceux conçus par des architectes comme Renée Gailhoustet et Jean Renaudie en France, ou Ralph Erskine en Angleterre et en Suède. Et puis il y a eu mon travail sur Lucien Kroll, qui est peut-être ce que j’ai fait de mieux jusqu’à présent. Lucien est d’ailleurs venu à mon atelier et c’était intéressant de le voir réagir face aux tableaux, lui qui est habitué à contrôler la représentation des immeubles qu’il conçoit.
Diriez-vous qu’il y a une évolution des sujets qui donne un sens particulier à votre travail ? D’abord, l’immeuble où vous avez vécu dans votre enfance, puis les architectures du même acabit, puis
celles sur lesquelles les habitants interviennent, puis celles dont les auteurs ont réfléchi à ces modifications… Mon travail est effectivement à la fois autobiographique, critique et outil de connaissance. Intégrer la vie est devenu un enjeu majeur pour moi, comme cela l’est certainement pour les architectes. De ce point de vue, les tableaux d’Hubert Robert ont été un autre point de départ de mon travail, notamment les quatre qui sont au Louvre et qui ont pour sujet les monuments du Sud de la France. Je m’intéresse chez ce peintre aux ruines qu’il représente dans la mesure où elles sont intégrées à la vie quotidienne et sont habitées. On voit entre autres des gens creuser la terre, des archéologues. La surface est éclatée. À un moment, j’ai pris pour modèle cet espace pictural, plein de temporalité et d’histoire, et je me suis mis à représenter l’immeuble de logements moderne comme un monument habité et transformé.
Dans vos dessins et peintures, on ne voit pas les habitants. N’est-ce pas paradoxal pour qui veut saisir la vie dans ces immeubles ?
En fait, il y a toujours eu des traces de leur passage dans mes tableaux. Plus récemment, certaines figures humaines apparaissent indirectement dans les vues d’intérieur. Ce que je recherche depuis le début, c’est à m’adresser aux spectateurs comme habitants, ou du moins à la partie habitante qui existe en chacun d’entre eux. Dans mes expositions, les tableaux font faire au public un retour sur lui-même quant à l’endroit où il vit, comme dans un travail de réparation, au sens où en parlent les psychanalystes. Lors de ma première exposition à Saint-Priest, dans la banlieue de Lyon, les jeunes regardaient les tableaux que j’avais faits d’immeubles de Varsovie et de Moscou et s’enthousiasmaient, car quelqu’un faisait des images de chez eux. Ils s’appropriaient les tableaux,
rencontre

Im Stadt Garten
Cologne, Allemagne Février 2018
Graphite sur papier 240 × 240 cm
rencontre
Bélorgey : Le peintre de la ville moderne

Stammheimer Straße, 69
Cologne Riehl, Allemagne
Novembre – décembre 2017
Graphite sur papier 240 × 240 cm
rencontre

Brabanter straße, 55 Cologne, Allemagne
Janvier 2018
Graphite sur papier 240 × 240 cm
Bélorgey : Le peintre de la ville moderne rencontre

Tour Boucry
Intérieur chez A. B.
Paris XVIIIe, France
Juillet – août 2017
Huile sur toile en couleur 240 × 240 cm
rencontre
même si ceux-ci montraient des scènes lointaines. Leur imaginaire avait pris, et c’est cela que je recherchais.
C’est parce que je doutais du fait que les expositions d’art contemporain puissent intéresser le grand public que j’ai choisi de faire des peintures de la ville et de l’architecture moderniste de mon temps. Au musée, la plupart des gens vont faire leur prière devant Picasso ou Matisse, les maîtres de l’art institutionnel, et quand il s’agit d’architecture, ils ne s’intéressent qu’aux chefs-d’œuvre et aux monuments, à ceux de Frank Gehry dont les maquettes me font penser aux compositions de Frank Stella. Ce qui manque dans les musées, c’est la ville contemporaine dans toutes ses dimensions, notamment ordinaires, la banlieue qu’on ne veut pas trop regarder et dont on ne sait plus vraiment quoi faire. Voilà pour moi une bonne raison de peindre mais après, toute la question est de savoir comment.
Le choix de votre sujet, l’architecture moderne, ordinaire ou non, a-t-il transformé votre manière de peindre ?
Chaque tableau est pour moi l’occasion de faire la synthèse entre un travail documentaire et une réflexion propre à la logique de la peinture. Mes tableaux des bâtiments de Lucien Kroll combinent des couleurs analogues ou locales avec des couleurs non analogues, qui ne sont pas là dans la réalité. La couleur est atmosphérique et en cela je me réapproprie de plus en plus délibérément
les techniques des impressionnistes, qui ont cassé quelque chose dans le continuum du clair-obscur, qui peignaient sur le vif ou donnaient l’impression de l’avoir fait.
J’appartiens à une génération qui a commencé à travailler dans les années 1980, influencée par l’expressionnisme abstrait d’artistes américains comme Barnett Newman, Jackson Pollock et quelques autres. En France, la plupart des artistes comme ceux de BPMT (D. Buren, O. Mosset, M. Parmentier et N. Toroni) et Support/Surface avaient, eux, adopté une posture plus ou moins conceptuelle. De fait, il m’a semblé que le travail de la peinture et du dessin ne pouvait être simplement mis de côté, et c’est ainsi que j’ai renoué avec la fabrication d’images.
Le grand format que j’ai choisi, par opposition à la peinture de chevalet, la récurrence des œuvres dans l’espace d’exposition, leur forte présence physique, voilà ce que j’ai conservé de l’art minimal. J’ai voulu faire rentrer dans ces mécanismes critiques une peinture qui représente ou décrit le monde, et qui le sert. Pour ce faire, j’ai dû restreindre mon champ d’opération à un sujet en particulier, l’immeuble d’habitation moderne dans sa diversité. Il est certain que pour moi, tout revient néanmoins à un problème de peinture, lequel est progressivement devenu un problème de dessin et de rapport de celui-ci à la photographie.
Propos recueillis par Valéry Didelon le 19 décembre 2017.
Détail d’une coupe territoriale sur le port de Rotterdam (Ruptured Landscapes, Teresa Klestorfer, Martin Denk, Georg Willheim).

Le grand classique de l’urbanisme qu’est le plan de ville peut-il encore prétendre résumer à lui seul la condition urbaine ?
Et continuer d’être l’outil essentiel, voire exclusif, des stratégies de sa transformation ?
Ce retour sur une expérience pédagogique menée il y a dix ans sur le port de Rotterdam suggère de renverser les modes de représentation des territoires urbanisés.
Françoise Fromonot, membre de la rédaction de criticat, enseigne à l’ENsA Paris-Belleville.
Françoise Fromonot
Éloge de la coupe, ou
l’enseignement de Rotterdam
Entre les trois variétés de dessin géométral qui font depuis des siècles l’outillage des architectes le plan, la coupe et la façade , le premier a toujours été privilégié par rapport aux deux autres. Parce qu’il permet de penser et de voir dans son ensemble le parti distributif d’un programme à un niveau donné et d’en équilibrer la composition, le plan est à la fois le garant et le dépositaire de l’intention architecturale. La coupe, pour sa part, fait apparaître en volume les effets de la superposition des plans ; elle expose la morphologie gravitaire et la logique constructive de l’édifice : son anatomie. Quant à la façade, elle présente son apparence extérieure, résultat du croisement de ces deux registres avec l’autonomie relative de sa composition verticale : son aspect. Aujourd’hui encore, dans les écoles comme dans les agences, le mode de projection qu’est le plan figure en tête des moyens de conception et de représentation d’un bâtiment, en phase avec les priorités qu’assigne à ces derniers tout un héritage disciplinaire. Plan, coupe, façade sont tous trois des vues idéales qui procèdent du rabattement orthogonal sur un … plan, en deux dimensions, d’un objet envisagé depuis un point de vue infini. Si on parle à ce propos de plan de coupe, c’est que tous trois sont aussi, et peut-être d’abord, des coupes : à l’horizontale et à un mètre du sol, dans la convention du plan ; hors intérieurs et en élévation, pour la façade. Pour concevoir l’objet tridimensionnel cohérent qu’est un bâtiment, le projet architectural

comme le relevé traitent et pensent ces trois représentations géométrales dans leur logique propre mais aussi à leur rencontre, dans leur accord. Traditionnellement, c’est au confluent des valeurs que le plan, la coupe et la façade incarnent respectivement dans la trilogie vitruvienne commodité pour le premier, solidité pour la deuxième, beauté pour la troisième , que surgit l’Architecture.
Si l’on considère maintenant l’extension à la pensée urbaine de ces représentations architecturales canoniques, la prépondérance du plan devient presque exclusive. S’agissant de l’étude des villes et de leur histoire, cette suprématie s’explique entre autres par l’importance de la propriété foncière, déterminante pour le développement urbain, qui inscrit au sol l’économie immobilière enregistrée par les cadastres. S’agissant des entreprises destinées à transformer la ville, la domination du plan tient d’abord aux origines d’une discipline, l’urbanisme, qui s’est attachée dès sa naissance à fixer des tracés, à répartir des activités puis des fonctions, bref à planifier en gelant dans un dessin global une vision organisatrice procédant de haut en bas.
Anomalies fertiles
La pensée et la représentation urbaines ne se cantonnent pourtant pas à produire des plans. Elles intègrent aussi des déroulés de façades, tant la venustas peut contribuer à l’urbanité. Les élévations de rues ne manquent pas dans les projets d’embellissement des XVIIe et XVIIIe siècles,
conférence
jusqu’aux opérations contemporaines qui prétendent s’apparenter à elles.
Les documents officiels de l’opération Paris Rive Gauche comprennent ainsi une élévation de synthèse des îlots sur la Seine, dressée sur plusieurs centaines de mètres comme un instrument de communication a posteriori
Au registre de l’ironie, il y a aussi un fameux collage de la bordée d’enseignes du Strip de Las Vegas, une idée de la fin des années soixante empruntée par Venturi & Scott Brown à l’artiste pop Ed Ruscha. Mais les exemples restent rares.
Quant à la coupe à grande échelle, on en trouve sans doute encore moins d’occurrences dans l’histoire, et surtout la théorie de l’urbanisme. La principale et la plus ancienne est toujours mise en avant : la Valley Section publiée par Patrick Geddes en 1923. C’est une sorte de manifeste. Sur le profil d’une vallée type, elle figure l’étagement géographique qui détermine, entre la mer et les collines, les activités agraires, pastorales puis forestières, avec leurs outils. Trente ans plus tard, l’idée fut reprise par les Smithson, cette fois pour exprimer la diversité des modes d’agglomération urbaine et les intensités d’« associations humaines » favorisées par cette corrélation. Ce serait ensuite l’urbanisme de coursives ou de dalle qui, sur des prémisses inverses, produirait les coupes les plus spectaculaires : celle du Front de Seine à Paris, par exemple, traduction spatiale du principe de discrimination verticale des fonctions et des flux ; ou une tout aussi remarquable vue perspective tranchée du Barbican Centre de Londres, qui détaille l’imbrication des programmes culturels et des rues intérieures de ce complexe au point que l’on pourrait presque s’y promener un clin d’œil peut-être à la fabuleuse City of the Future dessinée un demi-siècle plus tôt par Harvey Wiley Corbett. Parmi ceux qui ont poursuivi en l’infléchissant cette voie de l’urbanisme architectural, il n’y a guère que l’OMA pour avoir cherché, dans les années quatre-vingt à Euralille, à tester le « potentiel métropolitain » de la mise en connexion verticale entre des couches de programmes, et à la dessiner. Au même moment, en phase avec la pensée « compositionnelle » que le plan

conférence





présume et favorise, les us et coutumes du « projet urbain » en marche vers l’hégémonie tendaient à imposer dans les concours de ZAC la remise d’une cohorte de visions horizontales gigognes : plan de situation au 1/5 000e, plan de quartier au 1/1 000e, plan-masse au 1/500e, extraits de plan de rez-dechaussée au 1/200e et, il est vrai, une coupe schématique pour certifier le respect des gabarits autorisés. Aujourd’hui, à quelques exceptions près, par habitude, par respect des conventions en vigueur dans l’exercice professionnel comme au nom de leur transmission par l’enseignement, ces modes de représentation continuent d’être pratiqués en suivant leurs attributions historiques, dans des acceptions parfois si simplifiées qu’elles les réduisent à des codes.
Les dilemmes de la ville épaisse
Pourtant, plus que jamais, la ville demande à être prise en compte dans sa troisième dimension, cette épaisseur physique bien réelle qui lui a été imposée au fil du temps par l’ingénierie : vers le haut, par les infrastructures de franchissement, du pont au flyover, toujours plus autonomes à mesure
conférence

que la mécanisation et la vitesse les affranchissaient des contraintes de la topographie naturelle et du pas humain ; vers le bas, par les innombrables réseaux, adductions, évacuations, tunnels, parkings, rejoints à partir des années soixante par certains équipements et centres commerciaux. De nos jours, la raison gravitaire ou hygiéniste de ces implantations le cède à celle de la densification coûte que coûte des centres-ville au foncier cher et rare, comme le montre le retour dans l’actualité parisienne de l’« urbanisme souterrain ».
1. Sur la conception de la ville en coupe, voir « Leçons d’une exposition », in Françoise Fromonot, La Campagne des Halles, Paris, La Fabrique, 2005, p. 59 – 71 ; « Topographie des infrastructures », in coll. « Architectures de reconquête », Paris, éditions Recherches, 2010, p. 54 – 55.
Or de toutes ces évolutions, de ce monde qui gouverne en sous-main toute la vie citadine, la représentation de la ville ne tient que très peu compte. Alors qu’ils véhiculent autant de flux, voire plus, que n’en charrient les rues, les tubes où circulent les transports n’apparaissent pas sur les plans urbains. Les autoponts et leurs viaducs y sont portés sous forme de rubans opaques, plaqués sur des surfaces dont ils sont pourtant détachés. Les talus, rampes, trémies d’accès à ces bretelles et à leurs dépendances, si présents dans le paysage et si contraignants pour sa pratique au quotidien, n’apparaissent pas sur les cartes, ou alors encodés dans des indications indéchiffrables dont la signification est renvoyée en légende. Ce que les visionnaires métropolitains du siècle dernier imaginaient avec effroi ou gourmandise est de fait advenu sous nos yeux qui ne les voient pas. Démultiplié par les impératifs de la « mobilité », de plus en plus fabriqué, feuilleté, habité, le sol de la grande ville moderne est devenu invisible, donc incompréhensible dans son intégralité lorsqu’il n’est rapporté qu’au traditionnel plan1. On a pu voir tout récemment encore, dans le cas du réaménagement des Halles ou de la place de la République à Paris, combien la réforme de certains lieux historiques de la ville centre pouvait être compromise par cette cécité verticale. La mise en relation fonctionnelle des niveaux d’espaces publics qui les constituent, de la surface aux transports souterrains, est certes entravée par les rapports de force entre leurs divers gestionnaires ; elle l’est aussi par un blocage mental dont la convention persistante du plan urbain unique est peut-être au fond l’un des symptômes.
Horizons militants
L’urbanisme doit-il pour autant se doter d’autres outils ? Certains discours prêtent au plan la capacité de capter et de faire percevoir une troisième dimension de la ville ou du territoire, à l’instar des plans « actifs » qui filent la métaphore du palimpseste et de son accumulation sélective pour relayer, par le dessin, la mesure ou les effets du temps. En parallèle, deux décennies d’influence des pratiques des paysagistes, attachés par définition à la qualité et au comportement en profondeur des terrains où ils plantent, ont conduit
conférence

les urbanistes à intégrer quelques-unes des propriétés de la coupe et favoriser les réflexions sur ses facultés. Les « transects » paysagers une captation par la géographie, puis par l’urbanisme, d’un type de relevé utilisé pour les inventaires botaniques donnent depuis quelque temps à la coupe territoriale une nouvelle actualité descriptive, même s’ils s’attachent le plus souvent à ne répertorier des sols que leurs mouvements superficiels2 Plus illustrative que le plan, plus performante par conséquent à l’ère de la « concertation » obligatoire des aménagements urbains, la coupe peut aussi s’avérer utile pour faire comprendre et partager à des riverains l’impact d’interventions ciblées, comme la création d’un boulevard urbain avec son tramway, l’aménagement d’un canal et ses abords, la construction d’un îlot en gradins sur un site en pente. Au croisement de ces deux logiques paysagère et civique, et même politique , le pavillon français de la Biennale de Venise exposait dans son édition 2016 une petite invention, qui fut peu commentée malgré sa grande portée. Des coupes paysages détaillées sur six opérations architecturales exemplaires et leurs alentours avaient été fédérées en une frise présentée comme un seul dessin3. D’une réalisation à l’autre, cette « coupe récit » offrait un voyage au long cours dans un territoire idéalisé, en une réaffirmation militante du lien entre représentation et utopie.
2. Voir par exemple le projet D-Transect, qui rassemble plusieurs laboratoires de recherche et des professionnels, sous la direction de Frédéric Pousin. Accessible en ligne sur http://dtransect .jeb-project.net
3. Elles figurent partiellement dans Nouvelles richesses/New Riches, le catalogue de l’exposition, OBRAs, Frédéric Bonnet et le collectif AJAP14, Liège, éditions Fourre-Tout, 2016, p. 188 – 189, 204 – 205, 224 –225, 240 – 241, 258 – 259 et 278 – 279.
conférence
L’une des « coupes récits » du pavillon français de la Biennale de Venise
2016 : logements d’urgence à Saint-Denis, Niclas Dünnebacke architecte, 2013. Dessin : Boidot & Robin architectes.
Ces quelques exemples et les observations qui précèdent ne prétendent évidemment pas passer en revue tous les aspects restés marginaux de la représentation urbaine et territoriale, ni épuiser dans leurs nuances les tenants et aboutissants d’un sujet pour ainsi dire sans fond. Ils visent plutôt, pour le faire réagir, à y planter quelques banderilles, les mêmes qui préludaient à une action pédagogique volontairement extrême que nous avons menée, il y a bientôt dix ans, à trois enseignants à l’Institut d’art et d’architecture de l’Académie des beaux-arts de Vienne : une exploration sans filet des potentiels de la coupe appliquée à une situation construite a priori peu propice à la description graphique à grande échelle, un test du possible renouvellement de la compréhension d’un territoire très vaste par un renversement de sa représentation.
Tranches de port
4. « Cutting through the port of Rotterdam », Masterstudio HTC/GLC, Summer term 2009. Françoise Fromonot, Wouter Vanstiphout, Lisa Schmidt-Colinet, Institut für Kunst und Architektur, Akademie der Bildenden Künste Wien.
Avec le recul, cette aventure ressemble encore à un drôle de pari. « Au second semestre 2009, annonçait le programme conçu avec mon collègue Wouter Vanstiphout, les plateformes History Theory Criticism (HTC, histoire, théorie, critique) et Geography Landscape Cities (GLC, géographie, paysage, villes) collaboreront le temps d’un studio de master pour explorer un sujet impliquant deux objets : un site et un outil. Le site, c’est le port de Rotterdam, le plus grand port d’Europe et, il y a encore une décennie, du monde. L’outil, c’est la coupe, dont l’usage s’est développé bien au-delà de l’architecture, en géologie, en géographie, dans l’archéologie, le design industriel, l’anatomie, l’illustration, le cinéma et la performance artistique. L’objectif de ce studio est d’opérer, grâce à une série de plans verticaux en deux dimensions, des coupes critiques dans l’objet en trois dimensions qu’est le port pour investiguer son territoire, le documenter et révéler le paysage politique, la vallée économique et le champ de possibles urbains contenus dans les bandes parallèles de ce complexe immense.4 »
Une image satellitaire montrait, en plan, la succession d’installations portuaires qui ont colonisé et remodelé au fil du temps l’estuaire de la Nouvelle Meuse, une ramification du delta du Rhin. Entre le centre de Rotterdam et la mer du Nord, le port étire sur près de 50 kilomètres son empreinte claire un peu sinueuse, en forme d’os, entre les deux rives vertes du fleuve. L’image permettait presque de distinguer les quais et les darses, en étoile ou en peigne, modelés par creusement ou par comblement, servis par des canaux intérieurs ; un territoire strié par le rail et la route, traversé par des faisceaux d’adduction d’énergie. Des photos balayaient son étendue apparemment sans mystère, horizontale, fonctionnelle, rythmée par les mâts et les châteaux des navires, hérissée de raffineries, d’éoliennes, de
conférence
