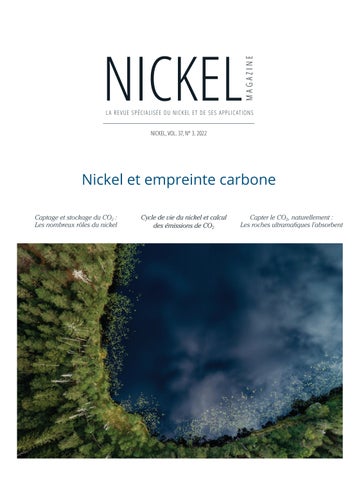LA REVUE SPÉCIALISÉE DU NICKEL ET DE SES APPLICATIONS
NICKEL, VOL. 37, Nº 3. 2022
Nickel et empreinte carbone
Captage et stockage du CO2 : Les nombreux rôles du nickel

Cycle de vie du nickel et calcul des émissions de CO2


Capter le CO2, naturellement : Les roches ultramafiques l’absorbent







NICKEL MAGAZINE
ÉTUDE DE CAS 26
PASSERELLE CHRISTOPHER CASSANITI

Avec son tablier de 178 m, la passerelle Christopher Cassaniti est la première passerelle à double hélice en Australie. Achevé en 2020, ce passage aérien à l’usage des piétons et des cyclistes enjambe deux axes routiers à grande circulation.

Architecture : KI Studio
Bureau d’études : Arup
Maître d’œuvre : Arenco Daracon
Constructeur : S & L Steel
Emplacement : Sydney (Australie)
Éléments contenant du nickel :
• Plaques de duplex 2205 de la structure du tablier principal
• Membres de compression en duplex 2205 supportant le tablier de la passerelle
• Alliage 718 (N07718) des goupilles
• Acier inoxydable austénitique 316L des garde-corps
Dimensions :
• 178 m de long
• Double hélice de 7,8 m (max.) à 5,5 m (min.) de diamètre
En raison du peu d’espaces se prêtant aux points d’entrée et de sortie, la passerelle suit un trajet sinueux. Sa construction a nécessité 200 tonnes d’acier au carbone et 80 tonnes de plaques d’acier inoxydable duplex microbillées. En raison de ses excellentes caractéristiques de ténacité et de résistance à la corrosion et aux contraintes, l’acier inoxydable duplex 2205 (UNS S32205, à environ 5 % de nickel) a été choisi pour la structure du tablier principal afin de réduire l’entretien de la passerelle au minimum sur sa durée de vie prévue de 100 ans. La passerelle repose sur des membres porteurs en acier inoxydable duplex raccordés par des goupilles et rotules en alliage 718, un superalliage à environ 50 % de nickel offrant une résistance à la corrosion exceptionnelle. Les garde-corps sont en acier inoxydable austénitique 316L (S31603), contenant d’ordinaire 10 % de nickel.
Le tablier en acier inoxydable duplex repose entièrement sur la structure d’acier au carbone tubulaire en double hélice et ne joue aucun rôle porteur dans la passerelle. La construction de la double hélice a nécessité plus de 3 600 plaques d’acier au carbone. Elles ont été découpées au laser avant d’être profilées et soudées ensemble pour produire des sections en poutrescaisson courbées et vrillées qui ont été assemblées hors site, puis démontées et transportées. Les plaques d’acier inoxydable duplex de 12 mm d’épaisseur ont nécessité un soudage soigneux afin de prévenir leur distorsion, qui est plus forte que celle de l’acier au carbone, en raison surtout de la plus faible conductivité thermique de l’acier inoxydable duplex.
Une couche de peinture bleu brillant met la passerelle en accord avec le ciel et les espaces verts environnants.
2 | NICKEL, VOL. 37, Nº 3. 2022 2 | NICKEL, VOL. 37, Nº 3. 2022
ARUP
ÉDITORIAL NICKEL ET DIOXYDE DE CARBONE
L’année 2022 aura été celle des conditions météorologiques extrêmes. Au Pakistan, des températures culminant à 50 °C dès le mois de mars ont fait place au mois de mai à des inondations dévastatrices. Au Royaume-Uni, le mercure a dépassé les 40 °C. L’Espagne et le Portugal ont été ravagés par des incendies. Et aux États-Unis, le niveau des réservoirs est tombé au plus bas. En Chine, certaines parties du Yangtsé se sont asséchées. En Australie, Sydney a connu l’année la plus humide jamais enregistrée.
« Les dix mois de septembre les plus chauds jamais enregistrés se sont tous produits depuis 2012 » — Rapport sur le climat mondial de septembre 2022 établi par les Centres nationaux d’information environnementale des États-Unis (www.ncei.noaa.gov)
Les émissions de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre (GES) résultant de l’activité humaine piègent la chaleur dans l’atmosphère. Cela entraîne un réchauffement planétaire qui amplifie les phénomènes naturels tels qu’inondations et sécheresses. Le présent numéro de Nickel examine les émissions de CO2 de différents points de vue, à savoir ceux de leur réduction, de leur calcul et de leur séquestration. Comme le premier pas d’un plan de réduction des émissions consiste à les mesurer, le Nickel Institute a produit un guide pour aider les producteurs de nickel métallique à calculer les leurs. L’article de la page 8 répond à des questions concernant la nécessité pour les producteurs et utilisateurs de nickel de disposer de données de cycle de vie fiables.

Parallèlement aux efforts des producteurs de nickel pour diminuer leurs émissions de CO2, l’utilisation du nickel joue aussi un rôle essentiel dans les procédés techniques réduisant la libération de ce gaz dans l’atmosphère. Il s’agit en particulier des techniques de captage et stockage du CO2. Comme les changements climatiques provoquent aussi des pénuries d’eau dans nombre de régions du monde, leur approvisionnement en eau douce passe par des stations de dessalement. Le nickel y joue aussi un rôle de taille.
Les entreprises minières visent aussi la neutralité carbone, et elles disposent parfois de procédés étonnamment naturels pour progresser dans ce sens (voir page 12).
Vous cherchez à réduire vos propres émissions de CO2 ? Vous rêvez de remplacer votre véhicule énergivore par un scooter électrique ? Ne cherchez plus : l’inspiration vous attend au dos du magazine.
Clare Richardson Rédactrice en chef
NICKEL, VOL. 37, Nº 3. 2022 | 3
NOAA
CENTILES DE TEMPÉRATURE DE SURFACE – JUIN-AOÛT 2022
Record de froid
Plus chaud que la moyenne
Beaucoup plus froid que la moyenne
Beaucoup plus chaud que la moyenne
Plus froid que la moyenne
Record de chaleur
02 Étude de cas 26

Passerelle Christopher Cassaniti
03 Éditorial Nickel et CO2
04 En bref
06 Captage et stockage du CO2
Les alliages de nickel captent l’attention
08 Empreinte carbone du nickel Questions et réponses
11 Dessalement
Vers plus d’eau

NICKEL
La revue Nickel est publiée par le Nickel Institute. www.nickelinstitute.org
Président : Hudson Bates
Rédactrice en chef : Clare Richardson communications@nickelinstitute.org
Collaborateurs : Nancy Baddoo, Gary Coates, Richard Matheson, Francisco Meza, Mark Mistry, Geir Moe, Kim Oakes, Odette Ziezold
Conception : Constructive Communications
Les articles sont destinés à l’information générale du lecteur et celui-ci ne doit pas s’y er pour des applications particulières sans avoir obtenu au préalable les conseils de spécialistes compétents. Bien que les informations données soient considérées comme techniquement exactes, le Nickel Institute, ses membres, son personnel et ses consultants ne garantissent pas leur adéquation à quelque usage particulier ou général que ce soit et déclinent toute responsabilité à leur égard.
ISSN 0829-8351
Imprimé au Canada, sur papier recyclé, par Hayes Print Group


Photos de banques d’images : iStock©peterschreiber.media (couverture), iStock©peterschreiber.media (page 4), iStock©VectorMine (page 7), iStock©kynny (page 10), iStock©Nils Versemann (page 11)
Nanodétection des tumeurs cérébrales
En quête d’un moyen fiable et minimalement invasif de diagnostiquer les cancers du cerveau, une équipe de chercheurs canadiens a créé un biocapteur ultrasensible capable de détecter des matières libérées par les tumeurs à partir d’un minuscule échantillon de sang. En utilisant des faisceaux laser de haute intensité pour former des nanocouches 3D de nickel-oxyde de nickel sur une puce de nickel, ils ont pu détecter d’infimes quantités de matières dérivées de tumeurs, telles qu’acides nucléiques, protéines et lipides. Les chercheurs ont pu distinguer le cancer du cerveau des cancers mammaires, pulmonaires et colorectaux avec une spécificité de 100 %, et discerner entre tumeurs cérébrales primaires et secondaires avec une fiabilité similaire. Publiés dans la revue ACS Nano, ces résultats pourraient ouvrir la voie à des diagnostics plus précoces et à de meilleures options de traitement.

4 | NICKEL, VOL. 37, Nº 3. 2022
SOMMAIRE
douce
Capter le CO2 , naturellement Les roches ultramafiques l’absorbent 14 Le saviez-vous ? 15 Nouvelles publications
Codes UNS
Plié au goût du jour Un scooter électrique léger
12
15
16
EN BREF
Lutte contre les mycoses
Des chercheurs ont fait de nets progrès dans la lutte contre de dangereuses infections fongiques en démontrant la grande efficacité de composés chimiques contenant certains métaux, dont le nickel. Avec l’aide de la CO-ADD (Community for Open Antimicrobial Drug Discovery), une initiative de production participative lancée par l’Université du Queensland en Australie, Angelo Frei et son équipe de l’Université de Berne ont testé 21 composés métalliques hautement actifs contre différentes souches fongiques résistantes. « Plusieurs [d’entre eux] ont présenté une bonne activité contre toutes les souches fongiques et se sont montrés jusqu’à 30 000 fois plus actifs contre ces dernières que contre les cellules humaines », explique Angelo Frei. « En exploitant tout le potentiel du tableau périodique, nous pourrions être en mesure de prévenir un futur dans lequel nous n’avons pas […] d’agents actifs pour prévenir et traiter les infections fongiques. »

Un moyen de recharge rapide
Imaginez pouvoir repartir pour 400 km après un arrêt recharge de 10 min. Des chercheurs de l’Université d’État de Pennsylvanie ont une solution prometteuse, fruit d’expériences utilisant une feuille de nickel pour échauffer des batteries lithium-ion afin d’accroître leur rendement. Chao-Yang Wang et son équipe ont démontré qu’en ajoutant une feuille de nickel ultrafine à l’intérieur d’une batterie de VE offrant une autonomie maximale d’environ 560 km, il pouvait la recharger à 70 % en 11 min et à 75 % en 12 min pour obtenir respectivement une autonomie d’environ 400 km et 440 km. « Notre technologie permet de mettre en service des batteries plus petites se chargeant plus vite en vue de généraliser l’adoption de véhicules électriques abordables », explique Chao-Yang Wang.

Prodige numismatique
Un pactole de 4,2 millions de dollars US pour une pièce de cinq cents en cupronickel ? C’est ce que la maison de ventes aux enchères spécialisée GreatCollections a déboursé cette année pour l’exemplaire Walton de la pièce de cinq cents Liberty Head de 1913, au motif que celle-ci « a l’une des histoires les plus formidables jamais relatées dans la numismatique américaine ». Les cinq exemplaires connus de cette pièce rarissime, dont la production a cessé en 1912, auraient été frappés soit par erreur, soit clandestinement au profit de Samuel Brown, un employé de la Monnaie des États-Unis (United States Mint). Vendus par celui-ci en 1924, les cinq exemplaires ont appartenu à quelques-uns des plus grands noms de la numismatique. La maison GreatCollections dit avoir acquis l’exemplaire Eliasberg l’an dernier avec deux autres pièces lors d’une transaction historique totalisant 13,35 millions de dollars US.

© CO-ADD EC POWER © GREATCOLLECTIONS AUCTIONS NICKEL, VOL. 37, Nº 3. 2022 | 5
CAPTAGE ET STOCKAGE DU CO2 QUAND LES ALLIAGES DE NICKEL CAPTENT L’ATTENTION
L’unité de captage et stockage du CO2
Quest, située près d’Edmonton, en Alberta (Canada). Depuis sa mise en service fin 2015, cette unité a capté et stocké plus de 6,8 millions de tonnes de CO2 désormais séquestrées en toute sécurité à 2 km sous terre.
Tandis que les industries du monde entier œuvrent à réduire les émissions de dioxyde de carbone, d’autres efforts visent à empêcher ce gaz de s’échapper dans l’atmosphère en le séquestrant au moyen de procédés de captage et stockage du CO2 (CSC). Pour concourir à l’objectif de réduire à zéro les émissions anthropiques nettes de gaz à effet de serre, le Nickel Institute continue de se pencher sur le rôle déterminant du nickel dans le succès des techniques de CSC. Il s’agit d’un projet englobant toute la chaîne du CSC depuis les procédés éprouvés de captage et de transport du carbone jusqu’à sa séquestration géologique.
Choisir des nuances supérieures
Pour mettre en œuvre une infrastructure de CSC sûre, fiable et économe, il est essentiel de tenir compte de la corrosion et de choisir les bons matériaux.
Nombre de procédés de CSC associent basses températures et présence d’eau libre, générant ainsi un milieu acide et un risque de corrosion. Pour cette raison, l’acier au carbone ne suffit pas et il faut généralement recourir à des aciers inoxydables au nickel de nuance supérieure et à des alliages de nickel.
Le captage du CO2 se fait le plus souvent à partir de gaz de combustion contenant de l’eau. Par conséquent, les procédés doivent fonctionner en milieu acide humide, sans quoi ils nécessitent un séchage préalable des gaz. Certains fonctionnent à haute température en conditions rigoureuses, ce qui exclut aussi l’acier au carbone.
Transport
Le transport du CO2 capté jusqu’au site de séquestration géologique se fait soit par pipeline, soit par mer, route ou rail, auquel cas il est liquéfié. Les équipements de transport utilisés nécessitent eux aussi des aciers inoxydables ou faiblement alliés contenant du nickel ou des alliages de nickel.
Séquestration géologique
Le CO2 injecté dans un site de séquestration géologique est généralement sec et non corrosif. Cependant, le puits doit être conçu de manière à parer au risque qu’un milieu acidifié n’entraîne sa corrosion pendant sa durée de vie.
Aux États-Unis et dans l’UE, les données de conception des puits montrent que l’acier inoxydable au nickel et les alliages de nickel sont généralement choisis pour les infrastructures critiques présentant un risque de corrosion. Pour la conception et la construction des puits d’injection de CO2, les États-Unis ont établi des directives précises insistant sur la sélection des matériaux, d’une manière qui conforte le rôle déterminant du nickel dans les projets de séquestration géologique du carbone à venir.
Afin de faciliter la sélection des matériaux destinés aux procédés de CSC, l’AMPP (Association for Materials Protection and

6 | NICKEL, VOL. 37, Nº 3. 2022
GROUPE CNW/SHELL CANADA
Amendements du sol
Captage et séparation
Mines de charbon
CO2 dissipé
Les arbres captent le CO2 atmosphérique
Performance) met actuellement au point un guide de sélection des matériaux et de prévention de la corrosion pour le transport et l’injection du CO2 (Guidelines for Materials Selection and Corrosion Control for CO2 Transport and Injection), qui indique notamment où et quand privilégier les matériaux au nickel.
À mesure que différentes industries
CO2 injecté artifi ciellement
Gisements d’hydrocarbures épuisés
Aquifères profonds
évaluent la chaîne du CSC, il devient évident que rares sont les étapes ne nécessitant pas d’alliages de nickel ou d’aciers inoxydables ou faiblement alliés contenant du nickel. Cela confirme le rôle vital du nickel dans la mise en place des systèmes de CSC devant aider à réduire à zéro les émissions anthropiques nettes de gaz à effet de serre dans les années et décennies à venir.
Domaines où le nickel joue un rôle déterminant
• Récupération du CO2 dans les gaz de combustion des centrales thermiques à charbon, qui contiennent aussi du SO2 et de l’eau et produisent ainsi un condensat acide corrosif pour l’acier au carbone.
• Un solvant liquide, tel qu’une solution d’amine, absorbe le CO2 contenu dans le flux gazeux. Cela peut créer un milieu acide corrosif dans la colonne d’absorption du CO2 , dans le système de circulation de la solution d’amine et dans la colonne de régénération où est libéré le CO2 épuré.
• Les systèmes de récupération à absorbant solide, notamment ceux utilisant l’adsorption à température modulée (ATM), extraient aussi le CO2 d’un flux de gaz par interaction avec le sorbant. Ce procédé fonctionnant en conditions humides avec des températures oscillant entre 40 °C et 100 °C produit des milieux acides corrosifs. Cela entraîne un risque de formation d’acide carbonique menaçant surtout le système de séchage et le souffl eur de précaptage, qui nécessitent respectivement l’emploi d’un acier inoxydable austénitique et d’un acier inoxydable duplex (contenant tous deux du nickel).
• Les procédés novateurs tels que le cycle de production d’électricité d’AllamFetvedt, où le CO2 sert de fluide de travail avant d’être capté et réutilisé, nécessitent des alliages au nickel pour la turbine et la chambre de combustion, pour l’échangeur de chaleur et pour la tuyauterie à haute température raccordant le tout.
CYCLE D’ALLAM-FETVEDT SIMPLIFIÉ

Apport thermique additionnel


Flux de recyclage du CO2 CO2 Réseau électrique Rejet
1. Unité de séparation d’air
2. Chambre d’oxycombustion

3. Turbine
4. Échangeur de chaleur
5. Refroidissement
Le cycle d’Allam-Fetvedt utilise des combustibles carbonés pour produire de l’énergie thermique et utilise le CO2 résultant comme fluide de travail pour entraîner une turbine avant de le capter et de rejeter l’eau résiduelle.


NICKEL, VOL. 37, Nº 3. 2022 | 7
O2
H2O
Admission d’air
pur
Séquestration CO2 CO2 H2O
Gaz naturel
CREATIVE COMMONS –THE JOY OF ALL THINGS
L’EMPREINTE CARBONE DU
MESURER
QUESTIONS-RÉPONSES AVEC MARK MISTRY, EXPERT EN DURABILITÉ AU NICKEL INSTITUTE
NICKEL :
Mark Mistry est spécialiste des évolutions réglementaires susceptibles de concerner l’industrie du nickel et contribue au débat scientifique et universitaire sur l’analyse du cycle de vie et sur les avantages de l’emploi et du recyclage du nickel. Il participe aussi à la mise au point des normes internationales de durabilité.

Depuis que les changements climatiques occupent le devant de la scène des problèmes mondiaux, toutes sortes d’acteurs demandent des données d’empreinte carbone aux producteurs de nickel.
Pourquoi ? Parce que les clients ont besoin d’évaluer le profil des émissions de GES de leurs propres produits contenant du nickel, parce que les pouvoirs publics doivent déterminer la conformité des produits et procédés, et parce que les places boursières telles que le London Metal Exchange ont un devoir de transparence. En outre, les producteurs de nickel ont eux aussi besoin de ces données pour cerner les améliorations à apporter à leurs procédés. Tout cela nécessite que le secteur produise des données fiables sur le cycle de vie du nickel.
Quel est le lien entre empreinte carbone et données de cycle de vie du nickel ?
Les données de cycle de vie rendent compte des flux entrants (énergie, produits chimiques industriels, eau, etc.) et sortants (rejets dans les eaux, émissions atmosphériques, déchets, etc.). Elles sont recueillies à chaque étape de la production des produits du nickel. Et elles constituent le socle d’une l’évaluation des impacts du cycle de vie (EICV). Les EICV convertissent flux entrants et sortants en 15 « catégories d’impacts environnementaux », la plus importante correspondant aux émissions de GES (à l’empreinte carbone). Une EICV détermine l’étape du procédé produisant les impacts environnementaux les plus élevés ou les plus nocifs.
Comment s’utilisent-elles en pratique ?
Les utilisateurs finaux utilisent les données de cycle de vie pour évaluer la performance environnementale d’un produit. Cela permet de comparer les flux entrants et sortants de deux produits
remplissant la même fonction. Il s’agit par exemple d’évaluer la performance environnementale de véhicules électriques utilisant différents types de batteries au nickel par rapport à celle d’un véhicule propulsé par un moteur à combustion interne, de manière à bien saisir les différences d’un bout à l’autre du cycle de vie. Les producteurs de nickel utilisent eux aussi les données de cycle de vie afin de cerner les améliorations à apporter à leurs procédés.
Pourquoi les normes d’analyse du cycle de vie (ACV) sont-elles importantes ?
Tous les calculs d’émissions de GES doivent être fiables et basés sur la norme d’analyse du cycle de vie mondialement reconnue (ISO 14044). En effet, l’adoption d’une démarche cohérente garantit que les producteurs de nickel recueillent tous les données de cycle de vie requises de la même manière et, par conséquent, qu’elles sont comparables.
Ces données sont-elles actualisées régulièrement ?
Plusieurs paramètres ont un impact sur
8 | NICKEL, VOL. 37, Nº 3. 2022
les données de cycles de vie, notamment la teneur des minerais et la présence de sous-produits, les changements dans les procédés de l’industrie minière, les techniques particulières utilisées, l’approvisionnement énergétique, les mises à niveau technologiques et les investissements dans la réduction ou la prévention des émissions. Ces facteurs peuvent changer à échéance relativement brève en pesant nettement sur les résultats d’une analyse du cycle de vie. Par conséquent, les données de cycle de vie doivent être actualisées régulièrement. Il est de pratique courante d’actualiser les données tous les cinq ans, mais nombre de clients et d’utilisateurs en aval ont besoin d’une actualisation plus fréquente.
Comment comparer le nickel aux autres métaux ?
Dans le monde de l’analyse du cycle de vie, il est largement admis que la comparaison doit se faire par « unité fonctionnelle » plutôt que par matériau. Or, le
nickel sert souvent d’élément d’alliage. Pour être judicieuse, la comparaison entre matériaux doit concerner une unité fonctionnelle convenue, par exemple un cadre de fenêtre de dimensions données ou une conduite bien définie transportant une substance donnée sur une certaine distance.


La qualité des données de cycle de vie du nickel varie-t-elle ?
Pour l’évaluation de l’empreinte carbone, les cabinets de conseil en analyse de données proposent des modèles qui, en l’absence de données, se fondent sur des hypothèses et, souvent, sur des estimations approximatives. Il est fréquent que les résultats produits par ces modèles diffèrent considérablement des données d’empreinte carbone du Nickel Institute, qui reposent sur des chiffres incontestables fournis par les entreprises, calculés selon des normes mondialement reconnues et vérifiés de manière indépendante.

Pour aider les producteurs à calculer leurs émissions de gaz à effet de serre, le Nickel Institute a publié un guide intitulé How to determine GHG emissions from nickel metal Class 1 production [Comment déterminer les émissions de GES dans la production de nickel métallique de classe 1]. Tenant compte de la complexité de la production de nickel, il aide à recueillir des données scientifiques sûres, fiables et comparables dans l’ensemble du secteur.


NICKEL, VOL. 37, Nº 3. 2022 | 9
Les analyses de cycle de vie permettent de comparer les émissions de GES des véhicules électriques à celles des véhicules à combustion interne d’un bout à l’autre de leur cycle de vie.
Pourquoi différents acteurs s’intéressent-ils à l’empreinte carbone des batteries de VE ?

Les véhicules électriques sont essentiels pour parvenir à une mobilité décarbonée durable et écologique. Cependant, certaines études soutiennent que les VE émettent à peu près autant, voire plus, de GES que les véhicules à combustion interne. Et comme l’empreinte carbone des batteries compte pour une part importante des émissions de GES des VE, différents acteurs la surveillent de près. Les analyses de cycle de vie permettent de comparer les émissions de GES des véhicules électriques à celles des véhicules à combustion interne d’un bout à l’autre de leur cycle de vie. Les batteries contribuent largement à l’empreinte carbone des VE et il est nécessaire d’analyser la totalité des matières premières et des procédés utilisés pour les produire. Les données de cycle de vie servent de base au calcul de l’empreinte carbone des batteries de VE.
Quelle est l’importance du nickel dans l’empreinte carbone des VE ?
Le nickel compte pour environ 9 % de l’empreinte carbone globale d’une batterie pour VE de type NMC 111. L’électricité utilisée pour fabriquer la batterie et l’aluminium constituant son boîtier comptent pour une part beaucoup plus importante.
Les producteurs d’acier inoxydable s’intéressent-ils aux données de cycle de vie du nickel ?
Le recueil des données de cycle de vie propres à une entreprise est de plus en plus souvent obligatoire. Par exemple, le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l’UE impose de calculer l’empreinte carbone de tout acier inoxydable importé afin de déterminer le nombre de certificats carbone à acheter. Par ailleurs, pour les producteurs d’acier inoxydable déclarant leur empreinte carbone, les données sont incorporées aux déclarations environnementales de produit (DEP).
L’empreinte carbone de l’acier inoxydable varie-t-elle selon les produits du nickel utilisés dans sa production ?
La fonte brute de nickel, le ferronickel et le nickel métallique sont les principaux matériaux au nickel alimentant la production d’acier inoxydable. Leur empreinte carbone peut varier d’un facteur supérieur à 30 entre le producteur émettant le moins de GES et celui en émettant le plus. Par conséquent, le choix du produit du nickel à utiliser dans la production de l’acier inoxydable a un impact considérable sur l’empreinte carbone de ce dernier.
L’acier inoxydable produit à partir de ferraille est-il plus écologique, vu sa moindre empreinte carbone ?
En règle générale, la collecte et le recyclage sont importants pour atteindre les objectifs de viabilité, car ils préviennent la mise en décharge, réduisent la demande de matières premières vierges, contribuent à l’utilisation efficace des ressources et créent des emplois dans les petites et moyennes entreprises œuvrant dans ce domaine. En modélisation du cycle de vie, il est commun d’adopter une méthode appliquant des « critères de coupure » à l’inclusion de matières premières secondaires. Avec cette méthode, les impacts environnementaux de la ferraille utilisée dans le procédé ne sont pas pris en compte. Les méthodes tenant compte de la fin de vie répartissent les impacts environnementaux de la production primaire de chaque matériau sur ses cycles de vie successifs. L’application de telles méthodes fait mieux concorder les empreintes carbone respectives du métal neuf et du métal recyclé.
Pour aider les producteurs à calculer leurs émissions de gaz à effet de serre dans la production de nickel métallique de classe 1, le Nickel Institute a produit un guide intitulé How to determine GHG emissions from nickel metal class 1 production. Il est disponible en téléchargement sur le site du Nickel Institute : www.nickelinstitute.org
10 | NICKEL, VOL. 37, Nº 3. 2022
DES PROCÉDÉS NOVATEURS POUR LE DESSALEMENT DE L’EAU

L’ONU a estimé que d’ici 2025, 1,8 milliard de personnes vivront dans des pays ou régions touchés par une pénurie d’eau complète et que les deux tiers de la population mondiale pourraient être en situation de stress hydrique.
Face à la pression croissante pour garantir l’approvisionnement en eau potable, le nombre de stations de dessalement progresse. Les matériaux contenant du nickel sont essentiels pour assurer un fonctionnement durable et sans problème, car les équipements d’épuration des eaux salées ou saumâtres sont menacés par la corrosion à moins d’utiliser des matériaux appropriés.

La mise en place de solutions viables répondant à la demande nécessite des options de dessalement durables. Les deux principaux types de procédés sont les procédés membranaires (osmose inverse) et les procédés par distillation (distillation à effets multiples et distillation à détentes étagées).
Les procédés par distillation font appel à une évaporation de l’eau, si bien que leurs coûts énergétiques et leurs impacts environnementaux sont plus importants que ceux de l’osmose inverse. Mis au point pour la première fois à la fin des années 1950, le dessalement par osmose inverse consiste à séparer les chlorures de l’eau de manière sélective en la forçant à traverser des membranes
semi-perméables sous l’effet d’une forte pression. Très modulable, l’osmose inverse peut servir à alimenter aussi bien un hôtel qu’une ville entière, ce qui en a fait le procédé privilégié.
Dans les stations à osmose inverse, plusieurs composants peuvent être en acier inoxydable super duplex S32750 ou S32760, comme les écrans et conduites d’admission de l’eau salée, les papillons de vanne et les tuyauteries à haute pression. Les corps de pompe des étages à haute et basse pression du système peuvent être coulés en aciers inoxydables super duplex J93380 et J93404. Les tubes d’instrumentation utilisés pour le contrôle du procédé peuvent aussi être en aciers inoxydables super duplex à 6 % de molybdène (comme les nuances S31254, N08367 et N08926) ou en cupronickel 90-10 (C70600).
Le guide de sélection des matériaux pour les stations de dessalement intitulé Materials selection for desalination plants (11 029) est disponible en téléchargement gratuit sur le site du Nickel Institute : www.nickelinstitute.org
Tuyauterie à haute pression en acier inoxydable super duplex de la station de dessalement de l’eau de mer par osmose inverse du Queensland, en Australie. Les aciers inoxydables duplex et super duplex sont les matériaux usuels pour les tuyauteries à haute pression dans la plupart des stations à osmose inverse du monde, car ils conjuguent haute résistance mécanique et excellente résistance à la corrosion.
La station de dessalement de l’État de Victoria, en Australie, est en service depuis 2012 et produit un volume d’eau estimé à 410 mégalitres par jour.
NICKEL, VOL. 37, Nº 3. 2022 | 11
SEQWATER
CAPTER LE CO2, NATURELLEMENT
La plupart des entreprises ont annoncé publiquement qu’elles comptaient parvenir à la neutralité carbone d’ici 2050, voire plus tôt. Pour nombre d’entre elles, le défi est de taille. Une manière de progresser vers la neutralité carbone consiste à capter du dioxyde de carbone qui est soit généré par un procédé utilisant la combustion d’un hydrocarbure, soit déjà présent dans l’atmosphère. Le CO2 capté peut être utilisé dans un autre procédé ou être définitivement séquestré afin de ne plus être libéré dans l’atmosphère. Une grande variété de procédés de captage et de stockage du CO2 ont été proposés ou fonctionnent déjà, et la plupart sont chers à mettre en place et à faire fonctionner.
Mais si on disposait d’une substance abondante et d’origine naturelle qui réagit avec le CO2 atmosphérique pour produire une matière pouvant se stocker facilement et sans danger pour des milliers d’années ? Certaines entreprises minières ont cette option.
Les roches ultramafiques absorbent le CO2
Dans les mines, les minéraux utiles sont mêlés à d’autres substances minérales, qui constituent la gangue. Le broyage des roches et l’extraction des minéraux utiles laissent des résidus qu’il faut éliminer.
Des recherches conduites en Australie à la mine de nickel du mont Keith, exploitée par Nickel West (groupe BHP), montrent qu’une année de résidus capte actuellement dans les 40 000 tonnes de CO2 et pourrait en capter 4 millions.

12 | NICKEL, VOL. 37, Nº 3. 2022 NICKEL WEST (GROUPE BHP)
Mais lorsque ces derniers se composent de roches ultramafiques (terme général désignant différents minéraux caractérisés par une teneur en magnésium relativement élevée et une faible teneur en silice), ils absorbent lentement le CO2 de l’atmosphère pour produire un carbonate stable et solide. Dans les autres procédés de séquestration du CO2, celui-ci est capté sous forme gazeuse puis pompé dans le sous-sol et y demeure sous la même forme, alors qu’ici le CO2 s’amalgame en un composé chimique solide qui reste sous cette forme pendant des milliers d’années. Un exemple de roche ultramafique communément présente dans les résidus est la serpentine, constituée essentiellement de silicates de magnésium hydratés. Elle réagit naturellement avec le dioxyde de carbone de l’air pour former du carbonate de magnésium.
Minéralisation passive du carbone
Des recherches conduites en AustralieOccidentale, à la mine de nickel du mont Keith exploitée par Nickel West (groupe BHP), montrent qu’une année de résidus capte actuellement dans les 40 000 tonnes de CO2, et ce sans aucun traitement spécial. Ce phénomène naturel est appelé minéralisation passive du carbone. De surcroît, ces résidus ont le potentiel de capter 4 millions de tonnes de CO2, quoique la réaction chimique à l’œuvre soit très lente. De même, un rapport concernant la mine de nickel et de cobalt Dumont, dans le nord du Québec, a indiqué que ses résidus pourraient capter 21 000 tonnes de CO2 par an de manière passive au cours de ses 33 années de durée de vie prévue.
Les moyens d’accélérer cette minéralisation sont actuellement à l’étude en laboratoire. Avec de telles techniques, nombre de mines pourraient devenir non seulement carboneutres, mais aussi carbonégatives. Cela est particulièrement intéressant pour les mines produisant des métaux destinés aux

batteries de véhicules électriques (EV), leurs acheteurs souhaitant savoir si elles ont été produites de manière éthique et écoresponsable.
Opérationnalisation du procédé
La carbonégativité est un objectif majeur de la société Canada Nickel pour son projet Crawford, qui vise à exploiter une mine de sulfates de nickel et de cobalt près de Timmins, en Ontario. À cet effet, elle a créé un procédé novateur intégrant la carbonatation des résidus au circuit de traitement, de manière à capter le CO2 directement à partir d’un flux concentré provenant par exemple d’une centrale électrique au gaz naturel. Selon Mark Selby, PDG de Canada Nickel, « Ces essais en laboratoire nous amènent à mieux comprendre comment opérationnaliser ce procédé pour créer une mine de nickel qui soit productrice nette de crédits carbone plutôt qu’émettrice de carbone ».
De façon similaire, d’autres projets de mine de nickel étudient les moyens d’accélérer la réaction chimique. FPX Nickel a réalisé des essais sur les résidus de son projet Baptiste, dans le centre de la Colombie-Britannique. Selon son PDG, Martin Turenne, « FPX s’honore de jouer un rôle moteur dans l’application des sciences fondamentales à l’évaluation des possibilités de captage et de séquestration permanente du CO2 à grande échelle dans le secteur minier ». Et Giga Metals finance des recherches visant à déterminer comment séquestrer du CO2 avec les résidus du gisement de Turnagain, qu’elle s’apprête à exploiter au nord de la Colombie-Britannique.
Le manteau terrestre se compose de roches ultramafiques, qui offrent un énorme potentiel de captage du CO2. Bien que cet article porte surtout sur les mines de nickel, le captage naturel du CO2 par les roches ultramafiques peut être mis à profit par bien d’autres types d’entreprises minières de par le monde.
Le manteau terrestre se compose de roches ultramafiques, qui offrent un énorme potentiel de captage du CO2
NICKEL, VOL. 37, Nº 3. 2022 | 13
–
JEAN-MICHEL HAROUY
CREATIVE COMMONS
Le saviez-vous ?
Les experts du Nickel Institute répondent à vos questions
Geir Moe est l’ingénieur chargé de coordonner le service d’information technique du Nickel Institute. Constituée d’experts techniques situés dans le monde entier, son équipe se tient à la disposition des utilisateurs et prescripteurs de matériaux contenant du nickel pour leur apporter gratuitement des conseils techniques sur une vaste gamme d’utilisations de ce métal (aciers inoxydables, alliages de nickel, nickelage, etc.) et leur permettre ainsi de tirer parti de ses nombreux avantages en toute confiance. https://inquiries.nickelinstitute.org/

NICKEL EN LIGNE

WWW.NICKELINSTITUTE.ORG
ABONNEZ-VOUS pour recevoir gratuitement un exemplaire imprimé de la revue Nickel en anglais ou un avis par courriel dès la parution d’un nouveau numéro. www.nickelinstitute.org
LISEZ la revue Nickel (disponible en ligne en plusieurs langues).
www.nickelinstitute.org/library/
CONSULTEZ LES ANCIENS NUMÉROS de la revue Nickel dans nos archives en ligne, qui remontent jusqu’à juillet 2009. www.nickelinstitute.org/library/
SUIVEZ-NOUS sur Twitter : @NickelInstitute
JOIGNEZ-VOUS À NOUS sur LinkedIn, en visitant la page du Nickel Institute.
VISIONNEZ les vidéos de la chaîne YouTube du Nickel Institute : www.youtube.com/user/NickelInstitute
QQuestion : J’ai reçu des plaintes d’un client qui fabrique des éviers, des poêles et des casseroles par emboutissage profond à partir d’acier inoxydable de nuance 304L (UNS S30403). Le matériau se comporte bien lors de sa mise en forme, mais des fi ssures apparaissent au bout d’un certain temps.
RL’acier inoxydable au nickel de nuance 304L, qui présente une microstructure austénitique, est métastable, ce qui veut dire que la déformation plastique lui confère une certaine teneur en martensite (dite martensite d’écrouissage). Cette autre microstructure, qui est moins ductile et se forme dans les zones écrouies, est susceptible de se fi ssurer sous l’effet de l’hydrogène présent dans l’acier inoxydable. En raison de l’écrouissage, l’hydrogène se diffuse dans la martensite et finit par entraîner une fi ssuration. Cette diffusion prend du temps, si bien que la fi ssuration est différée. Le risque de fi ssuration de l’acier inoxydable dépend largement de sa composition. Une teneur en nickel plus élevée et
une moindre teneur en carbone et en azote aident à prévenir la fi ssuration. Les aciers inoxydables à plus forte teneur en nickel, comme ceux de nuance 305 (S30500) ou 316L (S31603), présentent des microstructures plus stables et résistent ainsi à la formation de martensite d’écrouissage et donc à la fi ssuration différée.
Ce phénomène s’observe également avec les aciers inoxydables de la série 200, dont la teneur en manganèse est plus élevée. Le manganèse est aussi un stabilisateur de l’austénite utilisé pour les teneurs en nickel moins élevées ; cependant, il ne stabilise pas aussi bien la phase austénitique en présence de chrome, celui-ci étant un puissant stabilisateur de la ferrite. Par conséquent, la teneur en chrome de ces aciers inoxydables austénitiques à faible teneur en nickel doit être réduite, ce qui nuit à leur résistance à la corrosion, et ils restent sujets à la formation de martensite en cas de déformation plastique. La moindre résistance à la corrosion et le risque de fi ssuration différée sont les facteurs limitant l’emploi des aciers inoxydables austénitiques à faible teneur en nickel de la série 200.
14 | NICKEL, VOL. 37, Nº 3. 2022
14 VOL. Nº 3.
Nouvelles publications et nouvelle vidéo
Le guide de sélection des matériaux pour les stations de dessalement intitulé Materials selection for desalination plants (11 029) est une nouvelle publication portant sur l’emploi de différents alliages, notamment au nickel, dans le dessalement de l’eau. Il examine les trois procédés les plus courants : la distillation à détentes étagées, la distillation à effets multiples et l’osmose inverse de l’eau de mer. Celle-ci est devenue le procédé privilégié, car elle est très modulable (ce qui facilite la montée en capacité de la station et l’adaptation de la production à la demande), elle peut être alimentée par des énergies renouvelables (solaire et éolien) et elle produit une eau potable de qualité revenant généralement moins cher.


Rééditions d’articles de revue Le Nickel Institute a réédité plus de 90 articles de revue présentant







































d’importants emplois des matériaux contenant du nickel.

Toutes les publications sont disponibles en téléchargement gratuit sur www.nickelinstitute.org.
Garantir l’approvisionnement en nickel


Dans une courte vidéo intitulée Securing Nickel for the Future, Mark Mistry, expert du Nickel Institute, répond à des questions fréquentes à propos du nickel. Y a-t-il assez de nickel pour satisfaire la demande à venir ? Peut-on utiliser aussi bien des minerais latéritiques que des minerais sulfureux pour produire des batteries ? Le nickel est-il une matière première critique ? Quelle est la différence entre réserves de nickel et ressources en nickel ? Qu’en est-il du recyclage et des futurs défi s du secteur ? À voir sur la chaîne YouTube du Nickel Institute.



NICKEL, VOL. 37, Nº 3. 2022 | 15
Composition chimique des alliages et aciers inoxydables mentionnés dans ce numéro de Nickel (en pourcentage massique). UNS Al B C Co Cr Cu Fe Mn Mo N Nb Ni P S Si Ti W Autres C70600 P. 11 - - - - - restant 1,0 à 1,8 1,0 max. - - 9,0 à 11,0 - - - - - Pb : 0,05 max. Zn : 1,0 max. J93380 P. 11 - - 0,03 max. - 24,0 à 26,0 0,5 à 1,0 restant 1,00 max. 3,0 à 4,0 0,20 à 0,30 - 6,5 à 8,5 0,030 max. 0,025 max. 1,00 max. - 0,5 à 1,0J93404 P. 11 - - 0,03 max. - 24,0 à 26,0 - restant 1,50 max. 4,0 à 5,0 0,10 à 0,30 - 6,0 à 8,0 0,04 max. 0,04 max. 1,00 max. - -N07718 P. 2 0,020 à 0,080 0,006 max. 0,08 max. 1,0 max. 17,0 à 21,0 0,30 max. restant 0,35 max. 2,80 à 3,30 - 4,75 à 5,25 50,0 à 55,0 0,015 max. 0,015 max. 0,35 max. 0,65 à 1,15 -N08367 P. 11 - - 0,030 max. - 20,0 à 22,0 0,75 max. restant 2,00 max. 6,00 à 7,00 0,18 à 0,25 - 23,5 à 25,5 0,040 max. 0,030 max. 1,00 max. - -N08926 P. 11 - - 0,020 max. - 19,0 à 21,0 0,50 à 1,50 restant 2,00 max. 6,00 à 7,00 0,15 à 0,25 - 24,0 à 26,0 0,030 max. 0,010 max. 0,50 max. - -S30100 P. 16 - - 0,15 max. - 16,0 à 18,0 - restant 2,00 max. - 0,10 max. - 6,0 à 8,0 0,045 max. 0,030 max. 1,00 max. - -S30403 P. 14 - - 0,03 max. - 18,0 à 20,0 - restant 2,00 max. - - - 8,0 à 12,0 0,045 max. 0,030 max. 1,00 max. - -S30500 P. 14 - - 0,12 max. - 17,0 à 19,0 - restant 2,00 max. - - - 10,0 à 13,0 0,045 max. 0,030 max. 1,00 max. - -S31254 P. 11 - - 0,020 max. - 19,5 à 20,5 0,50 à 1,00 restant 1,00 max. 6,0 à 6,5 0,18 à 0,22 - 17,5 à 18,5 0,030 max. 0,010 max. 0,80 max. - -S31603 P. 2 et 14 - - 0,030 max. - 16,0 à 18,0 - restant 2,00 max. 2,00 à 3,00 - - 10,0 à 14,0 0,045 max. 0,030 max. 1,00 max. - -S32205 P. 2 - - 0,030 max. - 22,0 à 23,0 - restant 2,00 max. 3,00 à 3,50 0,14 à 0,20 - 4,50 à 6,50 0,030 max. 0,020 max. 1,00 max. - -S32750 P. 11 - - 0,030 max. - 24,0 à 26,0 - restant 1,20 max. 3,0 à 5,0 0,24 à 0,32 - 6,0 à 8,0 0,035 max. 0,020 max. 0,80 max. - -S32760 P. 11 - - 0,030 max. - 24,0 à 26,0 0,50 à 1,00 restant 1,00 max. 3,0 à 4,0 0,20 à 0,30 - 6,0 à 8,0 0,030 max. 0,010 max. 1,00 max. - 0,50 à 1,00Distributed by NICKEL INSTITUTE NICKEL’S CONTRIBUTION IN AIR POLLUTION ABATEMENT C.M. SCHILLMOLLER 10007
Codes UNS
UN SCOOTER PLIÉ AU GOÛT DU JOUR
Voilà une sorte d’origami industriel où des robots plient des feuilles d’acier inoxydable pour en faire des motos et des scooters d’une seule pièce. La jeune entreprise suédoise STILRIDE était déterminée à créer un scooter électrique léger offrant la plus petite empreinte carbone possible. En gestation depuis des années, leur première création, le Sport Utility Scooter One (SUS1), battra la chaussée fi n 2022.
Fabriqué à partir d’une feuille d’acier inoxydable Forta 301 d’Outokumpu (UNS S30100) passée au laminoir d’écrouissage, ce scooter léger alimenté par batterie au lithium a une empreinte carbone trois fois inférieure à celle des autres scooters.



Les deux fondateurs, Jonas Nyvang et Tue Beijer, ont donné vie avec leur équipe à une méthode de conception et de construction de véhicules utilisant des feuilles d’acier selon une technique exclusive baptisée STILFOLD. Dépassant la tradition, ils pratiquent un origami industriel robotisé consistant à réaliser des structures en pliant une feuille de métal sans trahir les caractéristiques et la nature géométrique du matériau. Le pliage en courbe est une technique artisanale bien établie, mais rarement utilisée en fabrication industrielle. Les scooters sont d’ordinaire constitués d’un cadre
tubulaire et d’un carénage en plastique, alors que le châssis du SUS1 est construit par découpe et pliage d’une seule feuille d’acier inoxydable. Selon l’entreprise, cette méthode peut réduire de beaucoup l’impact environnemental de la production par rapport aux techniques de fabrication usuelles, car elle nécessite moins de pièces et de matières premières.
Il s’agissait de construire le scooter électrique le plus attrayant et le plus écologique au monde. Résultat : Une monture d’élégance dépassant la tradition pour les scootéristes d’aujourd’hui.




NICKEL, VOL. 37, Nº 3. 2022
JORIS LAARMAN