CLIMAT
La guerre de l’eau aura-t-elle lieu ?
VRAI / FAUX
Testez vos connaissances sur la mobilité électrique !
Johanna Sommer « Prendre soin de la planète, c’est prendre soin de notre santé »
CONSTRUIRE À Rolle, des chais exemplaires


VRAI / FAUX
Testez vos connaissances sur la mobilité électrique !
Johanna Sommer « Prendre soin de la planète, c’est prendre soin de notre santé »
CONSTRUIRE À Rolle, des chais exemplaires

3 Le mot de la rédaction, les astuces, les news, etc.
10 Johanna Sommer, professeure à la faculté de médecine de Genève
15 L’innovation au cœur de la transition agricole
20 La guerre de l’eau aura-t-elle lieu ?
26 Du photovoltaïque partout, vraiment ?
28 Des idées pour rafraîchir nos villes ?
30 Durabilité et vins : l’accord parfait de la Maison Schenk
34 Le vrai/faux de la mobilité électrique




IMPRESSUM • GO 2050
www.go2050.ch
Un magazine encarté dans
« Le Nouvelliste », « ArcInfo » et « La Côte »
ÉDITEUR
ESH Médias Editions SA
Rue de l’industrie 13
1950 Sion 027 329 77 11
www.impactmedias.ch valais@impactmedias.ch
RÉDACTION EN CHEF
Élodie Maître-Arnaud
DIRECTION ARTISTIQUE Xavier Cerdá
ONT CONTRIBUÉ À CE NUMÉRO
Rédaction Joëlle Loretan, Thomas Pfefferlé et Sylvie Ulmann
Mise en page : Xavier Cerdá, Pénélope Schori
Correction Adeline Vanoverbeke
Illustrations couverture et dossier principal : Amélie Touchet
DIRECTION COMMERCIALE
Quentin Riva
RESPONSABLE DES PARTENARIATS
Thomas Alostery
PUBLICITÉ VALAIS
Impact Medias Valais
Rue de l’Industrie 13
1950 Sion 027 329 77 11 valais@impactmedias.ch
PUBLICITÉ NEUCHÂTEL
Impact Medias Neuchâtel
Avenue du Vignoble 3
2000 Neuchâtel 032 723 52 00 neuchatel@impactmedias.ch
PUBLICITÉ VAUD
Impact Medias Vaud
Route de Saint-Cergue 293 1260 Nyon 022 994 42 44 vaud@impactmedias.ch
MARKETING ET COMMUNICATION
Mélina Deville
Laura Colin
SITE INTERNET
Marvin Baumgartner
IMPRESSION
Centre d’impression
romand (CIR)
Route du Triboulet 12 1870 Monthey
DIFFUSION
« Le Nouvelliste » : 34 000 exemplaires
« ArcInfo » : 108 000 exemplaires
« La Côte » : 88 000 exemplaires
Le 9 avril dernier, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) condamnait la Suisse pour inaction face au changement climatique. Attaquée par l’association des Aînées pour la protection du climat (2500 Suissesses âgées de 64 ans et plus), la Suisse est le premier État qui fait l’objet d’une condamnation pour ce motif. La Cour a notamment affirmé que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme consacre le droit à une protection effective, par les autorités étatiques, contre les effets néfastes graves du changement climatique sur la vie, la santé, le bien-être et la qualité de vie.
C’est dans ce contexte que nous avons interviewé la professeure Johanna Sommer (lire « La rencontre » page 10), responsable du cursus de santé planétaire à la faculté de médecine de l’Université de Genève. Nous l’avons notamment questionnée sur les façons dont nous pouvons stimuler le changement de nos comportements, sans culpabiliser ni angoisser.

Nous nous sommes également penchés sur les enjeux de la protection de l’eau (lire « Le dossier », page 20). Car si la source n’est pas près de tarir en Suisse, les tensions sur la ressource nous amènent toutefois à réinventer notre approche de la gestion de l’eau afin d’en préserver tous les usages.
C’est encore dans cette approche « orientée solutions », chère à go2050, que nous avons rencontré d’autres actrices et acteurs des domaines de l’agriculture, de la construction ou encore de l’énergie pour partager avec vous autant de défis passionnants à relever collectivement, pour avancer sur le chemin de la durabilité. En route !
Nous vous souhaitons une bonne lecture ! o
Élodie Maître-Arnaud Rédactrice en chef

ais nous n’y sommes pas pour grand-chose ! « Grâce au bon taux de remplissage des stocks de gaz en Europe et à une meilleure disponibilité des centrales nucléaires françaises, les conditions de l’hiver prochain devraient être plus favorables que celles des deux hivers précédents. » C’est en ces termes rassurants qu’ElCom (la Commission fédérale de l’électricité) a fait part de ses prévisions pour la prochaine saison froide. Elle relève toutefois la forte influence des conditions météorologiques sur la sécurité de l’approvisionnement en électricité (températures douces réduisant la demande d’électricité et de gaz, et précipitations abondantes permettant à la Suisse d’enregistrer une production hydroélectrique record). o

Cette année, la Suisse n’aura pu compter sur ses propres ressources que jusqu’au 17 avril inclus. Une date que la Fondation suisse de l’énergie appelle « la journée de l’indépendance énergétique ». Bien sûr, la Suisse produit et exporte de l’énergie tout au long de l’année ; mais cette date exprime symboliquement que nos ressources locales ne permettent de couvrir nos propres besoins en électricité que durant 108 jours sur 366 en 2024. o

Les centrales nucléaires ne sont plus considérées comme « très dangereuses » pour l’être humain et l’environnement que par un quart des personnes sondées dans le cadre de la dernière enquête sur le thème de l’environnement réalisée par l’Office fédéral de la statistique. Elles étaient près d’une sur deux à craindre l’atome en 2012. L’initiative « De l’électricité pour tous en tout temps (Stop au blackout) » a quant à elle abouti. o

Le bonheur est-il compatible avec la durabilité ? C’est la question que s’est posée le sociologue Gaël Brulé dans cet ouvrage paru aux Presses polytechniques et universitaires romandes. Dans un contexte où le bien-être de notre société repose largement sur un imaginaire consumériste, est-il encore possible d’être heureux sans se soucier des limites planétaires ? o
➜ Le livre est disponible en Open Access en scannant le code QR ci-contre.

Les CFF ont annoncé vouloir diminuer de moitié leurs émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030, par rapport à 2018. Technologies novatrices à bord des trains, pose d’installations photovoltaïques, recours à des machines de chantier efficientes, économie circulaire : pas moins de 200 projets de développement durable sont ainsi en cours afin d’assurer que le rail demeure le moyen de transport le plus respectueux du climat. Les CFF rappellent que si 15% de trains en plus circulent aujourd’hui par rapport à 2010, ils consomment 5% d’énergie en moins. Un résultat obtenu grâce à une augmentation de 21% de l’efficacité énergétique. Symboliquement, l’entreprise a passé en vert la trotteuse de quelquesunes de ses célèbres horloges, à Lausanne, Zurich et Bellinzone. o
C’est ce que contiendrait une demeure américaine moyenne, selon un article paru dans le magazine en ligne canadien « L’actualité ». 300 000 choses à fabriquer, transporter, parfois jeter, et une démesure qui concerne sans doute aussi nombre d’entre nous. À méditer. o

Inondations, tempêtes, feux de forêts, vagues de chaleur : en Europe, le bilan 2023, dressé par le service Copernicus et l’Organisation météorologique mondiale (OMM), est catastrophique. Et cela ne devrait malheureusement pas s’arranger. Avec une hausse moyenne des températures de 2,5°C par rapport à l’ère préindustrielle, le Vieux Continent se réchauffe en effet presque deux fois plus vite que le reste du monde. À la clé, la multiplication de ces événements climatiques extrêmes. o



BÂTIMENTS
Selon l’inventaire annuel de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), en 2022, le secteur du bâtiment a émis 9,4 millions de tonnes d’équivalent CO2, soit 44% de moins qu’en 1990. Et ce, bien que les surfaces chauffées aient augmenté de plus de 50% au cours de cette période. L’OFEV rappelle toutefois que l’hiver 2022 a été particulièrement doux, ce qui a donné lieu à une consommation moindre de gaz et de mazout pour le chauffage. La tendance à la baisse depuis 1990 s’explique quant à elle surtout par l’amélioration de l’efficacité énergétique et par l’installation croissante de pompes à chaleur, notamment lors de l’assainissement de bâtiments. Sur la même période, les émissions liées aux transports ont enregistré une baisse de seulement 8%. o


LA PETITE CHRONIQUE
par Sylvie Ulmann
En rangeant ma cave, j’y ai découvert trois vélos. Et si je pédalais davantage au quotidien ? Aucun membre de ce trio n’est électrique, mais je suis plutôt sportive. Précisons que j’habite Lausanne, ville en pente. Dix étages séparent mon sweet home de mon bureau. Sauf météo exécrable ou chargement pesant, je les parcours allégrement à pied, tous les jours, depuis des années. Changer de mode de transport pour pédaler me permettrait de varier les plaisirs et peut-être d’économiser un peu de temps. Une seule tentative a néanmoins suffi à me convaincre que je resterai piétonne sur ce trajet-là : en arrivant à destination, je marche sur ma langue et j’ai des crampes aux oreilles et aux genoux à force de les serrer pour éviter les véhicules qui me collent aux flancs. Bilan : cinq minutes de gagnées. « Passe à l’électrique », me recommande un ami cycliste. Il a le bon goût de ne pas ajouter « à ton âge », mais oublie qu’une volée de marches sépare l’abri à vélos de la route. Un mur infranchissable avec un monstre pesant la moitié de mon poids. Moralité : avant d’opter pour une monture rechargeable, cherchez où la garer. Sinon, par beau temps et sans sacs à commissions (un cauchemar pour l’équilibre, prenez un sac à dos !), j’ai adopté ce mode de déplacement sur plusieurs trajets, notamment ceux qui longent le lac, pas toujours idéalement desservi par les transports publics. Si l’aventure du deux-roues vous tente, essayez-le avant de l’acheter. Bon plan : outre des biclous mécaniques, le réseau PubliBike loue aussi des modèles électriques ! o

La Suisse ne manque pas d’atouts dans le domaine des technologies propres, comme en témoigne le quatrième rapport sur les cleantechs suisses, paru il y a quelques semaines. Une centaine d’industries, PME et start-up innovantes sont mises en lumière dans cette publication, confirmant que notre pays est un terreau fertile pour apporter des réponses concrètes aux défis en lien avec le développement durable et le changement climatique. o
➜ Le Swiss Cleantech Report peut être consulté gratuitement ici (en anglais).
Une douzaine d’entreprises et d’instituts de recherche européens, parmi lesquels le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (Empa), vont plancher sur la gestion de l’énergie dans les bâtiments dotés d’une importante infrastructure informatique. Le but de ce vaste projet, baptisé HEATWISE ?
Récupérer la chaleur résiduelle de ces dispositifs et l’intégrer au système de chauffage de certains bâtiments truffés d’appareils techniques et d’instruments informatiques, comme les hôpitaux, les universités et les immeubles de bureaux. Ou comment appliquer le zéro déchet à la technique du bâtiment. o

Avec un interlocuteur unique et un service clés en main, vous économisez de l’énergie en toute simplicité.
genedis.ch

La Commission internationale pour la protection des eaux du Léman (Cipel) a annoncé que 2024 est la douzième année consécutive sans brassage complet des eaux du Léman. En résulte une concentration en oxygène des couches profondes à un niveau qualifié de « préoccupant » pour la santé de l’écosystème lacustre. Selon la Cipel, la perspective d’un brassage hivernal complet s’éloigne avec la hausse des températures induite par le réchauffement climatique. Privés d’oxygène, les organismes vivant en profondeur sont ainsi menacés de disparition. o
Plus de la moitié des toitures suisses seraient éligibles à la production d’électricité photovoltaïque, selon une étude de l’EPFL. Et deux stratégies ont été analysées par les auteurs de cette dernière pour optimiser cette production : d’abord, équiper en priorité les grands toits plats (hangars industriels ou agricoles, par exemple) ; ensuite, équilibrer la production d’énergie à l’échelle régionale. En fusionnant ces 5 millions de toits, 70% des communes suisses pourraient ainsi atteindre l’autonomie énergétique. o


Une centaine de personnes ont assisté au premier forum GO 2050 consacré aux rénovations énergétiques en Valais, à la fin du mois d’avril. Sur le thème « À vos marques, prêts, rénovez ! », six spécialistes ont éclairé le grand public sur les enjeux, le cadre réglementaire, les étapes et les leviers d’action des travaux d’assainissement d’une habitation. Nous donnerons prochainement rendez-vous à nos lecteurs vaudois et neuchâtelois pour deux nouvelles conférences sur ce thème. o
➜ Suivez-nous sur www.go2050.ch pour ne pas manquer l’annonce de ces événements !
Energy Green, nous prenons chaque projet solaire comme un
Chacun vit différemment, c’est pourquoi nous tenons compte de vos habitudes, de votre situation et de votre mode de vie pour construire un projet solaire cohérent, répondant ainsi à vos besoins quotidiens.
Nos devis sont sur mesure et gratuit.

UN PROJET SOLAIRE ? RENCONTRONS NOUS POUR EN PARLER !


QUALITÉ DE L’AIR
En 2023, seuls sept pays ont respecté la recommandation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la limite d’exposition annuelle aux particules fines. C’est ce que révèle un rapport sur la qualité de l’air dans le monde, publié par la société suisse IQAir. Dans le peloton de tête : l’Australie, l’Estonie, la Finlande, Grenade, l’Islande, l’île Maurice et la Nouvelle-Zélande, mais pas la Suisse… La qualité de l’air dans notre pays est toutefois classée « bonne », avec une concentration annuelle moyenne en particules fines 1,8 fois plus élevée que la valeur indicative fixée par l’OMS. Le rapport se base sur les données de plus de 30 000 stations de surveillance de la qualité de l’air, réparties dans 134 pays, territoires et régions du monde. o
La fondation zurichoise pour le cinéma et la SRR ont lancé Green Shooting, un calculateur d’empreinte carbone des productions audiovisuelles. Depuis peu, un rapport d’émissions doit être joint à toute demande de bourse de financement à la fondation par les sociétés de production. Selon des chiffres de la British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), cités par « Le Temps », les émissions liées aux combustibles (hors transport aérien) représentent la moitié de l’empreinte carbone


Ce lundi d’avril, la salle 23 du Théâtre de Vidy de Lausanne était quasi comble à l’occasion de la présentation de Léa Falco. La jeune porte-parole du collectif Pour un réveil écologique et employée au Ministère de la transition en France a ouvert le cycle d’événements « 2040, j’y vais ! », organisé par l’association du Hub des possibles. Elle a évoqué ce « triangle de l’inaction » dans lequel les pouvoirs publics, les entreprises et la population se trouvent, chacun attendant que l’autre agisse. Sans éluder les réalités et complexités, elle a dessiné des solutions pour que les différents groupes puissent faire écologie ensemble. o
➜ Retrouvez la vidéo de la soirée en scannant le code QR ci-contre.

Drôle d’invitation que celle de « La preuve par le slip », une action à l’initiative d’Agroscope et de l’Université de Zurich. L’objectif ? Attirer notre attention sur le rôle important des sols et de leurs habitants. Une prise de conscience qui doit conduire à mieux les protéger et les préserver. Mais quel est le rapport avec nos culottes ? L’action consiste à enfouir un slip en coton (ça marche aussi avec n’importe quel carré de tissu dans cette matière naturelle) pendant deux mois. Passé ce délai, on le déterre et on observe. Le stade de décomposition du tissu donne en effet des indications sur les activités biologiques qui se déroulent dans le sol, comme autant de signes de la vitalité des petits organismes qui le peuplent. o ➜ Plus d’infos sur www.preuve-par-slip.ch
PROFESSEURE À LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE GENÈVE I RESPONSABLE DU CURSUS SANTÉ PLANÉTAIRE
Changement climatique, pollution, accès à l’eau, effondrement de la biodiversité, la dégradation de notre environnement est aussi un enjeu mondial de santé publique. La professeure Johanna Sommer, responsable du cursus santé planétaire à la faculté de médecine de l’Université de Genève, plaide pour l’intégration des questions environnementales dans les pratiques médicales.
Propos recueillis par
ÉLODIE MAÎTRE-ARNAUD • Photographies PIERRE VOGEL
Et si la préservation de notre santé était l’argument ultime pour lutter contre la crise environnementale ? Pour les scientifiques, le constat est sans appel : si la planète va mal, ce sont tous ses habitants qui vont souffrir. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), cette crise serait même la plus grande menace sur la santé humaine de ce siècle. C’est pour relever ce défi
sanitaire que la « santé planétaire » a émergé il y a une dizaine d’années. Ce mouvement vise non seulement à comprendre les conséquences néfastes des dégradations de l’environnement sur notre santé, mais aussi à proposer des solutions pour soigner en nuisant le moins possible à notre planète. Car si la pollution et le changement climatique rendent malade, nos systèmes de santé pèsent, eux aussi, lourdement sur l’environnement. Un cercle vicieux ? Pour en parler, nous avons rencontré Johanna Sommer, médecin de famille à Genève. Elle est également professeure de médecine interne générale à la faculté de médecine de l’Université de Genève et responsable du cursus santé planétaire.
go2050 En quoi le changement climatique affecte-t-il notre santé ?
Johanna Sommer Je préfère faire le lien entre la santé et la crise environnementale en général, dont le changement climatique est un aspect important, mais pas le seul. La vie devient difficile par endroits sur la planète, et les conséquences de cette crise sur notre santé sont déjà perceptibles. La mortalité infantile a ainsi de nouveau augmenté au niveau mondial depuis le début du XXIe siècle, et le lien est clairement établi avec les problèmes environnementaux.
De même, la courbe de l’augmentation de l’espérance de vie s’infléchit désormais dans les pays européens et diminue au niveau mondial.
Plus précisément, quelles sont les menaces de cette crise environnementale et leurs conséquences sanitaires ?
Les personnes âgées et celles qui sont atteintes de maladies chroniques souffrent de plus en plus des canicules estivales, avec un surplus de mortalité important depuis plusieurs années. La pollution de l’air augmente les affections respiratoires ; nous développons aussi toujours davantage d’allergies et de troubles immunitaires. Le changement climatique et la destruction de certains habitats naturels favorisent le développement des zoonoses (les maladies infectieuses passant de l’animal à l’homme).
Les dégradations de l’environnement et les problèmes d’accès à l’eau entraînent des mouvements massifs de population, avec des répercussions sur leur santé. La menace est mondiale, mais ce sont les plus vulnérables qui souffrent en premier.
Quid de notre santé mentale ?
On observe une éco-anxiété grandissante, surtout parmi les plus jeunes. C’est sans doute l’impact le plus sournois de cette crise environnementale sur notre santé. Certains d’entre eux disent même ne pas vouloir d’enfants. Nous assistons à une véritable crise générationnelle remettant en question nos valeurs.
« Les conséquences de la crise environnementale sur notre santé sont déjà perceptibles. »


« Le concept de santé planétaire fait le lien entre la santé humaine et la santé de la planète, comme élément fondamental de toute forme de vie. »
Ces risques sanitaires sont-ils aujourd’hui bien documentés ?
Oui, le corpus de science et de savoir s’accumule, et ces risques sont clairement documentés par de nombreuses études. Le prestigieux journal médical The Lancet a notamment lancé
The Lancet Planetary Health, qui publie depuis plusieurs années des recherches en lien avec la santé planétaire. Le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) tire lui aussi la sonnette d’alarme depuis long-
temps. La science est beaucoup plus avancée que ce que l’on en sait ! Et, selon moi, le problème n’est pas pris en compte à la mesure de sa gravité.
Pouvez-vous expliquer ce concept de « santé planétaire » ?
Il est né de la prise de conscience par la communauté scientifique de son devoir d’informer la population sur l’influence de nos comportements et de nos modes de vie sur notre environnement, et sur les implications très importantes qui en résultent en matière de santé. Ce concept fait le lien entre la santé humaine et la santé de la planète, comme élément fondamental de toute forme de vie. Il va de pair avec la nécessité d’agir pour réduire l’empreinte environnementale des soins. Tout cela est indissociable.
Nos systèmes de santé auraient donc, eux aussi, un impact négatif sur l’environnement… Bien sûr. On estime que l’empreinte climatique des systèmes de santé, au niveau mondial, représente 4,6% des émissions totales de CO2 C’est énorme, deux fois plus que le transport aérien ! Surtout si nous gardons à l’esprit que les soins n’influencent notre santé qu’à 10%. Les déterminants les plus importants de notre santé
sont, en effet, l’environnement, les ressources, l’éducation, ou encore les conditions et les habitudes de vie.
De quelle façon les soins polluent-ils ?
On en revient toujours à nos modes de vie. En Suisse, le poste le plus émetteur dans le domaine de la santé est le transport : les patients qui vont au cabinet, les médecins qui vont à l’hôpital, etc. La consommation de médicaments est aussi une source majeure de pollution, qu’il s’agisse de leur production (emballage, transport – souvent depuis le bout du monde) ou de leur élimination (accumulation dans l’environnement de substances nocives pour certaines espèces). Je peux encore citer l’impact des nombreux produits à usage unique et celui des technologies utilisées pour réaliser des examens médicaux.
Quels sont les leviers d’action pour limiter l’impact des soins ?
Il faut remettre la santé au centre, et les soins à leur juste place. En Suisse – et dans les pays développés en général –, il y a un gaspillage énorme. Attention, on ne va pas dire aux gens de ne plus aller chez le médecin, ni aux médecins de ne plus prescrire d’examens médicaux ! Il s’agit de faire le rapport entre coût environne -
mental et qualité des soins. La Suisse est ainsi parmi les meilleurs pays au monde en matière de soins. Mais on trouve également dans ce peloton de tête certains pays du nord de l’Europe, alors que leurs systèmes de santé utilisent deux fois moins de ressources que le nôtre. Certaines études ont, par exemple, montré que 40% des IRM du genou prescrites ne sont pas utiles aux patients. Près d’une sur deux ! Et chaque IRM émet l’équivalent CO2 de 160 km en voiture. Autre exemple : les traitements contre l’asthme en aérosols. Une étude anglaise montre que leur utilisation représente 30% de la pollution due aux médicaments dans ce pays, à cause des gaz utilisés ; soit l’équivalent CO2 de 100 à 120 km en voiture. Pourtant, on sait faire autrement ! À quelques exceptions près, on peut en effet prescrire le même traitement sous forme de poudre à inhaler, avec vingt fois moins d’impact. Nous devons vraiment inviter les médecins et futurs médecins à être beaucoup plus critiques sur l’empreinte environnementale des traitements et des examens prescrits. Encore une fois, il ne s’agit pas de renoncer à soigner, mais de privilégier les soins ayant le moins d’impact, d’éviter les examens et les traitements inutiles, et d’être beaucoup plus actif dans le domaine de la prévention.
« La menace est mondiale, mais ce sont les plus vulnérables qui souffrent en premier. »

Comment la communauté médicale s’empare-t-elle du problème ?
On a longtemps pensé que, parce que l’on s’occupe de soigner les humains, on fait forcément du bien à l’humanité. C’est faux ! Et de plus en plus d’associations médicales développent désormais un axe de réflexion sur la santé planétaire. L’Académie suisse des sciences médicales a également édité sa propre feuille de route et a créé un groupe de travail pour initier des changements dans les pratiques de la profession. Ça bouge vraiment à de nombreux niveaux, y compris dans les facultés de médecine. À Genève, où j’enseigne, c’est d’ailleurs à la demande des étudiants que nous avons mis en place, en 2021, un cursus longitudinal de santé planétaire. Nous avons conçu les cours en trois blocs : les menaces de la dégradation de notre environnement sur la santé humaine, l’impact environnemental des systèmes de santé, et le rôle et la responsabilité des médecins.
Justement, comment les médecins peuvent-ils communiquer ces messages auprès du grand public ? Et comment est-ce perçu par les patients ?
« On estime que l’empreinte climatique des systèmes de santé, au niveau mondial, représente 4,6% des émissions totales de CO2. Deux fois plus que le transport aérien ! »




Sur une année, on estime que les médecins généralistes en Suisse voient, au moins une fois, 90% de la population. Nous avons donc non seulement accès à un grand nombre de personnes, mais aussi une relation de confiance avec elles, ce qui donne du poids à ces messages. Il ne s’agit ni de culpabiliser nos patients, ni de provoquer chez eux de l’éco-anxiété, ni de les limiter dans leurs traitements. Nous insistons beaucoup sur la notion de co-bénéfices, en mettant en avant les changements de comportements bénéfiques tant pour leur santé que pour celle de l’environnement. C’est vraiment de la prévention : nous les incitons par exemple à davantage marcher que prendre leur voiture, à manger moins de viande, à prendre moins de médicaments. C’est en ce sens que nous avons lancé, avec deux pédiatres genevois, l’initiative « 12 mois, 12 actions » au début de l’année (lire l’encadré, ndlr). L’information des
patients exige aussi du médecin d’être très transparent lorsqu’il décide de ne pas procéder à un examen inutile ou de préférer tel traitement. Le plus souvent d’ailleurs, les patients comprennent très bien ce langage. Nous devons également nous efforcer de montrer l’exemple, notamment en adoptant des mesures d’efficacité énergétique dans nos cabinets ; ce sont des détails qui, certes, ne changeront pas l’état de la planète, mais qui ont quand même leur importance.
Demeurez-vous optimiste sur les capacités de l’humanité à renverser la vapeur ?
Je ne veux surtout pas être alarmiste, mais je pense que nous ne sommes globalement pas prêts à renoncer à nos modes de vie, parce que nous ne sommes pas encore véritablement affectés par la dégradation de notre environnement dans des pays chanceux comme la Suisse. À commencer par moi, qui ne prétends pas être exemplaire en tous points ! Je reste cependant optimiste, car je crois à l’intelligence de l’homme et à sa capacité à réagir. Cessons donc de nous comporter comme notre pire ennemi et apprenons à revenir à l’essentiel, pour notre santé et pour celle de l’environnement ! o
Stimuler le changement sans culpabiliser ni angoisser. Voilà l’objectif de cette campagne lancée au mois de janvier dernier par la Prof. Johanna Sommer et deux pédiatres genevois, la Dre Martine Bideau et le Dr Jean-Yves Corajod. En collaboration avec l’Université de Genève, la Société genevoise de pédiatrie et une équipe d’étudiants en médecine, le projet propose chaque mois une action « santé » bénéfique tant pour les personnes que pour l’environnement. Qualité de l’alimentation, activité physique ou encore diminution de la consommation d’antibiotiques : à l’occasion des consultations, les médecins de famille sont ainsi encouragés à aborder avec leurs patients les bons réflexes et les avantages de divers comportements, sur la base d’infographies très pédagogiques et rigoureusement documentées. « Ce sont des mesures simples, que chacun d’entre nous peut mettre en place à son échelle », relève Johanna Sommer. « Même si un seul individu ne changera pas les choses, il faut agir à tous les niveaux pour enrayer la détérioration de notre planète et de notre santé. » La campagne est soutenue par la « Revue médicale suisse », qui relaie notamment les infographies dans ses pages. o
Réalisé pour Le PAL
Très engagé pour la préservation de la biodiversité et l’environnement, Le PAL n’est pas un parc de loisirs comme les autres. Situé en Auvergne, à trois heures de Genève, il conjugue attractions, réserve animalière et hébergements immersifs, sur fond de sensibilisation de ses visiteurs.
Trente et une attractions, 1000 animaux, 50 hectares de nature, 31 lodges et un hôtel de 60 suites au cœur de la savane africaine. Avec plus de 750 000 visiteurs en 2023 (dont 25% de Suisses dans la clientèle hôtelière), Le PAL se place dans le top 5 des parcs d’attractions les plus visités en France. Fondé en 1973, il est le seul à proposer attractions, réserve animalière et hébergements immersifs. Il se distingue également par une volonté de transmission des connaissances, à travers de nombreux programmes et animations pédagogiques, et par son engagement dans une démarche de tourisme durable. « Au-delà du ludique, nous avons pris le parti de la sensibilisation du public, en particulier des enfants, au respect de la biodiversité et de l’environnement », résume Arnaud Bennet, le président du PAL.
VISITEURS ET FUTURS AMBASSADEURS DE LA BIODIVERSITÉ
Pour ce faire, Le PAL a notamment créé l’Académie Le PAL. Elle propose diverses activités pédagogiques hebdomadaires en lien avec l’environnement, sur un cycle de trois ans. L’objectif est de sensibiliser les enfants et les adultes aux enjeux de préservation de la planète et d’en faire des ambassadeurs de la biodiversité auprès de leurs proches. Pour une expérience plus immersive, l’Académie Le PAL a récemment lancé des camps d’été sans hébergement, pour une semaine de découverte de la nature et des animaux. De nombreuses animations sont également proposées chaque jour aux visiteurs par l’équipe de soigneurs.

Afin de témoigner de sa solidarité, Le PAL a par ailleurs créé La Fondation Le PAL Nature en 2008. Dotée d’un programme d’action pluriannuel de cinq ans, pour un budget total de plus de 1 million d’euros, elle a pour but d’agir pour la conservation de la biodiversité, notamment des espèces animales sauvages menacées et de leur habitat, partout dans le monde.
D’ICI À 2025
Autant d’initiatives qui ont permis au PAL d’obtenir la certification internationale Green Globe dès 2009, avant de se voir récompensé par le label Divertissement durable, l’émotion responsable en 2021. Ce label vise à développer une prise de conscience des problématiques environnementales et sociales dans les sites de loisirs et culturels, et à engager un mouvement des professionnels du divertissement pour répondre à ces enjeux.
Pleinement inscrit dans cette démarche, Le PAL a mis en place plusieurs mesures témoignant notamment de ses engagements environnementaux, comprenant, entre autres, la filtration naturelle par les plantes de toutes les eaux usées du parc, le recyclage des déchets ou encore le remplacement du chauffage au gaz par des chaudières à bois pour chauffer les principaux bâtiments du parc. Le PAL entend également atteindre un quart d’autonomie de consommation électrique à l’horizon 2025, grâce à la créa-
tion d’un parc de 1 hectare de panneaux solaires au sol. Douze hectares d’ombrières photovoltaïques seront progressivement installées audessus des parkings; l’électricité produite sera revendue au réseau national. « Nous devons montrer l’exemple si nous voulons être crédibles dans notre message de sensibilisation au respect de l’environnement », conclut Arnaud Bennet. o
OUVERTURE 2024
Parc : jusqu’au 29 septembre inclus
Tél. +33 470 42 68 10
Savana réserve : jusqu’au 29 septembre inclus
Tél. +33 470 48 72 62
Les Lodges du PAL : jusqu’au 2 novembre inclus
Tél. +33 470 48 72 00
Saint-Pourçain-sur-Besbre
CS 60001
03290 Dompierre-sur-Besbre (France)



Comment concilier productivité agricole et protection de l’environnement ? C’est l’un des défis auxquels est confronté le secteur de l’agriculture, dont le modèle s’apprête sans doute à connaître sa plus profonde évolution. Un contexte dans lequel l’innovation a un rôle majeur à jouer, de la graine à l’assiette.
Texte ÉLODIE MAÎTRE-ARNAUD

Quelques chiffres
50 039
Le nombre d’exploitations agricoles en Suisse en 2019 (contre 111 302 en 1975)
4,5
En milliards de francs, c’est la valeur ajoutée brute générée par le secteur de l’agriculture en Suisse (soit 0,6% de la VAB totale).
59%
La part de denrées alimentaires consommées en Suisse provenant de la production agricole indigène.
ucune génération d’agriculteurs n’a jamais eu à opérer de tels changements ! » affirme Stéphane Fankhauser, fondateur et directeur de l’Agropôle. Croissance démographique, dégradation des terres arables, changement climatique ou encore durcissement des normes environnementales : la transition vers une agriculture plus résiliente et plus durable est devenue indispensable pour assurer la sécurité alimentaire mondiale et préserver la planète. Elle devrait aussi être compatible avec une meilleure qualité de vie pour les agriculteurs.
13,2%
La part des émissions de gaz à effet de serre imputable à l’agriculture en Suisse.
33%
L’objectif de baisse des émissions de CO2 d’ici à 2050 dans l’agriculture suisse. o
On estime aujourd’hui à un peu plus de 13% la part des émissions de gaz à effet de serre imputable à l’agriculture en Suisse. Le secteur a également un impact sur les ressources primaires (eau, oligoéléments présents dans les sols, pollution des terres, etc.) et sur la consommation d’énergie. « Mais si l’agriculture pèse elle-même de façon importante sur l’environnement, c’est aussi le climat qui nous force à changer », relève l’expert. « Et je ne suis pas certain que le monde agricole ait vraiment conscience de la vitesse à laquelle son support de production évolue. Produire toujours davantage pour moins cher, avec un impact de plus en plus élevé, c’est un suicide collectif ! »

Basée à Neuchâtel, Infrascreen propose une nanotechnologie de pointe pour améliorer la durabilité des cultures. L’entreprise a été fondée en 2019.
Objectif. La grande majorité des tomates, concombres et poivrons frais consommés en Europe sont produits dans des serres, chauffées au gaz naturel pendant la saison froide dans les régions septentrionales. Le chauffage représente environ 30% des coûts d’exploitation de ces exploitations et émet d’importantes quantités de CO2. Infrascreen entend contribuer à améliorer l’efficience énergétique de ces serres high-tech. Technologie. Infrascreen a développé un écran thermique transparent retenant la chaleur radiative à l’intérieur des serres, tout en permettant le passage de la lumière indispensable à la photosynthèse des plantes. Ses propriétés isolantes permettent ainsi de diminuer la consommation d’énergie annuelle de 20% par rapport à un écran thermique classique, soit 1000 tonnes d’équivalent CO2 par hectare installé. Maturité. L’écran Infrascreen est disponible sur le marché ; il équipe d’ores et déjà de nombreuses serres high-tech en Europe, aux États-Unis et au Canada.
Aux antipodes de cela, l’agroécologie exige non seulement de s’appuyer sur des méthodes et techniques ayant moins d’effets néfastes sur l’environnement, mais aussi de s’adapter aux modifications de celui-ci. Pour relever ces défis et opérer sa transition, le secteur agricole peut notamment s’appuyer sur de nombreuses solutions innovantes, déjà à disposition sur le marché.
LA SUISSE COMME DÉMONSTRATEUR MONDIAL DES AGRITECHS ?
Au cœur du Jura – Nord vaudois, le campus Agropôle entend ainsi mettre la technologie au service de l’agriculture durable. Terrain d’essai grandeur nature, il accueille de nombreux


Fondée en 2014, Ecorobotix développe des logiciels d’intelligence artificielle permettant de limiter l’impact de l’agriculture sur l’environnement. Elle est basée à Yverdon-les-Bains.
Objectif. Dans un contexte réglementaire de plus en plus strict quant à l’utilisation de produits phytosanitaires, Ecorobotix offre une solution permettant de réduire drastiquement le recours aux herbicides, fongicides, insecticides et engrais. Technologie. Basé sur l’intelligence artificielle, le pulvérisateur ARA est capable de reconnaître les plantes et de les classer en temps réel afin de distinguer les mauvaises herbes des cultures. Il permet ainsi d’appliquer uniquement la quantité de produit phytosanitaire nécessaire avec une précision de 6x6 cm, au rythme de 4 hectares par heure. Résultat : jusqu’à 95% de produits chimiques en moins, selon les cultures.
Maturité. Ecorobotix a développé des algorithmes adaptés à une grande variété de cultures, et poursuit ses travaux en ce sens. La technologie ARA est commercialisée en Europe, aux États-Unis (où l’entreprise a créé une filiale), en Amérique du Sud et au Canada. L’entreprise concentre ses efforts sur les exploitations de taille moyenne spécialisées dans les cultures à forte valeur ajoutée.
acteurs développant des solutions innovantes pour améliorer l’agriculture traditionnelle. Selon Stéphane Fankhauser, la Suisse dispose d’ores et déjà de nombreuses technologies pour bien faire, et pourrait devenir une sorte de « démonstrateur mondial » des agritechs ou technologies agricoles. Robotisation, intelligence artificielle, agriculture de précision, agrivoltaïque ou encore aéroponie : diverses technologies peuvent en effet permettre d’augmenter les rendements, de faciliter le travail, de réduire l’utilisation de produits chimiques, de diminuer la consommation d’eau et d’énergie ou encore d’améliorer l’état des sols ou le bienêtre des animaux (voir les exemples ci-dessous)
Et ce, sur l’ensemble de la chaîne de valeur agroalimentaire. Des semences aux produits phytosanitaires et engrais en passant par les méthodes de production et de récolte jusqu’à la transformation des denrées, la transition agricole nécessite en effet une approche transversale. « Les producteurs, les distributeurs, mais aussi les consommateurs et les milieux politiques ont tous un morceau de la réponse ! » souligne l’expert. Il déplore toutefois le fait que personne ne semble prêt à « payer la facture » pour adopter sans tarder les technologies existantes, souvent coûteuses. Et de plaider pour un support financier de nos agriculteurs, afin de mettre ces technologies à leur disposition et de réaliser

L’entreprise sierroise 3D2cut a mis au point une technologie permettant de tailler la vigne dans les règles de l’art, sans spécialisation particulière. Elle est active depuis 2019.
Objectif. Tailler convenablement la vigne est un travail d’expert qui permet de réduire considérablement le taux de mortalité des plants et d’augmenter leur productivité. Face à la pénurie de tailleurs professionnels, 3D2cut a développé un système de reconnaissance de la vigne et d’aide à la taille. Technologie. L’intelligence artificielle développée par 3D2cut est capable de reconstituer le jumeau numérique d’un cep de vigne et d’indiquer les endroits où tailler afin de ne pas affecter la vitalité des plants, tout en préservant les objectifs de production. Elle peut être intégrée dans n’importe quelle plateforme de gestion de vignobles, drone, lunettes de réalité augmentée, caméra, smartphone ou encore robot industriel. Maturité. La phase pilote a permis de démontrer l’efficacité du logiciel. D’ici à début 2025, une version industrielle devrait être intégrable dans tous les dispositifs précités. Une levée de fonds est en cours pour amener le produit à maturité commerciale.
ainsi rapidement des économies d’énergie massives, tout en limitant l’impact de l’agriculture sur l’environnement. « On est encore à cheval entre l’économie de compétition et la prise de conscience de la crise environnementale ; c’est notre plus grand challenge ! » Selon lui, l’agriculture ne pourra pas non plus opérer sa transition durable sans l’engagement simultané de certains lobbys – dont il doute cependant de l’intérêt à ce que les choses changent – et sans l’appui de l’opinion publique. « C’est aussi une question d’éducation du consommateur : bien se nourrir est bon non seulement pour la planète, mais aussi pour la santé », conclut Stéphane Fankhauser. o

Une vache émet jusqu’à 500 litres de méthane par jour. Fondée à Bière en 2006, Agolin a développé un additif alimentaire à base de plantes qui permet de lutter contre la production de ce gaz à effet de serre.
Objectif. Les fondateurs d’Agolin cherchaient avant tout à améliorer la performance des vaches laitières en agissant sur leur digestion, car les émissions de méthane constituent pour elles une perte d’énergie. La diminution de ces émissions est un effet secondaire positif pour l’environnement.
Technologie. Agolin Ruminant est un mélange d’extraits de plantes qui, ajouté à l’alimentation des bovins, permet d’en optimiser la consommation et l’assimilation. Pas moins de 23 études, menées sur quelque 4000 vaches, ont ainsi permis de démontrer une diminution des émissions de méthane de 8,8% par tête de bétail, grâce à une réduction du stress nutritionnel chez les ruminants.
Maturité. Deux millions de vaches dans le monde reçoivent aujourd’hui de l’Agolin Ruminant, principalement en Europe de l’Ouest et en Amérique du Nord. En Suisse, un projet mené par la coopérative Mooh doit permettre de réduire de 400 kg d’équivalent CO2 les émissions par vache et par an, grâce à ce complément alimentaire.
En mains familiales depuis quatre générations, l’entreprise valaisanne Zenhäusern s’est développée sur des valeurs humaines et entrepreneuriales fortes. Une évolution qui, l’année passée, s’est en grande partie orientée vers la durabilité au sens large, avec un focus sur les aspects énergétiques.
En passant de six collaborateurs en 1982 à une équipe de 450 personnes aujourd’hui, les frères Zenhäusern, qui dirigent la société, ont toujours veillé à maintenir l’esprit de famille. Parmi les apprentis, les employés et la direction, on se tutoie et chacun est amené à participer à l’évolution du groupe, dont les boulangeries et les restaurants sont répartis entre le Haut et le Bas-Valais. « Nous avons exprimé notre volonté de mettre en place une approche durable en 2023 », explique le CEO, Jörg Zenhäusern. « En tant qu’entreprise, nous estimons avoir une responsabilité forte à assumer dans ce sens envers nos collaborateurs, nos partenaires et nos clients. À notre vision et notre philosophie d’employeur responsable s’ajoute également un contexte énergétique complexe, marqué par des risques de pénurie et une augmentation significative des coûts. Nous avons donc pris les devants l’an dernier, en sollicitant l’expertise d’un consultant ex-
terne pour réaliser un audit de notre entreprise et identifier des potentiels d’amélioration. »
INSTALLATION SOLAIRE
À la suite de ces premières démarches, Zenhäusern a ainsi mis en place un comité dédié aux problématiques énergétiques au sein de l’entreprise. Deux fois par année, ce groupe se réunit pour suivre les projets d’optimisation qui sont entrepris. Réalisées avec son partenaire et fournisseur d’électricité OIKEN, ces démarches se déclinent en différents volets. Premier élément : la production solaire. Sur le toit de son centre de production basé à Sion, une infrastructure photovoltaïque permet désormais au groupe de bénéficier d’une puissance de 340 kW, produisant entre 15 et 18% de sa consommation énergétique en été, et 9% sur toute l’année. « Pour nous, c’est un grand pas en matière de durabilité; le projet devrait par ailleurs être amorti en dix ans », précise Jörg Zenhäusern. « Le programme d’accompagnement d’OIKEN comprend autant les aspects administratifs, notamment liés aux

demandes de subventions auxquelles nous avons droit, que les aspects opérationnels visant à installer les panneaux solaires. »
OPTIMISATION DES PROCESSUS
En parallèle, Zenhäusern a également mené une campagne de sensibilisation auprès de ses équipes. Dans les différents points de vente, les collaborateurs ont ainsi été amenés à participer à un concours récompensant les idées les plus prometteuses en matière d’efficience énergétique. L’entreprise continue par ailleurs d’être accompagnée sur cette voie par OIKEN. Pour Zenhäusern, ce suivi se traduit notamment par des audits de processus, réalisés par des spécialistes sur ses différents sites afin d’identifier des potentiels d’économie d’énergie supplémentaires. Une démarche qui comprend, entre autres, le remplacement d’appareils peu efficients. Pour les sociétés propriétaires de leurs murs, les aspects constructifs sont aussi explorés, par exemple pour améliorer l’isolation de l’enveloppe du bâtiment. o

Réalisé pour OIKEN

Chef de groupe Grands Comptes chez OIKEN
Comment OIKEN accompagne-t-elle les PME souhaitant prendre part à la transition énergétique ?
OIKEN propose plusieurs mesures susceptibles d’intéresser ces catégories d’entreprises : l’audit des bâtiments (CECB), l’audit des processus (PEIK) ou les visites-conseils Efficience-PME pour les plus petites entreprises. Ces deux dernières font partie intégrante de notre programme Efficiences pour la sobriété et l’efficacité. Quelles que soient leur taille et leur consommation, nous avons donc plusieurs cartes en main pour accompagner les PME. Il y a quelques années, c’était avant tout pour réaliser des économies financières que ces entreprises s’adressaient à
nous, en souhaitant accéder au marché libre. Mais, petit à petit, nous sommes passés de « combien ? » à « comment ? ». C’est-à-dire que nos clients PME souhaitent de plus en plus souvent bénéficier d’un accompagnement et plus seulement d’un prix. Nous avons d’ailleurs posé de nombreuses installations solaires sur leurs bâtiments au cours des dernières années. Ce changement de paradigme est encore plus net depuis la menace de pénurie d’électricité en 2022. De nombreuses entreprises ont en effet réalisé, dans le dur, qu’elles n’étaient absolument pas prêtes à affronter ce risque.
De quelle façon l’accompagnement des PME se déroule-t-il ?
Dans le cadre d’un audit PEIK, il s’agit de cartographier de façon très précise la manière dont l’énergie est consommée dans l’entreprise, machine par machine, processus par processus. C’est ce qui nous permet d’identifier les potentiels d’optimisation énergétique afin de faire des recommandations très concrètes. Par exemple, décaler le déclenchement de certaines machines pour éviter des pointes de puissance, ou encore baisser d’un bar la pression d’un compresseur. Parfois, les appareils sont neufs, mais les entreprises se basent en -

core sur d’anciens processus plutôt que de les optimiser. Pour chacune des mesures recommandées, une estimation du retour sur investissement est faite, ce qui permet à la PME de choisir en connaissance de cause celles qu’elle souhaite mettre en place.
Les PME accompagnées sont-elles également sensibles à l’efficacité énergétique de leurs locaux ?
Oui, l’audit des processus peut se doubler parfois d’un audit du bâtiment, comme c’est le cas pour l’entreprise Zenhäusern (lire ci-contre). Parfois encore, nous pouvons orienter une entreprise vers un concept énergétique global. Je songe notamment à notre collaboration avec l’entreprise Rigips (lire l’encadré) qui, dans le cadre de l’agrandissement de son site, a souhaité mener une réflexion pour utiliser efficacement l’énergie produite ou récupérée in situ. o
www.oiken.ch/mobilite
C’est dans le cadre de l’extension de son site à Granges que Rigips s’est associée à OIKEN pour améliorer son bilan énergétique. Leader de la production et de la fourniture de systèmes de construction à sec en plâtre en Suisse, l’entreprise dispose désormais de 1557 panneaux photovoltaïques installés, dont 187 sur les façades. Une centrale qui permettra d’atteindre une production annuelle de 750 MWh, couvrant ainsi un tiers environ de ses besoins annuels en électricité, notamment en hiver. Cette installation est une première pour OIKEN, qui déploie ici ses compétences dans la conception et la réalisation de panneaux photovoltaïques en façade pour un site industriel. Une étude est par ailleurs en cours pour évaluer le potentiel de récupération de chaleur résiduelle sur le site, démontrant l’engagement de Rigips pour une utilisation efficace des ressources énergétiques locales. o
On l’appelle l’or bleu et les prévisions les plus sérieuses annoncent qu’elle sera au centre de prochains grands conflits nationaux et internationaux. Avant de nous disputer l’eau, saurons-nous la partager ? Plongée à la source de cette ressource, pour mieux comprendre les services qu’elle nous rend et les enjeux à affronter.
Texte JOËLLE LORETAN • Illustrations AMÉLIE TOUCHET
Le titre de cet article peut sembler alarmiste. Cependant, les tensions autour de l’eau sont bien réelles. Si, en Suisse, nous sommes encore relativement épargnés, la situation est plus inquiétante à l’extérieur de nos frontières. En France, les projets de construction de méga-bassines de rétention ont provoqué de violents affrontements – et fait des blessés graves – entre activistes écologistes et forces de l’ordre ; en Europe, les sécheresses de ces dernières années sont qualifiées d’historiques, avec des pénuries d’eau répétées et des répercussions sur la population ; en Afrique subsaharienne, l’UNICEF rapporte qu’environ 500 enfants meurent chaque jour faute d’accès à une eau potable. Rien ne semble étancher notre soif. La situation est à ce point critique que le Forum économique mondial de Davos identifie la raréfaction de l’eau comme l’un des risques majeurs pour la prochaine décennie à l’échelle de la pla-
nète. Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU, prévient lui aussi : « Une surconsommation et un surdéveloppement vampiriques, une exploitation non durable des ressources en eau, la pollution et le réchauffement climatique incontrôlé sont en train d’épuiser, goutte après goutte, cette source de vie. L’humanité s’est engagée aveuglément sur un chemin périlleux. » L’approvisionnement en eau en quantité et en qualité suffisantes ainsi que sa gestion et ses usages seront, dans les années à venir, un immense défi. Chez nous aussi.
DÉJÀ DES TENSIONS EN SUISSE
« La Suisse possède d’abondantes ressources en eau, qui perdureront malgré les changements climatiques », tempère l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Même si, durant la saison chaude, le débit des ruisseaux et rivières sera plus faible qu’aujourd’hui, tandis que les épisodes de sécheresse seront plus longs et plus fréquents. « À l’heure actuelle, par temps chaud et sec, de nombreux cours d’eau et eaux souterraines de petite taille ne fournissent déjà plus d’eau pour l’irrigation », confirme le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC). La répartition des ressources en eau n’est toutefois pas uniforme à travers le pays, influencée notamment par la présence (ou non) de glaciers ou de nappes phréatiques, entre autres. La commune valai➜ Suite du texte en page 23


Certaines industries utilisent de l’eau pour refroidir leurs installations, et leurs besoins devraient augmenter avec la hausse des températures. Il en va de même pour les secteurs financier et technologique, qui utilisent les eaux souterraines ou de rivières pour maintenir leurs serveurs informatiques au frais.

Le tourisme
Les activités touristiques consomment beaucoup d’eau potable, par exemple pour l’enneigement artificiel, le thermalisme et les besoins quotidiens. Les hauts lieux touristiques du pays connaissent d’importants pics de fréquentation, notamment en hiver, puisant abondamment dans les sources, ce qui contribue au manque d’eau en été.

Les loisirs
Piquer une tête dans une rivière, se prélasser dans un bain thermal, arroser son jardin ou encore faire du paddle sur un lac sont autant de moments de détente propices aux rencontres, aux échanges et au bien-être physique et psychique.


L’énergie
Les barrages et les centrales au fil de l’eau permettent la production électrique ; l’hydrothermie utilise l’eau (des lacs chez nous) pour rafraîchir et chauffer des bâtiments ; les systèmes de pompe à chaleur géothermique sur aquifère s’alimentent avec l’eau située dans le sous-sol. L’eau sert encore à refroidir les centrales nucléaires en Suisse, mais également en France, où les eaux du Rhône atteignent quatre centrales nucléaires et alimentent une vingtaine de centrales hydroélectriques.

L’eau potable est, d’une part, utilisée en tant que boisson et pour cuisiner et permet, d’autre part, de couvrir nos besoins d’hygiène, comme le lavage des mains, les douches et le brossage des dents.

La protection contre les dangers naturels
L’eau est indispensable pour éteindre les incendies, qui seront plus fréquents à l’avenir (en raison des sécheresses !). Les bassins de retenue des centrales hydroélectriques servent quant à eux à la protection contre les crues.

L’agriculture
Les exploitations agricoles utilisent des quantités très importantes d’eau pour l’irrigation des cultures et l’abreuvage des animaux. Selon le DETEC, si aucune mesure efficace de protection du climat n’est mise en œuvre, les cultures irriguées aujourd’hui auront besoin d’environ deux fois plus d’eau d’ici la fin du siècle.

biodiversité
Nos lacs et nos cours d’eau abritent une grande biodiversité, mais les interventions anthropiques font disparaître ces espèces vivantes, et ce, plus rapidement encore que dans les milieux terrestres. o

sanne de Grimisuat a surpris en mars dernier lorsqu’elle a annoncé limiter sa population à 5000 habitants, en fonction de ses ressources en eau disponibles. Si la situation est inédite en Suisse, treize communes situées en Haute-Savoie (France) suspendaient provisoirement la délivrance des permis de construire en 2023, en raison de la baisse de la ressource.
Et Grimisuat n’est pas la seule à avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, précise Laurent Horvath, délégué à l’eau pour le canton du Valais : « C’est l’ensemble de la rive droite du Rhône, entre Saillon et le Lötschental, qui est confronté à la problématique de l’eau », expliquet-il. La rive gauche du Rhône profite en effet de nombreux glaciers et se trouve dans une zone davantage protégée du soleil. A contrario, la rive
droite est bien plus pauvre en glaciers et fait face au soleil. « Dans ces conditions, les stocks d’eau sous forme de glace sont nettement moins présents et cette partie du canton se trouve ainsi dans un plus grand stress hydrique », ajoute-t-il. Les projections suggèrent par ailleurs que d’ici à 2050 (dans vingt-cinq ans, donc), les trois quarts de l’eau stockée dans les montagnes helvétiques auront disparu. Une perte d’un réservoir crucial, qui augmentera durablement la sensibilité de la Suisse à la sécheresse.
LA
Le canton du Valais n’a pas attendu pour élaborer, dès 2014, une « Stratégie Eau », soit un plan d’action en 39 mesures pour une gestion durable de cette ressource. Chaque action tient compte
de l’ordre de priorités suivant, à savoir : l’utilisation de l’eau comme eau potable ; la protection de l’eau en tant que ressource et la protection de l’homme contre les dangers naturels ; la valorisation de l’eau dans divers secteurs incluant l’électricité, l’agriculture, l’industrie, le tourisme, ainsi que les biotopes et les paysages. « Cette stratégie visionnaire reste tout à fait d’actualité », précise Laurent Horvath. Pour le délégué aux questions relatives à l’eau récemment nommé, il s’agit désormais d’anticiper et de planifier les besoins futurs, en incluant les nombreux acteurs qui gèrent la ressource, avec, au cœur des réflexions, le partage et la multifonctionnalité.
Partager
Avec des ressources en eau de plus en plus restreintes et des demandes croissantes en périodes de pointe, les tensions entre les différents usages vont augmenter. Il s’agit donc de repenser la répartition de l’eau, en prenant en compte tant les aspects géographiques (intercommunaux, intercantonaux, voire internationaux – comme le partage du Rhône avec la France) que les différents besoins (eau potable, agriculture, énergie, etc.).
Renaturer
De nombreuses zones alluviales et marais sont asséchés, certaines berges aménagées, et les fleuves utilisés pour produire de l’énergie. Engrais, produits phytosanitaires et autres micropolluants contaminent les cours d’eau. Et ce chiffre alarmant de la Confédération : plus de 50% de toutes les espèces vivantes dans les eaux et sur leurs rives sont menacées ou éteintes. Une stratégie nationale de revitalisation des cours d’eau vise à rétablir d’ici à 2090 les fonctions naturelles de 4000 km d’entre eux jugés en « mauvais état ».
La multiplication des sécheresses estivales exerce une forte pression sur les cours d’eau, dont certains tronçons sont temporairement à sec. Des projets visent notamment à examiner la possibilité d’utiliser des réservoirs à l’échelon local et régional, et à explorer les possibilités de stockage dans les aquifères en hiver, afin que l’eau réintègre naturellement le lit des ruisseaux en été.

Certains dénoncent le manque de vision d’ensemble de la Suisse sur les quantités d’eau consommées dans l’agriculture. D’où le projet SwissIrrigationInfo, financé par l’Office fédéral de l’environnement et réalisé par Agroscope et la Haute École spécialisée bernoise, visant à développer des méthodes d’estimation pour une gestion durable et lucide des ressources en eau dans le secteur agricole.
L’intégration de la technologie numérique est essentielle pour fournir aux décideurs les outils nécessaires à une gestion de l’eau efficace. Cela inclut notamment la numérisation des réseaux d’eau, l’installation de capteurs ou encore la modélisation de ces réseaux pour permettre des simulations. Un contrôle plus fin sur les installations et les réseaux permet également d’éviter des pertes et écoulements inutiles.
De nombreuses approches et techniques innovantes sont développées pour économiser l’eau, dans tous les domaines évoqués précédemment (agriculture, industrie, tourisme, etc.). Et pour la population, les bonnes vieilles habitudes de consommation sont à portée de main : préférer les douches aux bains, installer des limiteurs de volume pour la chasse d’eau des toilettes, les pommeaux de douche et les robinets mitigeurs, ou encore des systèmes de récupération d’eaux de pluie pour l’arrosage. o

« Mon rôle est de continuer à déployer la stratégie cantonale, de fédérer et de soutenir les communes et les différents acteurs à s’adapter aux changements qui arrivent », résume-t-il.
« Je vais m’attacher à favoriser une utilisation concertée de l’eau, avec l’objectif de garantir la sécurité d’approvisionnement et une collaboration renforcée entre les communes en cas de besoin ou de problèmes particuliers. » Parallèlement, la fin prochaine de nombreuses concessions hydrauliques dans le canton représente une opportunité stratégique. À terme, les communes pourront en effet prendre des décisions autonomes sur cet or bleu.
ET SI L’EAU MANQUAIT ?
Il faut dire qu’en Suisse, si la gestion de l’eau est officiellement l’affaire des cantons, la réalité est plus nuancée, comme le précise Yann Rodriguez, directeur adjoint du BlueArk Entremont, un pôle d’innovation technologique et un laboratoire de données spécialisé dans la gestion de l’eau. « Selon la loi fédérale, les cantons sont chargés de s’organiser pour gérer leurs ressources en eau, mais ils transfèrent bien souvent cette responsabilité aux communes, qui délèguent à leur tour à des gestionnaires de réseaux de distribution. C’est un paysage morcelé, qui comprend de nombreux acteurs privés

qui opèrent sous un mandat communal. Au final, c’est bien aux communes d’assurer la fourniture d’eau à leurs habitants. »
Si des pénuries d’eau prolongées venaient à nous toucher, quels seraient les domaines et les services qui seraient approvisionnés en premier ? « L’eau potable a la priorité sur les autres utilisations ! » répond Laurent Horvath. Rassurant pour notre survie, ce choix aurait aussi, le cas échéant, de quoi poser des problèmes majeurs pour l’activité économique du pays. D’où l’importance d’anticiper afin de développer des solutions pour préserver la ressource et ses usages (lire page 22). Le délégué à l’eau évoque encore ce paradoxe éloquent : « Lorsque l’eau est disponible et qu’elle coule de notre robinet, on ne la voit pas. C’est lorsqu’elle manque qu’elle devient visible. » Cette étrange réalité est applicable tant à l’eau qu’à l’électricité, deux ressources que nous semblons percevoir comme infinies, que nous consommons sans réelle conscience de la somme d’efforts, d’argent et d’acteurs concernés, et qui entrent aujourd’hui en crise. Yann Rodriguez, directeur adjoint du BlueArk Entremont, conclut quant à lui par un dernier conseil : « Sans pour autant parler de guerre, il est indispensable de changer notre regard sur l’eau et de modifier notre manière de l’appréhender pour relever les challenges du multiusage et de la gouvernance de cette ressource. » o
HELIOS CLEAN TECH
L’entretien régulier des panneaux solaires évite les pertes de rendement et prolonge leur durée de vie. Active en Valais et dans le Chablais, l’entreprise
Poussière, pollen, sable, fientes d’oiseaux ou encore moisissures, en toiture ou en façade, les panneaux solaires sont exposés en permanence à toutes sortes de salissures. Au fil du temps, la saleté s’accumule et met à mal leur productivité.
« On estime jusqu’à 20% la perte de rendement des panneaux encrassés », affirme le directeur d’Helios
Clean Tech. De même, une installation mal entretenue s’abîme plus vite, et aura donc une durée de vie plus courte. Pour éviter cela, rien de mieux que de faire appel régulièrement à un service de nettoyage professionnel. Malheureusement, l’encrassement est inévitable. Et il est illusoire de

compter sur la pluie, la neige ou le givre pour débarrasser les panneaux de la saleté. « C’est comme pour la voiture : seul un lavage efficace permet de véritablement les nettoyer. » Quant à s’y employer soi-même, Laurent Vouilloz met en garde contre les risques à s’aventurer sur son toit : « Il ne faut pas négliger la sécurité. Nos techniciens sont convenablement équipés et nous respectons les normes de la SUVA pour le travail en hauteur. »
POUR TOUT TYPE D’INSTALLATION
Le service de nettoyage est adapté à tout type d’installation, particulier ou professionnel, quelle que soit sa superficie. Afin de tenir compte de ses spécificités et de son degré de

Helios Clean Tech propose un service de nettoyage écologique, pour tout type d’installation, particulier ou professionnel. www.helioscleantech.ch
salissure, un technicien se rend préalablement sur place pour réaliser un devis, après inspection visuelle. Il est recommandé de faire contrôler ses panneaux une fois par an pour juger de la nécessité, ou non, de procéder à un nettoyage. Souvent, un nettoyage tous les deux ans est suffisant. Mais les panneaux solaires situés à proximité d’une gravière, d’une route ou encore d’une voie ferrée se salissent plus vite. Quant au prix des travaux, il dépend de la taille de l’installation et inclut également les frais de mise en place du chantier. À noter que ce montant est déductible des impôts, au titre de l’entretien du bâtiment.
UN PROCESSUS ÉCOLOGIQUE
Helios Clean Tech n’utilise aucun produit chimique néfaste pour l’environnement. Il s’agit d’un procédé mécanique, utilisant de l’eau déminéralisée – filtrée par osmose grâce à un système branché sur le robinet du client – pour un résultat sans traces ni résidus calcaires. Avec une consommation de 8 litres d’eau par minute, la méthode est beaucoup moins gourmande qu’un dispositif de type Kärcher. Pour les petites surfaces, les techniciens utilisent des perches munies de brosses. Un robot équipé de brosses rotatives assure un nettoyage en profondeur des plus grandes installations, sans endommager les surfaces sensibles des panneaux solaires.
Pour plus d’informations, contactez-nous via notre page Facebook Helios Clean Tech Sàrl ou par téléphone au 077 408 69 22. o

Des projets solaires plus ou moins extravagants se multiplient. Mais avant d’étendre le photovoltaïque partout où cela semble possible, ne vaudrait-il pas mieux se concentrer sur les toitures et les façades de nos bâtiments ? Nous avons croisé les points de vue de trois experts.
Dans le domaine de l’énergie solaire, certains projets font le buzz : du photovoltaïque recouvrant les axes routiers, des champs de panneaux plantés sur les montagnes, et même des centrales en orbite dans l’espace. Mais tout cela est-il vraiment possible, voire souhaitable ? Car si certaines innovations ne manquent pas d’atouts pour répondre aux objectifs ambitieux de production d’électricité renouvelable, elles doivent aussi être mise en perspective avec l’approche « classique », qui consiste à recouvrir les toitures et façades de nos bâtiments. Le solaire en milieu urbain serait-il has been ?
QUESTIONNER LES BESOINS D’ABORD
« On aurait tort de considérer ces approches comme des pistes qui s’excluent », répond Patrick Hofer-Noser, CEO de l’entreprise 3S Swiss Solar Solutions, spécialisée dans les dispositifs photovoltaïques intégrés. « Nous avons besoin de tout pour mener à bien la transition énergétique et tendre vers un approvisionnement sûr et stable. » La fin justifiant les moyens, il s’agit en effet de questionner en premier lieu nos besoins.
« Concrètement, pour subvenir aux besoins de notre société de plus en plus électrifiée, notamment sous l’impulsion de la mobilité électrique, l’OFEN estime que la filière solaire devra être capable de fournir 35 TWh en Suisse en 2050 (sept fois plus que ce qui a été produit en 2023) », détaille l’ingénieur Arnaud Zufferey, fondateur d’Olika, une société de conseil spécialisée dans l’accompagnement à la transition énergétique. « La bonne nouvelle, c’est que le potentiel de nos toitures est d’environ 50 TWh, soit quasiment l’équivalent de notre consommation totale en 2023. On a donc largement de quoi faire avec le solaire urbain. » Pour Martial Genolet, responsable ligne d’affaires photovoltaïques chez Romande Energie, il faut toutefois prendre garde à ne pas surestimer



ce potentiel théorique. Selon lui, le potentiel opérationnel dont on dispose sur nos toitures serait moindre, notamment pour des raisons statiques : « Certains toits ne peuvent pas accueillir de charges supplémentaires sans risque d’affaissement, la marge calculée à l’époque n’étant prévue que pour supporter le poids supplémentaire relatif aux chutes de neige. De nombreux immeubles ont aussi des problèmes d’étanchéité. » Selon lui, avant de pouvoir y poser des panneaux solaires, il faudra donc commencer par entreprendre des rénovations.
SOLAIRE ALPIN : FAUSSE BONNE IDÉE OU MAL NÉCESSAIRE ?
Parmi les projets photovoltaïques qui suscitent le débat, impossible de passer à côté du solaire alpin. Pourquoi décider d’implanter des panneaux solaires dans des zones difficiles d’accès, alors que les toitures industrielles peuvent encore en accueillir dans de larges proportions ? « L’installation d’infrastructures photovoltaïques en altitude permet de bénéficier d’un excellent ensoleillement durant toute l’année, puisque l’on se trouve quasiment toujours au-dessus du brouillard et du stratus », affirme Patrick Hofer-Noser. « Ce qui permet d’élargir l’exploitation de la filière solaire en hiver, afin d’éliminer le besoin d’importation d’électricité depuis nos voisins. » Autre atout mis en avant par les porteurs de projets alpins : profiter de la réverbération du rayonnement solaire sur la neige, ainsi que de températures basses améliorant le rendement des cellules photovoltaïques. D’où l’utilisation de panneaux bifaciaux, capables de capter le rayonnement du soleil venant les frapper directement depuis le ciel, mais aussi depuis le sol, reflété par la neige. « Ces avantages sont en réalité très discutables », prévient Arnaud Zufferey, rappelant que les études ont été menées sur de petits îlots de panneaux disposés dans des zones enneigées et ensoleillées. « Une fois étendues dans des rangées plus nombreuses, ces infrastructures perdent en efficacité en raison de l’ombre qu’elles génèrent. Selon les dernières études, le solaire alpin ne serait en fait que 1,2 à 1,4 fois plus efficient que le solaire urbain. Par contre, les coûts de tels projets sont considérables. Le facteur clé à considérer est le prix du kilowatt installé : il est de 900 francs sur une toiture industrielle, contre 4000 francs en milieu alpin. »
Martial Genolet explique quant à lui que la stratégie de Romande Energie consiste à tabler sur une approche plurielle, répartie notamment

entre des solutions de solaire sur bâtiment et hors bâti. « Pour le solaire hors bâti, notre vision cible des espaces déjà transformés par l’activité de l’homme et situés à proximité d’infrastructures de raccordement existantes. Une approche d’ailleurs soutenue par la Confédération via son important programme de subventions. »
La démarche disruptive proposée par plusieurs start-up consiste à profiter des espaces artificiels que sont les autoroutes. Objectif : en exploiter le plein potentiel énergétique en les recouvrant de modules photovoltaïques. Autres atouts mis en avant : minimiser les nuisances liées à la circulation et préserver le bitume des intempéries. En Suisse, le potentiel théorique de ce type d’installations s’avère significatif, puisqu’en recouvrant près d’un tiers du réseau autoroutier, il serait possible d’égaler les capacités énergétiques actuelles de nos centrales nucléaires. En pratique, il est cependant très complexe, voire impossible, de recouvrir autant de tronçons en considérant les obstacles géographiques et légaux liés au réseau routier. Mentionnons toutefois que des parois antibruit recouvertes de modules photovoltaïques longent déjà certaines
routes argoviennes depuis plusieurs années. « La piste solaire autoroutière qui a le plus de sens consiste à cibler les talus qui bordent les voies de circulation, voire les parois antibruit », confirme Arnaud Zufferey. « Avec des panneaux bifaciaux, il est même envisageable de construire de telles parois directement avec ce type de modules photovoltaïques. En revanche, recouvrir les autoroutes de panneaux solaires pose des questions importantes en termes de coûts, de sécurité lors des travaux, d’interruption du trafic et d’impact paysager. »
Du solaire en orbite ? D’un point de vue technologique, l’idée consiste à déployer des satellites munis de panneaux photovoltaïques en orbite géostationnaire, soit à environ 36 000 km de la Terre. De quoi collecter l’énergie quasiment en continu, pour la transmettre ensuite vers la Terre sous forme de rayonnements micro-ondes capables de traverser les perturbations atmosphériques, garantissant ainsi une livraison d’énergie constante. Baptisé Solaris, le projet étudié par l’Agence spatiale européenne et Airbus représente un défi économique et technique de taille. « Qui n’en vaut de toute façon pas la peine », affirme Arnaud Zufferey. « On nage en
pleine science-fiction, là ! » Et de relever que la faisabilité d’un tel projet ne repose que sur des hypothèses : « Si l’industrie spatiale arrive à réduire encore ses coûts de lancement, si on parvient à alléger les infrastructures solaires, si on est capable de créer des modules qui se déploient dans l’espace, si aucune panne ne complique la situation et si on parvient à transférer efficacement cette énergie à d’énormes antennes à disposer sur l’équateur, alors il ne restera plus qu’à tirer d’immenses lignes haute tension pour acheminer cette électricité vers le reste du monde. Or c’est précisément l’inverse de ce qu’il faut faire ! » La NASA aurait d’ailleurs mené une étude qui démontre les obstacles et les difficultés du projet. L’ingénieur rappelle quant à lui que le photovoltaïque est en soi une source d’énergie décentralisée, qui frappe naturellement nos toitures là où on en a besoin. « Pourquoi la centraliser pour ensuite devoir l’acheminer à travers des infrastructures aussi énormes que coûteuses à bâtir ? » conclut-il. o

Vagues de chaleur, épisodes de canicule : ces dernières années, les citadins ont souvent tiré la langue au cours des mois d’été. Comment apporter un peu de fraîcheur au cœur des villes ? Plusieurs communes suisses ont empoigné le problème.
Texte SYLVIE ULMANN
Les étés se suivent et les villes suisses étouffent toujours plus sous des îlots de chaleur, quand la température des centres urbains dépasse de plusieurs degrés celle relevée en périphérie (lire l’encadré). « Notre pays n’avait guère été confronté au problème,
puis les choses se sont accélérées », constate Albane Ferraris, adjointe de direction au service d’urbanisme de la Ville de Genève. Résultat : les pouvoirs publics se mobilisent. La Cité de Calvin s’est ainsi dotée d’une stratégie climat en 2022, dans la continuité de celle du canton, lancée en 2019. L’ennui, c’est que les mesures les plus efficaces pour lutter contre les îlots de
chaleur sont aussi les plus lentes à déployer leurs effets. Point de technologie miracle en effet, mais des « recettes » ancestrales : ombre, humidité, perméabilité des sols. Reste qu’un arbre met des années à gagner suffisamment de hauteur et d’ampleur pour véritablement produire de l’ombre. Dans l’intervalle, les municipalités doivent donc rivaliser d’imagination pour empêcher leur population de mourir de chaud au cœur de l’été.
Ainsi, à Genève, deux nouvelles piscines verront le jour, de même qu’une nouvelle plage, quai Wilson. On prévoit également de réaménager les bains sur le Rhône et d’en créer de nouveaux à côté du jet d’eau. « Favoriser l’accès au lac est une mesure très efficace, idéalement en mobilité douce », confirme Martine Rebetez, climatologue et professeure à l’Université de Neuchâtel et à l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL). Mais, là encore, il faudra prendre son mal à patience avant de pouvoir piquer une tête dans ces nouveaux aménagements à qui il faudra plusieurs années pour prendre forme. Alors, pour offrir plus rapidement des zones de fraîcheur aux citadins, on a fait preuve d’inventivité au bout du Léman. L’an dernier, avec le concours de la Haute École du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (HEPIA), des oasis urbaines ont vu le jour : « De juin à octobre, ces
petits refuges mobiles se déplacent dans des zones définies avec le médecin cantonal, où les personnes âgées ou précaires sont plus nombreuses. Ces dernières peuvent venir se reposer à l’ombre et parfois bénéficier d’un apport d’eau », détaille Albane Ferraris. Une manière aussi de créer du lien, car ces hausses de température s’accompagnent d’effets secondaires inattendus, tels que l’isolement des seniors. « On leur recommande en effet de rester chez eux lorsqu’il fait très chaud ! » souligne-t-elle. Autre mesure à moyen terme : faire resurgir les rivières urbaines. « Beaucoup ont été recouvertes au début du XXe siècle pour gagner de l’espace de construction », rappelle Martine Rebetez. À Neuchâtel, ce fut le cas pour le Seyon, qui coule désormais à ciel ouvert. À Genève, d’ici quatre ou cinq ans, la Drize devrait revoir le jour dans le secteur Praille – Acacia – Vernets, en pleine redéfinition.
À MONTHEY, MOINS DE BÉTON, PLUS DE VERDURE
À Monthey, en Valais, une autre stratégie a été imaginée pour créer des îlots de fraîcheur, comme l’explique Stéphane Coppey, président de la commune. « Nous avons dégrappé 750 m2 de goudron sur l’avenue de la Gare, pour les végétaliser et les rendre perméables. Par ailleurs, 110 places de parc ont été supprimées dans le centre-ville, au profit d’arbres, de massifs et d’une petite place agrémentée de jeux d’eau. » La démarche, qui a suscité beaucoup d’intérêt et de visites, pourrait faire des émules. Seule ombre au tableau : ces espaces sont plus chers à entretenir qu’une rue bétonnée. La cité valaisanne, qui est en train de revoir son plan de zones, a néanmoins décidé d’inclure davantage d’espaces verts – un troisième parc est ainsi en projet, ainsi qu’une « voie verte » qui reliera le coteau au Rhône, grâce à un maillon de mobilité douce arborisée. « Nous avons en outre opté pour la biodiversité et ensemençons les pieds des arbres avec une sélection de plantes indigènes spécifiques à Monthey. De plus, nous varions les essences des arbres d’avenue afin de favoriser la faune et la flore et d’éviter qu’une maladie ne décime tout un secteur », souligne Stéphane Coppey. Un bon point, confirme Martine Rebetez, qui rappelle l’importance de miser sur les bonnes variétés : « Aux pins, connus pour leur effet réchauffant, on préférera ainsi des feuillus, et l’on choisira des essences adaptées au climat. Leur couronne doit être assez fournie et leurs racines disposer de suffisamment d’eau pour apporter une véritable fraîcheur. »
S’INSPIRER DES VILLES DU SUD ?
Se pose encore la question du bâti, principal responsable des îlots de chaleur urbains. « Une ville, ce sont des masses de béton et de bitume qui se chargent en chaleur durant la journée et la restituent la nuit », résume Lionel Fontannaz, de MétéoSuisse. Un effet accentué par la teinte
des façades et des toitures, souvent sombres sous nos latitudes. « Les cités du Sud ne sont pas blanches pour rien ! » relève Albane Ferraris. Les études scientifiques le démontrent : l’albedo – le pouvoir réfléchissant d’une surface –est un levier très efficace pour faire descendre la température. Elle poursuit : « Pour le moment, des questions de culture du bâti compliquent toute intervention sur la couleur des bâtiments. » En Valais, on a contourné le problème en s’attaquant aux routes : « Le canton teste des revêtements plus clairs que le bitume habituel », précise Lionel Fontannaz. Il ajoute que la qualité du bâti joue également un rôle : « On supporte mieux une situation de forte chaleur dans un bâtiment Minergie que dans un petit appartement mal isolé et non traversant. » Avis aux propriétaires !
Avis au monde politique aussi… Ainsi, à Monthey, ce n’est pas un hasard si les choses avancent au pas de course : « Tous les partis soutiennent la démarche », se félicite Stéphane Coppey. Ces préoccupations sont ainsi intégrées dans toutes les réflexions, du réaménagement de la zone sportive, qui mise sur la perméabilité du sol et l’intégration de la mobilité douce, à la construction d’un nouveau centre scolaire, où l’on évite de totalement goudronner les préaux. o
Îlots de chaleur, késaco ?
« On appelle îlots de chaleur ces zones dans lesquelles la température monte à cause des constructions », résume la climatologue Martine Rebetez. À Neuchâtel, où une trentaine de capteurs ont été posés, la différence entre zones bétonnées et zones arborisées atteignait 3 à 4°C en situation de canicule. « Dans certaines régions, elle avoisine les 7°C », souligne Lionel Fontannaz, de MétéoSuisse. « On peut pointer l’urbanisation du doigt, mais le réchauffement accentue le phénomène », relève le spécialiste. Avec, pour conséquence, des problèmes de santé publique : des nuits dites tropicales, où la température ne descend pas audessous de 20°C, et trop courtes pour que l’on puisse se reposer vraiment, avec un risque de mortalité qui augmente. « La vague de chaleur de 2003 avait fait 1000 morts en Suisse, celle de 2022, 650 », rappelle Martine Rebetez. Le chiffre, certes en baisse, demeure conséquent. o
Nombre de nuits et journées tropicales, à l’exemple de Zürich Kaserne (urbain) et de Zürich Affoltern (rural)
Zürich Kaserne Zürich Affoltern
SOURCE : MÉTÉOSUISSE

DURABILITÉ ET VINS
Pour réaliser les nouveaux chais, François Schenk (à gauche) a fait appel à l’architecte Jean-Frédéric Luscher.

Évocation du vin et de la pérennité, c’est le liège qui habille les façades des nouveaux chais de la Maison Schenk, à Rolle (VD). Un projet architectural tout en symboles, qui s’inscrit dans la démarche d’écoresponsabilité de l’entreprise familiale. Visite guidée.
Texte ÉLODIE MAÎTRE-ARNAUD
Bâtir l’une des plus belles caves d’Europe. Telle est l’ambition de la Maison Schenk, qui prendra possession de son nouveau site de production dès les prochaines vendanges. Esthétique, mais pas seulement. Car l’entreprise familiale a également fait le pari de l’écoresponsabilité, sous la houlette de l’architecte genevois Jean-Frédéric Luscher, à qui elle a confié le projet. « Nous nous inscrivons dans la tendance du « moins mais mieux », en lien avec l’évolution de notre modèle d’affaire vers le développement

durable », résume François Schenk. « Le site actuel était surdimensionné ; ce qui importe aujourd’hui n’est pas d’être grand, mais d’être juste. »
C’est à l’occasion d’un séjour dans un vignoble d’Afrique du Sud qu’il découvre le travail de Jean-Frédéric Luscher. Séduit par l’esthétique de sa réalisation – « une cave parfaitement intégrée dans son environnement, construite avec de beaux matériaux » –, il lui lance le défi de transformer les chais de la Maison Schenk en une élégante cité du vin écoresponsable. Chiche ! « Ce type d’architecture ne se résume pas à un bâtiment utilitaire », affirme l’architecte, qui a également signé plusieurs caves en Californie et en France. « Il faut aussi exprimer la typicité du terroir dans lequel il est implanté. »
ENTRE LAC ET COTEAUX
À Rolle, c’est entre lac et coteaux que le terroir s’exprime. Le nouveau plan de quartier y fait d’ailleurs écho, avec la cave dans sa partie nord et le futur écoquartier au sud – un projet immobilier développé par l’entreprise Halter, en symbiose avec la philosophie de la Maison Schenk.
« Je trouvais intéressant que la forme des chais soit adaptée à ce futur quartier d’habitation, qui fera le lien entre la ville et la vigne », ajoute Jean-Frédéric Luscher. Pas de construction unique donc, mais une série de cinq volumes en bois, inscrits dans la pente et témoignant des étapes de la chaîne de production du vin : vinification des rouges et des blancs, administration, laboratoires, préparation à la mise en bouteille, mise en bouteille et expédition.
L’architecte a en outre tiré profit de la déclivité naturelle du terrain. Contrairement à la plupart des caves dont le plancher est à niveau, cette pente de 16 mètres permet une production dite gravitaire. Les grappes seront livrées sur la partie haute de la parcelle et tomberont dans les presses, en suivant simplement la pente. Le vin s’écoulera quant à lui vers les cuves, grâce à un pompage doux n’altérant pas sa qualité et nécessitant moins d’énergie.
DU
L’esprit durable de cet ensemble de bâtiments se reflète également dans le choix des matériaux. À commencer par le parti pris très symbolique
des panneaux de liège du Portugal, en façade. Posé en double couche, ce matériau naturel dispose d’excellentes propriétés d’isolation thermique et phonique. Étanches et résistants, les panneaux peuvent être facilement remplacés et recyclés au fil du temps. Les charpentes, d’une portée de 24 m, mettent quant à elles l’épicéa vaudois à l’honneur. L’usage du béton (recyclé à 25%) est réservé aux planchers et aux murs porteurs, les autres éléments constructifs étant réalisés en bois ou en terre crue. Autant de matériaux naturels qui permettent de réduire l’empreinte de l’énergie grise des bâtiments, et dont la disponibilité future est garantie. « Nous avons à cœur de nous inscrire dans la durée », martèle François Schenk, dont l’entreprise a fêté ses 130 ans l’an dernier.
DES CHAIS PRODUCTEURS D’ÉNERGIE
L’ensemble architectural fait également preuve d’une grande ambition sur le plan énergétique.

Cinq volumes en bois (en vert sur le plan ci-contre) témoignent des étapes de la production de vin. Au sud de la parcelle, le futur écoquartier.

Partout, l’esprit durable de ce projet se reflète dans le choix des matériaux.

Ainsi, aucune énergie fossile ne sera utilisée sur le site, qui intègre plusieurs sources d’énergie renouvelable. L’entreprise disposant d’une concession sur les eaux du Léman, l’énergie thermique des chais proviendra d’une station de pompage disponible pour le chauffage en hiver, le rafraîchissement en été, ainsi que pour l’eau chaude sanitaire. « L’eau ne fera que transiter par nos locaux, avec moins d’un degré de différence entre la température lors du pompage et la température lors du rejet », précise François Schenk. Les besoins thermiques seront également assurés par la récupération de la chaleur issue des fermentations. Cette chaleur résiduelle permettra de produire une partie de l’eau à 95°C destinée aux processus de production, en complément d’une pompe à chaleur haute température. La couverture des toitures plates
des cinq halles par des panneaux photovoltaïques, combinés à une végétalisation, devrait enfin produire quelque 0,5 GWh de courant vert chaque année. Un concept énergétique global, qui doit également permettre d’alimenter le futur écoquartier en contrebas de la parcelle. Le Groupe Schenk a d’ailleurs créé en ce sens une société de production et d’approvisionnement en énergie.
UNE
DES ALPES
Des pistes de revalorisation des déchets issus de la production du vin sont par ailleurs à l’étude. Il est notamment question de capter le gaz carbonique émis lors de la fermentation afin de le transformer en bicarbonate de sodium ou de potassium, pour des usages industriels. Soit un
potentiel de 300 tonnes de CO2 par an. Autre projet en cours, la mutualisation de la récupération des déchets organiques (rafles de grappes, marcs de presse, etc.) en vue de leur méthanisation et de leur retour à la vigne sous forme de compost. « Nous menons une réflexion sur l’ensemble de la chaîne de valeur », relève François Schenk.
Jean-Frédéric Luscher se réjouit quant à lui que ce « projet passionnant » soit prochainement opérationnel et dévoilé au public. « Ce type de chais est une première au nord des Alpes », souligne-t-il. « J’espère qu’il constituera un modèle d’alternative durable aux caves classiques. Nous avons vraiment une responsabilité à investiguer l’utilisation de techniques plus naturelles dans l’architecture contemporaine, notamment pour les projets de grande échelle. » o
Moins prendre l’avion, c’est déjà bien.

En savoir plus et faire un don

C’est la question du moment en matière de mobilité : faut-il passer à l’électrique ? Une problématique qui relève d’aspects autant durables et environnementaux que financiers. Pour y voir plus clair, démêlons le vrai du faux.
Texte THOMAS PFEFFERLÉ
Une voiture électrique coûte cher, mais se révèle meilleur marché qu’un modèle thermique sur son cycle d’utilisation ; il faut compter entre quelques minutes et huit heures pour recharger complètement son véhicule ; les batteries ne se recyclent pas, mais peuvent être réutilisées pour d’autres usages. Quand il s’agit de mobilité électrique, force est de constater que l’on entend tout et son contraire. Durabilité et empreinte carbone, coûts, mais aussi temps de recharge et impact sur le réseau constituent pourtant autant de points pertinents à aborder sans détour afin de prendre une décision éclairée. Aujourd’hui, de nombreux acteurs et organismes liés au secteur des transports et de l’énergie réalisent des études complètes pour analyser tous les axes liés au changement de paradigme de la mobilité individuelle motorisée. Nous avons posé sept questions à Jean-Marc Geiser, spécialiste mobilité à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN). Voici ses réponses.
1L’impact CO2 d’un véhicule électrique est moindre par rapport à un véhicule thermique
VRAI. L’empreinte carbone d’une voiture électrique est deux fois meilleure que celle d’une voiture à moteur thermique, et cela sur sa durée de vie complète, qui comprend sa fabrication, son utilisation, puis son élimination. « En termes d’efficience, pour parcourir une distance de 100 km, une voiture électrique utilise trois à quatre fois moins d’énergie qu’une voiture à moteur thermique, deux fois et demie moins d’électricité qu’une voiture à pile à combustible fonctionnant à l’hydrogène et cinq fois moins qu’un moteur thermique fonctionnant avec des e-carburants, des carburants de synthèse fabriqués en utilisant de l’électricité décarbonée », rappelle Jean-Marc Geiser. Mentionnons encore qu’un tiers de toutes les émissions de gaz à effet de serre en Suisse sont imputables au trafic motorisé.
2Rouler à l’électrique coûte moins cher VRAI. Les voitures électriques se démarquent par les coûts totaux de possession (TCO) les plus bas, toutes catégories confondues. Les écarts de coûts les plus significatifs observés se rapportent surtout aux véhicules électriques de classes moyenne et supérieure, dont les modèles figurent parmi les plus économes. Côté acquisition, tous les modèles électriques ne sont d’ailleurs pas forcément plus chers que leur équivalent thermique. L’intérêt économique de l’électrique par rapport au thermique se joue également sur les postes énergie et entretien. « Une motorisation électrique possède environ 90% moins de pièces, ce qui se traduit par moins d’entretien, moins de pannes et moins de réparations », ajoute Jean-Marc Geiser.
3Le temps de charge est encore trop long et les bornes ne sont pas assez nombreuses
VRAI ET FAUX. Tout est relatif. Par exemple, pour bénéficier d’une autonomie de 100 km avec son véhicule électrique, il est possible de le recharger en cinq minutes avec un superchargeur de 250 kW. Tout dépend donc de l’infrastructure de recharge dont on dispose et de la puissance que tolère le véhicule en la matière. Avec environ 13 000 points de recharge publics accessibles en Suisse, le nombre de bornes à disposition s’avère déjà élevé. « Le potentiel de développement se trouve actuellement surtout dans les immeubles locatifs, les lieux de travail, les sites touristiques et de loisirs, et les bornes rapides le long des grands axes », détaille l’expert de la mobilité au sein de l’OFEN. « Selon les acteurs de la branche, le nombre de points de recharge en Suisse en 2035 devrait être de 2 millions à domicile, 90 000 sur le lieu de travail et 19 000 dans l’espace public, dont 13 000 existent déjà. »
4Les batteries ne se recyclent pas FAUX. En réalité, les filières de recyclage sont déjà bien en place et présentes en Suisse. Elles parviennent en outre à d’excellents résultats, puisqu’il est possible de recycler plus de 90% des matériaux qui entrent dans la composition des batteries. « Seulement, à l’heure actuelle, l’opération de recyclage reste peu rentable. Une donne qui va bien sûr changer au cours des prochaines années, alors que les besoins en matières premières vont grandement augmenter, parallèlement au nombre de batteries à traiter. Il faut aussi noter que, avant d’en arriver à devoir recycler une batterie automobile, il est possible, et souhaitable, de la revaloriser dans le cadre d’une approche dite « multi-vie ». Après son utilisation dans la voiture, il est ainsi possible de la réutiliser à des fins de stockage du surplus d’énergie solaire, par exemple pour des logements », précise Jean-Marc Geiser. À savoir également : la durée de vie d’une batterie d’une autonomie de 300 km est estimée entre 300 000 et 450 000 km, soit bien plus que la durée de vie totale d’un véhicule thermique.
5Si tout le monde roulait subitement à l’électrique, le réseau serait en péril VRAI. Si tout le monde roulait dès demain en voiture électrique, sans aucune gestion intelligente de la recharge, il est évident que le réseau actuel ne tiendrait pas. Mais, dans la pratique, le réseau électrique et celui des infrastructures de recharge auront le temps de s’adapter à l’arrivée des voitures électriques, toujours plus nombreuses sur le marché. Pour donner un ordre d’idées, environ 17 TWh seront nécessaire en 2050 pour recharger toutes les catégories de véhicules en Suisse. D’où l’importance d’utiliser les énergies renouvelables locales pour assurer notre approvisionnement énergétique sur le
long terme et réduire notre dépendance aux pays étrangers producteurs et fournisseurs d’énergies fossiles. Pour Jean-Marc Geiser, il faut aussi garder à l’esprit que la mobilité électrique et la gestion intelligente du réseau vont se développer en parallèle. « En effet, avec des systèmes de charge bidirectionnelle, les voitures électriques et les bornes joueront vraisemblablement dans le futur un rôle actif en matière de stabilisation du réseau et d’alimentation des logements. Ce n’est en outre pas seulement un problème de réseau électrique, mais aussi de marché automobile, car les vendeurs de voitures ne pourraient pas équiper tous les automobilistes de véhicules électriques d’ici demain. »
6Mieux vaut garder sa voiture thermique en bon état que changer pour un modèle électrique neuf
FAUX. Au niveau de l’empreinte carbone, le remplacement d’une voiture thermique par une voiture électrique en vaut quasiment toujours la peine, sauf pour une personne qui roule très peu. En réalité, même dès son premier kilomètre, il est préférable de changer son ancien véhicule pour un nouveau modèle électrique. Du moins d’un point de vue purement environnemental. Simplement parce que, dès sa mise en circulation, une voiture à moteur thermique ne va cesser d’émettre du CO2. « Et en termes de coûts, comme on l’a vu, l’électrique se révèle avantageux, parfois même dès l’acquisition. Plusieurs études qui analysent des données antérieures à 2019 parviennent à des conclusions similaires », souligne le spécialiste en mobilité.
7Les véhicules hybrides sont un bon compromis PLUTÔT FAUX. Tout est une question d’interprétation, nuance Jean-Marc Geiser. « Un bon compromis au niveau des frais d’acquisition, de la rentabilité, de l’empreinte écologique, de l’efficience énergétique, de l’autonomie, de la fiabilité ? Et pour quelle catégorie de véhicules : SUV, petites voitures, catégorie moyenne ? Et quel type d’hybride : microhybride, mild hybride, full hybride, plugin hybride ? » Ce que l’on peut affirmer, c’est qu’un véhicule full hybride présente certains avantages, dans le sens où il permet d’économiser en moyenne 20% de carburant, que ses émissions de CO2 sont faibles et qu’il est indépendant des infrastructures de recharge. En revanche, sa conduite purement électrique n’est possible que sur de courtes distances et à faible vitesse, tandis que son coût d’entretien peut s’avérer plus élevé, puisqu’il possède deux systèmes d’entraînement, ce qui augmente par ailleurs son poids. o


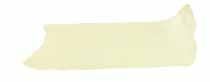
En avril dernier, le campus unlimitrust à Crissier (VD) a accueilli une des premières « fresques de la construction » de Suisse. L’événement, organisé par Romande Energie et REM Real Estate Meeting SA, a rassemblé des professionnels du bâtiment. Une journaliste de GO 2050 y a participé. Voici son retour d’expérience.
Texte JOËLLE LORETAN
Une quarantaine de professionnels de l’immobilier et de la construction ont répondu présents et les profils sont variés : employés et responsables de départements cantonaux, régies immobilières, bureaux d’architectes ou d’ingénieurs, coopératives, cabinets d’avocats ou compagnies d’assurances. L’objectif ? Prendre conscience des impacts environnementaux de la construction grâce à un atelier ludique et participatif. Autour des tables recouvertes de nappes en papier blanc, on se rassemble par groupes de quatre ou cinq. Les équipes sont formées, la fresque peut débuter.
CARTES SUR TABLE
À chaque groupe son « fresqueur » (nom donné à l’animateur). Il commence par distribuer des cartes (42 au total), sur lesquelles figurent des faits et des statistiques clés sur la construction. Chacun lit à haute voix les informations. Et certains chiffres claquent fort, comme lorsqu’on apprend que le sable – indispensable à la fabrication du béton – est la deuxième ressource la plus utilisée au monde après l’eau, ou encore que la Chine, entre 2011 et 2013, a consommé plus de béton que les États-Unis au XXe siècle. On égraine ainsi les informations et on pose progressivement les cartes sur la table en les regroupant par catégories. Petit à petit, le puzzle se compose. L’exercice s’avère d’ailleurs plus complexe qu’il n’y paraît ! Les perceptions personnelles influencent les choix, et l’interconnexion entre
le grand nombre de thématiques donne du fil à retorde : réglementations et normes, énergie, qualité de l’air, artificialisation des sols, produits et matériaux, engagements politiques, justice sociale, santé humaine, tout y passe. Après environ une heure, toutes les cartes posées forment un constat global. Reste à établir les liens de cause à effet. Alors on s’empare des stylos, on trace des flèches et des lignes en couleur sur la nappe en papier, les plus créatifs ajoutent des croquis et des dessins. Pour clore l’atelier, une courte discussion permet à chacun d’évoquer les solutions individuelles et collectives envisagées, tout comme les ressentis.
LES ÉCHANGES AU (GRAND) CŒUR
Adrien, jeune directeur d’une régie immobilière régionale, explique qu’il est venu pour le partage d’expériences et pour l’approche ouverte : « C’est une manière de sortir du mode conférence académique, où une personne détient le savoir et parle à un public qui écoute, qui sait lire les graphiques et qui comprend les enjeux. Cette forme participative permet de s’impliquer dans les réflexions et favorise le déclic personnel. » « C’est vrai ! » abonde Minh-Luc Pham, le fresqueur qui a accompagné notre groupe. « On retient mieux les informations en manipulant les cartes, en prenant physiquement part au jeu. » Sven, plutôt discret jusque-là, parle à son tour : « Je suis ingénieur et j’avoue avoir hésité à venir, parce que je suis souvent perçu comme un grand méchant bétonneur. J’avais peur de me sentir mal à l’aise, mais, finalement, j’ai beaucoup apprécié ces échanges sans animosité ni jugement. » Lors de l’apéritif partagé en fin de journée, les discussions s’élargissent et les réseaux se tissent. Et tous les échanges qui entourent la fresque sont d’une grande richesse : durant l’atelier, lorsqu’on déplace les cartes et qu’il faut se mettre d’accord, mais également lors des moments informels, où les sentiments se livrent et les retours d’expériences se partagent.


Relevons également la satisfaction de constater que le mouvement est amorcé. Il y a quelques années, une telle initiative aurait été perçue comme marginale, Aujourd’hui, deux grands acteurs s’unissent pour influencer leur secteur respectif.
LE MARIAGE DE L’ATOME ET DE LA PIERRE Romande Energie, grand groupe énergétique vaudois, est à l’origine de cette fresque de la construction (lire encadré). REM Real Estate Meeting SA, qui fédère des professionnels de l’immobilier et de la construction, s’est chargé de l’organisation. L’union d’un énergéticien et d’un acteur de l’immobilier peut questionner. Mais entre défis de la transition climatique et énergétique et bâtiments qui deviennent producteurs d’énergie, les frontières entre les disciplines deviennent perméables. « Le secteur du bâtiment représente 40% de la consommation totale
d’énergie en Suisse, il est le deuxième secteur qui émet le plus de CO2 », précise Tiphaine Roussillon, collaboratrice chez Romande Energie et responsable de l’organisation de cette fresque de la construction. « Il est donc indispensable de déployer un effort rapide et important pour décarboner cette industrie. » Minh-Luc Pham, « fresqueur » et collaborateur chez Romande Energie, rappelle qu’il est indispensable de fonctionner de concert. « La question du bâti s’est complexifiée et l’énergie est devenue centrale. Avoir une pensée globale et systémique sur les questions de rénovation est devenu essentiel, car comprendre ce qui sous-tend le tout facilite la prise de conscience et l’action. Un grand nombre d’acteurs doivent s’aligner pour atteindre des objectifs qui visent une échelle encore jamais vue. Et la fresque est un excellent moyen de sensibiliser les gens et de favoriser un passage à l’action. » o
Cet atelier participatif fait appel à l’intelligence collective d’un groupe afin de sensibiliser sur les enjeux du changement climatique. L’idée a germé en 2015 dans l’esprit de Cédric Ringenbach, alors directeur de The Shift Project (France). S’appuyant sur les données du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), il crée les cartes qui composeront la fresque du climat. Depuis, les thématiques se sont élargies (construction, biodiversité, numérique, mobilité, etc.). La fresque de la construction a quant à elle été créée en 2020 par des animateurs bénévoles français de la fresque du climat, également professionnels de la construction. En 2023, l’atelier a été adapté pour la Suisse par des collaborateurs de Romande Energie. o ➜ www.fresquedelaconstruction.org

Vous souhaitez organiser un atelier fresque de la construction dans votre entreprise ou votre commune ?
Renseignements en scannant le code QR ci-dessous.
De la vaisselle au gril jetable en passant par les canettes de boissons, un barbecue peut facilement devenir une mini-catastrophe écologique. « Éviter le jetable, privilégier le local » : tel est le mantra que recommande d’adopter Aurélie Gateaud, codirectrice de l’association ZeroWaste Switzerland.

QU’EST-CE QU’ON MANGE ?
Dans l’assiette, on favorise le végétal – « les champignons apportent la saveur umami tant appréciée », relève Aurélie Gateaud. Pour retrouver le goût du grillé, on optera par exemple pour des tranches d’aubergine et de poivron, de préférence d’origine locale. Et si l’on tient à la viande ? « La volaille est celle qui génère le moins de CO2, suivie du porc et, en dernier lieu, du bœuf. » Aux filets de poisson, qui risquent de s’émietter, on préfère un poisson entier, local bien sûr. Aux substituts véganes, pas terribles du point de vue de la santé, on préférera un tofu mariné. L’astuce ? « Associer légumes et viande pour éviter de manger 300 g de steak comme dans les séries télévisées. » L’occasion pour les carnivores convaincus de découvrir de nouvelles saveurs !

LE MEILLEUR MODE DE CUISSON ?
Tout dépend de l’endroit où l’on fait ses grillades. Au jardin ou en camping, les plus patients tenteront le four solaire, parfait pour réchauffer un plat ou cuisiner légumes et céréales. « Pour la viande, le barbecue électrique, alimenté par du courant vert, évidemment, reste la meilleure solution. » Le charbon, « local et de bonne qualité » – autrement dit labellisé FSC ou PEFC –, le suit de près. « À conserver au sec ! Humide, il dégage des HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques, ndlr), cancérigènes », prévient-elle. Pour le faire démarrer, vive le petit bois et le papier, vade retro l’allume-feu à base de produits pétroliers ! Et le gaz ? Il est peu pratique à transporter, mais « le biogaz local est intéressant, car il chauffe vite ». Et a-t-on vraiment besoin de préciser que les barbecues à usage unique sont à proscrire ?

QU’EST-CE QU’ON BOIT ?
« On privilégie les contenants réutilisables. Les meilleurs écologiquement parlant sont consignés, cela signale une provenance locale. » Quid du verre ? « Son recyclage fonctionne bien, mais il est très énergivore », souligne Aurélie Gateaud. « Par ailleurs, seulement 25% de celui qui est récupéré retourne faire des bouteilles. » À fuir, le PET – c’est un plastique. Si l’on n’a pas le choix, on cible les plus grands contenants possibles. En randonnée, la gourde reste un must, à remplir de kéfir ou de thé froid maison, par exemple.

ET LA VAISSELLE ?
On bannit le jetable, même labellisé « recyclable ». C’est aussi valable pour le bambou : « Il vient souvent d’Asie – inacceptable du point de vue de l’énergie grise – et est habillé d’une pellicule plastique qui le rend non compostable. » Au jardin, on utilise ses verres, assiettes et couverts habituels ; si l’on craint de les abîmer, on en chine dans une brocante ; si l’on en manque, on demande à ses invités d’en apporter. Idem pour les chaises ou les petites cuillères. Pour les raisons précitées, on évite de craquer pour un joli kit de pique-nique « made in China ». Et pour voyager léger, par exemple en balade, on embarque les Tupperware de grand-maman et on ressort la vaisselle en plastique dont Junior et Juniorette se servaient bébés. o



