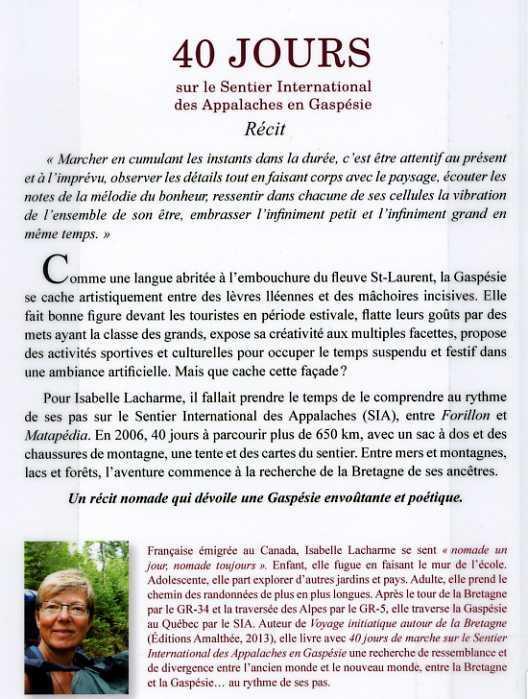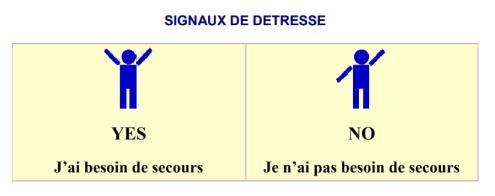Un voyage de mille lieues commence toujours par le premier pas.



SIA-QC-Topo+ Mis à jour le 2023/06/04 Auteur : Michel Lm Auger
Rivière-au-Renard
Mont-Albert
Lao-Tseu (VIe siècle av. JC)
Le projet SIA-QC Topo+ sur le Sentier international des Appalaches veut aller au-delà de la simple cartographie en y intégrant des informations sur les toponymes des régions traversées, des portraits de personnes y ayant vécu ou travaillé, de certains événements historiques locaux, des informations sur la faune, la flore, la géologie et attraits de la région.
Les liens en italique sont des hyperliens externes. Les étoiles rouges indiquent une nouveauté.
Index :
• Cartes topographiques Historique du SIA
• Cartes des secteurs Réservation hébergement SIA

• Profils topographiques Page Facebook officielle SIA-QC


• Repères géographiques Groupe Facebook SIA-QC Classe 2023
• Toponymie Groupe Facebook SIA-QC






• Suppléments Etat des sentiers
• Hébergement SIA
• Services Ravitaillements
• Filmographie Périodes de chasse
• Portraits Calendrier des phases lunaires
Légende Navigation Temps de marche Tables des marées Grande-Vallée
Livres et blogues Cloridorme
Crédits URGENCE Bureaux de poste Pharmacies
Lexique SAUVETAGE


Merci Isabelle
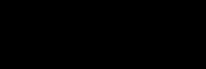
SIA-QC-Topo+
michel.lm.auger@gmail.com
INDEX DES CARTES TOPOGRAPHIQUES
Ce projet a utilisé le découpage en 39 sections proposé par le site Hikster. Ce découpage journalier est une simple indication. Il est nécessaire d'adapter votre planification à vos envies et capacités physiques.
SIA-QC-Topo+ michel.lm.auger@gmail.com
Secteur Section Balises Section Balises Avignon 01-Matapédia 650-648 02-Ref. Turcotte 647-631 03-Ref. Corbeau 630-622 04-Ref. Quartz 621-604 05-Ref. Ruisseau Creux 606-593 Matapédia 06-Causapscal 592-560 07-Abri Chutes 560-544 08-Abri Erablière 543-521 09-Amqui 520-506 10-Saint-Vianney 505-480 11-Rivière Matane 480-460 Matane 12-Ruisseau Pitounes 460-449 13-Lac Tombereau 447-435 14-Lac Matane 435-421 15-Lac Gros Ruisseau 421-414 16-Mont Craggy 414-405 17-Lac Beaulieu 404-397 18-Petit Sault 396-382 19-Ruisseau Bascon 381-374 16:18 Sorties d’urgence Gaspésie 20-Ref. Nyctale-Chouette 373-365 21-Ref. Huard 22-Ref. Mésange 23-Lac Cascapédia 24-Ref. Paruline 25-Mont Albert 26-Ref. Tétras 27-Mont Jacques-Cartier Haute-Gaspésie 28-Ref. Cabourons 255-247 29-Mont Saint-Pierre 245-228 30-Ruisseau Flétan 226-197 31-Madeleine Centre 196-170 32-Grande Vallée 163-139 Côte Gaspé 33-Ref. Cascades 139-111 34-La Chute 110-87 35-Ref. Zéphyr 87-79 35A-Sentier des Éoliennes 36-Erablière 77-56 Forillon 37-Les Lacs 56-33 38-LesCrêtes1 34-24 39-Cap Gaspé 24-1 Trop loin à l'ouest, c'est l'est. Lao-Tseu (VIe siècle av. JC)

SIA-QC-Topo+ michel.lm.auger@gmail.com
Lac du Diable
INDEX DES SUPPLÉMENTS
Catégorie Article Catégorie Article
Caribou Caribou de la Gaspésie-Atlantique
Caribou des bois ou orignal ?
Flore Flore laurentienne
Petit guide des plantes de bord de mer
Ornithologie Oiseaux du Québec par la couleur
Go oiseaux!.ca
Le chant du huard décodé
Divers Pourquoi ne pas toucher à une carcasse de mammifère marin ?
Détérioration du fleuve Saint-Laurent
Carte observations de baleines de la semaine
Catalogue des amphibiens et reptiles du Québec
Géologie Mont-Albert Lac aux Américains
Histoire Les Micmacs
La déportation de Gaspé
La révolte des pêcheurs de Rivière-au-Renard
Le naufrage du Carrick
Le Fort Péninsule
Enigme du radar du Mont Jacques-Cartier
Plan de destruction de la ville de Gaspé (2e guerre mondiale)
Histoire du phare de Cap-Gaspé
Histoire du parc de la Gaspésie
La torpille de St-Yvon. 1942
Drame aérien dans les « Shick-Chok ». 1957
Le tour de la Gaspésie (histoire épique d’un voyage sur la route)
Mont Jacques-Cartier Explorations du frère Marie-Victorin en Haute-Gaspésie (1885-1944)
Général Mont Logan Parc national Forillon
La Gaspésie Une toponymie maritime
Bénévoles SIA
Rando Sauvetage sur le SIA: le labyrinthe
Région éloignée : Savoir agir en cas d’urgence
Lexique
Événement Le Festival en chanson de Petite-Vallée
Festival Musique du bout du Monde (Gaspé)
Sans Trace Réserves
écologiques :
• Fernald • Manche d’Épée
• Mont-Saint-Pierre • Ristigouche
michel.lm.auger@gmail.com
SIA-QC-Topo+
Catégorie Vidéos
FILMOGRAPHIE
Catégorie Vidéos

SIA-QC Présentation du sentier Histoire Jacques Cartier revu et corrigé partie 1, partie 2
Au cœur des ChicChocs (SEPAQ)
Coup de coeur
1758: Wolfe, l’ennemi de la Gaspésie
Activités hivernales La deuxième guerre mondiale en Gaspésie
Faune et flore La bataille du Saint-Laurent aux portes de Forillon (Parcs Canada)
Les rivières Grand feu de Rimouski (1950)
L’Histoire du parc Village St-Octave de l’Avenir Villages effacés (Radio-Canada)
La Géomorphologie Chez nous, c’est chez nous (ONF)
Sécurité en montagne Marée noire à Matane (1985)
Activités plein air Canyoning au canyon Beaulieu Environnement Les sept merveilles du Bas-Saint-Laurent de SNAP
Cours d’avalanche au Hogs Back
Trekking sous la neige
Photographe/Peintre animalier
Jean-Simon Bégin Randonnées Productions Les Krinkés Déluge au Mont-Albert
Claude Fortin Pic de l'Aube
Gisèle Benoit Mont Logan
Eric Deschamps Nicol-Albert : La Gigue des recrues
Daniel Auger Xalibu Jacques-Cartier
Divers L’érosion côtière en Gaspésie
Mont Saint-Pierre en drone
Woman in the woods Tour du Mont Albert
Confiné ($) L’ultra-marathonien Mathieu Blanchard a franchi les 650km en un peu plus de 7 jours.
Saint Maxime-du-Mont-Louis Cheminements (Traversée avec un chien)
La route de la Gaspésie…à une autre
époque (Musée de la Gaspésie)
L’Écho des Chic-Chocs (Réserve faunique de Matane)
Auberge de montagne des Chic-
Chocs. (Drone en hiver)
La guerre des bois (2014)
Parc Forillon La complainte de Forillon (chanson) Résumé de l’implantation du parc Forillon
SIA-QC-Topo+
michel.lm.auger@gmail.com
Alfonse, Jean Dansereau, Pierre
Apalaches
Denys, Nicolas
Matapédia ,Colonisation de la vallée…

Moll, Herman
Deshayes, Jean Montmagny, Charles Hault de Bellin, Jacques-Nicolas
Bayfield, Henry Wolsey
Franquelin, Jean Baptiste Louis
Potvin, Alain
Blanchard, Raoul
Cartier, Jacques
Frontenac, Louis de Buade de Raudot, Jacques
Hazeur, François
Roberval, Jean-François de La Rocque de
Catalogne, Gédéon de Kempt, James
Taché, Eugène-Étienne
Saint-Viateur, Clercs de Champlain, Samuel de Le Clercq, Chrétien
Chaste, Aymar de Léry, Chaussegros de Vaudreuil, Pierre de Rigaud de Chauvin, Pierre de Marie-Victorin, frère
Vautrin, plan
Vimont, Barthélemy
Wolfe, James
SIA-QC-Topo+ michel.lm.auger@gmail.com
PORTRAITS
Forte pente (avec corde)
Chute
Source d’eau
Eau non disponible
136 Position balise
Couverture du profil de la carte (Certaines sections requièrent plusieurs cartes)
Point de vue
Réserve écologique ou Habitat floristique
Hébergement (entre parenthèses)



Abri 3 côtés (appentis ou lean-to)
Abri 4 côtés Camping avec/sans plateforme
Refuge (poêle)
Auberge/Motel
Abri de jour
Profil topographique de section
Point de jonction entre 2 cartes de même section.
Nom des cartes :

SIA-section12-Matane-RuisseauPitounes-1 /2


Bureau de poste
Table des marées
Chemin forestier
Ligne hydroélectrique



Éléments cliquables
Lien externe sur image
Lien externe sur icône


Distance dans la section (km).
Permet de se localiser sur le profil topo.

Ravitaillement
Référence toponymie en hyperlien

• Hyperlien externe

• Hyperlien interne
SIA-No section- Secteur- Destination- No de la carte / Nb de cartes section

Lien interne sur icône
Google Maps (externe)

S Services (interne)

14
Tableau temps de marche
Image satellitaire





Carte secteur

LÉGENDE
Épicerie Dépanneur
Pharmacie
Retour
Balise
Pourcentage de pente (calculé par logiciel) > 25% 28%
136
911
TOPONYMIE SIA
Toponyme Type entité Origine et signification
Albert Mont Ce mont fait partie des Chic-Chocs. Atteignant une altitude de 1 151 m, il comporte deux hauteurs, le sommet Albert Sud, le plus élevé, et le sommet Albert Nord, séparées par un plateau connu sous le nom Table à Moïse, un ensemble que l'on peut admirer de la route traversant la péninsule gaspésienne de Sainte-Anne-des-Monts à New Richmond. Quelques autres reliefs des environs, les monts Jacques-Cartier et Richardson notamment, partagent à des degrés divers certaines des caractéristiques bioclimatiques qui font du mont Albert un site exceptionnel au Québec : les neiges le recouvrent – du moins en partie – neuf mois par année; sa végétation de toundra alpine est particulière, à plusieurs égards semblable à celle du Grand Nord; on y trouve, à certains moments de l'année, quelques hardes de caribous des bois, ces cervidés s'étant maintenus au sud du Saint-Laurent uniquement dans la région des monts Chic-Chocs. Le mont Albert a été ainsi nommé par l'arpenteur-géologue Alexander Murray (1810-1884), qui en atteignit le sommet le 26 août 1845, jour de l'anniversaire de naissance du prince de Saxe-Cobourg-Gotha, Albert (1819-1861), époux de la reine Victoria.
Légende SIA-QC-Topo+
Source : Commission de toponymie du Québec
NAVIGATION
Comme « Une image vaut mille mots » et son corollaire « Une image évite mille maux », voici quelques exemples des symboles de navigation utilisés dans ce projet.


Cercle noir Hébergement Clic sur photos Liens cachés Nouveautés et navigation photos Services Point de jonction
Cercle rouge et soulignement
Cercle rouge sur icône : hyperlien externe

Soulignement : Lien vers Toponymie
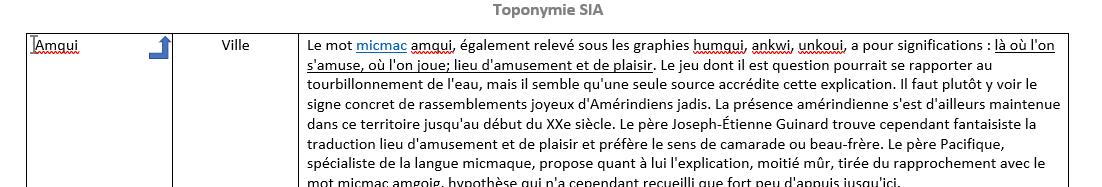
Cercle noir
Cercle noir sur icône: Horaire interne pharmacie ou Poste Canada


Italique : Lien externe vers pharmacie

Navigation SIA-QC-Topo+
Retour à la carte
Hébergement
Non disponible
Disponible
Parenthèse : vers le tableau d’hébergement

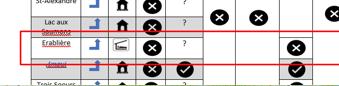
Parenthèse + italique : hyperlien externe vers hébergement

Navigation SIA-QC-Topo+
Clic sur photos

Un clic sur une photo d’abri amène également au tableau d’hébergement.

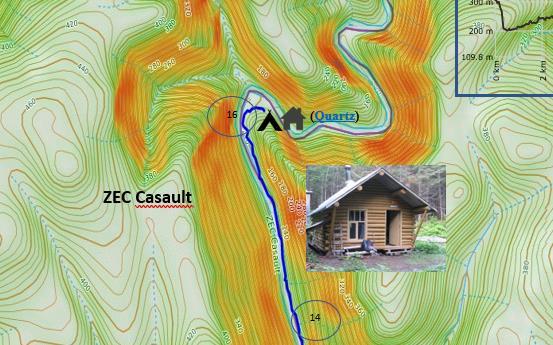
Un clic sur une photo d’un lieu nommé amène au toponyme ou parfois à un site externe.

Navigation SIA-QC-Topo+
Liens cachés



Plusieurs photos ont des liens cachés vers des sujets variés. Ils sont indiqués par un point rouge.



Navigation SIA-QC-Topo+
Nouveautés et navigation photos
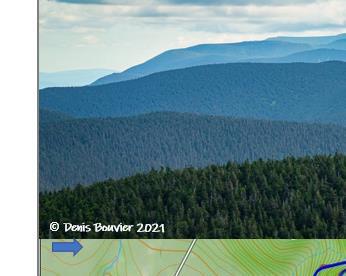


Une étoile rouge indique une nouveauté depuis la version précédente. Elle peut se retrouver à un niveau inférieur.

Les flèches horizontales bleues permettent de naviguer parmi toutes les photographies d’un(e) photographe.

Navigation SIA-QC-Topo+
Il y a souvent du chevauchement entre deux cartes d’une même section, comme on le voit dans les cercles rouges de ces deux cartes.

Le point de jonction, constitué d’un trait jaune, permet tout simplement de se positionner instantanément sur la carte suivante lorsqu’on atteint la fin du sentier de la première carte.

Navigation SIA-QC-Topo+ Point de jonction
Carte 2
Carte 1

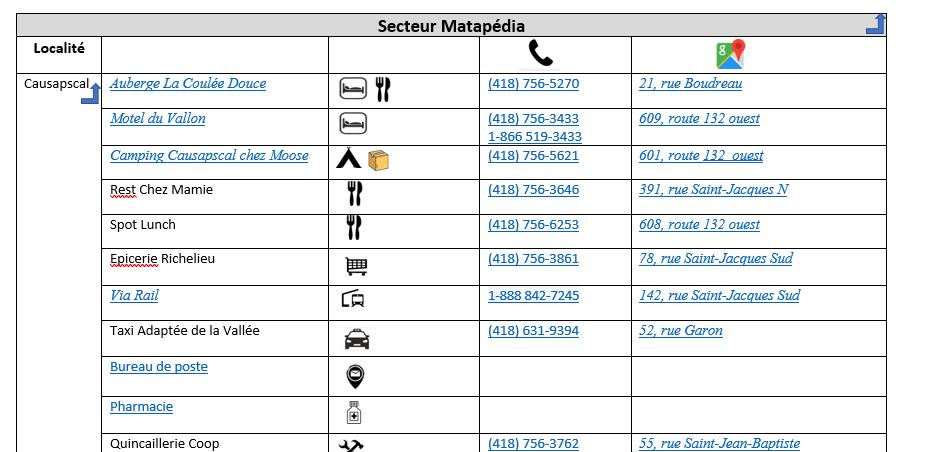



Navigation SIA-QC-Topo+ Services Clic sur icône Services Site web Google Maps Téléphone
Flèches de retour
Pour les cartes topographiques, la flèche de retour -située en bas à droite - ramène à l’index des cartes topographiques.

Dans la plupart des autres cas, elle ramène à l’hyperlien appelant. Pour les Suppléments, c’est vers l’index des suppléments, sauf exception à votre choix.
Par exemple, en cliquant sur l’hyperlien Amqui, la description du toponyme est affichée. Un clic sur la flèche nous ramène à l’hyperlien Amqui, la carte dans ce cas.

Dans les cas où un hyperlien peut-être appelé de différentes cartes, vous aurez à choisir la source pour y retourner.



Navigation SIA-QC-Topo+
Ce chiffre rappelle le no de section pour revenir de la carte des secteurs

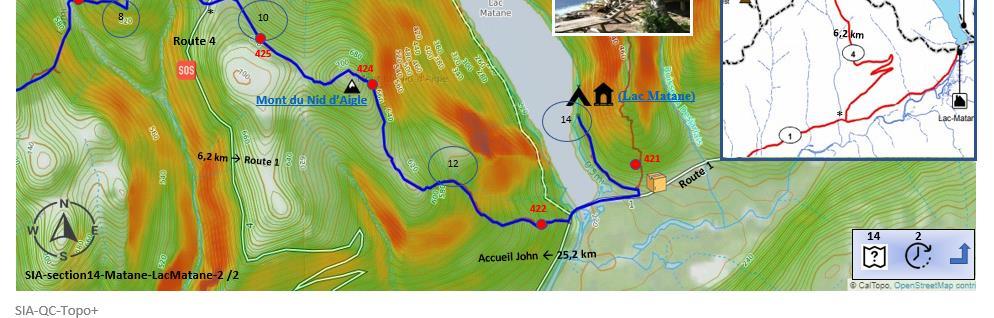
Ce chiffre rappelle le numéro de page de la section pour revenir du tableau du temps de marche

Navigation SIA-QC-Topo+
Estimation du temps de marche

Le tableau du temps de marche estime le temps pour 5 vitesses de base (de 2 à 4 km/h) , en y ajoutant 1 heure par 300m de dénivelé positif et 1 heure par 500m de dénivelé négatif pour la plupart des sections, mais en ne cumulant que les dénivelés des pentes de 7% et plus, selon la Fédération française du Milieu Montagnard. Une pente de moins de 7% est considérée comme un terrain plat. Ceci permet de pas trop surestimer le temps de marche.


Pour des variables personnelles différentes, veuillez utiliser la feuille de calcul ‘Planification SIA.. Il est possible de faire varier sa vitesse par secteur.
Ce graphique provient des infos de plus de 1200 randonneurs de la mythique John Muir Trail.


Source : randonner-malin

SIA-QC-Topo+
PROFIL TOPOGRAPHIQUE PAR SECTEUR


Gaspésie Haute-Gaspésie Côte-Gaspé Forillon
Avignon (5-472m) Carte secteur 1- 2-Ref. Turcotte 3-Ref. Corbeau 4-Ref. Quartz 5-Ref. Ruisseau Creux
Matapédia (68-468m) Carte secteur 6-Causapscal 7-Chutes 8-Ref. Érablière 9-Amqui 10-St-Vianney 11-Riv. Matane
Matane
Secteur
Secteur

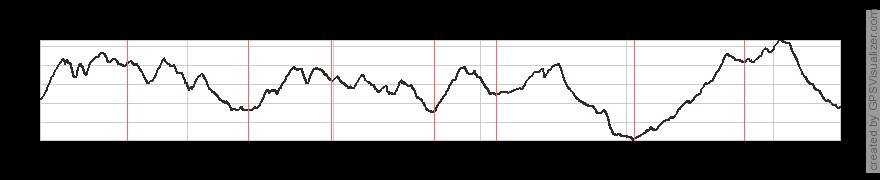
Profil topographique par secteur SIA-QC-Topo+
Carte
12-Ruiseau Pitounes 13-Lac Tombereau 14-Lac Matane 15-Lac Gros Ruisseau 16-Mt Craggy 17-Lac Beaulieu 18-Petit Sault 19Ruisseau Bascon
Secteur Matane (89-1060m)
secteur
Carte
20-Nyctale 21-Huard 22Mésange 23-Cascapédia 24Paruline 25-Mt Albert 26-Tétras 27-J-Cartier
Secteur Gaspésie (210-1274m)
secteur
Secteur Haute-Gaspésie (2-718m)

28-Cabourons 29-MtStPierre 30-Ruisseau Flétan 31-Madeleine-Centre 32-Grande Vallée
Secteur Côte-Gaspé (1-350m) Carte secteur
Profil topographique par secteur SIA-QC-Topo+
 Carte secteur
Carte secteur
33-Cascades 34-La Chute 35-Zéphyr 36-Érablière



SIA-QC-Topo+ Secteur Forillon (4-490m) Carte secteur 37-Les Lacs 38-Les Crêtes 1 39-Cap Gaspé
Profil topographique par secteur
Carte générale Matane
CARTE DES SECTEURS
Ste-Annedes-Monts
Gaspésie (Sections 20-27)

Haute-Gaspésie (Sections 28-32)

Côte-Gaspé (Sections 33-36)
Forillon (Sections 37-39)
Matapédia (Sections 6-11)
Matane (Sections 12-19)



Causapscal
Avignon (Sections 1-5)
Amqui
Mont Blanc
Mont Jacques-Cartier
Mont Albert
Mont St-Pierre Grande Vallée
Rivière-au-Renard
Matapédia
Gaspé
Carte des secteurs SIA-QC-Topo+










Secteur Avignon








 © Caltopo Matapédia
(Matapédia)
© Caltopo Matapédia
(Matapédia)
St-André-de-Restigouche (Turcotte) (Corbeau)
Canyon Clark nord
(Ruisseau St-Etienne)
Rivière Assemetquagan
(Quartz)
(Ruisseau Creux)
Section 5
Section 4
Section 3
Section 2
Données des sections 1 2 3 4 5 Distance (km) 1,9 17,9 9,5 16,2 11,4 Dénivelé+ (m) 64 976 299 542 799 Dénivelé- (m) -693 -325 -720 -741 Min/Max (m) 27/354 268/472 110/460 126/400
Section 1
(Lagacé)
Profil topo AVIGNON
SIA-QC-Topo+
Amqui
Carte des secteurs

(St-Alexandre) (Erablière)
Section 9

(Chutes)




Section 8










Secteur Matapédia-1/2
(Lac au Saumon)
Section 7
(Causapscal)


Causapscal
(Ste-Marguerite-Marie)
Profil topo MATAPÉDIA




Section 6
(Ruisseau Creux)
© Caltopo
Données des sections 6 7 8 9 Distance (km) 30,4 16,2 22,5 18,1 Dénivelé+ (m) 642 433 566 237 Dénivelé- (m) -654 -362 -476 -436 Min/Max (m) 140/469 170/330 222/450 160/360
SIA-QC-Topo+
Secteur Matapédia-2/2
Carte des secteurs

Réserve faunique de Matane
(Les Trois Sœurs)
(St-Vianney)
(Amqui)

Section 11
(Riv Matane) Section 10
Données des sections 10 11





Distance (km) 27,3 17,4



Dénivelé+ (m) 453 260
Dénivelé- (m) -370 -419 Min/Max (m) 159/321 69/302
Profil topo MATAPÉDIA
 (Accueil John)
(Accueil John)
Secteur Matane-1/2














des secteurs
Matane)
Carte
SIA-QC-Topo+ (Riv.
(Ruisseau des Pitounes) (Lac Tombereau) (Montagne à Valcourt) (Lac Matane) (Lac du Gros Ruisseau) Section 12 Section 13 Section 14 Section 15 Mont de l’Ouest Mont des Clercs © Caltopo Données des sections 12 13 14 15 Distance (km) 11,4 13,4 14,3 8,3 Dénivelé+ (m) 701 654 975 780 Dénivelé- (m) -386 -735 -1062 -375 Min/Max (m) 89/630 329/689 221/796 237/830 Profil topo MATANE












 Carte des secteurs SIA-QC-Topo+
(Lac du Gros Ruisseau)
(Mont Craggy)
(Lac Beaulieu)
(Petit Sault)
(Ruisseau Bascon)
Mont Pointu
Mont Blanc
Mont Nicol-Albert
Mont Coleman
Section 16
Section 17
Section 18
Section 19
Carte des secteurs SIA-QC-Topo+
(Lac du Gros Ruisseau)
(Mont Craggy)
(Lac Beaulieu)
(Petit Sault)
(Ruisseau Bascon)
Mont Pointu
Mont Blanc
Mont Nicol-Albert
Mont Coleman
Section 16
Section 17
Section 18
Section 19
©
Données des sections 16 17 18 19 Distance (km) 9,8 7,8 14,8 8,1 Dénivelé+ (m) 728 702 776 612 Dénivelé- (m) -786 -627 -1284 -113 Min/Max (m) 545/925 571/1060 139/949 130/640
Secteur Matane-2/2
Caltopo
Profil topo MATANE
Secteur Gaspésie-1/2

















Carte des secteurs SIA-QC-Topo+
Gaspésie © Caltopo (Ruisseau Bascon) (Nyctale et Chouette) (La Croisée) (Carouge) (Kalmia) (Huard) (Mésange) (Saule) (Lac Cascapédia) (Pluvier)
Pic de l’Aube Pic du Brûlé
Parc national de la
Mont Logan Mont des Loupes
Section 20 Section 21 Section 22 Section 23
Données des sections 20 21 22 23 Distance (km) 12 16,4 11,4 14 Dénivelé+ (m) 925 553 724 514 Dénivelé- (m) -538 -1040 -413 -828 Min/Max (m) 640/1137 519/1073 519/978 504/900
topo GASPÉSIE
Profil
Secteur Gaspésie-2/2






Profil











Parc national de la Gaspésie

Carte des secteurs SIA-QC-Topo+
© Caltopo
Cascapédia)
Pluvier) (Paruline) (Fougère) (La Rivière) (Roselin) (Tétras) (Camarine)
(Lac
(
(Mont Jacques-Cartier)
Mont Albert Nord
Mont Jacques-Cartier
Mont Dos de la Baleine
Section 24 Section 25
Section 26
Section 27-1
Section 27-2
Données des sections 24 25 26 27 Distance (km) 8,3 18,9 15 13 Dénivelé+ (m) 528 497 1031 356 Dénivelé- (m) -349 -980 -206 -828 Min/Max (m) 512/986 210/1000 220/1124 550/1274
GASPÉSIE
topo
Secteur Haute-Gaspésie-1/3

SIA-QC-Topo+

Section 28



(Mont Jacques-Cartier)

Carte des secteurs
 © Caltopo
© Caltopo
Section 29-1 (Cabourons)
Données des sections 28 29 Distance (km) 14,5 19,3 Dénivelé+ (m) 415 261 Dénivelé- (m) -441 -775 Min/Max (m) 422/718 10/640 Profil topo HAUTE GASPÉSIE
Carte des secteurs
Secteur Haute-Gaspésie-2/3






Profil topo HAUTE GASPÉSIE

SIA-QC-Topo+
(Mont Saint-Pierre)
(Camping Parc et Mer)
(Camping de l’Anse Pleureuse)
(Ruisseau Flétan)
Mont Saint-Pierre
Section 29-2
Section 30
Section 31-1
© Caltopo
Données des sections 30 31 Distance (km) 30,3 27 Dénivelé+ (m) 1131 962 Dénivelé- (m) -1077 -1004 Min/Max (m) 2/460 7/420
Mont Louis
Carte des secteurs
Secteur Haute-Gaspésie-3/3

Manche d’Épée
Madeleine Centre
Section 31-2

(Camping Mer et Montagne)
Section 32
(Camping Au Soleil Couchant)
Grande Vallée
(Grand Sault)
Données de section 31 32
Distance (km) 27 31





Dénivelé+ (m) 962 765
Dénivelé- (m) -1004 -786
Min/Max (m) 7/420 //430
Profil topo HAUTE GASPÉSIE
© Caltopo
SIA-QC-Topo+
Carte des secteurs

Secteur Côte-Gaspé-1/2






(Camping Au Soleil Couchant)

SIA-QC-Topo+
© Caltopo
(Les Terrasses) (Cascades) (Motel du Cap)
Données des sections 33 34 Distance (km) 27,8 23,7 Dénivelé+ (m) 948 826 Dénivelé- (m) -809 -794 Min/Max (m) 2/350 2/310
Section 33 Section 34-1
CÔTE GASPÉ
Profil topo
Petite Vallée Saint-Yvon
Secteur Côte-Gaspé-2/2
Profil

Carte des secteurs SIA-QC-Topo+

(Motel Camping des Ancêtres)








(Des Carrières)
(de l’Érablière) © Caltopo
(La Chute)
(Zéphyr)
Section 34-2
Section 35
Section 36
topo CÔTE GASPÉ Données des sections 35 36 Distance (km) 8,9 22,1 Dénivelé+ (m) 335 840 Dénivelé- (m) -520 -649 Min/Max (m) 18/299 1/260
Carte des secteurs

Secteur Forillon-1/2


SIA-QC-Topo+


(de

Rivière-au-Renard
(Camping

Données
(Les Lacs)
l’Érablière)
Section 37
Section 38-1
© Caltopo
des Appalaches)
37 38 Distance (km) 23,5 9,3 Dénivelé+ (m) 777 275 Dénivelé- (m) -557 -434 Min/Max (m) 28/491 155/435
des sections
Profil topo FORILLON
Secteur Forillon-2/2






(Camping
(Camping
(Camping

Carte des secteurs SIA-QC-Topo+
Section 38-2
Section 39 © Caltopo
(Les Crêtes 1)
de section 39 Distance (km) 22,6 Dénivelé+ (m) 752 Dénivelé- (m) -988 Min/Max (m) 4/383
St-Alban
(Les Crêtes 2)
Données
Mont
Cap Gaspé
des-Rosiers)
Cap-Bon-Ami)
Petit-Gaspé)
Profil topo FORILLON

 Massif des Chic-Chocs, vu de la Pointe aux Anglais, sur la Côte Nord
Massif des Chic-Chocs, vu de la Pointe aux Anglais, sur la Côte Nord
CARTES TOPOGRAPHIQUES











SIA – Secteur Avignon SECTION 1 : Nouveau-Brunswick → Matapédia SIA-QC-Topo+
Camping municipal parc Adams
Avignon-Matapédia © Caltopo
NOUVEAU-BRUNSWICK Matapédia
Rivière Restigouche
S
650
649
648
L'unique moyen de savoir jusqu'où l'on peut aller, c'est de se mettre en route et de marcher. (Henri Bergson)










SIA-QC-Topo+
SIA – Secteur Avignon SECTION 2 : Matapédia → Refuge Turcotte
©
6 4 2
(Matapédia)
Avignon-RefTurcotte-1 /3
Caltopo
Matapédia 1/3
Coulée McDavid
641 642 643 644 645 646 647 2 2 1 641
Rivière Matapédia



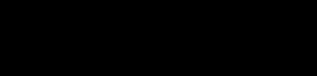






SIA – Secteur
SIA-QC-Topo+ 8 Avignon-RefTurcotte-2 /3 © Caltopo 10 12 Chutes à Pico 2/3 ATTENTION : Cet ancien sentier du SIA n’est plus entretenu et le balisage s’est détérioré. 635 636 637 638 639 640 2 2 2 2 639 636 (Lagacé)
Avignon SECTION 2 : Matapédia → Refuge Turcotte
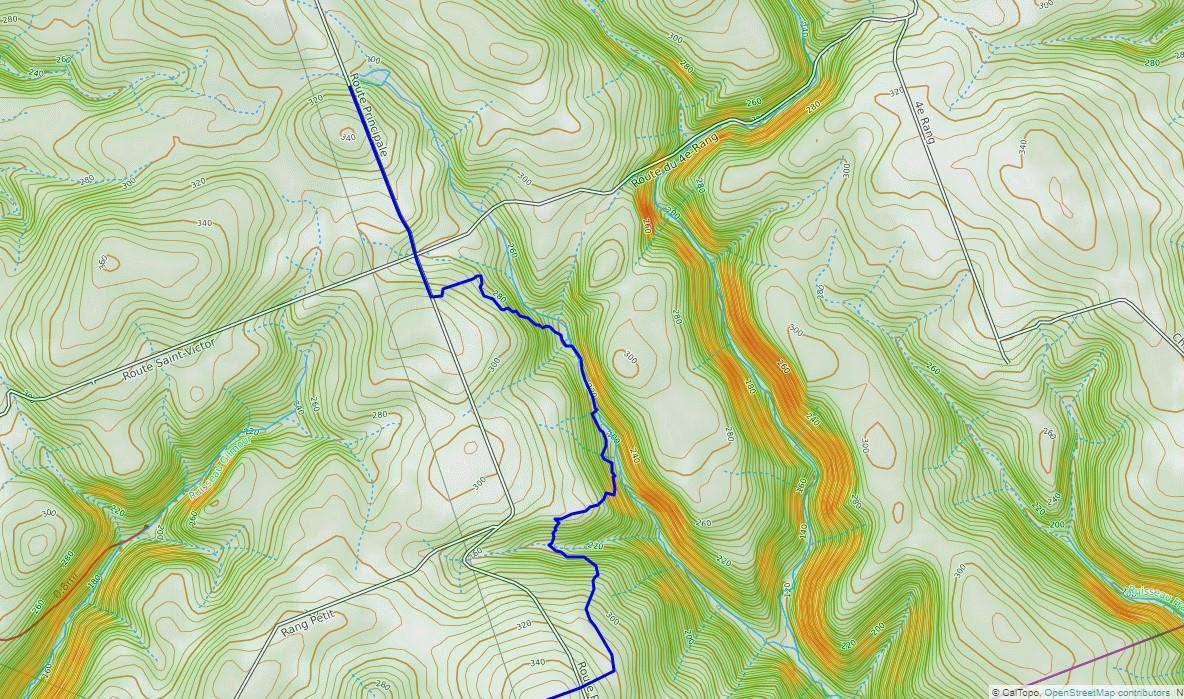














SIA – Secteur Avignon SECTION 2 :
→
Turcotte SIA-QC-Topo+ (Camping
(Turcotte) Avignon-RefTurcotte-3 /3 St-André de Restigouche 14 16 3/3 S 635 634 633 632 631 3 2 2 2
Matapédia
Refuge
et refuge municipal)
Chute à Roger












SIA – Secteur Avignon SECTION 3 : Refuge Turcotte → Refuge Corbeau SIA-QC-Topo+
Avignon-RefCorbeau-1 /2 2 4 6 8
(Turcotte) St-André-de-Restigouche
(Corbeau) 1/1 622 623
Canyon Clark nord 624
625 626 627
628 629 630 3 2
625 623
Il existe bien des méthodes pour atteindre un objectif, mais la meilleure est celle qui consiste à ne jamais abandonner. (Auteur inconnu)
ACCÈS SECONDAIRE POUR LE REFUGE




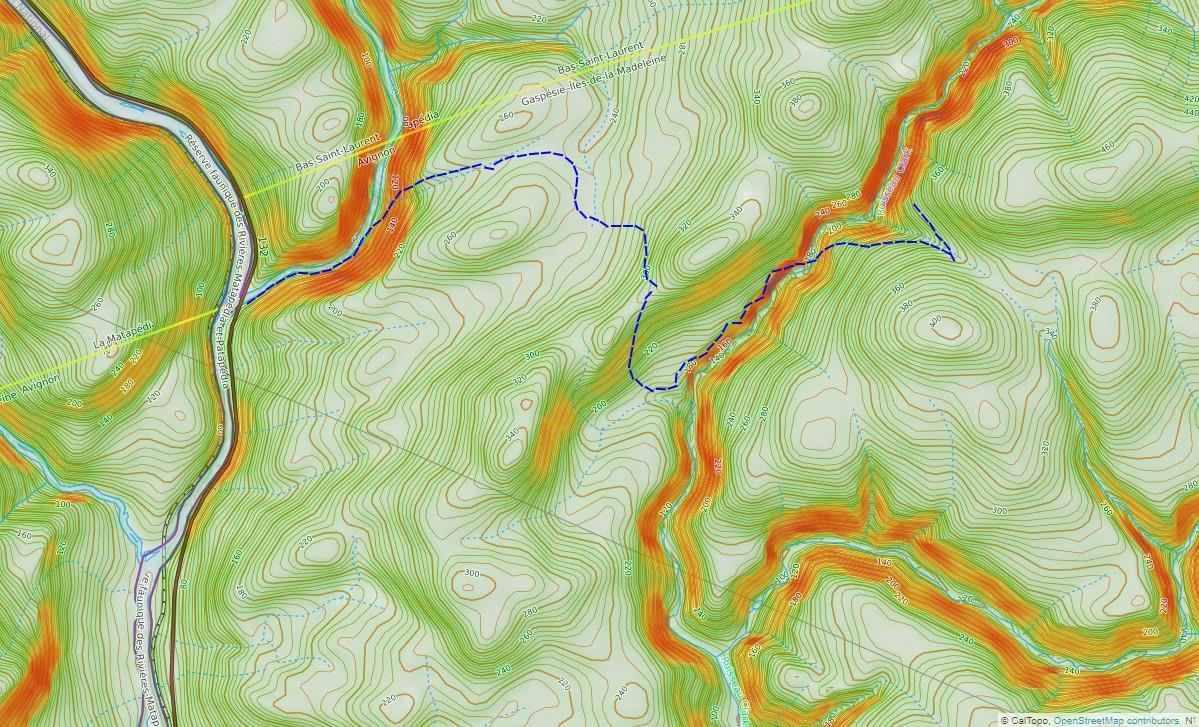
SIA – Secteur Avignon SECTION 3 : Refuge Turcotte → Refuge Corbeau SIA-QC-Topo+ Avignon-RefCorbeau-2 /2
(Corbeau)
2 4 6 1/1 3 2
Matapédia (17 km)








SIA – Secteur Avignon SECTION 4 : Refuge Corbeau → Refuge Quartz SIA-QC-Topo+ (Corbeau)
/3 2 4
Ruisseau Clark
Avignon-RefQuartz-1
1/3
Canyon Clark
616 617 618 619 620 621 4 2 1 2 618
Ruisseau Clark







SIA – Secteur Avignon SECTION 4 : Refuge Corbeau → Refuge Quartz SIA-QC-Topo+ Rivière Assemetquagan Avignon-RefQuartz-2 /3 10 12 8 6 2/3 (Ruisseau St-Etienne) 608 609 610 611 612 613 614 615 2 2 4 2
610 613 607
Celui qui déplace une montagne commence par déplacer de petites pierres. (Confucius)
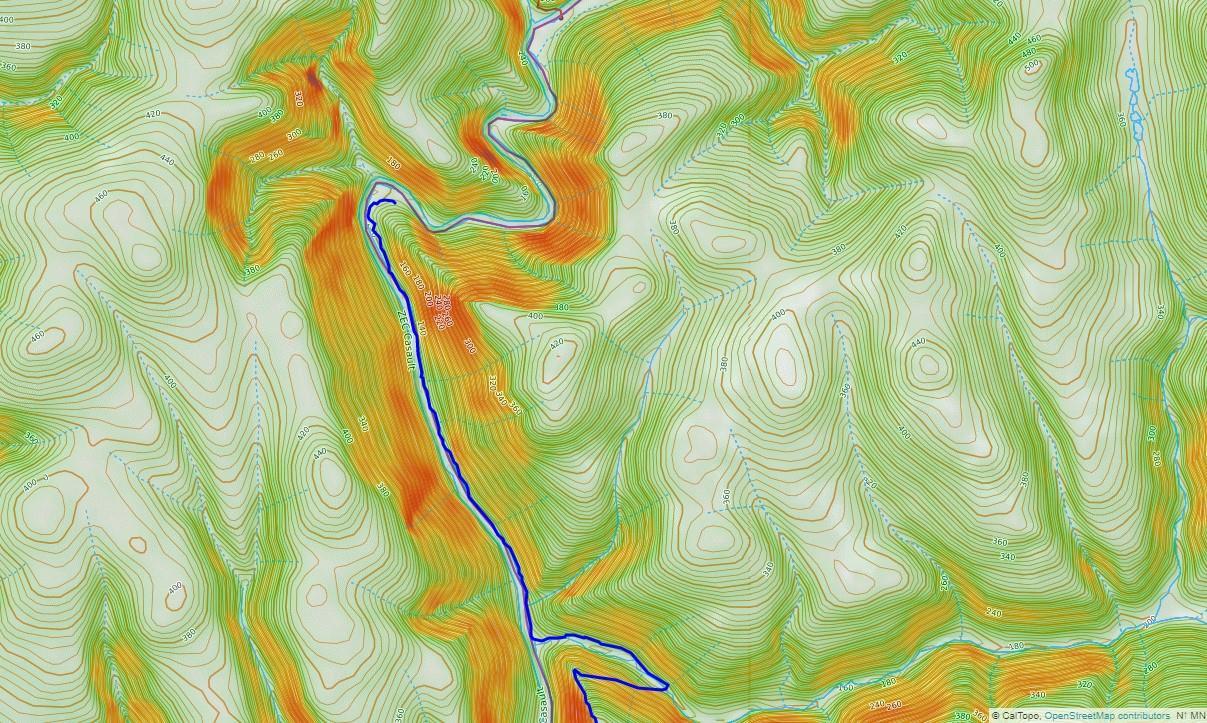







SIA – Secteur Avignon SECTION 4 : Refuge Corbeau → Refuge Quartz SIA-QC-Topo+ (Quartz) 16 14 ZEC Casault Avignon-RefQuartz-3 /3 3/3 (Ruisseau St-Etienne) 604 606 609 608 607 605 4 2 3 2



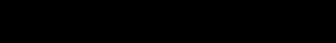





SIA – Secteur Avignon SECTION 5 : Refuge Quartz → : Refuge Ruisseau Creux SIA-QC-Topo+ (Quartz) Avignon-RefCreux-1 /2 2 4 6 ZEC Casault 1/2 Rivière Assemetquagan 605 604 602 601 600 598 599 5 2 1 2 33% 26% 36% 603 600 598
Apportez chaque jour une corbeille de terre, et vous ferez enfin une montagne. (Confucius)





Avignon-RefCreux-2 /2


SIA –
Secteur Avignon SECTION 5 : Refuge Quartz → : Refuge Ruisseau Creux SIA-QC-Topo+
(Ruisseau Creux)
8 10 2/2
594 595
5 2 2 2 28%
593
596 597
596 595
Le bonheur ne se trouve pas au sommet de la montagne, mais dans la façon de la gravir. (Confucius)






SIA – Secteur Matapédia SECTION 6 : Refuge Ruisseau Creux → Causapscal SIA-QC-Topo+
(Ruisseau Creux)
Matapédia-Causapscal-1 /4 1/4
592
591
590
6 2 1 2
589 588
Ste-Marguerite-Marie















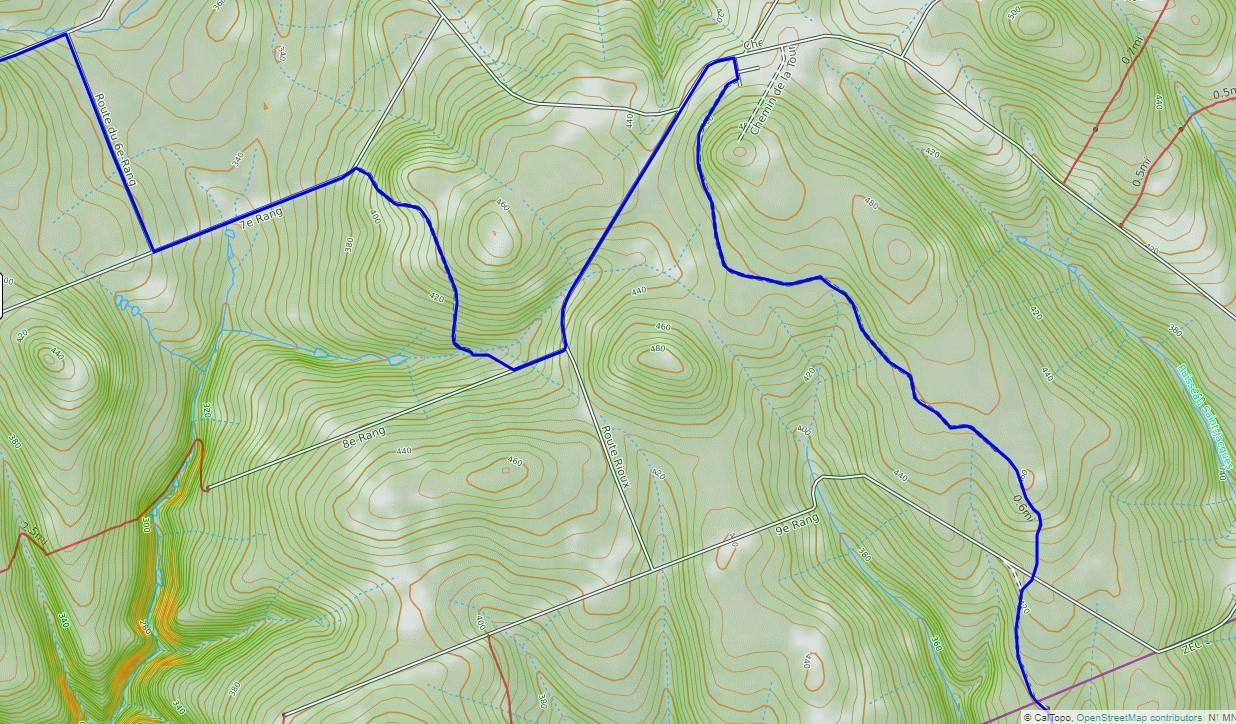
SIA – Secteur Matapédia SECTION 6 : Refuge Ruisseau Creux → Causapscal SIA-QC-Topo+
Matapédia-Causapscal-2 /4 15 10 5 (Ste-Marguerite) 2/4 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577 576 575 574 573 6 2 2 2 577
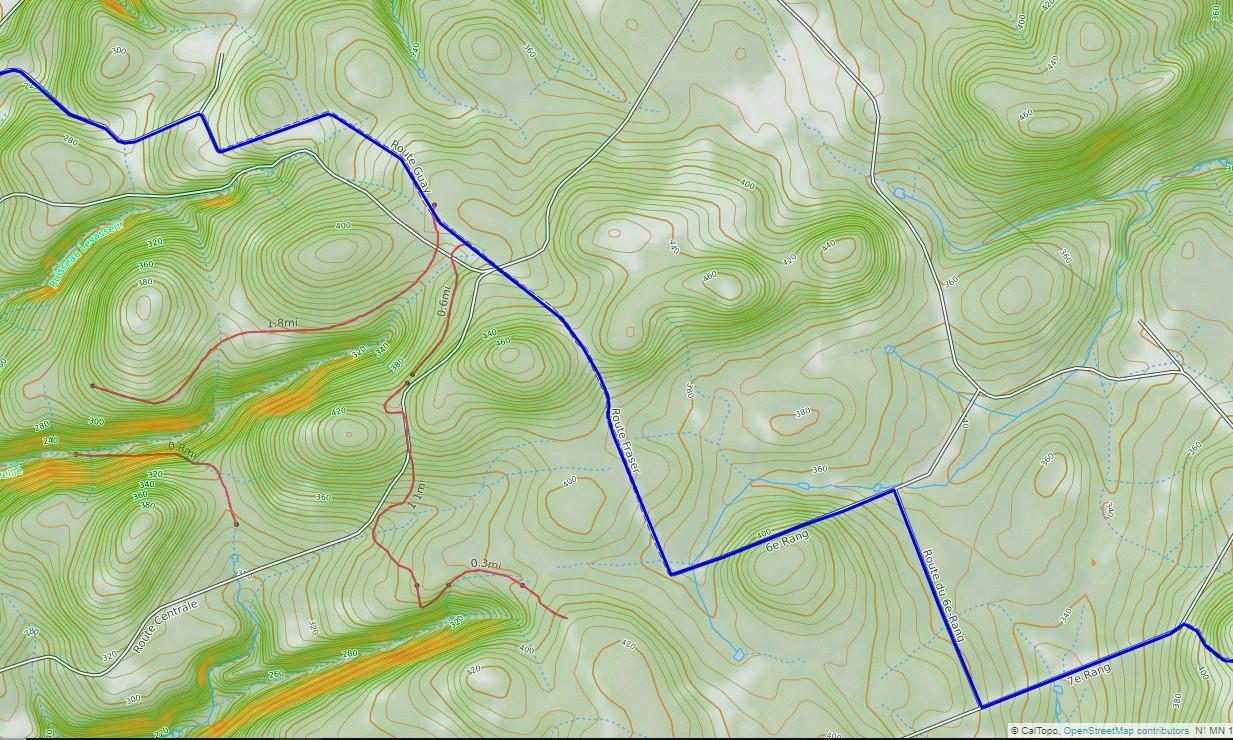


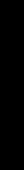




SIA – Secteur Matapédia SECTION 6 : Refuge Ruisseau Creux → Causapscal SIA-QC-Topo+ 25 20 Matapédia-Causapscal-3 /4 3/4 576 575 573 574 571 570 569 572 566 568 567 6 2 3 2 565



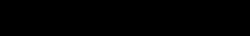

















SIA – Secteur Matapédia SECTION 6 : Refuge Ruisseau Creux → Causapscal SIA-QC-Topo+ 25 Matapédia-Causapscal-4 /4 Causapscal 4/4 (Auberge La
Site patrimonial de pêche Matamajaw S 569
564 566 565 560
563 561 562 (Causapscal)
6 2 4 2
Coulée douce)
568
567
(Camping Chez Moose)
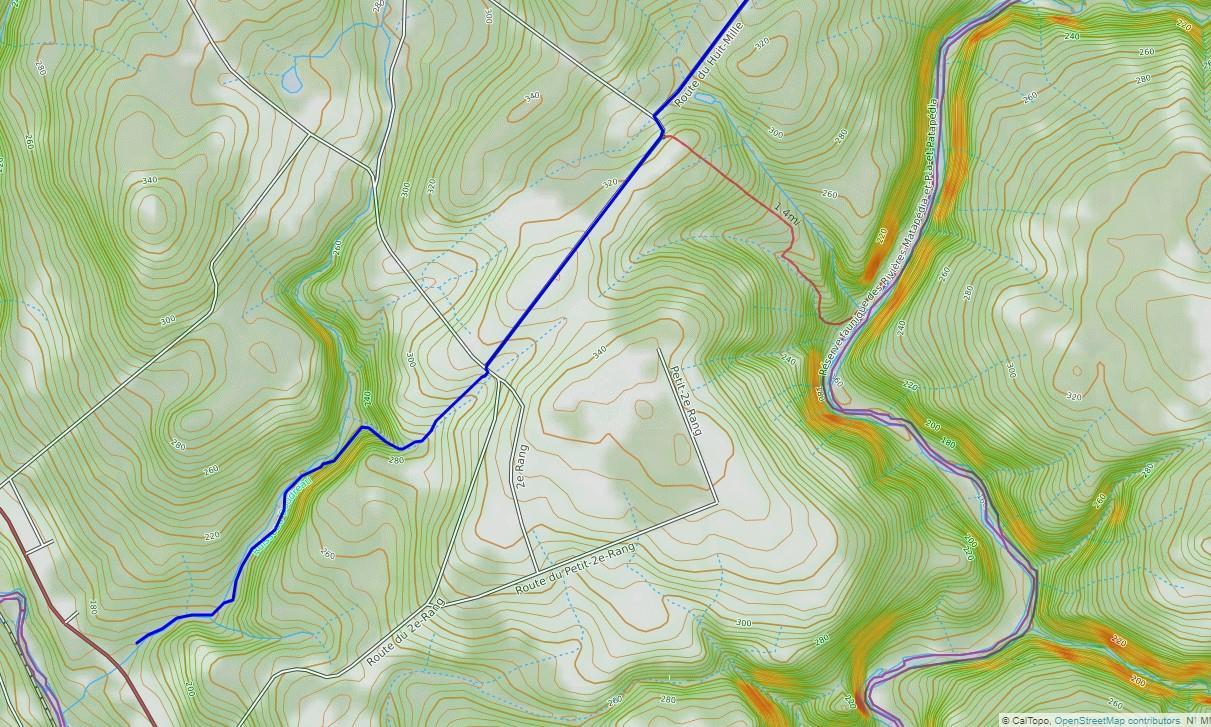





SIA – Secteur Matapédia SECTION 7 : Causapscal
Abri
Chutes SIA-QC-Topo+ Matapédia-AbriChutes-1 /3 4 2 Route du Lac des Huit Milles Rivière Causapscal 1/3 (Camping Chez Moose) 560 559 558 557 556 555 554 7 2 1 2
→
des




SIA – Secteur Matapédia SECTION 7 : Causapscal → Abri des Chutes SIA-QC-Topo+ 8 6 12 16 10 SIA-section07-Matapédia-AbriChutes-2 /3 Route du Lac des Huit Milles 2/3 554 553 552 551 550 549 548 547 7 2 2 2 552 547



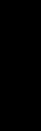




SIA – Secteur Matapédia SECTION 7 : Causapscal → Abri des Chutes SIA-QC-Topo+ (Chutes) 16 14 Matapédia-AbriChutes-3 /3 3/3 549 544 545 546 547 548 7 2 3 2 547 546
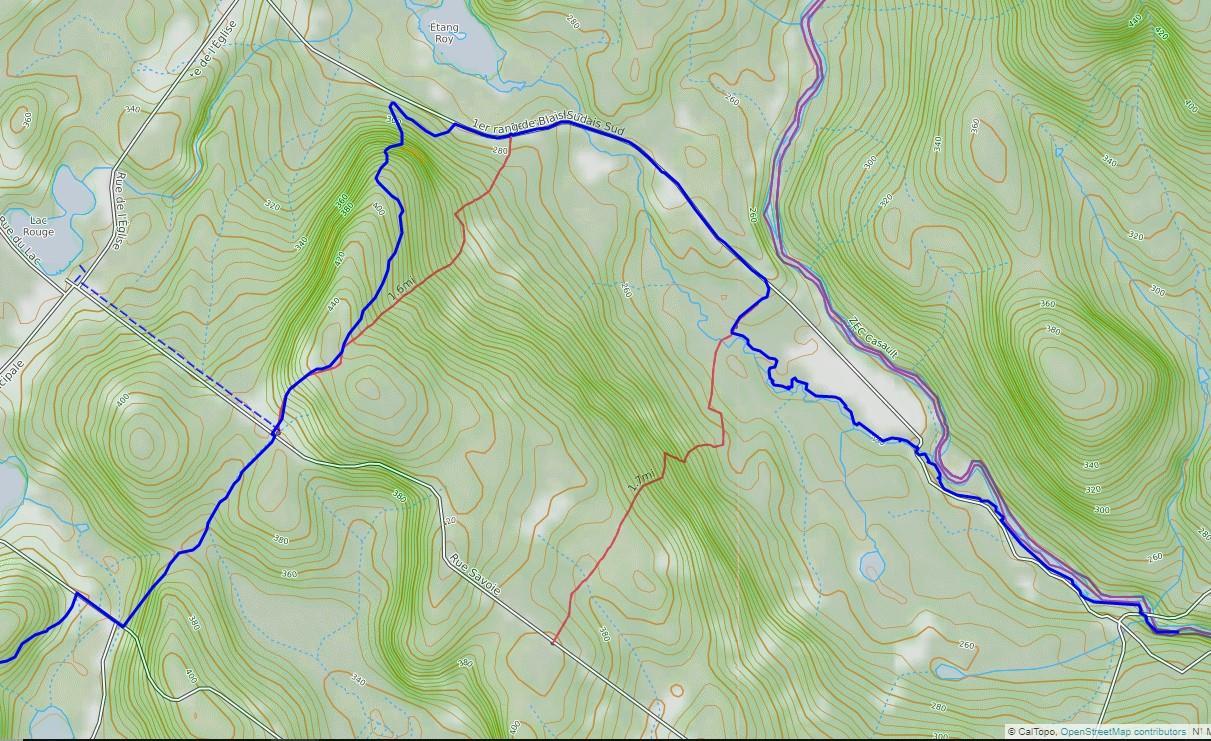












SIA – Secteur Matapédia SECTION 8 : Abri Chutes → Abri Erablière SIA-QC-Topo+
Matapédia-AbriErabliere-1 /3 5 10 1/2 1 A 543 542 541 540 539 538 537 536 535 534 533 8 2 1 2 8 2 536 533 532
(St-Alexandre) (Chutes)









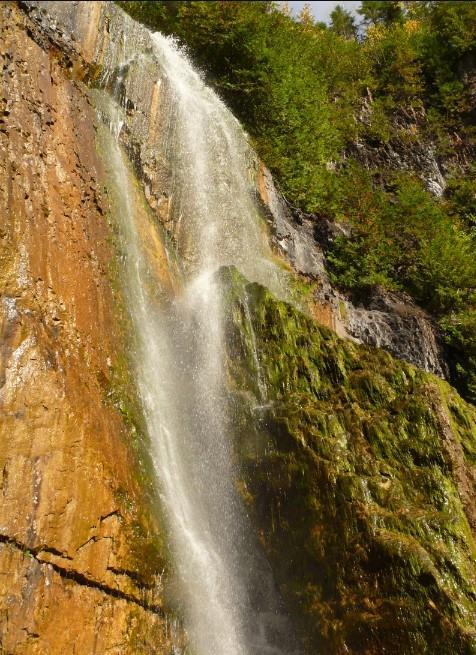




SIA – Secteur Matapédia SECTION 8 : Abri Chutes → Abri Erablière SIA-QC-Topo+ (Erablière) Chute à Philomène 20 15 Matapédia-AbriErabliere-2 /3 St-Alexandre-des-Lacs (St-Alexandre) 2/2 Vers (Lac au Saumon) 10 Vers (Lac au Saumon) 2 B 3 A 1 536 535 534 533 523 524 531 532 525 521 522 528-529 530 527 526 8 2 2 2 533 530 525 522







 SIA – Secteur Matapédia SECTION 8 : Sortie Abri Lac au Saumon (Hors-circuit)
SIA – Secteur Matapédia SECTION 8 : Sortie Abri Lac au Saumon (Hors-circuit)
SIA-QC-Topo+
St-Alexandre-des-Lacs (Erablière)
(Lac au Saumon)
1/1 B 8 2 3 2
SIA-section08-Matapédia-AbriErabliere-3 /3

















SIA – Secteur Matapédia SECTION 9 : Abri Erablière → Amqui SIA-QC-Topo+ (Erablière) Matapédia-Amqui-1 /2 6 4 2 14 12 10 Amqui Route 132 1/2
Beauséjour (1932) S 520 519 518 517 516 515 514 513 512 511 510 509 508 507 506 9 2 1 2 518 515 512
Pont











SIA – Secteur Matapédia SECTION 9 : Abri Erablière → Amqui SIA-QC-Topo+
16 SIA-section09-Matapédia-Amqui-2 /2 2/2
(Abri-Camping municipal)
507 506 9 2 2 2
Pont des Anses St-Jean (1931)








SIA – Secteur Matapédia SECTION 10 : Amqui → Saint-Vianney SIA-QC-Topo+ Matapédia-StVianney-1 /4 5 1/4 (Abri-Camping municipal) 505 504 502 503 501 500 Prenez un peu de repos, afin de finir plus vite. (George Herbert) 10 2 1 2








SIA – Secteur Matapédia SECTION 10 : Amqui → Saint-Vianney SIA-QC-Topo+ (Les Trois Sœurs) 15 10 Matapédia-StVianney-2 /4 PARC RÉGIONAL DE LA SEIGNEURIE DU LAC MATAPÉDIA 2/4 500 499 493 494 495 498 497 496 492 491 490 10 2 2 491





SIA – Secteur Matapédia SECTION 10 : Amqui → Saint-Vianney SIA-QC-Topo+ 20
/4 25 16 3/4 489 487 488 486 485 484 483 3 10 2
SIA-section10-Matapédia-StVianney-3














SIA – Secteur Matapédia SECTION 10 : Amqui → Saint-Vianney SIA-QC-Topo+ Saint Vianney Matapédia-StVianney-4 /4 25 (Saint Vianney) Avenue Centrale
Vianney) 4/4 484 477-480 483 482 481 4 10 2
(Saint









–
SIA-QC-Topo+ Vianney)
2 4 6 8 Rivière Tamagodi 10 Rang de la Tour Rang de la Tour 1/2 (Camps Tamagodi) 476 477-480 475 474 473 472 471 470 469 468 467 11 2 1 473 466
SIA
Secteur Matapédia SECTION 11 : Saint-Vianney → Abri Rivière Matane
SIA-section11-Matapédia-AbriRivMatane-1 /2











SIA – Secteur Matapédia SECTION 11 : Saint-Vianney → Abri Rivière Matane SIA-QC-Topo+ (Rivière Matane) (Accueil John) Matapédia-AbriRivMatane-2 /2 10 12 14 16 Rivière Matane Réserve faunique de Matane 2/2 Matane 468 467 466 465 464 463 462 461 460 11 2 2 Stationnement des Pins

















SIA – Secteur Matane SECTION 12 : Abri Riv. Matane → Ruisseau des Pitounes SIA-QC-Topo+ (Rivière Matane) Matane-RuisseauPitounes (Ruisseau des Pitounes) 2 4 6 8 10 Mont Charles-E.-Vézina (390) Mont aux Perches (600) 250 m Réserve faunique de Matane 1/1 * * © Denis Bouvier 2021 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 449 A quoi bon soulever des montagnes
il est si simple de passer par-dessus ? (Boris Vian) 12 Stationnement des Pins 454
quand












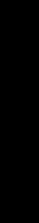









SIA – Secteur Matane SECTION 13 : Ruisseau des Pitounes → Lac Tombereau SIA-QC-Topo+ (Ruisseau des Pitounes)
2 4 6 8 10 12
Mont
1/1 * * * Lac Tombereau ©
447 446 445 444 443 442 441 440 439 438 437 436 435 13 440 444
(Lac Tombereau) Matane-LacTombereau
Mont William-Price (694)
Petchedetz (640)
Denis Bouvier 2021
Si tu arrives au sommet de la montagne, continue de









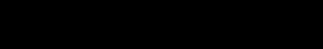



SIA – Secteur Matane SECTION 14 : Lac Tombereau → Lac Matane SIA-QC-Topo+ (Lac Tombereau) Matane-LacMatane-1 /2 2 4 6 8 Mont de l’Ouest (922) 1,5 km +144 m 225 m Mont Blanc 1/2 * 435 434 433 432 431 430 429 428 427 426
tibétain) 14 1 431 427 425 10
grimper (Proverbe

















SIA – Secteur Matane SECTION 14 : Lac Tombereau → Lac Matane SIA-QC-Topo+
Mont du Nid d’Aigle Matane-LacMatane-2 /2 10 12 14 Montagne à Valcourt (824) 1,6 km +204 m 8
à Valcourt) Route 4 Lac Matane 2/2 * * * Lac Matane 427 426 425 424 422 421
(Lac Matane)
(Montagne
la montagne;
n'en prend point fait fausse route même en plaine (Proverbe turc) 14 2 427 424
Qui prend conseil franchit
qui















SIA –
SIA-QC-Topo+
2
6
Secteur Matane SECTION 15 : Lac Matane → Lac Gros Ruisseau
Matane-LacGrosRuisseau 4
Pic du ruisseau Desjarlais 914 m, +85 m
8
(Lac du Gros Ruisseau)
(Lac Matane)
Lac Matane
1/1
Mont Elie Lister
421 420 419 418 416 414 15 418 415
©Denis Bouvier 2021






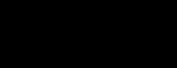
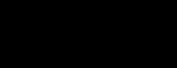
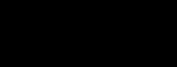


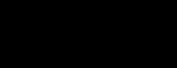


SIA – Secteur Matane
16
SECTION
: Lac Gros Ruisseau → Mont Craggy
SIA-QC-Topo+
(Lac du Gros Ruisseau)
4 2 6 8
Mont
1/1 * * Carte Sortie : Lac Gros
413 412 411 410 409 408 407 406 405 414 Chaque
le sommet rapproche de la
(Proverbe indien) 16 29% 411 410 406
SIA-section16-Matane-MontCraggy
(Mont Craggy)
Pic Bleu Mont Fernand Fafard (840) Mont Craggy
Pointu
Ruisseau
pas vers
pente opposée














SIA – Secteur Matane SECTION 17 :
→
SIA-QC-Topo+ Matane-LacBeaulieu
Mont Craggy
Lac Beaulieu
(Lac Beaulieu)
2 3
4 7,9
5 6 7
Chaîne
1/1 *
Carte
(Mont Craggy) 10 km → Route 1 404 403
Mont des Fougères 402
Mont Blanc (1063) 401
km → Route 1 400
Mont 399
des Disparus (956) Mont Blanc 398 397
Monts Chic-Chocs Qui veut gravir une montagne commence par le bas. (Proverbe chinois) 17
©Denis Bouvier 2021 402 399
Carte
Sortie : Mont Blanc
Sortie : Lac Beaulieu
Le Bonhomme du Mont Nicol-Albert. La dégradation du sol et l’inclinaison de la pente rend l’accès très périlleux et risqué. Une corde est en place, mais ce n’est pas suffisant comme moyen pour sécuriser l’accès.




















SIA – Secteur Matane SECTION 18 :
SIA-QC-Topo+
Lac Beaulieu → Petit Sault
Mont Séverin-Pelletier (890)
Matane-PetitSault
2
(Petit Sault)
(Lac Beaulieu)
Mont Bayfield (884)
Mont Ala’sui’nui
4 6 8 10 12 Lac d'Or 14
Mont Nicol-Albert (890)
Le Bonhomme du Nicol-Albert Lac T (sic) 1/1 S Carte Sortie 396 395 394 393 392 391 390 389 388 387 383 382 ATTENTION
Cap-Chat (38 km)
Proverbe
18 388 390 392 394
À force de persévérance, n'importe qui peut parvenir à déplacer une montagne (
chinois)
Mont Beaulieu (810)
Mont Jimmy-Russell (930)
SIA-QC-Topo+
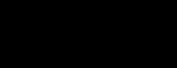
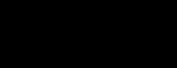
SIA – Secteur Matane SECTIONS 16-17-18 : Sorties d’urgence







1
Lac du Gros Ruisseau Route
Section16-Sortie Lac Gros Ruisseau Section17-Sortie Mont=Blanc
1
1
7,9 km → Route 1 10 km → Route 1 Étang
Section18-Sortie Lac Beaulieu Route
Route
Mont Blanc Lac Beaulieu
Tallard













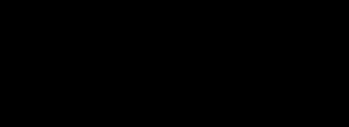




SIA –
SIA-QC-Topo+
Secteur Matane SECTION 19 : Petit Sault → Ruisseau Bascon
(Petit Sault)
(Ruisseau Bascon)
Matane-RuisseauBascon
Chute Hélène
Mont Jean-Yves-Bérubé (780)
Ruisseau Bascon
2 8 6 4
(Auberge de Montagne des Chic-Chocs)
Mont Coleman
Chute Hélène
1/1 378 381 380 379 377 376 375 374 19
Ruisseau Bascon
Parc national de la Gaspésie
La volonté permet de grimper sur les cimes ; sans volonté on reste au pied de la montagne (Proverbe chinois)




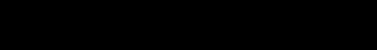

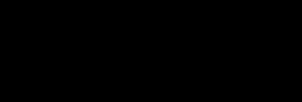

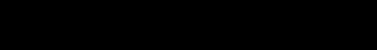
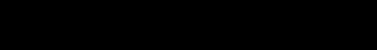
SIA – Secteur Gaspésie SECTION 20 : Ruisseau Bascon → Refuges Nyctale et Chouette SIA-QC-Topo+












(Ruisseau
(Nyctale
2 8 6 4 10
Bascon)
et Chouette SIA-section20-Gaspésie-NyctaleChouette-1 /2
Mont du lac Barbarin
Mont Collins (1036)
Mont Fortin (1020)
Mont Logan (1150)
Mont Dodge (1078)
(230m)
Lac à Jos Gagnon
Réserve faunique de Matane 1/1 Habitat floristique du Mont-Matawees Habitat floristique du Mont-Fortin Réserve écologique Fernald Habitat floristique du Mont-Logan 365 367 366 368 369 370 371 372 373
Mont Matawees (1073)
20
SIA – Secteur Gaspésie SECTION 20 : Ruisseau Bascon → Refuges Nyctale et Chouette




Gaspésie-NyctaleChouette-2
SIA-QC-Topo+

 Sentier alternatif Mont Collins
/2
(Ruisseau Bascon)
Mont Collins (1036)
Sentier du Lac Bardey
Mont Matawees (1073)
SIA
Sentier Mont Collins
Sentier Mont Collins
Sentier Lac Bardey (De jct)
Sentier alternatif Mont Collins
/2
(Ruisseau Bascon)
Mont Collins (1036)
Sentier du Lac Bardey
Mont Matawees (1073)
SIA
Sentier Mont Collins
Sentier Mont Collins
Sentier Lac Bardey (De jct)
1 2 3 4 5 1/1 1/1
Mont Fortin (1020)
SIA – Secteur Gaspésie SECTION 21 : Refuges Nyctale/Chouette → Refuge Huard






Habitat floristique

SIA section21 Gaspésie-Huard-1 /2
SIA-QC-Topo+
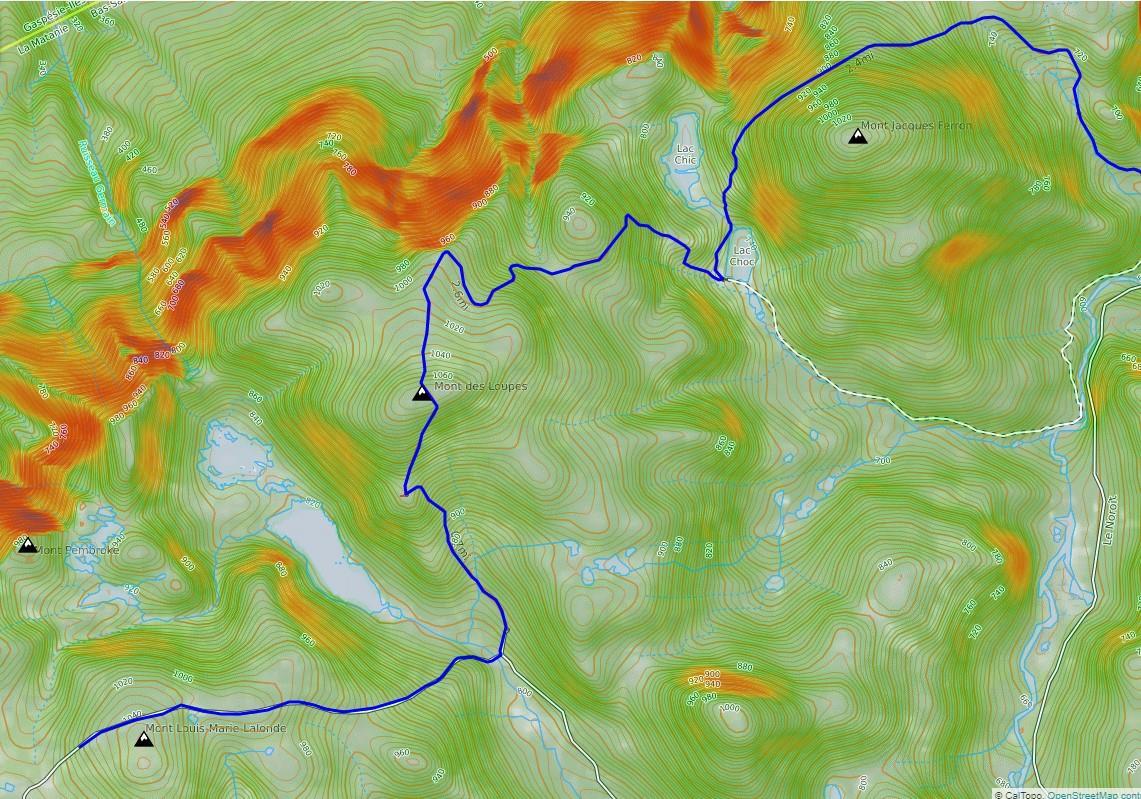 Nyctale et Chouette)
Premier lac des îles
Nyctale et Chouette)
Premier lac des îles
2 6 10
(Le Carouge)
Mont Pembroke
Mont des Loupes (1076)
Mont Louis-Marie Lalonde (1051)
8
Mont Jacques-Ferron (1043)
4 21 1 12
1/2
(Arnica)
Ruisseau aux Saumons

La poussière accumulée finit par former des montagnes. (Proverbe japonais)









SIA – Secteur Gaspésie SECTION 21 : Refuges Nyctale/Chouette
Refuge
SIA-QC-Topo+ Gaspésie-Huard-2 /2
→
Huard
(Le Kalmia)
12 14
16 St-Octave-de-l’Avenir (10km)
(Le Huard)
Lac
Thibault
2/2
21 2












SIA – Secteur Gaspésie SECTION 22: Refuge Huard → Refuge Mésange SIA-QC-Topo+
(Le Huard)
(Le Mésange)
Gaspésie-Mésange
2 4
(Le Saule)
6
8
10 Mont du Blizzard (976) Mont Arthur-Allen (980)
Pic de l’Aube (920) 22
1/1
SIA-QC-Topo+








SIA – Secteur Gaspésie SECTION 23 : Refuge Mésange → Lac Cascapédia
(Le Saule)
Gaspésie-Cascapédia-1 /2
(La Mésange)
Lac du Pic
Lac aux Bouleaux
2 4 6 8 10
Lac Loubert
Pic de l’Aube (920)
Mont Ernest-Ménard (850)
1/2 23 1
Pic du Brulé (790)










SIA
– Secteur Gaspésie SECTION 23 : Refuge Mésange → Lac Cascapédia
SIA-QC-Topo+
(Lac Cascapédia)
12
(Le Pluvier)
10 8
6
Mont Ernest-Ménard (850)
Pic du Brulé(790)
2/2
SIA-section23-Gaspésie-Cascapédia-2 /2
23 2
Puisque la montagne ne vient pas à nous, allons à la montagne (Mahomet)
Gaspésie-Paruline












SIA – Secteur Gaspésie SECTION 24 : Lac Cascapédia → Refuge Paruline SIA-QC-Topo+
(Le Pluvier)
(La Paruline)
(Lac Cascapédia)
2 4 6 8
Lac Alain-Potvin
Mont Ells (1000)
1/1
Mont du Milieu (950)
24
Rivière Cascapédia
Ce n'est pas sur une montagne qu'on trébuche, mais sur une pierre (Proverbe indien)











SIA – Secteur Gaspésie
25 :
SIA-QC-Topo+
SECTION
Refuge Paruline → Mont-Albert
(La Paruline)
Lac Lesurier (La Fougère)
Lac Ahier
Lac Whalen
Lac Bionneau
2 4 6 8 1/2
Gaspésie-MontAlbert-1 /2
Minuartie de la serpentine
25 1
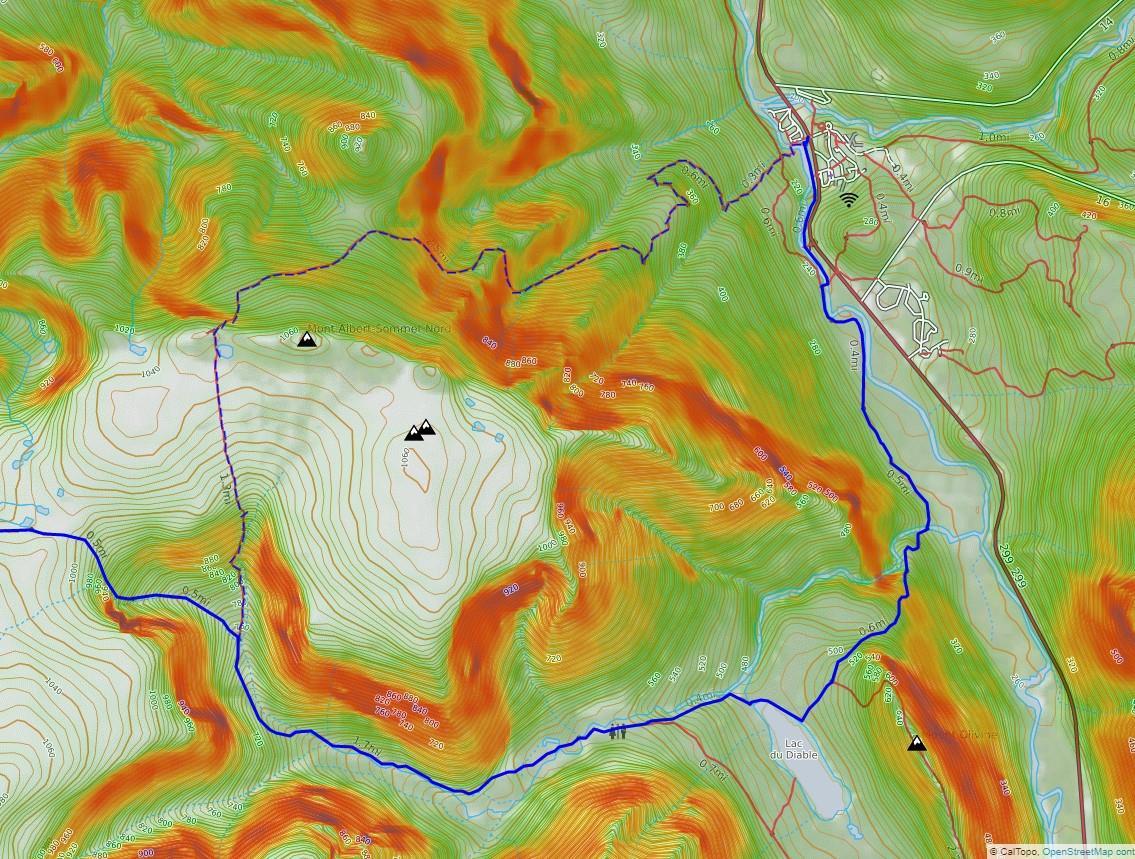
















SIA – Secteur Gaspésie SECTION 25 : Refuge Paruline → Mont-Albert SIA-QC-Topo+
8 km-324m+ 9,4 km Gaspésie-MontAlbert-2 /2 10 12 16
Parcours
Centre de services Mont Albert/ (Gîte du Mont-Albert) Le Rabougris La Serpentine
18
alternatif
Mont Albert nord (1088) 14 Mont Olivine (670)
(Camping La Rivière)
(Camping/refuges Mt Albert)
Table à Moise
Chaîne Monts Chic-Chocs Lac du Diable
Chute du Diable
Chute Ste-Anne
Ste-Anne-des-Monts
(40 km)
Habitat floristique Serpentine MontAlbert
Epaule
Grande
Rivière Ste-Anne Route 299 Sud
Lac Quiscale Grande Cuve Mur des Patrouilleurs 2/2
des Caribous Grand Mur S 25 2
Cuve
De loin, la montagne paraît lisse ; de près, elle est rugueuse.









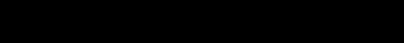







SIA – Secteur Gaspésie SECTION 26 : Mont-Albert → Refuge Tétras SIA-QC-Topo+
Centre de services Mont Albert/ (Gîte du Mont Albert)
2 6 4
Gaspésie-Tétras-1 /2
1/2
(Camping de la Rivière)
26 1 8
(Proverbe indien)










SIA-QC-Topo+
SIA – Secteur Gaspésie SECTION 26 : Mont-Albert → Refuge Tétras
(Le Roselin)
(Le Tétras)
(La Camarine)
10 12 14
Gaspésie-Tétras-2 /2
8
Lac Samuel-Côté
Mont Joseph-Fortin (1080)
Mont Xalibu (1140)
Mont Comte (1229)
Lac aux Américains
Mont de la Table
Mont de la Table Nord
2/2
Mont de la Table Sud
26 2
Lac aux Américains










SIA – Secteur Gaspésie SECTION 27 : Refuge Tétras → Camping Mont Jacques-Cartier SIA-QC-Topo+
(Le Tétras)
Gaspésie-MontJacquesCartier-1 /2
2 4 6 8
(La Camarine)
Mont de la Table
Mont Comte (1229)
Mont Jacques-Cartier (1270)
Mont Dos de la Baleine (1249)
Mont de la Table Sud
Mont de la Table Nord
1/2
Mont Jacques-Cartier
Éole
Plus la montagne est haute, plus basse est la vallée.
27 1
(Proverbe thaïlandais)
SIA-QC-Topo+















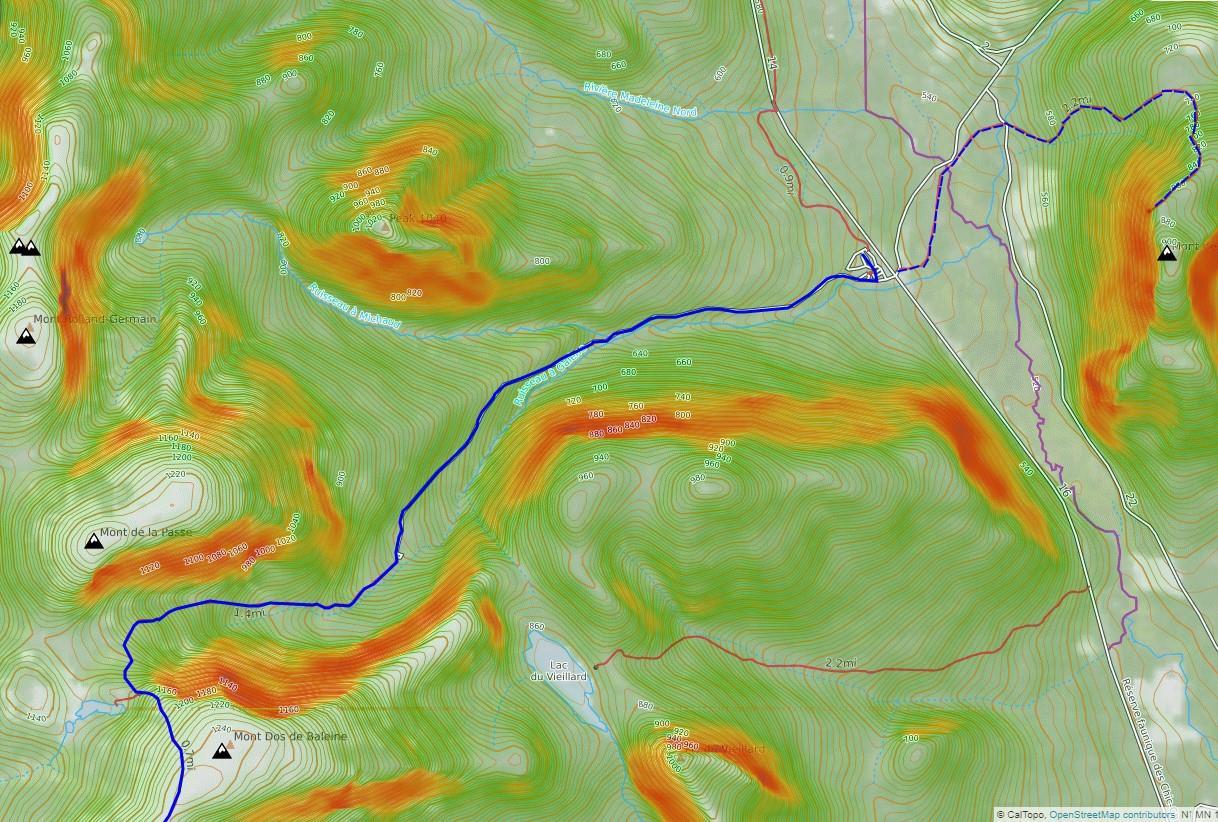 SIA – Secteur Gaspésie SECTION 27 : Refuge Tétras → Camping Mont Jacques-Cartier
(Mont Jacques-Cartier)
SIA – Secteur Gaspésie SECTION 27 : Refuge Tétras → Camping Mont Jacques-Cartier
(Mont Jacques-Cartier)
10 12
Gaspésie-MontJacquesCartier-2 /2
Mont des Pics (910)
Mont de la Passe (1231)
Mont Rolland-Germain (1202)
8
Chaîne Monts McGerrigle
2/2
Lac à René
27 2
La patience aplanit les montagnes (Proverbe libanais)
SIA – Secteur Haute-Gaspésie SECTION 28 : Camping Mont Jacques-Cartier → Refuge Cabourons








HauteGaspésie-RefCabourons-1 /3

SIA-QC-Topo+
(Mont Jacques-Cartier)
2 4 1/3 28 1 255
SIA – Secteur Haute-Gaspésie SECTION 28 : Camping Mont Jacques-Cartier → Refuge Cabourons






SIA-QC-Topo+ HauteGaspésie-RefCabourons-2 /3 6 10 Réserve faunique des Chic-Chocs 2/3 249 250 251 252 253 254 255 28 2 12








SIA-QC-Topo+ (Cabourons) 14 12 HauteGaspésie-RefCabourons-3 /3 3/3 247 249 248 28 3
SIA – Secteur Haute-Gaspésie SECTION 28 : Camping Mont Jacques-Cartier → Refuge Cabourons


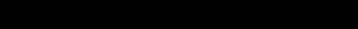






SIA-QC-Topo+ (Cabourons) HauteGaspésie-MtStPierre-1 /2 2 4 6 8 1/2 245 243 244 242 241 240 239 238 29 1
SIA – Secteur Haute-Gaspésie SECTION 29 : Refuge Cabourons → Mont St-Pierre








–
SIA-QC-Topo+ (Camping municipal Mont St-Pierre) HauteGaspésie-MtStPierre-2 /2 10 12 14 16 18 Réserve écologique du Mont Saint-Pierre Vallée Mont-St-Pierre 2/2 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 2 29
SIA
Secteur Haute-Gaspésie SECTION 29 : Refuge Cabourons → Mont St-Pierre















SIA-QC-Topo+
SIA – Secteur Haute-Gaspésie SECTION 30 : Mont St-Pierre → Abri Ruisseau Flétan
Camping municipal Mont St-Pierre)
HauteGaspésie-RuisseauFlétan-1 /3 5 10
(Camping Parc et Mer)
St-Pierre
Anse de Mont-Louis
Mont
Mont Saint-Pierre
Fleuve Saint-Laurent 1/3 S S 226 224 225 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 30 1 ATTENTION
Saint Maximedu- Mont-Louis
Mont Thomas-Mercier
Présence de la Berce du Caucase. Sa sève contient des toxines. Ces dernières sont activées par la lumière et rendent la peau extrêmement sensible au soleil, causant des dommages aux cellules cutanées superficielles (lésions apparentées à des brûlures, douloureuses et parfois graves).
SIA – Secteur Haute-Gaspésie SECTION 30 : Mont St-Pierre → Abri Ruisseau Flétan










SIA-QC-Topo+ HauteGaspésie-RuisseauFlétan-2 /3 L’Anse Pleureuse (Camping Parc et Mer) (Camping de l’ Anse Pleureuse) 20 15 Mont Louis 2/3 Parc éolien Mont-Louis (67 éoliennes) 212 211 210 209 208 207 206 204 205 203 202 Celui qui
inventé le bateau
aussi inventé le naufrage. (Lao-Tseu VIe siècle av J.C.) 30 2
a
a
SIA – Secteur Haute-Gaspésie SECTION 30 : Mont St-Pierre → Abri Ruisseau Flétan







SIA-QC-Topo+ (Ruisseau Flétan) HauteGaspésie-RuisseauFlétan-3 /3 25 30 Pointe Pleureuse Le Morne 3/3 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 30 3
Reconnaissable par sa tête chevaline quand il se trouve à la surface de l’eau, le phoque gris est l’un des plus gros phoques qui fréquentent les eaux du Saint-Laurent. Énormément chassé par le passé pour sa fourrure, sa population est aujourd’hui en augmentation constante. Le phoque gris a un impact important sur l’écosystème qu’il fréquente, puisqu’il se nourrit principalement des proies les plus abondantes qu’il trouve dans son environnement, comme la morue.


















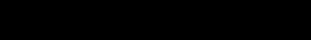


SIA – Secteur Haute-Gaspésie SECTION 31 : Abri Ruisseau Flétan → Madeleine-Centre SIA-QC-Topo+
HauteGaspésie-MadeleineCentre-1 /3 Rue du Moulin 5 Chemin du Portage 1/3 189 190 191 192 193 194 195 196 31 1
(Ruisseau Flétan) Gros-Morne
188
Source : Baleines en direct du GREMM
Manche d’Épée






















SIA – Secteur Haute-Gaspésie SECTION 31 : Abri Ruisseau Flétan → Madeleine-Centre SIA-QC-Topo+ HauteGaspésie-MadeleineCentre-2 /3 (Lac à Cyrille)
20 10 15 Réserve écologique de Manche d’Épée Pointe du Wrack 2/3 Parc éolien Gros-Morne (141 éoliennes) Parc éolien Gros-Morne (141 éoliennes) S 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 31 2 178 175









SIA-QC-Topo+ HauteGaspésie-MadeleineCentre-3 /3 Lac Castor Madeleine-Centre (Camping Mer et Montagne) 25 Anse de la Rivière Madeleine 3/3 Phare du Cap-dela-Madeleine S 170 171 172 173 174 175 176 Anse de la Rivière Madeleine 31 3
SIA – Secteur Haute-Gaspésie SECTION 31 : Abri Ruisseau Flétan → Madeleine-Centre
SIA – Secteur Haute-Gaspésie SECTION 32 : Madeleine-Centre → Grande-Vallée









SIA-QC-Topo+ CôteGaspé-GrandeVallée-1 /3 5 Anse de la Rivière Madeleine Saint-Madeleine-dela-Rivière-Madeleine La Grande Anse 1/3 (Camping Mer et Montagne) Phare du Cap-dela-Madeleine S 170 169 168 167 166 165 164 163 Anse du Cap à l’Ours 32 1 162
SIA – Secteur Haute-Gaspésie SECTION 32 : Madeleine-Centre → Grande-Vallée










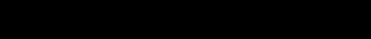
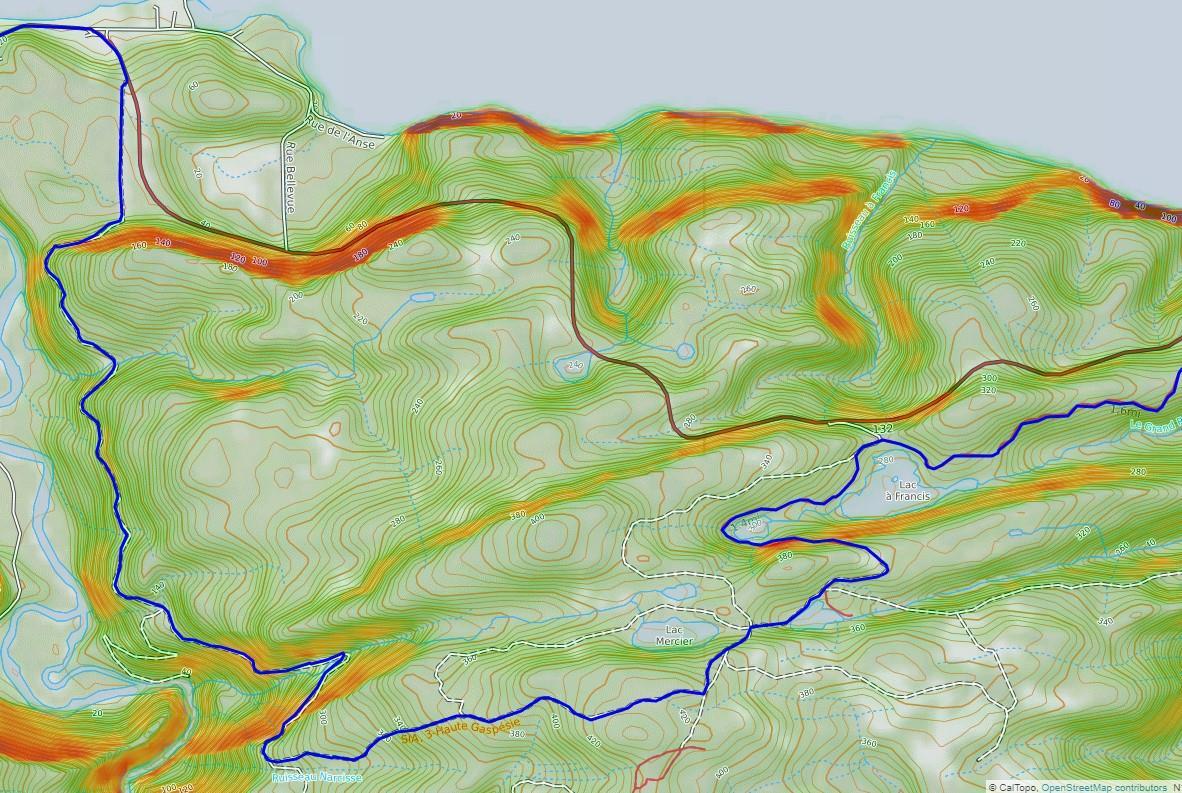
SIA-QC-Topo+ CôteGaspé-GrandeVallée-2 /3 10 (Grand Sault) Petit lac à Foin Petit lac de l’Est 15 La Grande Anse Passe migratoire à saumons du Grand Sault 2/3 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 32 2
















SIA-QC-Topo+ CôteGaspé-GrandeVallée-3 /3 20 25 (Camping au Soleil Couchant) 30 Cap Barré Grande-Vallée Route 132 Table des marées (Grande-Vallée) Anse à Colin
Estuaire du Saint-Laurent 3/3 Halte routière Le Gisant © Caltopo Pont Galipeault S 149 148 147 146 145 144 14 143 142 141 140 139 32 3
SIA – Secteur Haute-Gaspésie SECTION 32 : Madeleine-Centre → Grande-Vallée
Grande-Vallée de Marc-Aurèle Fortin
SIA – Secteur Côte-Gaspé SECTION 33 : Grande-Vallée → Refuge Cascades











SIA-QC-Topo+ (Camping au Soleil Couchant) CôteGaspé-Cascades-1 /3 5 Anse à Déry Petite-Vallée Anse à Mercier Petite-Vallée, 1934 1/3 © Caltopo S 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 Petit rorqual 33 1








SIA-QC-Topo+ (Terrasses) Lac Brûlé CôteGaspé-Cascades-2 /3 Lac Orignal 10 15 2/3 Parc éolien Montagne sèche (39 éoliennes) 130 128 129 127 126 125 124 123 122 121 120 119 Pointe-à-la-Frégate Anse-aux-Canons 2 33 124 121
SIA – Secteur Côte-Gaspé SECTION 33 : Grande-Vallée → Refuge Cascades












SIA-QC-Topo+ (Cascades) 20 25 Cloridorme CôteGaspé-Cascades-3 /3 3/3 Parc éolien Montagne sèche (39 éoliennes) S 121 119 120 118 117 116 115 114 113 112 111 33 3 120 Cloridorme S
SIA – Secteur Côte-Gaspé SECTION 33 : Grande-Vallée → Refuge Cascades








SIA-QC-Topo+ (Cascades) Saint Yvon CôteGaspé-LaChute-1 /3 5 10 1/3 (Motel du Cap) 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 Pointe à Mimi Cap Barré Torpille de St-Yvon 34 1 105 102 98
SIA – Secteur Côte-Gaspé SECTION 34 : Refuge Cascades → Abri La Chute
On








SIA – Secteur Côte-Gaspé SECTION 34 : Refuge Cascades → Abri La Chute SIA-QC-Topo+ CôteGaspé-LaChute-2 /3 Saint Yvon 15 Anse à la Rogne Anse de l’Etang Table des marées (Cloridorme) 2/3 (Motel du Cap) 99 100 101 102 103 104 98 97 96 95 94 93
jamais aussi loin
lorsqu’on ne sait pas où l’on va. (Christophe-Colomb.) 34 2
ne va
que
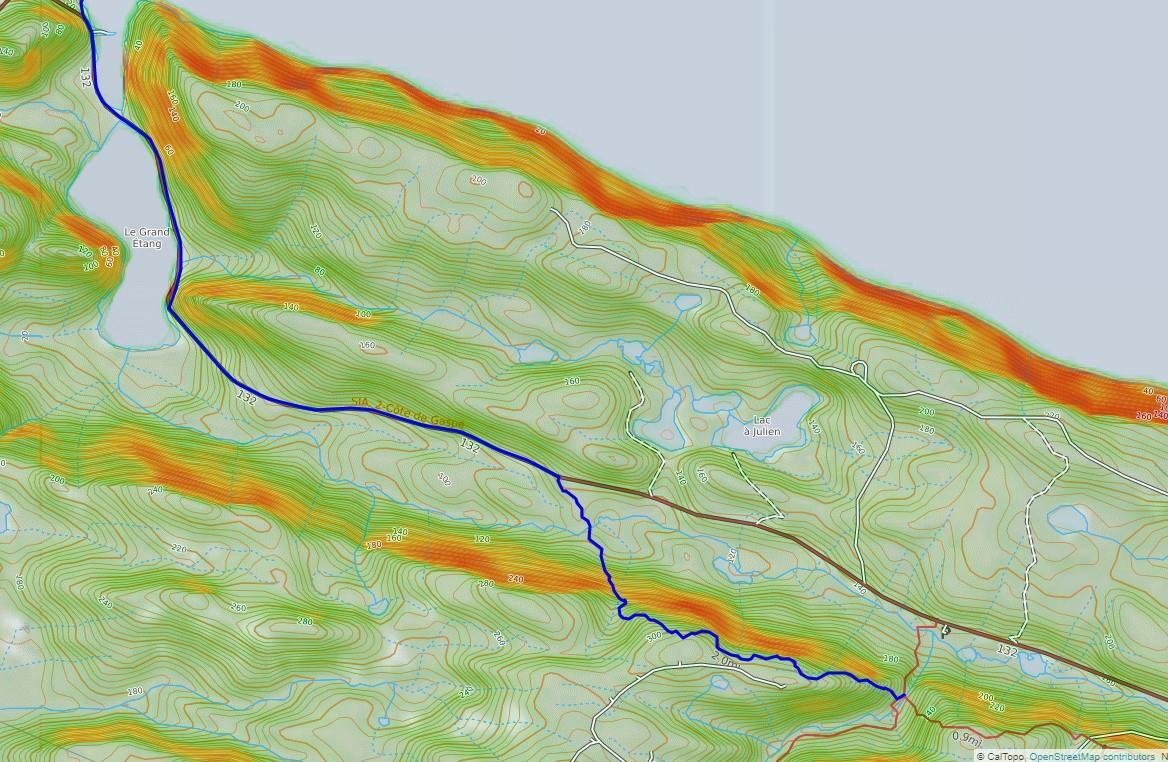







SIA – Secteur Côte-Gaspé SECTION 34 : Refuge Cascades → Abri La Chute SIA-QC-Topo+ CôteGaspé-LaChute-3 /3 (La Chute) Route 132 20 Chutes Jalbert 3/3 Parc éolien L’Anse-à-Valleau (67 éoliennes) 94 93 92 91 90 89 88 87 Seigneurie de l’Anse-de-l’Étang Grand Étang 34 3




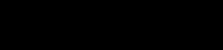
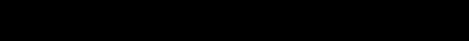
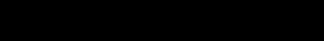








SIA – Secteur Côte-Gaspé SECTION 35 : Abri Chute → Refuge Zéphyr SIA-QC-Topo+ (La Chute) (Zéphyr) 6 8 2 4 SIA-section35-CôteGaspé-Zéphyr Chutes Jalbert 1/1 Parc éolien L’Anse-à-Valleau (67 éoliennes) 87 86 85 84 83 82 81 80 79 35
Sentier des Éoliennes (hors-SIA)
SIA – Secteur Côte Gaspé : Sentier des Éoliennes – Hors SIA
CôteGaspé-Eolienne


SIA-QC-Topo+

 Chutes Jalbert
Lac Victorin
SIA
SIA
Chutes Jalbert
Lac Victorin
SIA
SIA
Parc éolien L’Anse-à-Valleau (67 éoliennes)
















SIA – Secteur Côte-Gaspé SECTION 36 :
Zéphyr →
SIA-QC-Topo+
Refuge
Refuge Erablière
(Zéphyr)
CôteGaspé-Érablière-1 /3
L’Anse-à-Valleau
5 Anse
(Motel Camping des Ancêtres)
à Zéphyr
1/3 77 76 75 74 73 72 36 1
Table des marées (Cloridorme)












SIA – Secteur Côte-Gaspé SECTION 36 : Refuge Zéphyr → Refuge Erablière SIA-QC-Topo+ (Des Carrières) CôteGaspé-Érablière-2 /3 Lac de la Ligne 10 Saint-Maurice-del’Échouerie Rang du Ruisseau Jaune Ch du Lac Brillant 2/3 * S 72 71 70 69 68 67 66 65 Grande Anse 36 2









SIA – Secteur Côte-Gaspé SECTION 36 : Refuge Zéphyr → Refuge Erablière SIA-QC-Topo+ CôteGaspé-Érablière-3 /3 (De l’Érablière) 20 15 3/3 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 36 3







SIA – Secteur Forillon SECTION 37 : Refuge Erablière → Camping Les Lacs SIA-QC-Topo+ Forillon-LesLacs-1 /3 5 La Grande Coulée 1/3 (De l’Érablière) 56 55 54 53 52 51 50 49 48 37 1

















SIA – Secteur Forillon SECTION 37 : Refuge Erablière → Camping Les Lacs SIA-QC-Topo+ Forillon-LesLacs-2 /3 15 10 Rivière-au-Renard (8 km) Parc national Forillon Rivière-au-Renard 2/3 (Camping des Appalaches) S 48 47 46 45 44 43 42 41 40 37 2
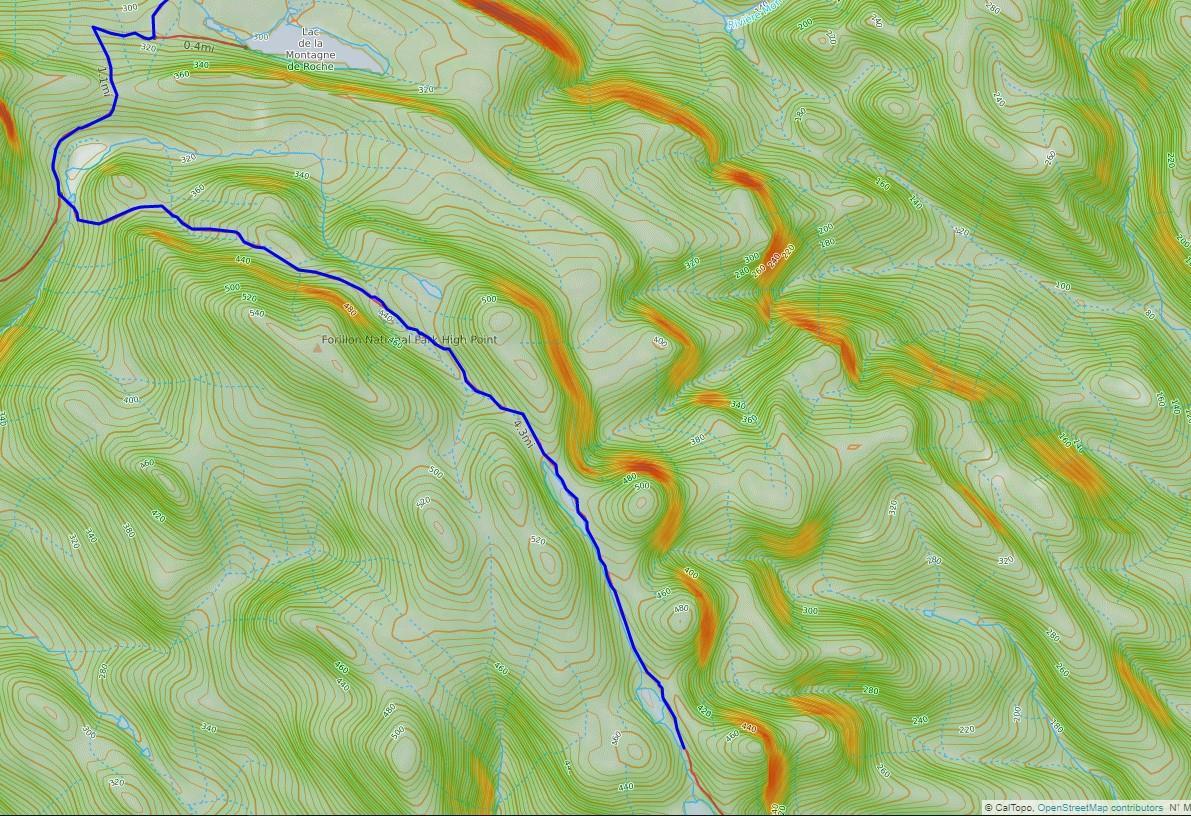






SIA – Secteur Forillon SECTION 37 : Refuge Erablière → Camping Les Lacs SIA-QC-Topo+ Forillon-LesLacs-3 /3 (Les Lacs) 20 3/3 Mont du lac à Canard Étang « Lac à Canard » Lacs de Penouille 40 39 38 37 36 35 34 33 37 3









SIA – Secteur Forillon SECTION 38 : Camping Les
→
1 SIA-QC-Topo+
Lacs)
Crêtes 1) Forillon-LesCretes1 2 4 6 8 L’Anse-au-Griffon 1/1 S 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 38
Lacs
Camping Les Crêtes
(Les
(Les














SIA – Secteur Forillon SECTION 39 : Camping Les Crêtes 1 → Cap Gaspé SIA-QC-Topo+
(Les
Crêtes 1) Forillon-Cap-Gaspé-1 /3
5 Gaspé Penouille Fort Péninsule Baie de Gaspé 1/3 Cap-aux-Os S 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 39 1 14 10
(Les Crêtes 2)









SIA – Secteur Forillon SECTION 39 : Camping Les Crêtes 1 → Cap Gaspé SIA-QC-Topo+
(Camping Petit-Gaspé)
Grande-Grave
(Camping Cap-Bon-Ami)
/3 10 15
2/3 S 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 39 2
(Camping Des-Rosiers)
Forillon-Cap-Gaspé-2
Cap-des-Rosiers Mont Saint-Alban







SIA – Secteur Forillon SECTION 39 : Camping Les Crêtes 1 → Cap Gaspé SIA-QC-Topo+
L’Anse-aux-Amérindiens
Anse Blanchette
20
3/3
7 6 5 4 2 1 3
L’Anse-Saint-Georges Forillon-Cap-Gaspé-3 /3
Cap-Gaspé
© Caltopo
39 3
Tu ne traverseras jamais l'océan, si tu as peur de perdre de vue le rivage. (Christophe-Colomb.)
Source : Commission de toponymie du Québec (sauf mention contraire)
Toponyme Type entité Origine et signification
Alain-Potvin Lac Le nom rappelle la mémoire du biologiste Alain Potvin, qui a travaillé pendant plusieurs années pour le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche. Son action fut particulièrement reliée au parc national de la Gaspésie vers la fin des années 1980. Il travaillait alors à Sainte-Anne-des-Monts et réalisa entre autres le plan de gestion des ressources naturelles du parc. Il était passionné par les activités de plein air et particulièrement par la randonnée pédestre. Le 31 mai 1992, Alain Potvin est décédé au cours d'une expédition en montagne. Après avoir atteint le sommet du mont McKinley dans le parc de Denali en Alaska, un accident fatal survint durant la descente vers le camp de base.

Ala'sui'nui Mont Son nom, d'origine micmaque, signifie « mont du voyageur ».
Albert Mont
Ce mont fait partie des Chic-Chocs. Atteignant une altitude de 1 151 m, il comporte deux hauteurs, le sommet Albert Sud, le plus élevé, et le sommet Albert Nord, séparées par un plateau connu sous le nom Table à Moïse, un ensemble que l'on peut admirer de la route traversant la péninsule gaspésienne de SainteAnne-des-Monts à New Richmond. Quelques autres reliefs des environs, les monts Jacques-Cartier et Richardson notamment, partagent à des degrés divers certaines des caractéristiques bioclimatiques qui font du mont Albert un site exceptionnel au Québec : les neiges le recouvrent – du moins en partie – neuf mois par année; sa végétation de toundra alpine est particulière, à plusieurs égards semblable à celle du Grand Nord; on y trouve, à certains moments de l'année, quelques hardes de caribous des bois, ces cervidés s'étant maintenus au sud du Saint-Laurent uniquement dans la région des monts Chic-Chocs. Le mont Albert a été ainsi nommé par l'arpenteur-géologue Alexander Murray (1810-1884), qui en atteignit le sommet le 26 août 1845, jour de l'anniversaire de naissance du prince de SaxeCobourg-Gotha, Albert (1819-1861), époux de la reine Victoria.
Supplément : Géologie Mont-Albert
Vidéo : Déluge au Mont-Albert (Productions Les Krinkés)
TOPONYMIE SIA
C D E F G H J KL M N O P R S T W X
B
Toponymie SIA
Américains, aux Lac Le nom du Lac aux Américains provient de deux guides canadiens-français
(Samuel Côté et Joseph Fortin) qui accompagnaient en 1903 deux botanistes américains de l’Université Harvard à Boston qui faisaient des relevés floristiques dans la région. (Source : Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes).
Supplément: Géomorphologie Lac aux Américains
Amqui Ville Le mot micmac amqui, également relevé sous les graphies humqui, ankwi, unkoui, a pour significations : là où l'on s'amuse, où l'on joue; lieu d'amusement et de plaisir. Le jeu dont il est question pourrait se rapporter au tourbillonnement de l'eau, mais il semble qu'une seule source accrédite cette explication. Il faut plutôt y voir le signe concret de rassemblements joyeux d'Amérindiens jadis. La présence amérindienne s'est d'ailleurs maintenue dans ce territoire jusqu'au début du XXe siècle. Le père Joseph-Étienne Guinard (missionnaire des Oblats de Marie-Immaculée) trouve cependant fantaisiste la traduction lieu d'amusement et de plaisir et préfère le sens de camarade ou beau-frère. Le père Pacifique de Valigny, (prêtre capucin) spécialiste de la langue micmaque, propose quant à lui l'explication, moitié mûr, tirée du rapprochement avec le mot micmac amgoig, hypothèse qui n'a cependant recueilli que fort peu d'appuis jusqu'ici.
Anse à Colin Lieu-dit Son nom rappelle le souvenir de Charles Collin, pêcheur et pionnier de l'endroit originaire de Montmagny. Accompagné de son épouse, il arrive à Grande-Vallée au début des années 1850. Toutefois, la famille quitte les lieux en 1856 pour aller s'installer à Sainte-Anne-des-Monts. La raison pour laquelle le toponyme s'écrit avec un seul « L » est inconnue.

Anse à Déry Lieu-dit À une certaine époque, chaque propriétaire d’un lot jouxtant la mer avait tendance à donner son nom à l’anse la plus proche de son bien. C’est entre autres le cas de Pierre Déry, pêcheur et cultivateur arrivé de Montmagny en 1878 en compagnie de son épouse Odile Proulx et de leurs deux fils aînés. Installé sur les hauteurs à l’est du village, il ancrait son bateau dans la petite baie au pied de ses terres.
Anse à Mercier Lieu-dit Cette petite baie évoque le souvenir d’un autre pêcheur venu s’installer temporairement à cet endroit au cours des années 1840-50, soit un dénommé André Mercier. Celui-ci n’a laissé aucune descendance à Grande-Vallée.
SIA-QC-Topo+
Anse-auxAmérindiens Lieu-dit Des « Sauvages » habitaient cette anse durant le régime français, ce qui a donné le nom au lieu. Mais on ne sait pas s’il s’agissait de Micmacs ou de Montagnais, car plusieurs de ces derniers étaient venus de la côte nord du golfe pour s’établir en Gaspésie.
Normalement Parcs Canada applique la politique respectueuse de préciser la nation amérindienne impliquée. Mais dans ce cas-ci, les données manquent.
Il faut se souvenir qu’à cette époque, le terme « sauvage » référait à ces gens qui vivaient pleinement de la nature, dans le même sens qu’on utilise encore ce terme pour désigner les fleurs natives d’une région. Ainsi le terme n’avait rien de péjoratif. Le terme a pris une autre connotation plus tard. Conserver le nom de l’anse comme appellation d’origine et faire valoir qu’il fait partie de notre patrimoine toponymique régional datant de la Nouvelle-France aurait pu servir à des fins pédagogiques.
L’anse aux Sauvages apparait sur la carte de Bell, l’aide de camp de Wolfe, dès la veille de la Conquête (1758). Avec la venue des Britanniques, ce lieu vint à s’appeler Indian Cove.
(Source : Magazine Gaspésie, avril-juillet 2017)
Anse-aux-Canons Lieu-dit Il fait référence à deux canons, l’un situé près de l’église du hameau, l’autre sur la grève. Ces deux canons sont des vestiges du naufrage de la frégate Pénélope en 1815. Environ 200 marins et soldats britanniques, qui revenaient au Canada après la victoire contre Napoléon, ont péri lors de ce naufrage survenu après que le navire eut heurté des récifs près du hameau voisin de Pointe-à-la-Frégate.
Au cours de la nuit du 30 avril 1815, la frégate Penelope s’approche d’une pointe de Gaspé, au large de l’actuelle municipalité de Cloridorme. Le matin du 1er mai, la frégate est éventrée par des rochers à moitié submergés par les flots. L’équipage essaie de maîtriser l’inondation de la cale, mais en vain. Le capitaine donne alors l’ordre de descendre les canots de sauvetage. La frégate ouvre aussi le feu avec ces canons afin d’attirer l‘attention des résidents, mais sans résultat

Finalement, malgré tous les efforts entrepris, la Penelope coule et la plus grande partie des hommes périssent en mer. Les marins et les soldats rescapés sont conduits à Québec, ainsi que le capitaine Galloway qui se trouve parmi les survivants. Les données sur le nombre total de victimes ne sont pas conservées, mais on peut considérer qu’au moins 200 marins et soldats ont trouvé la mort dans ce naufrage.
Source : Histoire du Québec
Toponymie SIA SIA-QC-Topo+
Anse du Cap à l’Ours
Lieu-dit
On identifie deux origines possibles au toponyme Cap à l'Ours : les protubérances du cap dessineraient le profil d'un ours; les pionniers de l'endroit auraient aperçu un ours, sur le cap, le jour de l'installation dans la région.
(Source : ‘Les plages et les grèves de la Gaspésie’ de Josée Kaltenback, ed. Fides )
Anse St-Georges Lieu-dit L’Anse St-Georges rappelle le nom d’un pionnier de l’endroit, Georges Lemesurier, originaire de l’ile Guernesey.

(Source : ‘Les plages et les grèves de la Gaspésie’ de Josée Kaltenback, ed. Fides )
Appalaches Chaîne de montagnes Les Appalaches sont un système montagneux de l'Amérique du Nord s'étendant sur plus de 2 000 km qu'on suit à travers tout l'est du continent, de l'État de l'Alabama jusqu'à Terre-Neuve.
La nation amérindienne Apalaches, qui a donné son nom à l'ensemble montagneux, occupait le nord de la Floride. Le toponyme Apalachen est mentionné en 1527 pour déterminer un lieu du sud-est des États-Unis.
L'explorateur et administrateur espagnol Cabeza de Vaca, qui a essayé mais sans succès de conquérir la Floride cette année-là, indique dans ses mémoires publiés en 1528 que Apalachen est le nom amérindien d'une province. Cette appellation est apparue par la suite dans des documents cartographiques mais elle a désigné d'une façon imprécise le relief montagneux situé au nord de la Floride. Les cartes d'Ortelius (1564) et de Mercator (1569) donnent Apalchen. Sur cette dernière carte, les Appalaches sont représentées comme une chaîne orientée sud-ouest–nord-est jusqu'à la Nouvelle-Écosse actuelle. C'est toutefois à partir du XVIIIe siècle que les cartographes donnent de l'extension au toponyme Appalaches. Pour Nicolas Bellin (1755), les montagnes des Appalaches s'étendent de la Floride jusqu'à la Pennsylvanie.
Pour identifier l'ensemble du massif, au XIXe siècle, les noms Allegheny et Appalachian Mountains, aux ÉtatsUnis, se sont imposés au détriment d'autres dénominations. La consécration du toponyme Appalaches, écrit avec la lettre p redoublée, de préférence à Allegheny, est due aux travaux d'Arnold Henry Guyot (1807-1884). Avant de publier son étude géologique sur cette chaîne de montagnes, en 1861, ce géologue opta finalement pour Appalachian, comme l'indique le titre de son étude On the Appalachian Mountain System. C'est la haute

Toponymie SIA SIA-QC-Topo+
valeur scientifique de cette publication qui semble avoir établi l'usage exclusif d'Appalachian pour désigner cette chaîne de montagnes tant aux États-Unis qu'au Québec.
Toutefois le nom Appalaches est apparu timidement dans la province de Québec au début du XXe siècle. Jusqu'aux années 1930, on distinguait encore les Appalaches du Nord des Appalaches du Sud situées aux États-Unis. Des parties de ce massif ont reçu des appellations spécifiques : les monts Chic-Chocs qui occupent le cœur de la péninsule gaspésienne; les monts Notre-Dame qui s'étendent de la Beauce à Gaspé; les montagnes Vertes qui forment au Québec l'extrémité nord des Green Mountains de l'État du Vermont; les montagnes Blanches qui sont en Estrie le prolongement des White Mountains de l'État du New Hampshire.
Suppléments : Les Appalaches et Sentier des Appalaches (AT) (Wikipédia)
Assemetquagan Rivière Son nom, une adaptation de la graphie micmaque Asm'tgwe'gn, signifie « qui apparaît soudainement au détour ».
Aube, de l’ Pic C'est en 1989, dans le cadre d'une opération de désignation des principaux sommets des monts Chic-Chocs et McGerrigle menée par l'administration du parc national de la Gaspésie, qu'a été donné ce nom. Il remplaçait le nom Pic de l'Aurore, utilisé localement en raison des premiers rayons de soleil venant frapper le pic, mais qui faisait double emploi avec le pic du même nom situé à Percé.
B
Bascon Ruisseau Le nom rappelle, depuis 1963 ou avant, Louis Bascon nommé dans un contrat d'engagement (1797-09-13) pour aller au poste français de traite de Détroit (territoire incluant l'actuelle ville étasunienne de Detroit).
Barbarin Mont, Lac Ce toponyme évoque Arsène-Louis Barbarin (1812-1875). Avocat né à Marseille, il entre chez les Sulpiciens où il est ordonné en 1841. Un an plus tard, il arrive au Canada et enseigne au collège puis au Grand Séminaire de Montréal. Vicaire de la paroisse Notre-Dame en 1853, il retourne en France en 1874 où, malade, il meurt à l'abbaye des Prémontrés, près de Tarascon, en Provence. Ce nom a été approuvé en 1968. Variantes : Lac Bromley; Lac Tarzan.

Bayfield Mont L'amiral Henry Wolsey Bayfield (1795-1885) a effectué, de nombreux relevés hydrographiques dans le fleuve et le golfe du Saint-Laurent. Le géologue William E. Logan baptisa ainsi ce mont, lors de son ascension, en 1844.
Blanc Mont Blanc parce que souvent recouvert de neige.
Toponymie SIA SIA-QC-Topo+
Blizzard, du Mont Ce nom a été proposé par l'Administration du parc de la Gaspésie. Il définit judicieusement le vent du nord fugueux, rapide, vibrant, de haute vélocité et qui fait osciller la température à -90C et atteint 150 km au faîte des monts. Le blizzard inspira également les légendes amérindiennes micmaques peuplées d'esprit envoûtant les ChicChocs.
Brûlé, du Pic Ce nom a été proposé par l'Administration du Parc de la Gaspésie. Il tire son origine de la présence d'un brûlé qui eût lieu en 1959 et détruisit 34 240 acres. On y trouve encore des traces aujourd'hui.
Cap-aux-Os Cap Ce spécifique dénominatif est commun à trois autres entités géographiques du même secteur soit le Petit cap aux Os, le Gros cap aux Os et le Petit ruisseau du Cap aux Os. … On pense généralement que les nombreux ossements de baleine trouvés sur la plage, vestiges d'anciennes chasses, ont inspiré le choix du toponyme, qui remonte au milieu du XIXe siècle. L'abbé Bossé, missionnaire à Capaux-Os en 1872, croit plutôt que la dénomination résulte d'une déformation du patronyme Ozo, nom du premier Guernesiais (de l'île de Guernesey) venu s'installer à cet endroit au XIXe siècle. Pour sa part, Carmen Roy, auteure de Littérature orale en Gaspésie, en 1962, croit que la désignation proviendrait de Cap Oiseau.

Cap Barré Cap La seule torpille allemande à avoir touché les côtes canadiennes durant la Seconde Guerre mondiale a frappé la terre entre le Cap Barré et le point à Mimi le 8 septembre 1942.
(Source : ‘Les plages et les grèves de la Gaspésie’ de Josée Kaltenback, ed. Fides )
Cap-Bon-Ami Cap Le toponyme Bon Ami est tiré du patronyme présent dans le nom de Hélier Bonamy, commerçant guernesiais de la compagnie Bonamy et LeMesurier, installée à Cap-Gaspé au milieu du XVIIIe siècle. En 1777, cette firme employait 58 des 70 engagés de pêche de la région. Thomas LeMesurier et Hélier Bonamy auraient été les premiers commerçants venus des îles anglo-normandes de la Manche à s'établir dans la région de Gaspé. Le nom du cap est inscrit sur la plupart des cartes dressées au XIXe siècle, notamment celles d'Antoine Painchaud (1858), de Russell (1861) et de Bayfield (réédition de 1890), de même que celle intitulée Cap Rosier (1873).
Toponymie SIA SIA-QC-Topo+
C
Cap-Chat Ville Cette municipalité de la Gaspésie, où une mission était établie en 1815, devrait son nom, selon l'opinion la plus répandue, à un rocher en forme de chat à demi accroupi situé tout près de la ville et que l'on distingue à plusieurs dizaines de kilomètres de Cap-Chat. Le relevé sur une carte du père Ducreux datant de 1660 de l'indication « Promontorium Felis », promontoire du chat, à la hauteur de Cap-Chat, tendrait à accréditer cette thèse. Une légende souligne que jadis un chat arpentant la grève cap-chatienne tuait de nombreux animaux et que la Fée-Chat, apparaissant soudainement et l'accusant d'avoir dévoré ses enfants, l'enferma dans sa prison de pierre jusqu'à la fin des temps. Une autre explication, qui paraît la seule acceptable à côté d'interprétations légendaires, soutient que l'élément « Chat » provient de la déformation du nom d'Aymar de Chaste, 3e lieutenant général de la Nouvelle-France en 1603, ce que tendrait à confirmer la graphie « Cap-Chatte » et la prononciation [kap1at] encore courante parmi la population âgée de l'endroit. Par ailleurs, les formes « Cap de Chatte » (1612 et 1660), « Cap de Chate » ou « Cap de Chatte » (1632) et « Cap du Chat » (1685) ont pu être relevées.
Cap-des-Rosiers Village Bien que fréquenté dès le XVIIe siècle par les pêcheurs, Cap-des-Rosiers verra sa première mission officielle se constituer au milieu du XIXe siècle. Stanislas Drapeau (1863) signale un peu plus d'un millier d'habitants à «la mission de Saint-Alban (Cap-Rosier)». Quant à la municipalité de Saint-Alban-du-Cap-des-Rosiers, elle sera érigée en 1895 et fusionnera à Gaspé en 1971. Zone importante d'accueil du parc national de Forillon, des excursions de pêche y sont offertes par les villageois. On peut également visiter le phare de Cap-des-Rosiers, classé monument historique en 1977. Construit en 1858, ce phare d'une hauteur de 37 m, est le plus haut du Canada.

Toponymie SIA SIA-QC-Topo+
Le nom du Cap-des-Rosiers vient d’une grande quantité de rosiers sylvestres qu’on y trouva lors des premières expéditions. Cap-des-Rosiers fut connu des pêcheurs depuis au moins le XVIIe siècle et on trouve le nom de l’endroit sur une des cartes de Samuel de Champlain, publiée en 1632 dans le cadre de la préparation des documents pour les négociations des limites des territoires entre la France et la Grande-Bretagne. Le cap y figure sous le nom du Cap Rosier.
Le village a été témoin d’importants événements historiques. On peut rappeler que c’est du Cap-des-Rosiers que les postes d’avant-garde français ont aperçu la flotte britannique se dirigeant vers Québec au printemps 1759 et c’est ici que d’épouvantables naufrages eurent lieu, dont le naufrage du Carrick, un voilier irlandais. Lors de ce naufrage, 139 immigrants irlandais ont péri et les 48 survivants sont devenus les résidents du Cap-des-Rosiers, de L’Anse-au-Griffon, du Cap-aux-Os et de la Rivière-au-Renard. En 1968, on a retrouvé la cloche du Carrick. Aujourd’hui, elle sert de monument en mémoire des naufragés.
(Source : Grandquebec)
Pendant la Seconde Guerre mondiale, le 15 septembre 1942, le gardien Joseph Ferguson aperçoit un Uboat allemand et sonne l’alarme à la défense civile. (Source : Wikipedia)
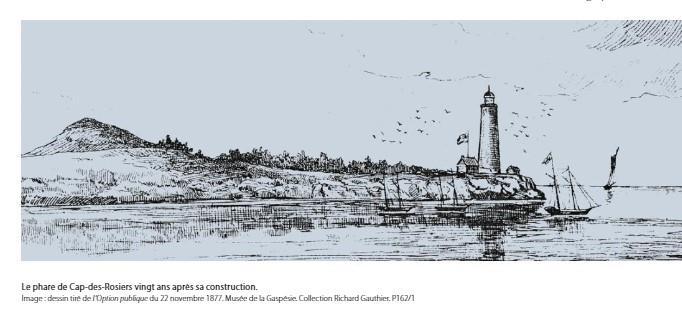
Toponymie SIA SIA-QC-Topo+
Toponymie SIA
Cap-Gaspé Cap Le cap Gaspé se situe à la pointe de la presqu'île de Forillon, longue d'une dizaine de kilomètres et large d'au moins 1 km. Très abrupt du côté nord, le cap Gaspé, qui s'élève à 91 m, est accessible du côté sud par une étroite route de gravier. Dès 1625, Champlain, en parlant du cap de Gaspey, signale la présence d'un petit rocher à une lieue (5 km) plus loin, que l'on nomme Le Farillon. Or, c'est probablement la présence rapprochée de ces deux toponymes qui explique que le cap Gaspé ait été identifié par Cap Forillon dès la fin du XVIIe siècle par Nicolas Denys (1672), Le Forillon sur une carte de Jean Deshayes levée en 1686 et publiée en 1695 et Cap Fourillon sur une carte de Lange en 1775. On retrouve même, sur une carte anonyme dessinée vers 1760, le toponyme Old Woman à la place du nom de lieu identifiant le cap.
La forme officielle du toponyme qui ignore la particule, alors qu'elle est présente sous la plume de Champlain en 1625 et sur plusieurs cartes du Régime français, doit avoir été inspirée de la carte des comtés de Bonaventure et de Gaspé publiée en 1924 par le ministère des Terres et Forêts et précédée par des cartes d'inspiration anglaise, comme celle de Carver (1776) qui mentionne « C. Gaspe ».
Supplément : Histoire du Phare de Cap-Gaspé
Cascapédia Rivière Née du lac Cascapédia et des cours d'eau environnants, la rivière Cascapédia, après avoir parcouru plus d'une centaine de kilomètres vers le sud, débouche dans la baie des Chaleurs par la baie de Cascapédia. Fréquentée par les amateurs de pêche, elle est reconnue comme l'une des plus riches rivières à saumon de la province. Afin d'en assurer la protection, le gouvernement du Québec a établi, en 1982, sur la quasi-totalité de son cours, la réserve faunique de la Rivière-Cascapédia.

Tout le monde s'entend à propos de l'origine micmaque de cet hydronyme, dérivé de gesgapegiag, qui signifierait forts courants ou rivière large. On peut observer que le cours de la Cascapédia, exempt de tout obstacle majeur, de toute dénivellation importante, forme un courant uniformément rapide.
D'abord indiquée «R. Kichkabeguiak» sur une carte de J.-B.-L. Franquelin, en 1686, c'est Rivière Kaskabijack qui paraît dans un rapport anonyme de 1783, conservé aux Archives nationales du Canada selon le père Pacifique. Stanislas Drapeau (1863) écrit Rivière Cascapédia, comme la graphie

SIA-QC-Topo+
actuelle, tandis que le nom de «Grande R. Cascapedia» est inscrit sur la carte de la province de Québec d’Eugène Taché (NDA : il est à l'origine de la devise du Québec : Je me souviens ) en 1870.

À partir du lac Cascapédia, compris dans les limites du Parc de conservation de la Gaspésie, l'arpenteur Joseph Hamel a fait le relevé de la rivière en 1835 et y constate l'abondante présence de poissons, comme la truite, le saumon, la carpe et le poisson blanc. La Description des cantons arpentés... (1889) note que «La grande Cascapedia... sort du lac Cascapedia»
Causapscal Ville La municipalité du village de Causapscal tire sa dénomination de celle du canton de Casupscull dans la vallée de la Matapédia, proclamé en 1864. La modification graphique, attestée pour la première fois en 1845, à l'époque des débuts du peuplement, pourrait s'expliquer par interversion du u et du a et remplacement de la lettre u par la lettre a par suite d'un phénomène d'écho phonique.
Par ailleurs, les déformations graphiques sont courantes dans les mots amérindiens adaptés en français. Ce nom provient du micmac Goesôpsiag ou Gesapsgel ou encore Gesôpsgigel ayant pour sens fond pierreux et brillant, eau rapide, pointe caillouteuse, ce dernier sens convenant bien au lit de la rivière Causapscal de nature très caillouteuse.
Des auteurs attribuent cependant à Causapscal et à Casupscull des significations différentes. La situation particulière de la ville, au confluent de la Causapscal et de la Matapédia qui se rejoignent pour former une fourche, lui a valu, vers 1830, le nom de : Les Fourches ou Les Fourches-de-Causapscal, par la suite modifié et qui a donné naissance au gentilé Causapscalien.
Charles-E.-Vézina Mont Son nom évoque le souvenir de Charles-E. Vézina, fondateur de la Société d'histoire et de généalogie de Matane, décédé à Matane le 13 avril 1973.
Chic-Chocs Chaîne des Monts

Cet ensemble montagneux de la Gaspésie, formé d'un haut plateau étroit, constitue l'extrémité orientale de la chaîne de montagnes que sont les monts Notre-Dame en même temps que les Appalaches. L'ensemble imposant de cette bande orographique, qui a une longueur d'environ 95 km et une largeur de 10 km, suit parallèlement le Saint-Laurent à une distance de 20 à 40 km à l'intérieur des terres.
Le géographe Raoul Blanchard écrit dans L'Est du Canada français que : « Ces hautes terres qu'on appelle les monts Shick shocks méritent ce nom de montagnes à cause de la raideur de leurs pentes septentrionales ». Le mot micmac sigsôg signifie rochers escarpés ou montagnes rocheuses selon les auteurs. Dans son Journal concernant l'exploration des comtés de Gaspé, Rimouski et
SIA-QC-Topo+
Toponymie SIA
Toponymie SIA
Bonaventure, Joseph Bureau écrit en 1883 : « Il y a de grosses montagnes qu'on appelle les Chic-Chocs ». Cet oronyme (Nom porté par un élément de relief) a connu plusieurs variantes graphiques, notamment : Chikchâks (1836); Shick-shock (1857); Chick-Saws (1863).

Comité de protection des Monts Chic-Chocs
Gravure des Chic-Chocs à partir du Mont-Albert, 1883
Clark Ruisseau, canyon La raison pour laquelle ce nom a été retenu est inconnue. Il est aussi connu sous le nom micmac Epsiagueg, qui signifie « la marmite très chaude ».
Clercs, des Mont Son nom rappelle que les clercs de Saint-Viateur séjournaient régulièrement en bordure du lac Matane dans les années 1960, dans un grand camp leur ayant été cédé par la compagnie Hammermill Paper. Le camp se trouvait près du barrage du Lac-Matane.
SIA-QC-Topo+
Cloridorme Village Plusieurs hypothèses, plus ou moins satisfaisantes, ont été avancées pour expliquer la dénomination Cloridorme colonisée depuis 1838 par des gens venus de Montmagny. D'ailleurs, on a déjà avancé l'hypothèse que l'endroit devrait sa dénomination à l'un des premiers colons, Cloridan Côté, originaire de Saint-Thomas-de-Montmagny.
Une mission répondant à l'appellation ultérieure de Sainte-Cécile-de-Cloridorme s'ouvre en 1853, devient paroisse en 1873 avec l'ouverture des registres et sera érigée canoniquement seulement en 1900. Il semble que personne ne connaît aujourd'hui la véritable origine ni la signification de ce toponyme. Même l'hypothèse présentée comme la plus plausible résiste mal à l'analyse. En effet, on croit que la concession, en 1707, à Charles Morin par le gouverneur Vaudreuil et l'intendant Raudot d'un territoire appelé Cloridan à la rivière Ristigouche, appellation qui, par modifications successives, aurait abouti à Cloridorme, fournirait l'explication définitive.
Mais on a démontré que le déplacement de ce toponyme de la baie des Chaleurs à la côte nord de la Gaspésie apparaît sinon impossible du moins fort peu probable. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que le nom était déjà en usage au cours du XVIIIe siècle comme en fait foi une carte anonyme de 1755, Les Cloridormes (sic) et qu'au XIXe siècle on soutenait que Les Chlorydormes identifient deux baies ouvertes sur le Saint-Laurent, du côté est, phénomène à rapprocher des rivières du Petit-Cloridorme et du Grand-Cloridorme.
Coleman Mont Son nom, qui paraît dans un rapport géologique de 1922, évoque Arthur Philemon Coleman (1852-1939), géologue et glaciologue, qui a effectué, au début du XXe siècle, des recherches dans les Chic-Chocs. Auteur de nombreuses publications scientifiques, il a notamment publié Physiography and Glacial Geology of Gaspé Peninsula, Québec (1922).

Collins Mont Le géographe J.-F. Collins parcourut les Chic-Chocs, en 1921-22, et est coauteur, avec M.-L. Fernald de l'article intitulé « The region of Mount Logan, Gaspé Peninsula ». (Geographical Review, Vol. 15, 1925).
Comte Mont Ce nom a été proposé par l'administration du Parc national de la Gaspésie. Les guides, les explorateurs et les naturalistes font usage de ce nom depuis 1939. L'origine aurait probablement une relation entre un personnage de souche noble et une mission scientifique.
Toponymie SIA SIA-QC-Topo+
D
Diable, du Lac, Chute, ruisseau

Toponymie SIA SIA-QC-Topo+
Le Diable, incarnation du Mal absolu, représente certainement l'un des personnagescertains diront réels, d'autres mythologiques ou légendaires - les plus connus des Québécois, qui ont pu en entendre parler dans la famille, à l'école, à l'église, en allant au cinéma, au musée ou à d'autres occasions. Rien d'étonnant, puisqu'il s'agit de l'une des créatures les plus présentes dans l'imaginaire à travers le monde, dans toutes ou presque toutes les cultures et ce depuis des temps immémoriaux. La croyance en la personnification du Mal trouve son origine dans les civilisations orientales de l'Antiquité, imaginant le monde dominé par deux grandes puissances spirituelles, aux forces relativement égales mais opposées, traversé et influencé par les anges et les démons. Le Judaïsme et le Christianisme héritèrent de cette conception, en la modifiant ou en l'adaptant selon leurs besoins. Ainsi, dans la Bible, le livre de la Genèse explique que Dieu dut expulser du ciel une partie de ses anges, révoltés à l'instigation de l'orgueilleux Lucifer, par la suite devenu le prince des démons - ou diables - et appelé Satan, Belzébuth ou Diable. Ce dernier nom, présent dans la langue française depuis 881, d'abord sous la forme de diaule puis refaite en diable à la fin du Xe siècle, vient du latin diabolus, traduction du grec diabolos signifiant « qui désunit, qui inspire la haine ou l'envie ».
Longtemps soumise à l'autorité du clergé catholique, la société québécoise se servit de multiples façons du nom le plus courant du Malin. En toponymie, plusieurs employèrent « Diable » pour dénommer certaines rivières ou des chutes afin de souligner l'assourdissant, l'infernal bruit qu'elles produisaient. Il apparaît dans bon nombre de dictons, proverbes et expressions, dont « mener le diable », « faire un bruit du diable » (c'est-à-dire produire des sons très forts, assourdissants, dérangeants); « cela ne vaut pas diable » (objet sans valeur) ou « loger le diable dans sa bourse » (être sans argent). Quelqu'un peut aussi être « en beau diable » ou en colère; « avoir le diable au corps », donc se comporter de façon turbulente, déréglée; et « se débattre comme un diable dans l'eau bénite », s'agiter beaucoup, agir énergiquement mais sans résultat. Certains parlent même d'aller « au diable vauvert » ou très loin, mais sans se rendre nécessairement compte qu'ils font allusion au château de Vauvert, dans la région parisienne, hanté, habité par le Diable. Ce dernier occupe également une place de choix dans les contes et les légendes, attaquant constamment les membres du clergé catholique et voulant faire tomber dans le péché les gens au cœur simple et pur.

L'iconographie présente généralement le Diable comme un homme grand et mince, au teint sombre ou noir, aux pieds fourchus, portant des cornes sur la tête et une longue queue à la base du dos. Maître des ténèbres et de l'Enfer, lieu où sont détenus les damnés, le Diable possède de nombreux pouvoirs, notamment celui de faire disparaître ses cornes et sa queue de la vue des humains. En plus du personnage, diable identifie quelques objets, dont un chariot servant à la manutention, un ustensile de cuisson et un appareil destiné à abattre les arbres. L'actuelle chute porte vraisemblablement ce nom en raison de sa présence sur le parcours du ruisseau du Diable.
Disparus, des Mont Son nom rappelle la disparition, en décembre 1936, de trois frères de la famille Imbeault, dans ce secteur.
Dodge Mont Le nom « Mont Dodge » est relevé dans « The region of Mount Logan Gaspé Peninsula », Franklin Collins et Merritt L. Fernald (1925). Il a été repris par Camille Gervais, dans La flore vasculaire de la région du mont Logan, Gaspésie (1982), p. 9-10. Ce toponyme évoque la mémoire de Carroll William Dodge (1895-1988), botaniste à l'Université d'Harvard.
Dos-de-la-Baleine Mont Ce nom a été proposé par l'Administration du parc de la Gaspésie. Ce mont ressemble étrangement au dos de la baleine comme si elle était venu s'y échouer.
Elie Lister Mont Depuis 2002, ce nom évoque le souvenir de Elie Lister, ingénieur forestier gérant de la compagnie Hammermill Paper qui possédait des droits de coupe forestière sur le territoire de l'actuelle réserve faunique de Matane dans les années 1950. Il est décédé à Montréal vers 1978.
Ells Mont Le nom Mont Ells rappelle la mémoire de R. Hugh W. Ells (1845-1911), explorateur et géologue, qui a travaillé pour la Commission géologique du Canada. En 1882, Ells remonte les rivières Sainte-Anne et Madeleine, en Gaspésie, et il explore les monts Chic-Chocs. Il refait une expédition dans la même région l'année suivante, en compagnie de William E. Logan, cette fois en passant par la rivière Cascapédia. C'est au cours de ces explorations que furent prises les premières photographies de ce territoire. Sur proposition des autorités du parc de conservation de la Gaspésie, la Commission de toponymie a attribué officiellement, en 1989, le nom Ells à un mont de la région qu'il a parcourue.

Toponymie SIA SIA-QC-Topo+
E
Éole Abri Dans la mythologie grecque, Éole est le maître et le régisseur des vents.

Éole apparaît pour la première fois au chant X de l’Odyssée, lorsque Ulysse accoste chez lui : « Nous gagnons Éolie, où le fils d'Hippotès, cher aux dieux immortels, Éole, a sa demeure. C'est une île qui flotte : une côte de bronze, infrangible muraille, l'encercle tout entière ; une roche polie en pointe vers le ciel. »
Homère lui prête douze enfants, six fils et six filles, qu'il a mariés entre eux et qui vivent fastueusement dans son palais. Après qu'Ulysse s'est reposé un mois auprès d'Éole, celui-ci lui fait présent pour son départ d'un sac dans lequel « il coud toutes les aires des vents impétueux, car le fils de Cronos l'en a fait régisseur : à son plaisir, il les excite ou les apaise ». Ulysse navigue pendant neuf jours à bon rythme avant que son équipage, jaloux, ne délie le sac et que des vents contraires le ramènent en Éolie. Mais cette fois, Éole le chasse assez vertement : « Décampe ! Tu reviens sous le courroux des dieux ! »
Source : Wikipédia
Ernest-Ménard Mont Ernest Ménard est né le 13 octobre 1888 à L'Islet. Il fera partie du premier groupe d'ingénieurs forestiers gradués. Il devient surintendant fondateur des parcs nationaux de la Gaspésie (1936) et du Mont-Orford (1938). Ce nom a été proposé par l'Administration du parc de la Gaspésie pour honorer un pionnier dans la création du parc dans les années 1930. Celui-ci aurait procédé à la construction de bâtiments dont le réputé Gîte du Mont-Albert.

Fernald Réserve écologique
Cette réserve écologique, d'une superficie de 7 km², se situe au sud de la ville de CapChat, entre la rivière Cap-Chat à l'ouest et le parc national de la Gaspésie à l'est. Sa création par décret, le 10 mai 1995, visait à protéger le milieu naturel de cette partie des monts Notre-Dame. Son nom rappelle le souvenir du botaniste américain Merritt Lyndon Fernald , professeur d'histoire naturelle à l'Université Harvard et rédacteur en chef de la revue scientifique Rhodora.
Supplément : Réserve écologique Fernald
Fernand Fafard Mont Cette division géographique rappelle la mémoire de Fernand Fafard (1882-1955), arpenteur et homme politique qui a exercé sa profession en Abitibi, dans le Haut-Saint-Maurice et dans le Lac-Saint-Jean. Il a tracé plusieurs
Toponymie SIA SIA-QC-Topo+
…
F
lignes de concessions forestières sur l'actuel territoire de la réserve faunique de Matane, dans les années 1920. Fafard a de plus été président de la Corporation des arpenteurs-géomètres de la province de Québec, député fédéral de L'Islet (1917-1940) et sénateur en 1940, peu de temps avant sa mort.
Forillon Parc national Avant la création du parc, le territoire avait été fréquenté pendant plusieurs siècles par les Amérindiens et les Européens. En 1665, à l'endroit nommé Petit-Gaspé , face à la baie de Gaspé et immédiatement à l'ouest de la presqu'île de Forillon, les Français ont même tenté de mettre en valeur une mine de plomb mais leur projet a dû être abandonné.
Le spécifique Forillon et ses variantes graphiques remontent au début de la colonie. Samuel de Champlain indique en 1626 qu'à « une lieue du Cap de Gaspey, est un petit rocher que l'on nomme le farillon (non pas forillon tel que généralement attribué à Champlain, selon l’historien Pierre-Georges Roy, en 1906, paru dans Noms Géographiques de la Province de Québec), éloigné de la terre d'un jet de pierre ». Le père Barthélemy Vimont mentionne Forillon de Gaspé dans la Relation des Jésuites de 1642. Dans un manuscrit de 1666, on précise qu'« À cinq lieues de l'isle platte est l'entrée de Gaspé où il y a un forillon sur la pointe faict comme une tonnille de Moulin avec une grosse roche par dessus en forme de Chaspeau ». On trouve également Forillon dans la Description générale des Costes de l'Amérique (1676) de Dassie, et sur la carte de 1744 de Nicolas Bellin. Suzelle Blais note dans Apport de la toponymie ancienne... (1983) que forillon semble être entré en français par le portugais farilhaom (farilhom) lui-même emprunté de l'italien faraglioni, mot ayant le sens de rocher, écueil dans la mer.
Supplément : Parc national Forillon
Toponymie SIA SIA-QC-Topo+
Sur cette photo de Cap Gaspé en 1969, on aperçoit (flèche blanche) la base du petit forillon décrit par Champlain comme étant « esloigné de la terre d’un jet de pierre » dont il ne reste aujourd’hui que le socle.

(Source : Magazine Gaspésie, avril 2017)
Fortin Mont En 1971, la Commission de géographie avait conclu que le nom du mont rappellerait possiblement la mémoire de Pierre Fortin, député de la circonscription électorale de Gaspé en 1867, commissaire des Terres de la Couronne de 1873 à 1874 et fondateur de la Société de géographie de Québec. Toutefois, une recherche effectuée en 1982 révèle que le nom de ce mont fut attribué par J. Franklin Collins et Merritt Lyndon Fernald, lors de leur expédition en 1922, en l'honneur de l'un de leurs guides Joseph Fortin. Le toponyme Mont Fortin est attesté sur une carte depuis 1954.
Habitat floristique (carte)
Cet habitat floristique correspond aux corniches, aux parois et aux colluvions des falaises schisteuses colonisées par une végétation gazonnante, sur les versants abrupts du mont Fortin. D’une superficie de 0,90 hectare, il se trouve sur des terres publiques vouées à la conservation, à l’intérieur de la réserve écologique Fernald et à environ 100 mètres au nord de l’habitat floristique du Mont-Matawees. Il vise la protection d’une plante herbacée vivace, le séneçon fausse-cymbalaire, une espèce très rare que la petitesse de ses populations rend vulnérable à toute perturbation.
Fort Péninsule Fort Lors de la Deuxième Guerre mondiale, une batterie fixe équipée de deux canons de 4,7 pouces et de quatre projecteurs de 60 pouces fut construite sur la Péninsule de Gaspé. Il y avait une quinzaine de bâtisses tenant lieu
SIA-QC-Topo+
Toponymie SIA
de dortoir avec un carré des officiers, un hôpital, une clinique dentaire, un garage, un atelier, une station de pompage, un réservoir d'eau, un édifice administratif, un poste de garde, un poste d'infanterie, une unité d'artillerie légère qui défend l'installation et un détachement de la troupe C de la 105e Batterie côtière.
Ils assuraient la protection et le maniement de la batterie côtière en cas d'attaques terrestres, aériennes, et navales. Il y avait jusqu'à 220 militaires qui ont commencé les opérations en 1940 jusqu'en octobre 1944.

Supplément : Fort Péninsule
Fougères, des Mont Son nom indique que le flanc sud-est du mont est recouvert de champs de fougères à plusieurs endroits. Le sentier offre d'ailleurs un superbe point de vue sur le mont à partir d'un champ de fougères.
GGaspé Ville Au fond de la célèbre baie de Gaspé, et à la pointe de la péninsule gaspésienne, se niche la ville de Gaspé, au passé si glorieux. Jacques Cartier y planta une croix lors de son premier voyage le 24 juillet 1534, évènement commémoré par un monument composé de six stèles de fonte.
La peuplade que l'explorateur rencontre alors dénommait ce territoire Honguedo, toponyme que des études récentes font remonter à un mot micmac ayant pour sens « lieu de rassemblement ». Quant au nom Gaspé, il a suscité quelques hypothèses. Selon certains, il aurait été attribué au XVIe siècle par des pêcheurs basques espagnols qui voulaient rappeler une ville du royaume d'Aragon, mais cette théorie recueille peu de crédit. Il faudrait y voir, selon Miren Egaña Goya, un emprunt au basque geizpe, kerizpe, signifiant « abri », « lieu de
Toponymie SIA SIA-QC-Topo+
refuge ». D'autres croient que le prénom de l'explorateur portugais Gaspar de CorteReal, qui a exploré le Labrador en 1500, aurait été déformé en Gaspé. La version la plus répandue demeure sans doute celle du père Pacifique reposant sur la transposition française du micmac gespeg, qui se traduit par « bout », « fin » ou « extrémité », une allusion à la fin des terres, au Finistère (finis terrae). L'appellation Gaspay, qui a été utilisée à la fin du XVIe siècle par l'Anglais Richard Hakluyt dans sa traduction de la Cosmosgraphie de Jean Alfonse (1484-1544), publiée en 1600, devint courante au début du XVIIe siècle et a suscité maintes variantes graphiques comme Gachepé, Gachepay, Gaschepay, Gaspey, Gaspay, Gaspèche, Gapèche, etc.
Suppléments: Plan de destruction de Gaspé lors de la 2e guerre mondiale
Festival Musique du Bout du Monde
Gaspésie Parc national Le parc national de la Gaspésie, d'une superficie de 802 km², se divise en trois grandes unités physiographiques : les monts Chic-Chocs, les monts McGerrigle et la vallée de la rivière Sainte-Anne. Il s'y trouve des sommets culminant à plus de 1 000 m, donc parmi les plus élevés de l'Est du Canada, de hauts plateaux découverts dont la flore et la végétation sont à peu près semblables à celles que l'on rencontre au-delà du 60e parallèle et où on peut encore observer une harde de caribous.
Ces lieux attirent les scientifiques depuis plusieurs générations. Des dizaines de biologistes, botanistes, géologues, géographes et écologistes ont suivi les traces des géographes William Edmond Logan (1798-1875) et Alexander Murray (1810-1884), à qui on doit les premières désignations des principaux sommets du secteur, dans les années 1844 et 1845. En 1937, la création du parc national de la Gaspésie avait comme objectif de protéger la beauté panoramique du mont Albert, du mont de la Table et des monts McGerrigle. Il y avait aussi une volonté d'assurer la protection permanente du saumon de la rivière Sainte-Anne ainsi que du caribou et de promouvoir le développement touristique de la Gaspésie.
Suppléments: Histoire du parc de la Gaspésie et La Gaspésie
Gisant Lieu-dit Avec le temps, les forces de la mer ont sculpté sur le rivage le visage d’un profil humain, que les marées recouvrent deux fois par jour. Qui est cet homme pétrifié?

Un naufragé du Saint-Laurent ? Un monument divin à la mémoire des victimes de l’Empress of Ireland ? Un hommage à un prêtre martyr que les Amérindiens ont fait griller, à petit feu, pour prolonger la souffrance? Nul ne le sait.
Source : Journal La Presse

Toponymie SIA SIA-QC-Topo+
Grande Anse Lieu-dit On dit qu’un coffre aurait été enfoui dans la Grande Anse suite à un naufrage survenu sous le Régime français. Un habitant de L’Échouerie, Ovide Cloutier, croyait fermement à cette légende. Il en avait parlé au curé Riou, qui aimait jouer des tours. Celui-ci alla jeter de menues monnaies à l’endroit où des fouilles avaient commencé. Ovide trouva ces pièces et en fit part au curé. Ce dernier s’entendit alors avec Baptiste Francoeur pour qu’un soir, alors qu’il serait sur les lieux avec Ovide, Baptiste se présente devant eux comme un fantôme.
De fait, à l’heure convenue, vers minuit, ils virent venir à eux un homme sans tête qui n’était autre que Baptiste coiffé de son veston… Ovide, livide de peur, devint obsédé par l’esprit de trésor et l’abbé Riou lui suggéra de faire bénir l’endroit par le curé Morris de Rivière-au-Renard. Ce qui fut fait. L’anse devint l’Anse au Trésor.
(Source : ‘Les plages et les grèves de la Gaspésie’ de Josée Kaltenback, ed. Fides )

Grande-Grave Lieu-dit Fréquenté dès le XVIIe siècle par quelques centaines de pêcheurs saisonniers, cet endroit, très propice à la pêche à la morue, fut choisi par les frères Francis et Philip Janvrin, originaires de l'île de Jersey, pour y installer un établissement de pêche à la fin du XVIIIe siècle. Provenant du bas latin grava, sable, gravier, le nom de GrandeGrave fut d'abord utilisé pour identifier la grande plage de galets où l'on faisait sécher la morue. Le nom s'est ensuite étendu pour désigner l'ensemble des équipements reliés à la pêche et à l'habitation.
À la même époque, on trouvait également le nom de Grande-Grève qui a longtemps prévalu par la suite. Un bureau de poste répondant à ce nom y a été ouvert en 1852 – probablement en même temps que la mission de Saint-Augustin qui comptait vingt familles canadiennes en 1863 – et a perduré jusqu'en 1969, l'année précédant la création du parc national de Forillon qui entraîna le déplacement de la population.
Selon Maxime St-Amour dans son guide du Parc national de Forillon (1984), deux hypothèses expliqueraient ce glissement : « une idée maladroite de vouloir franciser un terme qui pourtant n'en a pas besoin » ou « on a voulu bien écrire en français le nom tel que prononcé à l'anglaise, le mot grave en anglais se prononçant grève ».
Supplément: Une toponymie maritime
Toponymie SIA SIA-QC-Topo+
Grand-Étang Étang A la fin du XVIIe siècle, on chercha à utiliser des matériaux de construction incombustibles car les incendies ravageaient souvent les constructions en bois ou de chaume de la colonie française. En 1728, on ouvrit une carrière d’ardoise à Grand-Étang. L’ardoise était extraite et utilisée dans plusieurs constructions à Québec et Montréal. L’aventure se termina en 1733; l’ardoise coûtait très cher à extraire; elle se cassait lorsqu’elle était gelée et se brisait souvent lorsqu’on la perçait.
(Source : ‘Les plages et les grèves de la Gaspésie’ de Josée Kaltenback, ed. Fides)
Grande-Vallée Village Grande-Vallée est un toponyme ancien, car il a d'abord été attribué à la seigneurie concédée par le gouverneur général Frontenac, en 1691, à François Hazeur sous l'appellation La Grande-Vallée-des-Monts, et probablement tiré de celui de la rivière. Le cartographe Nicolas Bellin le fait également figurer sur une carte de 1744. Au cours des siècles, ce nom de lieu a subi quelques modifications tant en anglais, « Gt Valley », qu'en français, Grand Vallée. La majorité des commentateurs s'accordent à affirmer que c'est la présence d'une large vallée très fertile formée par la rivière qui a suscité cette dénomination. Grande-Vallée s'oppose à Petite-Vallée, plus à l'est, vallée qui ne dépasse guère la dimension d'une anse.
La région est fréquentée avec le XVIIe siècle par les Micmacs. On a également découvert une hache ayant appartenu aux Iroquoiens du Saint-Laurent. En 1691, Louis de Buade, comte de Frontenac, gouverneur de la Nouvelle-France, concéda la seigneurie de Grande-Vallée-des-Monts-Notre-Dame à François Hazeur, un riche marchand de Québec. Celle-ci s'étendait alors jusqu’à la seigneurie de la Rivière-Magdeleine à l'ouest, et à l'est jusqu’à celle de l'anse de l'étang (portage Saint-Hélier). À sa mort, François Hazeur donna comme héritage la seigneurie de Grande-Vallée-des-Monts à Michel Sarazin, chirurgien du roi, marié à sa fille. En septembre 1758, les troupes de Wolfe capturèrent un Français à Grande-Vallée. C'est la déportation de la Gaspésie.
Gros-Morne Village
La dénomination historique de Gros-Morne était cependant Grand-Male (1728), écrit aussi Masle, Mâle, et GrosMale (1758). Ce mot faisait allusion à la montagne qui s'avance sur le rivage dans la direction du Saint-Laurent.
Du point de vue linguistique, le mot male appartient au radical préroman mâl signifiant éminence rocheuse. Vers la fin du XIXe siècle, on a déformé localement le toponyme, surtout en Gros-Mâle parce que l'appellation historique déplaisait aux résidents du lieu. Le mot morne, un terme des Antilles tiré de l'espagnol morro, monticule, rocher, remonte à un radical préroman murr, au sens d'éminence.
Le terme a été introduit en Nouvelle-France par les explorateurs. En 1754, Chaussegros de Léry mentionne dans son journal le toponyme Gros Morne Pellé, au lac Érié.
Toponymie SIA SIA-QC-Topo+
H
Hélène Chute
Toponymie SIA
Le nom, utilisé depuis 1980 ou avant, réfère à une femme alpiniste probablement, qui fut la première à se rendre à cette chute du ruisseau Mem, en juillet 1974, accompagnant un prospecteur de la compagnie Imperial Oil.
Jacques-Cartier Mont
Le mont Jacques-Cartier domine le massif des Chic-Chocs et trône précisément dans la partie occidentale des monts McGerrigle. Sa faible étendue d'environ 1 km, tant en longueur qu'en largeur, est toutefois compensée par son altitude de 1270 m, l'une des plus fortes du Québec. Sur les flancs de cette importante montagne en forme de dôme où fleurissent des spécimens de plantes rares, s'étage une végétation boréale, subarctique et alpine qu'une équipe de botanistes américains a étudiée en 1923. Avant sa dénomination actuelle, on désignait d'ailleurs cette montagne sous le nom Botanist's Dome ou Pic des Botanistes. Des sentiers d'interprétation de la nature ont été par la suite aménagés jusqu'au sommet, où une tour de radiocommunication a été installée pendant la Deuxième Guerre mondiale.

Sur une proposition de la Commission de géographie du Canada, on adopta ce toponyme le 7 mai 1934 pour souligner le 400e anniversaire de la venue au Canada de Jacques Cartier. Compagnon probable de Verrazzano en Amérique, en 1524 et 1528, Cartier s'aventura au Nouveau Monde en 1534, chargé par François Ier de trouver de l'or et un passage vers l'Asie.
Au cours de ce premier voyage il ne dépassa pas l'île d'Anticosti, explora la baie des Chaleurs et le golfe du SaintLaurent. Lors de son second voyage en 1535, au cours duquel il se rendit jusqu'à Hochelaga (Montréal), il hiverna à Stadaconé (Québec). Le 15 août, après avoir laissé la pointe ouest de l'île d'Anticosti, il eut connaissance de terres qui demeuraient « devers le su qui est une terre a haultes montaignes à merveilles », ces terres hautes étant celles qui plongent dans la mer alentour des monts Saint-Louis et Saint-Pierre.
En 1541, Cartier, sous les ordres de Roberval, établit la première colonie française en Amérique. Il se fixa sur la rive gauche, à l'embouchure de la rivière du Cap Rouge, où il construisit deux forts communiquant entre eux, l'un au bas du promontoire, l'autre au-dessus. Il se rendit une deuxième fois à Hochelaga, puis revint à Cap-Rouge où il passa l'hiver.
Lorsque Jacques Cartier quitta la colonie au début du mois de juin 1542, Roberval était en route pour le Canada depuis le milieu d'avril. Les deux hommes

SIA-QC-Topo+
J
se rencontrèrent à Terre-Neuve à la mi-juin. Invité par Roberval à le suivre à Cap-Rouge, Cartier le délaissa et quitta Terre-Neuve durant la nuit du 18 au 19 juin et arriva à Saint-Malo au début de septembre. En France, Cartier dut reconnaître que son or trouvé au Canada était de la pyrite de fer et ses diamants, du quartz ou du mica.
Suppléments: Géologie Mont Jacques-Cartier et Enigme du radar 2e guerre mondiale
Le pergélisol du mont Jacques-Cartier est en voie de disparition (Le Devoir)
Jacques-Ferron Mont La présence dans cette partie du Québec du nom de Jacques Ferron (1921-1985), médecin et écrivain né à Louiseville, s'explique par le fait qu'il a pratiqué la médecine à SainteMadeleine-de-la-Rivière-Madeleine de 1946 à 1948 avant d'installer son cabinet au sud de Montréal. Pamphlétaire, humoriste mordant et ironique, il a produit une œuvre littéraire abondante et dans de nombreux genres : théâtre, conte, roman, autobiographie, histoire, essai. Récipiendaire du Prix du Gouverneur général en 1962 et des prix France-Québec et Duvernay en 1972, Jacques Ferron obtenait, en 1977, le prix David couronnant l'ensemble de son œuvre.

Jean-Yves Bérubé Mont Depuis 2002, ce nom évoque le souvenir de Jean-Yves Bérubé, fondateur de plusieurs sociétés et organismes de cette région, dont la Société Boisbuisson avec Jimmy Russell (prospection minière de 1963 à 1983 dans les monts Chic-Chocs et McGerrigle, qui mena à la découverte du gisement de cuivre qui fut exploité par les Mines Madeleine et qui favorisa l'économie de Saint-Anne-des-Monts);
-Héli-Ski Gaspésie dans les monts Chic-Chocs de (1985 à 1990);
-la Corporation de la Ligue navale de Cap-Chat (1972 à 1996) qui développa un camp d'été de cadets dans le village fermé de Saint-Octave-de-l'Avenir;
-le festival folklorique de Sainte-Octave-de-l'Avenir (1975 à 1978).
Jean-Yves Bérubé fut maire de Cap-Chat de 1993 à 1996. Il est né à Cap-Chat en 1928 et il est décédé le 11 décembre 1996.
Toponymie SIA SIA-QC-Topo+
Jimmy-Russell Mont Depuis 2002, ce nom évoque le souvenir de James-Gordon Russell, appelé familièrement Jimmy Russell, le président-gérant de la compagnie « James Richardson Co. Ltd » de Cap-Chat de 1934 à 1976. À 36 ans, il a succédé à son père John Stewart (Johnie) Russell, dans cette compagnie fondée par le géologue à la retraite James Richardson (le même que le « Mont Richardson ») en 1878 pour son gendre, James Russell, originaire d'Écosse. La J. R. Co. possédait plusieurs moulins à bois et avait fait l'acquisition de concessions forestières sur le territoire de l'actuelle réserve faunique de Matane et dans plusieurs cantons entre Matane et Cap-Chat. Le rappelé a contribué au développement économique de sa région par son ambition de faire de Cap-Chat un centre important (entre 1934 et 1965, la population y a presque triplé). La compagnie fut la plus grosse industrie en Gaspésie dans les années cinquante. Elle ferma en 1976. Né probablement à Matane, le 16 août 1900, Jimmy Russell est décédé à Cap-Chat, où il a passé sa vie, en février 1981.
Coupe forestière automne 2022. (Vue du Mont-Blanc)
John-A.-Allen (Arthur-Allen) Mont Son nom rappelle le souvenir de John Alpheus Allen (1863-1916), dit John A. Allen, botaniste américain. En 1881 et 1882, il a participé à des expéditions en Gaspésie, notamment sur le territoire de ce qui est, de nos jours, le parc national de la Gaspésie, pour effectuer des recherches sur la botanique de l'endroit. En 1883, il a publié l'ouvrage intitulé Alpine flora of the province of Quebec; publication qui a suscité l'attention d'autres prestigieux botanistes. Le nom est Arthur-Allen sur les cartes.
Joseph-Fortin Mont Ce nom a été proposé par l'Administration du parc de la Gaspésie. « Né à Sainte-Anne-des-Monts, il fut coureur de bois et guide de montagne pour l'ensemble du territoire du parc. Il a participé aux expéditions de Fernald en 1905 et 1906 et 1923. On dit qu'il avait une facilité à herboriser et à assimiler les noms latins des plantes. Ce nom a été proposé pour mettre en évidence les efforts d'un authentique guide de montagne. Il est mort le 30 mai 1960 »
Kempt Chemin, Parc éolien
Avant que la mission ne soit fondée, le territoire de Sainte-Marguerite était connu sous le nom de Kempt Road, rappelant l'ancien chemin militaire Kempt qui permit la colonisation de la vallée de la Matapédia qui fut construit en 1830 par le gouverneur James Kempt
Source : Héritage Chemin Kempt

SIA-QC-Topo+
Toponymie SIA
Photo : Eddy Pellerin
KL
La Longue Pointe Lieu-dit La Longue Pointe est une sorte de péninsule s’avançant dans le fleuve. Cette langue de terre où est situé aujourd’hui le Théâtre de la Vieille Forge, est habitée depuis les années 1860. Régis Roy et sa femme Émilie Brochu sont les premiers à y installer leurs pénates. Leur gendre Narcisse LeBreux s’y fixera avec sa famille en 1877.

L’Anse-au-Griffon Lieu-dit Le nom « rivière au Griffon » apparait dans la liste des concessions en seigneuries de la Nouvelle-France en 1636. Le nom de l’anse au Griffon apparait en 1652 dans le titre de la concession de la seigneurie du Cap-des-Rosiers (sic) et noté sur la carte de Jean-Baptiste Franquelin (1685). Le secteur est habité vers la fin du 18e siècle.
Les formes « Griffin » (simple traduction de Griffon) et « Gris-Fond » font leur apparition vers la fin du 18e siècle. On expliquait alors le toponyme par allusion au ton gris du fond marin. On a aussi souvent publié que le nom viendrait du nom d’un bateau « Le Griffon » qui aurait fait du cabotage à cet endroit.

Toutefois, si on regarde attentivement les dates précitées, on s’aperçoit que ces interprétations seraient fausses. La rivière portait ce nom avant l’anse et avant l’habitation par des pêcheurs et donc avant qu’un bateau vienne faire du ravitaillement.
Le nom se rapporterait peut-être plutôt à la présence d’un rapace (ex. Balbuzard pêcheur) actif à l’embouchure de la rivière comme cela se voit encore de nos jours. À ce moment, on nommait possiblement ce rapace « griffon » en faisant référence à cet animal chimérique ailé à tête d’oiseau de proie et aux serres impressionnantes, qui servait souvent à l’époque d’élément figuratif dans les armoiries ainsi que sur la proue de bateaux.
(Source : Magazine Gaspésie, avril-juillet 2017)
L'Anse-à-Valleau Village La dénomination Anse à Valleau a d'abord identifié le rentrant de côte de l'endroit. Une tradition orale ininterrompue fait remonter ce nom de lieu à Pierre Valleau - patronyme orthographié plus rarement Vallot, Valo, Vallo, Valeau - habitant de Percé à la fin du XVIIe siècle.
Toponymie SIA SIA-QC-Topo+
L'Anse Pleureuse Village Cette dénomination remonte au moins au début du XIXe siècle puisqu'une carte hydrographique de 1837 indique « Pleureuse Pt. », à l'est du ruisseau des Olives. Les auteurs attribuent une origine légendaire à ce toponyme : les premiers colons, entendant des pleurs et des plaintes sortir de la forêt les ont imputés aux âmes, aux revenants ou aux fantômes. Plus prosaïquement, le bruit des branches d'arbres agitées par le vent expliquerait ce nom géographique.
Logan Mont Le mont Logan constitue, en quelque sorte, une tour de garde du parc de conservation de la Gaspésie puisqu'il en est la limite ouest. Avec les monts Albert, Jacques-Cartier, McGerrigle et de nombreux autres, il fait partie du haut plateau étroit, aligné parallèlement au SaintLaurent, que l'on appelle Monts Chic-Chocs. S'élevant davantage comme une paroi rocheuse du côté nord, le mont Logan s'étire en douceur sur son versant sud d'où tirent leur origine, de part et d'autre, le ruisseau Ouellet et la rivière Cap-Chat Est qui alimentent la rivière Cap-Chat.

C'est par cette rivière d'ailleurs qu'Alexander Murray (géologue et explorateur) et William Edmond Logan parviendront au mont qui prendra plus tard le nom de ce dernier, bien contre son gré, dit-on. Cette expédition, menée au cours de l'été 1844, faisait partie d'une campagne de prospection visant la découverte de charbon, cette précieuse ressource minérale de l'époque. Celle-ci fut toutefois vaine sur ce plan mais contribua à compiler plusieurs données topographiques et géologiques utiles.
Attribué en 1898 dans le premier rapport de la Commission de géographie du Canada, l'usage du nom Mont Logan courait déjà depuis longtemps pour identifier ce mont de la Gaspésie. Taché l'avait d'ailleurs inscrit en 1870 sur sa carte.
Géologue et cartographe autodidacte, sir William Edmond Logan marquera l'histoire de la géologie du Canada après avoir contribué grandement à celle du Pays de Galles en Grande-Bretagne. Parti à 16 ans pour étudier à Édimbourg, il s'inscrit en médecine mais abandonne ses études après la première année. Il deviendra comptable au service de son oncle, Hart Logan, dont les affaires évoluent dans les secteurs de l'exploitation minière et des

SIA-QC-Topo+
Toponymie SIA
L’Anse-Pleureuse, 1927
Habitat floristique (carte)
Toponymie SIA
matériaux de construction dont la pierre. Le domaine l'intéresse suffisamment pour y rester vingt ans au cours desquels il développe ses talents de dessinateur, cartographe et géologue, talents qui furent reconnus par son élection en 1837 à la Geological Society of London.
En 1842, il revient à Montréal pour combler le poste de géologue de la province du Canada – correspondant aux parties sud des provinces actuelles du Québec et de l'Ontario – dont la tâche principale sera d'organiser et de diriger la Commission géologique du Canada, poste qu'il occupera jusqu'en 1869. En 1863, il publie son important ouvrage de référence Geology of Canada, essentiel encore aujourd'hui pour les géologues. L'atlas de cartes géologiques qui s'ensuivit et sa contribution au développement de cette science au Canada lui valent, en 1867, la médaille d'or royale décernée par la Royal Society of London. Onze années plus tôt, il avait été fait chevalier par la reine Victoria.
Suppléments: Mont Logan
Vidéo : Mont Logan (Productions Les Krinkés)
Cet habitat floristique de 163,80 ha a été créé afin de protéger l'Arnica de Griscom et l'Athyrie alpestre. L'habitat floristique se situe sur les pentes nord-est du mont Logan et les pentes nord-ouest du mont Griscom dans le parc national de la Gaspésie. À 1 150 m d'altitude, le mont Logan constitue une tour de garde du parc puisqu'il en est la limite ouest. Son nom rappelle William Edmond Logan, qui explore cette région au cours de l'été 1844, en compagnie d'Alexander Murray. Géologue et cartographe autodidacte né à Montréal en 1798, Logan marquera l'histoire de la géologie du Canada.

SIA-QC-Topo+
Louis-Marie Lalonde Mont
Le nom de Louis-Marie Lalonde a été proposé par l'Administration du parc de la Gaspésie pour honorer le premier botaniste canadien-français à herboriser dans la région du mont Logan. Il est né le 16 octobre 1896, mort en 1978. Professeur à l'Institut d'Oka, il fonde en 1926 la Revue d'Oka. Il rédige plusieurs écrits scientifiques en botanique. En 1962, il cède à la Faculté d'agriculture de l'Université Laval son herbier de 100 000 spécimens. Il a herborisé à 2 reprises dans la région du mont Logan.


Loupes, des Mont
Ce nom a été proposé par l'Administration du parc de la Gaspésie. Les loupes sont des excroissances ligneuses ayant une structure très contorsionnée et se présentant le plus souvent sur le tronc d'un arbre. Le sentier qui parcourt le mont permet d'observer plusieurs épinettes en possédant.

Manche d'Epée Village

Ce nom a d'abord été attribué au ruisseau sur le bord duquel on avait trouvé un pommeau d'épée. On raconte que René Pelchat, postillon originaire de Beaumont, avait fait cette découverte sur la pointe est du ruisseau, vers 1850. Le ruisseau de Manche-d'Épée coule sur une distance de 7,5 km, jusqu'au hameau situé à son embouchure.
Réserve écologique
Ce territoire de quelque 460 ha a été constitué en réserve écologique par décret, le 11 avril 1984.
Sa création visait notamment à protéger une érablière à bouleau jaune sise dans un territoire caractérisé par de hauts plateaux. Son sous-sol est marqué par la présence de roches appartenant à l'ordovicien moyen et supérieur et composées de calcaire, d'ardoise et de schiste.
Toponymie SIA SIA-QC-Topo+
M
Sur chacun des flancs rocheux dévalent de petits cours d'eau soit, à l'est, la coulée à Stanislas et, à l'ouest, les coulées à Édouard et de la Sucrerie, la Grande Cavée et la décharge du Lac à Raphaël.
Supplément: Réserve écologique de Manche-d’Épée
Matane Ville, rivière, lac Comme pour bon nombre de toponymes autochtones, le nom Matane suscite certaines interprétations divergentes. Ce qui fait l'unanimité, c'est que la rivière a d'abord reçu ce nom de Champlain en 1603, sous la forme Mantanne. Selon la version la plus communément admise, il faudrait considérer qu'il s'agit du micmac mtctan, « vivier de castor », d'autant que selon des sources anciennes le castor, là aussi, y abondait autrefois. D'autres personnes croient, suivant le témoignage d'un Autochtone, qu'il faut y voir le sens, en malécite, de « moelle épinière à travers les vertèbres de l'épine dorsale », interprétation qui s'appuie sur le fait que la rivière Matane descend des terres, entre des collines et des montagnes, sans rapides, sur une distance appréciable. D'autres rapprochent ce mot de mattawa, matawin, signifiant « rencontre des eaux ». Le père Guinard, pour sa part, y voit l'abréviation de matandipives, c'est-à-dire « épaves », « débris de navire », sens justifié par les particularités du courant en face de Matane.
Située sur la rive sud du Saint-Laurent à 400 km de Québec, à 64 km de Sainte-Flavie, à l'entrée de la Gaspésie, positionnement qui lui a valu le titre de Porte de la Gaspésie, Matane a été créée en 1893. D'abord identifiée comme village de Saint-Jérôme-de-Matane, tiré du nom de la paroisse établie officiellement en 1861, mais remontant au XVIIe siècle, la ville a reçu son appellation et son statut actuels en 1937. L'élément Jérôme faisait allusion à l'abbé Jérôme Demers (1774-1853), vicaire général de Québec (1825-1853). L'endroit recèle un riche passé puisqu'il a été fréquenté par Cartier, Jean Alfonse, Champlain, et que des Blancs s'y sont installés en 1795, quoique des Micmacs y aient vécu jusqu'en 1845. Il faut également compter avec la présence des Rochelais de 1534 à 1672 qui y ont exercé des activités de pêche. Chaque année, « ce lieu assez gentil » (Samuel de Champlain) est le théâtre du Festival de la crevette.
Matapédia Ville Ce toponyme descriptif provient du mot micmac matapegiag, qui signifie rivière qui fait fourche, jonction de rivières. Il traduit la situation géographique des lieux où la Matapédia se jette dans la Ristigouche. Les formants mata, jonction et pegiag, rivière rendent bien compte de ce phénomène. On a également avancé les sens de rivière musicale et de volume d'eau qui descend d'une grande mare, mais ces interprétations ne résistent pas à l'analyse. Le toponyme Matapédia a aussi été mentionné sous la graphie Matapediach, Matapeguia, Matapediac dans des documents du XVIIe siècle, et ultérieurement Matakpediack ou Madapeguia.
C'est en ces lieux que la colonisation de la vallée de la Matapédia a débuté avec l'arrivée successive des Loyalistes - étiquetés comme des squatters (1808) -, des Irlandais (1850), des Acadiens (1860) et des Canadiens français (1865). L'importance, pour les Matapédiens, de la rivière Matapédia qui divise le village en deux, se mesure à la réputation de dimension internationale de rivière à saumon qu'elle partage avec la Ristigouche. D'ailleurs les plaques d'identification des rues du village épousent la forme d'un saumon, transposition visuelle de cette
Toponymie SIA SIA-QC-Topo+
considérable et précieuse richesse locale. Pour protéger la richesse en saumon de la rivière, le gouvernement a établi une réserve faunique sur une partie de son cours, la Réserve faunique de la Rivière-Matapédia.
L’Église Saint-Laurent a été construite en 1902 et 1903 par l'architecte Joseph Doucet. De style éclectique elle est l'un des plus vieux lieux de culte de la région. Elle a été citée immeuble patrimonial en 2005 par la municipalité de Matapédia. (Source : Wikipedia)
Rivière D'une longueur d'environ 80 km, la rivière Matapédia est orientée sud-sud-est et coule dans la vallée du même nom qui traverse les Appalaches. Elle s'alimente au lac Matapédia situé à 25 km au sud du Saint-Laurent, ainsi qu'aux rivières Causapscal et Assemetquagan sur sa rive gauche et aux rivières Humqui, Milnikek et du Moulin sur sa rive droite. Elle est encadrée par un relief se situant autour de 425 m et pouvant atteindre des sommets de 640 m à l'est de Causapscal et même de 960 m à l'ouest du lac Matapédia.
Une bonne partie de la rivière est située dans la réserve faunique des Rivières-Matapédia-et-Patapédia. La rivière est réputée pour la pêche aux saumons grâce à ses 138 fosses et rapides. En effet, c'est entre 3 000 et 5 000 saumons qui remontent la rivière Matapédia annuellement.
Matawees Mont
Matawees, nom de langue micmaque signifiant porc-épic, a été attribué par le géologue William E. Logan en 1844. Cet explorateur écrit en effet: « une autre montagne, à laquelle nous donnâmes le nom de Mattaouisse mot qui, en micmâc, signifie un porc-épic, par la raison que nous avions tué un de ces animaux ».
Habitat floristique (carte)
Cet habitat floristique correspond aux arêtes, aux ravins et aux corniches des falaises schisteuses du mont Matawees. D’une superficie de 26,41 hectares, il se trouve sur des terres publiques vouées à la conservation, à l’intérieur de la réserve écologique Fernald et à environ 100 mètres au sud de l’habitat floristique du Mont-Fortin. L’habitat est difficile d’accès, ce qui facilite la protection d’une plante herbacée vivace, l’Arnica de Griscom, une espèce endémique du golfe du Saint-Laurent.
McGerrigle Chaîne des Monts
Les monts McGerrigle, constituants des monts Chic-Chocs, couvrent une superficie approximative de 100 km² à la limite ouest de Murdochville, dans le nord-est de la Gaspésie. Ces élévations, dominées par le mont JacquesCartier à 1 268 m, forment le plus haut massif montagneux de cette partie de l'est du Canada. Appelé autrefois Tabletop, le massif porte officiellement son nom actuel depuis 1965, en l'honneur du géologue Harold William McGerrigle (1904-1970).
Né à Ormstown, en Montérégie, le géologue McGerrigle a acquis sa formation aux Universités McGill (Montréal) et Princeton (New Jersey). Durant sa carrière au service du gouvernement du Québec, de 1937 à 1970, McGerrigle a occupé, notamment, le poste de directeur du Service de l'exploration géologique et a effectué, principalement de 1939 à 1959, d'importants travaux couvrant la péninsule gaspésienne. Il a été membre de la Société royale du
SIA-QC-Topo+
Toponymie SIA
Canada, de l'Association géologique du Canada et de l'Institut canadien des mines et de la métallurgie. Il est décédé à Québec, le 9 novembre 1970.
Mem Ruisseau Utilisé depuis 1946 ou avant, le nom désignait le cours d'eau partant des lacs Coleman et Bardey et se jetant dans la rivière Cap-Chat. Maintenant, il identifie la section amont de l'ancien ruisseau Mem, jusqu'à sa rencontre avec le ruisseau Bascon. Le nom pourrait être une déformation du mot anglais « men » signifiant « hommes », qui faisait référence aux hommes travaillant dans les chantiers forestiers.
Milieu, du Mont Le mont du Milieu est situé à égale distance entre le mont Jacques-Cartier à l'extrême est et le mont Logan à l'extrême ouest. Il offre un magnifique point de vue d'où l'on peut voir clairement les monts Jacques-Cartier et Logan. On a donc vraiment l'impression d'être au milieu du parc.
Moise, à Table Plateau gaspésien des monts Chic-Chocs correspondant au sommet du mont Albert, il couvre l'espace compris entre le sommet Albert Nord et le sommet Albert Sud. Le plateau épouse grossièrement la forme d'une graine de haricot dont les extrémités seraient distantes de quelque 5,5 km. Son altitude absolue moyenne est de 1 086 m. La géologie de la Table à Moïse consiste en un plateau de serpentine à bords escarpés et encerclé par un anneau d'amphibolite. On y retrouve des tourbières qui se développent dans des cuvettes et un réseau de petits lacs reliés par de minuscules cours d'eau. En pleine zone de végétation boréale, la Table à Moïse forme un îlot de toundra.
Dans l'Annuaire du Québec de 1974, l'écologiste Pierre Dansereau décrivait les lieux en ces termes : «Les pavés secs de la serpentine ont leurs interstices comblés par une floration abondante d'arméries, lychnis, stellaires, saxifrages, cependant que les arbustes rampants, rhododendrons, saules et bouleaux nains, tendent à disloquer davantage les pierres. Ce milieu s'enrichit là où le drainage est moins bon, où le sol est plus profond, tant et si bien que des bleuets nains dominent et forment une toundra assez dense, souvent revêtue d'un tapis de mousse brune et laineuse. La végétation la plus luxuriante toutefois est représentée par une pelouse de laîches, très verdoyante, constellée de fleurs à couleurs claires (arnica, véronique, campanule). Les éboulis rocheux et les affleurements abritent des fougères, des lycopodes, des bruyères dans leurs interstices.»
Le nom Table à Moïse apparaît dans un article du quotidien Le Soleil de Québec de juin 1971, dans les propos d'un guide rapportés par le journaliste. L'origine est inconnue. Rien ne nous laisse supposer que ce toponyme a un rapport avec les Tables de la Loi que Iahvé a dictées à Moïse. La Commission de géographie a officialisé ce nom en 1975. Le terme table employé dans son acception géographique de sommet aplati, mentionnée dans les dictionnaires de la langue française, est rare dans la nomenclature géographique du Québec. Outre ce plateau, on connaît notamment la Table à Roland, nom qui désigne le sommet tabulaire du mont Sainte-Anne à Percé.
Montagne-deRoche, de la Habitat floristique (carte)
Cet habitat floristique correspond aux corniches et aux anfractuosités des falaises calcaires de la montagne de Roche, situées dans la péninsule de Forillon. D’une superficie de 58,77 hectares, il se trouve sur des terres publiques vouées à la conservation à l’intérieur du parc national de Forillon, un parc fédéral. Le site est difficile
Toponymie SIA SIA-QC-Topo+
Mont Saint-Pierre Réserve écologique
d’accès, ce qui facilite la protection d’une plante herbacée vivace, le Séneçon fausse-cymbalaire, une espèce très rare que la petitesse de ses populations rend vulnérable à toute perturbation.
Cette réserve écologique se situe dans une impressionnante vallée glaciaire, au cœur de la municipalité de MontSaint-Pierre, à l'est de la rivière du même nom. Elle couvre une superficie de 6 km² et son territoire est constitué d'un ensemble de reliefs montagneux, dont le mont François-Ouellet au sud, la montagne du Blond à l'ouest et le mont Alexis-Ouellet au nord. Ces trois noms rappellent le souvenir de pionniers locaux. Créée par décret le 17 janvier 2001, cette réserve écologique vise à protéger des formations géologiques hautement friables dominées par des schistes argileux, et plus spécifiquement la végétation qui en découle. De plus, ce territoire regroupe des sapinières à bouleau jaune et à bouleau blanc ainsi qu'un peuplement de thuya.
Supplément: Réserve écologique du Mont St-Pierre
Village Auparavant, l'endroit devenu une municipalité en 1947 se nommait « Rivière-àPierre » (ce qui explique la confusion engendrée à une certaine époque avec Rivière-à-Pierre, dans Portneuf), appellation qui figure sur une carte de Gédéon de Catalogne en 1723 « R. à Pierre » et sur un document cartographique de Pierre Russell en 1861, tandis que la forme Rivière Pierre orne une carte de Joseph Bouchette en 1815. L'élément Pierre provient sans doute des imposantes falaises rocheuses qui composent le paysage et du voisinage de Mont-Louis, quoique certains inclinent à penser qu'il puisse s'agir d'un prénom, la préposition à figurant fréquemment dans des toponymes à composantes anthroponymiques : Barachois à Montpetit, Côte à Gagnon, Lac à Armand. Les premiers habitants de Mont-Saint-Pierre s'installent en ces lieux en 1858, le territoire étant alors rattaché à MontLouis.
Mur des Patrouilleurs
Lieu-dit Le nom « Mur des Patrouilleurs » est en usage depuis le début des années 1990. Son nom lui fut attribué par des patrouilleurs du parc. Il identifie une paroi pentue de 30° à 45° donnant sur la vallée du Diable, sur l'un des flancs du mont Albert, très fréquenté par les amateurs de ski de descente.
Musard Ruisseau En souvenir de l'abbé Louis Musard, né en France en 1806, sulpicien, professeur au séminaire de Montréal en 1842. Ce toponyme a paru sur une carte manuscrite datée de 1963.

SIA-QC-Topo+
Toponymie SIA
Nicol-Albert Mont L'origine de ce toponyme demeure énigmatique. Durant l'été de 1844, William Logan et son assistant Alexander Murray sont les premiers à effectuer des explorations géologiques dans cette région. Gravissant péniblement le mont Nicol-Albert, Logan le baptise alors Bonhomme comme l'indique son rapport, « de l'existence d'une grosse pierre comme levée debout sur un gradin de son penchant, dans l'attitude d'un homme qui épierait ce qui se passerait au-dessous ». Les premières mentions écrites des toponymes « Nicol-Albert » et « Frère de Nicol-Albert » ont été fournies par le géologue Arthur Philemon Coleman. Le récit des explorations qu'il a menées en 1918 mentionne que les guides locaux identifient depuis toujours le Bonhomme de Logan sous l'appellation de Nicolabert – et non Nicol-Albert –. Nicol-Albert résulte peut-être de l'expression anglaise nick of Albert devenue Nicol Albert dans la bouche des guides. Le mot anglais nick signifie entaille et brèche ce qui correspond à la topographie locale, la rivière Cap-Chat séparant les deux monts par une gorge assez remarquable.
Supplément vidéo Nicol-Albert : La Gigue des recrues (Productions Les Krinkés)
Nid d'Aigle, du Mont Son nom rappelle qu'il y a des aigles dorés qui nidifient sur le mont, depuis au moins 1926.

Notre-Dame Monts Les monts Notre-Dame sont les collines appartenant à la chaîne des Appalaches qui s'étirent en aval de Québec, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent jusque sur la péninsule gaspésienne. Orientées parallèlement au fleuve, ces collines et plateaux ondulés atteignent souvent 600 à 700 mètres d'altitude.
Les monts Notre-Dame ont pour origine l'expédition de Jacques Cartier où il nota le 15 août 1535 : « Le landemain jour Notre Dame d'aoust XVe [...] eusmes congnoissance de terres qui nous demouroient vers le su qui est une terre à haultes montaignes à merveilles ». Il baptisa plutôt ces montagnes du nom de « haultes montaignes de Honguedo ». Le toponyme « monts Notre-Dame » fut cependant le toponyme qui s'implanta.
Source : Wikipedia
Appalaches Chic-Chocs Réserve Fernald Ste-Anne-des-Monts Mont-Logan
SIA-QC-Topo+ N
Toponymie SIA
O
Olivine Mont Ce nom a été proposé par l'Administration du parc de la Gaspésie. Il apparaît sur les cartes des géologues. Ce toponyme provient du fait qu'un chercheur trouva de l'olivine près du mont Albert. Ce gisement en forme de croissant s'étend sur une distance de 8 000 pieds (2 438m) sur une largeur maximale de 3 000 pieds (914m).
Passe, de la Mont Ce nom a été proposé par l'Administration du parc de la Gaspésie. Il serait possiblement utilisé depuis fort longtemps, par les Amérindiens. Cette région des monts McGerrigle étant très accidentée, il existerait à proximité de ce mont une ouverture où l'on peut franchir la chaîne de montagnes.
Penouille Hameau
Dans la première moitié du XVIIIe siècle, Pierre Revol, un marchand de Québec, avait construit un poste de commerce dans la presqu'île de Penouille puisque la baie offrait un abri sûr pour les navires de tout tonnage. Nombre de documents archivistiques et cartographiques de cette période mentionnent effectivement la présence de « Penouille ». Au fil des ans, ce toponyme est utilisé sous différentes graphies : « Penouille », « Pensuïlle », « Penouil », « Penisle », « Peninsuala », « Peninsula », « Peninsule ».

Quelques textes historiques, conservés aux Archives nationales de France, (fonds de la marine) et retracés par Jean Poirier, attestent de l'ancienneté du toponyme. Citons entre autres, cet extrait de 1732 : « quoyque cependant le meilleur mouillage est d'aller mouillé à 6 heures (sic) du soirdans le fond de la baye nommée penouille ».
Sur la carte de Laubenierre (1746) intitulée « Idée de la Baye de Gaspé », la localisation de Penouille est bien indiquée. La légende de cette carte présise : « ... La Baye de Gaspé a 2 lieues ½ environ de largeur prife du fourillon è l'Isle St-Pierre, elle n'en a qu'une et un quart a 2 lieues plus haut. Il y a en cet endroit une bature de sable et de gravier, qui vient du sud, et ne laisse pour chenail qu'un tiers de lieue. Il se forme au diffus de cette baye un bassin qu'on nomme Penouille, aiant ¾ de lieue en tous fens : des vx de toute grandeur y peuvent mouiller et ils y font en sureté de tout vent. La Baye fe partage ensuite en deux branches... »
En 1757, un cartographe inconnu signale la « Baye de Gaspé » et localise le « Banc de Penouil ». L'année suivante, le capitaine Bell, aide de camp du général Wolfe, trace une carte sur laquelle il situe la « Penisle », forme anglaise de « Penouille ».
Toponymie SIA SIA-QC-Topo+
P
Penouille, 1930
Après le passage des soldats anglais et la destruction des établissements de pêche français, John Collins, un arpenteur chargé par le nouveau gouvernement colonial de dresser une carte de la baie de Gaspé, appelle Penouille, « Peninsuala », qui deviendra par la suite « Peninsula ». Enfin, sur la sienne, en 1773, Lange inscrit « Fon de Penouille ». D'après l’historien Mario Mimeault, toutes les autres cartes du XIXe siècle reprennent le toponyme de l'arpenteur Collins pour identifier ce site de pêche à la baleine.
Quant à l'origine même du vocable « Penouille », elle provient, selon l’historien Pierre-Georges Roy, des pêcheurs basques, pour qui ce mot signifiait « péninsule ».
Perches, aux Mont Son nom rappelle qu'on avait fait deux chemins forestiers qui se rejoignaient au sommet pour y faire des opérations forestières et où des camps forestiers avaient été construits. Les draveurs de la rivière Matane allaient y couper des perches pour se confectionner des gaffes. Une tour de relais en télécommunications du ministère des Communications y a été en opération jusqu'en 1998 environ.
Petchedetz Mont Son nom rappelle que le mont se trouve près de la rivière Duvivier, qui s'appelait anciennement Rivière Petchedetz. L'usage de ce toponyme, dont on ne connaît pas la signification, est relativement ancien. Dans son rapport d'arpentage de 1862, J. A. Bradley donne à ce toponyme les formes Petcheditz et Pechedety. La Description des cantons arpentés... (1889) signale la forme actuelle Petchedetz dans le rapport de l'arpenteur C.-S. Lepage (1881) alors que l'édition anglaise de ce rapport d'arpentage emploie toujours la variante Petcheditz. On relève également la forme Petchedec, attribuée au lac ainsi qu'à la rivière, dans le Dictionnaire des rivières et lacs de la province de Québec du géographe Eugène Rouillard (1914).
Petite-Vallée Village Elle doit son nom descriptif à sa situation au creux d'une vallée peu étendue, à l'embouchure de la rivière de la Petite Vallée. Quoique l'érection municipale ne remonte qu'à 1957, la dénomination Petite-Vallée figure déjà sur une carte de Nicolas Bellin de 1754 et sous la forme anglaise Little Valley dans un document de Sayer et Bennett en 1775, avant d'être attribuée au bureau de poste mis en service en 1885.
Supplément: Le Festival en chanson de Petite-Vallée
Pic Bleu Mont Son nom décrit la forme conique de son sommet et la couleur bleutée des épinettes qui s'y trouvent.
Pics, des Mont Le nom est utilisé localement depuis 1998, il décrit le « panorama exceptionnel que cette montagne offre sur les monts environnants ». Le mont, inclus dans l'ensemble plus vaste des monts Chic-Chocs, jouxte le lac des Pics et fait partie de quatre pics partant de la rivière Madeleine Nord et s'étendant vers l'est.
Pointe-à-la-Frégate Lieu-dit Cette pointe s'avance dans le fleuve Saint-Laurent en front du hameau de Pointe-à-la-Frégate. Son nom fait référence au naufrage d'une frégate anglaise, la Penelope, dans la nuit du 30 avril au 1er mai 1815.
Toponymie SIA SIA-QC-Topo+
Pointe aux Anglais
Pointe Son nom rappelle un événement historique, soit le naufrage d’une partie de la flotte de l’amiral britannique Hovenden Walker (vers 1656-vers 1725) au cours de la nuit du 22 au 23 août 1711. Ayant reçu l’ordre de s’emparer de Québec, celui-ci avait appareillé de Boston à la fin juillet avec une puissante armada convoyant 12 000 hommes. Or, une violente tempête s’est levée sur le fleuve Saint-Laurent dans la nuit du 22 au 23 août. Une partie de la flotte s’est alors écrasée sur les récifs de la pointe aux Anglais et à l’île aux Œufs, poussant Hovenden Walker à abandonner l’expédition. Près de 900 soldats et marins ont péri noyés au cours de cette nuit.
Pointe-à-laRenommée
Lieu-dit Le site historique Phare de Pointe-à-la-Renommée, construit en 1904 comme un phare et comme la station radiomaritime de Guglielmo Marconi, découvreur de la radio. Le site de Pointe-à-la-Renommée a été aménagé par des citoyens de L’Anse-à-Valleau en 1992, où les citoyens se sont données la mission de faire revivre Pointe-à-laRenommée et rapatrier son phare. Ils ont aménagé un circuit reconstituant la vie de l’époque où le site était un centre de communication essentiel entouré de trois postes de pêche : La Coulée-à-Zéphyr, Ruisseau-à-L’Air et Canne-de-Roches. Le phare a finalement été rapatrié en 1997, après vingt ans d’exil dans le vieux port de Québec. Aujourd’hui, on emprunte les sentiers su les caps d’où une magnifique vue panoramique s’ouvre sur la mer. On y voit souvent des baleines et des phoques.
Pointe du Wrack Lieu-dit Le poste de pêche de Manche d’Épée commence son existence lorsqu’un bateau s’échoue sur les plains, à portée de la vue de ses habitants. Selon un témoin de l’époque, c’est le 10 décembre 1867 que le Woodstock se brise sur une pointe rocheuse située à environ un kilomètre à l’ouest de la rivière. On imagine le choc que cette catastrophe provoque dans le hameau.
Par un hiver particulièrement rude, il s’agit du second échouement à survenir en moins d’une douzaine de jours sur la rive nord de la péninsule gaspésienne : le 30 novembre, un premier voilier appelé Swordfish s’est écrasé sous les caps à proximité de Grand-Masle le nom de Gros-Morne dans ce temps-là. Le matelot André Castagne, victime de graves engelures, nous a laissé un récit précis et saisissant de la tragédie intitulé Histoire d’un vieux marin. Le sort des rescapés de l’un et l’autre navire s’en trouve intimement lié. Toutefois, le drame du Woodstock révèle des zones d’ambiguïtés qui n’ont pas été élucidées.
(Source : lamedepierre.info)
Article complet
Premier lac des îles Habitat floristique (voir carte)
Cet habitat floristique de 6,31 ha a été créé afin de protéger l'Arnica de Griscom. Le nom de l'habitat qui se situe sur le territoire du parc national de la Gaspésie, fait référence au lac situé juste au sud, soit le Premier lac des îles. Ce lac, de forme irrégulière, renferme une douzaine d'îlots.
Toponymie SIA SIA-QC-Topo+
Restigouche Rivière La rivière Ristigouche, longue de plus de 200 km, naît au Nouveau-Brunswick, à 35 km au nord-est d'Edmundston. Elle coule d'abord vers le sud-est, puis vire abruptement au nord-est, servant de frontière entre le Québec et le Nouveau-Brunswick sur les 100 derniers kilomètres de son cours.
En juillet 1534, Jacques Cartier, explorant la baie des Chaleurs, se rend jusqu'à l'embouchure de la rivière Ristigouche qu'il ne nomme toutefois pas. Champlain, sur sa carte de 1632, donne à cette importante entité hydrographique le nom Rivière de Chaleu. Le père jésuite Barthélemy Vimont, dans sa Relation de 1642, ne parle pas non plus du cours d'eau, mais fait mention du nom Baie de Chaleurs qui désigne la baie appelée Restgoch par les Amérindiens des environs. Pierre-Emmanuel Jumeau indique, sur une carte de 1685, les noms R. S. Joseph et Richtigouch. La double désignation de Rivière Saint-Joseph, dite Ristigouche apparaît dans la Nouvelle Relation de la Gaspésie de Chrestien Le Clercq (1691). Une carte de Herman Moll (1715) indique ce cours d'eau sous la dénomination R. Sauveur. La graphie Ristigouche, employée notamment par Nicolas Denys (1672), monseigneur de Saint-Vallier (1688), Bellin (1744) et le père de La Brosse (1771), a la préférence des utilisateurs francophones, alors que les auteurs et cartographes d'expression anglaise optent plutôt pour la forme Restigouche, adoptée d'ailleurs par le Nouveau-Brunswick.
Le père Pacifique écrit, en 1927, dans Le pays des Micmacs que « Ce nom a été donné à la rivière et à toute la région par l'ancien chef Tonel (Tonnerre), en souvenir de l'extermination d'un parti d'Iroquois, dont il avait donné le signal par ce cri : Listo gotj, désobéis à ton père ». D'autres auteurs nous ont laissé des interprétations différentes du toponyme : « endroit pour amusement du printemps », « rivière de la longue guerre », « rivière divisée comme une main », « petit bois », « petit arbre », « théâtre de la grande querelle de l'écureuil », « rivière aux cinq doigts », « aux cinq branches », « aux branches nombreuses », « rivière bonne à canoter », « belle rivière » et « qui coule bien, sans obstruction ».
Supplément vidéo : Magnifique rivière Restigouche
Richardson Mont Cette appellation ancienne évoque le souvenir du géologue James Richardson (1810-1883), qui a fait des explorations dans la péninsule gaspésienne en 1858 pour la Commission géologique du Canada. Décédé à Matane, Richardson a contribué à l'avancement de la géologie, notamment par l'enrichissement de la collection de spécimens de minéraux et par l'introduction de la photographie, au service de l'exploration géologique. Ce nom paraît sur une carte géologique de 1925.

SIA-QC-Topo+ R
Toponymie SIA
Toponymie SIA SIA-QC-Topo+
Rivière-au-Renard Village Bâti autour d'une grande anse occupée par un barachois, était déjà connu au XVIIe siècle, peut-être même avant, comme poste de pêche saisonnier. Cet établissement, habité par une vingtaine de familles en 1836, fut desservi par voie de mission, de 1854 à 1858. De tout temps, la pêche a constitué la base de l'économie de Rivière-auRenard. Toutefois, parallèlement à cette activité, les habitants s'adonnaient aussi à l'agriculture. De nos jours, c'est encore la pêche qui est l'activité économique prépondérante de ce village qui emprunte son nom à la «Grande R. au Renard», déjà identifé ainsi durant la première moitié du XVIIIe siècle, comme l'attestent les cartes de Nicolas Bellin de 1744 et du sieur d'Anville de 1755.
Très utilisé dans la toponymie locale, le mot renard se retrouve également pour désigner la rivière, le village de Petite-Rivière-au-Renard, le hameau de Val-Renard et le secteur de Rivière-au-Renard-Ouest. Il évoque le renard roux, autrefois abondant dans la région. Coincidence remarquable, la rivière au Renard traverse le canton de Foxen français renard - érigé en 1842, dont le nom rappelle Charles James Fox, un lord anglais qui prit part à la discussion relative à l'Acte de Québec en 1774.
Supplément: La révolte des pêcheurs de 1909.
Rolland-Germain Mont Né en France en 1881, Rolland Germain arrive au Québec en 1905. Frère des Écoles chrétiennes, il enseigne au collège de Longueuil, où le frère Marie-Victorin le rencontrera. Excellent taxonomiste, il apprendra à ce dernier, à reconnaître les plantes qu'ils rapportent de leurs premières herborisations et l'initie aux méthodes scientifiques. Ils exploreront ensemble le Québec, du Témiscamingue aux îles de la Madeleine et de l'Abitibi aux Cantons-del'Est. On lui attribue une très grande contribution à la Flore laurentienne publiée par Marie-Victorin. Il étudia la flore outaouaise pendant son séjour comme professeur à Ottawa et compléta les notes de Marie-Victorin sur l'île d'Anticosti et la Minganie qu'il publia en 1969. Il est décédé en 1972.
S
Saint-Alban Mont Le nom Mont Saint-Alban serait issu de celui de la paroisse de Saint-Alban-de-Cap-des-Rosiers; celle-ci a été érigée canoniquement en 1872 et est située à environ 4 km au nord-ouest du relief. Saint Alban est un martyr du IIIe siècle, dont la fête est célébrée le 22 juin par les catholiques et le 17 juin par les anglicans.
Saint-Alexandredes-Lacs Village, paroisse Les municipalités de Saint-Tharcisius et de Saint-Benoît-Joseph-Labre ont toutes deux été amputées d'une partie de leur territoire, en 1965, pour former celle de Saint-Alexandre-des-Lacs. Établie comme mission en 1922, la communauté alexandrienne devait accéder au statut de paroisse lors de son érection canonique en 1965. L'endroit a reçu le nom de Saint-Alexandre, en l'honneur de l'abbé Alexandre Bouillon, né à Saint-Anaclet en 1873, de même qu'en souvenir d'Alexandre Courchesne, père de monseigneur Georges Courchesne, évêque de Rimouski. La présence de nombreux petits lacs qui parsèment cet espace et les alentours ne laisse aucune équivoque quant à la motivation du dernier constituant.
Saint-Anne-desMonts Ville
Les Annemontois habitent l'agglomération la plus densément peuplée entre Matane et Gaspé. Située à 500 km à l'est de Québec et à 90 km à l'est de Matane, Sainte-Anne-desMonts demeure une ville de services arrosée par la rivière Sainte-Anne, dont le nom figure sous la forme « R St Anne » sur une carte de Gédéon de Catalogne de 1709, entre CapChat et Tourelle. Vers 1900, les lieux attiraient de nombreux pèlerins et étaient considérés, avec Sainte-Anne-de-Beaupré et Sainte-Anne-de-la-Pocatière, comme un haut lieu de pèlerinage. L'histoire de ce coin de pays débute sous le Régime français alors qu'il était fréquenté par des pêcheurs saisonniers qui n'y venaient qu'en été.
L'isolement et l'absence de routes praticables au XIXe siècle ont retardé le développement de l'endroit amorcé par la construction de scieries. Les premières familles s'y installent en 1815 et l'essor initial est fondé sur l'industrie de la pêche. En 1863, on assiste à l'érection canonique de la paroisse de Sainte-Anne-des-Monts, établie dès 1815, et qui donnera son nom au bureau de poste (1853) et à la municipalité créée en 1855. Cette dernière obtiendra le statut de ville en 1968. La paroisse comme la ville tirent leur appellation de la seigneurie de Sainte-Anne-desMonts concédée à Denis Riverin en 1688 « à la rivière Ste-Anne située au commencement des Monts NostreDame », pour y établir un poste de pêche sédentaire. L'élément hagiotoponymique (NDA : lieu avec nom de saint) a été attribué par l'abbé Jean-Baptiste Sasseville, originaire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, tout comme les colons du début du XIXe siècle, sans qu'il faille y voir une relation de cause à effet, car la rivière portait déjà ce nom au XVIIe siècle.
La présence, au sud du territoire, des monts Notre-Dame, dont les Chic-Chocs forment un partie caractérisée par ses hauts reliefs, expliquerait le constituant Monts, quoique certains y voient le patronyme de Pierre Du Gua de Monts (1558?-1628), ami de Champlain et fondateur de la première colonie acadienne.

Toponymie SIA SIA-QC-Topo+
Saint-André-deRestigouche
Toponymie SIA SIA-QC-Topo+
Village La proclamation du canton de Ristigouche, en 1842, a précédé de peu la création, en 1855, de la municipalité de canton homonyme, établie sur les bords de la rivière Ristigouche, en Gaspésie, à l'ouest de Pointe-à-la-Croix et près de la ville néo-brunswickoise de Campbellton, sur la rive opposée.
En 1760, les lieux ont été le théâtre de la dernière bataille entre les Anglais et les Français qui s'est soldée par la destruction de l'église et de plusieurs maisons ainsi que par la désertion de la population blanche qui s'est déplacée vers l'est. Les lieux ont toujours été considérés comme un important centre de peuplement au fond de la baie des Chaleurs, notamment grâce à l'arrivée massive d'Acadiens et de Normands.
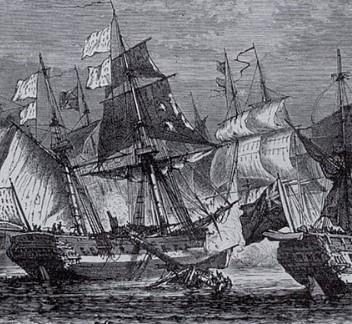
En 1989, les autorités municipales décident de modifier le nom de la municipalité en raison de nombreux problèmes soulevés par l'homonymie (Ristigouche-Partie-Sud-Est, Sainte-Anne-deRistigouche). Ils optent pour le nom de la paroisse créée au début du siècle et canoniquement érigée en 1908.
L'hagionyme (nom de saint) Saint-André rappelle monseigneur André-Albert Blais (1842-1919), évêque de Rimouski (1891-1919). Quant à Restigouche, nom également de la réserve indienne, il est généralement préféré dans l'usage populaire à Ristigouche, tiré du nom de la rivière, ainsi orthographié anciennement.
Supplément vidéo : Survol de St-André-de-Restigouche
Saint-Laurent Estuaire L'estuaire du Saint-Laurent est situé en aval du fleuve Saint-Laurent et en amont du golfe du Saint-Laurent. Il désigne l'endroit où se mélangent les eaux douces et salées entre le fleuve et le golfe. L'estuaire du Saint-Laurent débute au lac Saint-Pierre. Il est divisé en trois sections :
• l'estuaire fluvial du lac Saint-Pierre à l'ile d'Orléans,
• l'estuaire moyen jusqu'au Saguenay et
• l'estuaire maritime jusqu'à l'ile d'Anticosti.
La Proclamation royale de 1763 définit une ligne partant de la rivière Saint-Jean en passant par la pointe ouest de l'ile d'Anticosti, jusqu'au cap des Rosiers, qui délimite la fin du fleuve et le commencement du golfe. Il s'agit du plus grand estuaire au monde.
L’estuaire du Saint-Laurent est caractérisé par un front salin situé à la pointe est de l’ile d’Orléans.

Source : Wikipedia
Saint-Laurent Fleuve Majestueux cours d'eau, d'une longueur de 3 360 km qui prend ses sources dans le bassin du lac Supérieur, en Ontario, et dans quelques États américains, le Saint-Laurent se jette dans le golfe du même nom. Du point de vue toponymique, Saint-Laurent s'applique au fleuve proprement dit, soit sur une distance de 1 200 km depuis le lac Ontario jusqu'à l'île d'Anticosti.
Le nom Fleuve Saint-Laurent apparaît comme toponyme dans les traductions d'abord en espagnol, en 1552, puis en italien, en 1556, de la Narration de Jacques Cartier concernant son voyage de 1535-1536. Dans ces traductions, l'appellation baye sainct Laurens attribuée par Cartier, le 10 août 1535, soit le jour de la fête de saint Laurent, martyr à Rome en 258, à un rentrant de la Côte-Nord, est rendue principalement par « grand fleuve de SaintLaurent ». Par la suite, le spécifique Saint-Laurent s'est aussi appliqué au golfe puis au cours d'eau. Pour s'en rendre compte, il convient de citer à cet égard un passage du Rapport du navigateur anglais Humphrey Gilbert. Celui-ci écrit dans ce document daté de 1583 : « [...] the great river called S. Laurence in Canada ». L'appellation la plus ancienne à avoir été consignée pour caractériser cette entité hydrographique reste toutefois celle mentionnée par Jacques Cartier, d'abord en 1535, et qui est : Grand fleuve de Hochelaga.
Cependant, ainsi qu'en témoignent maints documents, le nom peut-être le plus connu de ce fleuve, au XVIe siècle, fut riviere de Canada. Jean Alfonse, pilote de Roberval, indique ce toponyme dans ses ouvrages de 1542 et 1544. Il en est de même pour le cartographe Nicolas Vallard qui inscrit aussi ce nom de lieu sur sa carte publiée vers 1547. Dans une lettre datée de 1587, Jacques Noël, petit-neveu de Cartier, et qui, lui aussi, avait remonté ce cours d'eau au moins jusqu'à la hauteur de Montréal, écrit également Rivière de Canada. En 1603, Samuel de Champlain a
SIA-QC-Topo+
Toponymie SIA
Saint-Maurice-del'Échouerie
d'abord désigné ce cours d'eau sous le nom de « riviere de Canadas ». Mais, à partir de 1604, le fondateur de Québec opta pour « grande riviere de sainct Laurens » et « fleuve sainct Laurens » dans ses écrits et sur ses cartes. C'est donc au XVIIe siècle que le toponyme Fleuve Saint-Laurent a fini par supplanter ses concurrents.
Depuis le XVIe siècle, des segments de cette voie d'eau ont parfois pris des appellations spécifiques. Par exemple, lors de son voyage de 1542-1543, l'explorateur français Jean-François de La Rocque de Roberval nomma France Prime la section de ce fleuve comprise entre l'île d'Orléans et la ville de Cap-Rouge. Selon le géographe anglais Richard Hakluyt, ce nom France Prime a été attribué par Roberval en hommage à François Ier, roi de France. Roberval s'installa au même endroit que Cartier, en 1541-1542, et nomma France-Roy sur FrancePrime l'habitation située à proximité de l'embouchure de la rivière du Cap Rouge près de Québec.
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la section du Saint-Laurent comprise entre les lacs Saint-François et Ontario a parfois été indiquée sur les cartes notamment, et a certainement été connue sous les noms Rivière des Iroquois et Rivière de Cataracoui. Cette dernière appellation provenait du nom amérindien du fort Frontenac, aujourd'hui Kingston, en Ontario. Cette voie d'eau fut et est encore connue des navigateurs et des pilotes sous l'appellatif géographique La Rivière. Cet usage semble être ancien puisque des auteurs des XVIe et XVIIe siècles, dont le géographe Richard Hakluyt, et l'explorateur Louis Jolliet, par exemple, indiquent déjà cet autre nom du Saint-Laurent.
Aujourd'hui, cette entité transfrontalière est reconnue officiellement par le Gouvernement fédéral sous la double appellation de Fleuve Saint-Laurent et de St. Lawrence River. Plusieurs nations amérindiennes ont leur(s) appellation(s) pour désigner ce cours d'eau : à titre d'exemple, le fleuve est désigné en innu par Wepistukujaw Sipo; en abénaquis par Moliantegok; en mohawk par Roiatatokenti ou Raoteniateara.
En 2017, le gouvernement du Québec désigna le fleuve Saint-Laurent lieu historique.
Supplément: Détérioration du fleuve Saint-Laurent
Village La première partie du toponyme provient du nom de la paroisse, détachée en 1915 de Saint-Martin-de-la-Rivièreau-Renard et dont l'abbé Elias Morris (1856-1936) était alors curé. Un rapprochement phonétique entre Morris et Maurice expliquerait son origine. Quant à la deuxième partie du nom, elle est empruntée à L'Échouerie, petite agglomération de pêcheurs. Ce terme que l'on retrouve en Gaspésie, aux îles-de-la-Madeleine et sur la Côte-Nord paraît dès 1764 sur une carte de Nicolas Bellin et désigne un endroit où les loups marins ont contracté l'habitude de venir se reposer. Il n'est pas interdit de penser cependant que ce mot peut également désigner une grève étendue où s'échouent les barques des pêcheurs.
SIA-QC-Topo+
Toponymie SIA
Sainte-MargueriteMarie Village
Sainte-Marguerite-Marie s'ouvre à la colonisation à partir de 1915.
D'abord fondée comme mission de Sainte-Marguerite, la localité prendra le nom Sainte-Marguerite-Marie en 1923, sous l'impulsion de l'abbé Jean-Baptiste Beaupré (1896-1977), premier curé résident de 1928 à 1936.
Saint-Maxime-duMont-Louis
Toponymie SIA SIA-QC-Topo+
Village Au XVIIIe siècle, cet endroit constituait un important poste de pêche à la morue que Denis Riverin considérait comme « l'endroit le meilleur du fleuve Saint-Laurent pour faire la pesche à la morue ». Habité par douze familles en 1697 et par 53 en 1699, le poste sera abandonné en 1702.
En 1758, le général James Wolfe donna l'ordre au major Dalling, qui était cantonné à Gaspé, de détruire l'établissement de Mont-Louis. C'est ainsi qu'il partit de Gaspé, le 14 septembre, avec environ 300 soldats pour se rendre à Mont-Louis en longeant la côte en cinq jours. Mahiet offrit une rançon contre son établissement, mais le major Dalling la refuse et s'empara des biens, puis, brûla les réserves de morue ainsi que les maisons, à l'exception de celle de Mahiet. Le 23 septembre, les troupes anglaises prirent les deux goélettes de Mahiet pour se retourner à Gaspé avec 43 prisonniers dont Mahiet et sa femme.
Avant sa fondation en 1867, la paroisse de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, qui comptait quelque 200 habitants en 1863, suivant Stanislas Drapeau, était incluse dans celle assez vaste de Sainte-Anne-des-Monts. Érigée canoniquement en 1875, elle transmettra son appellation à la municipalité officiellement établie en 1884. Elle tirerait sa dénomination, selon l’auteur Hormisdas Magnan, du prénom de l'abbé Maxime Tardif (1821-1850), ainsi que du nom de la seigneurie de Mont-Louis, concédée à Nicolas Bourlet, banquier et marchand de Paris, avant 1702. Attribuée à la rivière qui coule vers le Saint-Laurent dans une vallée resserrée, cette appellation évoque le grand roi Louis XIV (1638-1715), souverain régnant (1643-1715) lorsque la première concession de terre a été effectuée.
Saint-Octave de l’Avenir Lieu-dit
Toponymie SIA
Dans le but de contrer les effets néfastes du marasme général occasionné par la crise économique des années 1930 en Gaspésie, les autorités civiles et religieuses se sont entendues pour encourager l'établissement de colons à l'intérieur des terres. C'est ainsi qu'est née la paroisse de Saint-Octave-de-l'Avenir, située à 18 km au sud-est de Cap-Chat et à une altitude de 380 m, sur le rebord des monts Chic-Chocs. Fondée officiellement en 1935, l'année même du plan Vautrin – plan de colonisation –, elle avait été ouverte dès 1932 aux colons désireux de s'atteler immédiatement à la tâche. Après avoir compté une population de près de 1 200 habitants en 1937, cette paroisse a dû subir des hauts et des bas et être fermée en 1971, à la suite de la publication du rapport du Bureau de l'aménagement de l'Est du Québec qui la désignait comme paroisse marginale. Elle n'aura duré que 36 ans. Aujourd'hui, le toponyme désigne un lieu-dit et, tout comme à l'origine, il rend hommage au curé fondateur Louis-Octave Caron (1879-1942), né à Saint-Octave-de-Métis. Le premier terme s'explique par l'ajout du qualificatif Saint à son prénom. Quant au second, il traduit l'espoir que les fondateurs mettaient dans la fondation de la paroisse. On l'a également désigné sous les noms de Saint-Octave et SaintOctave-Nord. Bien qu'inhabité, Saint-Octave-de-l'Avenir a commencé à recevoir un camp estival des cadets de la Marine en 1972, des cadets de l'Air en 1980 et ceux de l'Armée en 1983.
Suppléments vidéo: Office National du Film : Chez nous, c’est chez_nous et Radio-Canada : Villages effacés
Saint-Vianney Village En 1918, la compagnie américaine Mutual Colonization and Development commence à y implanter des colons. Près de 300 familles de Franco-Américains s'établissent dans le canton de Langis au début des années 1920. Fondée en 1921, la mission du canton Langis, comme on l'appelait à l'époque, puisque ses limites coincidaient avec celles de l'entité cantonale, deviendra la paroisse de Saint-Jean-Baptiste-Vianney en 1925, parce que JeanMarie-Baptiste Vianney (1786-1859), curé d'Ars de 1817 à 1859, sera canonisé en 1925. Reconnu pour ses mortifications afin de convertir une population largement déchristianisée, ses nombreux miracles feront d'Ars, près de Lyon, un centre de pèlerinage. On l'invoque comme patron des curés et des responsables de communautés paroissiales. Sa fête liturgique est célébrée le 9 août. Reprise par la municipalité de paroisse créée en 1926, la dénomination devait être abrégée en 1988 en Saint-Vianney.

SIA-QC-Topo+
Saint-Yvon Village C'est en 1886 qu'un bureau de poste, fermé en 1968, a été ouvert sous le nom de Saint-Yvon qui est à l'origine du toponyme. Selon le témoignage des anciens, cette appellation fut donnée par le premier maître de poste, d'origine française, en souvenir de son lieu de naissance. L'endroit avait été connu antérieurement sous la dénomination de Pointe-Sèche, qui est d'ailleurs celle de la bande de terre qui s'avance dans le golfe du SaintLaurent à l'est de la baie de Saint-Yvon. Un rapport d'arpentage de 1869 indique seulement Pointe-Sèche pour ce lieu.
Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, plus précisément le 8 décembre 1942, une torpille lancée par un sousmarin allemand atteignit la côte, ce qui causa un grand émoi parmi la population de ce hameau.
Saint-Anne-desMonts Ville Les Annemontois habitent l'agglomération la plus densément peuplée entre Matane et Gaspé. Située à 500 km à l'est de Québec et à 90 km à l'est de Matane, Sainte-Anne-des-Monts demeure une ville de services arrosée par la rivière Sainte-Anne, dont le nom figure sous la forme « R St Anne » sur une carte de Catalogne de 1709, entre CapChat et Tourelle. Vers 1900, les lieux attiraient de nombreux pèlerins et étaient considérés, avec Sainte-Anne-deBeaupré et Sainte-Anne-de-la-Pocatière, comme un haut lieu de pèlerinage. L'histoire de ce coin de pays débute sous le Régime français alors qu'il était fréquenté par des pêcheurs saisonniers qui n'y venaient qu'en été.
L'isolement et l'absence de routes praticables au XIXe siècle ont retardé le développement de l'endroit amorcé par la construction de scieries. Les premières familles s'y installent en 1815 et l'essor initial est fondé sur l'industrie de la pêche. En 1863, on assiste à l'érection canonique de la paroisse de Sainte-Anne-des-Monts, établie dès 1815, et qui donnera son nom au bureau de poste (1853) et à la municipalité créée en 1855. Cette dernière obtiendra le statut de ville en 1968. La paroisse comme la ville tirent leur appellation de la seigneurie de Sainte-Anne-desMonts concédée à Denis Riverin en 1688 « à la rivière Ste-Anne située au commencement des Monts NostreDame », pour y établir un poste de pêche sédentaire. L'élément hagionymique a été attribué par l'abbé JeanBaptiste Sasseville, originaire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, tout comme les colons du début du XIXe siècle, sans qu'il faille y voir une relation de cause à effet, car la rivière portait déjà ce nom au XVIIe siècle.
La présence, au sud du territoire, des monts Notre-Dame, dont les Chic-Chocs forment un partie caractérisée par ses hauts reliefs, expliquerait le constituant Monts, quoique certains y voient le patronyme de Pierre Du Gua de Monts (1558?-1628), ami de Champlain et fondateur de la première colonie acadienne.
Seigneurie de l’Anse-de-l’Étang
Seigneurie Cette seigneurie a été concédée à François Hazeur et Denis Riverin, marchands à Québec, par le gouverneur Frontenac et l'intendant Champigny, le 20 septembre 1697. Son étendue est de 3 lieues de front sur 1 lieue de profondeur, six lieues au-dessous de la vallée des monts Notre-Dame.
Un étang se trouve immédiatement au sud et se déverse dans l'anse, ce qui expliquerait son nom. L'anse de l'Étang est aussi connue sous le nom micmac Gaqtugawei Sipu, qui signifie « rivière du tonnerre ».
Toponymie SIA SIA-QC-Topo+
Serpentine-duMont-Albert Habitat floristique (carte)
Toponymie SIA
Cet habitat floristique de 2 727,56 ha a été créé afin de protéger la Minuartie de la serpentine, le Saule à bractées vertes, le Polystic des rochers et la Verge d'or, simple variété à bractées vertes. Le nom de l'habitat qui se trouve à l'intérieur du parc national de la Gaspésie, emprunte celui de la formation géologique qui le caractérise : la serpentine. Celle-ci est une roche rare au Québec et dans le monde. Elle possède des caractéristiques toxiques pour la plupart des plantes, mais constitue en revanche un milieu propice pour certaines plantes rares. L'habitat se caractérise par la végétation de toundra qui se développe sur le plateau de serpentine et sur les versants est et sud du mont Albert, à partir de 550 mètres d'altitude, ainsi que sur les pentes rocheuses de serpentine du ravin du Diable.
Séverin-Pelletier Mont Depuis 2002, ce nom évoque le souvenir de Séverin Pelletier, un arpenteur natif de Cap-Chat et domicilié à Matane qui réalisa plusieurs travaux dans la réserve faunique de Matane. Il est décédé à Matane le 20 décembre 1995.
Table, de la Mont Le toponyme Mont de la Table, officiel depuis 1952, a été précédé par les appellations Tabletop écrite aussi Table Top ou simplement Table. Tabletop est toujours en usage, surtout depuis la publication, dans les années 1930, des travaux des géologues Harold William McGerrigle et I. W. Jones ainsi que des études du géographe Raoul Blanchard. Table est un terme de la langue courante pour désigner des surfaces horizontales, généralement des plateaux plus ou moins étendus. On parle même du relief tabulaire en géomorphologie structurale. Dans le cas du mont de la Table, il s'agit d'une ancienne surface d'aplanissement dont le rebord horizontal s'aperçoit d'assez loin, ce qui explique sans doute le choix du nom.
Tamagodi Rivière D'origine micmaque, ce nom signifie débouché, faisant peut-être allusion par là à la propriété de la rivière de constituer une voie navigable.
William Price Mont Son nom évoque le souvenir de William Price, président de la compagnie Price Brothers qui possédait des droits de coupe forestière sur le territoire de l'actuelle réserve faunique de Matane. Le camp 2, situé à proximité de ce mont, était la propriété de cette compagnie. William Price est décédé à Kénogami (Saguenay) en 1924.
SIA-QC-Topo+
T
W
X
Toponymie SIA
Xalibu Mont Ce relief porte un nom micmac, Xalibu, ou Galipu selon une autre transcription, qui signifie le trépigneur, la bête qui pioche, c'est-à-dire le caribou. Ce mammifère a en effet l'habitude de creuser avec ses pattes pour se nourrir. Il est abondant dans ce secteur du parc de conservation. La présence du caribou à cet endroit – le seul troupeau vivant au sud du Saint-Laurent depuis 1930 – représente un vestige faunique précieux, car on retrouvait autrefois cet animal partout au Québec et même dans les États du Maine et du New Hampshire. Le nom Mont Xalibu, proposé par les autorités du parc de conservation pour désigner une élévation jusqu'ici innommée, vient rappeler dans la toponymie ce phénomène d'exception. La Commission de toponymie a adopté cette désignation en 1989.
SIA-QC-Topo+
Source : Commission de toponymie du Québec (sauf mention contraire)
SUPPLÉMENTS - GÉNÉRAL
Mont Logan
Topographie On distingue trois divisions physiographiques au massif du mont Logan : au nord, les hautes-terres, au centre, la crête montagneuse des Chic-Chocs et, au sud, une plaine.
Les hautes-terres du piémont sont formées de vallons boisés d'une altitude moyenne de 550 mètres. Des ruisseaux et rivières coulent dans des ravins d'une profondeur pouvant atteindre 400 mètres.
Le mont Logan est caractérisé par une morphologie territoriale bigarrée, alternant pentes douces arrondies et herbeuses avec des falaises escarpées. Au nord, un escarpement prononcé place le mont Logan comme l'un des sommets les plus proéminents de l'Est du Canada, avec une hauteur de culminance de 620 mètres. Cette paroi, d'une hauteur variant entre 450 et 600 mètres et d'une inclinaison généralement comprise entre 20 et 40°, voire verticale à certains endroits, est visible de plusieurs endroits le long du littoral du SaintLaurent, notamment de Cap-Chat et Sainte-Anne-des-Monts. La portion ouest de la paroi, moins abrupte, n'en demeure pas moins infranchissable que sa contrepartie orientale. Les pentes du flanc sud du massif sont plus douces : leur élévation varie de 180 à 300 mètres, avec une distance en pente d'environ un kilomètre.
Le sommet lui-même est un dôme pittoresque d'une altitude maximale de 1 150 mètres, implanté sur une crête de sommets d'élévation similaire (monts Mattawees, Fortin, Pembroke) entrecoupée de vallées profondes,
Géologie Le mont Logan s'est formé il y a environ 450 millions d'années. Une pression latérale exercée par d'autres formations sur le socle rocheux entraîne la formation de plis, puis, la pression augmentant, entraîne le chevauchement ; une nappe de charriage de quelques centaines de mètres d'épaisseur se met en place. La nappe de Logan est constituée de roches plus dures que les roches des formations environnantes. L'érosion plus rapide de ces formations voisines a révélé le relief particulier des monts Chic-Chocs, et plus spécifiquement du mont Logan. Voir Histoire de la formation des Appalaches
L'Arnica de Griscom est endémique du golfe du Saint-Laurent.
Le mont Logan est principalement situé dans une sapinière à bouleau blanc. La forêt préindustrielle était composée d'une matrice dominée par les résineux matures, mais l'exploitation par les compagnies forestières, notamment la compagnie Hammermill qui détenait des droits de coupe pour un volume annuel de bois de 72 000 m3 sur la montagne, transforme la nature des peuplements, maintenant composés de jeunes pousses de résineux voisinant
 Faune et Flore
Faune et Flore
Suppléments - Général
davantage de feuillus. Le cycle de régénération est lent : 30 à 60 ans sont requis pour qu'un peuplement dominé par les sapins arrive à maturité, soit près de deux fois plus de temps qu'il en faut généralement.
Les caribous de Gaspésie fréquentent le mont Logan.

L'altitude de la montagne et son exposition aux vents en font un site exceptionnel pour la végétation de prairie subalpine. Le versant ouest de la montagne et son sommet abritent une forte quantité d'espèces floristiques rares, menacées ou vulnérables, dont quelques-unes endémiques au massif des Chic-Chocs. Le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques y protège l'Arnica de Griscom, l'Arnica à aigrettes brunes, l'Athyrie alpestre, le Senéçon fausse-cymbalaire, la Cirse des montagnes, la Fougère mâle, la Fétuque de l'Altaï, le Gnaphale de Norvège et le Saxifrage de Gaspésie.

Le mont Logan est habité par deux espèces d'animaux vulnérables. D'une part, le versant oriental constitue un habitat pour la grive de Bicknell. D'autre part, après l'avoir déserté à partir des années 1970, le troupeau de caribous de la Gaspésie fréquente de nouveau la montagne
Histoire Expédition de Logan
À la recherche de charbon, William Edmond Logan explore la Gaspésie pour la première fois en 1843, puis il y retourne en 1844. Sur le bateau les conduisant à Gaspé, le chimiste Édouard Sylvestre de Rottermund, en plaisantant avec le capitaine Walter Douglas, propose de nommer « Logan » la plus haute des montagnes qu'ils pouvaient voir du large de Cap-Chat, et qu'ils avaient l'intention d'ausculter. Le géologue désapprouve.
Flanqué du comte de Rottermund, du géologue Alexander Murray, de deux assistants et de quatre guides Mi'gmaq, Logan et ses huit acolytes quittent Cap-Chat le 5 juillet 1844, avec l'intention d'atteindre le mont Saint-Joseph, puis la baie des Chaleurs. Les chercheurs procèdent d'abord à la topographie des sommets visibles de la côte au nord de la péninsule, puis remontant la rivière Cap-Chat en canot,
SIA-QC-Topo+
ils atteignent la base de la montagne le 14 juillet. Quatre jours plus tard, ils deviennent les premiers Européens à atteindre le sommet du mont Logan ; ils y plantent l'Union Jack. Logan décrit la vue en ces termes :
« Du plus haut sommet que nous visitâmes, le panorama était des plus grandioses. Sur la moitié nord du cercle, les eaux du Saint-Laurent, ponctuées de navires et bateaux de pêche, s'étendaient à gauche et à droite pour aussi loin que l'œil pût voir [...].
Vers l'est, une confusion de montagnes et de ravins appartenant aux monts Notre-Dame remplissait l'horizon, et nous présumâmes qu'un sommet, qui montrait une plaque de neige, eût pu être plus haut que le point sur lequel nous nous trouvâmes. Plusieurs des pics qui s'offraient à notre vision étaient de roc nu [...].
Vers le sud, une mer ondoyante de crêtes parallèles occupait le tableau [...].
Sur les collines de plus faible élévation, les épinettes se mêlaient aux bouleaux, et la taille des arbres augmentait au fur et à mesure que l'altitude diminuait. Après le confinement dans la forêt d'en bas, la végétation de haute altitude nous frappa de plein fouet et nous satisfit grandement. De grandes étendues de prairie dégagée nous apparurent de tous les côtés sauf le nord. De larges pentes à l'est, au sud et à l'ouest étaient tapissées des pousses les plus luxuriantes et d'une diversité de fougères, à partir desquelles les collines ressemblaient parfois à des paysages de parc ou à des œuvres d'art comme si la distribution fut arrangée dans un but d'ornement et produisant souvent, avec des sommets, des ravins et un horizon lointain, des paysages des plus grandioses.
William Edmond Logan, Report of progress
L'expédition de Logan explore les environs, puis franchit un col pour enfin gagner la rivière Cascapédia, qu'elle arpente dans le détail. Elle atteint la baie des Chaleurs le 6 septembre 1844.

Expéditions de Fernald De nombreuses publications académiques s'intéressent au massif des Chic-Chocs lors de la décennie 1920. Constatant le peu de connaissances produites sur la montagne, le botaniste Merritt Lyndon Fernald tente de gagner le sommet du mont Logan avec l'intention d'en décrire la flore. Pour ses travaux, Fernald s'inspire de l'herbier laurentien du botaniste John Macoun, de même que des études physiographiques des géologues William Edmond Logan, Arthur Coleman et Frederick J. Alcock.
En 1922, accompagné du botaniste Arthur Stanley Pease et du guide Joseph Fortin, Fernald tente de retrouver la piste que Logan a empruntée jusqu'au sommet. La montagne est pratiquement inconnue des locaux : les chercheurs tentent plusieurs voies pour atteindre le sommet. Une série d'orages met un terme à leur première expédition. L'année suivante, Fernald forme une équipe de sept botanistes. Les scientifiques trouvent sur la montagne des plantes caractéristiques de l'Arctique canadien et de la cordillère de l'Ouest, jamais
Suppléments - Général SIA-QC-Topo+
Suppléments - Général
observées auparavant autant au sud et à l'est. En somme, l'expédition identifie 300 plantes arctiques, alpines et endémiques. Fernald explique ces découvertes en émettant l'hypothèse que le mont Logan et les sommets avoisinants étaient des nunataqs lors de la dernière glaciation.
Les noms des monts voisins Collins et Dodge, de l'Arnica de Griscom et de la réserve écologique Fernald rappellent la visite des botanistes dans les années 1920. Les travaux de Fernald en Gaspésie inspirent au frère Marie-Victorin la constitution de sa Flore laurentienne. Marie-Victorin dit même de Fernald qu'il est son « père botanique ».
Télédiffusion Alors que se généralise la télévision dans les foyers québécois, une course à l'ascension des Chic-Chocs se dessine entre différents groupes de radiodiffusion. Début 1961, Télévision Transgaspésienne (TVTG, affiliée à Télé-Métropole) et la Compagnie de radiodiffusion de Matane (CKBL) réclament tous deux au Bureau des gouverneurs de la radiodiffusion une licence de diffusion sur les plus hauts sommets gaspésiens. TVTG avait obtenu de l'État québécois un bail emphytéotique pour l'installation d'une antenne au sommet du mont Jacques-Cartier ; CKBL, à qui est finalement octroyée la licence, a plutôt obtenu du gouvernement la permission d'occuper le sommet Logan.
Bien qu'il soit des plus puissants, le signal est mésadapté à la topographie gaspésienne et l'émetteur est difficile à rentabiliser. Entre temps, au pied de la montagne, le village de Saint-Octave-de-l'Avenir est abandonné et l'approvisionnement doit dorénavant se faire à partir de Cap-Chat, via la vallée de la rivière Cap-Chat. Dès l'acquisition en 1972 de CKBL par la Société Radio-Canada (SRC), on projette la mise hors-d'onde de l'émetteur. L'opération « Descente du mont Logan » est annoncée en 1977 par les ingénieurs de la SRC, et une partie des installations sont démantelées l'année suivante. Les bâtiments restants et le pylône principal sont finalement démolis en 2011.
En 2007, Radio-Canada, toujours propriétaire du sommet, tente de se départir de son terrain. Le Ministère de l'Environnement bloque la vente ; une étude révèle une contamination des sols au diésel qui alimentait autrefois les génératrices. Des travaux d'une valeur de 400 000 $ sont entamés en 2014 afin de construire un biotertre (dispositif de décontamination), mais le processus doit s'échelonner sur une période d'au moins six ans, en raison de la rigueur du climat, de l'isolement du site et de la sensibilité écologique.
Domaine skiable Afin de rentabiliser leur émetteur du mont Logan, les propriétaires de CKBL planifient dès sa mise en service le développement du potentiel skiable de la montagne. Ils font appel à Ernie McCullogh, entraîneur de ski, pour organiser avec des industriels de Matane une expédition d'exploration, puis une expédition cinématographique afin de faire la démonstration de ce potentiel au printemps 1964. La montagne est vantée pour ses neiges abondantes et persistantes, en plus des multiples versants exploitables. Le site est le théâtre d'entraînements de la délégation canadienne de l'Interski. McCullogh promet même de faire du mont Logan le site d'entraînement de l'équipe canadienne de ski alpin. La montagne est régulièrement comparée à Val-d'Isère.
Les multiples expéditions attirent l'attention de politiciens et de financiers torontois, lesquels désirent obtenir des garanties des gouvernements avant d'investir. On projette l'aménagement d'une station de ski pouvant accueillir jusqu'à 5 000 skieurs convoyés par
SIA-QC-Topo+
Suppléments - Général
cinq télésièges, et hébergés dans les villes à proximité ou encore dans un hôtel d'une capacité de 500 clients. Le coût estimé de la station est d'abord de 1 500 000 $, puis de 3 000 000 $, pour être ensuite estimé entre 7 000 000 et 10 000 000 $. Le Bureau d'aménagement de l'Est du Québec se saisit de l'affaire ; le ministère des Terres et Forêts confie à Claude Robillard le soin d'étudier des projets d'aménagements skiables des plus hauts sommets des Chic-Chocs. On projette la construction d'un réseau élaboré de chemins d'accès et d'un aéroport d'une taille suffisante pour accueillir des avions de ligne ; la facture grimpe à 40 000 000 $. Aucun investissement public n'est toutefois fait en ce sens. Le gouvernement interdit la projection au Québec des films sur les expéditions de McCullogh, et le site du mont Sainte-Anne, plus près de Québec et Montréal, est préféré pour l'implantation d'une station de ski de calibre international.
Le projet est encore discuté au milieu des années 1970 avec une formule héli-ski, nécessitant des immobilisations plus légères. Cependant, le gouvernement du Québec refuse d'y injecter de l'argent. Une station d'héli-ski est opérée par des hommes d'affaires de la région entre 1985 et 1990, mais leurs efforts de mise en valeur de la montagne sont plombés par la concurrence du Massif de Charlevoix.
En 2002, la Société des établissements de plein air du Québec préfère le mont Jean-Yves-Bérubé au mont Logan pour la construction d'une auberge de montagne de grand luxe, l'Auberge de montagne des Chic-Chocs, où sont offerts des services de randonnées à ski guidées.
Protection environnementale
Faisant partie du parc national de la Gaspésie, la majeure partie de la montagne est protégée dès 1937. Afin d'assurer une protection accrue de la faune et la flore particulières au massif des Chic-Chocs, les activités de foresterie industrielle et d'exploitation minière sont interdites dans le parc à partir de 1977. Appartenant à la Société Radio-Canada, le sommet de la montagne ne fait pas partie du parc de la Gaspésie. Il est toutefois prévu de le céder à l'État québécois une fois que les sols auront été décontaminés du diesel qui s'y trouve.
Intégré à l'habitat floristique du Mont-Logan depuis 1995, le versant est de la montagne bénéficie d'une protection supplémentaire afin d'assurer la survie des spécimens de végétaux rares et menacés qui s'y trouvent. La partie du versant ouest exclue du parc de la Gaspésie est comprise dans la réserve faunique de Matane. Immédiatement au nord-ouest, la réserve écologique Fernald assure une protection intégrale de l'escarpement au nord des sommets Collins, Mattawees et Fortin.
La totalité de la montagne est incluse dans l'habitat légal du caribou de la Gaspésie
Index Mont Logan
Source : Wikipedia
SIA-QC-Topo+
Parc national Forillon
Histoire La création du parc en 1970 a été précédée par la fermeture de villages et le déplacement par l'expropriation de 225 familles qui résidaient dans les limites du secteur proposé. Les maisons furent démolies et/ou brulées, souvent en présence de leurs propriétaires qui les avaient habitées pendant des décennies. En 2010, après 40 ans, les expropriés survivants n'ont enfin plus à payer un droit de passage à un kiosque de Parcs Canada pour fouler les terres qui les ont vus naître. Plusieurs fondations de maisons démolies restent aujourd'hui cachées dans les broussailles de plusieurs sections du parc. Cependant, certaines zones du secteur sud du parc relatent les activités humaines qui ont eu cours à Forillon avant que le territoire ne soit écologiquement protégé.
Des activités d'interprétation nous invitent ainsi à en apprendre davantage sur les activités humaines sur la péninsule de Forillon. La visite du Magasin Hyman et des expositions attenantes, ou encore lors de la randonnée intitulée Une Tournée dans les Parages, qui nous fait côtoyer maisons, champs, installations agricoles et commerciales du début du XXe siècle, permettent de saisir que Forillon a déjà été habité par des communautés.
Forillon abrite aussi le Fort Péninsule, situé près de la péninsule de Penouille, une avancée de terre dans la baie de Gaspé. L'endroit a été aménagé et fortifié lors de la Seconde Guerre mondiale pour former, avec le Fort Prével, situé du côté opposé de la baie de Gaspé, un système de défense contre les sous-marins allemands. On prévoyait en effet qu'advenant la prise de l'Angleterre par les nazis, la flotte de navires britanniques allait se réfugier dans la baie de Gaspé. Elle aurait été ainsi protégée par les deux forts sus-mentionnés et par un filet anti sous-marins jadis installé.

Géologie et relief

On retrouve dans le parc 10 formations géologiques superposées en bande, ce qui est un phénomène rare. Les roches de Forillon sont composées de calcaires et de grès provenant de sédiments marins datant 359 à 488 millions d'années qui ont été soulevés lors de le formation des Appalaches. Dans le sud du parc, les roches ont pris une inclinaison de 20 à 30 degrés vers la baie de Gaspé, pour se terminer abruptement au centre du parc.
Flore On retrouve 696 espèces végétales dans le parc national. La forêt recouvre 95 % du parc qui est divisé en 63 regroupements végétaux distincts. La sapinière à bouleau blanc et l'érablière à bouleau jaune sont les regroupements les plus fréquents du parc. Le parc possède aussi l'une des forêts de Chêne rouge qui est située à la limite nord de sa distribution.
- Général SIA-QC-Topo+
Suppléments
Avant l’expropriation, 1970
Suppléments - Général
Le parc possède aussi un grand nombre de plantes à affinité alpine ou arctique. On y retrouve 115 espèces qui seraient un reliquat de la glaciation du Wisconsin. Le climat exposé aux intempéries du sommet et sur les falaises calcaire de la presqu'île de Forillon leur sert d'habitat.
Faune On retrouve dans le parc la plupart des espèces de mammifères de la forêt boréale. Les plus imposants sont sans conteste l'Orignal et l'Ours noir. Parmi les petits mammifères, on retrouve le Castor du Canada, le Renard roux, le Coyote, le Lynx du Canada, le Lièvre d'Amérique, le Porc-épic d'Amérique, la Marmotte commune , le Vison d'Amérique , l'Hermine, le Tamia rayé et l'Écureuil roux . Le parc est aussi fréquenté par plusieurs mammifères marins. On y retrouve entre autres le Phoque commun et le Phoque gris qui fréquentent les côtes pour se reposer et se reproduire. Parmi les cétacés on peut apercevoir le Rorqual bleu, le Marsouin commun, le Rorqual commun et le Globicéphale noir qui fréquentent les eaux autour du parc pour s'y nourrir.
On retrouve dans le parc 225 espèces d'oiseaux dont 124 y nichent. Parmi les oiseaux marins, on retrouve le Cormoran à aigrettes , le Guillemot à miroir, la Mouette tridactyle, le Petit Pingouin, le Grand Héron, la Sterne pierregarin et de nombreuses espèces de goélands. On retrouve aussi plusieurs espèces qui fréquentent les forêts, dont les bruants, les parulines, les geais, les pics et les grives. Il y a 26 espèces d'oiseaux de proie qui fréquentent le parc, les plus courants étant la Buse pattue, le Busard Saint-Martin et la Crécerelle d'Amérique.
Outre ses espèces, les falaises de la presqu'île de Forillon sont reconnues comme un site de nidification important de l'Arlequin plongeur. Le site comprendrait 6,7 % de la population de l'est de l'Amérique du Nord. Le site est aussi l'hôte de 2 % des Mouettes tridactyles de l'Amérique du Nord. La baie de Gaspé est quant à elle reconnue comme étant une importante aire d'hivernage de l'Harelde kakawi et du Garrot d'Islande. La baie est aussi fréquenté l'été par 1 % de la population nord-américaine de la Bernache cravant. Le parc possède deux héronnières importantes, l'une de Grand Héron à Penouille et l'autre de Bihoreau gris à L'Anse-aux-Amérindiens.
Index Parc Forillon
Source : Wikipédia
Suppléments vidéos : Chanson La complainte de Forillon et Résumé de l’implantation du parc Forillon
SIA-QC-Topo+
SUPPLÉMENTS - ÉCOLOGIE
Caribou de la Gaspésie-Atlantique
Le caribou (Rangifer tarandus) appartient à la famille des cervidés.
Il comprend actuellement sept sous-espèces, dont une seule présente au Québec : il s’agit du caribou des bois. Il abonde dans les régions Nord, mais une seule population persiste à l'état naturel, au sud du fleuve Saint-Laurent : c'est celle de la Gaspésie. En 2002, après de longues discussions, les chercheurs s'accordent pour confirmer que les caribous des bois de la Gaspésie-Atlantique sont uniques, car distincts génétiquement de façon significative de toutes les autres hardes existantes. Les caribous des bois sont répartis en trois écotypes : toundrique, forestier et montagnard. Les caribous de la péninsule de Gaspé appartiennent à l’écotype montagnard. Ils entreprennent des migrations saisonnières en altitude vers un habitat alpin, mais celles-ci se limitent principalement aux monts du parc de la Gaspésie.


Suppléments - Écologie
Histoire de la population
Les caribous peuplaient autrefois tout le territoire québécois. Au début des années 1950, on estimait que l'effectif de la population de caribou en Gaspésie était de 700 à 1 500 individus. En 1980, il ne restait plus que 250 individus. Les principales causes de cette chute sont les activités humaines, que ce soit la chasse qui s'est poursuivie jusqu'en 1948, ou encore la perturbation des habitats liée à l'exploitation forestière, minière et au développement de l'agriculture. Les caribous de la Gaspésie sont en fait une métapopulation divisée en trois hardes qui ont vraisemblablement peu d'échanges entre elles. Leur population a atteint son plus bas niveau en 1999, où l'on estimait qu'il ne restait alors plus que quelques dizaines d'individus. Depuis, plusieurs mesures de conservation ont été misent en place pour permettre à la population de caribous de se rétablir.
Statut de conservation
L’isolement géographique et génétique du caribou de la Gaspésie sont à l'origine de la grande valeur biologique et patrimoniale associée au caribou de la Gaspésie-Atlantique. La population de la Gaspésie fut désignée comme étant "en voie de disparition" par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada en 2001. C'est le statut maximal avant que l'espèce soit officiellement considérée comme éteinte. Ce statut est en général décerné aux populations à faible dispersion géographique. D'autre part, les modèles de population prévoient que le caribou de la Gaspésie-Atlantique pourrait disparaître d’ici 2056.
Cette mesure allait aussi dans le sens de la loi sur les parcs selon laquelle : "l'objectif prioritaire d'un parc national est d'assurer la conservation et la protection permanente de territoires représentatifs des régions naturelles du Québec ou de sites naturels à caractère exceptionnel, notamment en raison de leur diversité biologique, tout en les rendant accessibles au public pour des fins d'éducation et de récréation extensive".
Caractéristiques
Habitat Le parc national de la Gaspésie est d'une superficie de 802 km. Il comprend deux importants massifs montagneux de la chaîne des Appalaches : les monts Chic-Chocs et les monts McGerrigle, au cœur desquels vivent les caribous. On retrouve dans le parc des îlots de toundra arctique-alpine qui font partie intégrante de l'habitat des caribous des bois d'écotype montagnard. Le caribou de la Gaspésie-Atlantique se distingue par son utilisation exclusive des milieux montagneux. Le parc national protège également certains écosystèmes forestiers exceptionnels, dont plusieurs îlots de forêts anciennes.
Cycle de vie
Reproduction
L'espérance de vie des caribous à l'état sauvage est estimée à 10 et 15 ans respectivement pour les mâles et les femelles.
Les caribous ont un taux de fécondité assez bas, ce qui les rend d'autant plus vulnérables. En effet, ils n'atteignent leur maturité sexuelle qu'à l'âge de deux ans et demi (contre six mois pour les cerfs de Virginie, par exemple) et ne font, en général, qu'un seul petit. Le rut et l'accouplement ont lieu à l’automne, de septembre à novembre. La durée de la gestation varie entre sept et huit mois. Et entre la fin mai et la mi-juin, les femelles se dispersent pour donner naissance à leurs faons. Il a été démontré que la fécondité des femelles dépendait grandement des conditions d'alimentation et de la richesse en protéine de la nourriture à laquelle elles ont accès.
SIA-QC-Topo+
Suppléments - Écologie
Régime alimentaire La composition de son régime alimentaire varie selon les saisons. En été, le caribou se nourrit de mousses, de lichens et d'herbacées. Alors qu'en hiver, son alimentation est presque exclusivement constituée de lichens arboricoles. Ces lichens, que l'on trouve dans les peuplements d'arbres matures des hautes altitudes, sont essentiels à la survie du caribou en hiver lorsque le reste de sa nourriture est recouvert par la neige.
Menaces
La perte d'habitat L’altération ou la perte de l'habitat liées à l’exploitation forestière conventionnelle sont reconnues comme étant les causes ultimes du déclin du caribou. L’exploitation forestière pratiquée dans le parc jusqu’en 1881 créa une forêt plus jeune, qui ne constitue généralement pas un milieu propice pour les caribous qui ne peuvent s’y nourrir. La Gaspésie est ainsi, passée d’un terrain forestier principalement constitué de résineux matures à un terrain forestier à prédominance de jeunes peuplements avec une présence plus importante de feuillus. Encore aujourd'hui, l’exploitation des ressources naturelles se poursuit dans les réserves fauniques de Matane et des Chic-Chocs, voisines du parc national de la Gaspésie. Les coupes forestières résultent aussi de l'arrivée des lobbies pour les énergies renouvelables. Des parcs éoliens se trouvent déjà sur l’aire de répartition des caribous de la Gaspésie-Atlantique, et trois autres sont en construction. Les éoliennes seront assez proches les unes des autres, et leur construction nécessitera probablement la coupe de la majeure partie de la forêt qui les sépare. L'extérieur du parc étant beaucoup moins propice à l'épanouissement des caribous, les connaissances actuelles suggèrent que le parc national de la Gaspésie est trop petit pour assurer, à lui seul, la conservation du caribou à long terme.
L'arrivée de nouveaux prédateurs
Les changements d'environnement créés par l’exploitation forestière peuvent être bénéfiques pour certaines espèces animales comme l’orignal, le coyote, ou encore l’ours noir. En effet, la régénération des feuillus favorise une augmentation de la densité des orignaux dans le parc. Ces nouvelles proies potentielles ainsi que le nouvel habitat, avec des zones d'aires ouvertes et des arbustes de végétation dense, sont à l'origine de l'arrivée massive des prédateurs. On a repéré pour la première fois des coyotes en Gaspésie en 1973, probablement attirés par les orignaux et la prolifération des lièvres d'Amérique dans les zones perturbées leur offrant de nouvelles aires ouvertes. Les ours eux, étaient également attirés par l'apparition de beaucoup de petits arbustes produisant des baies sauvages dont ils raffolent. Mais il faut savoir que les caribous, plus petits que les orignaux, sont malencontreusement la première ligne de mire de ces prédateurs. Ainsi, les chercheurs ont remarqué que l’augmentation des populations de coyotes et d’ours noirs exerçait une pression de prédation trop forte sur les faons des caribous et constituait ainsi l’une des principales causes de la disparition de la population de Gaspésie
La proximité avec l'Homme
L'aménagement du parc naturel en terrain récréatif pour les touristes présente aussi son lot de problèmes. En plus de créer des couloirs de dispersion pour les prédateurs via les chemins destinés au public, les visiteurs dérangent les cervidés. Les chemins/routes du parc sont très défavorables aux caribous qui n'osent souvent pas les traverser. Cela a pour conséquence de diminuer la taille de leurs habitats et de séparer les différentes parties de la population. Des études ont aussi montré que les animaux se déplaçaient beaucoup plus du fait des stress induits par la proximité avec l'humain. En effet, cela leur cause une fatigue supplémentaire et de ce fait augmente leur vulnérabilité face aux prédateurs.
SIA-QC-Topo+
Initiatives de protection
Suppléments - Écologie
Depuis, plusieurs années un plan de rétablissement du caribou forestier] est mis en place au Québec. L'équipe de rétablissement du caribou forestier qui est mandatée par le gouvernement, regroupe plus de 40 experts d'horizons différents. Ils sont chargés de la coordination du plan de rétablissement du caribou. Pour tenter de sauver ceux du parc de la Gaspésie, cette équipe a dû, en premier lieu, contrôler l'effectif des prédateurs présents, notamment en abattant certain de ces animaux, particulièrement à la période où il y a des faons. Mais ces décisions posent évidemment des problèmes éthiques à long-terme. Les grands objectifs du plan actuel (2013-2023) de restauration du caribou forestier à l'échelle du Québec sont :
(1) la préservation des habitats du caribou,
(2) le maintien des effectifs, via l'amélioration du taux de survie des caribous, en effectuant un suivi démographique régulier et en préservant toutes les hardes actuelles,
(3) l'obtention de l'appui du public et de l'implication des Premières Nations,
(4) la poursuite de l'acquisition de connaissances.
L'aménagement forestier Du fait de ses nombreuses menaces, une grande partie de l'effort de sauvegarde du caribou de la Gaspésie-Atlantique passe par un contrôle strict de l'état de son habitat et par des tentatives d'amélioration de ce dernier en correspondance avec les besoins des caribous. Ces objectifs sont discutés et établis à l'occasion de la sortie du "Plan d’aménagement forestier de l’aire de fréquentation du caribou de la Gaspésie (2013-2018) ", tous les 5 ans. On a ainsi recours à la planification écologique pour améliorer la gestion du parc.
Le plan propose d'encourager un aménagement basé sur des coupes partielles afin de conserver une quantité intéressante de lichens et de minimiser la création d'habitats qui avantagent les prédateurs et les proies alternatives telles que l'orignal. Des normes ont ainsi été créées au niveau de l'exploitation forestière dans l'aire de fréquentation du caribou. Dans les zones de conservation, aucune intervention visant à la production forestière n'est autorisée, hormis certains traitements sylvicoles qui contribuent à l'augmentation de la production de lichens et à la création d'habitats accueillants pour les caribous. Dans l'aire d'aménagement, il est conseillé de développer des structures inéquiennes, c'est-à-dire des forêts qui contiennent des arbres de tous âges et diamètres. Par là, on espère conserver des îlots de forêts matures porteur de lichens. Les réglementations changent et sont adaptées en fonction de l'altitude considérée.
Les objectifs généraux sont de conserver au moins 50 % de l'abondance historique des vieux peuplements d'arbres dans les unités où il y a directement présence de caribous et 30 % dans les unités alentour. On compte aussi contrôler la quantité de jeunes peuplements. L'équipe veut maintenir un couvert forestier qui soit supérieur à 4 m de haut (soit 30 ans d'âge ou plus) sur au moins 84 % du territoire forestier et favoriser le couvert par des résineux à longue durée de vie. Finalement, la priorité est de préserver au maximum le lichen arboricole, qui ne peut s'établir pleinement que dans des massifs forestiers qui ont plus de 90 ans. On veut aussi augmenter la protection des sommets comprenant un faciès de toundra, paysages particuliers essentiels aux caribous de la Gaspésie
SIA-QC-Topo+
Suppléments - Écologie

et protéger ce qui correspond aux corridors de déplacement du caribou. Une autre initiative est de restaurer des massifs forestiers continues dans toutes la zone d'aménagement, en reboisant notamment certains chemins forestiers
Le contrôle des prédateurs
La sensibilisation du grand public
Aujourd'hui un contrôle des populations de prédateurs, particulièrement des populations de coyotes, mais aussi des populations d'ours est effectué dans le parc de la Gaspésie. Des opérations de trappage sont mises en place dans le cadre du plan de rétablissement du caribou (2013-2023). Le but étant de diminuer les pressions de prédations particulièrement sur les jeunes et ainsi d'augmenter le taux de survie des faons. Ces techniques se révèlent être des solutions efficaces. Mais ces pratiques de contrôle des populations de prédateurs peuvent soulever plusieurs problèmes éthiques, de financement et d'acceptabilité sociale auprès des populations. Elles ne sont donc envisagées que comme des solutions de court terme.
Dans l'objectif d'atteindre une meilleure protection, il y a une forte médiatisation autour de la protection des caribous de la Gaspésie-Atlantique. Les responsables du parc tentent de sensibiliser les visiteurs face à l'importance de préserver cette population relique emblématique. Plusieurs études ont montré que l'intégration du public dans les prises de décisions et l'établissement des plans de protection rendait ces derniers plus efficaces. D'autre part, dans le but de diminuer le stress auquel est exposé cette population fragile, les gestionnaires du parc ont décidé de fermer au public, pendant une période de l'année, une grande partie des sentiers. Ceci afin de faciliter la restauration du milieu forestier et de créer un espace refuge pour l'espèce.
Le suivi de la population Les caribous de la Gaspésie-Atlantique sont maintenant recensés chaque année à l'aide d'observations par hélicoptère. On en dénombrait 54 en 2017 et on estimait donc que leur population devait se trouver autour de 75 individus. La population est stable depuis quelques années, mais toujours dans un état précaire. La mise en place du plan de conservation, demande un contrôle régulier des hardes, notamment du taux de faons présents chaque année. Les objectifs sont actuellement d'avoir plus de 17 % de faons dans chaque harde. On estime que ce taux est le minimum nécessaire pour permettre à la harde de se régénérer naturellement. Le nombre de faons dépend évidemment de si l'environnement est favorable et du nombre de prédateurs qui y sont présents.
Par ailleurs, les nouvelles données offertes par la télémétrie sont aujourd'hui utilisées pour tenter de mieux comprendre les déplacements et les comportements des hardes et des individus. Cela permet aussi d'avoir des indices plus spécifiques quant aux taux de survie des caribous de la Gaspésie-Atlantique. Les données télémétriques guident les gestionnaires de la biodiversité dans leur choix des zones géographiques à protéger en priorité.
Autre ressource Caribou des bois, écotype montagnard, population de la Gaspésie (Gouvernement du Québec)
Source : Wikipedia
SIA-QC-Topo+
Index Mont Logan
Collectif Caribou
Réserve écologique de Manche d’Épée
La réserve écologique de Manche-d'Épée couvre une superficie de 573,24 hectares.
Cette réserve écologique assure la protection d'une érablière sucrière à bouleau jaune située dans une vallée encaissée et sur un substrat calcaire. Cette communauté végétale est rare en Gaspésie.
La vallée du ruisseau du Manche d'Épée est typique des vallées gaspésiennes orientées nord-sud. Elle est fortement encaissée; à son extrémité nord, elle s'étale sur une largeur de quelque 300 mètres et son altitude ne dépasse pas 20 mètres, mais les pentes sont fortes. En gagnant l'arrière-pays, le fond de la vallée se rétrécit et se relève tandis que la déclivité augmente; l'altitude y atteint alors 400 mètres.
Les roches du massif appalachien sont composées de calcaires, d'ardoises et de schistes argileux. Les flancs de la vallée du ruisseau du Manche d'Épée sont tapissés de talus et cônes d'éboulis. Les parois verticales demeurent dynamiques sous l'action du gel et du dégel, participant du même coup au rajeunissement des dépôts par de nouveaux apports. Les parties inférieures des talus sont plus stables et plus âgées alors que les platières bordant le ruisseau sont constituées d'alluvions récentes. Les sols sont de types régosols et brunisols; ils sont généralement peu profonds et bien drainés.

Au point de vue végétation, le fond de la vallée, là où les sols sont les mieux développés, est colonisé par l'érablière sucrière à bouleau jaune typique. La sapinière à érable à sucre et l'érablière à bouleau jaune et polystic faux-lonchitis marquent ensuite le bas versant alors que, plus en altitude, les pentes fortes sont colonisées par la sapinière à bouleau blanc et mousses. Enfin, les milieux les plus secs qui leur font suite, à plus haute altitude, appartiennent à la sapinière à thuya occidental et pin blanc.
Notons enfin que le polystic faux-lonchitis, espèce d'érablière susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable, a été recensé dans la réserve écologique.
Réserve Manche d’Épée
Source : Ministère de l’Environnement du Québec
- Écologie SIA-QC-Topo+
Suppléments
Index
Réserve écologique de Mont-Saint-Pierre
La réserve écologique de Mont-Saint-Pierre couvre une superficie de 643 hectares. Elle s’étend sur environ cinq kilomètres du versant est de la vallée glaciaire encaissée de Mont-Saint-Pierre qui s’engouffre dans les montagnes. En plus du versant sur lequel s’observent d’importants talus d’éboulis, la réserve écologique comprend aussi le plateau surplombant le versant.
Une somme de plus de 20 ans de connaissances scientifiques sur la complexité et la dynamique des phénomènes géologiques et géomorphologiques qui façonnent les versants de la vallée de Mont-Saint-Pierre, et l’analyse de la répartition et de l’abondance des plantes menacées ou vulnérables de ce territoire, ont permis de justifier cette réserve écologique.
La réserve écologique de Mont-Saint-Pierre protège des versants qui évoluent sur des formations géologiques hautement friables. Les versants présentent des falaises rocheuses qui alimentent des talus d’éboulis actifs. Sur ces versants, de nombreux processus géomorphologiques ont lieu : désagrégation des parois rocheuses, coulées, roulement de blocs, glissement sur la neige et sur la glace, coulée de pierres glacées, avalanches., etc..
Le couvert végétal appartient au domaine de la sapinière à bouleau jaune et à celui de la sapinière à bouleau blanc . Il est surtout dominé par le sapin baumier , alors que le thuya occidental abonde dans les bordures. Dans la partie supérieure des versants, sur les pierriers, poussent des clones isolés de thuyas, trapus et denses, en forme de krummholz, qui témoignent de l’action éolienne intense. Les études sur la couverture forestière montrent que sur l’ensemble des talus d’éboulis actifs, la forêt est en régression au profit des pierriers.
La réserve écologique de Mont-Saint-Pierre assure la protection de 60 % de la population québécoise de l’astragale australe. Cette plante, qui figure sur la liste des plantes désignées menacées ou vulnérables au Québec, ne se trouve que dans trois localités au Québec, dont la population la plus importante est à Mont-Saint-Pierre.
La constitution de la réserve écologique de Mont-Saint-Pierre assure le maintien à l’état naturel d’un fabuleux laboratoire de recherche scientifique et protège des éléments importants de la diversité écologique du Québec. De plus, elle garantit la sauvegarde d’un paysage exceptionnel.
Index
Réserve St-Pierre
Source : Ministère de l’Environnement du Québec
SIA-QC-Topo+
Suppléments - Écologie
Réserve écologique Fernald
La réserve écologique Fernald assure la protection d'une portion de l'imposant versant nord des monts Chic-Chocs où se retrouvent des groupements végétaux appartenant aux domaines climaciques de la sapinière à bouleau jaune, de la sapinière à bouleau blanc et de la sapinière à épinette noire. Ces domaines climaciques sont représentés par des éléments des trois régions écologiques suivantes: Lac Matapédia et Gaspésie, Bas et Moyens Monts NotreDame et Monts Chic-Chocs. Également, la réserve écologique protège des espèces floristiques désignées et susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables.
Le relief du territoire de la réserve écologique est vallonné dans la partie inférieure du versant. La déclivité prend de l'ampleur entre les 250 et 450 mètres d'altitude et s'accentue brusquement pour atteindre les sommets aplatis (tables) des monts Collins, Mattawees et Fortin à une altitude de près de 1 100 mètres.
Les glaciers du Wisconsin ont couvert l'ensemble du territoire. Ils ont mis en place une couverture de till dans la partie inférieure des versants de faible déclivité et ont modelé des cirques dans les versants abrupts. Ces derniers, au pied desquels se sont accumulés des dépôts surtout constitués de roc.
La végétation qui colonise le versant des monts Chic-Chocs s'organise selon une séquence altitudinale. La partie inférieure du versant jusqu'à l'altitude de 450 mètres est l'hôte de l'érablière à sucre et de l'érablière à bouleau jaune et sapin. Entre les altitudes de 450 à 700 mètres, l'érablière fait graduellement place à la sapinière à sapin baumier et à la sapinière à bouleau blanc. À mi-pente, la sapinière se transforme graduellement en forêt subalpine ouverte et, sur les hauts de pente et les sommets, elle est remplacée par la forêt rabougrie (krummolz).
Les crêtes dénudées et les parois rocheuses exposées comportent une flore alpine diversifiée dont certaines espèces sont désignées menacées ou vulnérables ou sont susceptibles d'être ainsi désignées. Les principales espèces, incluant celles des milieux humides à drainage oblique, sont: l'Arnica de Griscom et le Séneçon fausse-cymbalaire, qui sont désignées, l'Arnica à aigrette brune, la Gnaphale de Norvège, le Pâturin de Fernald et la Saxifrage des neiges qui sont susceptibles d'être désignées.
Le toponyme de la réserve écologique est donné en l'honneur de Merritt Lyndon Fernald (1873-1950) qui a fait connaître, à l'échelle mondiale, la flore des Chic-Chocs. Parmi les territoires explorés par Fernald et dont il révéla la richesse, citons les environs des monts Logan, Coleman, Pembroke, Fortin et Matawees. Un passage entre ces deux derniers porte le nom de « Passe à Fernald ». En 1938, l'Université de Montréal le nomma docteur honoris causa et en 1949, l'Institut botanique de Montréal lui décerna la médaille Marie-Victorin.
Source : Ministère de l’Environnement du Québec
Suppléments - Écologie SIA-QC-Topo+
Index
Réserve Fernald
Réserve écologique de Ristigouche
La réserve écologique de Ristigouche est située dans la partie sud-ouest de la péninsule gaspésienne, à 5 kilomètres au sud-est du village de Saint-Andréde-Ristigouche (municipalité régionale de comté d'Avignon). Elle couvre une superficie de 473,37 hectares.
Le site assure la protection d'écosystèmes représentatifs de la région écologique de la Baie des Chaleurs, laquelle appartient au domaine de l'érablière à bouleau jaune et de la sapinière à bouleau jaune.

Le relief de la réserve écologique est constitué de deux plateaux entrecoupés par deux vallées. Les plateaux atteignent une altitude de 275 mètres, tandis que les vallées, où coulent les ruisseaux Fraser et Flatland, sont respectivement à 125 et 80 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le substrat rocheux appartient à la série de Matapédia de la formation appalachienne. Ardoises, quartzites, schistes et calcaires le constituent. Ces roches sont principalement recouvertes d'un till mince.
Quant à la végétation, on reconnaît l'érablière sucrière à bouleau jaune et la sapinière baumière à thuya occidental sur le plateau, la sapinière à bouleau jaune au bas versant du plateau, la cédrière à sapin, l'aulnaie et un groupement à cornouiller stolonifère au fond des vallées.
Parmi les espèces floristiques représentant l'érablière à bouleau jaune du plateau, un seul individu de hêtre à grandes feuilles a été recensé; l'espèce a atteint ici la limite nord de son aire de distribution.
Du côté de la faune, les castors sont présents et abondants; leurs barrages causent des inondations qui ont entraîné la mort de quelques arbres.
Un échantillon d’érablière à bouleau jaune de la Baie-des-Chaleurs : la réserve écologique de Ristigouche.
Source : Ministère de l’Environnement du Québec
Suppléments - Écologie SIA-QC-Topo+
Index Carte
Trait distinctif
Forme du visage
Suppléments
Caribou des bois ou orignal ?



Caribou des bois

Orignal
Sa queue avec zone blanchâtre. Sa bosse pointue. Ornée de longs poils foncés.
Coloris de tête et visage
• Petites oreilles
• Petite tête de forme triangulaire
• Grosse tête de forme rectangulaire
• Gros nez bulbeux et recourbé qui dépasse sa mâchoire inférieure
• Grandes oreilles
• Repli de peau poilu (fanon) sous la gorge
SIA-QC-Topo+
- Écologie
• Tête : nuance de brun
• Pelage : Du brun au blanc


• Museau : Poils couleur foncé, de brun à noir
Coloris du corps Été Hiver
• Tête : Couleur généralement uniforme (brun à brun foncé)
Bois
Ventre, flancs et cou plus pâles que le dos et la tête, qui sont dans les teintes de brun
Presque blanc

• Couleur uniforme, brun à noir.
• Pattes grises, surtout les pattes arrière.
Mâle adulte
• Bois palmés et beaucoup plus longs, mais moins larges que l’orignal

• Merrains en forme de pelle projetés vers l’avant
Suppléments - Écologie SIA-QC-Topo+
Mâle adulte

• Bois larges et palmés.

• Andouiller frontal projeté vers l’avant
• Palmure principale s’étale vers l’arrière
Grosseur du corps et taille
Femelle adulte
Suppléments - Écologie
• Bois plus simples
• Il arrive parfois qu’une femelle n’ait qu’un seul bois, voire aucun
Femelle adulte
• Aucun bois
Jeune mâle et femelle
• Bois simple Jeune mâle et femelle
Les bois du jeune mâle orignal peuvent ressembler à ceux de la femelle du caribou.

Poids 80 à 200 kg 350 à 710 kg Épaules développées, formant une bosse pointue, recouverte de longs poils
Femelle Plus petite et moins massive À son premier automne, la taille du veau de l’orignal peut s’apparenter à celle de la femelle du caribou des bois.

SIA-QC-Topo+
1,7 à 2,5 m 2 à 3 m
1,7
Longueur
Hauteur 1 à 1,4 m
à 2,1 m
Source : Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Québec
Suppléments - Écologie SIA-QC-Topo+
 ©Catherine Auger
©Catherine Auger
SUPPLÉMENTS - GÉOLOGIE
Géologie du Mont-Albert
La formation géologique du mont Albert correspond à un ancien fond océanique. Lors de la première phase de formation des Appalaches, le fond de l’océan Iapetus a été charrié et transporté au-dessus de la Nappe du mont Logan par de puissantes poussées tectoniques. Les roches du mont Albert sont composées de cette croûte océanique.
Comment un fond océanique peut-il se retrouver au sommet d’une montagne?
À partir du milieu de l’Ordovicien (ère géologique, -460 Ma), l’océan Iapetus cesse son expansion et commence à se refermer. La croûte océanique subit alors de fortes pressions tectoniques qui la plissent, la cassent et la transportent sur le continent Laurentia. Certaines portions de la croûte océanique sont transportées sous forme de nappes de charriage. L’une d’elles est transportée par-dessus la Nappe de Logan selon un phénomène appelé obduction et devient la nappe du mont Albert. La majeure partie de la croûte océanique a été recyclée dans le manteau terrestre après avoir plongé sous le continent Laurentia dans une immense fosse océanique appelée zone de subduction et dont il ne reste plus aucune trace. La fermeture de l’océan Iapetus a donné naissance à une gigantesque collision continentale responsable de la formation de la chaine Taconienne. La nappe du mont Albert et celle qu’elle surmonte (Logan) ont été enfouies sous une épaisseur considérable de formations rocheuses charriées et déformées.
Ce n’est qu’au cours de la très longue séquence d’érosion qui suivit que l’érosion différentielle a pu mettre en relief ce lambeau témoin de l’ancien fond océanique. Ces roches plus dures que les formations rocheuses environnantes constituent l’ossature des monts Chics-Chocs.
Source : Histoire de la formation des Appalaches (Université Laval)
Suppléments - Géologie

SIA-QC-Topo+
Suppléments - Géologie
Chute Sainte-Anne.
La chute résulte d’une rupture de pente liée à une faille entre les basaltes en coussin et les calcaires.
Index
Lac aux Américains
Source : Inventaire patrimoine géomorphologique MRC Haute-Gaspésie, UQAR (pdf)
SIA-QC-Topo+

Lac aux Américains. Géomorphologie

L’amphithéâtre du Lac aux Américains est un cirque glaciaire qui résulte de l’érosion du substratum rocheux par un glacier de cirque. Un cirque glaciaire est une dépression semi-circulaire bordée de versants abrupts produite par abrasion et délogement de blocs à la base du glacier.
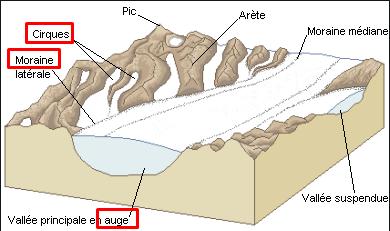
L’érosion glaciaire s’est concentrée au fond de la dépression et au bas des versants, ce qui explique le profil en auge de la dépression. Les portions de versants qui dominaient le glacier évoluaient sous l’influence de la cryoclastie (fragmentation de la roche sous l’effet des cycles gel-dégel), des avalanches et des chutes de pierres. Le cirque du Lac aux Américains fait partie d’un ensemble de cirques qui découpent les flancs du massif des monts McGerrigle .
Le glacier de cirque du Lac aux Américains alimentait un glacier de vallée qui a construit une petite moraine frontale à la sortie du cirque. Le glacier était alimenté par l’accumulation de précipitations solides. Initialement, les accumulations de neige pérenne (subsistent plus d’une année) subsistent au fond d’une dépression et se compactent pour se transformer en névé. L’accumulation de neige puis de névés toujours au même endroit accroit les pressions sur le névé qui se transforme éventuellement en glace. C’est ainsi que naissent et évoluent les glaciers au fil de centaines et de milliers d’années. Ce glacier mué par la gravité et par fluage interne commence à éroder le substratum rocheux et à y imprimer une morphologie particulière.
Suppléments - Géologie SIA-QC-Topo+
Suppléments - Géologie
Le cirque du Lac aux Américains résulte de ce lent processus qui s’échelonne sur des centaines et des milliers d’années. Ce cirque alimentait un glacier de vallée qui rejoignait un autre glacier de vallée plus grand; celui de la vallée de la rivière Sainte-Anne actuelle. La topographie de la vallée relate cet épisode d’érosion glaciaire. Les cirques qui découpent le pourtour des monts McGerrigle ont été occupés à deux reprises au moins, soit au début et à la fin de la dernière grande glaciation. La dernière période d’activité remontée vraisemblablement à moins de 10 000 ans.

Index
Source : Inventaire patrimoine géomorphologique MRC Haute-Gaspésie, UQAR

Lac aux Américains

SIA-QC-Topo+
© Denis Bouvier 2021
Géologie et géomorphologie Mont Jacques-Cartier
Deuxième plus haut sommet du Québec, après le mont d’Iberville (1652 m), et principal sommet du massif granitique des monts McGerrigle, le mont JacquesCartier est issu d’une intrusion magmatique durant l’orogenèse appalachienne. Celui-ci offre un paysage subarctique au centre de la Gaspésie. On y retrouve entre autres des reliques de climat périglaciaire comme des sols polygonaux, des sols striés et un profond champ de blocs. De plus, on y trouve du pergélisol sur une épaisseur se situant entre 70 et 100 m.
Au point de vue géologique, les roches que l’on retrouve dans le massif des monts McGerrigle possèdent des caractéristiques propres qui les distinguent des autres formations rocheuses régionales en Gaspésie. Le massif granitique des monts McGerrigle est unique sur le territoire de l’est du Québec. Celui-ci correspond à l’intrusion d’un batholithe sous les Appalaches il y 380 Ma. Ce batholithe qui a cristallisé à plusieurs kilomètres de profondeur au sein des jeunes Appalaches a été depuis exhumé par érosion différentielle.
Un batholithe correspond à une remontée de magma en provenance du manteau au travers de la croûte terrestre. Dans le cas du massif granitique du mont Jacques-Cartier, cette remontée magmatique s’est effectuée vers la fin des deux premières phases orogéniques à l’origine des Appalaches en Gaspésie. … La composition des roches granitiques et la structure cristalline nous informent qu’à cette époque le magma n’a pas atteint la surface et qu’il s’est refroidi très lentement en profondeur. Son sommet se retrouvait alors à 7 km sous la surface.
Depuis cette époque, les processus d’érosion ont déblayé les roches plus friables qui entouraient l’intrusion (érosion différentielle), ce qui a contribué à mettre en relief les roches dures du massif des monts McGerrigle, dominé dans sa partie nord par le mont JacquesCartier (1270 m) qui correspond au toit de l’intrusion.
Les principaux gisements métallifères de la Gaspésie sont issus de cette intrusion granitique. Les gisements de cuivre de Murdochville et des mines Madeleine résultent directement de l’intrusion. Les gisements sont tous situés en périphérie du massif dans l’auréole de métamorphisme. Lorsque le magma pénètre dans les fissures des roches encaissantes, une « cuisson » s’opère. Cette cuisson à haute pression et haute température change les structures minérales de la roche, d’où le terme de métamorphisme. Si de l’eau est présente à l’intérieur des fissures lorsque le magma se met en place, la minéralisation métallifère est très active; c’est pourquoi l’histoire de la prospection minière est si riche dans les monts McGerrigle.
La dernière séquence d’érosion très active ayant contribuée à la mise en relief des monts McGerrigle est la période quaternaire. Bien que cette période soit relativement brève (1,6Ma), elle a tout de même laissé de profondes marques dans le territoire. Cette période géologique est caractérisée par des variations climatiques importantes et rapides qui ont engendré de nombreuses périodes glaciaires. On n’en compte pas moins de huit depuis un million d’années , mais c’est bien sûr la dernière qui a laissé les traces les plus visibles dans le paysage. Les glaciers ont une grande force érosive et ils peuvent façonner le territoire, mais leur action est souvent très localisée. Du sommet du mont Jacques-Cartier, la force érosive des glaciers de la dernière glaciation est facilement appréciable.
Le pergélisol et les nombreux cycles gel-dégel qui affectent les hauts sommets gaspésiens ont favorisé le développement de nombreuses formes périglaciaires tels les talus d’éboulis, les champs de blocs, les glaciers rocheux, les sols polygonaux et les sols striés.
Les sols triés et striés
- Géologie SIA-QC-Topo+
Suppléments
Suppléments - Géologie SIA-QC-Topo+
Les polygones de blocs que l’on peut observer au sommet du mont Jacques-Cartier ont une origine périglaciaire. La succession des cycles gels-dégels engendre des variations de volume (gonflement des sols gorgés d’eau lors de la congélation) qui se traduisent à terme par le tri les matériaux en fonction de leur taille. Le centre des polygones est légèrement bombé lorsque le sol est gelé et les particules grossières sont lentement entrainées vers l’extérieur par gravité.

Ainsi, après quelques milliers de cycles, on obtient un tri presque parfait. Le centre des polygones évolués est constitué de sol meuble alors que les cloisons sont composées de blocs (Fig. 1). La présence d’un pergélisol imperméabilisant à faible profondeur sous la surface favorise les processus cryogéniques en gardant l’eau disponible près de la surface. Sur les surfaces horizontales, les processus cryogéniques ont tendance à produire des formes quasi circulaires. Lorsque la pente de la surface dépasse 2,5 à 3°, les sols triés évoluent en polygones allongés puis, passé 5°, ils se déchirent donnant naissance à des bandes parallèles appelées sols striés (Fig. 2 et 3).
 Figure 1. Polygones de matériaux triés.
Figure 2. Sol strié.
Figure 1. Polygones de matériaux triés.
Figure 2. Sol strié.

Suppléments - Géologie SIA-QC-Topo+
Figure 3
Déformation des cercles de pierres en fonction de la pente. Quand la pente excède 5 degrés, on passe à des sols en bandes appelés sols striés.
Index Mont Jacques-Cartier
Source : Inventaire patrimoine géomorphologique MRC Haute-Gaspésie, UQAR
L’énigme du «radar» du mont Jacques-Cartier
Texte de Marcel Descarreaux Photos : Archives Canada
Beaucoup d’entre vous avez mis le pied un jour ou l’autre sur le sommet du mont Jacques-Cartier, dans le Parc national de la Gaspésie. Les vestiges de fondations de béton sur le sommet de la montagne ont peut-être attiré votre curiosité. Si vous vous êtes informés sur leur origine, on vous a probablement répondu que c’était les ruines d’une ancienne station de radar datant de la dernière guerre mondiale.
En fait, les résidents de la région n’ont jamais su grand-chose sur cette histoire. Il faut dire que les militaires impliqués à l’époque, probablement tous anglophones, n’ont vraiment jamais fraternisé avec la population locale; d’abord à cause de la barrière de la langue, et ensuite à cause des ordres des officiers supérieurs de ne pas le faire. Depuis ce temps et à maintes reprises, des gens de la Gaspésie et d’ailleurs ont voulu en savoir plus auprès des autorités fédérales, mais sans beaucoup de succès. Nous pouvons aujourd’hui consulter certains documents, autrefois hors de la portée des yeux. Ils nous révèlent des choses intéressantes, sans toutefois tout dire. On sait, du moins aujourd’hui, que la dite « station de radar » était en réalité une station de relais sans-filiste qui a jouté un rôle important durant les années de guerre.
La Gaspésie en guerre!
Au début des années 40, la guerre fait rage en Europe. Notre pays supporte l’Angleterre par l’envoi massif de troupes, de matériel et de victuailles de toutes sortes. Les Canadiens, même ceux sur la côte est du Canada, se sentent en sécurité relative à cause de l’éloignement du conflit. Tout va changer quand les sous-marins allemands viennent semer la terreur sur nos côtes dans un événement connu comme la bataille du Saint-Laurent (et ici). En tout, 28 bateaux alliés seront attaqués et 23 coulés, causant ainsi des centaines de pertes de vie dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent.
Pourtant, encore aujourd’hui, la plupart des Québécois ignorent complètement l’existence de cette bataille maritime qui, il y a plus de 60 ans, aurait pu changer le cours de l’Histoire. Il faut dire qu’à l’époque, le gouvernement canadien a imposé la censure – à juste titre d’ailleurs – à la presse, pour empêcher de rapporter ces événements qui auraient pu semer la panique dans la population. Les autorités militaires canadiennes n’avaient pas prévu une telle audace de la part des Allemands et se sont fait totalement prendre au dépourvu. C’est ainsi que ces sous-marins ennemis ont pu semer la terreur le long de nos côtes en toute impunité. Plus spécifiquement en terre québécoise, seize navires ont été attaqués entre (approximativement) Mont-Joli et Gaspé autour de la péninsule gaspésienne, et trois autres près de la Pointe-des-Monts sur la Côte-Nord.
Le tout a débuté d’une drôle de façon. D’abord, un pêcheur côtier affolé rapporte qu’il a vu de ses yeux un tuyau de poêle se déplacer à la verticale dans l’eau. Un gardien de phare plus futé réalise rapidement qu’on a affaire à un périscope de sous-marin et réussit à entrer en contact avec la base de la Royal Canadian Navy à Gaspé. Malheureusement, le Gaspésien ne parle que le français et l’officier anglophone, à l’autre bout du fil, ne comprend que l’anglais. En fin de compte, ils ne se sont jamais compris. Il faudra attendre qu’un premier navire soit coulé, avec pertes de vie, le 12 mai 1942 au large de Gaspé, pour que la Navy comprenne que les sous-marins allemands naviguaient dans nos eaux; la bataille du Saint-Laurent était commencée! Plusieurs de nos bateaux alliés
SUPPLÉMENTS - HISTOIRE
seront ainsi attaqués dans les mois suivants. Suivra une accalmie dans l’estuaire du Saint-Laurent en 1943, mais les Allemands reviendront en 1944 avec d’autres torpillages sur la Côte-Nord.
Les Gaspésiens connaissent aussi la guerre d’une autre façon, soit par des milliers d’avions militaires (plus de 10 000) qui passent au-dessus de leurs têtes. A partir de Dorval, à l’ouest de Montréal, sur un aéroport nouvellement aménagé, le Ferry Command a pour mission de convoyer, par la voie des airs, d’innombrables bombardiers et avions de transport vers l’Écosse. Ils survolent la Gaspésie en direction de Goose Bay (Terre-Neuve) pour une escale de ravitaillement avant de se diriger vers le Groenland et de traverser l’Atlantique.
Le détachement du relais sans-filiste no 1
Tel est le nom (du moins dans sa traduction approximative) de l’installation militaire aménagée sur le mont Jacques-Cartier en 1943. Le gros défi sera la construction et l’entretien d’un chemin d’accès d’une trentaine de kilomètres, entre le village de Mont-Saint-Pierre et le sommet de la montagne. Pour empirer les choses, l’été 1943 en est un extrêmement pluvieux, ce qui rend la tâche encore plus difficile.

Le ravitaillement sera toujours un problème durant toute la durée de service de la station. A l’approche de l’hiver, on devra stocker la nourriture sur la montagne pour les mois suivants sans approvisionnement extérieur. Durant la saison froide, le service du courrier est assuré par des gens de Mont-Saint-Pierre, à l’aide de traîneaux à chiens.
Néanmoins, à partir du mois de septembre de la même année, la station devient opérationnelle pour relier par radio les bases militaires de la région (Bagotville, Mont-Joli, Sept-Iles, Matane, Mingan et Gaspé) et les nombreux avions de l’armée qui survolent la région. Sur le sommet de la montagne se trouvent plusieurs bâtiments temporaires et quatre immenses tours de radio. Les hommes (on dit jusqu’à 14 à la fois) vont y habiter en permanence pour assurer l’opération et l’entretien de la station connue comme le détachement du relais sans-filiste No 1.
Après la guerre
Toutes les activités militaires cessent sur la montagne avec la défaite de l’Allemagne en 1945. Pendant les années qui suivent, les installations sont laissées intactes pour en faire éventuellement une station d’observation météorologique du gouvernement canadien. Finalement, en 1952, un appel d’offres est lancé pour la démolition de toutes les installations, ce qui mettra fin définitivement à l’existence de la station. Un homme d’affaires de Rimouski récupère, en autres choses, tout le matériel téléphonique et électronique. A l’automne de 1975, l’armée canadienne vient nettoyer le site de la base qu’elle avait occupée 30 ans auparavant.
Suppléments - Histoire SIA-QC-Topo+
Suppléments - Histoire SIA-QC-Topo+
Aujourd’hui, le mont Jacques-Cartier est une belle destination de randonnée avec un point de vue splendide sur toute la région, une véritable « mer de montagnes ». On se plaira à savoir que c’est le plus haut sommet du Québec, après le mont d’Iberville, dans les Torngats.
De ce que fut l’installation militaire sur le sommet de la montagne, il ne reste que quelques fondations de béton. Les gardes du parc ont ramassé les derniers bouts de ferraille qui restaient, parce que les caribous avaient tendance à les lécher! On a peine à croire aujourd’hui que ces lieux ont été témoins d’une période aussi mouvementée de notre histoire.

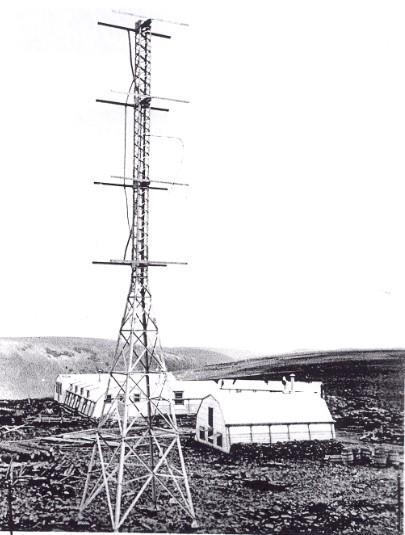
Supplément : La Deuxième Guerre mondiale : au bord d’un conflit
Suppléments vidéo : La bataille du Saint-Laurent aux portes de Forillon et La deuxième guerre mondiale en Gaspésie
Index Carte topo
Mont Jacques-Cartier
Les Micmacs (Mi’kmaq)
Les Micmacs ou Lnu sont un peuple autochtone de la côte nord-est d'Amérique, faisant partie des peuples algonquiens. Il y a aujourd'hui vingt-huit groupes distincts de cette ethnie au Canada, et une seule bande, la « Aroostook Band of Micmacs (en) (bande de Micmacs d’Aroostoock) », aux États-Unis.
Arrivés il y a plus de dix mille ans, ces « premiers hommes », comme ils se nommaient, venus de l'Ouest via le détroit de Béring, étaient déjà présents dans cette partie du monde bien avant l'arrivée des Vikings puis des Européens.
Les Micmacs se sont progressivement installés dans la péninsule de la Gaspésie au Québec. Puis, ils conquirent plusieurs régions du Canada, à savoir : la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard, une partie du Nouveau-Brunswick et l'île de Terre-Neuve.
Les Micmacs sont arrivés dans la région de la Gaspésie il y a environ 3 000 ans. Ceux-ci vivaient, à l’époque, de chasse et de pêche la majorité de l’année, ainsi que de cueillette de crustacés et de fruits. Lors de l’hiver, les Micmacs, étant nomades, se déplaçaient dans la forêt et vivaient surtout de chasse de différents animaux, dont l’orignal et le castor.
Ethnonyme
« Micmac » signifie « mes frères » ou « mes amis » ; c'est le nom que se donne une nation de la Gaspésie, mot dérivé du micmac signifiant « fin de la terre »8. Parmi les variantes du nom, on trouve « Migmagi », « Mickmaki » et « Mikmakique ». Il y a plusieurs sous-groupes parmi les Micmacs, comme les Gaspésiens de Le Clercq (au Québec oriental), les Souriquoisn. 1 de la tradition jésuite (au centre et au sud de la Nouvelle-Écosse). Le qualificatif de « Tarrantine » fut introduit par les Britanniques au XVIIe siècle.

Le mot micmac, d'une toute autre origine, fait son apparition en français dans les années 1640. On trouve en français au début du XVIe siècle micquemacque « intrigue, agissements suspects » que l'on retracerait au latin migma, migmatis ou bien à mutemaque. Quand les Français ont entendu le micmac parlé en Gaspésie, ils ont immédiatement songé à leur acception du mot, qui prit le sens au Canada de langage incompréhensible.
Index Amqui Grande-Vallée Matane Matapédia Matawees Restigouche
Source : Wikipédia
- Histoire SIA-QC-Topo+
Suppléments
La déportation de Gaspé
Mario Mimeault, Ph. D. Histoire. Gaspé, 25 juin 2002, 2017
La Guerre de Sept ans (1741-1748) puis celle de la Conquête (1755-1760) marquent la fin du régime français. La Gaspésie est aux premières loges. À l’été 1755, c’est la chute de Louisbourg et, dès celui de 1746, un navire anglais patrouille la baie de Gaspé pendant deux jours. En juillet 1747, trois corsaires sont repoussés par les armes à Grande-Rivière. En 1755, c’est la déportation des Acadiens de la Nouvelle-Écosse puis, pour une deuxième fois, la chute de Louisbourg et de ses habitants à l’été 1758. Le même été, les Anglais vident l’île Saint-Jean. C’est clair, les troupes britanniques préparent la remontée du Saint-Laurent et, pour ce faire, assurent leurs arrières en éliminant toute poche de résistance possible. En septembre de la même année 1758, un an presque jour pour jour avant la célèbre bataille des Plaines d’Abraham, c’est la déportation de Gaspé.
Le propriétaire des lieux, Pierre Revol
Le principal établissement de pêche de la baie de Gaspé appartient, à l’été 1758, à un Canadien français appelé Pierre Revol. Exilé en Nouvelle-France pour contrebande du sel, cet entrepreneur choisit de faire du commerce et de se livrer à la pêche de la morue. Il s’installe à Gaspé en 1752 et il amène tout de suite quarante hommes sur les lieux, mais, déjà en octobre de la même année, les autorités y dénombrent trois cents personnes au moins, sans compter ceux qui ont passé l'été comme pêcheurs saisonniers.
Les eaux gaspésiennes n’étant pas des plus tranquilles, Revol fait dans les années qui suivent plusieurs fois appel aux autorités coloniales pour qu’elles lui apportent une protection. L’intendant Bigot lui envoie en 1756 cent vingt hommes « tant français que canadiens » pour constituer des compagnies de milice. Le contingent est augmenté à deux cents hommes à la fin de l'année. Au total, l’établissement de Gaspé compte alors au moins cinq cents personnes. À l’été suivant, celui de l’année 1757, les pêcheurs désertent le poste et des difficultés d'approvisionnement obligent le gouvernement colonial à rapatrier ses miliciens à Québec. Ne restent plus avec le propriétaire des lieux qu’une soixantaine de personnes pour défendre ses installations. Mais à quoi ressemble cet établissement ? Est-il si important?
L'établissement de Gaspé (1758)
Il est possible de reconstituer de façon presque certaine l'établissement de Pierre Revol dans la baie de Gaspé grâce à une carte établie par l’aide de camp du général Wolfe. À l’entrée nord de la baie, au sommet de la pointe de Forillon, du côté faisant face au golfe Saint-Laurent, le gouvernement a placé une sentinelle pour surveiller l’arrivée des ennemis et l’en avertir. Pierre Arbour y a vécu avec sa femme les étés précédents, mais, à l’été 1758, il n'y a personne en poste. Revol a besoin de tout son personnel à son établissement. Ce sera d'ailleurs là que Wolfe rencontrera Arbour quelques heures après son arrivée dans le bassin de Gaspé. À l’extrémité de Forillon, se trouvent six maisons à l'endroit appelé aujourd’hui l’Anse-aux-Sauvages ou Anses-aux-Amérindiens (Indian Cove). Au moins une famille et cinq Français y vivent. Il y a aussi, juste à côté, Grande-Grave, un poste de pêche fréquenté surtout par les pêcheurs européens, mais il est déserté cet été-là. En pénétrant dans la baie, jusqu'à l'endroit appelé aujourd'hui Penouille, des cabanes de pêcheurs ont été construites, si on se fie à des fouilles archéologiques menées dans les années 1980 et 1990.
Enfin, dans le bras nord de la baie de Gaspé, appelé aujourd’hui rivière Dartmouth, six autres maisons se trouvent de part et d'autre du plan d'eau et deux autres habitations tout au fond. L'établissement principal de Revol est situé à l'embouchure de la rivière York, tout près, aujourd’hui, de la marina. Une gravure réalisée par le peintre de l'expédition, Hervey Smyth, représente sa maison, entourée de quatre petites cabanes de pêcheurs, d’un magasin et d’une forge. À l'intérieur
- Histoire SIA-QC-Topo+
Suppléments
du bras sud de la baie de Gaspé, (le bassin de Gaspé de nos jours), plusieurs maisons bordent les deux rives, sept ou huit probablement. Tout au fond, Revol a fait reconstruire un moulin à scie pour remplacer l'ancien, en ruine. Boscawen écrit plus tard, dans le bilan de l'expédition des troupes anglaises à Gaspé, qu'il y avait là sept maisons.
Il existe aussi un autre établissement au fond de la Malbaie, à l'endroit même de l'actuel village de Barachois. Revol y a installé un engagé en 1754 pour cultiver la terre. Il a mis sous contrat Guillaume Cochery et sa femme, tous deux de Saint-Malo. Originellement, l'établissement appartenait à François Thibodeau, mais il devient sa propriété à la faveur d’un accord passé entre les deux hommes en 1754. Les pêcheurs établis en permanence à cet endroit ont pour noms Guillaume Cochery, François Vincent, Augustin Bolanger, Baptiste Gagutry, Jean Caneyhou et Robert Gilbert. S’ajoute à la liste Jean Chicoine qui demeure à la Pointe-SaintPierre depuis un temps indéterminé.
La menace anglaise
En cet été 1758, la stratégie anglaise est bien connue : trouver un point d'appui à partir duquel ils pourront surveiller l'entrée du Saint-Laurent et ainsi couper la colonie française de sa mère-patrie. L'aide de camp de Montcalm, Monsieur de Bougainville, le signale dans un rapport sur les mesures à prendre en cas d'attaque. Il n’est malheureusement pas écouté et, de toute manière, son avis arrive trop tard. À ce moment, Wolfe reçoit les ordres de l'amiral Boscawen de se rendre sur la côte de la Gaspésie pour écarter la présence française, il vient avec une escadre de quatorze navires. C’est à sa tête qu’il y débarque le 4 septembre.
Les Anglais découvrent à leur arrivée le piètre état de la petite colonie française. Elle se meure presque de faim et Revol est d’ailleurs décédé quelques jours avant. Les troupes s’emparent des bâtiments sans coups férir. Il y a en plus 6 000 quintaux de poisson, des munitions, des agrès de pêche, des animaux. Pierre Arbour vient leur dire que les habitants ont fui au fond des baies. Le 7 septembre, les hommes de Wolfe entrent plus avant dans le bras Sud-Ouest de la baie de Gaspé (celui de la rivière York) où ils prennent huit hommes. Ils trouvent tout au fond le moulin à bois de Revol et l’incendient avec toutes les planches et les maisons aux alentours. En revenant avec les prisonniers sur les berges de la baie, les soldats trouvent deux femmes et leurs enfants. Dans les jours qui suivent, les soldats se partagent les prises et un détachement capture douze autres Français puis les ordres sont donnés de tout brûler, après quoi l'armée se retire à Grande-Grave.
Le sort des prisonniers
Le bilan des prisonniers capturés par les soldats de Wolfe est de trente-sept hommes, quatre femmes et cinq enfants, pour un total de quarante-six personnes. Les autres résidants ont fui jusqu’à Québec à travers bois. L’amiral Boscawen chiffre à 6 000 le nombre de quintaux de morue détruits. Comme il estime luimême le quintal de morue à 40 Livres sur le marché de Québec pour l'époque, Revol eut fait, s'il eut survécu à la catastrophe, des profits bruts de 240 000 Livres. Un désastre à tous les points de vue.
Après la prise de l'île Saint-Jean (Île-du-Prince-Édouard), les Anglais organisent l'évacuation des prisonniers acadiens vers la France, comptant laisser ainsi tout le poids de leur entretien à son monarque. Lorsque Wolfe revient à Louisbourg, à l’automne, il n'a donc qu’à mettre les prisonniers de la côte de Gaspé dans les mêmes bateaux qu’eux. Seulement vingt-trois personnes de Gaspé sont cependant amenées sur L'Antelope et débarquent à Saint-Malo le 1er novembre. Que sont devenues les autres ? Nul ne le sait. Dans quelle condition ont-elles traversé l’océan ? Que seules deux personnes sur quatre-vingt-trois passagers soient dites saines à leur arrivée montre la sévérité des conditions qui ont prévalu. Aucun Gaspésien n’est rapporté en bonne santé au débarquement. Qui plus
Suppléments - Histoire SIA-QC-Topo+
Suppléments - Histoire
est, l’un d’eux est décédé lors du passage et quatre autres sont morts à l'hôpital dans les semaines qui suivent. Les autres cas sont parfois pathétiques. Par exemple, celui de Marie-Anne Peltier (sic) : âgée de seize ans, mère d’un jeune enfant, veuve et de surcroît enceinte au moment de sa capture, elle accouche d’un enfant mort-né en cours de route vers Saint-Malo. À tout considérer, il est permis de se demander, en regardant ce cas, si c’était là un sort plus enviable que celui réservé aux Acadiens de la Nouvelle-Écosse.
Index
Grande-Vallée
Source : Encyclobec
SIA-QC-Topo+
 © Denis Bouvier 2021
© Denis Bouvier 2021
Le Fort Péninsule
Un épisode peu connu de la Seconde Guerre mondiale s'est déroulé dans la baie de Gaspé. Au début des hostilités, la Défense nationale réquisitionna le site du futur Fort Péninsule et y installa une batterie côtière afin de protéger le port de Gaspé contre une éventuelle attaque ennemie.
Tirant profit des avantages naturels de la baie de Gaspé, les stratèges militaires y construisent une base navale. Des défenses fixes en protègent les approches. Ce système comprend un filet anti-sous-marin, tendu entre Sandy Beach et Penouille et trois batteries côtières: Fort Prével, Fort Haldimand et Fort Péninsule.
Une rade stratégique
Vaste port naturel, la baie de Gaspé offre l'un des meilleurs havres d'Amérique. Bien abrité tant par le relief de la côte que par les pointes sablonneuses de Penouille et de Sandy Beach, le bassin de Gaspé est facile à défendre. De plus, les navires de fort tonnage peuvent y mouiller l'ancre.
La défense s'organise
Tirant profit des avantages naturels de la baie de Gaspé, les stratèges militaires y construisent une base navale. Des défenses fixes en protègent les approches. Ce système comprend un filet anti-sous-marin, tendu entre Sandy Beach et Penouille et trois batteries côtières: Fort Prével, Fort Haldimand et Fort Péninsule.

Le 1er mai 1942, la base navale « H.M.C.S. Fort Ramsay » est officiellement inaugurée. Trois mois plus tard, on y retrouve plus de 2 000 hommes détachés par les trois corps d'armée (Marine, Armée, Aviation). La flotte affectée à Gaspé regroupe 19 navires de guerre, dont 5 balayeurs de mines, 6 vedettes « Fairmile », un yacht armé et 7 corvettes. De plus, l'Aviation y affecte aussi quelques appareils amphibies.»
L’ennemi à nos portes
Le 11 mai 1942, le sous-marin allemand U-553 torpille un premier bateau dans le golfe du Saint-Laurent. Le navire sombre au large de Cloridorme, petit village côtier de la péninsule Gaspésienne. Trois heures plus tard, le navire hollandais SS Leto connait le même sort dans les eaux avoisinantes.
Dès que le haut commandement de la Marine est informé de ces évènements, un système de convois maritime est mis sur pied. Le port de Gaspé est choisi comme base pour les escorteurs charges d’assurer la sécurité des navires marchands sur une partie du circuit Québec – Sydney.»
Site Parc Canada
Suppléments vidéo : La bataille du Saint-Laurent aux portes de Forillon et La deuxième guerre mondiale en Gaspésie
- Histoire SIA-QC-Topo+
Suppléments
Index Parc Forillon Fort Péninsule
La révolte des pêcheurs de Rivière-au-Renard
La révolte de Rivière-au-Renard est un soulèvement de pêcheurs contre le système économique de servitude envers des compagnies étrangères, survenu à Rivière-au-Renard en 1909.

Système Robin
Dès le XVIIIe siècle, les activités de pêche en Gaspésie sont sous contrôle jersiais. Charles Robin y établit un monopole, profitant des troubles administratifs au cours des guerres de Sept ans et d'Indépendance des ÉtatsUnis pour s'assurer une mainmise sur le marché. Il met sur pied le «système Robin», forçant une relation de servitude économique entre les pêcheurs et les marchands; les seconds accordent un crédit ou payent en nature les premiers, forcés d'acheter au magasin de la compagnie. Afin d'éviter à leur famille de trop s'endetter, les femmes et enfants des pêcheurs sont souvent mis à contribution, sans rémunération, lors des étapes de transformation. Le système Robin, maintenant les pêcheurs dans une situation économique de dépendance et de pauvreté ― voire d'esclavage ―, est imité par les autres commerçants de poisson gaspésiens. Ce système a cours durant au moins le siècle suivant, sous les auspices des élus, maintenant les pêcheurs dans une spirale d'endettement poursuivie de génération en génération.
Origine du conflit
En août 1909, les compagnies de pêche réduisent par 30 % le prix offert au quintal de morue salée séchée, principal produit commercé par les pêcheurs renardois. Les pêcheurs sont outrés. Début septembre, des pêcheurs répliquent en exigeant que la baisse soit au plus de 20 %, et qu'aucun pêcheur endetté ne serait dépossédé de ses biens. Sous la menace de saisir les biens des compagnies et de former une coopérative de travail, un groupe de pêcheurs fait connaître ses revendications aux marchands Connick Kennedy et Horatio Hyman, puis ceux de la Charles Robin, Collas & Co. et de la William Fruing & Co. Tous leur opposent un refus catégorique.
Affrontements

Suppléments - Histoire SIA-QC-Topo+
Rivière-au-Renard, 1899
Charles Brien, directeur de la Fruing, concerte les autres marchands, qui décident de faire appel au député Rodolphe Lemieux (NDA : ministre de la Marine et des Pêcheries) afin qu'il sollicite l'appui de la Marine royale pour les défendre. La frégate Christine est mobilisée le 5 septembre et arrive deux jours plus tard. Entre temps, le soulèvement tourne à l'émeute. Un marchand tire sur un pêcheur, le blessant à la jambe. Effrayant leur employeur, les pêcheurs de la Fruing signent une entente avec Brien fixant le prix de la morue et les dédommageant pour les pertes encourues.
Parvenus sur place, les officiers du Christine font parvenir à leur commandement un rapport alarmiste, qui fera mobiliser immédiatement le bateau Canada, véritable navire de guerre d'un équipage de 75 marins et officiers et muni de quatre canons. Le 11 septembre, les deux navires de guerre mouillent dans l'anse de Rivière-au-Renard. 40 militaires touchent terre, menant des perquisitions et procédant à l'arrestation de 24 pêcheurs, dont cinq purgent, à l'issue de leur procès qualifié de « mascarade », une peine qui varie entre 8 et 11 mois de prison.
Postérité
Les compagnies accusent le coup dans les années qui suivent : les actionnaires de la Robin vendent leurs parts à un commerçant d'Halifax, tandis que la Fruing fait faillite en 1912. Le prix du poisson remonte à partir de 1910 et atteint un sommet pendant la Première Guerre mondiale.


Après 1925, les pêcheurs se regroupent pour former les premières coopératives de travail, aidés de l'évêque François-Xavier Ross.,
Index
Rivière-au-Renard
Source : Wikipédia.
Supplément : Quand le pêcheur ne veut plus être le poisson.
Suppléments - Histoire SIA-QC-Topo+
Séchage de la morue
Le naufrage du Carrick
Texte et photos : Monique Durand
Port de Sligo, nord-ouest de l’Irlande, 27 mars 1847. Molly tient son violon serré sur sa poitrine. C’est le seul trésor qu’elle a emporté sur le Carrick. Autour d’elle se tiennent, agglutinées, des dizaines d’hommes, de femmes et d’enfants d’une maigreur à faire peur. Mais plus personne n’a vraiment peur en cet endroit. Parce que plus personne n’a la force d’avoir peur. Petit peuple de squelettes qui a réussi, épuisé et affamé, à marcher jusqu’au port de Sligo et, on ne sait trop comment, tient encore debout.

Le navire aux ponts surpeuplés s’éloigne de la côte avec sa charge d’humanité enguenillée. Au milieu de la puanteur et des vomissements, Molly* reste immobile et fixe l’horizon, son violon à côté d’elle. Toute sa famille est à bord : son père, Patrick Kavanagh, sa mère, Sarah McDonald, ses quatre sœurs et son frère. Ils font partie des 167 passagers qui fuient vers le Nouveau Monde à cause de la famine qui sévit en Irlande.
La Grande Famine s’étendit de 1845 à 1852, résultat de l’apparition d’un parasite, appelé mildiou, qui détruisit presque totalement les cultures de pomme de terre, nourriture de base des Irlandais d’alors, et cela, sur fond d’impérialisme britannique tous azimuts. John Mitchel, leader nationaliste irlandais, écrivait en 1860 : « Le Tout-Puissant a envoyé le mildiou, mais les Anglais ont créé la famine. »
Le Carrick est un voilier à deux mâts, d’une longueur de 87 pieds, construit en Angleterre en 1812. Dans les livres d’histoire, on voit parfois Karrick ou Carrick’s. Le mot « carrick » est un dérivé du gaélique qui signifie « roche ». Des spécialistes prétendent que c’est le même Carrick qui avait déjà fait le voyage vers Québec en 1832 avec des passagers souffrant du choléra à son bord. Et racontent que ce furent les premières victimes d’une épidémie qui causa des milliers de morts ici et força le gouvernement québécois à ouvrir, la même année, une station de quarantaine à Grosse-Île, en face de Montmagny, où des milliers d’émigrants de la verte Eire trouveront leur dernier repos.
Le bateau franchit la baie de Donegal. Molly ne jette pas un regard, même furtif, derrière elle. Elle ne veut pas. Mais des images s’entêtent et reviennent la hanter. Elle revoit ce landlord venu arracher aux siens leurs derniers boisseaux de blé en guise de loyer. Tout ce blé, et celui des voisins, serait ensuite transporté dans les ports sous escorte de l’armée britannique pour être exportés dans les villes d’Angleterre. Pendant qu’eux crevaient de faim. Molly revoit aussi ce matin récent où, l’air grave, Patrick et Sarah annoncent aux enfants un incroyable projet : ils s’embarqueraient sur un bateau au port de Sligo en partance pour le Dominion du Canada où ils referaient leur vie, ils n’emporteraient presque rien avec eux. Comme tant d’autres compatriotes, ils essaieraient d’échapper à l’enfer. Un enfer qui fera un million de morts et, en moins de dix ans, conduira près de 2 millions d’Irlandais à fuir leur île, soit le quart de sa population. Inimaginable saignée.
Pendant que le Carrick s’éloigne des côtes irlandaises, Molly chasse une autre pensée qui la tenaille : elle ne verrait jamais Dublin, dont tant de chansons de son pays parlaient, où elle avait toujours rêvé d’aller. Mais elle se consolait un peu en pensant que Dublin, ensevelie sous les eaux et prisonnière d’une chape
Suppléments - Histoire SIA-QC-Topo+
de brouillard depuis des mois, Dublin sous les monceaux de cadavres, avait-elle entendu dire, Dublin sans vent depuis une éternité, n’était plus Dublin. Elle gardait les yeux fixés sur l’horizon. Et son violon près d’elle.
Le navire accède enfin au grand océan avec sa cargaison de gens malades. Un peu d’eau et quelques feuilles de chou sont distribués chaque jour aux passagers. Au début, ils se vautrent sur les rations comme des bêtes. Mais, plus les jours passent, plus ils faiblissent. Ils ne ressentent plus la faim en fait. Insalubrité, odeurs pestilentielles, passagers étendus partout aux prises avec typhus, dysenterie ou choléra, ces traversées atlantiques étaient une horreur. 100,000 Irlandais quittèrent leur patrie en direction de Québec au milieu du 19e siècle, à bord de ces bateaux-cercueil où ils mouraient comme des mouches. En plus des 5,400 qui mourront à Grosse-Île, 5,000 expireront sur la mer.
À bord de ces tombeaux flottants, on peut imaginer qu’il se créait, autour de celui ou de celle qui venait de rendre l’âme, un petit attroupement de ces gens si attachés à leur religion catholique. Pour prier, pour chanter. Ensuite, les membres d’équipage enveloppaient le corps dans une toile lestée de pierres et le basculaient par-dessus bord.
Molly eut l’idée, pour dire adieu aux malheureux qu’on allait abandonner aux hordes marines, de jouer pour chacun quelques notes de violon. Tandis que le Carrick poursuivait sa route vers l’ouest, Molly joua du violon pour les morts. Alors tout s’arrêtait net sur les ponts, petits et grands figés dans leur pose, certains fermant les yeux, ils écoutaient les notes s’envoler au firmament comme un requiem. Puis on entendait le flac du mort balancé dans la mer.
Mais le destin réservait d’autres misères aux passagers du Carrick. Voilà qu’au bout de plusieurs semaines de traversée, le ciel se voile dangereusement et la mer devient mauvaise. Le voilier n’est plus bientôt qu’un fétu de paille ballotté par les lames monstrueuses et un vent déchaîné, accompagné de neige. Le 28 avril 1847 – quoique certains rapportent plutôt la date du 19 mai -, le Carrick fait naufrage sur les récifs de Cap-des-Rosiers, sur la pointe de la Gaspésie. Seulement 48 personnes survivent. 87 corps sont rejetés par la mer et seront enterrés dans une fosse commune. Patrick Kavanagh et Sarah McDonald perdent leurs cinq filles. Seul leur fils Martin, âgé de 12 ans, a la vie sauve. Le couple ne veut pas aller plus loin et s’installe à Cap-des-Rosiers même. Patrick et Sarah auront encore quatre enfants en Gaspésie, dont un petit James.
* Molly est un nom fictif. L’auteure de ces lignes n’a pu retrouver auprès de sites spécialisés les noms de l’une ou l’autre des cinq filles noyées de Patrick et Sarah. Elle a aussi imaginé que la jeune fille avait joué du violon sur le Carrick, ce qui paraît tout à fait vraisemblable aux yeux des experts. Le violon a transité, un temps, à l’Ile aux Perroquets et se trouve maintenant chez une descendante de Patrick Kavanagh.
Source : Journal Le Phare Article complet
Les ossements de 21 naufragés du Carricks seront inhumés sur la plage de Cap-des-Rosiers le 4 juillet prochain. Ce moment sera l'occasion pour les descendants des survivants d'offrir aux naufragés l'enterrement officiel qu'ils n'ont jamais eu.
La semaine dernière, Parcs Canada confirmait que les ossements retrouvés en 2011 et 2016 au Parc national Forillon, sont bien ceux des naufragés du navire irlandais Carricks, qui s'était échoué au large de Cap-des-Rosiers en 1847.
Source : Radio-Canada
Suppléments - Histoire SIA-QC-Topo+
____________________
Index Cap-des-Rosiers

- Histoire SIA-QC-Topo+
Suppléments
Plan de destruction des villes de Québec, Gaspé, … lors la 2e guerre mondiale
En 1942, le gouvernement canadien avait décidé de recourir à la tactique de la terre brûlée et de sacrifier Terre-Neuve si les nazis avaient envahi le pays. C'est ce que révèlent des documents qui étaient considérés jusqu'à récemment comme «ultra-secrets». Les villes de Québec et de Gaspé, entre autres, étaient aussi visées par cette politique.
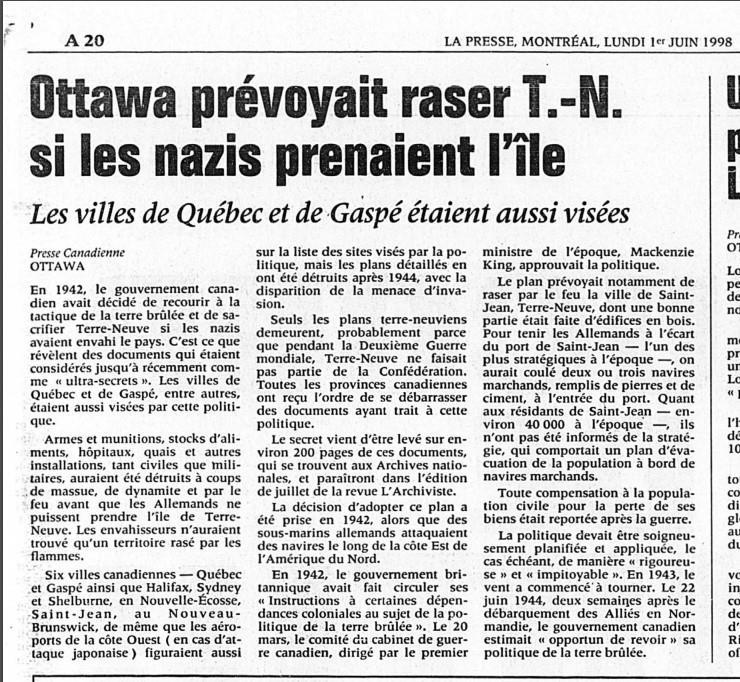
Armes et munitions, stocks d'aliments, hôpitaux, quais et autres installations, tant civiles que militaires, auraient été détruits à coups de massue, de dynamite et par le feu avant que les Allemands ne puissent prendre l'île de Terre-Neuve. Les envahisseurs n'auraient trouvé qu'un territoire rasé par les flammes.
Six villes canadiennes - Québec et Gaspé ainsi que Halifax, Sydney et Shelburne, en Nouvelle-Écosse, Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, de même que les aéroports de la côte Ouest (en cas d'attaque japonaise) figuraient aussi sur la liste des sites visés par la politique, mais les plans détaillés en ont été détruits après 1944, avec la disparition de la menace d'invasion.
Seuls les plans terre-neuviens demeurent, probablement parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, Terre-Neuve ne faisait pas partie de la Confédération. Toutes les provinces canadiennes ont reçu l'ordre de se débarrasser des documents ayant trait à cette politique.
Le secret vient d'être levé sur environ 200 pages de ces documents, qui se trouvent aux Archives nationales, et paraîtront dans l'édition de juillet de la revue L'Archiviste.
La décision d'adopter ce plan a été prise en 1942, alors que des sous-marins allemands attaquaient des navires le long de la côte Est de l'Amérique du Nord.
En 1942, le gouvernement britannique avait fait circuler ses «Instructions à certaines dépendances coloniales au sujet de la politique de la terre brûlée». Le 20 mars, le comité du cabinet de guerre canadien, dirigé par le premier ministre de l'époque, Mackenzie King, approuvait la politique.
Le plan prévoyait notamment de raser par le feu la ville de Saint-Jean, Terre-Neuve, dont une bonne partie était faite d'édifices en bois. Pour tenir les Allemands à l'écart du port de Saint-Jean - l'un des plus stratégiques à l'époque -, on aurait coulé deux ou trois navires marchands, remplis de pierres et de
Suppléments - Histoire SIA-QC-Topo+
Suppléments - Histoire SIA-QC-Topo+

ciment, à l'entrée du port. Quant aux résidants de Saint-Jean - environ 40 000 à l'époque -, ils n'ont pas été informés de la stratégie, qui comportait un plan d'évacuation de la population à bord de navires marchands.
Toute compensation à la population civile pour la perte de ses biens était reportée après la guerre.
La politique devait être soigneusement planifiée et appliquée, le cas échéant, de manière «rigoureuse» et «impitoyable». En 1943, le vent a commencé à tourner. Le 22 juin 1944, deux semaines après le débarquement des Alliés en Normandie, le gouvernement canadien estimait «opportun de revoir» sa politique de la terre brûlée.
Source : La Presse, 1er juin 1998
Index Gaspé
(1957)
Des agents de la Gendarmerie Royale du Canada montent actuellement la garde auprès des débris du bimoteur Aero-Commander qui s’est abattu le 5 mars dernier sur un pic des montagnes de St-Octave-de-l’Avenir, en Gaspésie, causant la mort du pilote John Rober Kovel, 28 ans, de Buffalo N-Y et du co-pilote Peter J. Lorenz, 40 ans, de Burbank, Californie.

Trois pays sont intéressés dans la chute de cet avion. Ce sont l’Iran, vers lequel les deux aviateurs se dirigeaient pour livrer l’appareil dont ils étaient en charge ; le Canada, où l’accident s’est produit, et enfin les Etats-Unis où demeurent les deux victimes. A la suite de l’enquête du coroner, présidée par le Dr Delphis Miville, de Cap-Chat, l’enquêteur William Gordon, du ministère fédéral des Transports poursuit actuellement des recherches pour établir les causes de cette tragédie que l’on attribue pour le moment à la tempête de neige dans laquelle furent surpris les deux aviateurs américains.
Ces deux derniers avaient laissé New-York et se dirigeaient vers Goose Bay pour se rendre ensuite en Iran. Son dernier message avait été capté par l’aéroport de Sept-Iles à 9 heures 55. Le pilote Kovel mentionnait alors qu’il traversait une tempête de neige. …
Il est mentionné que les corps de victimes et les débris de l’avion ont été ramenés à Ste-Annedes-Monts par des équipes de policiers et des citoyens. Le travail était difficile et très exténuant. Il a fallu plus de huit heures de marche pour monter dans la montagne et revenir avec les corps. …
Enquête pour déterminer la cause du drame aérien de St-Octave-de- l’Avenir
Index Carte
Source : Le Soleil, 27 août 1957, p 13 Merci à Robert de l’Etoile d’avoir déniché cet article
Explorations du frère Marie-Victorin en Haute-Gaspésie
Sa découverte de la botanique Depuis le tout début du XXe siècle, Marie-Victorin découvre, apprend et se passionne pour la botanique. Jusqu’à la fin des années 1930, il caresse un grand rêve : écrire la Flore laurentienne. Dès lors, il prend tous les moyens pour perfectionner sa connaissance. Sa copieuse et intarissable correspondance avec les plus grands scientifiques européens et nord-américains le servira grandement. Le plus éminent de ses correspondants est sans contredit le professeur M.L. Fernald du Gray Herbarium de l’université de Harvard. Ce dernier a foulé de nombreuses fois le sol haut-gaspésien; sa connaissance de la flore de l’Est du Québec est la plus achevée. Les patientes recherches de la prestigieuse institution de Boston « ont fait connaître dans la péninsule gaspésienne l’existence de toute une flore alpine et calcicole étroitement liée à celle des Rocheuses (…) ». L’Américain ne cesse de recommander cet endroit au jeune religieux québécois. À l’été 1923, Fernald et Marie-Victorin manquent de peu leur première rencontre : à quelques semaines d’intervalle, ils explorent tous deux l’intérieur de la Gaspésie. En cours d’expédition, le dernier trouve même le papier du premier dans le sentier qui mène au mont Albert. Les deux hommes deviennent de fidèles collaborateurs et Marie-Victorin prononcera même des conférences à Harvard.
Bien qu’il soit le plus grand spécialiste de la botanique de l’est de l’Amérique du Nord, Fernald n’est certes pas le seul à s’intéresser à notre coin de pays. La bibliothèque de Harvard contient des publications découlant des déplacements qui s’effectuent aux monts Jacques-Cartier et Albert depuis le milieu du XIXe siècle. Entre autres, la contribution d’Arthur Allen est considérable. La Commission géologique de l’État de New York et l’American Museum of Natural History of New York entreprennent également des études sur la Gaspésie.
Sa découverte de la Gaspésie
À l’été de 1919, Marie-Victorin effectue son premier déplacement vers la grande péninsule. L’insistance de Fernald semble avoir convaincu le Québécois et son équipe. Cependant, peu de traces témoignent de ces pérégrinations. Mon miroir, son journal intime, est silencieux de 1918 à 1920 : la fondation de l’Institut botanique de l’Université de Montréal combinée à ses activités de plus en plus nombreuses semblent perturber son action littéraire quotidienne. Or, dans un ouvrage consacré au fondateur du Jardin botanique, Robert Rumilly nous apprend qu’ « avec une curiosité particulière, (il parcourt la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine) : l’isolement fait de ces régions des entités géographiques, des terrains d’observation tout désignés. (…) Les voyageurs ne sont pas déçus. Saint-Joachin-des-Tourelles; Rivière-àClaude ; Mont-Saint-Pierre; Cap-des-Rosiers : chaque étape livre de nouvelles merveilles ». Il découvre par exemple l’Arnica gaspensis, presque inconnu en dehors de la Gaspésie.

Suppléments - Histoire SIA-QC-Topo+
Et arrive l’importante expédition de 1923. Parmi les explorateurs, on retrouve, entre autres, le frère Rolland-Germain. Ce dernier évolue dans l’ombre avec compétence et désintéressement; il est le compagnon de toujours. Le trajet Gaspé / Sainte-Anne-des-Monts s’effectue à bord du navire le Gaspesia. Le brouillard ralentit le périple et l’arrivée se produit dans la nuit du 1er au 2 août. En aprèsmidi, à la hâte, le groupe se dirige vers les sommets en suivant la grande rivière Sainte-Anne. Accompagnés d’un guide et de porteurs du coin (Pelletier, Dugas, etc.), deux à trois jours sont nécessaires pour finalement atteindre le mont Albert, le paradis du botaniste. Quelques embûches attendent les explorateurs, mais ils y herborisent tout de même avec succès. Il est intéressant de constater que les guides gaspésiens tracent parfois de nouveaux sentiers pour atteindre des lieux peu explorés. La chasse au caribou fait également partie de leurs tâches.
De santé fragile, Marie-Victorin sort affaibli de ce dur périple. Le 7 août, débute la souffrance : à regret il doit quitter l’expédition. Se dirigeant vers l’Europe, en mai 1929, ses souvenirs rejaillissent : « Nous passons en face de la Gaspésie, des Shikshoks (sic). Cela me rappelle 1923, mon séjour au Mont Albert, la flore de rêve du grand plateau, ma chute nerveuse, ma descente du Plaqué malade vers la civilisation (…) et les terribles quatre mois qui suivirent (…).
Son retour en Haute-Gaspésie
En 1940, le « frère explorateur » est de retour en Haute-Gaspésie; il connaît désormais le territoire. Néanmoins, la nouvelle route reliant Sainte-Anne-des-Monts au Parc national l’enchante beaucoup : le portage de quelques jours n’est plus nécessaire. Marie-Victorin évoque également son bonheur de revoir « les vieilles demoiselles (Pelletier) et leur mère », propriétaires de l’hôtel À la Bonne table. De cette fin d’été, on retient plutôt, par contre, son herborisation sur la côte : les Fonds de Cap-Chat, dans les caps entre Tourelle et Marsoui (déçu de ne pouvoir tout scruter, faute de temps), Rivière-à-Claude (récolte et observations très intéressantes) et Mont-Saint-Pierre. Il passe un bon moment dans l’érablière de cette dernière localité qu’il retrouve après deux ans. Il y a les « écorchis » aussi; ils sont pris d’assaut par les alpinistes. On témoigne alors passionnément de la complexité biologique de l’endroit. Les photographies couleurs s’y multiplient. Enfin, découverte inusitée sur la plage de


Suppléments - Histoire SIA-QC-Topo+
Mont-Louis : le Grindelia squarrosa, une espèce prairiale débarquée là par un grand mystère. À maintes reprises, il s’exclame d’une fin d’août à basse température : « Nous avons passé la nuit (21 août) à Mont-Saint-Pierre dans les abris Bernatchez. Nuit froide, mais belle. Ce matin encore, le vent du nord est glacé, et une petite attisée dans le poêle de tôle n’est pas un luxe. »
Élément fâcheux pour le chercheur historique, Marie-Victorin n’est guère un ethnologue, mais bien un scientifique presque entièrement centré sur son champ d’étude : de façon générale, il se montre bien avare dans les détails du quotidien. Par exemple, lorsqu’il débarque au quai de Sainte-Anne-des-Monts, en août 1923, il ne daigne pas mentionner le chantier d’une vaste basilique de granit (bien qu’il réside au village durant près de douze heures). En revanche, ses déplaisirs sur un fait ne passent guère inaperçus et sa plume peut glisser de façon bien virulente. Ainsi, sa description sans détour de la pauvreté à Tourelle en 1940 peut aisément choquer les uns alors que pour d’autres, elle apparaît comme un précieux témoignage de ce temps.
Les expéditions nord-gaspésiennes de Marie-Victorin n’ont rien de banales. Il semble en effet être le premier scientifique francophone à gravir les hauts sommets gaspésiens. Auréolé de ses grandes réalisations (le Jardin botanique de Montréal, la Flore laurentienne et ses multiples travaux scientifiques), il contribue au rayonnement du Québec dans le monde. Sa présence en Haute-Gaspésie est donc un pan important de notre histoire régionale qui aura, au surplus, une incidence sur l’histoire universelle de la botanique.
Texte de Marc-Antoine DeRoy, Société d’histoire de la Haute-Gaspésie, Sainte-Anne-des-Monts
* L’auteur remercie trois précieux collaborateurs à la documentation de cet article : Mme Monique Voyer, archiviste à l’Université de Montréal; M. Gilles Beaudet, frère des Écoles chrétiennes et M. François Boulanger, directeur du Parc national de la Gaspésie.

Source : La Presse, 1er juin 1998
Index
Portrait Marie-Victorin
Suppléments - Histoire SIA-QC-Topo+
▬
La torpille de St-Yvon (1942)
Au cours de la seconde guerre mondiale, le fleuve St-Laurent fut témoin de plusieurs événements tragiques. Sillonnant le golfe et l’estuaire du St-Laurent, le sous-marin allemand U-517, partant de Kiel en Allemagne le 8 aout 1942, est commandé par le lieutenant commandant Paul Härtwig, un homme très compétent mais ivrogne.
En fin d’après-midi, le jeudi 8 septembre, les habitants de St-Yvon eurent la désagréable surprise d’être visités par un sous-marin. Le Meadcliffe Hall, bateau apparemment chargé de bois de pulpe, remontait le fleuve en direction de Québec. Le sous-marin visa le bateau mais le capitaine, sachant que des sous-marins ennemis sillonnaient le St-Laurent, eut tout juste le temps de dévier sa course et se poster en travers, se préservant ainsi de la torpille. Le capitaine du bateau continua sa course au ralenti avec la plus grande précaution et son inquiétude face à la menace d’une autre catastrophe lui faire escale plus tard au quai de Petite-Vallée.
Pendant ce temps, à St-Yvon, quelques hommes venant du côté est du village aperçurent l’objet inconnu qui se dirigeait à une vitesse vertigineuse et ils coururent au rivage croyant voir une baleine. Mais bien vite, ils se rendirent compte qu’il s’agissait d’une torpille et ils se hâtèrent de courir dans la direction opposée. L’engin destructeur atteignit le cap pour lui faire une brèche irrémédiable. La carcasse fit un bond en arrière et s’immobilisa à environ 701 mètres de la pointe à l’extérieur de l’anse, se retrouvant ainsi complètement immergée.
La détonation fut très violente et occasionna de graves dégâts : des terrains ont vibré sous l’impact, des roches ont volé dans les airs, sur quelques centaines de mètres occasionnant des bris à certaines résidences, des armoires ont été renversées et la vaisselle qui s’y trouvait a été cassée. Pour M. Robert Clavet et Mme Marie-Anne Minville, leur défunte fille Winnifred étant exposée sur les planches fut jonchée d’articles décrochés des murs. Ce fut aussi la pagaille chez les animaux. La détonation ne se fit pas ressentir qu’à StYvon. Trois kilomètres plus loin, à Cloridorme, se trouvait la bâtisse des pêcheurs unis où des travailleurs, adossés le long d’un mur pour attendre le camion de poissons, furent tellement secoués qu’ils pensaient que celui-ci avait frappé l’usine. Les camionneurs arrivant en retard de St-Yvon annoncèrent la visite de la torpille. Pendant trois jours, deux hommes de l’Armée canadienne firent le guet de crainte de voir réapparaître l’ennemi.
Lors de son passage à Gaspé en septembre 1966, M. Jean-Louis Aubert raconte qu’à cette date du 5 septembre 1942, il n’y avait dans le fleuve St-Laurent que deux sous-marins allemands : le U-517 et le U-165.


Le premier, le U-517 qui avait quitté sa base de Kiel en Allemagne en date du 8 août 1942, était commandé par le lieutenant-commandant Paut Härtwig. Le 26 août, il arriva en vue de Belle-Ilse et coula un navire de transport trois jours plus tard. Il était en vue du Cap d’Anticosti.
Le 4 septembre, il reçut des grenades sous-marines lancées par un navire de guerre canadien. En date du 5 septembre, se glissant entre les colonnes d’un convoi, il n’avait que quatre torpilles et son tir était défectueux. Dans l’après-midi, il tira sa dernière salve et la torpille rata le but.
Suppléments - Histoire SIA-QC-Topo+
A cette époque, un autre navire allemand était dans cette région mais il ne coula qu’un seul navire de guerre canadien. Mais la torpille frappa le but : soit le U165. Donc, dans ce cas, il s’agit bien du sous-marin allemand le U-517. Bien des gens se demandaient pourquoi un sous-marin venait de torpiller un bateau dans un petit village le long de la côte. C’est qu’il avait reçu l’ordre d’attaquer tous les navires marchands et aussi naturellement les navires de guerre. Évidemment, le lieutenant-commandant Paul Härtwig ne peut se vanter d’avoir torpillé un rocher alors qu’i venait de manquer sa cible qui était le Meadcliffe Hall. Le 11 septembre 1942, dans le village de St-Yvon, M. Rock Côté, ambitieux et courageux citoyen, eut la merveilleuse idée d’essayer de reconstituer la torpille. Il s’obstina avec ardeur, sa ténacité et sa persistance lui valurent la réussite complète dans l’exécution de son projet. Le premier morceau à être émergé fut l’extérieur de la carcasse ou étaient où étaient attachées deux hélices. M. Côté agrippa la charpente avec un grappin et la remorqua jusqu’au rivage et la monta chez lui. Quinze jours plus tard, par un temps calme et une eau limpide, il aperçut le moteur et manœuvra de la même manière qu’il avait fait pour récupérer la carcasse.
Les pièces repêchées faisaient partie d’une torpille allemande de type G7A, utilisée par des sous-marins allemand durant la 2e guerre mondiale qui servaient surtout aux attaques de nuit. On pouvait voir la torpille chez M. Côté dans une bâtisse construite à cette fin, mais depuis 1987, nous pouvons la visiter au Musée de la Gaspésie.
Source : Panneaux d’information touristique, Route 132
Deux autres U-boot, les U-517 et U-165, firent des ravages. Aux petites heures du 27 août, dans le nord du golfe, le U-517 coula le transporteur de troupes américain Chatham (seulement 13 des 562 passagers et membres d’équipage périrent), et le U-165 attaqua le gros du convoi, coulant un navire et en désemparant un autre, qui serait plus tard achevé par le U-517.
Le sous-marin U-517 échappa à la destruction dans la baie Forteau où se trouvait la corvette Weyburn qui n’arriva pas à obtenir de contact ASDIC. C’est cette même impossibilité d’obtenir un contact acoustique qui sauva de nouveau le sous-marin plusieurs jours plus tard, après qu’il eut attaqué le petit convoi Québec-Labrador NL-6. Le Weyburn tomba sur le U-517 qui était sur le point de torpiller le Donald Stewart, et le força à plonger à peine les torpilles lancées. Le vapeur coula, et le Weyburn fut incapable de trouver le sous-marin. Tony German, un des officiers subalternes qui se trouvait sur la passerelle du Weyburn ce jour-là expliqua : « Sur le Weyburn, nous n’avons capté aucun ping à l’ASDIC et pourtant, nous avons vu deux fois le sous-marin; il n’y avait pas à s’y tromper. »
En septembre, les sous-marins U-517 et U-165 s’installèrent dans le Saint-Laurent et laissèrent les convois venir à eux. Le premier fut le QS-33, qui perdit un navire et le yacht armé NCSM Raccoon, tous deux coulés par le U-165, le 7 septembre au large de Cap-Chat. Le lendemain, le U-517 coula trois navires du convoi au large du cap Gaspé. La radio allemande en jubila, qualifiant la flotte d’escorte canadienne de flotte de troisième catégorie. Quatre jours plus tard, le U-517 coula la corvette Charlottetown en plein jour, au large du cap Gaspé. Puis, le 15 septembre, le U-517 attaqua le convoi SQ-36 en se laissant dériver silencieusement vers lui, mettant à profit le flux d’ouest en est du fleuve et le déplacement vers l’avant du convoi; il coula ainsi deux navires. Le U-165, informé de l’avance du convoi, fit une attaque de jour en plongée, et toucha trois navires.
Aucune contre-attaque navale ne sut mettre fin aux exploits de ces deux intrépides sous- mariniers. Dans bien des cas, les escorteurs se trouvaient sur place, voyaient le sous-marin plonger, et pourtant les ASDIC de recherche n’arrivaient pas à pénétrer les couches complexes de l’océan. Un commandant de sous-
Suppléments - Histoire SIA-QC-Topo+
Suppléments - Histoire
marin allemand expliqua plus tard que, dans le Golfe, une fois que le sous-marin avait pénétré la « couche » des 50 pieds de profondeur, il était en sécurité, comme dans le « sein d’Abraham ».
Source : La bataille de l’Atlantique, de 1939 à 1945
Index
Carte
SIA-QC-Topo+
SUPPLÉMENTS SUPPLÉMENTS - LEXIQUE
Andouiller Ramification du merrain des bois des cervidés.
Barachois
Barachois est un mot utilisé au Canada Atlantique et au Québec pour désigner un plan d’eau peu profond, isolé partiellement de la mer par un cordon littoral constitué de sable, de gravier ou de galets. Les échanges avec la mer se font par une brèche appelée passe ou goulet. Ces bancs de sable sont généralement formés d'alluvions déposés dans l'estuaire d'une rivière ou d'un ruisseau.
Barachois est un mot français acadien venant vraisemblablement du basque barratxoa (« petite barre »).

Basalte
Roche volcanique, très sombre (souvent presque noire). Il est le principal constituant de la croûte océanique.
Le basalte se forme dans les volcans, quand les coulées de lave refroidissent. Quand le volcan se trouve sous la mer, les basaltes ont une forme particulière, arrondie, on parle de "basalte en coussin". Cette forme arrondie est causée par le refroidissement rapide de la lave dans l'eau.
Brunisol
Les sols bruns. ou brunisols, sont la forme classique de sol évolué que l'on rencontre sous forêt feuillue en zone tempérée.
Calcaire
Les calcaires sont des roches sédimentaires, tout comme les grès ou les gypses, facilement solubles dans l'eau
Colluvion

Une colluvion ou un dépôt de pente est un dépôt meuble sur un versant, mis en place par gravité.
Cryogénique Processus générés par les cycles gels-dégels.
Echouerie C’est un canadianisme très évocateur qui ne se trouve qu’en Gaspésie, aux îles de la Madeleine et sur la Côte-Nord, en d’autres mots, que dans le milieu des pêches. Deux endroits en Gaspésie ont hérité du toponyme. Une anse à Sainte-Annedes-Monts a simplement pour nom L’Échouerie et une paroisse, plus à l’est, s’appelle Saint-Maurice de L’Échouerie. Nicolas Bélin permet d’en retracer un des usages les plus anciens en désignant de ce nom un lieu, sur une de ses cartes, où les loups marins venaient se reposer. Ces plages étant faites de sable, les Gaspésiens, en revenant de leur pêche, ont développé l’habitude de tirer leurs barques en leur partie la plus élevée de manière à les placer hors de la portée des flots pour la nuit. À Saint-Maurice, les gens expliquent le nom de manière un peu différente : « … à cause des fortes marées descendantes, à certaines périodes de l’année, les barques ancrées dans la petite anse, bordée de récifs de ce village, s’échouaient et dormaient sur les flancs jusqu’au retour de la marée montante. »
Source : Encyclobec
Erosion différentielle L’érosion est qualifiée de différentielle lorsqu’elle progresse à des vitesses différentes selon la dureté des roches.
Glaciation du Wisconsin La dernière période glaciaire est une période de refroidissement global ou glaciation. Elle commence il y a environ 110 000 ans et se termine il y a environ 10 000 ans.
Forillon Fernald
Suppléments - Lexique SIA-QC-Topo+
Iapetus Océan existant au Carbonifère et au Permien (entre -252 et -359 Ma) entre l’Amérique du Nord et l’Eurafrique.
Suppléments - Lexique
Krummholz Krummholz (de l'allemand : krumm : tortueux, courbé, crochus et Holz : bois) est un terme utilisé pour décrire la stature rabougrie et de forme inhabituelle des arbres soumis aux contraintes du vent, des basses températures, de la neige, généralement à la limite de la forêt dans les régions montagneuses ou littorales.

Laurentia
Paléocontinent (ancienne masse continentale) formant la base de l’Amérique du Nord.
Loupe Cette déformation, nommée « loupe » n’est rien d’autre qu’un dérèglement du cambium (une couche de tissus située entre le bois et de l’écorce), qui s’est mis à créer une prolifération tourbillonnaire de cellules, créant ainsi une grosse boule de bois (parfois déformée).
Ces bosses sont tout simplement des tumeurs bénignes qui n’affectent d’aucune manière la croissance de l’arbre. D’un point de vue botanique, il s’agit d’un désordre perturbant un bourgeon terminal, modifiant ainsi le matériel génétique d’une future branche ou de l’arbre tout entier.
Merrain Tige centrale à partir de laquelle se développe la ramure des cervidés.
Métamorphisme Transformation des roches sous l’effet de la pression et de la chaleur. Le métamorphisme engendre des minéraux variés dont plusieurs ont une valeur économique.
Moraine Un amas de débris rocheux érodé et transporté par un glacier.
Nappe de charriage Ensemble important de couches géologiques qui se sont décollées du socle rocheux et se sont déplacées sur de grandes distances
SIA-QC-Topo+
Évolution théorique vers le stade d’une nappe de charriage :
A. Les couches de roches sédimentaires non perturbées.
B. Une pression latérale entraîne la formation de plis ouverts.
C. La pression augmente et des plis déversés apparaissent.
D. Apparition d’une faille inverse de chevauchement.
E. Nappe de charriage
Mont Logan Mont Albert
Névé Stade de métamorphisme intermédiaire entre la neige et la glace.
Nunatak Un nunatak (en groenlandais nunataq signifiant « montagne » ou « monticule entièrement recouvert de glace durcie ») est une montagne ou piton rocheux s'élevant au-dessus de la glace des inlandsis, champs de glace ou des calottes glaciaires.
Ce terme désigne également toute surface non glaciaire entourée de glaciers.

SIA-QC-Topo+
Suppléments - Lexique
Suppléments - Lexique
Obduction Le chevauchement d'une croûte continentale par une croûte océanique.
Ordovicien Ère géologique de -488 à -443 Ma. Les couches géologiques de l’Ordovicien renferment aujourd’hui de vastes réservoirs de pétrole et de gaz naturel dans certaines régions du monde. Il correspond à une époque où l'océan global et l'atmosphère terrestre se sont refroidis, conjointement à une explosion de la biodiversité sur la planète. L’Ordovicien débute avec un épisode d’extinction d’espèces important et se finit par une autre extinction massive où 60 % des genres et 85 % des espèces disparaissent
Géologie Mt Albert Réserve écolog. Manche d’Épée
Supplément : L’Ordovicien à Montréal (Univ. McGill)
Orogenèse Ensemble des mécanismes de formation des montagnes.
Orogenèse appalachienne Orogenèse ayant formé les Appalaches.
Orographie L'orographie est le domaine de la géomorphologie et de la géographie physique concernant la description des montagnes.
Périglaciaire Un climat est considéré périglaciaire lorsque les températures annuelles moyennes sont inférieures à -5 °C.
Régosol Sol minéral brut, d'érosion, ou climatique (désert), sur matériau non consolidé, résultant de la désagrégation d'une roche tendre ou d'un apport sableux ou limoneux.
Roches sédimentaires Les roches sédimentaires proviennent de l'accumulation de sédiments qui se déposent le plus souvent en couches ou lits superposés, appelés strates. Elles résultent de l'accumulation de sédiments divers.

Schiste Un schiste est une roche qui a pour particularité d'avoir un aspect feuilleté, et de se débiter en plaques fines ou « feuillet rocheux ».
Serpentine Roche métamorphique (silicate de magnésium) à la masse vert sombre parcourue de petits filons fibreux. Une roche rare au Québec et dans le monde. Elle possède des caractéristiques toxiques pour la plupart des plantes, mais constitue en revanche un milieu propice pour certaines plantes rares.
SIA-QC-Topo+
Suppléments - Lexique SIA-QC-Topo+
Subduction Processus par lequel une plaque tectonique océanique s'incurve et plonge sous une autre plaque avant de s'enfoncer dans le manteau.
Substratum La formation géologique sur laquelle repose les terrains.
Till Dépôt glaciaire laissé directement par la glace, et consistant en argile, sable, gravier et blocs rocheux mélangés dans n'importe quelle proportion
SUPPLÉMENTS PORTRAITS
Alfonse, Jean Jean Fonteneau dit Alfonse de Saintonge, ou Jean Alfonse, en portugais, est un explorateur français naturalisé portugais, au service du Royaume de France.
Dès les années 1540, c'est un capitaine de renom, capable de mener une flotte jusqu'à la Côte de l'Or ou aux Antilles, et qui n'a jamais perdu un navire.
Sa réputation due à sa connaissance des routes commerciales conduit François Ier à le recruter comme « capitaine pilote ». Au cours de l'hiver 1542-1543, Alfonse sert de pilote à Jean-François de la Rocque de Roberval, qui, sur les traces de Jacques Cartier, espère fonder une colonie au Canada. Alfonse démontre l'existence d'un détroit navigable entre le Groenland et les côtes du Labrador. Son équipage, comprenant 200 hommes et femmes, dont quelques prisonniers, doit hiverner dans des conditions extrêmement dures sur les berges du Saint-Laurent. Décimés par le scorbut, un quart de l'effectif périt avant le retour vers la France.
Source : Wikipedia
Gaspé Matane St-Laurent
Apalaches Les Apalaches étaient une tribu amérindienne qui vivait dans la Province Apalachee au sein de l'actuel État de Floride jusqu'à ce qu'elle soit en grande partie anéantie et dispersée au XVIIIe siècle.
Ils vivaient entre les fleuves Aucilla et Ochlockonee, au nord de la baie Apalachee, et furent rencontrés pour la première fois par des explorateurs espagnols au xvie siècle. Les Apalaches parlaient une langue aujourd'hui éteinte, l'apalachee, documentée par des écrits de la période coloniale espagnole.
Au XVIIIe siècle, les Apalachees sont soumis par les Espagnols et christianisés. Mais en 1703, des colons anglais envahissent la région et massacrent de nombreux Appalachee, en déportant d'autres en esclavage. Les survivants se réfugient chez les Français, à Pensacola puis à Mobile. Ils s'installent plus tard en Louisiane. Un autre groupe s'était auparavant réfugié, dans la région de Veracruz, au Mexique, en 1763, lors de l'évacuation de la Floride par les Espagnols.

Source : Wikipedia
Bayfield, Henry Wolsey

Henry Wolsey Bayfield, né le 21 janvier 1795 à Hull (Angleterre) et mort le 10 février 1885 à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), est un officier de marine britannique des XVIIIe et XIXe siècles.
Il n’avait pas encore onze ans lorsqu’il s’engagea comme gentleman surnuméraire sur le HMS Pompey, de la Royal Navy.
De 1827 à 1840, Bayfield se consacra entièrement à cette tâche immense d’effectuer l’hydrographie entre Montréal et Terre-Neuve. Durant ces quatorze années, ses activités couvrirent la rive nord du fleuve, le lac Saint-Pierre, les ports de Montréal et de Québec, le Saguenay, la rive nord de la Gaspésie, le détroit de Belle-Isle, la côte du Labrador de Belle-Isle au cap St-Lewis, une partie de la côte ouest de Terre-Neuve, l’île d’Anticosti et les îles de la Madeleine, la baie des Chaleurs, la côte du Nouveau-Brunswick ainsi que les rivières Mirachimi, Restigouche, Richibouctou et leurs principaux ports.
Son journal de bord relate les conditions extrêmes de l'entreprise : les moustiques et mouches noires sont une épreuve quotidienne, des accidents graves menant parfois à des amputations se produisent à bord, des épidémies se déclarent, le ravitaillement est souvent en retard, l'équipage voit sa solde réduite par la hiérarchie militaire et, surtout, cette mission dont le but ultime est de prévenir les naufrages échappe elle-même plusieurs fois de peu à la catastrophe.
Source : Wikipédia
Bellin, JacquesNicolas Jacques-Nicolas Bellin, né en 1703 à Paris et mort le 21 mars 1772 à Versailles, est un cartographe hydrographe français.
Au cours d’une carrière de 50 ans, il dessine les cartes de plusieurs ouvrages majeurs de son temps tels que Histoire et description générale de la NouvelleFrance de Charlevoix (1744) ou Histoire générale des voyages de l’abbé Prévost (publié entre 1746 et 1759). Il est le cartographe le plus copié du XVIIIe siècle.

Ses cartes du Canada et des territoires français de l’Amérique du Nord (NouvelleFrance, Acadie, Louisiane) sont d’une valeur considérable. Ceci est d'autant plus remarquable que, archétype du cartographe de cabinet, Bellin n'est jamais venu en Amérique. Pour sa cartographie du fleuve SaintLaurent, il confiait à des navigateurs des cartes manuscrites à corriger et enrichir. À chaque retour de ces cartes, il mettait à jour ses connaissances. Sa cartographie de l'Amérique du Nord est animée par deux besoins fondamentaux : sécuriser la navigation sur le fleuve Saint-Laurent et revendiquer pour la France les terres explorées par des Français dans la région des Grands Lacs et le long du fleuve Mississippi.
Source : Wikipédia.
Appalaches
Forillon
Grande-Vallée
Suppléments - Portrait SIA-QC-Topo+
Rivière-au-Renard
Restigouche
Petite-Vallée Saint-Maurice-del’Échouerie
Blanchard, Raoul Raoul Blanchard, né à Orléans en 1877 et mort à Paris en 1965, est un géographe français. Enseignant à l'Université de Grenoble à partir de 1906, il s'est particulièrement intéressé à la Plaine maritime flamande, aux Alpes françaises et au Québec.
Raoul Blanchard est ensuite nommé professeur de géographie à l'université Harvard, dans le Massachusetts. En 1929 il s’intéresse au Canada. Au vu de ses racines francophones et des facilités de travail qui lui sont offertes, Blanchard apprécie beaucoup de travailler sur ce vaste territoire du dominion encore vierge de toute étude géographique. Jusqu’en 1960, il séjourne une quinzaine de fois au Québec. C’est ainsi qu’il commence à produire des documents sur le Québec avec une méthode strictement géographique. Au cours
de cinq automnes, de 1929 à 1933, Blanchard parcourt le Québec, dont la Gaspésie à deux reprises, à pied et en voiture. Par deux fois également il se rend sur la côte nord du Saint-Laurent et à Natashquan. En homme habitué à l'Europe, il était très intéressé par la nouveauté du sujet que constituait alors le Québec. En 1930, il publie « Presqu’île de Gaspé » dans la revue Géographie alpine. C’était, dans cette revue, le premier d’une longue série d’articles sur le Canada et plus particulièrement le Québec.
Par la suite, Raoul Blanchard donne des conférences à Montréal. En 1947, il accepte de fonder un Institut de géographie de l’Université de Montréal, qui deviendra en 1962 le département de géographie.
Raoul Blanchard est considéré comme le père de la géographie moderne au Québec. Le Québec possède grâce à lui de nombreux ouvrages sur sa géographie. Pour le remercier de cet apport, la Commission de toponymie du Québec a donné son nom à un mont de 1 166 mètres d’altitude, le plus haut sommet des Laurentides, et le département de géographie de l'Université de Montréal l’a honoré en donnant son nom à sa plus grande salle de cours.
Source : Wikipedia
Chic-Chocs
Mont de la Table
Cartier, Jacques On ne sait pas comment Jacques Cartier a été initié à la navigation, mais Saint-Malo, la ville où il est né entre l’été et l’hiver 1491, était alors l’un des plus importants ports d’Europe. En 1524, il aurait accompagné Giovanni da Verrazzano et participé ainsi aux explorations officieuses engagées par le roi de France. Une dizaine d’années plus tard, Jacques Cartier est un navigateur assez expérimenté pour que François 1er lui demande d’entreprendre l’exploration officielle de l’Amérique du Nord. Il ne fait pas de doute que la route maritime qu’il emprunte, en 1534, lui était déjà familière.

Le premier voyage (1534)
Suppléments - Portrait SIA-QC-Topo+
Le 19 mars 1534, Cartier reçoit la mission de « faire le voyage de ce royaume es Terres Neuves pour descouvrir certaines yles et pays où l’on dit qu’il se doibt trouver grant quantité d’or et autres riches choses.
Cartier progresse ensuite jusqu’à la baie des Chaleurs où, le 7 juillet, il rencontre des Micmacs. Les palabres sont assorties d’échanges que l’histoire a consignés comme étant le premier geste commercial intervenu entre Français et Amérindiens. Peu après, Cartier atteint la baie de Gaspé.
 Jacques Cartier, gravure attribuée à Pierre-Louis Morin, vers 1854.
Jacques Cartier, gravure attribuée à Pierre-Louis Morin, vers 1854.
»
Plus de 200 Iroquois de Stadaconé (Québec) se sont rendus dans la péninsule pour pêcher. D’abord confiantes et cordiales, les relations se ternissent quand, le 24 juillet, Jacques Cartier prend possession du territoire. La croix de 30 pieds de haut, qu’il érige à la PointePenouille, semble inconvenante à Donnacona, le chef des Autochtones. Craignant les conséquences de ce mécontentement, Cartier ment en décrivant la croix comme un insignifiant point de repère.

Jacques Cartier à Gaspé Le 25, il quitte les environs de Gaspé en direction du golfe Saint-Laurent. Après avoir longé le détroit qui sépare l’île d’Anticosti et la rive nord, il repart pour Saint-Malo où il accoste le 5 septembre. Le fleuve Saint-Laurent n’a pas été découvert.

Le deuxième voyage (1535-1536)
Le deuxième voyage a lieu en 1535–1536 et débute le 19 mai. Cette expédition compte trois navires, La Petite Hermine (60 tonneaux), L'Émérillon (40 tonneaux) et la nef qui transporte Cartier, la Grande Hermine (120 tonneaux). Quinze mois de vivres ont été prévus. Ramenés de France par Cartier, les deux « fils » (neveux ?) du chef Donnacona, Taignoagny et Domagaya, parlent maintenant français. Recourant à leurs connaissances, Cartier remonte alors le cours du Saint-Laurent, découvrant qu'il navigue sur un fleuve lorsque l'eau devient douce. Le 3 septembre il signale dans son journal de bord avoir aperçu des bélugas dans le fleuve.
Le troisième voyage (1541-1542)
Donnacona, qui a compris ce que cherchent les Français (de l'or, des gemmes, des épices), leur fait la description qu'ils veulent entendre : celle du riche royaume de Saguenay. François Ier se laisse convaincre de lancer une troisième expédition avec pour instructions, cette fois, d'implanter une colonie.
En attendant, Cartier accumule « l'or et les diamants », qu'il négocie avec les Iroquoiens du Saint-Laurent. Il fait expertiser le minerai en France, apprenant qu'il ne rapporte que de la pyrite et du quartz, sans valeur. Sa mésaventure est à l'origine de l'expression « faux comme des diamants du Canada »… et du toponyme actuel, « cap Diamant », pour désigner l'extrémité est du promontoire de Québec.
Source : Wikipédia et Musée virtuel de la Nouvelle-France
Supplément : Où Jacques-Cartier a-t-il planté sa croix ?
Suppléments vidéo : Cartier revu et corrigé, partie 1 partie 2
Suppléments - Portrait SIA-QC-Topo+
Jacques-Cartier Gaspé Restigouche Fleuve St-Laurent
Suppléments - Portrait SIA-QC-Topo+
Catalogne, Gédéon de Gédéon de Catalogne est un arpenteur, cartographe, seigneur et officier français, né en 1663 dans les Pyrénées-Atlantiques, et mort le 5 juillet 1729 à Louisbourg, en Acadie. Il passe la plus grande partie de sa vie en Nouvelle-France.
En 1700, les Sulpiciens, seigneurs de Montréal, lui commandent le creusement d'un canal vers Lachine (canal de Lachine), mais des difficultés techniques l'empêchèrent d'achever cette tâche.

Nommé lieutenant en 1704, il effectue les relevés des seigneuries de la colonie, puis dresse les plans de Montréal et participe à la construction de ses fortifications.

Un parc rappelle son nom à Montréal, près du canal de Lachine . 45° 28′ 19″ N, 73° 35′ 00″ O
Source : Wikipedia Mont St-Pierre Ste-Anne-des-Monts
Champlain, Samuel de N'appartenant pas à la noblesse, Champlain agit en tant que subalterne d'un noble désigné par le roi. Il est ainsi « lieutenant du vice-roi de la Nouvelle-France » puis à partir de 1629 « commandant en la Nouvelle-France » en l’absence du cardinal de Richelieu .
Administrateur local de la ville de Québec jusqu'à sa mort, il ne reçoit jamais le titre officiel de gouverneur de la Nouvelle-France, même s'il en exerce les fonctions.
Les difficultés rencontrées dans l'entreprise d'une colonisation de l'Amérique du Nord sont nombreuses, et ce n'est qu'à partir des étés 1634 et 1635, dans les dix-huit derniers mois de sa vie, que Champlain voit son rêve de colonisation se concrétiser, avec l'arrivée et
l'établissement de quelques dizaines de familles de colons. Son acharnement à vouloir implanter une colonie française en Amérique du Nord lui vaut, depuis le milieu du XIXe siècle, le surnom de « Père de la Nouvelle-France ».
(Il a fondé Québec, Trois-Rivières, été victime d’une tentative d’assassinat. Il a effectué 12 voyages en Nouvelle-France… dans le confort des bateaux de l’époque!!! Fallait aimer venir nous visiter…)
Source : Wikipédia
Cap-des-Rosiers Cap-Gaspé Forillon Matane Restigouche Fleuve St-Laurent
Chaste, Aymar de Aymar de Clermont-Chaste, seigneur de Gessans et de La Bretonnière, mort en 1603, est un gentilhomme catholique, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem et officier de marine français des XVIe siècle et XVIIe siècle. Il sert durant les guerres entre l'Espagne et la France entre 1582 et 1598.
Malgré le fait qu'il était frère de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, donc moine ayant prononcé les vœux requis, entre autres de chasteté, il laissa plusieurs enfants naturels pensionnés par Henri IV et légitimés par Louis XIII.
Il hérita en 16033, des privilèges de Pierre de Chauvin, recevant d'Henri IV le titre de Vice-roi de la Nouvelle-France. Pour mener à bonne fin son projet de colonisation du Canada, il forma la compagnie de Monts, dans laquelle entrèrent de très riches négociants. François Gravé reçut le commandement de l’expédition, Samuel de Champlain fut engagé comme simple observateur. Ils partent de Honfleur le 15 mars 1603. Arrivés au Canada, ils laissèrent leurs vaisseaux à Tadoussac, et remontèrent le Fleuve Saint-Laurent, en barque jusqu’au Sault Saint-Louis, près du futur Montréal. Ces explorateurs dressèrent des cartes et cherchèrent l’endroit le plus favorable à un établissement.
Aymar de Chaste développa la Traite des fourrures et les Français dominèrent ce marché pendant plus de dix ans. Il meurt le 13 mai 1603 avant le retour de l'expédition en France.
Source : Wikipédia.
Suppléments - Portrait SIA-QC-Topo+
Chauvin, Pierre de Pierre de Chauvin, sieur de Tonnetuit, né à Dieppe (Normandie, France) avant 1575 et mort à Honfleur en février 1603, est un capitaine de la marine et de l'armée française, lieutenant-général de la Nouvelle-France.
Huguenot, Pierre de Chauvin sollicita, en 1599, une commission du roi Henri IV pour obtenir le monopole pour dix ans de la traite des fourrures en Nouvelle-France, qui lui fut accordée à condition d'y fonder une colonie et d'y établir la religion catholique. De Chauvin ne tint aucune de ses promesses, et s'occupa exclusivement de la traite des fourrures à Tadoussac, qu'il fonda en 1600.
Source : Wikipedia
Dansereau, Pierre Pierre Dansereau est un écologiste et professeur québécois, reconnu pour ses recherches sur les écosystèmes et comme l'un des pionniers de l'interdisciplinarité en écologie.
Il travaille au Jardin botanique de Montréal de 1939 à 1942, auprès de Marie-Victorin.
De 1940 à 1950, il enseigne l'écologie à l'Université de Montréal. Il y fonde et dirige le Service de « biogéographie du Québec », de 1943 à 1950. Son étude de l'écologie de l'érablière laurentienne au début des années 1940 lui vaut un bon début de notoriété comme scientifique.
Il aura enseigné dans une vingtaine d’universités sur cinq continents et de nombreuses missions l'ont conduit en Amérique du Sud, en Europe, en Afrique, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon et en Chine.
Dansereau met l’accent durant toute sa vie sur l’importance des phénomènes de collaboration entre les espèces vivantes, faisant ainsi pendant à la dynamique de la concurrence interespèces valorisée par Darwin, et prône la nécessité de réunir dans une vision intégrée les humains et les autres espèces vivantes.
En 2001, il fait l'objet du documentaire Quelques raisons d'espérer de l'Office national du film du Canada
L'Encyclopédie Britannica le présente comme un des fondateurs de l’écologie contemporaine et le Biographical Center de Cambridge (Angleterre) le décrit comme un des 2 000 chercheurs qui ont le plus marqué le XXe siècle.
Source : Wikipédia

Suppléments - Portrait SIA-QC-Topo+
Suppléments - Portrait
Denys, Nicolas Nicolas Denys est un explorateur français, marchand et industriel de la pêche au Canada, gouverneur, lieutenant général pour le roi, et propriétaire d'une partie de l'Acadie et du Canada. Il est un des premiers entrepreneurs d’Amérique du Nord mais aussi un grand géographe et observateur de l’histoire naturelle de la région.
En 1650,Nicolas Denys est nommé, par Louis XIV, Lieutenant Gouverneur. Denys, durant sa vie en Acadie, fonda les établissements de Port-Rossignol,de Miscou, de Chedabouctou, de Saint-Pierre, de Sainte-Anne, et de Nipisiguit au Nouveau-Brunswick.
Ses « fortunes » ont connu un revirement lorsque son rival, Emmanuel Le Borgne, saisit ses avoirs à Port-Royal par la force des armes en 1654, alors que Nicolas Denys était à Sainte-Anne. La même année, Louis XIV reconnut officiellement les revendications de Nicolas Denys sur les propriétés confisquées par Le Borgne10. Il fut donc ordonné à Le Borgne de remettre tous les biens saisis à Nicolas Denys.
Source : Wikipedia Cap-Gaspé Restigouche
Deshayes, Jean Jean Deshayes (1650-1706) ; homme de science, cartographe, hydrographe, et géographe du roi.
Lors de son voyage de 1685, Jean Deshayes avait pour mission de cartographier le fleuve Saint-Laurent et ses environs. Afin de réaliser ce travail de première importance, Deshayes utilise des instruments scientifiques à la fine pointe de la technologie. Il fait aussi usage de triangulation pour tracer les rives du fleuve et exécute ainsi les premiers travaux géographiques et géodésiques modernes sur le SaintLaurent entre la ville de Québec et le lac Ontario.
Depuis environ deux siècles, nos historiens canadiens affirmaient qu’en 1665 le premier « Chemin du Roy » de la colonie qui se rendait de Chambly à Montréal passait par… Longueuil et ceci, sans qu’aucun parmi eux n’élabore la moindre preuve crédible pour appuyer cette affirmation.
Finalement après 335 ans passés au fonds des Archives de la Marine en France, une ancienne carte refait surface et vient conclure la synthèse autour de la première route terrestre de la Nouvelle-France.
Source : Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine
Franquelin, Jean Baptiste Louis
Jean Baptiste Louis Franquelin est un hydrographe et géographe au service du roi de France, à Québec, petite ville coloniale française d'Amérique du Nord. En plus de 30 ans, il dessine une cinquantaine de cartes géographiques de la Nouvelle-France et de ses environs.

Il dessina avec la collaboration de Louis Jolliet une carte du fleuve Saint-Laurent sur laquelle figurait une route maritime à suivre pour éviter les naufrages.
SIA-QC-Topo+
Il participa à l'effort de guerre contre l'Angleterre, en cartographiant notamment la côte de la Nouvelle-Angleterre7. À nouveau en France à la fin 1692 pour compléter ses dessins, il
demanda à être rejoint par sa femme et ses enfants. Sa famille périt l'année suivante lors du naufrage du Corossol, près de l'île du Corossol, dans l'archipel des Sept Îles.
Source : Wikipedia
Cascapédia L’Anse-aux-Griffons
Frontenac, Louis de Buade de Louis de Buade, comte de Frontenac et de Palluau, né en 1622 au château de Saint-Germain-en-Laye (France) et mort en 1698 à Québec , est un militaire et administrateur français. Nommé à deux reprises gouverneur de la Nouvelle-France par le roi de France Louis XIV, il développe la colonie et la défend contre les attaques anglaises, notamment lors de la bataille de Québec en 1690.
Les dettes furent une constante préoccupation de Frontenac au cours de sa vie. En 1653, pour cette raison, il vendit la charge de colonel de son régiment. Le roi Louis XIV était sans doute pressé de le voir quitter la France pour une autre raison. Madame de Montespan ne laissa pas indifférent Frontenac, et il eut même une relation adultère avec elle avant qu'elle soit la favorite du Roi-Soleil.
Le premier gouvernement
Le 7 avril 1672, Louis de Frontenac obtient de Louis XIV la charge de gouverneur général de la Nouvelle-France. Les revenus qu'il tirait de cette charge étaient assez modestes. (24 000 livres). Toutefois, il améliorait sa situation car il avait réussi à obtenir une ordonnance du Conseil d’État qui levait la saisie dont ses biens avaient été frappés et lui accordait un sursis pour rembourser ses dettes.
Frontenac comprit très vite ce que pouvait apporter la traite des fourrures dans l’Ouest. Sans en informer le ministre, il établissait, un an après son arrivée, un poste de traite sur le lac Ontario, nommé fort Frontenac (ou Cataracoui)i, là où se trouve la ville de Kingston. Les traitants de fourrures et les habitants de Montréal en furent très mécontents.
Les abus d'autorité de Frontenac se multiplièrent au cours de ce premier gouvernement et finirent par être connus de la Cour. Le gouverneur fut sévèrement blâmé.
Au terme de son premier mandat, la situation de la colonie devenait préoccupante. En s'étendant vers l’ouest, celle-ci entra en conflit avec les Iroquois qui étaient décidés à se rendre maîtres de la vallée de l’Ohio.
Le deuxième gouvernement
Suppléments - Portrait SIA-QC-Topo+
Après un interrègne de sept ans, le comte revient en Nouvelle-France en 1689, alors que la France et l'Angleterre sont officiellement en guerre.
Il doit défendre la Nouvelle-France contre les Iroquois qui poursuivaient leurs incursions dévastatrices contre les établissements. Quatre mois après la nomination de Frontenac, le 4 août 1689, a lieu le tristement célèbre « massacre de Lachine », au cours duquel des Iroquois attaquent à l'improviste l'établissement français, tuant un grand nombre de personnes et semant la destruction.
Il devait aussi parer à de possibles attaques de la part des colonies anglaises, tout en fournissant une aide militaire aux alliés amérindiens de l’Ouest.
En janvier 1690, Frontenac se lance à l'attaque contre les établissements anglais frontaliers. Il s'en prend à trois petits établissements, fort éloignés l’un de l’autre : Schenectady (New York), Salmon Falls (Maine) et fort Loyal (baie de Casco). Les fermes et les maisons sont détruites, les colons massacrés, et l'on ramène quelques prisonniers. Utiles afin de remonter le moral de la colonie, elles suscitent, dans les établissements anglais, une colère qui ne peut que les pousser à se porter à l'attaque.
Bataille de Québec
Les Anglais conçoivent donc un plan de campagne par terre et par mer contre la Nouvelle-France.
La flotte de Phips remonte le Saint-Laurent et vient assiéger Québec le 16 octobre 1690. Frontenac, qui a pu regrouper toutes les forces militaires de la colonie, organise la défense de la ville. Le 16 octobre, l'amiral anglais envoie au gouverneur un émissaire portant une sommation rédigée par avance. Frontenac ruse pour faire croire au délégué qu'il y a beaucoup plus de soldats à Québec qu'il n'y en avait en réalité.
Le lendemain, des renforts dirigés par M. de Callières arrivent de Montréal. Mais le 18 octobre, les Anglais de Phips débarquent à Beauport, pendant que quatre de leurs navires bombardent Québec. L'attaque dure trois jours, elle est un échec et Phips quitte définitivement la Nouvelle-France.
 Source : Wikipédia
Source : Wikipédia
Grande-Vallée Seigneurie Anse de l’Étang
Hazeur, François Eminent marchand de Québec, entrepreneur, seigneur, membre de la Compagnie du Nord et de la Compagnie de la Colonie, conseiller au Conseil supérieur, né en France aux environs de 1638, décédé à Québec, le 28 juin 1708.
Il s’occupa tout particulièrement de la traite des fourrures, arma de nombreuses embarcations à destination de l’Ouest et acheta des congés de traite à leurs détenteurs initiaux. Hazeur ne fut pas long à se joindre à la Compagnie du Nord, dès sa formation en 1682 ; la société avait pour but d’exploiter la traite à la baie d’Hudson.
En 1688 et 1689, Hazeur commença à diversifier ses intérêts économiques. Avec Soumande et Grignon, il forma une société qui obtint le monopole de la seigneurie de la Malbaie, une région aux épaisses forêts dont les variétés de bois se prêtaient particulièrement bien à la construction navale. Sous la direction des trois associés, la seigneurie devint bientôt le plus important centre de l’industrie du bois au Canada. On y érigea deux moulins à scie, des hangars et des bâtiments, et on ouvrit des routes ; 25 à 30 hommes y travaillaient. En 1689,
SIA-QC-Topo+
Suppléments - Portrait
Suppléments - Portrait
Hazeur fit savoir que la seigneurie pouvait produire annuellement 30 000 pieds de planches, 2 000 pieds de bordages et jusqu’à une centaine de mâts.
Pendant une trentaine d’années, François Hazeur a été, de tous les hommes d’affaires de la Nouvelle-France à cette époque, un des plus éminents, et aussi un des plus audacieux ; n’eussent été ses expériences désastreuses dans l’industrie du bois, les pêcheries et la traite de Tadoussac, il aurait pu amasser une fortune considérable. Ces échecs ne doivent pas être imputés à son incompétence, mais plutôt aux conditions économiques défavorables à cette époque.
Source : Dictionnaire biographique du Canada
Grande-Vallée
Seigneurie Anse de l’Étang
Kempt, James James Kempt (vers 1765 - 20 décembre 1854) est un officier et administrateur colonial britannique qui fut lieutenant-gouverneur de Nouvelle-Écosse et gouverneur général de l'Amérique du Nord britannique.

Kempt aborde son poste à Québec comme il l'avait fait à Halifax, c'est-à-dire avec un esprit ouvert et une certaine confiance. En novembre 1828, il confirme Louis-Joseph Papineau comme président de l'Assemblée législative, puis accepte le projet de loi sur les finances soumis par l'Assemblée. De plus, en 1829 il autorise le redécoupage des districts électoraux, lesquels passent de 27 à 45, alors que le nombre de députés passe de 50 à 84. Ces arrangements sont vus à Londres comme de dangereuses concessions aux Canadiens français.
Tout au long de son mandat de deux ans, Kempt s'efforce d'agir en médiateur et de gouverner d'une manière non partisane et sans susciter de passions. Il y réussit en bonne partie. Au cours de l'été 1830 il rappelle au secrétaire aux Colonies son désir de rentrer en Grande-Bretagne avant l'automne. Son vœu est exaucé et Kempt transfère ses pouvoirs à lord Aylmer le 20 octobre 1830.
Source : Wikipedia
Le Clercq, Chrétien Chrétien Le Clercq (avant 1655 † après 1698) est un religieux français de l’Ordre des récollets frères mineurs. Il est connu comme l’auteur de Premier établissement de la foy dans la Nouvelle-France (en 2 vol.) et de Nouvelle relation de la Gaspésie (1691). Dans ce dernier récit de son œuvre missionnaire, il décrit le mode de vie des Micmacs du Québec, qu’il appelle « Gaspésiens ». Mgr de Laval le chargea de fonder une mission auprès des indiens Micmac. Il apprit la langue de cette tribu et en entreprit l’évangélisation.
Source : Encyclobec
SIA-QC-Topo+
Suppléments - Portrait
Léry, Chaussegros de Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry (Québec, 1721 – 1797) est un ingénieur militaire et une personnalité politique du Bas-Canada.

Pendant la guerre de Sept Ans, il se révèle être un officier exceptionnel et est l'un des rares officiers coloniaux très estimés par le marquis de Montcalm. En reconnaissance de son service militaire, il est fait chevalier de l'ordre de Saint-Louis en 1759.
En 1763, après la conquête britannique de la Nouvelle-France, lui et son épouse, Louise Martel de Brouage, sont le premier couple franco-canadien à être présenté à la cour anglaise, tirant le compliment du roi George III selon lequel, si toutes les Canadiennes ressemblaient à Mme de Léry, il avait « bel et bien fait une conquête »
Source : Wikipedia
NDA : Il est à noter que son père porte les mêmes nom et prénom et était également ingénieur militaire à Québec et Montréal.
Marie-Victorin, frère Frère Marie-Victorin (1885-19440, né Conrad Kirouac , est un religieux, frère des écoles chrétiennes, botaniste, enseignant, professeur d'université, intellectuel et écrivain québécois. Au XXe siècle, il est surtout connu pour ses travaux en botanique qui ont probablement culminé avec la publication de sa Flore laurentienne et l'élaboration de l'herbier Marie-Victorin. Il est le fondateur du Jardin botanique de Montréal..

Source : Wikipedia
Supplément : Explorations en Haute-Gaspésie
Pierre Dansereau Rolland-Germain Mont Logan
Matapédia
,Colonisation de la vallée…
L’occupation de la vallée de la Matapédia affiche le caractère d’une véritable invasion, des années 1890 à 1920. À la fin du XIXe siècle, la Matapédia constitue sans doute la région du Québec qui présente le meilleur potentiel agricole et forestier encore inexploité. Les industriels du sciage mettent la forêt en coupe réglée et les colons éventuels affluent en masse dans le nouvel eldorado depuis les vieilles paroisses du long de l’estuaire. En moins de deux générations, la majeure partie de la forêt vierge est ravagée et les meilleurs sols sont mis en culture. Dans les années 1950 arrive l’heure du ressac et des milliers de Matapédiens doivent quitter leur chère vallée colonisée par leurs grands-parents, à peine quelques décennies plus tôt.
Pour les autorités coloniales françaises, puis britanniques, la vallée de la Matapédia présente un moindre intérêt que celle du Témiscouata pour les liaisons terrestres entre la vallée du Saint-Laurent et les Maritimes. Le chemin Kempt, une première route postale construite entre Métis et la baie des Chaleurs en 1830-1832, n’est en fait qu’une étroite piste de 160 kilomètres difficilement accessible aux chevaux de bât. C’est la Guerre de sécession, en 1861, qui incite le gouvernement à construire une nouvelle route, le « chemin de Matapédiac », une voie de communication de première classe qui va permettre la construction du chemin de fer Intercolonial quelques
SIA-QC-Topo+
années plus tard. Malgré ces voies de pénétration de grande qualité, le peuplement de la vallée n’est pas immédiat. La crise économique des années 1874 à 1895 n’est guère favorable à la colonisation pour le bois.
Source: Encyclobec Kempt Matapédia
Moll, Herman Herman Moll, né probablement en 1654 et mort le 22 septembre 1732 à Londres et un cartographe anglais d'origine allemande ou néerlandaise.

Herman Moll est connu pour ses nombreuses cartes souvent minutieusement préparées de l'Europe et de l'Amérique. En outre, il a aussi réalisé des cartes pour Daniel Defoe pour son roman Robinson Crusoé et pour Jonathan Swift pour son roman Les Voyages de Gulliver.

Hermann Moll réalisa "l'Atlas geographus" entre 1711 et 1717, en cinq volumes et "l'Atlas Minor" en 1719
Source : Wikipédia
Montmagny, Charles Hault de Le premier gouverneur officiel de Québec
Charles Huault de Montmagny est l’un des directeurs de la compagnie des Cent-Associés qui gère la Nouvelle-France aux débuts de la colonie. Il devient en 1636 le premier gouverneur en titre de la Nouvelle-France, après la mort de Samuel de Champlain, le gouverneur « de facto ». Sa commission est signée par le roi Louis XIII et cette fonction, il l’occupera jusqu’en 1648.
C’est Montmagny qui entreprend de faire du modeste poste établi sous le règne de son prédécesseur une véritable ville. Après en avoir délimité les contours, il dessine les rues qui rayonnent à partir d’un point central, le fort Saint-Louis, à la façon des villes médiévales.
La présence du fort rassure les habitants du bourg. Le supérieur des jésuites écrit en 1636 : « Nous avons de très honnêtes gentilshommes, nombre de soldats de façon et de résolution; c’est un plaisir de leur voir faire les exercices de guerre dans la douceur de la paix, de n’entendre le bruit des mousquetades et des canons que par réjouissance, nos grands bois et nos montagnes répondant à ces coups par des échos, roulant comme des tonnerres innocents qui n’ont ni foudre ni éclairs. La diane nous réveille tous les matins, nous voyons poser les sentinelles.
Suppléments - Portrait SIA-QC-Topo+
Le corps de garde est toujours bien muni : chaque escouade a ses jours de faction ; en un mot notre forteresse de Québec est gardée dans la paix comme une place d’importance dans l’ardeur de la guerre ».
L’hostilité grandissante des Iroquois, qui peuvent se procurer des arquebuses auprès des Hollandais, va briser cette quiétude. La défense de la colonie va demeurer une préoccupation constante du gouverneur Montmagny. C’est d’ailleurs ce qui l’amène à s’opposer à la fondation de Montréal, qu’il juge une « folle entreprise ».
Source : Histoire du Québec
Notons que le Gouverneur Montmagny est l’un des personnages du roman Autre monde, de Cyrano de Bergerac, paru en 1657. Ce roman est considéré comme le premier roman de science-fiction au monde. Au début de la partie intitulée Histoire comique des Estats et empires de la Lune, Montmagny, qui est sur le point d’attaquer les Iroquois, tient une conversation philosophique avec Cyrano peu de temps avant que celui-ci décolle pour la Lune à bord d’une machine spatiale.
Source : Grand Québec
Potvin, Alain Une belle histoire d'amitié s'est éteinte avec la mort de quatre alpinistes québécois qui ont fait une chute de 1000 mètres sous les yeux horrifiés d'un garde-chasse, dimanche matin, au mont McKinley, en plein coeur de l'Alaska.

«C'est bouleversant. Ces gars-là étaient plus que des amis pour moi. C'était mes frères», a confié avec émotion Yvon Méthot, le seul survivant de cette tragique expédition, joint par La Presse à son domicile de Sept-Iles, hier soir.
«On se préparait depuis deux ans pour ce grand et beau projet. On connaissait toutes les procédures d'urgence. Rien ne pouvait arriver», a ajouté M. Méthot, qui n'a pas terminé l'ascension pour des raisons professionnelles.
Des quatre victimes, trois étaient originaires de Sept-Iles. Il s'agit de Simon Proulx, un professeur d'éducation physique de 42 ans, son fils Christian, un cégépien de 18 ans, et Alain Potvin, un biologiste de 38 ans. L'autre victime est un technicien en génie civil de Montréal, Maurice Grandchamp, 29 ans.
Suppléments - Portrait SIA-QC-Topo+
Les cinq membres de l'équipe étaient arrivés en Alaska, le 16 mai, et avaient entrepris dans les jours suivants d'escalader la montagne de 6400 mètres d'altitude. Après s'être habitués au climat et à l'altitude, dans un campement installé à 4600 mètres du sommet, Yvon Méthot a quitté le groupe, jeudi dernier, pour rentrer à Sept-Iles.
Avant de partir, les autres lui ont remis une cassette sur laquelle ils ont enregistré des messages émouvants destinés à leur famille et d'autres faisant l'apologie de leur très grande amitié. «Il y en a un qui pleurait et qui disait regretter que je ne puisse continuer à monter», se souvient M. Méthot.
Les quatre autres membres du groupe ont donc grimpé les derniers mètres les séparant du sommet. Ils l'ont bel et bien atteint, samedi soir, mais c'est en redescendant, le lendemain, qu'ils ont fait leur chute dramatique.
Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Personne ne le sait encore au juste, puisque ni les corps ni le journal de bord de l'équipe n'ont encore été récupérés.
Chose certaine, les quatre victimes possédaient une grande expérience des expéditions de toutes sortes et se montraient extrêmement prudentes et minutieuses, quoique certains aient souligné qu'ils n'avaient jamais effectué une telle ascension. «Ils ont pu être engourdis par les effets de l'altitude», a aussi expliqué Gilbert Rioux, qui a lui-même grimpé au plus haut sommet de l'Amérique du nord, en 1983.
Pour sa part, Yvon Méthot croit qu'ils ont pu dévier de la voie classique qu'empruntent généralement les alpinistes, au mont McKinley, sans s'en rendre compte. Rendus à l'embouchure d'une voie plus abrupte, l'un d'eux aurait perdu pied, entraînant dans le vide les autres qui étaient attachés à lui.
Ils étaient à 5800 mètres lorsqu'ils ont dégringolé. «Un garde-chasse les a aperçus à travers ses lunettes d'approche. Ils ont chuté, sur une distance de 940 mètres», a expliqué le porte-parole du parc McKinley, John Quinley.
Des recherches ont été effectuées hier et lundi en vue de récupérer les cadavres, mais une tempête de neige et une avalanche a rendu l'opération impossible. «D'ici la fin de la semaine, nous allons tenter de nous approcher d'eux à nouveau, a indiqué M. Quinley, mais il ne serait pas surprenant que nous ne puissions jamais les retrouver...»
La petite communauté de la Côte-Nord était dans tous ses émois, hier, en apprenant la perte de ces personnages célèbres et longuement louangés. «Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un désastre comme ça à Sept-Iles. Ces gars-là étaient si merveilleux», a expliqué un ami du groupe, Yvan Méthot (à ne pas confondre avec Yvon Méthot).
Tous pleuraient leur mort, mais personne ne regrettait l'expérience qu'ils ont dû vivre, «leur plus beau voyage». «D'un côté, je suis contente parce qu'il est parti avec de merveilleux paysages dans sa tête. Et il m'a laissé un beau cadeau», a laissé tomber l'amie d'Alain Potvin, Françoise Murray, qui attend un bébé de lui le mois prochain.
Suppléments - Portrait SIA-QC-Topo+
«C'est un accident bête de montagne. Quand on m'a réveillé pour m'annoncer cette triste nouvelle, ça m'a jeté une douche d'eau froide. Mais d'un autre côté, tous les alpinistes savent que les accidents font partie du voyage», a conclu Gilbert Rioux.
Par Marie-Josée Godbout, Eric Trottier, Journal La Presse, le 3 juin 1992
Raudot, Jacques Jacques Raudot, intendant de la Nouvelle-France de 1705 à 1711. Il tente d'apporter des réformes aux systèmes seigneurial et judiciaire, à l'éducation, à l'agriculture et à la milice. Bien que sociable et cultivé, il est de tempérament émotif, et il s'offense facilement. Il a une piètre opinion des Canadiens en général. N'appréciant guère la position prééminente du gouverneur Vaudreuil, il passe les dernières années de son mandat en querelles stériles avec lui.
Source : Encyclopédie canadienne
Roberval, JeanFrançois de La Rocque de
Suppléments - Portrait SIA-QC-Topo+
Jean-François de La Rocque, sieur de Roberval est né en France vers 1500. Selon certaines sources, il est né à Carcassonne, ville dont son père fut gouverneur.

En 1541, malgré sa foi protestante (il est né catholique, mais il s’est converti au protestantisme), le roi François Ier le nomme lieutenant-général du Canada et lui confie le commandement de la troisième expédition de Jacques Cartier au Canada. Curieusement, le roi charge Roberval de «répandre la sainte foi catholique» ce qui peut signifier que Roberval s’est reconverti au catholicisme.
La mission de Roberval parait simple : fonder une colonie, y construire des églises et des villes fortifiées. Pour accomplir cette mission, Roberval reçoit un subside de 45 mille livres et frète trois navires : la Valentine, l’Anne et la Lèchefraye.
Cartier s’apprêtait à repartir au mois de mai de 1541, mais Roberval retarde son départ pour rassembler des fonds et il quitte le port de La Rochelle en avril 1542.
Cartier abandonne son établissement de Charlesbourg-Royal et les vaisseaux de Cartier et de Roberval se croisent dans le port de St. John’s de Terre-Neuve le 8 juin 1542.
Informé de l’abandon de Charlesbourg, Roberval, avec deux cents hommes, reprend possession du poste et décide d’y passer l’hiver. Cette décision s’avère désastreuse car les froids, les maladies et les querelles parmi les membres d’équipage causent la mort de plusieurs marins.
Selon les témoignages de marins, le capitaine Roberval fut fort cruel, contraignant les hommes à travailler sans repos, les privant de boire et de manger et faisant punir ceux qui défaillaient.
On raconte qu’il fit pendre six marins pour vol.
La sévérité de Roberval s’explique peut-être par le fait que sa colonie était composée de repris de justice. Il exerça cependant son droit de grâce en faveur d’Aussillon de Sauveterre qui tua un matelot rebelle. Sauveterre reçut une lettre de rémission pour ce fait. Ce document, daté du 9 septembre 1542, porte la signature de J. F. de La Roque et c’est le plus ancien document officiel canadien.

Après une exploration en direction d’Hochelaga, alors que Roberval essaie de franchir les rapides de Lachine, il tente une exploration du Saguenay au cours de l’été 1543. Mais suite à l’échec de l’expédition, Roberval, ruiné, met fin à ses projets de colonisation du Canada.
Rentré en France, il se voit confier par François Ier la reconstruction des fortifications de Senlis, puis de Paris. Plus tard, Henri II le nomme surintendant des mines de France. Cependant, en 1555, ses biens sont hypothéqués.
En 1560, il est tué à Paris dans une bagarre de rue entre Catholiques et Protestants au début des Guerres de Religion.
Mont Jacques-Cartier Fleuve St-Laurent Jean Alfonse
Saint-Viateur, Clercs de Cette congrégation a été fondée le 3 novembre 1831 en France par le père Louis Querbes… Il pose les bases d'une association de catéchistes qui assureront l'éducation chrétienne des enfants et les tâches affectées aux clercs paroissiaux : préparation des offices, des chants.
L'institut a été expulsé de France par les lois anti-congrégationnistes de la Troisième République ; ses églises, couvents, écoles, maisons de retraite, juniorats et les provincialats ont été nationalisés.
Une trentaine de frères sont partis pour le Canada. L'institut s'est donc étendu depuis ses origines françaises vers les États-Unis et le Canada, où il était encore très présent jusque dans les années 1970.
Source : Wikipédia.
Taché, EugèneÉtienne Eugène-Étienne Taché, né le 25 octobre 1836, est un arpenteur-géomètre et un architecte québécois. Il est le fils de d'Étienne-Paschal Taché, père de la confédération.
Il est connu pour avoir dessiné les plans de l'Hôtel du Parlement du Québec, de l'ancien palais de justice (aujourd'hui l'édifice Gérard-D.-Levesque appartenant au Ministère des Finances) et du Manège militaire de Québec.
Source : Wikipedia
Suppléments - Portrait SIA-QC-Topo+
Vaudreuil, Pierre de Rigaud de Pierre de Rigaud de Vaudreuil de Cavagnial, né le 22 novembre 1698 à Québec et mort le 4 août 1778 à Paris , fut marquis de Vaudreuil, officier de la Marine, gouverneur de Trois-Rivières, gouverneur de Louisiane et le dernier gouverneur général de la Nouvelle-France. De tous les gouverneurs de la NouvelleFrance, Pierre de Rigaud de Vaudreuil est le seul né dans la colonie.

En 1755, le marquis de Vaudreuil devient gouverneur-général de la Nouvelle-France, il gère la colonie durant la guerre de Sept Ans. Les colonies américaines de la France sont un des théâtres de cette guerre entre la France et l'Angleterre.
Source : Wikipédia
Vautrin, plan Le plan Vautrin est un plan de colonisation dirigé mis en place par le gouvernement du Québec entre 1934 et 1937. Ce nom est donné en l’honneur du ministre Irénée Vautrin qui est responsable de ce projet. En plein cœur de la Grande dépression de 1929-1939, le gouvernement de Louis-Alexandre Taschereau espère que le plan Vautrin contribuera à aider les chômeurs en leur attribuant des terres qu’ils pourront défricher, cultiver et habiter.

Dès 1933, plusieurs groupes présentent des mémoires au gouvernement du Québec pour promouvoir le retour à la terre, mais le gouvernement de Taschereau n’est pas favorable à un tel plan. Néanmoins, après de nombreuses critiques et consultations, le plan Vautrin se met finalement en place à partir de 1934; il est d’ailleurs considéré comme le plus important effort de colonisation de la décennie. Pour l’Église, l’installation des colons catholiques sur de nouvelles terres lui permettait de faire la promotion de la religion et d’étendre son « champ » de pouvoir.
Source : Wikipedia
Vimont, Barthélemy
Barthélemy Vimont, né le 1er janvier 1594 à Lisieux et décédé le 13 juillet 1667 à Vannes, est un missionnaire français.
ll a été le premier à célébrer la messe à Montréal en 1642. Il participe à la fondation du premier collège d’Amérique du Nord en 1635. Lors des pourparlers de paix avec les Iroquois en 1645, il agit en guise de conseiller auprès du gouverneur Huault de Montmagny. Le 22 octobre 1659, il retourne, à la suite d'ennuis de santé, en France où il achèvera sa vie.
Source : Wikipédia.
Parc Forillon Restigouche
Suppléments - Portrait SIA-QC-Topo+
Wolfe, James James Wolfe, né le 2 janvier 1727 à Westerham (Kent, Angleterre) et mort le 13 septembre 1759 à Québec (Nouvelle-France), est un général britannique. Lors de la guerre de Sept Ans, il remporta la bataille des Plaines d'Abraham à la tête de la force expéditionnaire britannique, ce qui entraina la chute de la ville de Québec et précipita la perte pour le royaume de France de la Nouvelle-France. Il est mortellement blessé au cours de cette bataille.

Wolfe maniait bien l'arme psychologique comme le démontre son manifeste qui visait avant tout à semer crainte et terreur dans le cœur des habitants. Wolfe mit ses menaces à exécution et toutes les fermes le long du Saint-Laurent furent incendiées, ce qui causa deux hivers de famine. Le journal de John Knox raconta l'horreur d'entendre des femmes et des enfants qui criaient pendant qu'ils brûlaient vifs.
Contrairement à ce qu'il prétend, Wolfe n'épargnera aucune ferme en aval de Québec sur les deux côtés du Saint-Laurent. Ceux qui lui résistèrent furent tués, certains pendus.
Source : Wikipédia
Supplément : Le passage du général Wolfe en Gaspésie
Supplément vidéo : 1758: Wolfe, l’ennemi de la Gaspésie
Suppléments - Portrait SIA-QC-Topo+
Anse aux Amérindiens Grande-Vallée Penouille St-Maxime-du-Mont-Louis
Bénévoles SIA
Dans la municipalité de Val-Brillant, sise aux abords du lac Matapédia, Gaétan Roy se dévoue à une infrastructure de plein air unique en son genre : le Sentier international des Appalaches – section Québec (SIA), une piste de longue randonnée de 650 km qui traverse la Gaspésie de part en part.

Ex-commissaire industriel à la Ville d’Amqui, Gaétan Roy s’implique à fond dans le fonctionnement du sentier depuis sa retraite, en 2005. « Dès sa fondation dans les années 1990, j’ai toujours été interpellé par ce sentier », se rappelle l’homme de 75 ans qui ne rechigne pas à se salir les mains, en toutes saisons.
Bien que le SIA ait été aménagé entièrement grâce à des subventions, tout restait encore à faire lorsque Gaétan Roy s’est joint au conseil d’administration. Le sentier demeure inconnu des Gaspésiens, qui préfèrent la motoneige aux bottes de rando. Son entretien s’avère complexe en raison de sa longueur et de son accès difficile.
Gaétan Roy a piloté lui-même la construction d’une douzaine d’abris, de la demande de subventions à leur construction en zone sauvage. Il a érigé et réparé quantité de ponts et de passerelles. Il s’est lancé des défis, comme la construction d’un câble aérien franchissant la rivière Assemetquagan. « C’était une construction complètement folle ! », rigole-t-il.
Ce Val-Brillantois, qui a sous sa responsabilité directe 135 km du SIA, a un message à livrer aux Québécois : « Croyez-moi ou non, mais c’est l’fun de faire du bénévolat ! Quand je vois ce que le sentier est devenu, qui est passé d’un projet utopique à un franc succès, qui attire des randonneurs de partout dans le monde, je suis excessivement fier du chemin parcouru par l’équipe du SIA. Ça met en valeur la vallée de la Matapédia », témoigne-t-il.
Les bénévoles qui s’investissent ainsi sont principalement des hommes car les travaux sur le terrain impliquent le maniement de scies à chaîne et de sécateurs. Mais les femmes ne sont pas en reste. Clémence Pépin, 60 ans, qui habite le splendide village de La Martre, en Haute-Gaspésie, fait elle aussi partie de l’escadron de bénévoles du SIA.

« Selon moi, ce sentier est un atout précieux pour nos enfants. Il leur donne une place pour jouer », dit cette ex-infirmière, grande randonneuse devant l’éternel. Cette jeune retraitée a des projets plein la tête, dont une trousse scolaire sur le SIA. « Notre équipe veut faire connaître le sentier aux jeunes. Ce projet est stimulant et extrêmement enrichissant », dit-elle.
Source : Magazine Virage. Article complet
-
SIA-QC-Topo+
Suppléments
Portrait
Mont Logan
SUPPLÉMENTS - ÉVÉNEMENT
Le Festival en chanson de Petite-Vallée

Le Festival en chanson de Petite-Vallée est un événement culturel annuel qui a plus de trente-cinq ans. Il est devenu un des plus importants, sinon le plus important des événements du genre au Québec.


Le Festival en chanson de Petite-Vallée tire son origine du Festival de la parenté, un festival local de chansons créé en 1983 et s'adressant spécialement aux jeunes Gaspésiens qui revenaient dans la région après avoir travaillé à Montréal ou à Québec.
Chanson Chic-Chocs (Daniel Boucher, Michel Rivard et Richard Séguin)
Index
Articles complets : Encyclobec et Wikipedia
Toponyme
SIA-QC-Topo+
© Denis Bouvier 2021
© Denis Bouvier 2021
CARTES DIVERSES



Index Carte
PARC RÉGIONAL DE LA SEIGNEURIE DU LAC MATAPÉDIA
Séneçon fausse-cymbalaire


HABITAT FLORISTIQUE DU MONT FORTIN

Toponymie

SIA-QC-Topo+ Index
HABITAT FLORISTIQUE DU MONT LOGAN


Toponymie Index



SIA-QC-Topo+
Arnica de Griscom
Athyrie alpestre
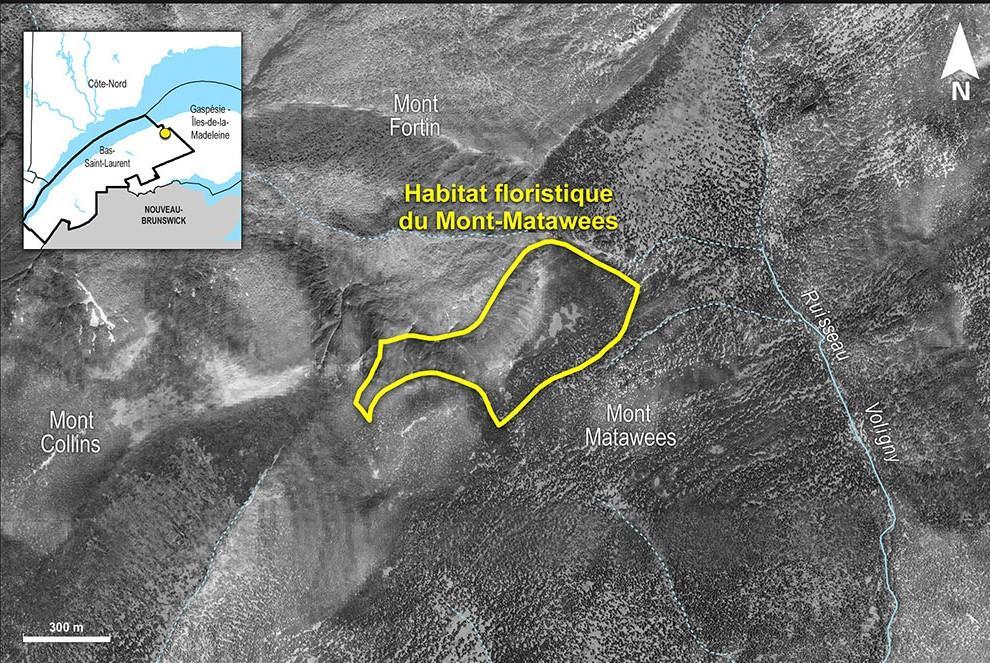



SIA-QC-Topo+
ndex Toponymie
HABITAT FLORISTIQUE DU MONT MATAWEES I
Arnica de Griscom
Séneçon fausse-cymbalaire
HABITAT FLORISTIQUE DE LA MONTAGNE-DE-ROCHE


Index Toponymie


SIA-QC-Topo+
HABITAT FLORISTIQUE DU PREMIER LAC DES ILES I

Cet habitat floristique est constitué d’escarpements situés au nord du Premier lac des Îles. D’une superficie de 6,31 hectares, il se trouve sur des terres publiques vouées à la conservation, à l’intérieur du parc national de la Gaspésie. Il abrite une population d’une plante herbacée vivace, l’Arnica de Griscom, une espèce endémique du golfe du Saint-Laurent. L’habitat, constitué de parois tailladées de petits ravins, est difficile d’accès, ce qui facilite sa protection.

Source : Ministère de l’Environnement du Québec


SIA-QC-Topo+
ndex Toponymie
Arnica de Griscom
HABITAT FLORISTIQUE DE LA SERPENTINE DU MONT ALBERT I






SIA-QC-Topo+
ndex Toponymie
Minuartie de la serpentine
Saule à bractées vertes
Polystic des rochers
Matapédia

















Gaspésie Haute-Gaspésie Côte Gaspé Forillon Secteur

HÉBERGEMENT SIA
Lieu Type et nb places en abri Notes Nb plateformes Hors plateforme Poêle bois Bois chauffage Lit Matelas Point d’eau Eau potable *Matapédia 4 1 *Lagacé 4 *Turcotte 4 1 Dépôt de ravitaillement avec Nature Aventure *Corbeau 8 1 Forte pente pour le point d’eau Dépôt de ravitaillement avec Nature Aventure *Ruisseau St-Etienne 1 Dépôt
ravitaillement
Aventure *Quartz 4 2
Matane
Avignon
de
avec Nature
Lieu

Secteur Matapédia




























Notes




Hébergement SIA SIA-QC-Topo+
Type et nb places en abri
Nb plateformes Hors plateforme Poêle bois Bois chauffage Lit Matelas Point d’eau Eau potable *Ruisseau Creux 8 2 *Ste-Marguerite 4 1 $ Douche au dépanneur *Causapscal 4 1 Clé au Marché Richelieu rte 132 Camping Chez Moose *Les Chutes 4 1 Eau à 300m au sud *St-Alexandre 4 1 *Lac au Saumon 4 1 *Erablière 4 1 *Amqui 4 1 Camping Amqui Buanderie/vélo *Les Trois Soeurs 6 1 Boîte à eau *St-Vianney 4 1 $
Hébergement SIA

Secteur Matane


















SIA-QC-Topo+
Lieu Type et nb places en abri Notes Nb plateformes Hors plateforme Poêle bois Bois chauffage Lit Matelas Point d’eau Eau potable Accueil John *Riv Matane 4 2 *Ruisseau Pitounes 4 2 *Lac Tombereau 4 2 *Montagne Valcourt 4 2 *Lac Matane 4 2 *Lac Gros Ruisseau 4 2 *Mont Craggy 4 2 *Lac Beaulieu 4 2 *Petit Sault 4 3 *Ruisseau Bascon 4 2





















SIA-QC-Topo+
Lieu Type et nb places en abri Notes Nb plateformes Hors plateforme Poêle bois Bois chauffage Lit Matelas Point d’eau Eau potable La Nyctale 8 La Chouette 8 L’Arnica 2 Le Carouge *Le Kalmia 1 Le Huard La Mésange *Le Saule 4
Hébergement SIA
Secteur Gaspésie
Hébergement SIA
Secteur



























SIA-QC-Topo+
Type et nb places en abri Notes Nb plateformes Hors plateforme Poêle bois Bois chauffage Lit Matelas Point d’eau Eau potable *Lac Cascapédia Abri-repas. Le Pluvier La Paruline *La Fougère 2 *La Rivière Mt Albert Le Roselin Le Tétras *La Camarine 2
Gaspésie Lieu
Cartier
*Mont-Jacques-
Hébergement SIA



Secteur Haute-Gaspésie





Notes






SIA-QC-Topo+
Lieu Type et nb places en abri
Nb plateformes Hors plateforme Poêle bois Bois chauffage Lit Matelas Point d’eau Eau potable *Cabourons 8 1 Baril disponible pour l’eau, mais peut-être à sec *Ruisseau Flétan 4 2 *Lac à Cyrille 4 2 *Grand-Sault 4 2
Hébergement SIA




Secteur Côte-Gaspé










Notes



SIA-QC-Topo+
Type et nb places en abri
Lieu
Nb plateformes Hors plateforme Poêle bois Bois chauffage Lit Matelas Point d’eau Eau potable *Terrasses 4 2 *Cascades 8 *La Chute 4 2 *Zéphyr 8 *Carrières 4 2 Source d’eau incertaine. Ruisseau 300m avant. *Érablière2 8
Hébergement SIA SIA-QC-Topo+












Secteur Forillon
Lieu Type et nb places en abri

Notes


Nb plateformes Hors plateforme Poêle bois Bois chauffage Lit Matelas Point d’eau Eau potable
Lacs 1
1
Camping des Appalaches *Les
*Crêtes-1 1 Eau à 800m NE *Crêtes-2
BOTTIN DES SERVICES














Matapédia Matane Gaspésie Haute-Gaspésie Côte Gaspé Forillon



Localité
Nature Aventure (418) 865-3554 20, rue de l’Église
Casimir (418) 865-2333 19, rue de l’Église
du Moulinet (418) 865-2733 2, rue du Ruisselet
(418) 865-2915 21, rue de l’Église Orleans Express 1-833-449-6444 14, boul Perron E Bureau de poste Pharmacie St-AndrédeRestigouche Camping et refuge municipal (418) 865-2063 143, Route Principale 10, Route du 4e Rang Bureau de poste
Secteur Avignon
Matapédia
Chez
Gîte
L’InterMarché
S

























SIA-QC-Topo+
Services
Auberge La Coulée Douce (418)
21,
Boudreau
Secteur Matapédia Localité Causapscal
756-5270
rue
(418)
1-866
609,
Motel du Vallon
756-3433
519-3433
route 132 ouest
(418)
601,
Camping Causapscal chez Moose
756-5621
route 132 ouest
(418)
391,
N
(418)
608,
Rest Chez Mamie
756-3646
rue Saint-Jacques
Spot Lunch
756-6253
route 132 ouest
(418)
78,
Saint-Jacques Sud
1-888
142,
Saint-Jacques Sud
Vallée (418) 631-9394 52,
Garon
Pharmacie
(418) 756-3762 55,
Saint-Jean-Baptiste
Matawajaw (418)
53c,
Sud
Saumon Dépanneur du Lac (418)
263,
St-Edmond
Beauséjour (418)
71,
Saint-Benoit Ouest
Ambassadeur 1-888-588-6464 266, boul Saint-Benoit Ouest Sélectotel Amqui 1-800-463-0831 340, boul Saint-Benoit Ouest
(418) 629-3434 232, boul Saint-Benoit Ouest
Epicerie Richelieu
756-3861
rue
Via Rail
842-7245
rue
Taxi Adaptée de la
rue
Bureau de poste
Quincaillerie Coop
rue
Site patrimonial de pêche
756-5999
rue Saint-Jacques
Lac-au-
778-3232
rue
Amqui Auberge
629-5531
boul
Auberge
Hotel Gagnon
Abri-camping Amqui

Vrac Vallée
Services

(418) 629-3433 686, route 132 ouest
(418) 629-1618 158, boul. Saint-Benoit Ouest
Via Rail (418) 629-4242 209, boul. Saint-Benoit Ouest




Orléans Express 219-1, boul. Saint-Benoit Est
Taxi de l’est
(418) 330-4444 12, boul Saint-Benoit Ouest
Taxi Rapido (418) 629-4011 85, rue du Collège Bureau de poste Pharmacie




InterSports

St-Vianney Coop de Solidarité
St-René-deMatane Camps Tamagodi
(418) 629-3252 102, boul Saint-Benoit Ouest
(418) 629-5002 1040C, route 195


(418) 429-9340
(418) 224-3340 696, route 195
SIA-QC-Topo+
Localité
Cap-Chat Chalets-Resto Valmont











Gîte Au Crépuscule
Services

Secteur Matane

(418) 786-1355 10, rue Notre-Dame Est
(418) 786-5751
1 866 786-5751 239, rue Notre-Dame Ouest
Auberge Micho (418) 786-5955 202, rue Notre-Dame Est















Gîte l’Aube Matinale
La Maison Mer et Montagnes
Gîte Domaine Joseph Ross
Motel Nanook
Gîte Rêve et Réalité
Gîte de la Maison verte
(418) 786-2445 52, rue Notre-Dame Est
(418) 786-3071 6, rue Notre-Dame Est
(418) 786-5340 238, route 132




(418) 786-2070
1 866 786-2071 104, rue Notre-Dame Est
(418) 786-2465 216, rue Notre-Dame Est
(418) 967-9975 86, rue des Écoliers
Gîte de l’Anse Mitan 190, rue Notre-Dame Est
Le Pirate (418) 786-1411 184, rue Notre-Dame Est

Cabine Goëmons sur Mer
Chalets de l’Anse Blanche
Chalets de La Petite Normandie
(418) 763-3556
1 888 893-5715 195, rue Notre-Dame Est
(418) 786-2272 252, rue Notre-Dame Ouest
(418) 786-5751 239, rue Notre-Dame Ouest
Orléans Express 24, rue Notre-Dame Est
Bureau de poste Pharmacie
BMR Rénovex
(418) 786-5531 27, rue Notre Dame
SIA-QC-Topo+































SIA-QC-Topo+
Services
Localité Ste-Annedes-Monts Auberge Pub Chez Bass (418) 763-2613 170, 1re Avenue Ouest Hôtel & cie (418) 763-3321 90, boul. Sainte-Anne Ouest Auberge Château Lamontagne (418) 763-7666 170, 1re Avenue Est Motel A la Brunante 1 800 463-0828 94, boul. Sainte-Anne Ouest Motel Manoir sur Mer (418) 763-7844 475, 1re Avenue Ouest Motel Beaurivage 1 888 763-2291 245, 1re Avenue Ouest Gîte La P’tite Falaise (418) 763-5188 127, 2e Avenue Ouest Auberge Seigneurie des Monts (418) 763-5308 21, 1re Avenue Est L’Estran (418) 763-3261 43, 1re Avenue Est Auberge du Vieux Faubourg (418) 763-5345 45, 1re Avenue Ouest Auberge internationale La Vieille Ecole (418) 763-7123 295, 1re Avenue Est Camping Ancre Jaune (418) 763-1813 2, rue Simard Camping du Rivage (418) 763-8387 500, 1re Avenue Ouest Boulangerie Marie 4poches (418) 763-4775 111, boul Sainte-Anne Ouest Le Malbord (418) 764-0022 178, 1re Avenue Ouest Orléans Express 85, boul. Sainte-Anne Ouest Parc de la Gaspésie 1-866-727-2427 (418) 763-7494 poste 3301 Taxi Mario (418) 763-2630 168, Route du Parc
Secteur Gaspésie
Services

Taxi Marie-Hélène (418) 763-5310 180, rue Therrien

Pharmacies

Nettoyeur Le Golfe (418) 763-2666 29, Route du Parc
Rona Lafontaine (418) 763-3428 2, Route Lavoie
Quincaillerie Keable (418) 763-5535 168, 1re Avenue Ouest





Exploramer (418) 763-2500 1, rue du Quai
Parc Gaspésie Centre de découverte et services (418) 763-7811
Gîte du Mont-Albert (418) 763-2288
1-866-727-2427
SIA-QC-Topo+
Localité
Mont StPierre Hotel/Motel Mont St-Pierre
Services
Secteur Haute-Gaspésie
(418) 797-2202 60, rue Prudent-Cloutier
Chalets Vermont (418) 797-2810 24, rue Prudent-Cloutier















Motel Au Délice Resto Les Boucaniers
Motel Flots Bleus
1-888-797-2955 100, rue Prudent-Cloutier
(418) 797-2860 18, rue Prudent-Cloutier
Chalets Bernatchez (418) 797-2733 12 rue Prudent-Cloutier
Le Refuge du Maudit Français 11, route Pierre Godefroi Coulombe
Camping municipal (418) 797-2250 103, route Pierre-Godefroi-Coulombe

Marché Bonichoix Chez Julie 70, rue Prudent Cloutier
Bureau de poste
Mont Louis Auberge et restaurant L’Amarée
(418) 797-2323
1-844-867-4319 30, 1re avenue Est




Gîtes des Neiges (418) 797-2855 107, rue de l’Église
Chalets 4 saisons
Camping Parc et Mer
L’Epice-rit ML


(418) 393-2581 92, rue de l’Église
(418) 797-5270 18, 10e rue Est
(418) 797-2943 13, 1re Avenue Ouest
Orléans Express 1, rue Chanoine Richard
Bureau de poste
Pharmacie




SIA-QC-Topo+
Services








Manche

D’Épée Maison Rosa au bord de mer
Madeleine Centre Hotel du Rocher (418) 393-2425
Le Relais d’Olivier, Bureau de poste (418) 393-2411 117, rue Principale
Gîte Shoreline de la Terre à la Mer (514) 970-8325





Camping-Chalets Mer et Montagne (514) 402-6174











Shack à guédilles



SIA-QC-Topo+
53, rue principale
128, route Principale
99, route Principale
195,
208,
37,
37,
(418)
1-800-795-3008 94,
(418)
36,
Rivière-laMadeleine Auberge Chez Mamie 1-866-393-2212
rue Principale Hotel Bon Accueil (418) 393-2323
rue Principale La Capitainerie des Deux Sœurs (418) 393-2777
rue Bellevue GrandeVallée Hotel-Motel Grande Vallée (418) 393-2648 1-800-380-1190
rue du Quai Motel-Resto La Marée Haute
393-3008
rue Saint-François-Xavier Est Motel Richard
393-2670
rue Saint-François-Xavier Ouest
73,
Camping Au Soleil couchant (418) 393-2489
rue Saint-François-Xavier Est
2,
14,
Marché Bonichoix (418) 693-2010
rue St François-Xavier Ouest Les Marchés Tradition (418) 393-2851
rue St François-Xavier Est
2,
Pharmacie
Orléans Express
rue Saint-François-Xavier Ouest Bureau de poste
Localité
PetiteVallée Motel du Villlage
Auberge Chez Madame Lola
Gîte Pétales de lune sur mer
Pourvoirie Beauséjour
Camping de la Falaise
Services
Secteur Côte Gaspé
(418) 393-2592 17, rue Principale
(418) 361-2956 66, rue Principale
1-855-993-3223 117, rue Principale
(418) 393-2347 135, rue Principale
(418) 361-2956 4, rue de la Falaise
Café de la Vieille Forge 4, rue de la Longue Pointe
Cloridorme Rest. Motel Etoile du Nord
Bureau de poste
Saint-Yvon Motel du Cap
L’Anse-àValleau Motel-Camping des Ancêtres















SaintMaurice de l’Échouerie
Gîte Le Clocher d’Argent

Marché Bonichoix
Bureau de poste
(418) 395-2966 1, route du Pêcheur
1-866-395-2990
907, route QC-132




(418) 355-9747
865, boul. Anse-à-Valleau
(418) 269-5676
1-866-284-5676 36, chemin de l’Eglise

(418) 269-3434 420, boul. Petit Cap

SIA-QC-Topo+
Localité

Rivière-auRenard Gîte du Renard
Camping des Appalaches
Microbrasserie Au Frontibus
Services
Secteur Forillon
(418) 882-9070 92, boul. Renard Est
(418) 269-7775
1-866-828-7775
367, Montée de Rivière-Morris
(418) 360-5153 41, rue du Banc
La Cantine du Quai 2, rue de la Langevin
Marché Alban Aspirault (418) 269-3202 42, boul. Renard Est

Épicerie Gaétan Boulay

(418) 269-3654 77, boul. Renard Est
Orléans Express 127, boul. Renard Ouest
Taxi Déry


Bureau de poste Pharmacie
L’Anse-auGriffon Motel Le Noroit










Café de l’Anse
Cap-desRosiers Motel du Haut Phare
Gîte Pétales de Rose
Hôtel Motel Le Pharillon
Havre de Forillon
(418) 269-3348 41, Montée de Rivière-Morris
(418) 892-5531
1-855-892-5531
589, boul. du Griffon
(418) 892-0115 557, boul. Du Griffon


(418) 892-5533 1334, boul. de Cap des Rosiers
(418) 892-5031 1184, boul. de Cap des Rosiers
(418) 892-5200
1 877 909-5200




1293, boul. de Cap des Rosiers

1428, boul. de Cap des Rosiers

SIA-QC-Topo+


Services SIA-QC-Topo+ Cap-aux-Os Auberge La Petite école de Forillon (418) 892-5451 (418) 892-0077 1826, boul. Forillon
Temps de marche Section 02 - Vers Forillon




Temps de marche Section 02 - Vers Matapédia

Origine-Destination Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 De : Matapédia St-André-Restigouche 16,5 895 612 11h20 9h40 8h35 7h50 7h10 Refuge Le Turcotte 1,5 54 52 0h55 0h40 0h35 0h30 0h30
Vitesse de marche (km/h) Origine-Destination Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 St-André-Restigouche 1,5 52 54 0h55 0h50 0h40 0h35 0h30 Matapédia 16,5 612 895 11h 9h25 8h20 7h30 6h55 Temps d'ascension: 300 m/h 500 m/h Temps de descente:
Vitesse de marche (km/h) Du : Refuge Le Turcotte
Actée rouge - Toxique
Temps de marche Section 03 - Vers Forillon

Section 03 - Vers Matapédia

SIA-QC-Topo+ Origine-Destination Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 Du : Refuge Le Turcotte Refuge Le Corbeau 9,5 282 308 5h40 4h40 4h05 3h35 3h20
de marche (km/h) Origine-Destination Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 Refuge Le Turcotte 9,5 308 282 5h35 4h40 4h05 3h35 3h20 Temps d'ascension: 300 m/h 500 m/h Temps de descente:
Vitesse
marche
Vitesse de marche (km/h)
: Refuge Le Corbeau
Temps de
Du
Anse aux Gascons. Marc-Aurèle Fortin, 1942
Temps de marche Section 04 - Vers Forillon



Temps de marche Section 04 - Vers Matapédia

SIA-QC-Topo+ Origine-Destination Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 Du : Refuge Le Corbeau Camping Ruisseau StEtienne 12 443 606 6h55 5h50 4h55 4h25 3h55 Refuge Quartz 4,2 47 60 2h05 1h40 1h25 1h10 1h05
Vitesse de marche (km/h) Origine-Destination Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 Camping Ruisseau StEtienne 4,2 60 47 2h05 1h40 1h25 1h10 1h05 Refuge Le Corbeau 12 606 443 7h35 6h25 5h35 5h 4h35 Temps d'ascension: 300 m/h 500 m/h Temps de descente:
Vitesse de marche (km/h) Du : Refuge Quartz
Du


Temps de marche Section 05 - Vers Forillon Vitesse
Temps de marche Section 05 - Vers Matapédia
Vitesse

SIA-QC-Topo+ Origine-Destination Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 Du : Refuge Le Quartz Refuge du Ruisseau Creux 11,4 744 686 8h55 7h40 6h55 6h25 6h
de marche (km/h) Origine-Destination Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 Refuge Le Quartz 11,4 686 744 8h55 7h40 6h55 6h25 6h Temps d'ascension: 300 m/h 500 m/h Temps de descente:
de marche (km/h)
: Refuge du Ruisseau Creux
Temps de marche Section 06 - Vers Forillon




Section 06 - Vers Matapédia

SIA-QC-Topo+ Origine-Destination Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 Du : Refuge du Ruisseau Creux Abri Ste-Marguerite 10,7 343 76 5h25 4h20 3h35 3h05 2h40 Abri camping Causapscal 17,5 291 572 8h50 7h 5h50 5h 4h25 Camping Chez Moose 2,5 36 7 1h20 1h 0h50 0h40 0h35
Vitesse de marche (km/h) Origine-Destination Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 Abri camping Causapscal 2,5 7 36 1h20 1h 0h50 0h40 0h35 Abri Ste-Marguerite 17,5 572 291 8h50 7h 5h50 5h 4h25 Refuge du Ruisseau Creux 10,7 76 343 5h25 4h20 3h35 3h05 2h40 Temps d'ascension: 300 m/h 500 m/h Temps de descente: Temps
Vitesse de marche (km/h) Du : Camping Chez Moose
de marche




SIA-QC-Topo+ Origine-Destination Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 Du : Camping Chez Moose Abri Les Chutes 16,2 414 341 8h05 6h30 5h25 4h35 4h Temps de marche Section 07 - Vers Forillon Vitesse de marche (km/h) Origine-Destination Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 Camping Chez Moose 16,2 341 414 8h05 6h30 5h25 4h35 4h Temps d'ascension: 300 m/h 500 m/h Temps de descente: Temps de marche Section 07 - Vers Matapédia Vitesse de marche (km/h) Du : Abri Les Chutes
Temps de marche Section 08 - Vers Forillon


Section 08 - Vers Matapédia

SIA-QC-Topo+ Origine-Destination Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 De : Abri Les Chutes JCT Rue savoie (1) 10,7 262 110 5h30 4h25 3h40 3h10 2h50 JCT Lac au Saumon (2) 8,2 218 273 4h35 3h50 3h20 2h55 2h35 Abri Érablière (3) 3,8 74 86 2h 1h40 1h25 1h10 1h05
Vitesse de marche (km/h) Origine-Destination Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 Jct Lac au Saumon (3) 3,8 86 74 1h55 1h35 1h25 1h10 1h JCT Rte Savoie (2) 8,2 273 218 4h40 3h55 3h25 2h55 2h40 Abri Les Chutes (1) 10,7 110 262 5h30 4h30 3h50 3h10 2h55 Temps d'ascension: 300 m/h 500 m/h Temps de marche
Vitesse de marche (km/h) De : Abri Erablière Temps de descente: Origine-Destination Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 JCT Rue Savoie -> Abri St Alexandre (A) 1,7 4 66 0h55 0h40 0h35 0h30 0h25 Abri st-alexandre --> JCT rue Savoie (A) 1,7 66 4 0h55 0h40 0h35 0h30 0h25 JCT ->Abri Lac au Saumon (B) 3,9 15 199 2h20 1h55 1h40 1h30 1h20 Abri Lac au Saumon --> JCT (B) 3,9 199 15 2h35 2h10 1h55 1h40 1h35 Temps de marche Section 08 -
Vitesse de marche (km/h) De: Abri Érablière
Segments secondaires
Section 09 - Vers Forillon


Section 09 - Vers Matapédia

SIA-QC-Topo+ Origine-Destination Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 Du : Abri Erablière Abri camping Amqui 18,1 224 383 9h05 7h10 6h 5h10 4h30 Temps de marche
Vitesse de marche (km/h) Origine-Destination Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 Abri Erablière 18,1 383 224 9h05 7h10 6h 5h10 4h30 Temps d'ascension: 300 m/h 500 m/h Temps de descente: Temps de marche
Vitesse de marche (km/h) Du : Abri camping Amqui
Temps de marche Section 10 - Vers Forillon

Temps de marche Section 10 - Vers Matapédia




SIA-QC-Topo+ Origine-Destination Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 De : Abri cammping Amqui Abri Les Trois Sœurs 16,2 258 127 8h05 6h30 5h25 4h35 4h Abri St-Vianney 11,2 185 232 5h50 4h35 3h55 3h25 2h55
Vitesse de marche (km/h) Origine-Destination Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 Abri Les Trois Sœurs 11,2 232 185 5h55 4h40 3h55 3h30 3h Abri camping Amqui 16,2 127 258 8h05 6h30 5h25 4h35 4h Temps d'ascension: 300 m/h 500 m/h Temps de descente:
Vitesse de marche (km/h) De : Abri St-Vianney
Temps de marche Section 11 - Vers Forillon
Temps de marche Section 11 - Vers Matapédia



SIA-QC-Topo+ Origine-Destination Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 De : Abri St-Vianney Camps Tamagodi 9,8 185 368 5h10 4h10 3h35 3h05 2h50 Accueil John 6,6 60 29 3h20 2h35 2h10 1h55 1h40 Abri Rivière Matane 1 5 15 0h30 0h25 0h20 0h20 0h20
Vitesse de marche (km/h) Origine-Destination Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 Accueil John 1 15 5 0h30 0h25 0h20 0h20 0h20 Camps Tamagodi 6,6 29 60 3h20 2h35 2h10 1h55 1h40 Abri St-Vianney 9,8 368 185 5h05 4h05 3h30 2h55 2h35 Temps d'ascension: 300 m/h 500 m/h Temps de descente:
Vitesse de marche (km/h) De : Abri Rivière Matane
Près de la riv. Ste-Anne
Temps
de marche Section 12 - Vers Forillon
Temps

Section 12 - Vers Matapédia

SIA-QC-Topo+ Origine-Destination Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 De : Abri Rivière Matane Abri Ruisseau des Pitounes 11,4 673 357 6h20 5h10 4h25 3h55 3h30
Vitesse de marche (km/h) Origine-Destination Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 Abri Rivière Matane 11,4 357 673 6h50 5h40 4h55 4h25 3h55 Temps d'ascension: 200 m/h 350 m/h Temps de descente:
de marche
Vitesse de marche (km/h)
: Abri Ruisseau des Pitounes
De

SIA-QC-Topo+ Origine-Destination Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 De : Abri Ruisseau des Pitounes JCT raccourci avant Petchedetz 7,9 419 322 6h25 5h35 5h 4h40 4h25 Abri Tombereau via raccourci 2,5 52 231 1h55 1h35 1h30 1h25 1h20 Abri Tombereau via Mont Petchedetz 5,5 205 383 4h25 3h50 3h25 3h10 2h55 Temps de marche
Forillon Vitesse de marche (km/h) OU Origine-Destination Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 Via raccourci -> JCT 2,5 231 52 2h25 2h05 1h55 1h50 1h50 Via Mont Petchedetz -> JCT 5,5 383 205 4h40 4h10 3h50 3h30 3h20 JCT ->Abri Ruisseau des Pitounes 7,9 322 419 5h55 5h05 4h35 4h10 3h55 Temps d'ascension: 200 m/h 350 m/h Temps de descente: OU Temps de marche Section 13 -
Matapédia Vitesse de marche (km/h) De : Abri Lac Tombereau
Section 13 - Vers
Vers
Temps de marche Section 14 - Vers Forillon



SIA-QC-Topo+ Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 De: Abri Lac Tombereau 8,9 720 430 8h 7h05 6h30 6h05 5h50 5,9 153 528 4h25 3h50 3h25 3h05 2h55 Abri Lac Matane Origine-Destination
Vitesse de marche (km/h) Abri La Montagne à Valcourt Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 De: Abri Lac Matane 5,9 528 153 5h25 4h50 4h25 4h10 3h55 8,9 430 720 7h20 6h25 5h50 5h25 5h05
d'ascension: 200 m/h 350 m/h
de descente: Abri La Montagne à Valcourt Abri Lac Tombereau Origine-Destination Temps de marche Section 14 - Vers Matapédia Vitesse de marche (km/h)
Temps
Temps
de marche Section 15 - Vers Forillon
de marche Section 15 - Vers Matapédia


SIA-QC-Topo+ Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 De: Abri Lac Matane 8,3 764 359 8h20 7h30 6h55 6h30 6h20
Vitesse de marche (km/h) Abri Lac du Gros Ruisseau Origine-Destination Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 De: Abri Lac du Gros Ruisseau 8,3 359 764 7h10 6h20 5h50 5h25 5h05 Temps d'ascension: 200 m/h 350 m/h Temps de descente:
Vitesse de marche (km/h) Abri Lac Matane Origine-Destination
Temps
Temps
Orignal femelle
Temps de marche Section 16 - Vers Forillon

Section 16 - Vers

SIA-QC-Topo+ Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 De: Abri Lac du Gros Ruisseau 9,8 699 757 9h10 8h10 7h30 7h05 6h40
Origine-Destination Vitesse de marche (km/h) Abri Mont Craggy Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 De: Abri Mont Craggy 9,8 757 699 9h05 8h05 7h30 7h 6h40 Temps d'ascension: 200 m/h 350 m/h Temps de descente: Origine-Destination Vitesse de marche (km/h) Abri Lac du Gros Ruisseau
marche
Matapédia
Canada
Temps de
Tétras du
Temps de marche Section 17 - Vers Forillon
Temps de marche Section 17 - Vers Matapédia


SIA-QC-Topo+ Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 De: Abri Mont Craggy 3,2 510 26 4h 3h40 3h30 3h20 3h10 4,7 148 556 3h55 3h25 3h05 2h55 2h40
Origine-Destination Vitesse de marche (km/h) Mont Blanc Abri Lac Beaulieu Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 De: Abri Lac Beaulieu 4,7 556 148 5h 4h30 4h10 4h 3h50 3,2 26 510 2h55 2h40 2h25 2h20 2h10 Temps d'ascension: 200 m/h 350 m/h Temps de descente: Abri Mont Craggy
Origine-Destination Vitesse de marche (km/h) Mont Blanc
Temps de marche Section 18 - Vers Forillon
Temps de marche Section 18 - Vers Matapédia


SIA-QC-Topo+ Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 De: Abri Lac Beaulieu 8,7 705 494 7h55 7h 6h25 6h 5h40 6,1 29 772 5h10 4h35 4h10 3h55 3h40
Origine-Destination Vitesse de marche (km/h) Mont Nicol-Albert Abri Petit Sault Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 De: Abri Petit Sault 6,1 772 29 6h50 6h10 5h50 5h30 5h20 Abri Lac Beaulieu 8,7 494 705 7h35 6h40 6h10 5h50 5h25 Temps d'ascension: 200 m/h 350 m/h Temps de descente:
Origine-Destination Vitesse de marche (km/h) Mont Nicol-Albert
©Catherine Auger
de marche Section 19 - Vers Forillon
de marche Section 19 - Vers Matapédia


SIA-QC-Topo+ Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 De: Abri Petit Sault 8,1 575 76 6h35 5h50 5h20 4h55 4h35
Origine-Destination Vitesse de marche (km/h) Abri Ruisseau Bascon Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 De: Abri Ruisseau Bascon 8,1 76 575 5h30 4h40 4h10 3h50 3h30 Temps d'ascension: 200 m/h 350 m/h Temps
Origine-Destination Vitesse de marche (km/h) Abri Petit Sault Temps de descente:
Temps
Temps de marche Section 20 - Vers Forillon
Temps de marche Section 20 - Vers Matapédia



SIA-QC-Topo+
Origine-Destination Distance Dénivelé + Dénivelé - Vitesse de marche (km/h) (km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 De: Abri Ruisseau Bascon Mont Logan 8,4 834 348 7h20 6h30 5h55 5h30 5h10 Refuges Nyctale et Chouette 3,4 44 158 1h40 1h25 1h05 0h55 0h55
Origine-Destination Distance Dénivelé + Dénivelé - Vitesse de marche (km/h) (km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 Du: Refuges Nyctale et Chouette Mont Logan 3,4 158 44 1h40 1h25 1h05 0h55 0h55 Abri Ruisseau Bascon 8,4 348 834 7h35 6h40 6h10 5h50 5h30 Temps d'ascension: 300 m/h Temps de descente: 500 m/h
Temps de marche Section 21 - Vers Forillon
Temps de marche Section 21 - Vers Matapédia


SIA-QC-Topo+
Origine-Destination Distance Dénivelé + Dénivelé - Vitesse de marche (km/h) (km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 Du: Refuges Nyctale et Chouette Camping Arnica 3 45 238 1h55 1h40 1h30 1h20 1h10 Refuge Carouge 5,5 270 342 4h10 3h40 3h20 3h05 2h55 Camping Kalmia 6 193 416 4h10 3h35 3h10 2h55 2h40 Refuge Le Huard 2,2 43 45 1h05 0h55 0h40 0h35 0h35
Origine-Destination Distance Dénivelé + Dénivelé - Vitesse de marche (km/h) (km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 Du: Refuge Le Huard Camping Kalmia 2,2 45 43 1h05 0h55 0h40 0h35 0h35 Refuge Carouge 6 416 193 4h30 3h55 3h30 3h10 2h55 Camping Arnica 5,5 342 270 4h20 3h50 3h25 3h05 2h55 Refuges Nyctale et Chouette 3 238 45 2h10 1h55 1h40 1h35 1h30 Temps d'ascension: 300 m/h Temps de descente: 500 m/h
marche Section 22 - Vers Forillon
Temps de marche Section 22 - Vers Matapédia


SIA-QC-Topo+ Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 Du: Refuge Le Huard 11,4 701 390 8h05 6h55 6h10 5h40 5h10
Origine-Destination Vitesse de marche (km/h) Refuge Le Mésange Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 Du: Refuge Le Mésange 11,4 390 701 7h30 6h25 5h35 5h05 4h40 Temps d'ascension: 300 m/h 500 m/h Origine-Destination Vitesse de marche (km/h) Refuge Le Huard Temps de descente:
Temps de
Temps de marche Section 23 - Vers Forillon



SIA-QC-Topo+ Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 Du: Refuge Le Mésange 1,1 63 39 0h50 0h40 0h40 0h35 0h35 5,9 255 344 3h55 3h25 2h55 2h40 2h30 6,8 182 451 4h30 3h55 3h25 3h05 2h50 Pic du Brulé Camping Lac Cascapédia
Origine-Destination Vitesse de marche (km/h) Camping Le Saule Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 Du: Camping Lac Cascapédia Pic du Brulé 6,8 451 255 4h40 4h 3h35 3h10 2h55 Camping Le Saule 5,9 344 255 3h55 3h25 2h55 2h40 2h30 1,1 39 63 0h50 0h40 0h35 0h35 0h30 Temps d'ascension: 300 m/h 500 m/h Origine-Destination Vitesse de marche (km/h) Refuge Le Mésange Temps de descente: Temps de marche Section 23 - Vers Matapédia
Plateau Mont-Albert
de marche Section 24 - Vers Forillon
de marche Section 24 - Vers Matapédia


SIA-QC-Topo+ Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 Du: Camping Lac Cascapédia 8,4 508 329 6h20 5h30 4h55 4h30 4h10
Origine-Destination Vitesse de marche (km/h) Refuge La Paruline Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 Du: Refuge La Paruline 8,4 329 508 6h05 5h20 4h40 4h20 4h Temps d'ascension: 300 m/h 500 m/h
Origine-Destination Vitesse de marche (km/h) Camping Lac Cascapédia Temps de descente:
Temps
Temps
Cuve Mont-Albert
JCT Grande Cuve sud
Camping La Rivière (par la cuve et lac du Diable)
Temps de marche Section 25 - Vers Forillon
Camping La Rivière (par le Mont Albert-Versant Nord)
de marche Section 25 - Vers Matapédia
JCT
JCT


SIA-QC-Topo+ Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 Du: Refuge La Paruline Camping La Fougère 3,5 94 31 1h50 1h25 1h10 1h 0h55 10 440 378 6h05 5h05 4h25 3h55 3h35 8,9 41 585 4h30 3h35 2h55 2h30 2h10 7,6 305 850 6h30 5h40 5h10 4h55 4h35 OU
Origine-Destination Vitesse de marche (km/h)
Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 Du: Camping La Rivière 7,6 850 305 7h10 6h30 5h55 5h35 5h20 8,9 585 41 4h30 3h35 2h55 2h30 2h10 10 378 440 6h25 5h25 4h40 4h10 3h55 3,5 31 94 1h50 1h25 1h10 1h 0h55 Temps d'ascension: 300 m/h 500 m/h Temps de descente:
Grande Cuve sud (Par Mt Albert – Versant nord)
Diable
Temps
Refuge La Paruline OU Origine-Destination Vitesse de marche (km/h) Camping La Fougère
Grande Cuve sud (Par le lac du
et la cuve)
Temps de marche Section 26 - Vers Forillon
Temps de marche Section 26 - Vers Matapédia



SIA-QC-Topo+ Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 Du: Camping La Rivière 8,4 529 74 4h10 3h25 2h50 2h25 2h05 6,6 459 95 4h50 4h05 3h40 3h25 3h10 Refuge Le Tétras
Origine-Destination Vitesse de marche (km/h) Refuge Le Roselin Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 Du: Refuge Le Tétras 6,6 95 459 4h10 3h30 3h05 2h50 2h35 Camping La Rivière 8,4 74 529 4h10 3h25 2h50 2h25 2h05 Vitesse d'ascension: 300 m/h 500 m/h
Origine-Destination Vitesse de marche (km/h) Refuge Le Roselin Temps de descente:
Lac Quiscale, Mont-Albert
Temps de marche Section 27 - Vers Forillon
Temps de marche Section 27 - Vers Matapédia



SIA-QC-Topo+ Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 Du: Refuge Le Tétras 4,9 327 84 3h25 2h55 2h35 2h25 2h10 8,2 19 735 5h30 4h40 4h10 3h50 3h30 Camping Mont Jacques-Cartier
Origine-Destination Vitesse de marche (km/h) Mont Jacques-Cartier Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 Du: Camping Mont JacquesCartier 8,2 735 19 6h30 5h40 5h05 4h40 4h30 Refuge Le Tétras 4,9 84 327 3h 2h30 2h10 1h55 1h50 Temps d'ascension: 300 m/h 500 m/h
Origine-Destination Vitesse de marche (km/h) Mont Jacques-Cartier Temps de descente:
Américains
Lac aux
Temps de marche Section 28 - Vers Forillon


de marche Section 28 - Vers Matapédia


SIA-QC-Topo+ Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 Du: Camping Mont JacquesCartier 14,5 398 424 7h20 5h50 4h50 4h05 3h35
Origine-Destination Vitesse de marche (km/h) Refuge Cabourons Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 Du: Refuge Cabourons 14,5 424 398 7h20 5h50 4h50 4h05 3h35 Temps d'ascension: 300 m/h 500 m/h Temps
Origine-Destination Vitesse de marche (km/h)
Mont Jacques-Cartier Temps de descente:
Camping
Temps de marche Section 29 - Vers Forillon

Temps de marche Section 29 - Vers Matapédia


SIA-QC-Topo+ Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 Du: Refuge Cabourons 8,2 19 735 5h30 4h40 4h10 3h50 3h30
Origine-Destination Vitesse de marche (km/h) Camping Mont St-Pierre Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 Du: Camping Mont St-Pierre 8,2 735 19 9h40 7h40 6h25 5h30 4h50 Temps d'ascension: 300 m/h 500 m/h Origine-Destination Vitesse de marche (km/h) Refuge Cabourons Temps de descente:
Vallée Mont St-Pierre




SIA-QC-Topo+ Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 Du: Camping Mont St-Pierre 13,2 548 558 9h 7h40 6h50 6h10 5h40 6,8 143 143 3h25 2h40 2h20 1h55 1h40 10,3 444 382 6h35 5h35 4h55 4h25 4h05 Camping l'Anse-Pleureuse Abri Ruisseau-Flétan Temps de marche Section 30 - Vers Forillon Origine-Destination Vitesse de marche (km/h) Mont-Louis Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 De: Abri Ruisseau-Flétan 10,3 382 444 6h30 5h30 4h50 4h20 3h55 6,8 143 143 3h25 2h40 2h20 1h55 1h40 13,2 558 548 9h 7h40 6h50 6h10 5h40 Temps d'ascension: 300 m/h 500 m/h Temps de descente: Mont-Louis Camping Mont St-Pierre Temps de marche Section 30 - Vers Matapédia Origine-Destination Vitesse de marche (km/h) Camping l'Anse-Pleureuse
Temps de marche Section 31 - Vers Forillon



SIA-QC-Topo+ Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 De: Abri Ruisseau-Flétan 3,3 88 146 2h10 1h50 1h35 1h30 1h20 9,3 308 320 5h10 4h20 3h40 3h10 2h55 6,4 451 60 3h10 2h35 2h05 1h50 1h35 8,1 118 487 4h40 3h55 3h20 2h55 2h35
Origine-Destination Vitesse de marche (km/h) Gros-Morne Manche d'Épée Camping Lac à Cyrille Madeleine-Centre Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 De: Madeleine-Centre 8,1 487 118 4h40 3h55 3h20 2h55 2h35 6,4 60 451 3h10 2h35 2h05 1h50 1h35 9,3 320 308 5h35 4h40 4h 3h35 3h20 3,3 146 88 2h10 1h55 1h40 1h30 1h25 Temps d'ascension: 300 m/h 500 m/h Temps de descente: Manche d'Épée Gros-Morne Temps de marche Section 31 - Vers Matapédia Abri Ruisseau-Flétan Origine-Destination Vitesse de marche (km/h) Camping Lac à Cyrille


SIA-QC-Topo+ Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 De: Madeleine-Centre 3,9 46 62 1h55 1h35 1h20 1h05 0h55 6,7 322 80 3h40 2h55 2h30 2h10 1h55 20,4 421 662 10h50 8h50 7h25 6h30 5h40 Temps de marche
-
Origine-Destination Vitesse de marche (km/h) Rivière-la-Madeleine Camping Grand-Sault Grande-Vallée (Camping Soleil Couchant) Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 De: Grande-Vallée (Camping Soleil Couchant) 20,4 662 421 10h35 8h30 7h10 6h10 5h30 6,7 80 322 3h30 2h55 2h25 2h05 1h55 3,9 62 46 1h55 1h35 1h20 1h05 0h55 Temps d'ascension: 300 m/h 500 m/h Temps de descente: Camping Grand-Sault Rivière-la-Madeleine Madeleine-Centre Origine-Destination Vitesse de marche (km/h) Temps de marche Section 32 - Vers Matapédia
Section 32
Vers Forillon
Temps de marche Section 33 - Vers Forillon



Section 33 - Vers Matapédia

SIA-QC-Topo+ Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 De: Grande-Vallée (Camping Soleil Couchant) 5,4 76 75 2h50 2h10 1h55 1h35 1h25 9,5 405 223 5h40 4h50 4h05 3h40 3h20 12,9 457 496 7h55 6h35 5h50 5h10 4h40
Origine-Destination Vitesse de marche (km/h) Petite-Vallée Abri Les Terrasses Refuge Les Cascades Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 De: Refuge Les Cascades 12,9 496 457 8h10 6h55 6h 5h25 4h55 9,5 223 405 5h30 4h35 3h55 3h30 3h10 5,4 75 76 2h40 2h10 1h50 1h35 1h25 Temps d'ascension: 300 m/h 500 m/h Temps de marche
Temps de descente: Abri Les Terrasses Petite-Vallée Grande-Vallée (Camping Soleil Couchant) Origine-Destination Vitesse de marche (km/h)
Temps de marche Section 34 - Vers Forillon


Temps de marche Section 34 - Vers Matapédia


SIA-QC-Topo+ Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 Du: Refuge Les Cascades 11 306 465 6h20 5h10 4h30 3h55 3h35 12,7 505 315 6h35 5h20 4h25 3h50 3h25 Abri La Chute
Origine-Destination Vitesse de marche (km/h) Saint-Yvon Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 De: Abri La Chute 12,7 465 306 6h40 5h25 4h35 3h55 3h30 11 315 505 6h25 5h20 4h35 4h05 3h40 Temps d'ascension: 300 m/h 500 m/h Refuge Les Cascades Temps de descente: Saint-Yvon
Origine-Destination Vitesse de marche (km/h)
Mont Logan
Temps de marche Section 35 - Vers Forillon
Temps de marche Section 35 - Vers Matapédia


SIA-QC-Topo+ Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 De: Abri La Chute 8,9 320 506 5h35 4h40 4h05 3h40 3h25
Origine-Destination Vitesse de marche (km/h) Refuge Le Zéphir Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 Du: Refuge Le Zéphir 8,9 506 320 5h40 4h50 4h10 3h50 3h25 Temps d'ascension: 300 m/h 500 m/h Origine-Destination Vitesse de marche (km/h) Abri La Chute Temps de descente:
Temps de marche Section 36 - Vers Forillon




SIA-QC-Topo+ Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 Du: Refuge Le Zéphir 5,2 165 100 2h55 2h25 2h 1h50 1h35 7,1 322 232 4h30 3h50 3h25 3h 2h50 9,8 291 279 5h10 4h20 3h35 3h05 2h50 Abri Les Carrières Refuge L'Érablière
Origine-Destination Vitesse de marche (km/h) L'Anse-à-Valleau Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 De: Refuge L'Érablière 9,8 279 291 5h05 4h05 3h30 3h 2h40 7,1 232 322 4h25 3h40 3h10 2h55 2h35 5,2 100 165 2h50 2h10 1h55 1h40 1h30 Temps d'ascension: 300 m/h 500 m/h Refuge Le Zéphir Temps de descente: Abri Les Carrières L'Anse-à-Valleau Temps de marche Section 36
Vers Matapédia Origine-Destination Vitesse de marche (km/h)
-
Riv. Ste-Anne
Temps de marche Section 37 - Vers Forillon

Temps de marche Section 37 - Vers Matapédia



SIA-QC-Topo+ Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 Du: Refuge L'Érablière 9,5 174 360 5h 4h05 3h25 2h55 2h35 14,1 587 188 7h 5h35 4h40 4h 3h30 Camping Les Lacs
Origine-Destination Vitesse de marche (km/h) Camping Appalaches Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 Du: Camping Les Lacs 14,1 188 587 7h 5h35 4h40 4h 3h30 9,5 360 174 5h10 4h10 3h35 3h10 2h50 Temps d'ascension: 300 m/h 500 m/h Temps de descente: Refuge L'Érablière
Origine-Destination Vitesse de marche (km/h) Camping Appalaches
©Catherine Auger
de marche Section 38 - Vers Forillon
marche Section 38 - Vers Matapédia



SIA-QC-Topo+ Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 De: Camping Les Lacs 9,3 263 422 5h35 4h40 4h05 3h35 3h20 Temps
Origine-Destination Vitesse de marche (km/h) Camping Les Crêtes #1 Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 De: Camping Les Crêtes #1 9,3 422 263 5h25 4h30 3h55 3h25 3h05 Temps d'ascension: 300 m/h 500 m/h Temps
Origine-Destination Vitesse de marche (km/h) Camping Les Lacs Temps de descente:
de
Temps de marche Section 39 - Vers Forillon

Étant au bout du monde, n’oublie pas de revenir sur tes pas.



SIA-QC-Topo+ Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 Du: Camping Les Crêtes #1 4 118 99 2h 1h35 1h20 1h05 1h 10,8 425 613 7h05 5h55 5h20 4h40 4h25 10 293 322 5h40 4h40 3h55 3h30 3h10
Origine-Destination Vitesse de marche (km/h) Camping Les Crêtes #2 Camping Cap-Bon-Ami Cap-Gaspé Distance Dénivelé + Dénivelé(km) (m) (m) 2 2,5 3 3,5 4 De: Cap-Gaspé 10 322 293 5h40 4h40 4h 3h35 3h10 10,8 613 425 7h25 6h20 5h35 5h05 4h40 4 99 118 2h 1h35 1h20 1h05 1h Temps d'ascension: 300 m/h 500 m/h Origine-Destination Vitesse de marche (km/h) Temps de descente: Camping Cap-Bon-Ami Camping Les Crêtes #2 Camping Les Crêtes #1 Temps de marche Section 39 - Vers Matapédia
Images satellitaires
 Mont Blanc
Mont Blanc
Images satellitaires
 Mont Nicol-Albert
Mont Nicol-Albert

SIA-QC-Topo+
Région des Monts Fortin, Matawees et Logan 1/3

SIA-QC-Topo+
Mont Logan 2/3

SIA-QC-Topo+
Mont Logan 3/3




SIA-QC-Topo+
Mont Albert
Sommet Albert Sud (1154)
SIA
Table à Moïse Grande Cuve Sud
Lac Quiscale
Sommet Albert Nord (1088)
Montée versant nord
Mur des Patrouilleurs
Grand Mur Epaule des Caribous
SIA L.B.
Cet index vous permettra d’atteindre directement la carte ou la description du toponyme du repère désiré.
→ Carte
Secteur ➔ Toponyme → Carte
A Accueil John, Camping Matane
Alain-Potvin, Lac
Ala'sui'nui, Mont
Albert , Mont
Gaspésie
Matane
Gaspésie
Américains, Lac aux Gaspésie
Américains, Ruisseau aux Gaspésie
Amqui, Abri
Amqui, Ville
Matapédia
Matapédia
Anse à Colin Haute-Gaspésie
Anse à Déry Côte Gaspé
Anse à Mercier Côte Gaspé
Anse-aux-Canons
Anse du Cap à l’Ours
Anse Saint-Georges
Anses Saint-Jean, Pont des
Appalaches, Camping des





Arthur-Allen, Mont
Assemetquagan, Rivière
Aube, Pic
Barbarin, Mont du lac
Bascon, Abri
Bascon, Ruisseau
Côte Gaspé
Haute-Gaspésie
Forillon
Matapédia





Forillon





Gaspésie
Avignon
Gaspésie
Gaspésie
Matane
Matane
SIA-QC-Topo+
B C D E F G H J KL M N O P QR S T VWXZ
REPÈRES GÉOGRAPHIQUES
B
Bayfield, Mont
Beaulieu, Abri
Beaulieu, Lac
Beaulieu, Ruisseau
Beauséjour, Pont
Blanc, Mont
Bleu, Pic
Blizzard, Mont
Matane
Matane
Matane
Matane
Matapédia
Matane
Matane
Gaspésie
Bouleaux, Lac aux Gaspésie
Brûlé, Pic du Gaspésie C
Caburons, Refuge
Haute-Gaspésie
Camarine, Camping Gaspésie
Camp à Guelou, Ruisseau du Haute-Gaspésie
Cap-aux-Os Forillon
Cap Barré Haute-Gaspésie
Cap Bon-Ami, Cap Forillon
Cap Bon-Ami, Camping Forillon
Cap-de-la-Madeleine, Phare
Haute-Gaspésie
Cap-Chat, Ville Matane
Cap-Chat Est, Ruisseau Matane
Cap-des-Rosiers, Village Forillon
Cap-Gaspé, Cap Forillon
Carouge, Refuge






Carrières, Abri des
Cascades, Refuge
Gaspésie
Côte Gaspé
Côte Gaspé
Cascapédia, Camping Gaspésie
Cascapédia, Rivière
Causapscal, Abri


Gaspésie
Matapédia














SIA-QC-Topo+
Causapscal, Rivière
Causapscal, Ville
Charles-E. Vézina, Mont
Chic-Chocs, Monts
Chouette, Refuge







Matapédia
Matapédia
Matane
Gaspésie
Gaspésie
Chute, Abri La Côte Gaspé
Chutes, Abri
Clark, Canyon
Clark, Ruisseau
Clercs, Mont des
Cloridorme, Village
Coleman, Mont
Collins, Mont
Comte, Mont
Corbeau, Refuge
Craggy, Abri
Craggy, Mont
Crêtes 1, Camping
Crêtes 2, Camping
Creux, Refuge Ruisseau
Creux, Ruisseau
Croisée, Abri La
Cyrille, Lac à, Abri
Desjarlais, Pic
Desjarlais, Ruisseau
Des-Rosiers, Camping
Diable, Chute












Matapédia





Avignon
Avignon
Matane
Côte Gaspé
Matane
Gaspésie
Gaspésie
Avignon
Matane
Matane
Forillon
Forillon
Avignon
Avignon
Gaspésie
Haute-Gaspésie
Matane
Matane
Forillon
Gaspésie
SIA-QC-Topo+
D
Diable, Lac








Diable, Ruisseau

Gaspésie
Gaspésie
Disparus, Mont des Matane
Division, Rivière de la Forillon
Dodge, Mont
Dos de la Baleine, Mont
Gaspésie
Gaspésie
Duvivier, Rivière Matane
Éole, Abri
Ells, Mont
Erablière, Abri
Erablière, Refuge de l'
Ernest-Ménard, Mont
Fernald, Réserve écologique
Gaspésie
Gaspésie
Matapédia









Côte Gaspé
Gaspésie
Gaspésie
Fernand Fafard, Mont Matane
Ferré, Ruisseau
Haute-Gaspésie
Forillon, Parc national Forillon
Fortin, Mont
Fortin, Mont – Habitat floristique

Gaspésie
Gaspésie
Fort Péninsule Forillon
Fougère, Camping Gaspésie
Fougères, Mont des Matane
Galène, Ruisseau à Gaspésie
Galipeault, Pont
Gaspé , Ville
Gaspésie, Parc national
Gisant
Golfe, Ruisseau du
Haute-Gaspésie
Forillon




Gaspésie
Haute-Gaspésie
Haute-Gaspésie
SIA-QC-Topo+
E
F
G
Grand Sault, Abri
Grande Anse
Grande-Grave, Lieu-dit
Grand-Étang
Grande-Vallée, Village
Haute-Gaspésie
Côte Gaspé
Forillon
Côte Gaspé
Haute-Gaspésie
Gros Ruisseau, Abri Lac du Matane
Gros-Morne, Parc éolien
Gros-Morne, Village
Hélène, Chute
Huard, Refuge
Jacques-Cartier, Mont
Jacques-Ferron, Mont
Jalbert, Chutes
Jean-Yves Bérubé, Mont
Jimmy-Russell, Mont
John-A.-Allen, Mont








Haute-Gaspésie
Haute-Gaspésie
Matane
Gaspésie
Gaspésie
Gaspésie
Côte Gaspé
Matane
Matane
Gaspésie
Gaspésie KL
Joseph-Fortin, Mont
Kalmia, Camping Le Gaspésie
Kempt, Parc éolien
Lac à Canard, Mont du
Lac Matane, Abri
Lac Tombereau, Abri
La Longue Pointe
L’Anse-au-Griffon, Village
L'Anse Pleureuse, Village
L'Anse-à-Valleau, Parc éolien
Matapédia


Forillon
Matane
Matane
Côte Gaspé
Forillon





Haute-Gaspésie
Côte Gaspé
SIA-QC-Topo+
H
J
L'Anse-à -Valleau, Village
La Rivière, Camping
Les Lacs, Camping
Le Saule, Camping
Logan, Mont
Logan, Mont. Camping
Logan, Mont – Habitat floristique
Loubert, Lac
Louis-Marie Lalonde, Mont
Côte Gaspé
Gaspésie
Forillon

Gaspésie
Gaspésie
Gaspésie
Gaspésie
Gaspésie
Gaspésie
Gaspésie M
Loupes, Mont des
Madeleine-Centre, Village
Madeleine, Rivière
Manche d'Épée, Village
Manche d’Épée, Réserve écologique





Matane, Lac
Matane, Rivière
Matapédia, Abri
Matapédia, Ville

Matapédia, Rivière
Matawees, Mont
Mattawees, Mont – Habitat floristique
McGerrigle, Chaîne Monts
Mem, Ruisseau
Mer et Montagne, Camping







Mésange, Refuge
Haute-Gaspésie
Haute-Gaspésie
Haute-Gaspésie
Haute-Gaspésie
Matane
Matane
Avignon
Avignon
Avignon
Gaspésie
Gaspésie
Gaspésie
Matane










Haute-Gaspésie
Gaspésie
Michaud, Ruisseau à Gaspésie
Milieu, Mont du
Mont-Albert
Gaspésie
Gaspésie
SIA-QC-Topo+
Mont-Albert, Camping
Mont-Albert, Refuges


Mont Jacques-Cartier, Abri
Mont-Louis, Parc éolien
Mont-Louis, Village
Mont St-Pierre, Camping
Mont St-Pierre, Réserve écologique
Mont St-Pierre, Village
Montagne à Valcourt, Abri
Montagne à Valcourt, Mont
Montagne-de-Roche, Habitat floristique
Montagne sèche, Parc éolien
Musard, Ruisseau
Narcisse, Ruisseau
Nicol-Albert, Mont
Gaspésie
Gaspésie
Gaspésie
Haute-Gaspésie
Haute-Gaspésie
Haute-Gaspésie
Haute-Gaspésie
Haute-Gaspésie
Matane
Matane
Forillon
Côte Gaspé
Gaspésie
Haute-Gaspésie
Matane
Nid d’Aigle, Mont du Matane
Nyctale, Refuge
Olivine, Mont






Or, Lac d’
Ouest, Ruisseau de l’
Parc et Mer, Camping
Paruline, Refuge
Passe, Mont de la
Pembroke, Mont
Penouille, Hameau
Penouille, Lacs de
Gaspésie
Gaspésie
Matane
Matane






Haute-Gaspésie
Gaspésie
Gaspésie
Gaspésie
Forillon
Forillon






SIA-QC-Topo+
N
O
P
Perches, Mont aux
Petchedetz, Mont
Petit Sault, Abri
Matane
Matane
Matane
Petite Fourche, Rivière de la Côte Gaspé
Petites Chutes, Ruisseau des Haute-Gaspésie
Petite-Vallée, Village
Petit-Gaspé, Camping
Côte Gaspé
Forillon
Philomène, Chute à Matapédia





Pic, Lac du Gaspésie
Pico, Chutes
Avignon
Pics, Mont des Gaspésie
Matane
Pitounes, Abri
Pluvier, Refuge Le Gaspésie
Pointe-à-la-Frégate
Pointe-à-la-Renommée

Pointe-du-Wrack
Pointu, Mont
Côte Gaspé
Côte Gaspé
Haute-Gaspésie
Matane
Portage, Ruisseau du Gaspésie
Premier-lac-des-Iles, Habitat floristique
Quartz, Refuge
Quiscale, Lac
Restigouche, Rivière
Ristigouche, Réserve écologique
Rivière-au-Renard, Village
Rivière Matane, Abri
Roger, Chute à
Rolland-Germain, Mont
Gaspésie
Avignon
Gaspésie
Avignon
Avignon
Forillon






Matapédia
Matapédia










Gaspésie

SIA-QC-Topo+
QR
S





Ruisseau Creux, Refuge du Avignon
Ruisseau Desjarlais, Pic du
Ruisseau Flétan, Abri
Ruisseau des Pitounes, Abri
Saint-Alban, Mont
Saint-Alexandre, Abri
Saint-Alexandre-des-Lacs, Village
Saint-André-de-Restigouche, Village
Matapédia
Haute-Gaspésie
Matane
Forillon







Matapédia
Matapédia
Avignon
Sainte-Anne, Chute Gaspésie
Sainte-Anne, Rivière Gaspésie
Sainte-Anne-des-Monts, Ville Gaspésie
Sainte-Anne Nord-Est, Rivière Gaspésie
Saint-Laurent, Estuaire
Saint-Laurent, Fleuve
Sainte-Marguerite, Abri
Sainte-Marguerite-Marie, Village
Saint-Maurice-de-l'Échouerie, Village
Saint-Maxime-du-Mont-Louis, Village
Saint-Octave-de-l’Avenir, Village

Saint-Pierre, Mont
Saint-Pierre, Rivière Mont
Saint-Vianney, Abri
Saint-Vianney, Village
Saint-Yvon, Village
Haute-Gaspésie
Haute-Gaspésie
Matapédia
Matapédia
Côte Gaspé
Haute-Gaspésie
Gaspésie
Haute-Gaspésie
Haute-Gaspésie
Matapédia
Matapédia
Côte Gaspé
Saule, Camping Le Gaspésie



Saumon, Abri Lac au
Matapédia
Saumons, Ruisseau des Gaspésie
Seigneurie de l’Anse-de-l’Étang
Côte Gaspé
SIA-QC-Topo+
VWXZ



Serpentine-du Mont-Albert, Habitat floristique
Séverin-Pelletier, Mont




Gaspésie
Matane
Soleil Couchant, Camping Au Haute-Gaspésie
Table, Mont de la Gaspésie
Table à Moise, Plateau
Tamagodi, Camps
Terrasses, Abri
Tétras, Refuge Le





Tombereau, Abri
Gaspésie
Matapédia



Côte Gaspé
Gaspésie
Matane
Trois Soeurs, Abri des Matapédia
Turcotte, Refuge
Avignon
Vents du Kempt, Parc éolien Matapédia
Voligny, Ruisseau
William-Price, Mont
Xalibu, Mont
Zéphyr, Refuge
Gaspésie
Matane
Gaspésie
Côte Gaspé
SIA-QC-Topo+
T
Images satellitaires


Matapédia-Matane Haute-Gaspésie Côte-Gaspé
Bureaux de poste

POSTE CANADA
e Adresse
rue Principale
postal G0J 2G0 G0J 2G0 Téléphone (418) 865-2188 (418) 865-2063 Horaire : Dim. Fermé 09:00-17:00 Lun. 09-12:30, 13:30-17:30 11:00-17:00 Mar. Mer. Jeu. 09:00-20:00 Ven. Sam. Fermé 09:00-17:00
- Avignon Localité et lien externe : Matapédia Saint-André-de-Restigouch
3 rue McDonnel 143
Code
Ruisseau vers le lac aux Américains
Bureaux de poste – Matapédia-Matane



Poste Canada SIA-QC-Topo+
Localité et lien externe : Ste-Marguerite-Marie Causapscal Amqui Saint-Vianney Cap-Chat Adresse 238 chemin Kempt 480 Rue St-Jacques Nord 10 avenue du Parc 125 ave. Centrale 42 rue Notre-Dame E Code postal G0J 2Y0 G0J 1J0 G5J 1A0 G0J 3J0 G0J 1E0 Téléphone 1-800 267-1177 (418) 756-3869 (418) 629-3080 (418) 629-3705 (418) 786-5920 Horaire : Dim. Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Lun. 09:30-13:30 08:30-17:30 08:30-17:15 09:30-12:00, 14:00-16:15 08:30-17:15 Mar. Mer. Jeu. 09:30-12:00, 14:00-17:15 Ven. 09:30-12:00, 14:00-17:30 Sam. Fermé Fermé Fermé Fermé 09:30-11:30
Bureaux de poste – Haute-Gaspésie



Poste Canada SIA-QC-Topo+
Localité et lien externe : Mont Saint-Pierre Mont-Louis Gros-Morne Madeleine-Centre Grande-Vallée Adresse 104 rue Prudent-Cloutier 9 1ere ave. O 8A rue Principale 117 route Principale 7 rue Saint-FrancoisXavier Code postal G0J 1V0 G0E 1T0 G0J 1L0 G0J 1P0 G0J 1K0 Téléphone (418) 797-5160 (418) 797-2370 (418) 797-2434 (418) 393-2090 Horaire : Dim. Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Lun. 09:30-12:00, 14:00-17:00 08:30-12:00, 13:00-17:00 09:00-12:00, 13:0017:30 09:00-17:00 08:30-17:00 Mar. Mer. Jeu. 08:30-12:00, 13:00-18:00 08:30-18:00 Ven. 08:30-12:00, 13:00-17:00 08:30-17:00 Sam. Fermé Fermé 09:00-11:45 Fermé Fermé
Bureaux de poste – Côte-Gaspé



Poste Canada SIA-QC-Topo+
Localité et lien externe : Cloridorme L’Anse-à-Valleau St-Maurice-del’Échouerie Rivière-au-Renard Adresse 532 route 132 922 route 132 51 rue de l’Église 40 boul Renard E Code postal G0J 1G0 G4X 1L0 G4X 1P0 G4X 1S0 Téléphone (418) 269-5497 (418) 269-3612 (418) 269-3768 Horaire : Dim. Fermé Fermé Fermé Fermé Lun. 09-11:30, 12:30-17:15 10:00-12:00, 14:00-17:30 08:30-12:00 - 13:30-17:30 08:30-17:30 Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. Fermé Fermé 09:00 - 11:45 Fermé
PHARMACIES

Horaire des pharmacies


Localité et lien externe : Matapédia Causapscal Amqui Amqui Bannière Familiprix Familiprix Familiprix Brunet Adresse 4-B, Boul Perron Est 28, rue St-Jean-Baptiste 20, rue du Pont 30 boul Saint-Benoit est Téléphone (418) 865-2003 (418) 756-5033 (418) 629-1414 (418) 629-4411 Horaire : Dim. Fermé Fermé 12:00-17:00 10:00-17:30 Lun. 08:30-16:30 09:30-17:30 09:00-18:00 08:30-21:30 Mar. Mer. Jeu. 09:30-19:00 09:00-20:00 Ven. Sam. Fermé 09:30-12:00 - 13:0015:00 09:00-17:00 09:00-17:30
Horaire des pharmacies


Pharmacies SIA-QC-Topo+
Localité et lien externe : Cap-Chat Sainte-Anne-desMonts Sainte-Anne-desMonts Saint-Maxime-duMont-Louis Grande-Vallée Rivièreau-Renard Bannière Jean Coutu Jean Coutu Familiprix Uniprix Familiprix Uniprix Adresse 61, rue Notre-Dame Ouest 20 Boul. Ste Anne O 33 Boul. Ste Anne O 19A, 1ere Ave Ouest 30, rue St-FrançoisXavier ouest 80, boul Renard Est Téléphone (418) 786-5551 (418) 763-5575 (418) 763-7848 (418) 727-2499 (418) 393-3030 (418) 269-3351 Horaire : Dim. Fermé 10:00-17:00 13:00-16:00 Fermé Fermé 10:00-16:00 Lun. 09:00-17:00 09:00-18:00 09:00-18:00 09:00-17:00 09:00-18:00 09:00-17:30 Mar. Mer. Jeu. 09:00-21:00 09:00-21:00 Ven. Sam. Fermé 09:00-17:00 09:00-17:00 09:00-13:00 09:00-17:00 09:00-17:00
LIVRES ET BLOGUES
Blogues
Dix écrivains ont accepté l’invitation lancée par Geneviève Lefebvre : participer à la Traversée de la Gaspésie. Une plongée hors zone de confort librement consentie. Car si l’appel des montagnes gaspésiennes parvient chaque année à séduire près de deux cents adeptes prêts à se lancer dans l’aventure, celle-ci n’a rien d’une sinécure. Chacun a tôt fait de se heurter à ses limites physiques et psychologiques. Les sommets se méritent, bobos et blessures sont légion, découragement et fatigue se sont jamais bien loin.

Mais c’est sans compter la magie des lieux, la bonté légendaire des Gaspésiens, le prodigieux charisme de Claudine Roy, la fondatrice des Traversées, et un saisissant effet de groupe. Les confidences aidant, on trouve son second souffle, on se découvre de nouveaux amis, de nouvelles passions, on est emporté par l’extase. Et par la beauté somptueuse des paysages, qui, souvent, impose le silence.
Chaque récit, chaque nouvelle et chaque réflexion de ce recueil exprime avec générosité, humour ou autodérision une expérience déterminante, tout en contrastes. Il y aura un avant et un après.
Editions LaPresse, 2020
couverture
Livres : Page
Dos de couverture
Having hiked the Appalachian Trail in 2001, Nancy Shepherd was no stranger to long-distance backpacking. Yet, when she set out to hike the International Appalachian Trail in 2003, she had a backpack full of concerns, from questions about the terrain itself, crossing the border, and the language barrier in a different country to worries over hiking with someone she'd met briefly only once before.

In 2003, the International Appalachian Trail was relatively new, and extended about 700 miles from Maine to Cap Gaspe in Quebec. Much of the length was still on roads, and lacked printed maps. Shepherd and her partner set out on faith, trusting that they could handle whatever issues they encountered the first of which occurred on the very first day.
While the hike was not everything she'd hoped for, the beauty of the wilderness and the joy of being on the trail outweighed the struggles and frustrations. Along the way Shepherd learned the importance of self-reliance and of choosing a compatible partner. She learned that sometimes adjustments are necessary, and realized that without those compromises, she may have missed the opportunity for the most important lesson of all.
"This is a story of going beyond the comfort zone, of realizing limits, and of lessons learned, as well as a story that will reaffirm your faith in humanity."
If you enjoy adventure stories that go beyond sunshine and butterflies to tell it like it really is, Where The Mountains Meet The Sea is for you.
Livre numérique
SAUVETAGE SIA-QC-Topo+


SAUVETAGE SIA-QC-Topo+

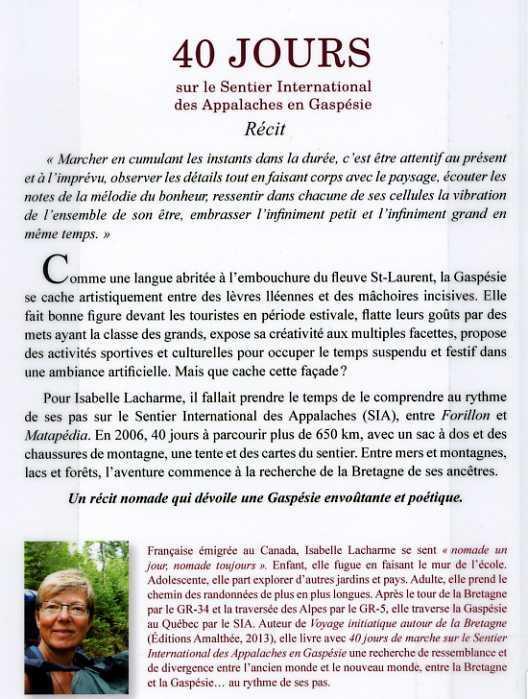
SAUVETAGE SIA-QC-Topo+
Version papier et numérique
In June 2000, Monique Dykstra set out to hike the brand new International Appalachian Trail, from Maine to Cap Gaspe, Quebec. A city girl, she thought that hiking was "simply a matter of throwing a few granola bars into a pack and heading for the hills." Two months, 1,073 km and countless blisters later, she was not so sure.

This hilarious and moving narrative includes 50 colour photos and vivid descriptions of the characters Dykstra meets along the trail. It also contains a 24-page guide to the IAT.
Acclaimed Montreal-based writer and photographer Monique Dykstra knows what some travel writers are unable to grasp: travel writing isn't just about the details of getting from one place to another; it's about encounters with people and lessons learned on the road, the stuff that makes for entertaining anecdotes when you return home.
Dykstra has filled her book with many such anecdotes from her two-month, 1,000-kilometre, millionstep trek along the legendary International Appalachian Trail through Maine, New Brunswick, and Quebec. One such anecdote concerns an encounter with two bears: "Trudging past a row of mistshrouded trees, I heard a twig snap. Then I heard CRASH! THUD! CRASH! I couldn't see it, but I knew it was a bear." Stuck in the middle of nowhere without pepper spray, Dykstra writes, "Stumbling across one bear is bad. Seeing two bears is worse. Finding yourself trapped between a mama bear and a baby bear is about as bad as it gets." Other tales feature beaver dams, moose tracks, walking along the banks of the Saint John River (dubbed the Rhine of America), as well as fun meetings with other longdistance hikers and some cranky customs officers, mixed in with local lore, history, and lots of stunning colour photographs.
Most importantly for those interested in backpacking in her footsteps, Dykstra ends her book with a 42-page essential guide of everything you need to know, from maps and a trip-planner timetable to equipment checklists, official IAT contacts, B & Bs, and clinics. A good thing, because Dykstra's sense of wonder and personal accomplishment is infectious. Richard Burnett
SIA-QC-Topo+
SAUVETAGE
Le Mont Albert, situé en plein cœur du Parc de la Gaspésie, est un endroit fabuleux qui a marqué l’esprit d’un grand nombre de randonneurs. Les plantes rares du sommet sont un prétexte idéal pour vous présenter les caractéristiques de cette montagne.

Jean-Philippe Chartrand, biologiste et naturaliste pour le Parc de la Gaspésie, vous raconte avec simplicité la vie de ces plantes tenaces. De la forêt jusqu’au plateau, en passant par la crête de près de 1100 mètres d’altitude, faites le tour de la montagne.
Ce guide d’apprentissage et d’activités se veut un recueil riche en information de qualité sur les attitudes et les comportements adéquats à adopter en plein air. Il a été conçu pour les éducatrices et éducateurs du programme Sans trace. Il convient également aux animatrices et animateurs, aux enseignantes et enseignants et même aux parents souhaitant sensibiliser leur famille à une pratique du plein air responsable. Adapté pour nos territoires et notre réalité, il propose trois sections complémentaires pour favoriser l’enseignement de l’éthique du plein air et des sept principes Sans trace :

• Les fondements de l’éthique du plein air et les sept principes Sans trace, et quelques astuces pour se lancer dans l’aventure de cet enseignement en plein air.
• Une banque de jeux originaux, pratiques et modulables permettant d’animer des activités d’initiation et d’apprentissage selon le contexte et le groupe d’âge, en ville ou dans l’arrière-pays.
• En annexe, des documents bien pensés pour accompagner les initiatives d’éducation à l’éthique du plein air.
SAUVETAGE SIA-QC-Topo+
Rando Québec Editions, 2019
Blogues :
Journal de Gabriel Piette Lauzière
Rand'honneur
Blogue La Cordée
Journal de David Biron
Journal de Maxime Boisvenu-Fortin
De Cap-Gaspé à Val-David par les sentiers
Longue Randonnée au coeur de la Gaspésie
Voici l’ouvrage le plus complet jamais écrit sur les cervidés du Québec. Rédigé par trois biologistes chevronnés, Sur la piste des nos cervidés est une mine de renseignements sur l’orignal, le cerf de Virginie et le caribou. L’ouvrage, abondamment illustré de croquis et de photos remarquables, traite de la biologie et du cycle de vie de ces grands mammifères, de leurs comportements, de leur écologie et de leur conservation.

Journal de voyage sur le SIA, du Mont Katahdin (Maine) au Cap-Gaspé en 2012.
Journal de voyage de Matapédia au Mont-Albert en 19 jours.
Quelques conseils d’un défi mère-fille pour marcher le SIA en 1 mois.
Journal de bord 650 km à pieds sur le Sentier International des Appalaches SIA 2018
Randonnée réalisée en 23 jours
Journal de Renaud Dionne, 2 230 km en 75 jours.
Journal de Robert de l’Etoile en 2022.
SIA-QC-Topo+
SAUVETAGE
Les 7 principes du Sans Trace :


1. Se préparer et prévoir
2. Utiliser les surfaces durables
3. Gérer adéquatement les déchets
4. Laisser intact ce qu’on trouve
5. Minimiser l’impact des feux
6. Respecter la vie sauvage
7. Respecter les autres usagers
SANS TRACE
CRÉDITS
Merci à ces personnes qui ont autorisé l’utilisation de leur matériel pour ce projet.
Nom Organisme Sujet
Claire Deguelle Site Hikster Tracés GPX et profils initiaux.
Marcel Descarreaux
Marc-Antoine DeRoy Société d’histoire de la HauteGaspésie
Denis Bouvier
Catherine Auger
Jean-François Caron
Eddy Pellerin
Article Enigme du radar du Mont Jacques-Cartier
Article Explorations du frère Marie-Victorin en Haute-Gaspésie


Photographies Réserve faunique de Matane
Photographies
Photo Massif Chic-Chocs en hiver.
Photo Mont Jimmy-Russell
Mont Olivine
URGENCE
911
SIA-QC Bureau (418) 560-4642
Police (418) 310-4141
4141
Centre anti-poison
(506) 548-0420
Réserve faunique Matane Accueil John (418) 224-3345
Parc Gaspésie Centre d’interprétation
Gîte Mt-Albert (24/7)
(418) 763-7811
(418) 763-2288
1-866-727-2427
Évacuation non urgente (Destination ChicChocs)
Parc Forillon Urgence
Airmedic (membre seulement)
Numéro d’urgence
(418) 763-7633
(888) 783-2663
(418) 368-6440
1-877-999-3322
Numéro satellite (418) 673-3322


Courriel-urgence urgences@airmedic.net
Hélico Secours (membre seulement) Urgence
(343) 212-2222
SAUVETAGE
PROCÉDURES POUR ÉVACUATION HÉLIPORTÉE
Ces notes font suite à la formation 'Prévention et sécurité en plein air' , donnée par un membre de l'Escouade de Recherche et Sauvetage héliportée de la Sûreté du Québec. Et quelques ajouts personnels pour le SIA.
La SQ est le seul corps policier au Canada ayant sa propre équipe de recherche et de sauvetage héliportée depuis 2018. Pour avoir un aperçu de leur travail, allez voir la série 'Sauvetage ultime' sur Ici.Explora si vous ne l'avez pas déjà vu... Il y a de bonnes chances que vous l'écoutiez en rafale...
Voici quelques points importants mentionnés durant la formation :
Activation d'une balise de détresse.
1.1 Motif : LA VIE D'UNE PERSONNE EST EN DANGER.
Exemples : -trauma : hémorragie, blessure au fémur, ...
-hypothermie (même l'été)
-malaise médical
Dans la planification d'une sortie, il faut avoir préparé un itinéraire et le remettre à un "ange gardien".
1.2 Moyens de communication possibles:
- Balise de détresse. Bidirectionnelle à privilégier : Inreach ou Spot X sont les balises les plus connues.
- Téléphone cellulaire
- Téléphone satellitaire

1.3 Chaîne de communication à la suite de l'activation du bouton SOS d'une balise.
Le signal est reçu au centre d'appel de Garmin ou Spot au Texas. Il est ensuite acheminé aux forces policières locales. Des secours terrestres sont possibles selon votre localisation.
Si une intervention nécessite un hélicoptère, l'appel est transféré à l'escouade héliportée, basée à l'aéroport de St-Hubert. Ils disposent de trois appareils dont deux avec treuil. Ils effectuent environ 250 missions par année.
1.4 AVANT d'activer la balise de détresse, aviser votre ange-gardien par message prédéfini de votre situation.
ATTENTION : L'activation d'une balise de détresse ne peut être annulée. Les secours sont en route.

1.5 Le temps réponse de l'hélico?
Une bonne approximation est de calculer le temps en automobile divisé par deux plus une heure de préparation de l'équipe. Donc, Ste-Anne-des-Monts étant à environ 8 heures de voiture de St-Hubert, vous pouvez espérer avoir un hélico dans les 5 heures, si les conditions météo le permettent.
Il y a une collaboration entre l'Escouade et l'Armée canadienne (CAFS) pour certains sauvetages. Ils sont basés à Halifax.
1.6 Airmedic et Hélico Secours.
Prendre note que si vous avez une assurance évacuation avec Airmedic ou Hélico Secours, ce qui est fortement recommandé, ils ne sont PAS appelés lorsque vous appuyez sur le bouton SOS. Dans le cas d'une évacuation non urgente, il faut les rejoindre par courriel (par message prédéfini) via la balise satellitaire ou téléphone cellulaire si vous avez du réseau. Si vous les appelez, assurez-vous bien d'être membre, sinon une juteuse facture $$$$ vous attendra.

Bases opérationnelles Vol de nuit Hélitreuillage RECCO
Sûreté du Québec St-Hubert Oui Oui Oui
Airmedic St-Hubert, Québec, St-Honoré Oui Non Non
Hélico Secours St-Hubert, St-Honoré A venir A venir Oui
Quoi faire avant l'arrivée des secours héliportés.
2.1 Demeurer au même endroit à moins qu’il soit dangereux. Dans le cas de changement, avisez le centre d’appel.
2.2 Préparez ce qu’il faut pour une longue attente.
2.3 En cas de blessure, préparer la victime et la protéger contre l'hypothermie. L'hélicoptère peut lui-même être un facteur aggravant une hypothermie. Pour avoir un aperçu du vent généré par les pales d’hélicoptère.
2.4 Préparer les sacs à dos avec ses effets personnels et essentiels (médicaments, clefs d'auto, etc.)
2.5 Avoir préparé un feu de signalisation (3) si le lieu le permet. Prévoir aussi de quoi l'éteindre à l'arrivée des secours. Vos coordonnées GPS seront transmises si vous avez utilisé une balise. Vêtements colorés, frontale ou lumière de cellulaire en mode stroboscopique, miroir, fusées de signalisation, réflecteur RECCO, … pour signaler également votre présence. Sifflet ou cartouches anti-ours pour équipe de recherche au sol.
2.6 Regrouper tout le reste de l'équipement à un seul endroit avec les coordonnées GPS. S'ils ne peuvent être transportés à bord, ça vous aidera à les récupérer plus tard.
2.7 Trouver un endroit dégagé et visible pour l'hélico (si possible). Dimensions requises : De jour 30 x 30 mètres, de nuit 100 x 50 mètres. A quoi cela correspond-t-il visuellement? Un camion semi-remorque peut avoir une remorque de 53 pieds (16m); donc de jour 2 longueurs de remorque; de nuit ce serait 3 longueurs de remorque par 6.
2.8 Se rassembler à un même endroit et loin des arbres. Attacher tout objet pouvant s’envoler: vêtements, casquettes, sacs, couverture de survie etc.... Le souffle des pales de l'hélicoptère pourrait casser des branches et causer des blessures.

SAUVETAGE SIA-QC-Topo+
Il faut être prêt 1 heure avant l'arrivée des secours.
3.1 Répondre par signaux manuels YES/NO au besoin pour les secours. Ça pourrait être utile pour localiser la bonne personne à évacuer si plusieurs groupes se retrouvent dans le même secteur.
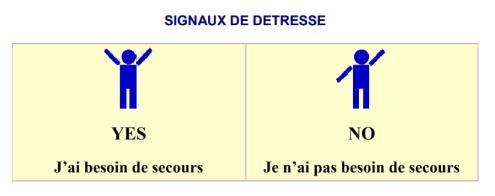
3.2 Établir l'ordre d'évacuation; la victime en priorité.
3.3 Ne jamais approcher un hélico avant l'arrêt des moteurs OU sinon l'approche se fait face à l'hélico entre 10h et 2h sous l'ordre du pilote. Un contact visuel avec le pilote est ESSENTIEL.
3.4 Toujours se pencher à l'approche de l'hélico à cause du rotor et du terrain.
Autres liens
When to initiate a backcounty rescue (with your Garmin InReach, PLB, or SPOT) Entrevue avec le directeur de SAR de la région Los Angeles. L’auteur élabore certains scénarios et suggère quand déclencher le SOS.
How long do InReach messages take to send? On y explique la communication entre une balise et le réseau de satellites et pourquoi le temps réponse peut varier.
SAUVETAGE SIA-QC-Topo+












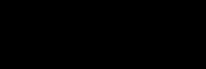






















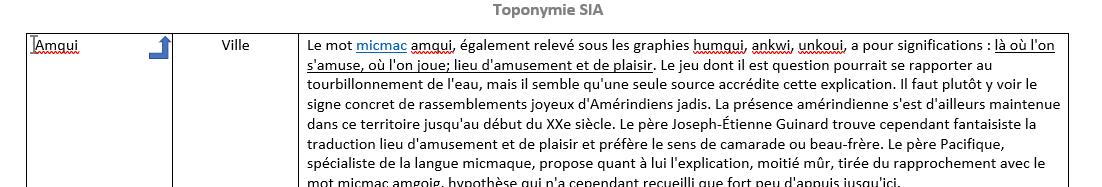




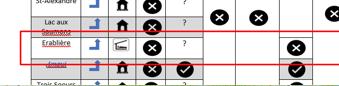



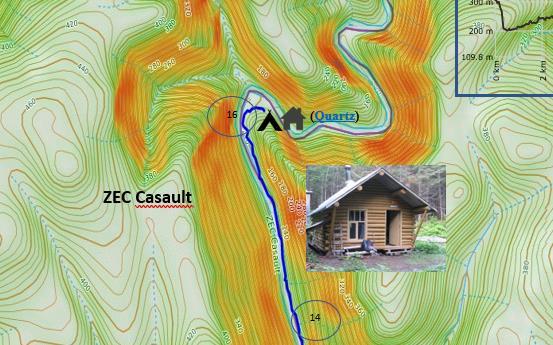







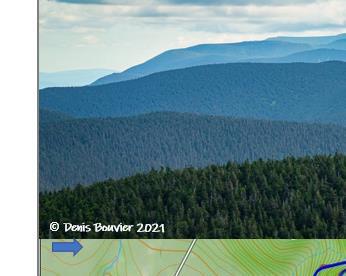







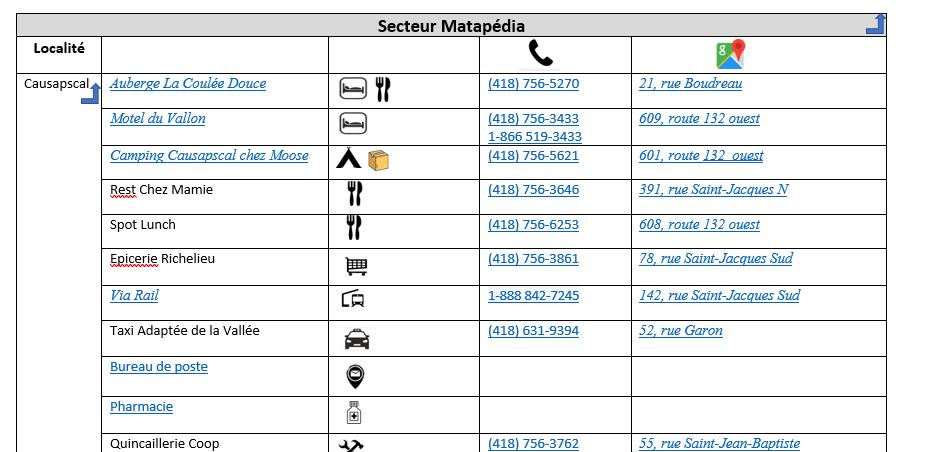









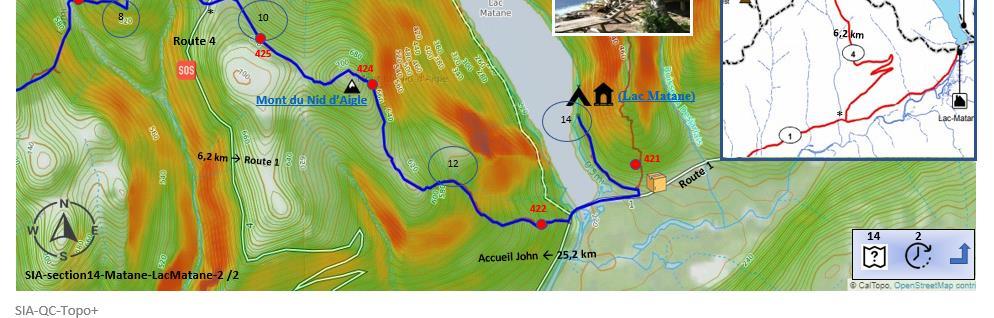









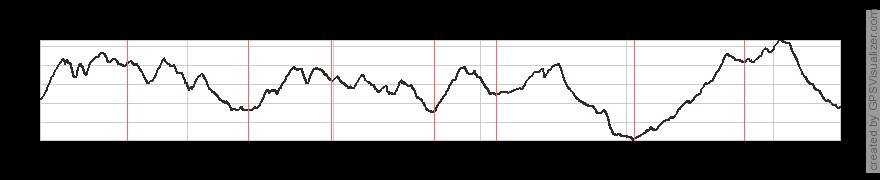

 Carte secteur
Carte secteur















 © Caltopo
© Caltopo







 Massif des Chic-Chocs, vu de la Pointe aux Anglais, sur la Côte Nord
Massif des Chic-Chocs, vu de la Pointe aux Anglais, sur la Côte Nord








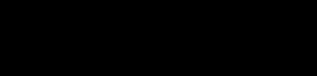

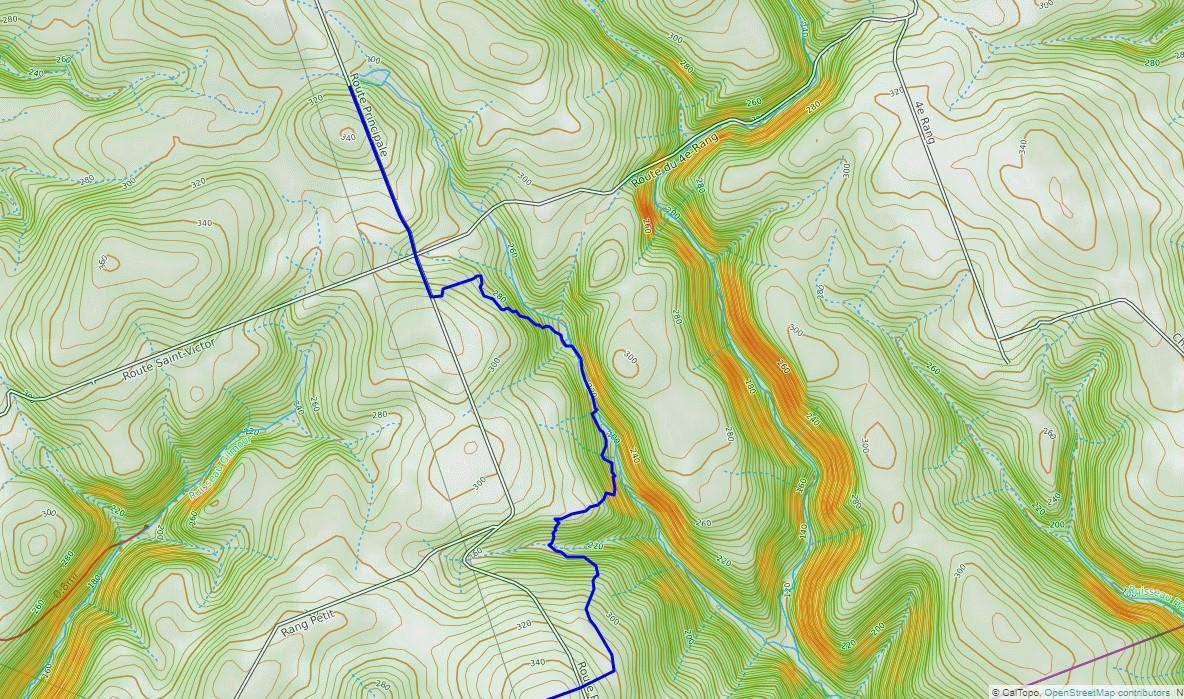





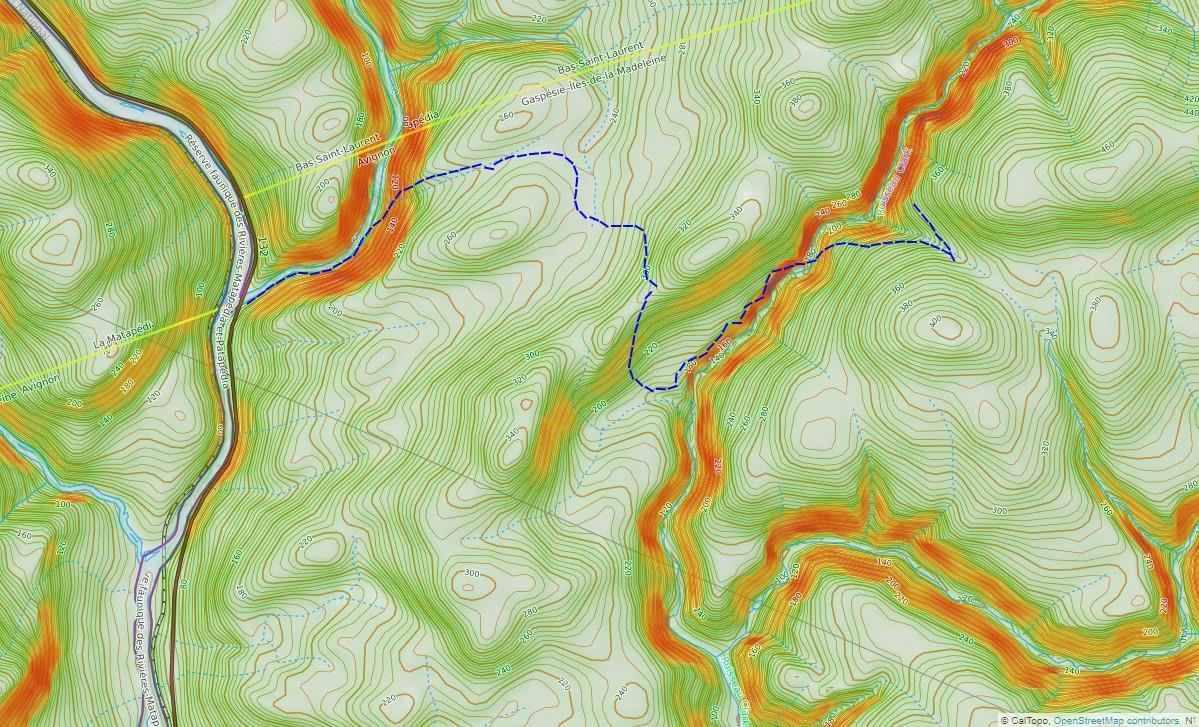





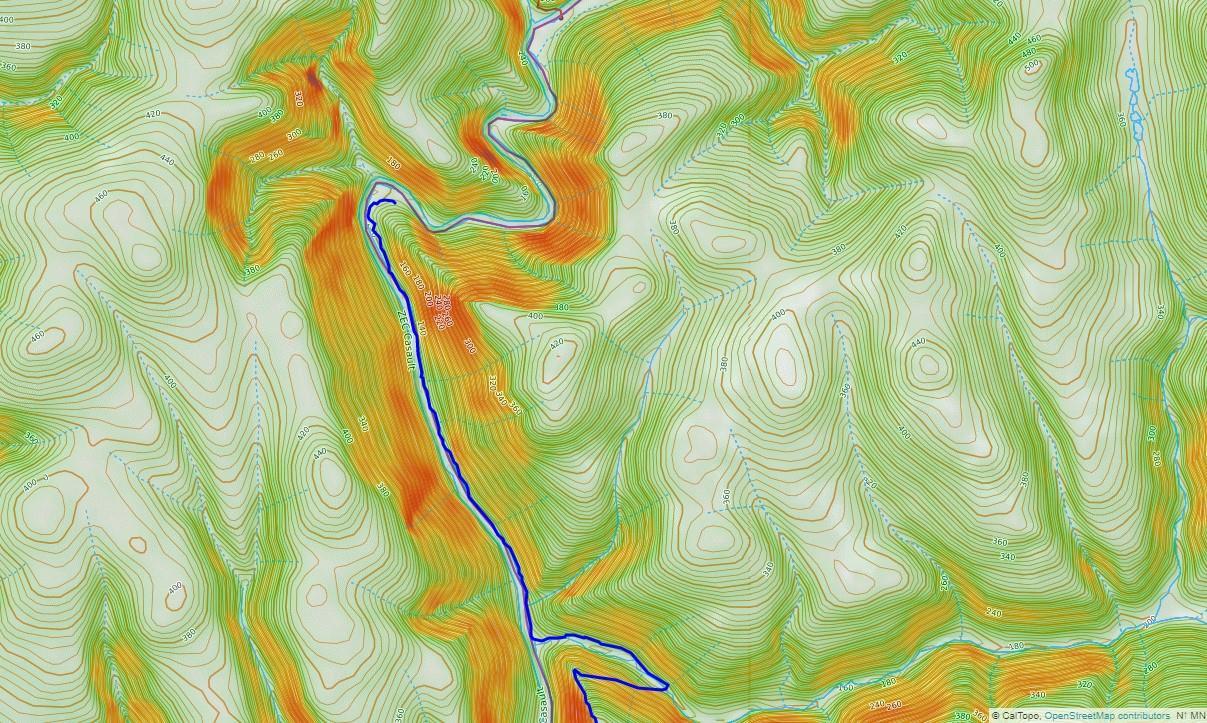








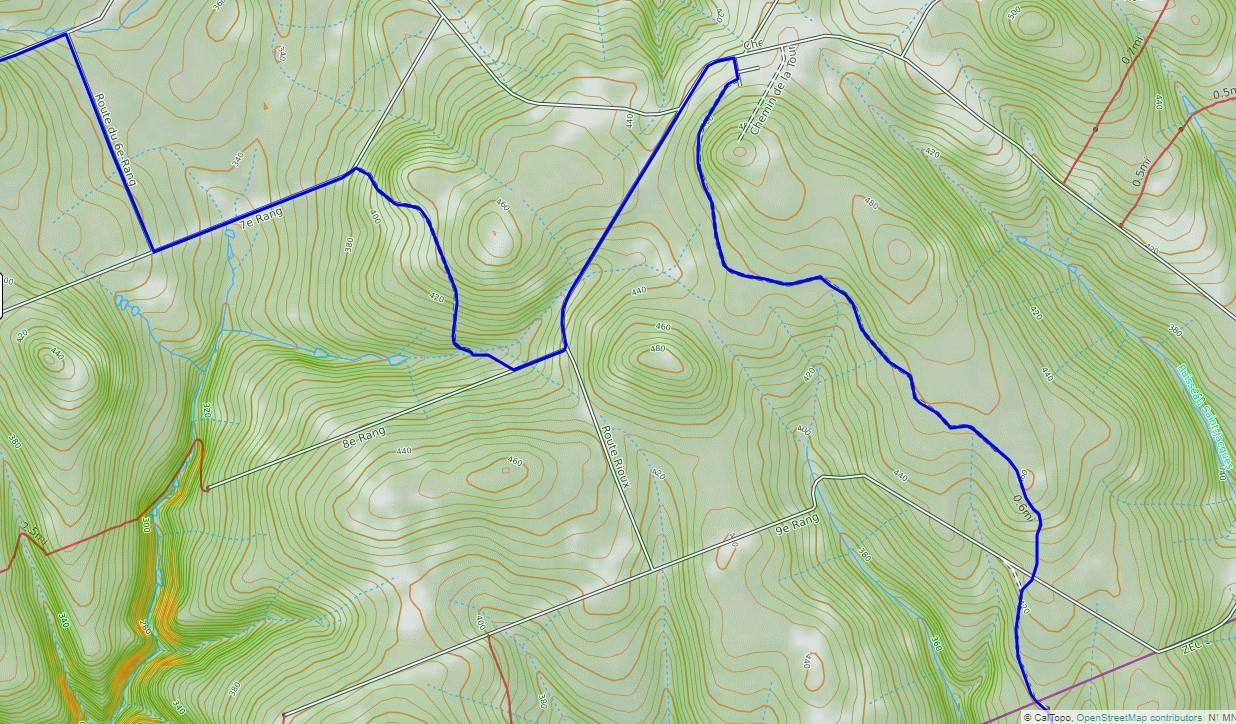
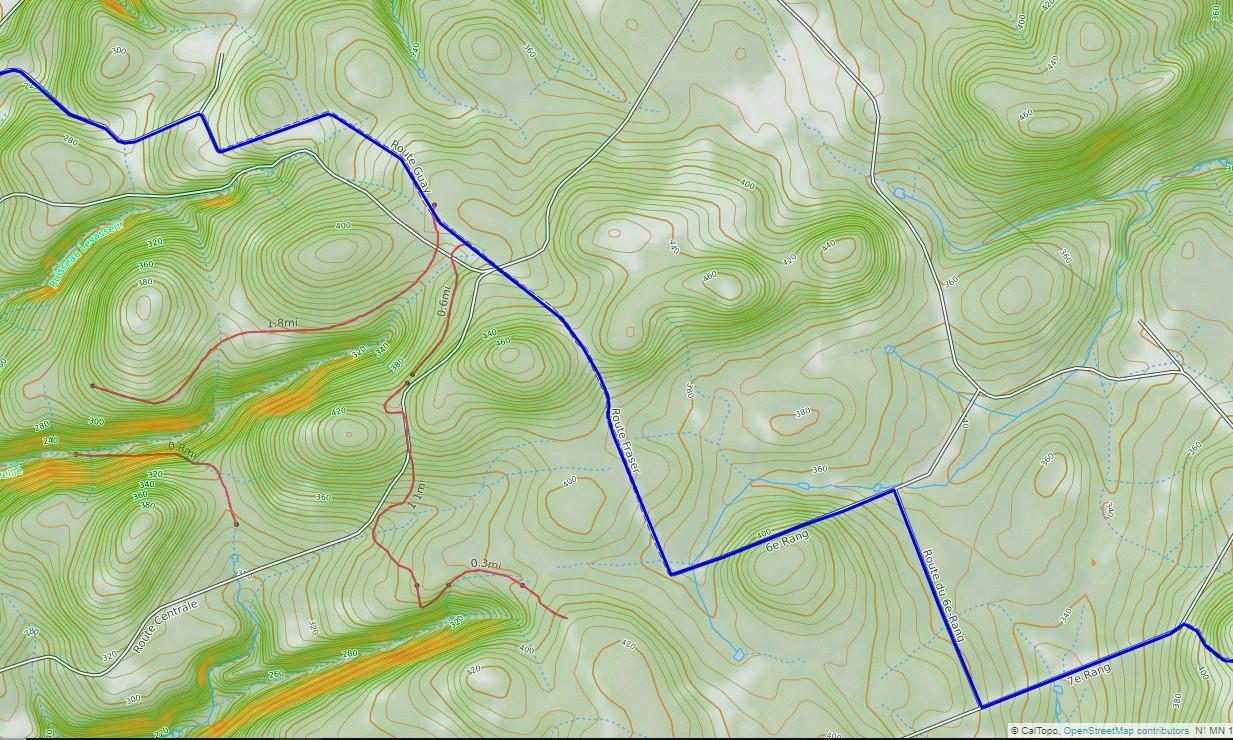







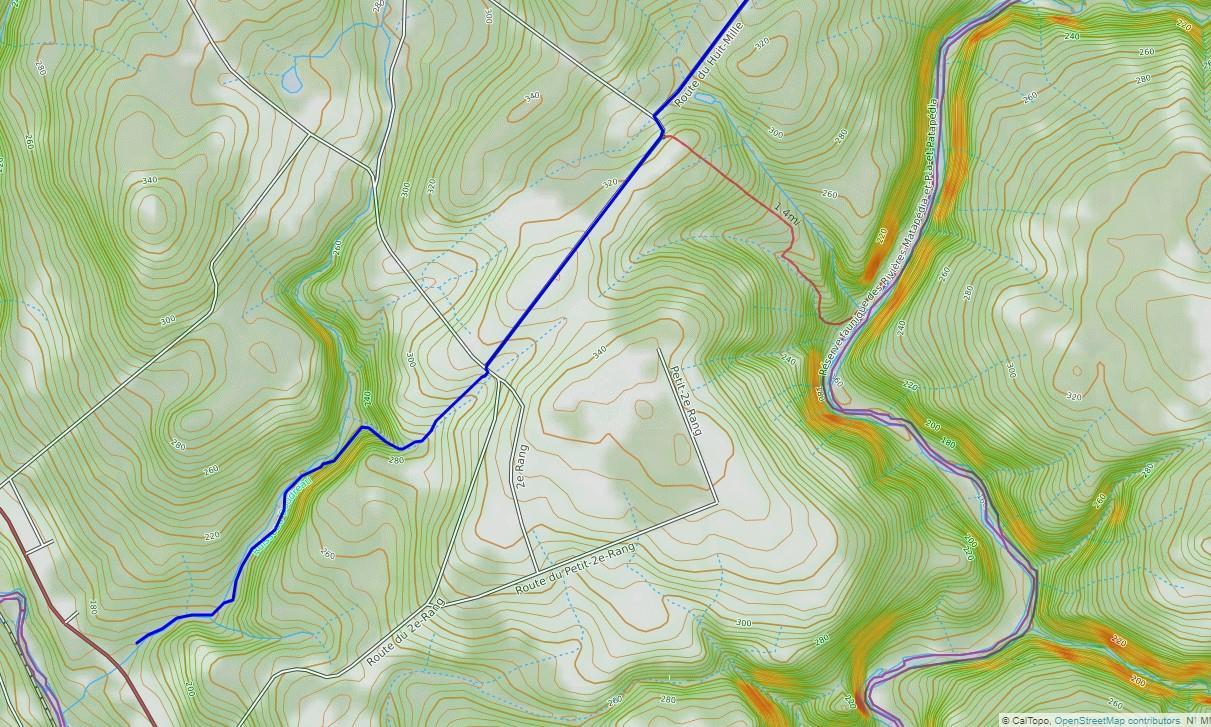




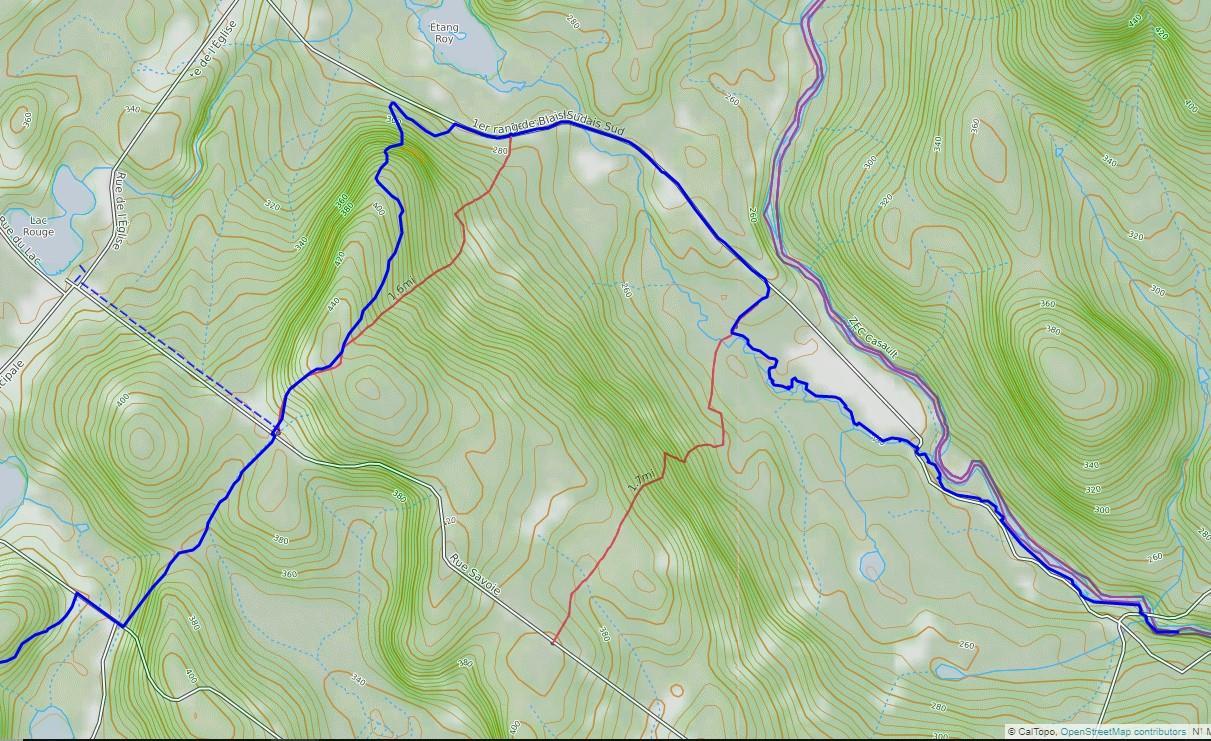





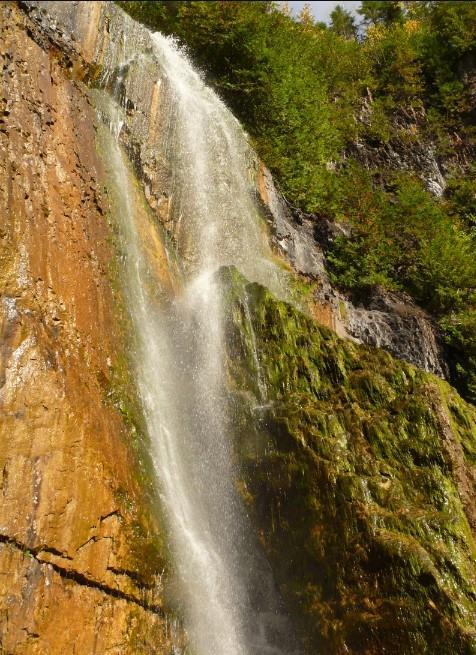









































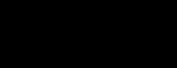
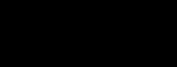












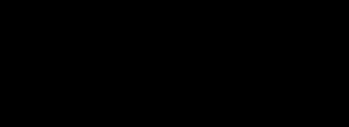

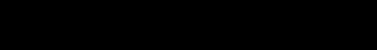
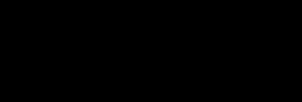





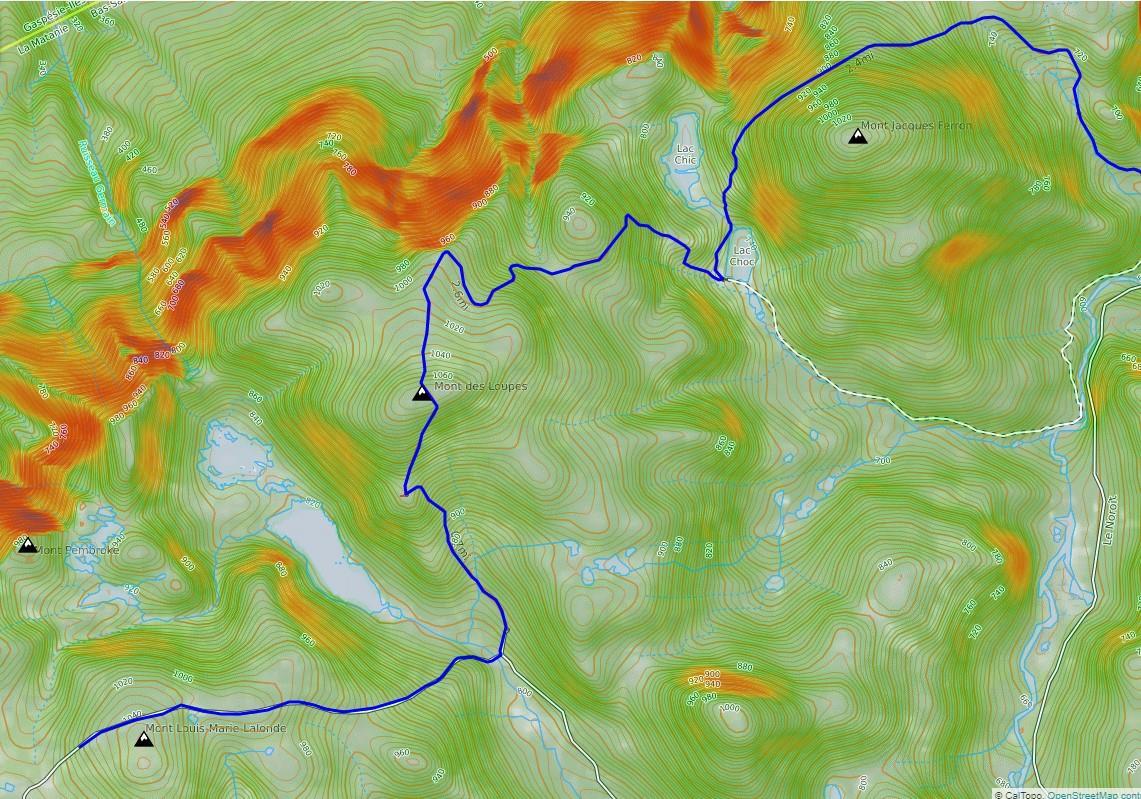 Nyctale et Chouette)
Premier lac des îles
Nyctale et Chouette)
Premier lac des îles

















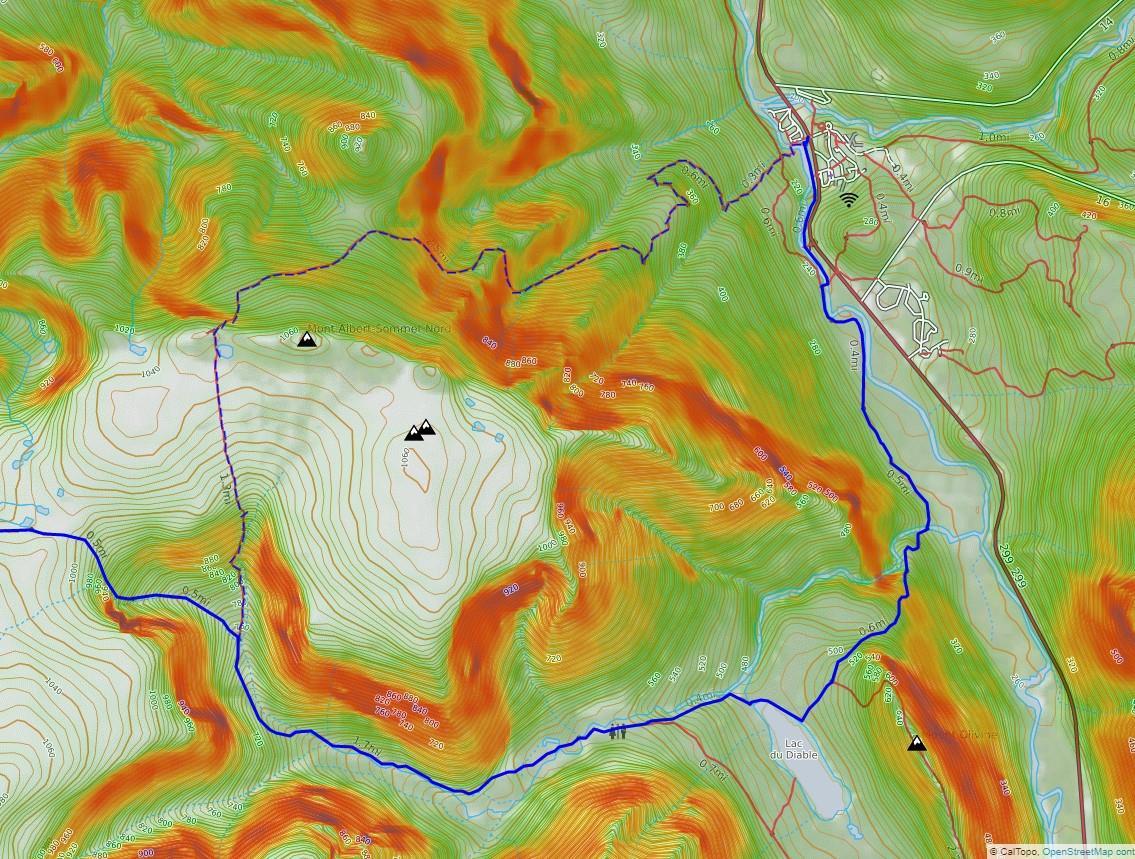











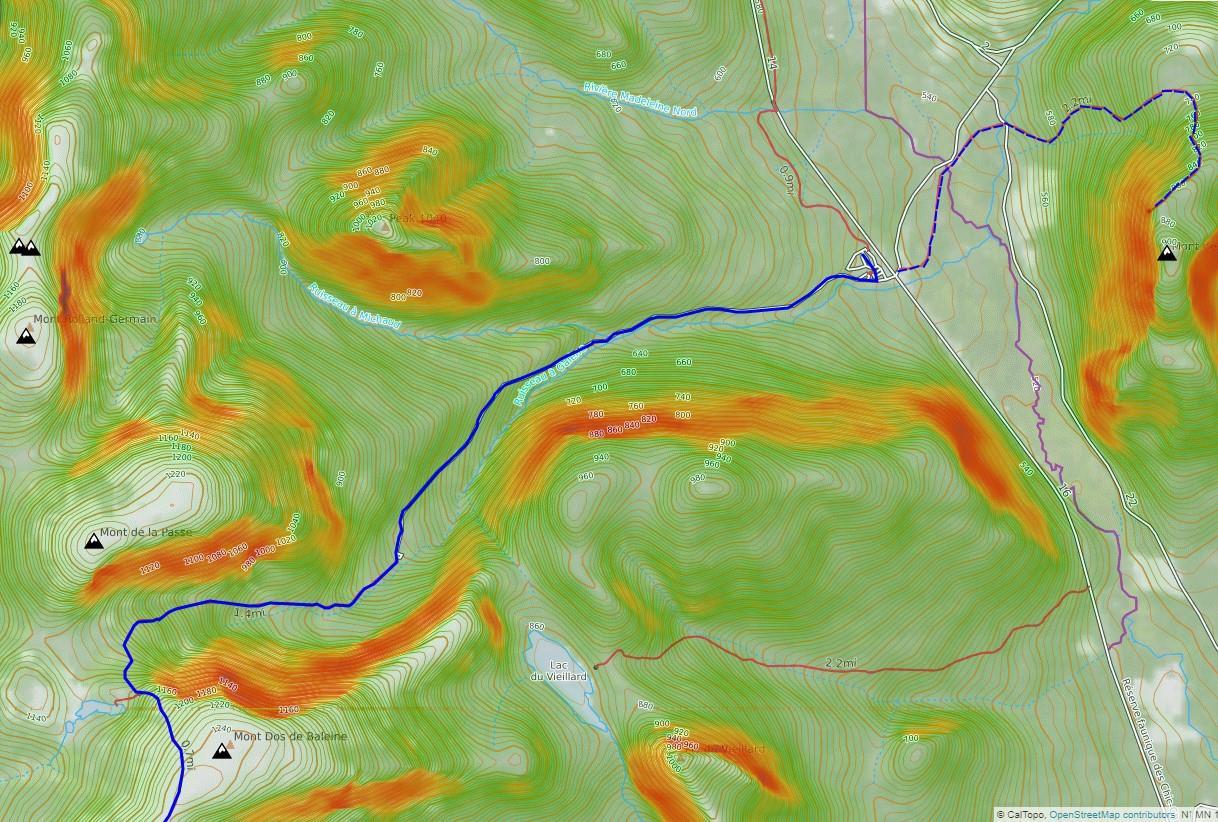 SIA – Secteur Gaspésie SECTION 27 : Refuge Tétras → Camping Mont Jacques-Cartier
(Mont Jacques-Cartier)
SIA – Secteur Gaspésie SECTION 27 : Refuge Tétras → Camping Mont Jacques-Cartier
(Mont Jacques-Cartier)


































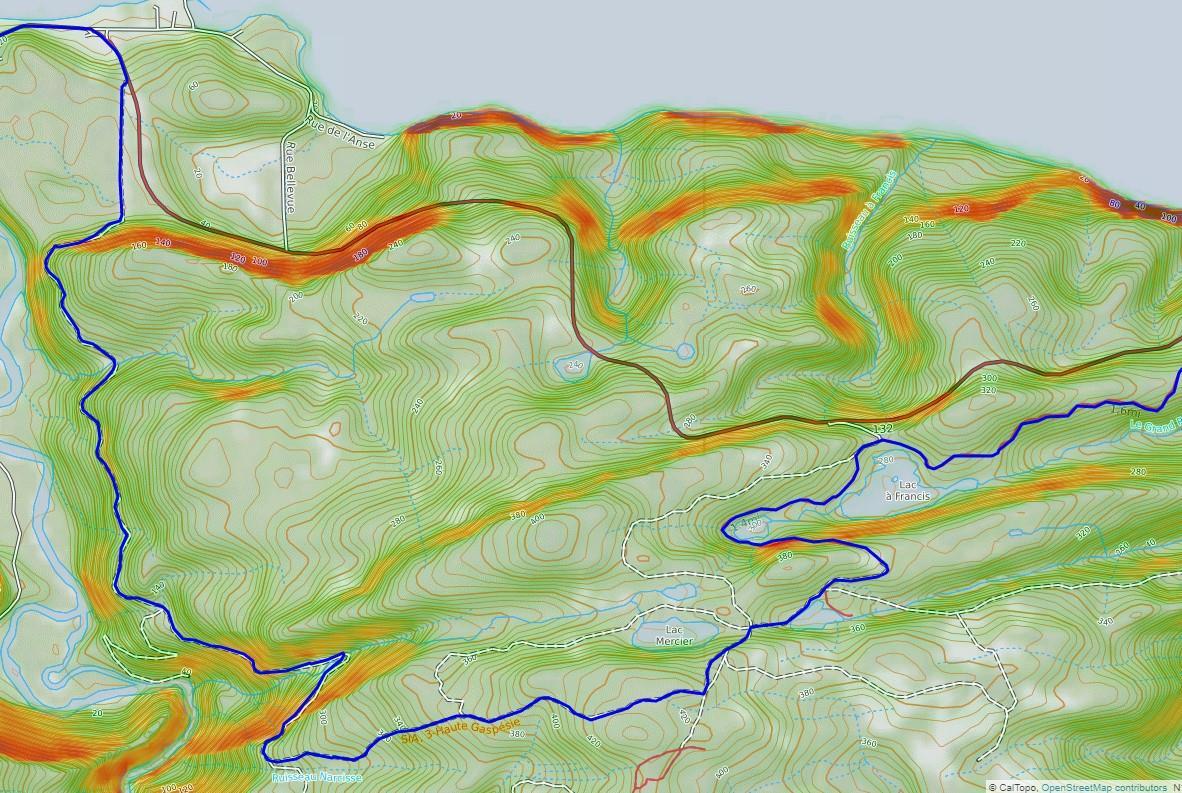
















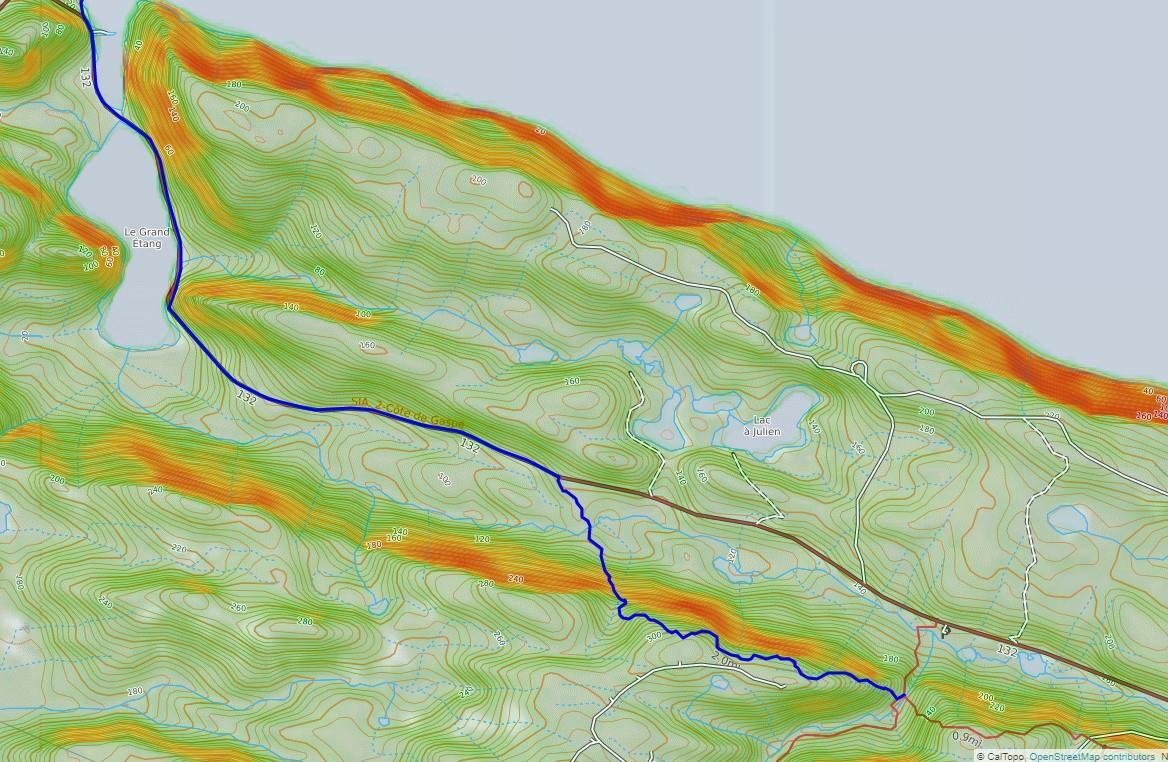


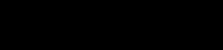


 Chutes Jalbert
Lac Victorin
SIA
SIA
Chutes Jalbert
Lac Victorin
SIA
SIA















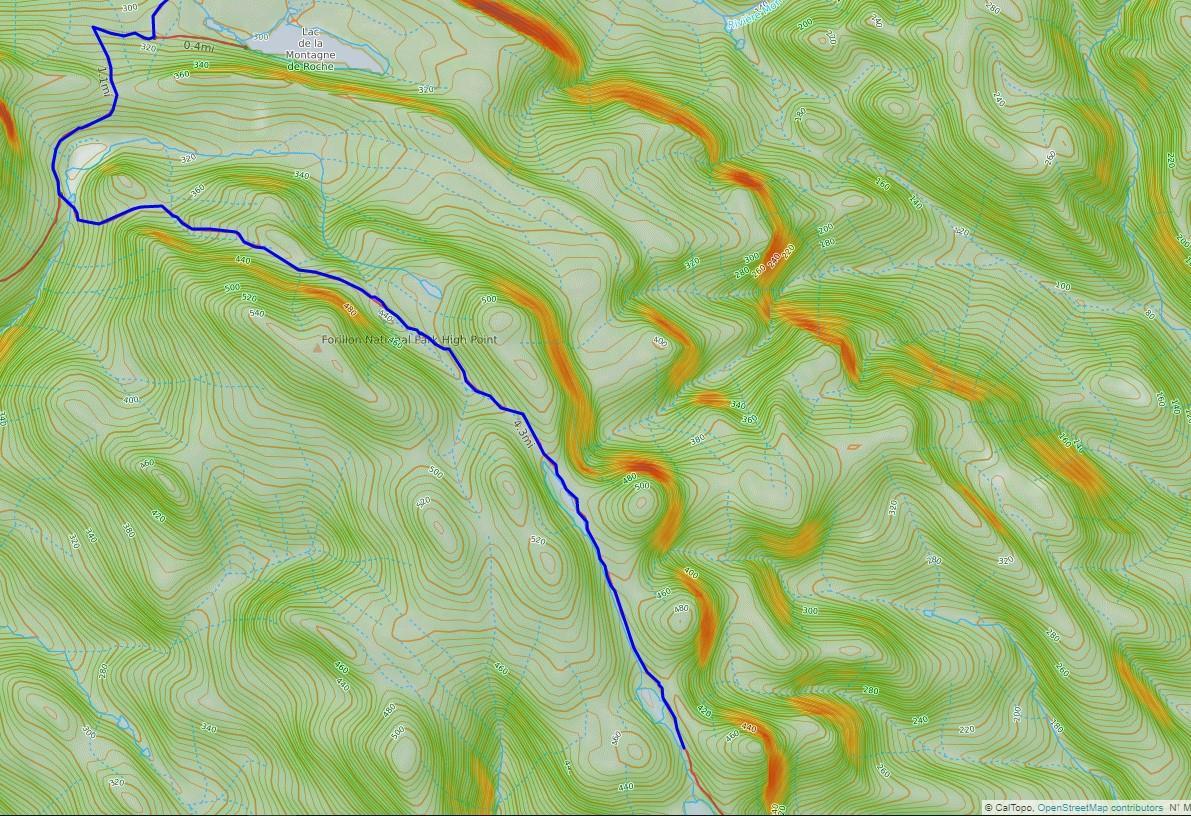



















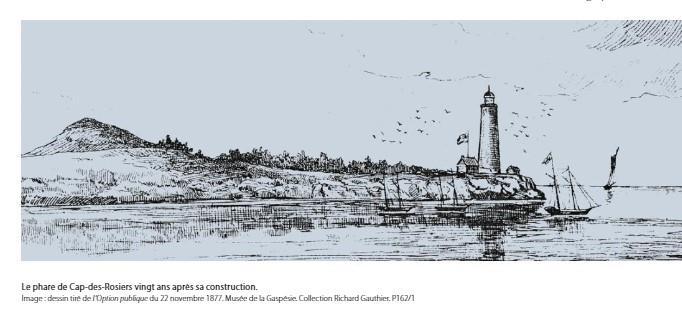

































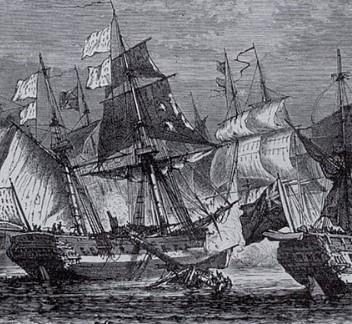


 Faune et Flore
Faune et Flore





















 ©Catherine Auger
©Catherine Auger



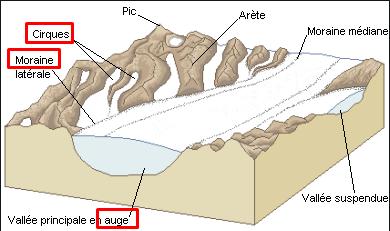




 Figure 1. Polygones de matériaux triés.
Figure 2. Sol strié.
Figure 1. Polygones de matériaux triés.
Figure 2. Sol strié.



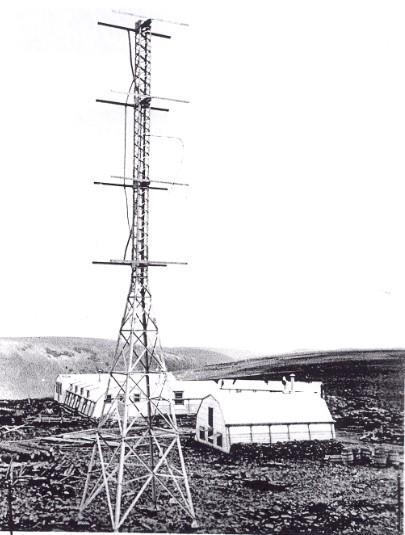

 © Denis Bouvier 2021
© Denis Bouvier 2021






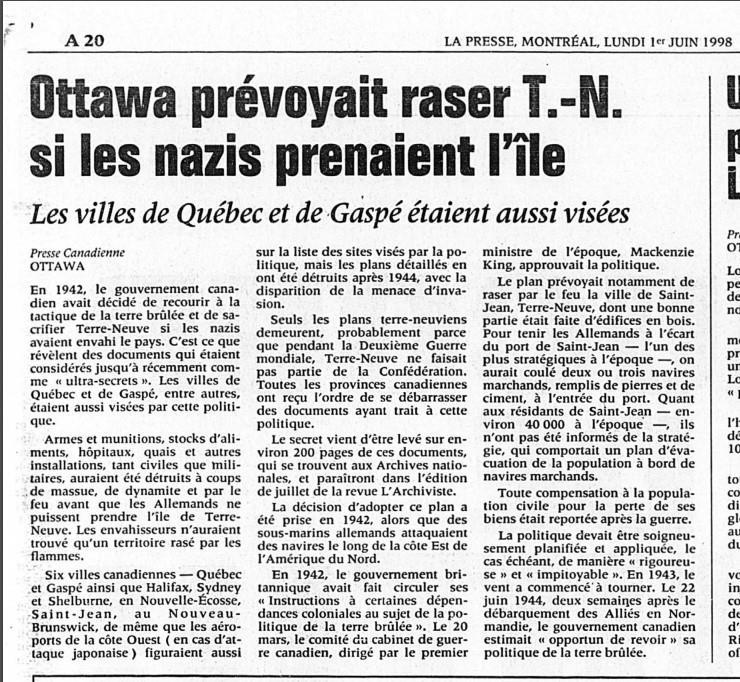

















 Jacques Cartier, gravure attribuée à Pierre-Louis Morin, vers 1854.
Jacques Cartier, gravure attribuée à Pierre-Louis Morin, vers 1854.






 Source : Wikipédia
Source : Wikipédia






















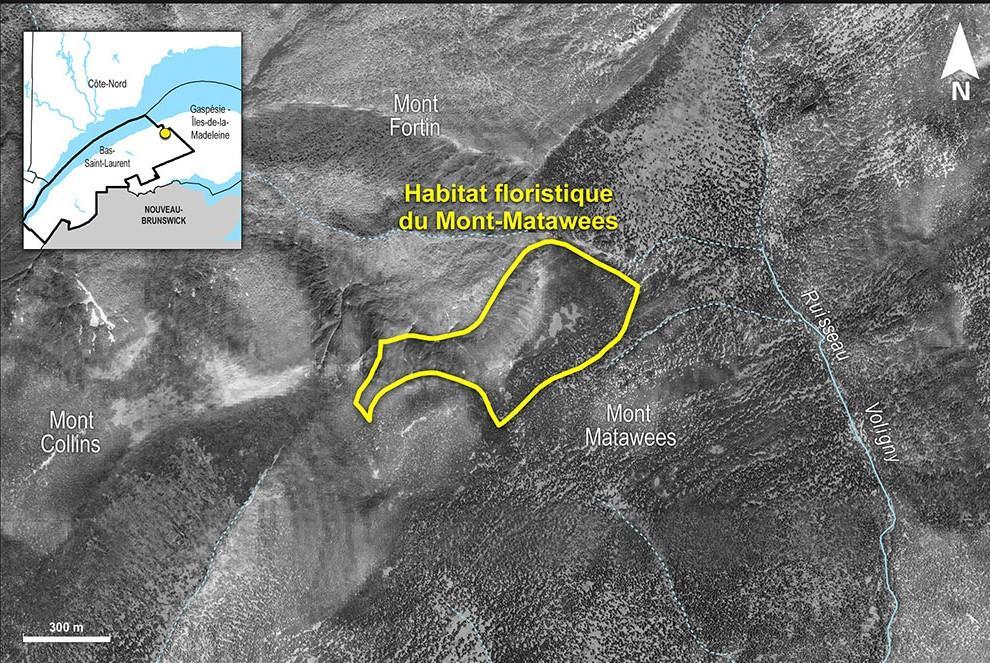


















































 Mont Blanc
Mont Blanc
 Mont Nicol-Albert
Mont Nicol-Albert