ITALIE 13 DÉLIRE ITALIE 13 DÉLIRE JONGMIN KIM
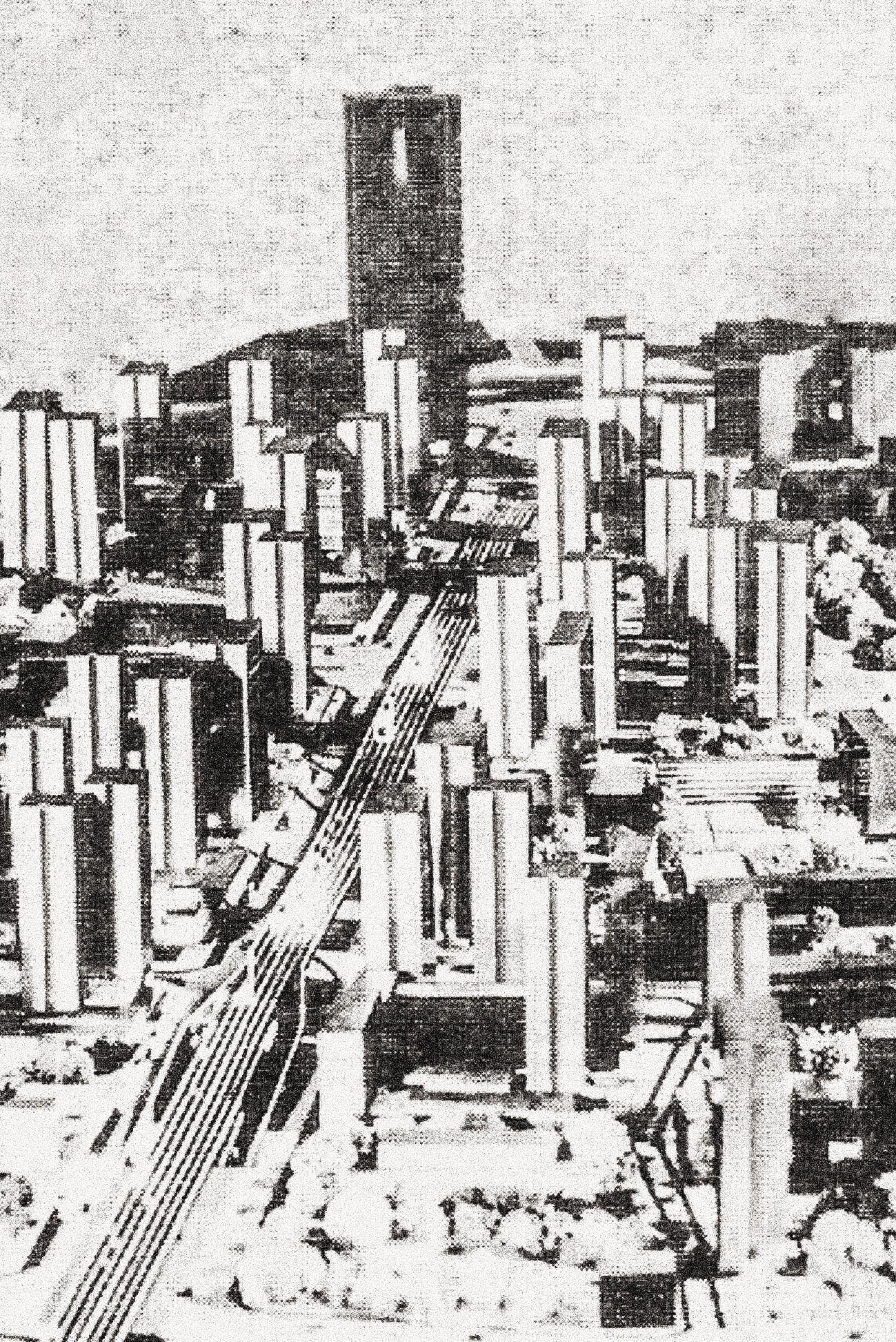


: Photo des maquettes de l’Opération Italie XIII, Michel Holley

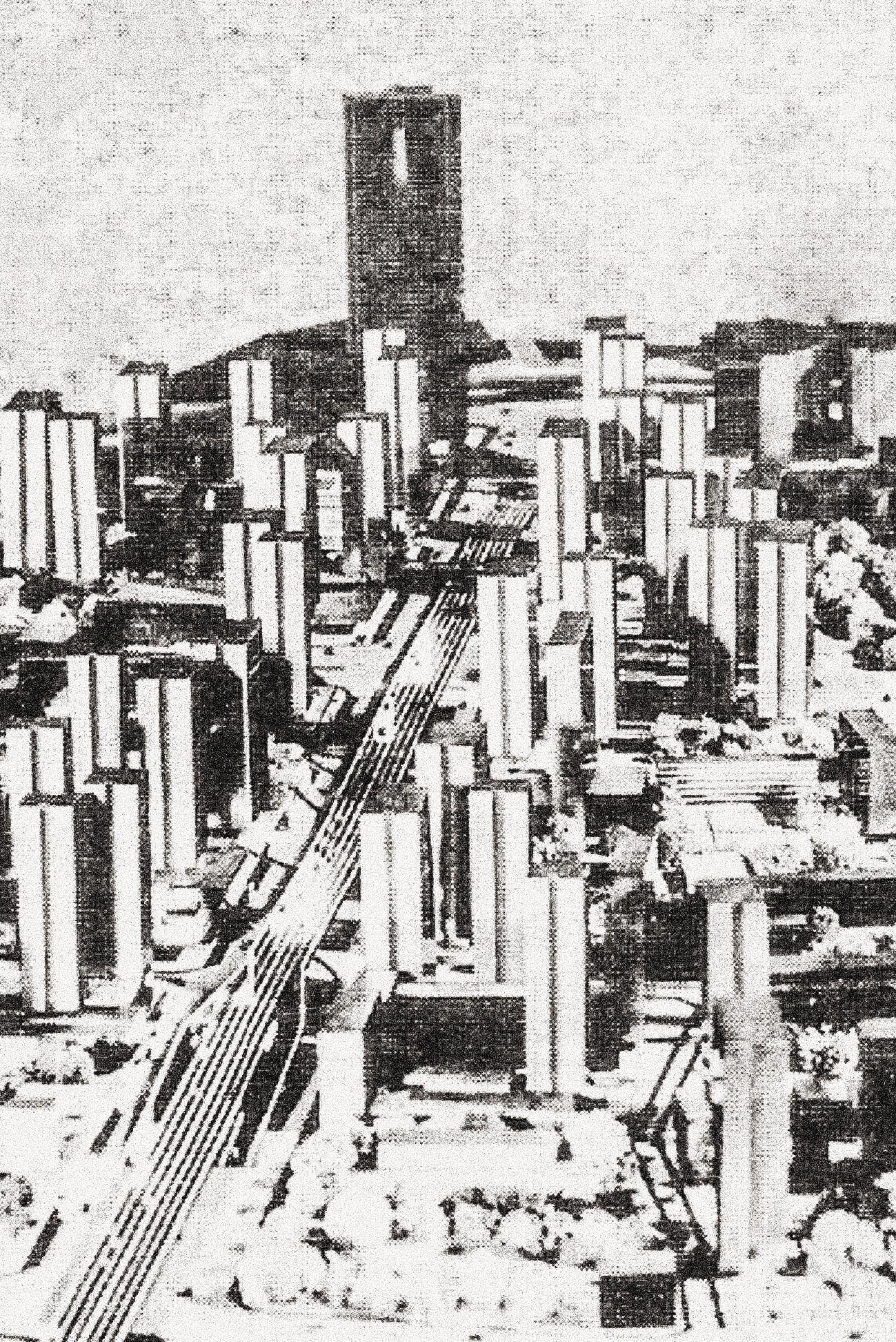


: Photo des maquettes de l’Opération Italie XIII, Michel Holley
L’ascension et la chute d’une utopie verticale, et 50 ans plus tard
Mémoire de Master Jongmin KIM
Sous la direction de Céline BODART, Antoine BEGEL
Séminaire Architecture des milieux habités Ensa Paris La Villette, 2023


Cette étude sur l’urbanisme vertical a vu le jour grâce à mon parcours dans mon pays natal, la Corée du Sud. Comme d’autres pays dans les quatre coins du monde, depuis les années 1960, la croissance économique et démographique de la Corée du Sud a haussé. En conséquence, le manque de logements et de territoires ont obligé des villes de faire table rase afin de reconstruire des bâtiments plus hauts, plus denses et plus standardisés comme les gens appellent « une cage à lapin ». Paradoxalement, souvent dans la verticalité, nous avons plus de confort technique le plus avancé1 grâce aux nouveaux matériaux rigides(béton, acier), à son coeur dit ascenseur qui circule les habitants à chaque étage et à l’interphone qui relie les habitants au concierge mais aussi entre les habitants. De nos jours, la plupart des métropoles ont tendance à faire l’urbanisme vertical. Ensuite, elles rivalisent pour avoir un prix « tel plus haut, tel plus grand, tel plus moderne ». Comme la plupart des compétitions, le prix leur récompense soit par l’apport matériel soit par l’honneur montrant la puissance technique et économique de leur ville ainsi que leur pays. Dans ce monde de compétition, je m’interroge premièrement sur l’identité des métropoles où la population urbaine qui devient de plus en plus hyper-individualiste2, se présente. Une ville d’aujourd’hui, doit-elle avoir une identité pure pour elle ? Faut-il avoir une architecture représentative, typique ou emblématique d’elle ? Les architectures d’une ville ne peuvent pas être hyper-individualistes comme leurs propriétaires comme le cas de Manhattan ?
Deuxièmement, face à la croissance démographique et aux manques des espaces constructibles et des sols naturels, comment une ville comme Paris, qui résiste à l’urbanisme vertical depuis l’urbanisme giscardien3, s’adapte aux enjeux actuels ? Peut-elle rester toujours saine, sure et vivante tout en accueillant une densité importante qui provoque davantage de problèmes urbains? Afin de dérouler ce mémoire, j’ai choisi la manière rétroactive de Rem Koolhaas qui a développé Manhattan du XIXe et XXe siècle dans son ouvrage, New York Délire. Italie XIII Délire, provient de la succession de manifeste rétroactif de New York Délire, qui traite de l’opération Italie XIII ayant été arrêtée à cause de l’abandon de l’urbanisme vertical. A travers ce titre ironique, je m’interroge sur « l’indifférence » en matière d’urbanisme vertical à Paris et sur une Utopie verticale inachevée (Italie XIII) afin d’avoir des réflexions sur la ville verticale et l’avenir de la ville de Paris sous différents points de vue.
1. Jean Castex, Les tours à Paris, bilan et prospectives, APUR, 2003
2. Gilles Lipovetsky, L’esthétisation du monde : Vivre à l’âge du capitalisme artiste, éditions Gallimard, 2013
3. Lancé par Valéry Giscard d’Estaing, l’ancien président, en évoquant l’architecture familière pour les Parisiens et l’écologie
Je souhaite avant tout remercier les enseignants encadrants, Céline BODART et Antoine BEGEL qui m’ont accompagné durant ce travail. Les discussions avec eux m’ont permis de clarifier le sujet.
Je voudrais également remercier Isabelle et Marie pour la relecture du mémoire ainsi que Shekinah qui m’a donné des inspirations à travers des échanges.
Enfin, je remercie mes parents Cheolgon KIM et Banghee CHO qui m’ont soutenu pendant toutes mes études.
La conquête de Paris par la verticalité
Quatre figures de la verticalité
Haussmanhattan
Opération Italie XIII
La plus vaste opération d’urbanisme dans Paris
Un instrument politique : Montée et chute d’une utopie
Publicité : Vivre l’Utopie verticale !
Un nouveau moteur asiatique : Faire revivre l’Utopie verticale
I.G.H d’Italie XIII
Nouveau skyline, un symbole d’une nouvelle utopie Habiter dans l’utopie verticale : La vie réelle en noir et blanc
L’abandon des « utopies verticales »
L’inégalité entre les villages verticaux
La rue et la fréquentation
L’évolution et la régression d’Italie XIII
Italie XIII dans les réseaux sociaux
(...) Si, pour l’instant, les architectes ne pouvaient plus construire, ils pouvaient du moins se mettre à réfléchir pour de bon. L’euphorie du gratte-ciel était terminée ; l’heure était désormais à la réflexion.
Hugh Ferris, The Metropolis of Tomorrow, New York, Ives Washburn, 1929 (La métropole du future, Paris, Centre Georges Pompidou, 1987)
Les villes forment un immense laboratoire pour faire des expériences, commettre des erreurs, échouer ou réussir en matière d’architecture et d’aménagement urbain. C’est dans ce laboratoire que l’urbanisme aurait dû étudier, concevoir et expérimenter des théories.
Vivre c’est oser.
Oser pour une ville c’est accepter de se mettre au niveau de l’époque, d’utiliser à plein les ressources de la technique et les élans de l’art contemporain, c’est restaurer les legs du passé, mais c’est tout autant créer des quartiers nouveaux, greffer les faubourgs sur le centre par des réseaux modernes, faire jaillir le confort à la place des taudis, organiser l’habitat pour les générations futures.
C’est une tâche rude, où toutes les disciplines doivent s’unir pour résoudre des problèmes nombreux.
C’est à tout cela que nous convie le secteur de l’avenue d’Italie.
M. Roussilhe, Directeur de l’urbanisme et du Préfet de la Seine Michel Holley, Urbanisme vertical et autres souvenirs, éditions Somogy éditions d’art, 2012
Comment s’orienter, agir, vivre sans savoir et comparer, sans se situer dans le temps et dans l’espace !
Renaud Sainsaulieu, Sociologue français

Tour :
(latin turris)
1. Corps de bâtiment ou bâtiment (dans œuvre, hors œuvre, demi-hors œuvre, ou indépendant) de plan massé et nettement plus haut que large
2. Toute construction en hauteur
Gratte-ciel :
(Source : Larousse)
Bâtiment d’habitation ou de bureaux à grand nombre d’étages et à faible emprise au sol par rapport à sa hauteur. (On dit en langue administrative I.G.H. [immeuble de grande hauteur].
Le gratte-ciel est une création de l’architecture américaine, et spécialement de l’école de Chicago, à la fin du XIXe siècle)
(Source : Larousse)
I.G.H :
Constitue un Immeuble de Grande Hauteur, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau (PBDN) est situé par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie :
• à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d’habitation, tels qu’ils sont définis par l’article R.111-1 ;
• à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles. »
(Source : Les services de l’État dans la Vienne)


Après la révolution industrielle, la population mondiale a augmenté de cinq-cent-millions à sept milliards. La terre souffre de plus en plus avec cette croissance démographique. Les villes s’agrandissent pour accueillir les futurs citadins. Les terrains naturels producteurs de nourriture, se réduisent progressivement à cause de l’urbanisation. Le monde est face au réchauffement et aux changements climatiques dus à la densité urbaine, l’artificialisation du sol, la circulation automobile et l’exploitation insensée. Aujourd’hui le débat pour la ville se situe entre l’étalement urbain et l’urbanisme vertical. Tout d’abord, l’étalement urbain à la hauteur basse ou moyenne est plus adapté à l’échelle humaine. Il s’harmonise plus avec les paysages urbain et naturel. Toutefois, vu la circulation automobile pour aller au travail, depuis les périphériques jusqu’aux centres-villes, ce n’est pas plus écologique que l’urbanisme vertical voir pire comme Renzo Piano dit « Il n’y a rien de moins écologique que de construire en s’étalant. Dès que vous faites à l’horizontal, vous construisez de nouvelles banlieues, vous devez amener des égouts, des routes, des moyens de transport... Cela devient vite insupportable. C’est une idée romantique que de vouloir construire bas, à l’échelle humaine. Le résultat, ce sont des villes ridicules et sans âme. Il faut accepter que le destin d’une ville aujourd’hui ne soit pas celui d’un petit village. Les villes sont des lieux d’intensité, des lieux d’échange. »1 Nous savons que l’étalement urbain nécessite plus de terrains pour recevoir la même densité que l’urbanisme vertical. Plus de terrains urbanisés aggravent les dégâts, en cas de catastrophes naturelles. La ville bitumée et bétonnée n’a plus la capacité de laisser passer une grande quantité d’eau fluviale avec des pluies de plus en plus importantes, ce qui augmente les risques d’inondation. L’imperméabilité empêche l’infiltration des eaux dans les sols – nappes phréatiques et par réverbération la chaleur urbaine s’accentue. L’horizontalité et la verticalité s’opposent non seulement dans l’urbanisme mais aussi dans la vie quotidienne. Chacun rencontre cette expérience au quotidien. Souvent les objets pour le confort humain, sont horizontaux. Mais à la fois pour stocker et gagner des espaces libres, ce n’est pas dans l’horizontalité, c’est toujours avec la verticalité. Celle-ci nous demande alors un effort pour atteindre ce qui est hors de portée, rangé au-dessus, en hauteur. La verticalité est alors synonyme d’inconfort. Mais nous préférons avoir plus d’espaces libres pour nous, non pour les objets, pour notre confort temporaire. A la suite de la révolution industrielle, nombreux ont commencé à travailler en intérieur, les
1. Entretien avec Renzo Piano, Nouvelobs, 16 avril 2018
ouvriers dans les usines, le personnel administratif dans les bureaux. L’exode rural provoque une affluence dans les villes, celles-ci s’agrandissent et se construisent en hauteur afin d’offrir plus d’espaces. Notre monde a besoin des espaces pour se nourrir, s’amuser, se loger, se déplacer, se reposer, vivre ensemble. C’est pour cela que l’urbanisme vertical est né à Chicago, pratiquement à Manhattan sous une contrainte territoriale. Quant à Paris, la construction d’immeuble de grande hauteur a été acceptée dans les années 1950, 1960 et 1970 par les besoins de l’époque. En France l’urbanisme vertical a été transmis, développé et réinterprété principalement par quatre figures majeures comme Auguste Perret, Le Corbusier, Raymond Lopez et Michel Holley. Ils ont imaginé le nouveau Paris à la verticale pour que Paris soit adapté au surpeuplement, au changement des modes de transports et aux nouvelles activités, nouveau mode de vie, confort humain, etc. Nous connaissons déjà les grands travaux de Haussmann en plein milieu du XIXe siècle dans la capitale française pour augmenter et améliorer, modernité, hygiène, dynamisme grâce à des modifications chirurgicales. En conséquence, Paris était devenu une ville plus propre, dense et vivante qui attirait les riches ainsi que les artistes, commerçants, etc. Aujourd’hui le Paris d’Haussmann est emblématique et attire de nombreux touristes du monde entier. Ce fut une adaptation aux enjeux majeurs de l’époque pour raviver et faire évoluer la ville. De nos jours, Paris a besoin de nouveaux aménagements, afin de « transformer Paris en ville plus moderne, aérée par des parcs et des avenues-squares »2 tout en mettant à disposition plus d’espaces habitables, d’espaces verts et plus d’équipements publics où sont proposés différents services. Des habitants souffrent encore de nos jours sur Paris, dans des logements insalubres aux loyers coûteux. Des besoins apparaissent, comme les terrains de jeux pour les enfants, des bureaux pour les travailleurs, etc. La construction en hauteur n’est pas une réponse absolue à toutes les questions urbaines dues au surpeuplement. Toutefois, elle peut au moins contribuer à régler les problèmes liés au manque d’espaces nécessaires pour certains programmes sans trop étaler les constructions. Les gratte-ciel représentant l’urbanisme vertical suscitent toujours beaucoup de critiques. Les raisons principales en sont la ségrégation non seulement entre les classes sociales due au coût élevé des charges mais aussi entre les tissus de tours et les tissus existants et l’inquiétude au sujet de l’écologie et de la sécurité. Thierry Paquot, un philosophe français de l’urbain, les souligne aussi dans ses deux ouvrages : Désastres urbains : Les villes meurent aussi, ainsi que La folie des hauteurs : Critique du gratte-ciel. Il considère le gratte-ciel comme l’élément d’un package de la ville productiviste ayant une logique « toujours plus »3. La vision négative est indispensable pour que cet urbanisme à la verticale se complète et évolue. Celui à la française, par les quatre figures de la verticalité est un fruit de l’évolution par rapport à l’original des Etats-Unis. Les gratte-ciel étalés sur le plan hippodamien de Manhattan ne se préoccupent pas des avantages principaux de l’urbanisme vertical : libérer plus de surfaces pour le public et plus
2. Jean Castex, Les tours à Paris, bilan et prospectives, APUR, 2003
3. Thierry Paquot, La folie des hauteurs : Critique du gratte-ciel, éditions In Folio, 2017, p9


de sols naturels, mieux éclairer et aérer la ville grâce à l’emprise au sol beaucoup plus faible que d’autres. C’est pourquoi Le Corbusier a proposé sa version à la verticale, le Plan Voisin, pour Paris qui est mieux pensé concernant l’ensoleillement, la présence de la nature même si sa proposition a été considérée comme un danger pour Paris. Malgré les critiques des architectes, urbanistes et des Parisiens, son concept répond aux besoins de la société moderne. Mais du point de vue paysager urbain, c’est trop éloigné par rapport à l’existant. Comme Georges Pompidou a dit, « Je ne suis pas un fanatique des tours. Il me parait absurde d’écraser un village ou une petite ville par des tours, même de hauteur médiocre. Mais c’est un fait que l’architecture moderne de la grande ville se ramène à la tour. »4 Ce n’est pas la société moderne, se rassemblant dans les grandes villes, qui demande cet urbanisme à la verticale. Raymond Lopez et Michel Holley, les deux protagonistes de deux rénovations urbaines à Paris : L’opération Beaugrenelle dans le XVe arrondissement et l’opération Italie XIII dans le XIIIe arrondissement, ont réalisé ces opérations avec de bonnes intentions : implanter plus de logements avec le confort et l’hygiène, plus d’équipements publics à la fois culturels, éducatifs et sportifs, proposer un nouveau mode de vie pour une nouvelle société en permettant aux habitants de gagner du temps grâce à l’installation des commerces, bureaux, écoles, etc. Malgré toutes ces bonnes pensées, ils n’ont pas pu apporter un happy ending à l’urbanisme vertical en France. Il y a davantage de débats sur la hauteur puis plusieurs études qui révèlent des problématiques provenant des immeubles de grande hauteur (IGH). Quelques années après la fin de l’opération Italie XIII, Renaud Sainsaulieu, un sociologue français, a souligné surtout des problèmes sociaux.5 La façon brutale, en faisant table rase, a provoqué une ségrégation entre les nouveaux arrivants et les habitants du quartier déjà existant, à cause d’un manque de lien social. Les équipements culturels et sportifs installés au sein de chaque opération, non fréquentés par tous, auraient pu devenir un lieu d’échanges entre les nouveaux et les autochtones, avec la proximité et la visibilité sur le quartier. La plupart des quartiers de tours auraient pu régler le problème d’insécurité grâce à la fréquentation des habitants de tout le quartier voir de toute la ville. Jan Gehl, urbaniste et architecte danois, a affirmé qu’une ville animée permet de devenir plus sûre, plus durable et plus saine.6 Un tel type d’urbanisme n’est pas une théorie parfaite. Il vit ou meurt selon les époques mais il peut aussi évoluer malgré l’échec. Un tel type d’urbanisme n’est pas une théorie parfaite. Il vit ou meurt selon les époques mais il peut aussi évoluer malgré l’échec. Dans l’ouvrage de Michèle Tilmont, Les I.G.H dans la ville, dossier sur le cas français, qui est une bible par rapport aux IGH français et l’urbanisme vertical, elle analyse d’abord l’histoire générale de l’urbanisme vertical, puis les opérations comme le Front de Seine, la Maine-Montparnasse, avec les IGH en France afin de bien connaître les raisons pour lesquelles on a choisi et abandonné cet urbanisme. Son approche très administrative a clarifié le choix de mon cas d’étude, l’opération Italie XIII, inachevée à cause d’une politique
4. Le Monde, Publié le 17 octobre 1972
5. A. Mohamed, M. Norbert, Rénovation urbaine et mutations sociales au 13e arrondissement, ENTPE, 1983-1984
6. Jan Gehl, Cities for people, éditions Island Press, 2010
sans réels arguments. Cependant, cet ouvrage qui date de 1978, a ses limites pour percevoir les problèmes dans les quartiers verticaux, la vie des habitants, les conflits, et les arguments pour ne pas rejeter l’urbanisme vertical pour la Capitale mais plutôt encourager son évolution, tout en réfléchissant comment l’adapter à Paris. Pour cela, ce mémoire va se dérouler d’abord sur l’urbanisme vertical tout en présentant des enjeux actuels et des éléments à porter pour le cas d’étude. Ensuite, la deuxième partie va ouvrir une enquête en se focalisant sur la réalité d’aujourd’hui, de l’Italie XIII héritage du passé. Enfin avec cette enquête actualisée, ce mémoire donnera une vision générale, sur l’Italie XIII, qui permettra d’avoir une bonne analyse de l’urbanisme vertical à Paris.



La verticalité apparaît dans l’architecture depuis Babylone, le royaume antique au sud de la Mésopotamie. Cette architecture nommée ziggourat, révèle un agencement et un espace caractéristiques démontrant la puissance d’un pouvoir centralisé, régnant sur une société citadine d’environ cinq mille personnes. A l’inverse, Israël était constitué de nomades, sans avoir composé une société. Ainsi, la densité est un facteur majeur dans la tendance à favoriser la verticalité. La ziggourat construite par empilement de briques d’argile, constitue des escaliers, lesquels, par leur différence de hauteur, démontre l’importance du pouvoir. Depuis ce royaume antique, la verticalité se présente en tant que symbole du pouvoir du roi comme la pyramide, ou du pouvoir religieux comme la ziggourat, les cathédrales, mais aussi en tant qu’architecture fonctionnelle comme le clocher ou le château ayant une vue au loin, pour des raisons défensives. Toutefois l’urbanisme vertical n’a pas une longue histoire. Ce développement vertical est né à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle aux États-Unis grâce à l’expansion économique et la croissance des villes comme un facteur environnemental mais aussi grâce aux innovations techniques comme l’ascenseur, l’acier, etc. Tout d’abord à Chicago, avec l’École de Chicago sous l’influence de Sullivan, la ville se lève plus timidement que New York, avec des constructions en hauteur qui sont accentuées par des ornements fonctionnalistes et modestes avant 1900. Cependant après 1900, à New York, sous l’influence de l’École de New York, des gratte-ciel se différencient avec la tripartition des styles, comportant des ornements ayant l’aspect antique, par exemple, le Chrysler Building. L’urbanisme vertical se développe pratiquement plus à New York, plus précisément à Manhattan. Manhattan est territorialement très limité par le fleuve Hudson et ses deux rivières, East et Harlem. En plus, avec la concentration des grandes entreprises amenant une population importante, Manhattan réalise tout de suite la spéculation foncière. Par la suite, les nouvelles activités commerciales et de services demandent de plus grands locaux. Ces facteurs incitent à construire des édifices à la verticale sur Manhattan. Autrement dit, la naissance de l’urbanisme vertical est due aux besoins de la société moderne ; donc son architecture n’est pas un objet décoratif. Sa nature est fonctionnelle et productive. Raymond M. Hood, précurseur du Rockefeller Center considéré comme un gratte-ciel où il y a une vraie vie sociale, a également souligné la réunification de diverses activités comme clubs, hôtels, magasins, appartements, et théâtres1
1. Dans « Nation’s business », New York, Novembre 1929, pp. 19-20 et pp. 206-209.
Cette idée illustre très bien une nouvelle société moderne qui poursuit le gain de temps et de mouvement puisque la plupart de ces salariés travaillent « confortablement », contrairement aux générations passées. La réussite de cette métropole verticale et de ses gratte-ciel considérés comme une ville dans la ville2, s’est transmise dans le monde entier. L’urbanisme vertical est répandu quel que soit l’environnement, le climat, la topographie, la culture. En conséquence, de nos jours nous trouvons les métropoles mondiales qui se ressemblent petit à petit avec ce type d’architecture en hauteur qui exprime leur ego plutôt que le caractère régional ou national. Autrefois, il était décidé de construire une ville à la verticale suivant les contraintes territoriales et les intérêts économiques par rapport aux superficies des terrains. Aujourd’hui la situation demande de prendre en compte de nouveaux éléments ; avec le changement climatique, notre génération doit réfléchir à faire évoluer la ville, le mode de vie, etc. L’humain ne peut étaler les villes à l’infini, puisque la terre est limitée et que nous n’avons pas seulement la vie urbaine. Il faut préserver l’espace rural. C’est pour cela qu’il est indispensable de prévoir comment faire évoluer l’urbanisme vertical. Nous ne pouvons plus faire plusieurs Manhattan. Comme Le Corbusier et Auguste Perret ont souligné, il faut apporter la lumière, l’air et la nature. Les tours d’habitation bien espacées ayant des espaces verts se trouvant par exemple à Paris, sont une évolution d’urbanisme vertical après Manhattan. Avec cela, quelle sera la prochaine évolution de cet urbanisme ? Avec les enjeux environnementaux, il faudrait surtout envisager les enjeux sociaux qui sont soulevés, un des problèmes majeurs de l’urbanisme vertical. La plupart des opposants à la hauteur reprochent surtout l’aspect environnemental, esthétique et social. L’acier et le béton qui sont les matériaux principaux de la construction en hauteur, sont aussi les matériaux typiques qui polluent en créant davantage de carbone. Ce point est en train de progresser avec de nouvelles inventions techniques comme le béton négatif en carbone de CARBICRETE ou l’acier fait avec de l’hydrogène qui ne crée aucun carbone, HyRex (Hydrogen Reduction) de Posco. En revanche, les domaines d’architecture et d’urbanisme doivent rechercher et proposer de nouvelles manières de vivre dans cet habitat vertical. Comment favoriser une vie sociale dans la verticalité ? Comment relier l’habitat vertical avec l’habitat existant ? Malgré ces problèmes pourquoi le monde s’enthousiasme pour l’urbanisme vertical ? Est-il adapté à tous les environnements ? Satisfait-il à tous les besoins de la société moderne ? Tout d’abord, à l’échelle mondiale, construire de plus en plus haut montre la puissance économique de la ville et du pays, puisque la construction en hauteur coûte beaucoup plus cher. Elle demande aussi le high-tech qui permet de dépasser les contraintes environnementales. De plus, cela peut apporter beaucoup de profits économiques. Par exemple, chaque année Dubaï, qui a une image de ville nouvelle verticale ayant le plus haut gratte-ciel au monde, Burj Khalifa, accueille plus de 10 millions de touristes.
2. Ibid.



Dubaï a pris la première place dans le classement des villes où les touristes dépensent le plus avec un chiffre de 29,4 milliards de dollars en 20223. A l’échelle d’une ville, l’urbanisme vertical est un moyen pour recevoir une population de plus en plus importante et il permet d’apporter plus de surfaces utiles, plus de logements et plus de sols libres à la ville. Toutefois, Raymond Unwin conclut son étude par « Le fait de s’élever ne supprime pas le problème du transport. »4 en étudiant le cas de l’immeuble Woolworth à New York, les gratte-ciel qui ne sont pas à usage d’habitation, ne peuvent pas améliorer la circulation chaotique, cela empire même à cause de la population imposante qui se déplace à pieds. Donc pour que l’urbanisme vertical soit bénéfique, il est indispensable d’envisager comment implanter le programme d’habitation tout en le reliant à d’autres programmes tels que les bureaux et les commerces. La densité importante apportée par l’urbanisme vertical impose de prendre en considération également la grandeur des îlots bâtis et la largeur des rues afin d’éviter l’engorgement contrairement aux villes traditionnelles.
Ensuite concernant son concept, la verticalité permet de maximaliser le coefficient d’emprise au sol (CES) avec le minimum de coefficient d’occupation des sols (COS). Au travers d’un schéma sur la forme urbaine et la densité (ILL. 07) de Vincent Fouchier, directeur général adjoint de la métropole Aix-Marseille-Provence, nous pouvons tout de suite comprendre l’avantage de la construction en hauteur. Par rapport à la construction basse et moyenne, la construction en hauteur est plus imposante dans un paysage mais territorialement elle densifie moins la ville et libère ainsi davantage d’espace au sol. Donc nous pouvons nous servir du reste de la parcelle pour un espace public en ayant plusieurs programmes comme un espace vert ou un équipement public sportif, scolaire, etc. La vie sociale du monde vertical d’aujourd’hui se fait majoritairement dans ces espaces publics. L’ascenseur et le hall d’entrée dans l’IGH sont également des lieux de rencontre comme une « place ou rue de rencontre » de la cité jardin ou des quartiers maisons. En revanche il y a toujours la question : comment faire évoluer ces « espaces d’échanges ». En général, plus la densité est importante, plus l’échange est important. Mais paradoxalement, la densité importante dans une tour d’habitation ne le permet pas. Car un habitat vertical distingue plus clairement l’espace commun de l’espace privé. C’est-à-dire que les habitants ne peuvent pas regarder leurs voisins depuis leur appartement alors que les habitants dans un quartier traditionnel peuvent entendre et regarder plus facilement leurs voisins. De plus, la société moderne qui est devenue de plus en plus individualiste, aggrave l’individualisme. En Corée où l’habitat le plus courant est la tour d’habitation, un journal, Dong-A, a fait plusieurs expériences5 dans quatre ensembles d’habitations verticales. La première expérience était de saluer les habitants dans l’ascenseur, la deuxième en faisant une enquête avec un questionnaire : « Avez-vous des échanges avec vos voisins ? », « Quel est le niveau de proximité que vous
3. World Travel and Tourism Council (WTTC)
4. Extrait du rapport présenté au R.I.B.A le lundi 17 décembre 1923. « Higher Building in relation to town planning » Cité par la Revue Architecture d’aujourd’hui n’178 dans un article « 3 textes prophétiques »
5. Jin Woo Shin, Vers une nouvelle coexistence/Partie 3 : Savez-vous qui habite à côté ?, Dong-A journal, 02 août 2011

— ILL. 13
Paysage de Dubaï, Voyage Oman et Emirats

— ILL. 15
Paysage de Salvador, Grandescapades

— ILL. 14
Paysage de Hong Kong, Hong-Kong Tourism Board

— ILL. 16
Paysage de Francfort-sur-le-Main, Skylineatlas

— ILL. 17
Paysage de New York, Wikipedia

— ILL. 18
Vincent Fouchier (d’après J. Comby), Forme urbaine et Densité
avez avec vos voisins ? », « Avez-vous envie de communiquer avec vos voisins ? » Le résultat était intéressant. 85% d’habitants ont répondu qu’il n’y a pas d’échanges avec leurs voisins et le niveau de proximité comme avec des passants ou des serveurs dans les restaurants. Toutefois, 70% d’habitants ont répondu qu’ils ont envie de communiquer avec leurs voisins. Comme beaucoup d’opposants disent, la verticalité cause la ségrégation sociale ? Je ne pense pas que ça soit seulement un problème avec les immeubles de grande hauteur. C’est plutôt un phénomène social à cause de l’individualisme, des environnements. La ville de Séoul a déjà testé un projet « Abattre le mur » afin de changer le paysage dans certains ensembles de tours en enlevant les clôtures et en aménageant des arbres, équipements sportifs de plein air. Cela a permis d’y rassembler les habitants et de favoriser la constitution d’un sentiment d’unité en tant que communauté villageoise. Comme pour ce cas, les architectes et les promoteurs d’aujourd’hui sont en train d’essayer un nouveau mode de vie dans la verticalité avec des espaces communs intermédiaires, des passerelles entre plusieurs tours, etc. La différence de la hauteur crée certainement un sentiment d’inégalité selon les niveaux comme je l’ai déjà mentionné pour la ziggourat de Babylone. La difficulté, dans l’urbanisme vertical, est de pouvoir gérer les sentiments d’inégalités avec ces différences de niveaux. En habitant aux niveaux supérieurs, nous pouvons acquérir une vue dégagée sur le paysage environnant et le ciel mais aussi l’ensoleillement plus important, l’intimité plus assurée, moins de nuisances sonores depuis la rue. Les niveaux inférieurs sont donc moins favorisés à ce propos. De nos jours, il y a un mot spécifique « Royal floor » ou « Penthouse » qui désignent les étages royaux et l’espace de vie de luxe au dernier étage. Cela provoque une société hiérarchisée et l’inégalité sociale. Le fait d’avoir la ville en dessous de soi, crée un certain sentiment de supériorité. Dans le film, High-rise réalisé en 2015 par Ben Wheatley et basé sur le roman, High-rise de J.G. Ballard, le dernier étage appartient à l’architecte qui est illustré comme un créateur du monde vertical. Seulement les gens concernés peuvent aller au dernier étage et il y a une toiture jardin splendide qui n’est que pour l’architecte.
En 2020, dans le drama Penthouse, les habitants dans le Hera Palace sont classés selon l’étage où ils vivent. Et les habitants des étages inférieurs rampent devant les habitants des étages supérieurs et ignorent les gens qui n’y habitent pas. C’est un monde vertical où les habitants désirent toujours de monter plus haut et d’avoir plus. En 2023, un immobilier américain publie une vidéo publicitaire de vente d’un penthouse sur Youtube. C’est un penthouse à New York ayant une vue sur le Central Park et toute la ville. Aujourd’hui la hauteur est pour une minorité. On ne peut expérimenter la grande hauteur que dans une tour privée, au prix et aux charges importantes.
Toutefois, dans les immeubles haussmanniens au XIXe siècle, habiter aux étages supérieurs







était plutôt pour la classe défavorisée à cause de l’effort pour monter les escaliers. La société de cette époque privilégiait le confort physique plutôt qu’avoir une vue sur la ville ou autre.
En revanche, pour la nouvelle société l’invention de l’ascenseur rassurait le confort dans la verticalité. La circulation grâce à l’ascenseur permet de ne pas perdre de temps pour se déplacer à condition que l’ascenseur marche toujours bien et qu’il n’y ait pas d’affluence. Donc plus la hauteur de l’édifice est importante, plus il faut d’ascenseurs. Il faut aussi penser au manque d’approvisionnement en électricité, les niveaux supérieurs sont alors défavorisés. Par exemple, en Corée du Nord, la classe de haut rang évite les étages hauts, y compris les penthouses qui sont attribué aux classes défavorisées. Selon Reuters6, la raison pour laquelle la classe de haut rang refuse d’acheter des appartements de grande hauteur est due aux inquiétudes concernant les ascenseurs et l’alimentation électrique peu fiables, le mauvais approvisionnement en eau et la technologie de construction. C’est pour cela que l’ascenseur doit bien fonctionner avant tout.
Ensuite, nous pouvons réfléchir comment résoudre cette inégalité née par la hauteur. Du point de vue de l’intérêt public, l’espace commun ou privatif pourrait se situer aux derniers étages afin que les habitants puissent partager la hauteur comme le projet Panache d’Edouard François à Grenoble avec le slogan « Je veux une hauteur pour tous ! »7. Comme l’ascenseur, l’urbanisme vertical fait par les IGH, est une forme synthétique qui exprime le développement de la technique. Pour cela, son moteur exécutif vient de la finance privée pour que le crédit budgétaire pour l’opération soit assuré. Ce fait cause souvent des problèmes. L’intérêt des promoteurs à la rentabilisation maximalisée, est confronté avec l’intérêt public, qui veut des espaces pour circuler, se reposer, rencontrer les gens au rez-de-chaussée. Cela est contrôlé par la municipalité, par exemple, à Manhattan, la hauteur constructible peut être récompensée par la contribution au public en donnant plus d’espaces publics au rez-de-chaussée. Dans l’opération Italie XIII, toutes les constructions des équipements publics ont été assurées par les promoteurs grâce aux règlements par le gouvernement. Comme toute chose, l’urbanisme vertical doit être contrôlé par l’état pour éviter l’exploitation de la part du privé qui se focalise souvent sur le profit. De nos jours, proposer plusieurs formes d’habitat est important pour que la population qui est mixte et diversifiée, ait la liberté de choisir le type d’habitation ou d’environnement. Christian Norberg-Schulz, architecte, théoricien de l’architecture et historien norvégien évoque trois formes d’habitat :
« D’abord, il signifie rencontrer d’autres êtres humains pour échanger des produits, des idées et des sentiments, c’est-à-dire pour expérimenter la vie comme une multi-
6. Josh Smith, Penthouses in North Korea are mainly for the unfortunate few, REUTERS, 15 avril 2022
7. Edouard François, https://www.edouardfrancois.com/projects/panache
tude de possibilités. Ensuite, il signifie se mettre d’accord avec certains d’entre eux, c’est-à-dire accepter un certain nombre de valeurs communes. Enfin, il signifie être soi-même, c’est-à-dire choisir son petit monde personnel. Ces trois formes d’habitat, nous pouvons les appeler habitat collectif, habitat public et habitat privé. »8
A ce propos, l’urbanisme vertical peut proposer plusieurs formes d’habitat grâce à l’implantation de diverses activités dans les espaces publics, aux règlements par le syndicat de copropriétaires et aux logements plus intimes. La densité importante dans l’urbanisme vertical permet d’avoir une mixité sociale puisqu’il y aura davantage de types de personne qui vont choisir un type d’habitation selon leur goût. La réinterprétation d’Auguste Perret et Le Corbusier après le voyage à Manhattan a permis de penser l’habitat vertical de façon plus pensée par rapport au confort humain. Et cela a été exprimé dans l’opération Italie XIII à Paris malgré qu’elle n’ait pas été complètement achevée. Ainsi, l’urbanisme vertical est toujours en train d’évoluer par des essais, des échecs et des succès. Puisque son histoire n’est pas longue, nous trouverons encore ses avantages et ses inconvénients à nouveau qui vont permettre de mieux connaître l’urbanisme vertical, de le faire progresser et de l’adapter à chaque société ainsi qu’à chaque époque.

Le désir de « gratter » le ciel n’est pas nouveau. Le ciel qui représente Dieu, est sacré et précieux depuis l’antiquité. Toutefois le ciel, ou la hauteur n’était pas une exception pour l’humain qui est un être vivant ayant une envie de dominer toutes les créations de la Terre. À dater de l’époque du cueilleur-chasseur, être en hauteur assure la sécurité face aux ennemies que ce soit pour l’humain comme pour l’animal. Ce qui a amené, par la suite, une architecture militaire défensive à la verticale. La hauteur représente aussi comme un lien de contact avec Dieu pour de nombreuses religions. Jusqu’avant l’ère industrielle au XVIIIe siècle, en Europe la tour a été une construction influencée par deux acteurs majeurs1 : religion, pouvoir. A partir du XIXe siècle, avec l’invention de l’acier, l’ascenseur est du type : d’assemblage de rivetages grâce aux produits laminés plats. L’humain a pu commencer à habiter, en grand nombre, dans cette forme d’architecture verticale. Après le succès de New York, au début du XIXe siècle et après la Première Guerre Mondiale, dans le contexte de restructuration de la ville, les pays européens ont commencé à proposer des concours où la verticalité est présente, par exemple, le concours de la Friedrichstraße en 1922 et le concours de l’Alexanderplatz en 1929 pour Berlin, le concours Rosenthal pour l’aménagement de la porte Maillot en 1930, le concours pour la voie triomphale en 1931 pour Paris sans avoir jamais été réalisés. En Europe, le concept de l’urbanisme vertical n’est pas tout à fait le même que le concept américain. Il y a plus de réflexions par rapport à l’ensoleillement, la circulation pour une ville plus radieuse, moins engorgée. Après les guerres, un besoin important d’habitations avec plus d’hygiène et de confort, fait choisir la construction en hauteur afin de produire un maximum de logements. Au sujet des matériaux, en Europe, les architectes ont employé plus le béton comparé aux États-Unis. La structure en béton préfabriquée ou mixte (béton et acier) est utilisée plutôt que l’emploi d’une structure en acier puis drapée de maçonnerie aux États-Unis. Finalement, cet emploi du béton apporte banalité et sensation de froid, ce qui ne fait pas l’approbation générale. La standardisation du mode d’emploi des matériaux et du style architectural représente l’urbanisme vertical européen du XXe siècle. Aujourd’hui, les métropoles européennes sont constamment érigées par leurs trophées et ils constituent des paysages urbains qui donnent une autre échelle à la ville. Désormais, la tour n’est plus seulement un objet étranger qui est solitaire, c’est un modèle d’architecture qui constitue une forme, des tissus et des paysages urbains ce qui peut résoudre plusieurs problématiques environnementales et urbaines. 1. Ingrid Taillandier, L’invention

— ILL. 27
La première tour de Paris (1960), rue Croulebarbe, In Une ville dans Paris, Gilles-Antoine Langlois

— ILL. 28
Publicité pour la commercialisation de la tour Croulebarbe, permier gratte-ciel parisien. Edouard Albert, In , Le Figaro du 23 janvier 1959 Archive Albert, Centre Georges Pompidou
Paris, patrimoine mondial, n’a pas été une exception il a fallu l’aide de l’urbanisme verticale pour pouvoir satisfaire la nouvelle société. Au début du XXe siècle, le concept à la verticale a commencé à être évoqué. Puis dans les années 1950, quelques tours ont vu le jour, ainsi qu’en parallèle des études, envisageant l’urbanisme vertical, sur la rénovation urbaine. La première tour « résidentielle » en France, achevée en 1952 puis inaugurée en 1959 n’a pas été construite dans la capitale. Après la Seconde guerre mondiale, Amiens a commencé à reconstruire sa ville touchée par le bombardement. Le Ministère de la Reconstruction1 a confié à Auguste Perret la première construction de tour en béton financée par des crédits publics d’expérimentation, à la différence de la plupart des tours qui sont financées par des crédits privés. De plus la tour Perret, qui se présente dans la ville comme un autre point de repère avec la Cathédrale Notre-Dame d’Amiens, préserve l’harmonie de l’ensemble. L’insertion dans un ensemble de bâtiments alignés sur la rue donne plus de cohésion dans le tissu urbain. Et la place Alphonse Fiquet située en face de la tour Perret permet ainsi d’intégrer la tour dans la ville. Quelques années plus tard, en 1960 une tour d’habitation dessinée par Edouard Albert s’est implantée dans le XIIIe arrondissement de la capitale. La première tour d’habitation parisienne a annoncé la conquête de Paris par la verticalité. La tour Albert, mesurant 67m de haut avec un niveau esplanade prévu pour que le public traverse, aurait pu devenir un modèle de la ville verticale connectée par les passerelles que nous pouvons retrouver dans de nombreux dessins d’architectes comme La cité des Tours de Francisco Mujica et d’ouvrages cinématographiques par excellence, Metropolis de Fritz Lang. Cette première tour d’habitation parisienne a proposé un nouveau mode de vie « habiter la hauteur » en ayant la vue sur la ville de Paris grâce à l’ascenseur et la structure métallique qui permettent de monter plus haut. À la suite de la première construction d’habitation en hauteur, plusieurs opérations de rénovation urbaine : Le Front de Seine (XVe arr.), la Maine-Montparnasse (XIVe arr.), l’Italie XIII (XIIIe arr.), ont été conduites à Paris. La verticalité considérée comme une image de la modernité, a commencé à étendre son territoire dans Paris, grâce aux pouvoirs politiques qui encouragent la construction en hauteur, en dehors du centre historique de Paris tout en apportant une masse de logements, de bureaux et d’équipements, un confort et un nouveau mode de vie pour la nouvelle société.
1. La Tour Perret, Amiens Métropole
— ILL. 29 Poupée russe, dessin personnel
Auguste Perret (1874-1954) Le Corbusier (1887-1965) Raymond Lopez (1904-1966) Michel Holley 1924-2022)
[...] La ville devient théoriquement un immense square planté de tours.
...L’homme n’a guère utilisé jusqu’ici un espace à deux dimensions. Désormais, il ne sera plus obligé de ramper dans le bruit et les poussières, mais pourra vivre dans les étages supérieurs de maisons dressées en hauteur.1
[...] Le gratte-ciel est un outil. Outil magnifique de concentration de population, de décongestionnement du sol, de classification, d’efficacité intérieure, une source prodigieuse d’amélioration des conditions du travail, un créateur d’économie et par là, un dispensateur de richesse.2
[...] de même qu’Haussmann, pour des raisons d’ailleurs presque uniquement politiques, a fait détruire le vieux quartier du Temple, il est urgent à présent de démolir et de reconstruire certains quartiers de Paris qui ne sont plus en état de satisfaire les besoins de l’époque.3
Paris, actuellement est constitué d’immeubles de six étages moyens occupant la moitié de la surface des îlots. Pour obtenir la surface nécessaire aux équipements, il faut dégager 80% du sol, ce qui aboutit à construire des bâtiments de 24 étages sur 12% du sol, au lieu de 12 étages sur 25% ou de 6 sur 50%.4
1. Michel Holley, Urbanisme vertical & autres souvenirs, Somogy, 2012, p36
2. Le Corbusier, Descartes est-il américain, 1935
3. Raymond Lopez, L’avenir des villes, 1964
4. Interview à la revue “Architecture Française”, n385-386 d’octobre-novembre 1974
En France, même si la période de l’urbanisme vertical était succincte, cette période est formée de quatre figures importantes de la verticalité : Auguste Perret, Le Corbusier, Raymond Lopez et Michel Holley. Ces quatre figures ne sont pas opposées les unes aux autres car il y a une influence héréditaire. Le Corbusier était élève de Perret qui avait déjà compris l’importance du modèle innovateur à la verticale pour la ville moderne après son voyage aux Etats-Unis. Son concept pour la ville contemporaine de trois millions d’habitants en 1922, porte l’empreinte d’Auguste Perret qui a évoqué le concept « Maisons hautes ». Il s’est basé sur la construction de gratte-ciel monumentaux qui multiplient les usages mais entourés d’espaces libres tels que des squares et des avenues. Le Corbusier qui considérait Manhattan comme un chaos urbain, souligne aussi l’espace libre au sol qui permet d’avoir l’ensoleillement, l’aération, la circulation. Son concept « évolué » depuis l’urbanisme vertical américain est aujourd’hui présent dans la plupart des pays qui privilégient la verticalité pour dédensifier et décongestionner la ville. Ensuite Raymond Lopez, élève de Le Corbusier et son collaborateur Michel Holley qui a été également beaucoup influencé par Le Corbusier, ont développé et réalisé au travers des opérations de rénovation urbaine particulièrement le Front de Seine (Beaugrenelle) et l’Italie XIII. Ils ont pris en compte aussi de la particularité du Vieux Paris qui présente une horizontalité grâce aux hauteurs des bâtiments plus ou moins homogènes, en égalisant les hauteurs des tours sauf une tour Signal (le cas de tour Apogée). Michel Holley a proposé aussi un principe de zoning vertical qui superpose les fonctions urbaines (habiter, travailler, se recréer, circuler) verticalement au contraire de la Charte d’Athènes de Le Corbusier qui les répartit. Malgré des critiques à propos des opérations de rénovation urbaine à la verticale dans Paris, la contribution de ces quatre figures de la verticalité et leurs réalisations sur la ville de Paris ne sont pas négligeables. Les tours d’habitation ont permis de loger une population dense, avec plus de confort et d’hygiène. Les quatre précurseurs de la verticalité n’ont pas simplement apporté l’urbanisme vertical en France depuis les États-Unis. C’est un propre urbanisme vertical à la française qui met en application des réflexions sur le milieu urbain, le rapport ville-homme, la forme urbaine en prenant en compte les besoins de la nouvelle société.







La construction en hauteur pour l’habitation à Paris n’existe plus depuis l’urbanisme giscardien dans les années 1970. D’autres métropoles européennes voient de degrés en degrés des tours qui poussent sur n’importe quel terrain. En général, les logements des tours sont luxueux ayant une vue magnifique sur la ville. Paris est la « seule métropole » qui est résistante aux tours grâce aux grands travaux d’Haussmann et aux Parisiens qui veulent toujours garder ce « vieux Paris ». Malgré cette résistance conservatrice, les tours apparaissent non seulement conceptuellement, mais réellement comme les tours Duo de Jean Nouvel ou la tour Triangle de Herzog et de Meuron (non-type IGH A). Toutes les métropoles ont rêvé d’être un autre Manhattan rempli de gratte-ciel. Le skyline de New York est dynamisant comme paysage urbain. Le monde rêve d’aller à Paris qui a reçu un héritage de Georges Eugène Haussmann. Les bâtiments haussmanniens créent un paysage ayant des matériaux homogènes comme la pierre pour le corps du bâtiment et le zinc pour la toiture. Le skyline, composé de cheminées en argile de teinte orangée et quelques monuments emblématiques comme points de repère, donne un autre charme aux touristes. Luis Fernandes, architecte français, a donc imaginé Paris comme Manhattan et mélangé deux paysages différents en apportant les gratte-ciel newyorkais à Paris. Ce projet Haussmanhattan (Haussmann + Manhattan) montre étonnamment une certaine homogénéité entre les gratte-ciel newyorkais et Paris des années 1900. Cela m’évoque une question. Puisque les constructions en hauteur newyorkaises peuvent créer une homogénéité avec le vieux Paris, ce n’est pas l’aspect architectural qui pose d’abord une « ségrégation extérieure » ? Si l’urbanisme vertical avait été appliqué à Paris sans aucune distance vis à vis de l’allure architecturale, les Parisiens l’auraient accepté comme nous n’avons pas un sentiment de rejet pour les cathédrales ou clochers ? Avant tout, l’humain est visuel. L’hétérogénéité des styles architecturaux, des dimensions accentuées par la banalité formelle des tours n’est pas à négliger. Puisque la tour n’a rien hérité de l’existant et qu’elle est entourée des tissus déjà présents, elle est là comme une inconnue. Donc en réalisant la nécessité de la construction en hauteur dans la ville, je me demande si l’urbanisme vertical ne doit pas hériter de l’existant tel que le langage architectural, les matériaux, etc., afin que la ville soit plus harmonieuse et accepte l’ancien et le nouveau.




∧ — ILL. 38
Plan de rénovations urbaines
< — ILL. 39
Plan état actuel, 1965
Depuis la période d’Après-guerre, la France a commencé à reconstruire les villes comme d’autres pays européens. A partir de la fin des années 1950, sous la présidence de Charles de Gaulle, la ville de Paris a démarré des études sur la condition de vie, l’état des logements et la circulation. En premier lieu, Raymond Lopez a réalisé une enquête immobilière sur les îlots à rénover dans la capitale. Le 13e arrondissement était un agglomérat de villages artisanaux et industriels avec un habitat vétuste, délabré et insalubre. De ce fait, la grande opération de rénovation serait bénéfique. Puis, en 1959, le Centre de Documentation et d’Urbanisme de la Ville de Paris (CDU) fit la demande d’une étude à Michel Holley, sur « une inquiétude partagée par beaucoup de Parisiens »1 : « Paris peut-il s’adapter à la vie moderne sans perdre les parures accumulées tout au long de sa prestigieuse histoire ? »2 Pour cela, Michel Holley et son équipe ont voyagé dans les métropoles du monde telles que New York, Philadelphie, Milan, Moscou, Londres, Berlin et également Paris. En les étudiant, ils ont pu définir les zones de rénovation, les inconvénients de l’habitat de la ville de Paris. L’architecte a proposé le zoning vertical qui s’avéra être une des solutions pour résoudre les problèmes urbains. Le zoning horizontal, correspondant plutôt aux espaces vierges et pays neufs, est difficilement adaptable à la complexité des vieilles villes comme Paris.3 Avec le zoning vertical, Michel Holley a proposé également un principe d’horizontalité, une des particularités de Paris. Dans son concept, un ensemble de tours constitue l’horizontalité avec une même hauteur autour de 100m et une tour Signal qui marque une hauteur plus importante dans le paysage comme le clocher ou l’église ou d’autres hauteurs importantes de Paris. C’est avec le soutien du pouvoir public, la Soteru (groupement de constructeurs et de promoteurs) et l’atelier de rénovation urbaine, que Michel Holley, en tant qu’architecte en chef, a pu diriger leur réalisation en 1964 et 1965. En 1966 est créée la fédération du secteur Italie XIII ayant pour mission de veiller au respect de la convention avec les Associations Foncières Urbaines (AFU). Enfin la plus vaste opération d’urbanisme financée et conduite par les propriétaires, a commencé avec les Olympiades (l’îlot Gobelins Nord). L’opération Italie XIII qui couvre 87 hectares, soit 10% de la surface du 13e arrondissement, s’étend entre la place d’Italie et le boulevard Masséna, de l’avenue d’Italie à l’avenue d’Ivry. Avec l’objectif de doubler le nombre d’habitants de 27 000 à 60 000 puis 70 000 dans le secteur, ils ont aussi prévu de doubler le nombre de logements en détruisant 7 000 logements et en
1.
2. Ibid.
3. Ibid.
construisant 19 000 dont 3 100 HLM. En même temps que la construction des logements, les équipements publics tels que écoles, crèches, centre de protection maternelle et infantile, foyers de personnes âgées et de jeunes, centres commerciaux, bibliothèque4, ont été exigés par le plan d’urbanisme. Comme les arrivants étaient souvent de jeunes couples, les équipements scolaires étaient importants. D’après Michel Jean, le directeur de la publication de L’Écho du XIIIe, la plupart des arrivants étaient jeunes et attirés par la qualité et le confort des appartements. Ils étaient en général satisfaits même si l’ambiance des quartiers restait assez froide.5 Cependant le problème majeur fut le retard dans les chantiers des écoles. Les nouveaux quartiers privilégiaient surtout la population jeune dans son enquête : « En général l’ensemble des personnes interrogées estime que l’avenir sera plus agréable pour les jeunes et pour les femmes (sans doute en raison de l’animation commerciale et du confort) mais prévoit au contraire des conditions de vie pénibles pour les personnes âgées qui ne semblent pas avoir leur place dans ce qu’on prépare. »6 Le deuxième problème important se posait dans la démarche des AFU. Le principe de la rénovation dans le secteur Italie se basait sur la concertation entre les propriétaires et une certaine autonomie dans le processus de rénovation de leur îlot. Donc la démarche fut la suivante :
« Dans un premier temps, les AFU se constituent librement entre propriétaires d’un îlot selon le droit commun des associations. Elles étudient la restructuration de l’îlot en conformité avec le Plan d’Urbanisme de Détail, choisissent un constructeur et sollicitent leur adhésion à la Fédération du Secteur Italie qui ne donne son agrément que si les soutiens financiers du promoteur choisi sont assez solides pour tenir les divers engagements souscrits par la Fédération (équipements, relogements, etc.)
Dans un deuxième temps, lorsque 75% des propriétaires représentant 75% de la superficie en font la demande, le Préfet prend un arrêté conférant à l’association le statut d’AFU autorisé, lui donnant par là des prérogatives de puissance publique, contraignant notamment tous les propriétaires à participer ou à délaisser leurs biens ; toutes les contestations sur la valeur des immeubles étant tranchées comme en matière d’expropriation. »7
La plupart des îlots ont été rénovés par les promoteurs en donnant plusieurs choix aux propriétaires :
1. Demander le paiement en espèces et se retirer de l’opération
2. Recevoir en paiement des parts de la SCI ce qui les ferait participer vraiment à l’opération mais aussi à ses risques éventuels et surtout aux avances de fonds
4.
5.
6. Ibid.
7. Ibid.
8. Ibid.
3. Par le système de la dation en paiement, recevoir en échange de leurs biens des droits sur les futurs logements8
La majorité des propriétaires ont voulu bénéficier des droits sur leurs futurs logements. Même constat pour les commerces. Le résultat était « violent » pour la classe défavorisée. Les locataires ou sous-locataires qui n’étaient pas capables de payer des logements sociaux dans le secteur, étaient obligés de partir en banlieue, loin du centre de Paris. Les artisans étaient aussi obligés de partir ailleurs car dans le nouveau secteur, les activités artisanales n’avaient pas été envisagées. Bien que toutes les classes sociales ne soient pas prises en compte dans leur ensemble, l’Italie XIII a continué dans son élan avec l’architecture verticale. Toutefois, la situation a changé, assez rapidement, avec l’élection de Valéry Giscard d’Estaing en 1974. Il a soulevé le problème de l’urbanisme vertical qui était en train de changer l’aspect de Paris et n’était pas écologique pour lui. Il a finalement souhaité abandonner totalement la verticalité, surtout pour les tours à usage d’habitation, ce qui ne lui semblait pas cohérent. Après cette décision, le projet s’est arrêté avec la moitié des tours prévues (59 tours dont 26 seulement réalisées). La fin de l’opération Italie XIII a été décidée hâtivement en laissant des conflits dans le secteur et des questions : Aurait-il dû prendre le temps d’analyser la situation, l’impact, les problèmes sociaux, urbains, environnementaux et leurs interactions dans un urbanisme vertical ? Pourquoi le Président a-t-il interdit les tours à usage d’habitation si c’était un problème d’environnement, d’esthétique et d’échelle ? Serait-ce une réaction contre la politique de son prédécesseur, Georges Pompidou ? Était-il obligé d’abandonner à cause du contexte défavorisé (le choc pétrolier et la fin de la période des Trente glorieuses) et du fait que les promoteurs aient perdu beaucoup dans le secteur Italie et finalement préféraient construire des bureaux ? Il me paraîtrait plus logique d’interdire tous les types de constructions en hauteur s’il voulait une architecture plus écologiques et plus adaptée à l’échelle humaine. Le choix d’urbanisme vertical est lié aux besoins de la société. C’est pour cela que les deux présidents précédents avaient choisi ce type d’urbanisme même s’ils préféraient la vie dans un village ou une petite ville, plus à dimension humaine. Enfin, aujourd’hui l’Italie XIII est restée comme un témoin de l’époque et représente malgré tout une des figures de Paris.

La région parisienne, à relancer, à développer et à urbaniser à la hauteur de ses besoins.1
Charles de Gaulle, 18e Président (1959-1969)
Je ne suis pas un fanatique des tours. Il me paraît absurde d’écraser un village ou une petite ville par des tours, même de hauteur médiocre. Mais c’est un fait que l’architecture moderne de la grande ville se ramène à la tour.2
Georges Pompidou, Premier ministre (1962-1968), 19e Président (1969-1974)
Je souhaite que la construction d’immeubles de hauteur excessive destinés à l’habitat soient abandonnées sur tout le territoire français.3
Valéry Giscard d’Estaing, 20e Président (1974-1981)
Le rôle de la politique a été le plus important et influent pour l’opération Italie XIII. Durant le mandat de deux présidents, l’Italie XIII s’épanouissait, Charles de Gaulle et Georges Pompidou ont pris conscience de l’importance de l’urbanisme vertical. Ils ont cherché à résoudre plusieurs problèmes à l’époque tels que l’hygiène et le manque de logement. Pour eux, le nouveau monde a besoin d’une nouvelle manière de construire la ville, d’une nouvelle manière de vivre et d’une nouvelle architecture qui convient à la nouvelle société. Au XIXe siècle, Napoléon III qui a vécu à Londres, a éprouvé le besoin de moderniser Paris qui était insalubre, trop étroit afin d’aérer et de mieux circuler. Et Georges Eugène Haussmann sur l’ordre de Napoléon III, a changé Paris de manière « chirurgicale. » La façon de construire l’Italie XIII, le monde de demain et l’utopie verticale, ont eu une action radicale, chirurgicale et violente mais pour de « bonnes raisons. » Toutefois, Valéry Giscard d’Estaing, le président qui a pris la suite après Georges Pompidou, a décidé d’arrêter tout type de construction en hauteur y compris l’opération Italie XIII qui n’a pas été complètement achevée. Il a donné ce coup d’arrêt à l’Italie XIII avec pour justificatif, la volonté d’écouter les vœux des familles françaises et afin d’éviter des erreurs architecturales.4 En revanche, derrière cette décision il y avait un contexte que nous ne pouvons pas négliger. C’est la fin de la période des Trente Glorieuses en 1975 et le choc pétrolier en 1973. Pour l’urbanisme vertical qui coûte cher, cette crise était douloureuse. Aujourd’hui la conséquence de cette décision a mis en évidence des conflits chaotiques entre certaines tours et les tissus existants. Finalement, l’opération Italie XIII a été un instrument dépendant complètement de la politique du moment ce qui a provoqué la montée puis la chute de l’Italie XIII.
1. Michel Holley, Urbanisme vertical & autres souvenirs, Somogy, 2012, p105
2. Le Monde, Publié le 17 octobre 1972
3. Lettre de M. Valery Giscard d’Estaing à M. Jacques Chirac, Premier ministre, sur la protection de l’environnement en matière d’urbanisme, Paris, le 29
Juin 1976
4. Ibid.
L’opération Italie XIII, c’est une opération qui a été totalement financée par le privé. Pour les promoteurs, vendre des logements et rentabiliser au maximum était le plus important. Cette utopie verticale qui représente “un monde de demain” et la modernité était pour eux une stratégie marketing percutante. Les mots-clés que nous pouvons trouver fréquemment sont « demain », « rêver », « renaître », « renaissance », « nouveau », « nouveau Paris », « nouvelle société », « nouveau quartier », « nouvelle vie », « vivre mieux », « lumière », « ciel », « confort ». Afin de proposer un nouveau mode de vie dans un nouveau type d’habitat, la publicité (Voir les illustrations à la page suivante) a eu un rôle très important pour convaincre et séduire les futurs habitants. Il était donc indispensable de montrer les points forts des projets d’architecture à travers divers programmes, usages, fonctions, l’ambiance moderne, la vue sur Paris, le confort, la sécurité, l’accessibilité, le calme. De plus, la publicité a permis de mettre en évidence le problème majeur de l’époque, à Paris, au niveau de la circulation entre les automobiles et les piétons. Les images montrent le point positif, avec la distinction des espaces, pour les automobiles et ceux pour les piétons. Le choix de la couleur argent pour la plaquette publicitaire veut montrer que les futurs habitants dans le secteur Italie représentent la nouvelle société, à la pointe de la modernité. La présence du centre commercial prend aussi une place importante dans la stratégie publicitaire. La publicité convaincs que la nouvelle société peut habiter et se divertir en un même endroit sans avoir à se déplacer. En regardant ces publicités avec des couleurs très variées, il est facile de rêver et d’adhérer à une utopie même si nous savons que c’est exagéré. Toutefois, quand les habitants ont vu ces publicités, ils ont sûrement eu le désir de vivre conformément aux promesses annoncées. Mais en réalité, de nombreuses nuisances ont démenties la belle utopie. La continuation des travaux alentours ont apporté, bruits, poussières, agitations. Les équipements ont été livrés en retard, les zones végétalisées n’étant pas arrivées à maturité ont accentué les sentiments d’insatisfactions voir de souffrances des nouveaux habitants. L’Utopie verticale a donc été livrée aux habitants, avant d’avoir été finalisée. En conséquence, les promesses publicitaires pour l’Utopie verticale ont surtout amené soucis, insatisfactions, etc. Malgré une réalité très différente, la publicité pour l’Italie XIII a été assez convaincante pour faire rêver et imaginer une Utopie verticale en habitant dans un nouveau Paris tout en gardant le vieux Paris à ses pieds.

— ILL. 41 et 42 Plaquettes publicitaires, Fonds ADA 13, Centre d’archives d’architecture du XXe siècle






— ILL.43 - 57







Plaquettes de vente des appartements et plaquettes publicitaires, Fonds ADA 13, Centre d’archives d’architecture du XXe siècle
Publicité par les plaquettes publicitaires












< < — ILL. 58
Couverture du journal L’Equipe, 5 mars 1970
< — ILL. 59
Journal publicitaire distribué à l’ouverture du Stadium, septembre 1976
< < — ILL. 60
Journal publicitaire, fonds ADA13, Centre d’archives d’architecture du XXe siècle
< — ILL. 61
Journal Le Monde, 9-10 novembre 1969
< < < — ILL. 62
Journal Le Monde, 21 octobre 1971
< < — ILL. 63
Journal Le Monde, 25 mars 1971
< — ILL. 64
Journal publicitaire, fonds ADA13, Centre d’archives d’architecture du XXe siècle
Publicité par les journaux
1.
L’immigration asiatique en France s’est faite en deux périodes principales : La première pendant la période coloniale et la deuxième après la guerre du Vietnam. La France qui avait entretenu des relations avec le Vietnam du Sud, a accepté des réfugiés vietnamiens en grand nombre après leur défaite. En même temps que le Vietnam du Sud, le Laos, le Cambodge et le Myanmar ont été soumis au régime communiste. Donc beaucoup de gens opposés à ce régime politique ont quitté leur pays soit par la mer ou par la terre, pendant la période du milieu des années 1970 au milieu des années 1980. Nous les appelons les « boat people » ou « land people ». C’est à ce moment-là, qu’en France, la politique giscardienne a donné un coup d’arrêt à l’opération Italie XIII. Cet arrêt, ainsi que les pertes financières engendrées, pour la plupart des promoteurs, a défavorisé peu à peu l’Utopie verticale. Les charges élevées et l’insécurité dans les espaces communs ouverts au public, n’ont plus attiré les acquéreurs. En conséquence, beaucoup de logements restant inoccupés, ceux-ci ont permis l’installation des réfugiés asiatiques qui s’y sont installés au fur et à mesure. Ils y ont apporté leurs cultures, leur identité, appelée aujourd’hui « le plus grand Chinatown d’Europe », une des identités de Paris. Les Asiatiques regroupés dans ces logements n’ont pas perdu leur identité et ont structuré leurs quartiers, leurs activités économiques en regroupant leur population, en travaillant ensemble et en consommant des produits de leurs pays.1 Au niveau du cinéma, nous pouvons tout de suite remarquer l’importance de la population asiatique dans le secteur Italie XIII, dans le 13e arrondissement de Paris et Paris même. Par exemple on peut citer quatre films (Augustin, roi du kung-fu d’Anne Fontaine en 1999, Paris, je t’aime de Christopher Doyle en 2006, Made in China de Julien Abraham en 2019 et Les Olympiades de Jacques Audiard en 2021), illustrant bien la population asiatique dans le Chinatown du 13e arrondissement (Voir les illustrations à la page suivante). Dans ces films, plusieurs points intéressants sont présents : L’escalator dans le quartier Olympiades, les tours et les pagodes. Cela ne peut exprimer toutes les images de l’Utopie verticale de l’Italie XIII mais cela montre déjà la verticalité, l’ascension et la modernité. Grâce à ce protagonisme vertical de Paris, l’image du 13e arrondissement de Paris est devenue le Chinatown. Pour l’Italie XIII, la population asiatique a été salvatrice et régénératrice, en donnant un nouvel essor au quartier. Intéressant au niveau économique et politique, elle a favorisé davantage de logements, de commerces. De plus, le fait que la population asiatique soit
devenue l’une des images de Paris, accentue le multiculturalisme de Paris. Dans les deux premiers films (Augustin, roi du kung-fu, Paris, je t’aime), les protagonistes français sont considérés comme des étrangers dans des « paysages exotiques. » Les asiatiques se méfient de ces étrangers et il y en a qui ne peuvent pas communiquer avec eux car ils ne parlent pas le français. Dans ces scènes, est ressenti le sentiment de distance dû à la différence d’origine.
Toutefois, dans les deux films récents (Made in China, Les Olympiades) les héros (François et Émilie) sont également français mais d’origine asiatique. Ils se sont intégrés dans la société française, tout en gardant leur identité asiatique. La population asiatique dans l’Italie XIII, composée à l’origine de réfugiés asiatiques, était « étrangère » pour les français. Mais de nos jours, leurs descendants font partie des français et représentent la diversité de Paris comme Yue Pan, doctorante spécialisée en études culturelles et en cinéma. Elle a dit, « Pour le moment, nous pouvons déjà dire que le Chinatown parisien est une icône qui représente la multiculturalité de Paris. »2 Enfin, le nouveau moteur asiatique est en train de devenir peu à peu français. Cela permet non seulement d’avoir fait revivre l’Utopie verticale mais aussi d’y apporter la mixité et d’argumenter que l’urbanisme vertical peut apporter la vie sociale et peut devenir une utopie, en pratiquant la « vie moderne » (habiter, travailler, se recréer et circuler), dans la verticalité.
2. Yue Pan, Visions et représentations du quartier de Chinatown à Paris dans les films français de l’extrême contemporain?: de l’exotisme au multiculturalisme, HYBRIDA, Revue scientifique sur les hybridations culturelles et les identités migrantes, [S.l.] , n°5, p. 75-95, decembre 2022, ISSN 2660-6259
















Tour
Ensemble Galaxie
Tours avec les noms de pierre
-Tour Onyx
-Tour Jade
-Tour Rubis
-Tour Béryl

Tour en forme de périscope
Tour Super-Italie
Ensemble « égyptien »
Tours en forme pyramidale avec les noms de Pharaon
-Tour Chéops
-Tour Chéphren
-Tour Mykérinos
Tours avec les noms de villes qui ont organisé les Jeux Olympiques
-Tour Sapporo
-Tour Mexico
-Tour Athènes
-Tour Helsinki
-Tour Cortina
-Tour Tokyo
-Tour Londres
-Tour Anvers

Ensemble Masséna
Tours avec les noms de villes italiennes
-Tour Abeille
-Tour Ancône
-Tour Atlas
-Tour Bergame
-Tour Verdi
-Tour Bologne
-Tour Ferrare
-Tour Capri
-Tour Palerme
-Tour Puccini
-Tour Ravenne
-Tour Rimini
-Tour Mantoue






Dans le film High-rise, le Dr. Robert travaille dans un hôpital, il habite dans une tour d’habitation de luxe réservée exclusivement aux personnes ayant un revenu élevé. Il sort juste pour aller travailler sinon il réalise toutes sortes d’activités sans quitter le bâtiment. Sur place, Il fait les courses, pratique le sport (la musculation, la natation et le squash) et fréquente la mondanité. La même situation se déroule dans le film « Les Olympiades », à travers Emilie, jeune diplômée de Sciences Po et d’origine taïwanaise. Elle vit dans le quartier des Olympiades où se trouvent davantage de tours d’habitation. Elle travaille en tant que téléconseillère dans un bâtiment puis en tant que serveuse dans un restaurant chinois qui se trouve au niveau du rdc de la tour. Elle fait ses courses en rentrant, dans un supermarché au même niveau. Enfin, elle y rencontre ses amis et passe du temps avec eux. La vie quotidienne des héros (Dr Robert Lainget et Emilie) nous révèle comment la nouvelle société vit dans la verticalité et comment l’architecture propose des espaces qui correspondent à leurs besoins. Malgré son inachèvement, l’Italie XIII construite dans les années 1960 et 1970, pour la nouvelle société, est le fruit des efforts des architectes : construire les commodités à proximité pour un « mieux vivre », en profitant du développement de la technique. Toutefois, les temps changent et les besoins changent aussi. De nos jours, les architectes ne peuvent proposer les mêmes programmes, les mêmes habitats, les mêmes espaces qu’avant. Les enjeux de chaque époque sont différents. Par exemple, aujourd’hui avec l’hyper-individualisme et les changements climatiques, les enjeux sociaux et environnementaux sont plus importants qu’autrefois, où on favorisait les conditions de vie comme la lumière, l’air et l’hygiène. Mais chaque nouvelle ère, pour se développer, prend appui sur les bases de l’époque précédente. C’est pour cette raison qu’ouvrir une enquête sur l’Utopie verticale, 50ans après, est important, non seulement pour le secteur Italie, mais aussi pour donner une vision et une analyse d’ensemble sur l’urbanisme vertical. (Comme Auguste Perret et Le Corbusier ont appris de Manhattan et comme Raymond Lopez et Michel Holley ont amélioré des concepts de Le Corbusier.) Cette enquête se déroule en prenant en considération, des éléments importants relevés pendant mes visites dans le secteur Italie, des comparaisons entre l’état initial et l’état actuel, etc. Quelques questions pour orienter les recherches : « A quoi ressemble l’Utopie verticale aujourd’hui ? Sous quelle forme a-t-elle évoluée, s’est-elle déformée ? Comment vit-elle en symbiose avec l’existant ? Quel impact a-t-elle sur les habitants, les passants ?
« Un immeuble de cette catégorie a de quoi rassurer le profane, côté sécurité : chaque appartement est une cellule de béton, le feu ne peut passer de l’un à l’autre. Le danger ne pourrait venir que du mobilier, des fumées qui peuvent s’en dégager. Pour combattre un début d’incendie en attendant les pompiers, trois extincteurs sont disposés à chaque étage. Les couloirs ont un détecteur de fumées et des grilles d’aspirations. A l’apparition de fumées, un panneau tomberait derrière une petite grille, entre le sas d’évacuation et le couloir, en même temps qu’une trappe s’ouvrirait pour pulser de l’air sur ceux qui dévaleraient les étages. Les ascenseurs seraient bloqués. »
« Lorsqu’on vit en hauteur, son regard porte d’emblée sur le lointain de la ville, il ne s’attarde pas sur le voisinage immédiat. Au demeurant, personne n’a de rideaux pour faire respecter son intimité. Les stores, s’il s’en trouve, ont pour fonction de nous protéger du soleil ou de nous procurer la nuit noire favorable à notre sommeil. De mon sixième étage j’ai eu plaisir autrefois à observer de belles voisines, cette quête ne m’a plus requis dès que j’ai habité une tour. »
« Les vigiles sont des Noirs sportifs et de haute taille. Ils ont de tout temps chassé les jeunes, et surtout, les SDF qui prenaient la terrasse pour un lieu de détente, pour s’asseoir, bavarder et même se restaurer, au risque de laisser des papiers gras. »
« On a un sentiment de protection un peu comme quand on est, vous savez entre la mer et la montagne, on a l’impression que personne ne va pouvoir venir vous le déranger et comme moi je n’aime pas trop être dérangée enfin je suis assez sociable mais je n’aime pas qu’on s’occupe de ma life. »
« Il me rassurait que le gaz fût proscrit dans les immeubles de grande hauteur (IGH). »
« Je n’ai jamais eu froid dans ces couloirs. Les seules fois où j’y ai souffert de la chaleur, c’est durant la canicule de 2003. [...] il m’est arrivé de me demander pourquoi personne n’avait prévu la possibilité d’inverser le chauffage en système de refroidissement d’air. »
« Dans une tour, la sécurité est meilleure, et le résident se trouve déchargé de bien des soucis : si le chauffage est insuffisant, il téléphone au gardien ; s’il y a une fuite dans la façade entre les blocs de béton, des travaux sont entrepris, sans qu’il ait à prendre des rendez-vous et à examiner des devis. »
« Chaque été, j’assiste à quelques orages avec le sentiment d’être à l’abri, tout à la fois en retrait et en première ligne. L’impression de sécurité n’est pas due à la présence des paratonnerres. La vue lointaine, l’épaisseur et les dimensions des baies vitrées font que je n’ai pas l’impression de me trouver derrière une fenêtre, comme dans mon enfance. »
« En deux décennies, j’ai déploré une seule coupure, hormis de brèves interruptions nocturnes pour travaux, annoncées. »
« Quand j’ai choisi de vivre dans cette tour, la hauteur m’importait, et je trouvais intéressant d’être au-dessus d’un centre commercial et à proximité d’un nœud du métro, pour gagner du temps. »
« Ici il n’y a pas un bruit aucun de Paris. J’aime être absolument surplombante avec personne au-dessus. J’adore ça il y aurait 55e étage, je serais au 55e. »
« Depuis 50 ans, je monte plusieurs fois par jour mes six étages. Eh bien, je vous garantis que je serai bien contente d’habiter une tour et de ne pas monter à pied. »
« A sa façon, il prédisait le ratage auquel a abouti ce curieux manque de persévérance étatique, alors que le XIIIe rénové pouvait contribuer à résoudre la crise du logement, à maintenir une population nombreuse dans Paris. »
« C’est l’expérience de l’espace parce que je vis en plein ciel. Ils changent toutes les secondes, toutes les dix minutes. C’est ravissant comme architecture sans avoir l’air d’être impressionnante mais c’est extrêmement intéressant chaque maison est différente, vue d’en haut. »
« J’avais envie de me marier et partant de là, mon futur mari et moi nous avons cherché dans Paris un appartement. De tous les appartements que nous avons visités, de tous les prix qu’on a pu voir sur le journal, c’est ici que c’était le plus avantageux, le plus intéressant. »
« J’ai la nostalgie d’une époque où j’ai vu –– de loin ––qu’on introduisait du nouveau dans cette zone du XIIIe. Puis, l’innovation s’est déportée à l’est, vers la BnF, et à l’ouest, autour du parc Montsouris. Patrick Besson a formulé un sentiment assez proche du mien d’une façon qui m’a étonné : « La seule chose jolie ce sont les tours mais on n’en construit plus, on est revenu à une architecture plus humaine, donc plus moche. »
« Ces tours avaient remplacé des immeubles vétustes, dans un arrondissement qui fut longtemps le plus misérable de Paris. On avait donné au sud-est de la capitale une nouvelle identité, mais pour ce faire on avait chassé des artisans et des commerçants, des ouvriers et des personnes âgées démunies. »
« Regarder Paris sous un éclair, c’est assister à un flash qui illumine la ville pour moi. »
« J’avoue que c’est très agréable de se dire qu’a moins de cinq minutes de chez soi, on peut aller faire de la poterie du tissage ou la peinture sur soie ou d’autres choses. »
« Il y a pas mal d’étrangers ici...Moi, j’aime bien. »
« Mais voyant la hauteur des tours, la netteté de leurs façades, leur symétrie, le jeu de leur emplacement par rapport au soleil, aux voies de communication et au bâti antérieur, je crois néanmoins qu’il y a une beauté intrinsèque des tours. »
« Michel Holley a donné à la tour Antoine et Cléopâtre une forme octogonale singulière, il a su jouer de divers aspects du béton, mais ce qui me séduit vraiment dans cette bâtisse, c’est le rapport extérieur-intérieur : chaque appartement est doté d’une loggia ouverte et pourtant abritée, souvent petite et néanmoins utile et agréable. »
« Les jeunes célibataires apprécient les tours. Dans la tour Rubis qui comporte beaucoup de studettes et de studios, ils sont nombreux. Autrefois jusqu’à 21 heures, maintenant jusqu’à 22 heures, en rentrant du travail ils peuvent faire des courses au supermarché. Les amitiés de voisinage ne sont pas rares. »
« Je suis séduit toutefois quand je regarde Super-Italie, la tour ovale de Maurice Novarina –– qui fut aussi l’architecte du Périscope de Paris tout proche, dont j’aime la silhouette, le hall et le toit terrasse. »
« Le hall est en général vaste, lumineux, parfois luxueux ou beau (comme dans les immeubles Jade, Super-Italie, le Périscope). »
« Cet univers de béton, je pense que c’est supportable. Je connais beaucoup de personnes dont des spécialistes d’architecture, d’urbaniste, des sociologues qui habitent cette cité et qui sont satisfait de leur sort comme habitant. »
« Les ascenseurs ne sont pas souvent bondés. Comme partout ailleurs, nos conversations demeurent des esquisses, des politesses avec leur part de maladresse répétitive. J’ai connu quelques habitants, certains sont devenus des amis. »
« Si les parties communes sont de dimensions généreuses, il n’en est pas de même pour les couloirs des appartements, leur espace a été phagocyté par les placards, rendus indispensables par les dimensions réduites des chambres (9,36m2 en moyenne chez moi), qui limitent le mobilier. On peut déplorer la faible hauteur des plafonds (2,50m) et les surfaces partout minimales. »
« Les couloirs et les ascenseurs des tours sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant, ensuite les portes et les portes et les couloirs intérieurs sont trop étroits ; il revient alors à chacun d’adapter son lieu de vie. »
« Un inconvénient m’a étonné par intermittences lorsque j’ai commencé à habiter l’appartement de mes rêves, ce sont les sifflements qu’on entend lorsqu’il y a de fortes rafales de vent. »
« Les ascenseurs, pourtant très sûrs, focalisent réticences et phobies. »
« Il y a la ségrégation sociale. Elle se fait très doucement mais elle se fait. »
« Plus angoissante que la peur d’être soudain privé d’ascenseur, plus réelle que l’appréhension d’un dévissage, vient l’idée qu’on pourrait un jour rester captif entre deux étages. »
« Il ne vaut mieux pas se promener tout seul le soir dans les parkings. Il m’est arrivé d’avoir très peur.»
« De loin, elles formaient un bel horizon, une superbe skyline, pourtant elles représentent le degré zéro de l’architecture, toute comparaison avec les tours de New York, ou avec celles d’autres villes comme Chicago, São Paulo, Hongkong ou Shanghai, leur serait défavorable. »
« On n’a aucun contact humain, on est environnés de tours. C’est à peine si on peut reconnaître notre porte. Les gens viennent vous voir, ce sont des numéros. Nous sommes en numéros d’ailleurs. On ne connaît pas ni madame Intel, c’est plutôt numéro Intel. On ne se reconnaît pas »
« Son béton, teinte dans la masse, s’assombrit dès qu’il pleut. Il devient encore plus laid. »
« Le béton, c’est une forêt. ça donne une sensation malaise d’étouffement, d’écrasement qui est très désagréable et très oppressante. J’ai l’impression d’être comme une fourmi. »
« Déménagements et emménagements sont d’une certaine façon la hantise des résidents, parce qu’ils bloquent des heures durant un ascenseur. »
« Est-ce cher de vivre dans une tour ? Place d’Italie, les prix oscillent durant l’été 2008 entre 6000 et 7000 euros le mètre carré. Les charges sont réputées être lourdes. »
« C’est interdit de faire du vélo, de jouer au foot, faire du patin à roulette, interdit de faire tout. Le gardien quand il nous voit faire du vélo, il nous dit de descendre. Il nous dit d’arrêter de jouer, sinon il nous prend la balle. Il nous confisque nos vélos et tout. »
« Les gosses dans les ascenseurs, c’est encore un travail ils brisent tout, ils cassent tout. Les boutons, ça fait déjà deux fois qu’on remplace ces boutons. »
« Tous les services ils sont privés. On paye pour tout, la surveillance, le nettoyage, l’enlèvement des ordures. »
« On nous a promis des arbres... et il y a que trois arbres dans un bac en face d’un magasin et puis c’est tout quoi. »
« Il y a une absence d’espaces vert. C’est quand même très sec. »
Témoignages dans Vivre aux Olympiades dans le 13ème d’INA, Rencontres au sommet des Olympiades de Judith Pugliese et Intrinsèque beauté des tours d’ADA 13
Les gens font les villes et les villes font les gens.1
Jae C. Choe, Professeur à l’Université pour femmes Ewha
Les architectes, urbanistes, tous ceux qui participent à la construction d’une ville, poursuivent sûrement l’idée d’une ville idéale. En revanche tout le monde s’accorde pour dire qu’il est difficile d’imaginer une « ville utopie » dans la réalité. L’homme s’efforce de s’en approcher. Il construit une ville sans maîtriser complètement toutes les implications et interactions entre chaque élément construit. Il ne prévoit qu’une ville idéale adaptée au temps et à la population du moment comme pour Michel Holley lorsqu’il a dessiné l’Italie XIII en répondant aux problèmes de la société du XXe siècle. D’ailleurs, pendant la conférence sur l’urbanisme vertical PARIS 1954-1976 au Pavillon de l’Arsenal, celui-ci a répondu sur ce point-là :
« Vous avez répondu vous-même à la question en disant que ce n’est plus adapté aujourd’hui. Je ne suis plus le même, l’époque n’est pas la même. Ce genre de chose, je ne peux pas répondre. Je peux vous répondre sur ce que j’étais à ce moment-là et à ce que j’ai pensé mais, je vais vous dire que maintenant, non seulement je ne peux pas le savoir, mais je ne veux pas y penser. [...] Je ne peux pas y penser. J’ai pensé ça à cette époque-là, pensant et croyant que c’était la bonne. Je répète. Je ne suis plus le même. Ces temps ne sont plus les mêmes. [...] On ne peut pas répondre. Je ne peux pas répondre aujourd’hui aux questions d’aujourd’hui. »2
Un quartier ou secteur vertical comme Italie XIII qui illustre la ville du futur est représenté surtout négativement dans les films de science-fiction. Joëlle Salomon Cavin, géographe et maître d’enseignement et de recherche à l’Université de Lausanne et chercheure associée au Ladyss (CNRS), analyse les représentations négatives de la ville appelée « la ville mal aimée » ou « l’urbaphobie » d’après elle. Elle présente donc un extrait de son analyse en choisissant un film SF, Blade Runner de Ridley Scott réalisé en 1982. Ce qui est intéressant, c’est de voir quelle vision ont les gens du passé sur la ville du futur (Los Angeles en 2019). La vision sur la ville du future est la suivante : Ville négative, très technologique et polluée avec beaucoup de violences. Joëlle Salomon Cavin met en évidence dans ce film une vie quotidienne pas si différente de celle d’avant. Le héros regarde un journal sur une tablette et il attend ses nouilles dans un restaurant japonais. Ces scènes montrent qu’il y a toujours de la vie dans la ville du futur même si elle ressemble à une dystopie. La conclusion de Joëlle Salomon Cavin est : « Dans la ville du futur, on habitera toujours dans la ville, il y a des gens heureux, il y a des gens malheureux mais c’est une ville qui sera toujours vivable. »3
1. Hyunjoon Yoo, De quoi vit une ville (Titre original : 도시는무엇으로사는가), éditions Eulyoo, 2015
2. Michel Holley, Conférence L’urbanisme vertical Paris 1954-1976, Pavillon de l’Arsenal, 18 septembre 2009, https://dai.ly/xamu4j
3. Joëlle Salomon Cavin, Utopie-Dystopie : Blade Runner, Université de Lausanne, https://youtu.be/Q_WZYReXthQ
Si nous regardons maintenant la vie réelle d’Italie XIII en ayant comme question : « A quoi ressemblerait la vie dans le secteur Italie ? » Cela est basé sur des témoignages sous différentes formes de supports : un documentaire d’INA, Vivre aux Olympiades dans le 13ème, une vidéo de Judith Pugliese, Rencontres au sommet des Olympiades, une rencontre personnelle avec une association, Jardin partagé des Olympiades, enfin, une enquête d’ADA 13 (Association pour le Développement et l’Aménagement du 13e arrondissement de Paris), Intrinsèque beauté des tours. Comme Joëlle Salomon Cavin a dit, il y a des gens heureux et malheureux ce qui influe sur les avis positifs et négatifs. Nous pouvons remarquer que les gens heureux ne sont pas forcément les jeunes et les gens malheureux ne sont pas toujours les personnes âgées. Il y a bien sûr quelques besoins particuliers à prendre en compte pour les deux catégories mais habiter dans une tour dépend généralement de la personnalité de chacun. C’est-à-dire qu’aimer ou ne pas aimer habiter dans une tour, est très subjectif. D’après le résultat de sondage BVA de 2013, 62% des Français sont opposés aux tours. Ce qui veut dire que 38% des Français accepterait de vivre dans une hauteur. Cela ne veut pas dire qu’il faut construire des tours. Mais il me semble important de pouvoir proposer plusieurs choix d’habitats aux personnes puisque chacun est différent. Il y a également une certaine évolution dans l’habitat vertical dans le secteur Italie. Avant, les habitants ont souligné l’absence de la nature, le manque de vie sociale, l’insécurité, etc. Aujourd’hui, grâce à plusieurs associations syndicales, celles des habitants du quartier et plusieurs évènements, ils partagent la vie sociale et leurs différentes cultures. Désormais, des échanges naissent entre les habitants et les « étrangers » qui n’y vivent pas forcément. De plus, la végétation est arrivée à maturation. Les arbres ont grandi, les zones de verdures s’étendent de plus en plus. Enfin, la sécurité s’améliore avec l’occupation des logements des tours qui n’étaient pas tous occupés autrefois et avec la fréquentation plus importante des passants. Jane Jacobs, journaliste et auteure canado-américaine travaillant beaucoup sur la philosophie de l’architecture et de l’urbanisme, met l’accent sur trois éléments qui ont une importance certaine au niveau de la sécurité : « la distinction des domaines publics et privés, la présence des yeux dans la rue et la fréquentation. »4 En rappelant ces éléments de Jane Jacobs, Jan Gehl, architecte et urbaniste danois, rajoute dans son ouvrage, la vitalité dans les immeubles avec la présence des occupants ou les fenêtres éclairées la nuit et la transparence des façades surtout au rez-de-chaussée.5 Aujourd’hui, des espaces ouverts au public comme dans le quartier Olympiades, l’ensemble de Masséna et la tour Antoine et Cléopâtre, sont importants puisque les gens peuvent y passer pour gagner du temps, s’y reposer(ce qui n’est pas le cas pour la plupart des parcelles parisiennes qui sont privatisées). Et grâce à ces usages, leurs sécurité s’améliorent. Nous avons donc ainsi, l’assimilation du Nouveau monde dans l’existant.
4. Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities, éditions Mardaga, 1961
5. Jan Gehl, Cities for people, éditions Island Press, 2010


A New York, le skyline représentatif est celui de Manhattan avec des tours qui varient dans les hauteurs et les formes. Elles donnent un certain rythme au paysage de New York qui ne ressemble pas du tout à celui de Paris. Mais il existe un autre skyline remarquable à New York. C’est le skyline de Luna Park au Coney Island. Frederic Thomson, l’inventeur de Luna Park illustre ainsi : « un ensemble de pinacles et de tours dont la blancheur neigeuse se détache sur le bleu du ciel, et qui compose un spectacle infiniment plaisant pour des milliers de regards fatigués des briques, du mortier et des pierres de la grande ville. »1 C’est un nouveau skyline qui représente non seulement une utopie nouvelle mais aussi donne un ensemble qui reste harmonieux et s’intègre bien aux autres utopies déjà existantes, comme sur Manhattan. Mais d’un point de vue urbain, deux skyline différents permettent de rendre New York plus varié et dynamique. Hyunjoon Yoo, professeur et architecte coréen diplômé du MIT (Massachusetts Institute of Technology) puis de l’université Harvard, souligne également l’importance de skyline d’une ville : « Le skyline d’une ville est une œuvre d’art composée de divers facteurs tels que la technologie architecturale, la valeur culturelle et le contexte économique de l’époque. »2 Dans une émission de radio coréenne, il explique pourquoi aujourd’hui il est difficile de trouver une ville contemporaine qui soit « belle. »3 Il argumente clairement avec la théorie des fractales de Mandelbrot. Le principe de la théorie des fractales est que tout système, quelle que soit sa complexité, est un système avec des structures et des motifs géométriques simples, lorsqu’il est vu de loin. Si l’indice fractal est proche de 1, c’est une forme monotone alors que s’il est proche de 2, une forme complexe. Et quand l’humain trouve beau avec ses yeux, c’est environ 1,4. Hyunjoon Yoo applique cette théorie au paysage de la nature d’abord : « Quand nous voyons une forêt, nous nous sentons généralement beaux. Si vous regardez la forêt, la forme est très complexe. Mais si vous regardez ses couleurs, c’est vert et marron et les couleurs de la terre. Il y a peu de couleurs. »4 Ensuite, il l’applique également au paysage urbain en comparant le skyline de Manhattan et celui de Séoul : « Quand les matériaux et formes sont tous les deux compliqués, l’ensemble de la forme est compliqué. Toutefois, quand les matériaux et formes sont simples, l’ensemble de la forme devient trop simple comme la plupart des ensembles d’habitation en Corée. »5 Enfin, il souligne l’importance de la diversité pour la ville contemporaine qui construit généralement de la même façon (construire haut avec les mêmes matériaux :
1. Rem Koolhaas, Delirious New York, éditions Oxford University Press, 1978
2. Hyunjoon Yoo, De quoi vit une ville (Titre original :
3. Sisazaki Jeong Gwan-yong, CBS Radio, 7 octobre 2020
4. Ibid.
5. Ibid.
), éditions Eulyoo, 2015
l’acier, le béton et le verre) :
« Manhattan avec ses gratte-ciel peut, en fait, ressembler à une ville insipide par rapport à Rome ou à Paris. Mais la raison pour laquelle nous le trouvons beau, c’est parce que chaque gratte-ciel a un design légèrement différent. Donc, si vous comparez le skyline de Manhattan depuis la rivière Hudson et le skyline de Gangnam depuis la rivière Han, cela semble complètement différent, alors que c’est le même IGH avec le même ascenseur, mais la différence vient de la diversité. »6
L’utopie verticale à la française dans le 13e arrondissement de Paris s’exprime aussi dans le paysage de la capitale. Depuis la butte Montmartre et le Trocadéro (la cité de l’architecture), nous voyons ce nouveau skyline qui symbolise remarquablement un nouveau monde qui se dresse à l’horizon de Paris. C’est « un nouvel horizon » plus moderne et plus haut. Contrairement à la plupart des skyline avec des tours dans les métropolitains du monde qui expriment plutôt la diversité et la dynamique, celui du Nouveau Paris respecte l’uniformité, l’harmonie tout en héritant le caractère horizontal de Paris. D’après la théorie de Hyunjoon Yoo, le paysage de l’Italie XIII devrait être très simple et ennuyeux puisque les formes et les matériaux des tours sont plus ou moins semblables. Mais étrangement, le skyline, l’Italie XIII dans le paysage parisien, produit un effet complètement inverse. L’ensemble des tours apporte un dynamisme dans l’ensemble des lignes et formes urbaines de Paris. C’est le cas de Luna Park à New York, où un autre skyline créé finalement une diversité harmonieuse, agréable à l’œil. Pour la même raison, même si le skyline d’Italie XIII est en réalité très simple et monotone, dans le paysage de Paris, il s’intègre bien, tout en y apportant un plus. Puisque la ville est composée de structures majoritairement horizontales, à l’échelle de la ville, il est un des composants qui diversifient le paysage de la capitale française.
6. Ibid.






Après l’arrêt de l’opération Italie XIII, certaines tours sont restées délaissées, sans véritable accord avec l’existant. La tour Antoine et Cléopâtre à la pointe du triangle de Choisy est presque une tour Signal placée entre l’avenue d’Ivry et l’avenue d’Italie, à proximité de la place d’Italie. Sa forme octogonale se différencie des tours de l’ensemble de Galaxie, plutôt de formes rectangulaires, plus simples. Afin de donner une harmonie avec l’existant, deux bâtiments viennent former une sorte de connexion avec le socle de tour Antoine et Cléopâtre et souligner l’alignement avec l’avenue d’Ivry. Les liaisons, entre sa partie en retrait et ses voisins sur l’avenue d’Italie, montrent bien la cassure dû à l’inachèvement de l’opération. En continuant sur l’avenue d’Italie, nous pouvons retrouver deux autres tours d’habitation : Périscope et Super-Italie. D’abord, le Périscope se dresse au sein d’un terrain plus ou moins dégagé grâce à son vaste socle. C’est un vrai périscope, comme isolé sur Paris, qui exprime la solitude. Près de lui, une tour qui devait être accompagnée de sa jumelle, cette dernière, finalement non réalisée, donne un résultat des plus inesthétique, entourée de bâtiments moyens et bas. Son environnement minéralisé accentue la tristesse de cette tour de forme cylindrique. De cette mise à l’écart, il a sa revanche sur les petits immeubles d’habitation au nord, en leur faisant littéralement de l’ombre. Ces trois tours qui sont toutes en retrait de l’avenue d’Italie se regardent comme pour se consoler. La dernière tour abandonnée, faisant partie de l’ensemble de Renaissance, devait également voir deux autres tours. La tour « Chambord » rappelle le château de Chambord non seulement par son nom mais aussi par son aspect, exprimant la solidité grâce aux balcons filants en béton. Le jardin du Moulin de la Pointe - Paul Quilès, la petite ceinture du 13e, le square Robert Bajac et le parc Kellermann, sont les espaces verts qui entourent la tour Chambord. Cette masse de verdure adoucit l’aspect brut de ce château vertical. Finalement, la relation de ces quatre tours isolées, avec leurs bâtiments mitoyens, donnent plus de curiosité et d’inquiétude comparée aux autres tours qui sont groupées. Les tours contribuent à la création des espaces libres dans ces quartiers, convertis soit en placettes (tour Antoine et Cléopâtre, Périscope) pour les piétons, soit la future gare Maison-Blanche-Paris XIII (Super-Italie), soit la continuité de la trame verte. Toutefois, cette coexistence gênante fait percevoir l’importance du principe de l’urbanisme vertical pour que l’ancien et le nouveau soient cohérents.






Malgré l’imperfection de l’opération Italie XIII, le secteur Italie est toujours présent sans destruction. Ses quartiers verticaux qui étaient nouveaux, ne le sont plus, au fur et à mesure que d’autres nouveaux quartiers apparaissent. Depuis la fin du XXe siècle le quartier Rive Gauche a toujours des secteurs en cours de construction dans le 13e arrondissement. Quelques hauteurs plus importantes que celles d’Italie XIII, telles que la Bibliothèque nationale de France (BnF) de Dominique Perrault, les tours Duo de Jean Nouvel récemment nées, apportent leur modernité. Plus timidement, plusieurs tours d’habitation s’y présentent avec leurs plancher bas du dernier niveau (PBDN) ne dépassant pas 50m pour ne pas être classées comme un IGH à usage d’habitation. C’est une conséquence de « l’échec » de l’urbanisme vertical à Paris puisque l’on ne construit plus les IGH à usage d’habitation mais des IGH à usage de bureaux et d’hôtel. D’après le Journal du Dimanche, les Parisiens n’aiment pas les immeubles de grande hauteur quel que soit le programme : « Pourquoi les Parisiens sont-ils allergiques aux gratte-ciel? Tout le monde évoque le “traumatisme” des tours Montparnasse, du front de Seine, d’Italie 13, accusées de défigurer la ville séculaire. »1 Toutefois, bizarrement seulement les tours d’habitation n’ont plus le droit de naître. L’habitation à la verticale, est-elle l’erreur que l’on ne peut plus commettre ? L’Italie XIII qui a plus de 50ans, connaît une certaine inégalité dans ses quartiers verticaux. Leur croissance physique s’est arrêtée mais ils mûrissent différemment selon leurs espaces. Pour certains (Les Olympiades et l’ensemble de Masséna), la fréquentation des gens rappelle un des caractères de l’urbanisme vertical, « une ville dans une ville » ou « un village dans une ville ». Ils s’assimilent de plus en plus au contexte existant, en prenant de l’âge. Grâce aux espaces accessibles à tous, ils cassent petit à petit la ségrégation, avec les tissus existants, en accueillant les habitants des quartiers voisins. Cette accessibilité privilégiant les piétons, leur permet de venir et de s’attarder dans ces quartiers d’un âge moyen, non seulement pour traverser, mais aussi pour se reposer en profitant des espaces « publics », favorisant le contact avec d’autres. Jane Jacobs évoque plusieurs éléments nécessaires pour les grands ensembles isolés de la ville : « Les urbanistes doivent diagnostiquer quelles sont les conditions nécessaires qui font défaut pour générer la diversité : manque de mélanges de fonctions primaires, blocs trop grands, insuffisante mixité de bâtiments d’époques et de typologies différentes, densité de population trop faible. Puis il faut pallier les manques, le
1. Quel horizon pour Paris?, Le Journal du Dimanche, 18 janvier 2023, https://www.lejdd.fr/Societe/Tour-Triangle-La-Samaritaine-quel-horizon-pour-laville-de-Paris-703576-3034118


plus souvent en opérant de façon graduelle et pragmatique. »2 Dans le quartier Olympiades et l’ensemble de Masséna, il y a une densité de population importante avec plus de tours d’habitation. Cela permet bien sûr d’entretenir des espaces communs, moins lourds financièrement, mais aussi d’apporter la mixité sociale en proposant différentes formes de logements. Toutefois, les autres ensembles de tours ou les tours isolées qui ont une densité de population beaucoup plus faible par rapport aux précédents, sont soit non-accessibles au public (le cas de l’ensemble Galaxie, la tour Super-Italie et la tour Chambord), soit restés comme un désert urbain (le cas de l’ensemble des trois tours égyptiennes, la tour Antoine et Cléopâtre), soit resté comme un musée en valorisant son histoire, son rez-de-chaussée luxueux où l’on peut visiter comme la tour Périscope. Donc la densité de population est un premier facteur qui favorise cette inégalité dans le secteur Italie. Ensuite, parmi les quartiers verticaux où l’on peut accéder, l’ensemble des trois tours égyptiennes est le seul qui a une certaine densité. Sa dalle est bien végétalisée placée au-dessus d’un centre commercial comme pour les Olympiades. En comparaison, sur la dalle des Olympiades, nous pouvons voir plus d’espaces créant la vie à l’échelle humaine, avec des « rues », alors que celle égyptienne est plutôt une « promenade avec des espaces déserts. »3 Les commerces aux Olympiades, sont au même niveau que les rues tandis que ceux déjà quasi disparus de l’ensemble égyptien ne sont pas au même niveau que l’espace vert et sont devenus comme une muraille pour les piétons. Enfin, aux Olympiades il y a la mixité programmatique et sociale. Quelques équipements scolaires et sportifs, une aire de jeu pour les enfants, le jardin partagé sur la dalle et la présence des bureaux et l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne permettent non seulement d’apporter une mixité des usagers mais aussi une vie sociale où les échanges sont possibles. Au contraire à l’ensemble égyptien ces programmes ne se croisent pas vraiment. En conclusion, les deux ensembles des tours achevés et ouverts au public en étant tout près l’un de l’autre présentent une continuité et favorisent la fréquentation des piétons. Au contraire, ceux isolés l’un de l’autre ont du mal à entretenir une vie avec leurs quartiers voisins et sont restés très monofonctionnels comme une simple habitation à la verticale.
2.
3. Ibid.



L’Utopie vertical comme « une ville dans une ville » est constituée des composants urbains tels que la rue, la place, les habitations, etc. Ils permettent de séparer les domaines publics et privés et de créer des vides où les gens peuvent développer une vie sociale. L’Italie XIII, en ayant un principe conceptuel privilégiant les piétons, a rationnellement distingué les espaces pour les passants, de ceux pour les automobiles. Les automobiles ne circulent pas dans les espaces communs où les habitants peuvent passer du temps. D’après Hyunjoon Yoo, les objets qui se mettent en mouvement, définissent le caractère d’une rue parce qu’ils lui donnent des énergies. Et la vitesse d’un objet détermine son énergie cinétique avec la formule de l’énergie cinétique, (E=1/2mv2). Par exemple, les Champs-Élysées peuvent varier sa dominante selon la vitesse des voiries. Avec cette théorie, il crée une nouvelle formule pour mesurer « la vitesse d’un espace »1 approximativement.
Vitesse d’un espace = (Largeur de voirie x Vitesse moyenne d’automobile) + (Largeur de trottoir x Vitesse moyenne de piéton) + (Surface de terrasse(au rdc) x 1km/h) + (Surface de parking(au rdc) x 1km/h)
Surface totale
Avec ce nouveau calcul, il compare cinq rues représentatives de Séoul. Il démontre que plus la vitesse d’une rue augmente, moins les piétons la fréquentent. En même temps que la vitesse présente sur une zone, il évoque un autre facteur pour définir un espace fréquenté par les piétons. C’est la densité des événements. Il donne également une autre formule :
« Quand on suit une rue, on trouve, tout le long, les commerces et les entrées des bâtiments. Quand le piéton arrive au niveau d’un commerce, il a deux options : soit continuer son chemin, soit y entrer. [...] C’est-à-dire que si le nombre des commerces est « n », le nombre de choix que le piéton peut avoir est 2n. Le piéton peut avoir une autre expérience même s’il marche sur la même rue le lendemain. »2
Sa conclusion est la suivante : Plus la densité des événements augmente, plus le piéton a du « pouvoir », c’est-à-dire qu’il a l’initiative devant lui un large choix de déplacements possibles. Ensuite, le piéton peut expérimenter le « changement de scène » que les commerces créent. Cela donne la « possibilité de nouvelles expériences ». Finalement, cette recherche,
1. Hyunjoon Yoo, De quoi vit une ville (Titre original : 도시는무엇으로사는가), éditions Eulyoo, 2015 2. Ibid.
sur les facteurs agissant sur l’espace fréquenté par les piétons, correspond aux rues les plus fréquentées de Séoul. Si on l’applique au secteur Italie, c’est bien sûr, les Olympiades et l’ensemble de Masséna qui s’avèrent être les plus fréquentés, puisque la largeur de ces espaces piétons sont généreux et qu’il n’y a pas de voiture augmentant la vitesse d’espace, les commerces augmentent en revanche, la densité des événements. La fréquentation des piétons encourage l’accueil des événements culturels, sportifs, un marché éphémère, etc.
Au contraire, l’ensemble des trois tours égyptiennes ou la tour Antoine et Cléopâtre ont déjà une largeur beaucoup plus petite et l’absence de commerces ouverts font baisser la fréquentation des piétons. Par conséquent, aucun événement n’a lieu et ces endroits se dégradent peu à peu. Le manque de fréquentation des piétons favorise l’insécurité.
La présence des piétons est donc importante parce qu’elle assure à la fois la sécurité et l’économie du quartier. Pour l’avenir de l’Italie XIII, il faudrait développer des aménagements attirant plus l’intérêt public. Si c’est une ville dans une ville fermée et isolée comme les gated communities ou grands ensembles, cet urbanisme vertical à la française va perdre son identité. L’intention d’apporter la vie à l’échelle humaine tout en accueillant une densité de population importante, doit être ajustée, améliorée sans cesse pour fournir des services nécessaires adaptés aux besoins des habitants. La naissance de l’Italie vertical est fondée sur « la fonction », comme toutes les choses créées pour la première fois. Mais tout être vivant évolue afin de survivre dans la nature. Ce n’était que le premier essai de réalisation d’une Utopie verticale. Comme Gabriel Campanario, journaliste et illustrateur espagnol, a dit dans son ouvrage Carnets de voyage, « La ville est un mime de la nature dont elle s’efforce de copier et de dessiner la complexité. »3 , l’Utopie verticale s’efforce de devenir un modèle hybride correspondant à l’envie de l’humain d’avoir des relations sociales avec les autres et satisfaisant les besoins de la société moderne. C’est son vrai potentiel qui doit progresser.














Après l’inauguration des tours, la nature n’est pas vraiment encore là. Cette ambiance des espaces verts « délaissés » montre encore que les quartiers verticaux ne sont pas accomplis par la nature.


Les espaces verts marquent leurs dimensions généreuses. Toutefois, ils ne sont pas vraiment valorisés et aménagés. Les herbes manifestent la présence de verdure mais toutes seules sans autres types de plantes semblent aussi délaissées comme un désert urbain. Enfin, l’espace vert devant le centre commercial Italie 2 a été supprimé pour construire son extension.


Le mûrissement de la nature dans les quartiers verticaux, ça adoucit l’ambiance froide due à l’architecture moderne. Aujourd’hui les usagers y se sentent mieux. On peut venir jouer, se promener, rencontrer les gens, etc. en profitant de la nature.


L’envie d’habiter dans un environnement « plus naturel » est extériorisée par l’appropriation des sols minéraux. On les transforme en espaces verts soit un jardin d’agrément, soit un jardin partagé afin de profiter de la vue sur la nature et d’y cultiver des légumes et fruits.


































Les images avec les mots-clés (les Olympiades, Italie 13) représentent certains aspects et certaines appropriations des espaces par des usagers : Verticalité, acrobatie, acsension, chinatown, lumière colorée, exotique
L’Italie XIII d’aujourd’hui est une partie intégrante du paysage parisien. De loin, c’est un ensemble qui compose un nouveau monde et donne une véritable identité au Nouveau Paris. Toutefois, si l’on entre dans ce nouveau monde vertical, ses quartiers verticaux dispersés ont perdu souvent leur avantages conceptuels. Et le concept global pour tous les secteurs se différencie selon la dimension des îlots, la densité de population, l’accessibilité, etc. Les ensembles achevés comme les Olympiades ou Masséna, qui fonctionnent mieux que les autres, démontrent l’impact important de l’arrêt de l’opération Italie XIII. Cela a amené finalement une certaine inégalité entre eux qui se traduit à travers la fréquentation des piétons. Par conséquent, même si l’on considère les quartiers d’Italie XIII comme un ensemble, aujourd’hui l’identité de ce monde est concentrée sur un secteur, les Olympiades. Sur les réseaux sociaux, les Olympiades expriment un monde idéalisé que ses créateurs ont imaginé comme tel, même si cela est toujours imparfait. Mais à travers ce fait, il est important de souligner que cette identité a réussi à prendre une place au nom de « la modernité » dans la société. Et cette identité représente de bonnes choses plutôt que des problèmes. C’est l’arrivée des migrants asiatiques qui a relancé et donné cette nouvelle image. De plus, le public et le privé sur le quartier essayent non seulement de le développer mais d’apporter la culture et le multiculturel grâce aux divers événements. C’est une action de la génération actuelle souhaitant l’évolution du quartier vertical qui pourrait transformer l’utopie verticale en réalité. A travers plusieurs faits, nous avons vu que la politique a joué un rôle majeur à la fois pour cette opération et ses problèmes actuels. Premièrement, le fait de faire un « urbanisme ponctuel »1 avec des initiatives privées, a causé, non seulement, les dissociations entre des quartiers verticaux mais aussi les isolements et enfermements de certaines tours. Deuxièmement, la décision politique d’arrêter l’opération Italie XIII, sans avoir eu une étude approfondie sur son avenir, fait obstacle, aujourd’hui, à l’analyse correcte du principe de l’urbanisme vertical ; si celui-ci a été bon, quels sont ses problèmes conceptuels et est-ce qu’il pourrait devenir un bon modèle pour faire une ville durable, etc. Comme Michèle Tilmont a souligné l’importance du contrôle public pour la construction des immeubles de grande hauteur, il ne faudrait pas imputer, les conséquences problématiques dues aux décisions politiques, à l’urbanisme vertical. Les opposants imputent certaines erreurs à l’urbanisme vertical qui ne doivent pas se commettre à Paris. De nos jours, il y a
toujours la bataille sur la hauteur entre les conservateurs qui veulent conserver Paris tels qu’il est, et les modernistes qui veulent améliorer les conditions de vie à Paris, grâce à la hauteur qui libère des sols. Et il semble que l’IGH est toujours un instrument politique. Emmanuel Grégoire, Premier adjoint à la Mairie de Paris en charge de l’urbanisme, de l’architecture, du Grand Paris, a annoncé en 2021 : « Il n’y aura pas de proposition supplémentaire d’immeubles de grande hauteur. »2 Récemment en juin 2023, le PLU bioclimatique de Paris, qui avait été adopté après le vote du Conseil de Paris, a été annoncé par Anne Hidalgo : Ne pas dépasser le plafond de 37m, soit l’abandon de construction en hauteur. Toutefois, ils défendaient la tour Triangle en disant :
« Mais en réalité en ville, pour faire des choses dont on a besoin, il y a encore besoin d’un peu de béton. […] Ça sert à tout, notamment se loger, manger, coucher, être éduqué, etc. [...] C’est un bâtiment particulièrement vertu parce qu’il propose d’être réversible. C’est-à-dire qu’on pourra en changer l’usage. Il est particulièrement bien conçu. Il sera équipé de panneaux solaires, etc. Autre part, quand on va monter, on va éviter de construire à côté. Quand on veut faire des espaces verts, des équipements publics et l’attractivité économique, à un moment donné, faut faire des arbitrages. Et l’arbitrage, ça ne peut pas renoncer à tout. »3


— ILL. 139 et 140
Cléopâtre Hidalgo et sa tour Triangle, miss Lilou
2. Les tours à Paris, c’est fini !, Le Monde, 06 juillet 2022, https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/07/05/les-tours-a-paris-c-est-fini_6133448_3232. html
3. Tour Triangle à Paris: Emmanuel Grégoire défend le projet controversé, BFM TV, 04 novembre 2021, https://www.bfmtv.com/paris/replay-emissions/ capitale-2020/tour-triangle-a-paris-emmanuel-gregoire-defend-le-projet-controverse_VN-202111040496.html
Le PLU bioclimatique qui veut à la fois densifier pour augmenter le nombre de logements et créer des espaces verts de 300 hectares, présente une certaine contradiction. Même si l’on densifie les immeubles existants, ça ne peut pas régler les problèmes majeurs environnementaux, parce que la densité que l’on peut leur donner, a ses limites, donc ne peut être durable. Le vrai problème à Paris est de ne laisser choisir qu’une seule direction au lieu d’harmoniser plusieurs types d’urbanisme selon les contextes, les besoins, etc. Comme on peut voir via l’enquête sur l’Italie XIII, il y a plusieurs problèmes dans les quartiers dus à l’inachèvement de l’opération. Au lieu de faire évoluer les quartiers verticaux et de revaloriser leurs avantages, on les réduit et/ou les supprime en construisant de nouveaux bâtiments sur les terrains libres comme le cas des Olympiades ayant un nouveau projet de bureaux comprenant deux bâtiments, nommés Los Angeles et Melbourne, noms des villes qui ont organisés les Jeux Olympiques comme ses précédents. Depuis le commencement de l’urbanisme vertical, la société poursuit de plus en plus, la recherche du confort physique. En 2023, nous pouvons déjà remarquer plusieurs changements par rapport au début du XXIe siècle. A la maison, nous pouvons faire l’expérience du restaurant grâce à la livraison des plats ou des mealkit, du cinéma grâce à Netflix, Amazon Prime, etc. Cela concerne également l’urbanisme et l’architecture. Il faudrait que Paris s’adapte à cette nouvelle société. Comme les quatre figures de la verticalité, l’urbanisme vertical a pour objet d’offrir le confort, les services et la nature pour mieux vivre. Le but ultime est fonctionnel. Faire une ville durable et la rendre plus adaptée à chaque époque, génération, plutôt que créer une ville esthétique, moderne et puissante. Malgré l’influence de Le Corbusier, qui avait effrayé les Parisiens en montrant « Paris opéré », Michel Holley et Raymond Lopez n’ont pas dénié l’identité forte du centre historique de Paris. Nous savons que l’Utopie verticale n’a pas sa place au centre historique de Paris. C’est plutôt en faisant évoluer les périphériques tout en donnant plus de confort et de modernité. Aujourd’hui chaque individu choisit selon son goût les vidéos qu’il veut et les regarde sur YouTube. Ce système de consommation effrénée demande une infrastructure d’une complexité colossale.
Au travers, de son taux de croissance de 47%, de 2020 à 2022, il est évident que la diversité de choix améliore non seulement l’économie mais aussi offre une plus grande liberté d’action à la société. Si l’on donne plusieurs choix aux individus, chacun peut choisir ce qui lui convient le mieux. La ville devrait procéder pareillement en proposant plusieurs types d’habitats, d’espaces publiques, d’architecture, et d’usages... Mais cela veut dire qu’il faut également faire évoluer cette architecture verticale qui avait reçu comme image celle de cage à lapin, ce qui est une contre image de la diversité. Finalement, une certaine contradiction dans l’abandon de l’urbanisme vertical à Paris, limité seulement à usage d’habitation,
empêche d’apporter la diversité des choix de l’habitat. Nous avons vu le potentiel de l’Utopie verticale qui permet la vie comme d’autres type d’habitat. Ce mémoire en se focalisant sur la réalité de l’Utopie verticale, au plus près, avec ses enjeux actuels, a permis une rétrospective de l’Italie XIII sur 50ans après jusqu’à aujourd’hui. Nous avons vu ses bons côtés comme ses mauvais. Nous avons également visualisé comment l’Italie XIII a évolué physiquement en ajoutant ou supprimant des espaces libres au sol. En revanche, la difficulté de cette recherche vient de l’inachèvement de l’Utopie verticale. Comme on ne pourrait pas juger un enfant qui a commis une erreur sans connaître les circonstances, on ne pourrait pas non plus juger cette opération verticale à la française, qui était un premier essai, sans avoir ses précédents. De plus il est compliqué de dire clairement, si de tels problèmes viennent de l’urbanisme vertical, du concept lui-même ou de l’imperfection de l’opération. Les opposants vont accuser le concept, les défenseurs vont souligner plutôt les faits causés par la politique, ou par le pouvoir public. Mais il est important d’accepter la diversité, sans pencher d’un côté ou de l’autre, selon la situation et les enjeux actuels.
A moins que l’urbanisme vertical ne soit un « péché » du point de vue urbain, il faudrait accepter cette diversité qui créera l’Utopie verticale. Au cas où la verticalité perdrait ses avantages précieux, tels que la possibilité de diminuer des désordres urbains et de dégager des sols libres pour répondre aux divers enjeux sociaux et environnementaux, il pourrait devenir un bon compagnon pour la génération de la crise climatique.
A moins que Paris ne doive rester tel qu’il est en gardant les mêmes conditions, usages, espaces, architectures pour la future génération, il faudrait l’adapter à chaque génération sans détruire son cœur historique.
A moins que la hauteur ne soit pas seulement le privilège des entreprises qui ont besoin des bureaux et des symboles représentant leurs puissance économique, il faudrait poursuivre « la hauteur pour tous » et donner la possibilité d’avoir une mixité programmatique, sociale, culturelle afin de créer une vraie utopie verticale.
A moins que…
Livre
Gilles-Antoine Langlois, Une ville dans Paris: 13e arrondissement, éditions Action Artistique De Paris, 1997
Gilles Lipovetsky, L’esthétisation du monde : Vivre à l’âge du capitalisme artiste, 563 pages, éditions Gallimard, 2013
Hyunjoon Yoo, De quoi vit une ville (Titre original : 도시는 무엇으로 사는가 ), 391 pages, éditions Eulyoo, 2015
Hyunjoon Yoo, Où vivre (Titre original : 어디서살것인가 ), 380 pages, éditions Eulyoo, 2017
Ingrid Taillandier, L’invention de la tour européenne, 440 pages, éditions Picard, 2009
Jan Gehl, Cities for people, 288 pages, éditions Island Press, 2010
Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities, 433 pages, éditions Mardaga, 1961
Le Corbusier, Urbanisme, 293 pages, éditions Vincent,Freal & Cie, 1966
Le Corbusier, Quand les cathédrales étaient blanches, 325 pages, Éditions Plon, 1937
Michel Holley, Urbanisme vertical et autres souvenirs, 143 pages, éditions Somogy éditions d’art, 2012
Michèle Tilmont, Les I.G.H dans la ville, dossier sur le cas français, 310 pages, éditions CRU, 1978
Olivier Mongin, La ville des flux : L’envers et l’endroit de la mondialisation urbaine, 696 pages, éditions Fayard, 2013
Raymond Lopez, L’avenir des villes, 135 pages, éditions Construire le monde, 1964
Rem Koolhaas, Junkspace, 128 pages, éditions Quodlibet, 2001
Rem Koolhaas, Delirious New York, 320 pages, éditions Oxford University Press, 1978
Thierry Paquot, Désastres urbains : Les villes meurent aussi, 224 pages, éditions La Découverte, 2015
Thierry Paquot, La folie des hauteurs : Critique du gratte-ciel, 208 pages, éditions In Folio, 2017
Article
Alex Gulphe, « Intrinsèque beauté des tours » dans la Revue des Deux Mondes, février 2009
Didier Arnaud, Agir pour le vivant: portrait : Philippe Simay, la face vivante de l’architecture, Libération, 29 avril 2021, https://www.liberation.fr/plus/philippe-simay-la-face-vivante-de-larchitecture-20210429_4Z63FZLZJJEXJBBV5MEKVQSJRA/
Guillon Michelle, La localisation des Asiatiques en région parisienne, In: Perspectives chinoises, n°27, 1995. pp. 41-48;
Léa Muller, Avec la science-fiction, « chaque époque rêve la suivante », Chroniques d’architecture, 27 juin 2017, https://chroniques-architecture.com/science-fiction-le-cinema-de-son-epoque/
Romain Clergeat, VINCENT CALLEBAUT, ARCHITECTE VERT « Les cités du futur seront verticales et végétales », Paris Match, 23 novembre 2015, https://www.parismatch.com/Actu/Environnevment/ Les-cites-du-futur-seront-verticales-et-vegetales-Vincent-Callebaut-870027
Jin Woo Shin, Vers une nouvelle coexistence/Partie 3, « Savez-vous qui habite à côté ? », 02 août 2011, Dong-A journal, https://www.donga.com/news/Society/article/all/20110208/34642570/1
Conférence
Chris Younès, Métamorphose des lieux habités, ENSA Strasbourg, 2014
Michel Holley, L’urbanisme vertical, Paris 1954-1976, Pavillon de l’Arsenal, 2009
Vidéo
ARTE, L’avenir est-il dans les tours ?, 2022
France info, La France, seule opposante aux gratte-ciel ?, 17 novembre 2017
INA, 1978 : Vivre aux Olympiades dans le 13ème, 1978
INA, Paris 13 : une touche d’Asie dans la capitale, 2019
Judith Pugliese, Rencontres au sommet des Olympiades, 2021
Cinématographie
Ben Wheatley, High-Rise, 2016
Christopher Doyle, Paris, je t’aime - 06 - Porte de Choisy, 2006
Fritz Lang, Metropolis, 1927
Jacques Audiard, Les Olympiades, 2021
Jacques Tati, Playtime, 1967
Julien Abraham, Made in China, 2019
Bande dessinée
Jancovici Blain, Le monde sans fin, 196 pages, éditions Dargaud, 2021
Jean-Marie Busscher, Architectures de bande dessinée, éditions Institut français d’architecture, 1985
Schuiten Et Peeters, Revoir Paris, 144 pages, éditions Casterman, 2018
En ayant des réflexions sur les métropoles d’aujourd’hui qui se ressemblent de plus en plus avec les gratte-ciel, mon intérêt se porta tout naturellement sur l’urbanisme vertical et sur Paris, la seule métropole, qui résiste le mieux à l’urbanisme vertical depuis l’arrêt de l’opération Italie XIII. Ce choix de ne pas construire en hauteur, pose une question fondamentale : Comment Paris, ville horizontale, s’adapte aux enjeux environnementaux en même que à la croissance démographique et au manque des sols constructibles et libres ? Pour cela, il me paraît intéressant de revoir l’opération Italie XIII qui restait inachevée, l’ascension, la chute, et 50 ans plus tard de cette « utopie verticale. » Comme New York délire dans lequel Rem Koolhaas a évoqué Manhattan de manière rétroactive, dans « Italie XIII délire », je présente quelles formes et quels phénomènes ont été créé par le fait d’inachèvement d’Italie XIII. Malgré l’indifférence à l’Italie XIII, cette recherche permet de voir que cette opération à la verticale prend un rôle important pour les gens, en créant une vie et contribue à Paris, en étant devenue une des identités de Paris. Cependant, elle évoque également une problématique à la fois dans l’Italie XIII et la ville de Paris, due aux décisions politiques, celles-ci empêchant d’avoir une diversité d’habitat qui permettrait de ne pas étaler la ville.
Mots clés : Urbanisme vertical - Rénovation urbaine - Paris Italie XIII - I.G.H. A - Utopie verticale


