LE LIEN SOCIAL

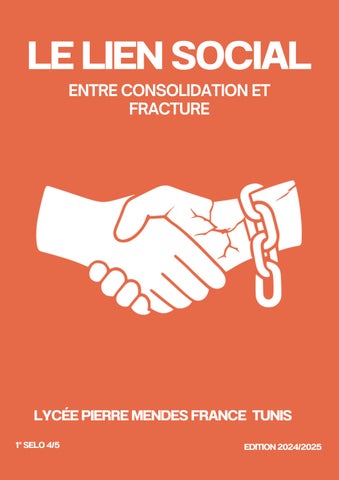

Dans le cadre de leur projet annuel d’Éducation morale et civique, les élèves de Première SELO 4 et 5 s’engagent dans un véritable travail d’équipe, une aventure collective mêlant rigueur, curiosité et esprit critique. L’objectif ? Explorer un sujet lié aux liens sociaux, en comprendre les enjeux et en restituer les résultats sous une forme originale : la réalisation d’un magazine
Un travail collectif, tout au long de l’année, a été fait autour de grandes thématiques sociales. Chaque groupe a choisi un sujet spécifique pour questionner la manière dont les liens sociaux se transforment, se fragilisent ou se reforment dans notre société actuelle Encadrés par leurs professeurs, ils ont travaillé en groupes autour de sujets variés, choisis pour leur portée humaine, sociale ou historique. Cette année, les thématiques abordées ont permis d’explorer des réalités très différentes mais toutes porteuses d’enjeux contemporains majeurs
Certains se sont penchés sur le sport, en s’intéressant notamment à la pratique du tennis et au handball féminin. D’autres ont choisi d’interroger les effets du divorce sur les relations familiales et les trajectoires individuelles Le handicap a également été abordé à travers deux angles : le handicap physique d’une part, et l’autisme d’autre part, afin de mieux comprendre les formes d’inclusion, de stigmatisation, ou de soutien mises en place dans la société. Un groupe a mené une étude de cas sur la ferme thérapeutique GAIA, un lieu d’accompagnement original qui permet à des personnes en difficulté de se reconstruire au contact de la nature, des animaux et d’un environnement bienveillant. Enfin, un autre groupe a choisi d’explorer un pan souvent méconnu de l’histoire en travaillant sur la mémoire des tirailleurs tunisiens, ces soldats coloniaux longtemps oubliés, dont la reconnaissance soulève des questions essentielles de justice, d’égalité et de mémoire collective.
Ce magazine, fruit de semaines de recherche, de réflexion et d’enquête sur le terrain, rassemble les contributions de tous les groupes, chacun apportant sa pierre à l’édifice collectif
Zoom sur Ridha Booukraa : l’art de l’enquête
Au-delà d’un sport individuel, découverte du TCT

Dans le cadre de leur projet annuel d’éducation morale et civique sur les liens sociaux, les élèves de première SELO anglais ont échangé avec Aïda Arab, journaliste et ancienne basketteuse internationale. Cette rencontre, organisée au CDI par Mme Ben Rhouma et Mme Driss avec la participation de Mme Othmani, visait à les aider à améliorer leurs articles pour la Semaine de la presse.
En premier lieu, Aïda Arab a partagé son expérience et donné des conseils clés sur le journalisme et la presse : vérifier ses sources, structurer ses articles et choisir un titre accrocheur (qu’il soit informatif ou incitatif).

Ses acquis sur la presse sportive ont également aidé les élèves dont les projets portaient sur le sport (le tennis ou le handball) à mieux cerner leur sujet.
Les élèves ont pu poser des questions sur la fiabilité des sources et les défis du métier. Elle a aussi évoqué son parcours et ses débuts dans la presse écrite et audiovisuelle, ainsi que les difficultés du journalisme sportif, notamment pour une femme. Cet échange a permis aux élèves d’affiner leur travail et de mieux comprendre les exigences du journalisme
Elle a expliqué la règle de la triptyque (informer, éduquer, distraire) et l’importance des statistiques et témoignages pour étayer un article. D’après elle :
« Les statistiques ne mentent pas ! »

Un grand merci à Aïda Arab pour ses précieux conseils et à Mme Ben Rhouma, Mme Driss et Mme Othmani pour l’organisation de cette rencontre !
Khalil ZAIER

Les élèves de première SELO 4 et 5 ont eu l'honneur d'accueillir M. Boukraa, professeur de sociologie à l'université, venu partager son expertise sur un aspect essentiel du travail sociologique : l'enquête de terrain
Pendant près d’une heure, il a captivé son auditoire en présentant les différentes étapes qui jalonnent une enquête sociologique. De la définition du sujet à l’analyse des données, en passant par la construction du questionnaire ainsi que la prise de contact avec les enquêtés Il a pu aborder avec eux toutes les étapes de l’enquête sur terrain.


Cours de sociologie à PMF mené par M Ridha Boukraa, professeur de sociologie à l’université
lI a insisté sur l’importance de bien définir son sujet d’étude, de garder une posture neutre et bienveillante face aux personnes interrogées, et surtout de toujours remettre en question ses propres représentations, tout en soulignant le rôle essentiel de l'observation et de l’écoute active.
Loin d’un exposé théorique, l’intervention de M. Boukraa s’est appuyée sur des exemples tirés de ses propres recherches de terrain. Il a raconté avec humour certaines situations inattendues vécues lors d’entretiens, soulignant ainsi la part d’imprévu inhérente à ce type de démarche. Il a également donné aux élèves une série d’astuces pratiques pour réussir leurs enquêtes : comment instaurer un climat de confiance avec les enquêtés, quelles questions éviter, ou encore comment prendre des notes efficacement sans perdre le fil de l’entretien. Les élèves, très attentifs, ont pu poser de nombreuses questions sur la méthodologie, les outils utilisés, mais aussi sur le métier de sociologue en général. Beaucoup ont découvert une facette concrète et vivante de la sociologie, bien différente de l’image parfois abstraite qu’ils en avaient.
Cette rencontre a permis aux élèves de mieux comprendre les enjeux du travail sociologique et de se projeter concrètement dans la réalisation de leurs propres enquêtes Un moment stimulant qui a suscité de nombreuses questions et un vif intérêt parmi les participants.
Longtemps perçu comme un sport individuel et élitiste, le tennis révèle aujourd’hui une toute autre facette : celle d’un puissant vecteur de lien social. Entre camaraderie sur les courts et solidarité en dehors, comment ce sport tisse-t-il des relations durables entre ses pratiquants ? Enquête au cœur des clubs.
Le tennis n’est pas seulement une affaire de raquettes et de balles jaunes. Dans les clubs, il devient un véritable lieu de vie. « Dans mon club, l’ambiance est incroyable. Même si c’est un sport individuel, on se soutient tous. On est connectés » , témoigne une jeune joueuse. Loin de l’image froide des compétitions de haut niveau, les clubs locaux sont des foyers d’échange et de convivialité, où les liens se créent à travers les entraînements, les matchs amicaux et les événements collectifs.
Les jeux en double, par exemple, nécessitent coordination, confiance et communication. Jouer à deux n’est pas qu’une stratégie sportive : c’est aussi un moyen de renforcer la complicité entre partenaires. « On choisit notre partenaire souvent en fonction du lien qu’on partage. C’est une forme de prolongement de l’amitié sur le terrain » , explique une autre pratiquante.


Participer à des tournois interclubs ou internationaux, c’est aussi élargir son réseau social. « Grâce aux tournois ITF, j’ai rencontré des joueurs du monde entier. Ça m’a ouvert l’esprit et permis de créer des liens avec des personnes très différentes de moi » , raconte une jeune compétitrice tunisienne. Le tennis devient alors un pont entre les cultures, un moyen d’intégration et d’ouverture sur l’autre. En Tunisie, le tennis connaît un essor important : de plus en plus de jeunes s’y investissent, encouragés par les clubs.

Tennis Club de Tunis
De plus en plus de jeunes s’y investissent, encouragés par les clubs qui multiplient les événements inclusifs. Le sport devient ainsi un outil puissant de cohésion sociale, surtout dans une société en quête de repères collectifs

Le respect de l’adversaire, le fair-play et la discipline ne sont pas que des mots dans le tennis. Ce sont des piliers relationnels. En amateur, où l’on arbitre souvent soi-même ses matchs, l’honnêteté devient essentielle. Ces valeurs favorisent la confiance entre joueurs, même lorsqu’ils ne se connaissent pas.
Par ailleurs, le tennis encourage naturellement l’échange de savoirs : conseils techniques, astuces de jeu, ou simples encouragements. Ces interactions, si fréquentes dans les clubs, permettent de créer une véritable communauté autour de la passion commune du tennis
Entre compétition, isolement et élitisme

Mais tout n’est pas toujours rose sur les courts Certains regrettent que l’esprit de compétition prenne parfois le pas sur la convivialité « Certains joueurs viennent uniquement pour écraser les autres. Ce côté malsain casse un peu l’ambiance » , confie un licencié. Dans les tournois officiels, la pression peut créer des tensions, nuisant aux relations entre joueurs.
D’autres freins sont d’ordre économique. Cotisations, matériel, coaching : le tennis peut apparaître comme un sport élitiste, peu accessible aux milieux modestes. Ce fossé social empêche parfois l’intégration de nouveaux membres et limite la mixité.
Pour surmonter ces limites, de nombreux clubs multiplient les initiatives : tournois mixtes, soirées conviviales, journées portes ouvertes, cours collectifs tous niveaux. Ces formats favorisent les échanges et l’intégration des nouveaux venus.
D’autres vont plus loin, en nouant des partenariats avec des associations pour proposer des tarifs réduits ou des initiations gratuites. Objectif : faire du tennis un sport plus inclusif, où chacun, quel que soit son milieu, peut s’épanouir et tisser des liens.



Des matchs en double qui soudent plus que n’importe quel message sur une application. Des entraînements où naissent des amitiés sincères. Le sport, en particulier le tennis, dépasse aujourd'hui la simple performance : il devient un véritable outil de cohésion sociale.
Fondé en 1923, le TCT est devenu au fil des décennies un carrefour générationnel Ici, les joueurs ne viennent pas seulement échanger des balles, mais aussi des sourires, des discussions, des valeurs Entre les entraînements, les tournois internes et les moments de détente à la cafétéria du club, les liens se renforcent. Du plus jeune adolescent qui débute à l’adulte passionné, jusqu’au retraité fidèle au poste, toutes les générations coexistent et interagissent Cette diversité contribue à créer une communauté soudée, où les différences d'âge, de parcours ou de niveaux ne sont pas des barrières, mais des richesses.
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le tennis n’est pas un sport si solitaire. Chaque échange sur le court implique écoute, respect et entraide, même entre adversaires. Loin des relations éphémères des réseaux sociaux, les liens qui se tissent au TCT sont concrets, durables, et souvent inattendus. Une rencontre sportive peut se poursuivre bien au-delà du filet. Et tout cela, sans algorithme. Juste une raquette, des balles et l’envie de partager. Au TCT, certains viennent pour jouer, et repartent avec bien plus : une bande d’amis, un mentor, ou même un partenaire de vie Parce qu’ici les connexions sont vraies, simples et humaines Sur les courts comme dans la vie, c’est souvent là que tout commence.
Ça match vraiment
Inès LUCIANI & Inès CHIHAOUI
Le sport collectif, au-delà de la performance, est un véritable laboratoire social où se construisent et parfois se défont des relations humaines. L’équipe nationale cadette de handball tunisienne en est un exemple frappant. Entre solidarité et rivalités, partons à la découverte de ce monde.
Comme toute équipe sportive, la sélection cadette est animée par un but précis : progresser ensemble pour remporter des compétitions et représenter fièrement la Tunisie à l’international. Cette ambition commune pousse les joueuses à coopérer et à s’entraider, renforçant ainsi leur cohésion

Les entraînements, stages et déplacements créent aussi des moments de partage essentiels Ces instants hors du terrain permettent de forger des amitiés et d’instaurer un esprit d’équipe L’encadrement joue un rôle clé dans ce processus : un coach bienveillant, qui valorise la communication et l’égalité entre les joueuses, favorise un climat de confiance et de respect mutuel.
De plus, les défis auxquels l’équipe est confrontée, qu’il s’agisse de défaites, de blessures ou de pression, agissent comme un ciment social. Se soutenir dans l’adversité renforce le sentiment d’appartenance et soude le groupe. La diversité des joueuses, venues de différentes régions du pays, constitue également un atout : leurs expériences variées enrichissent les interactions et favorisent une meilleure compréhension mutuelle.

Cependant, cette harmonie est parfois mise à rude épreuve. La compétition interne, notamment pour décrocher une place de titulaire, peut créer des tensions. Si certaines joueuses se sentent mises à l’écart, des rivalités peuvent émerger et nuire à la cohésion du groupe.
Un autre facteur de division est le manque de communication. Des incompréhensions ou un déficit d’écoute dans un contexte de forte pression peuvent rapidement dégénérer en conflits. De plus, un encadrement jugé injuste ou autoritaire peut créer un sentiment de frustration et accentuer les divisions.
Enfin, la gestion des échecs joue un rôle clé Si les défaites ou les conflits internes sont mal abordés, certaines joueuses peuvent se sentir abandonnées ou injustement pointées du doigt, ce qui fragilise l’esprit collectif De même, un manque de vision commune peut diviser le groupe en sous-ensembles qui fonctionnent indépendamment, au détriment du collectif
à préserver pour une réussite de l’équipe
L’équipe nationale cadette de handball tunisienne, comme toute équipe sportive, doit trouver un équilibre entre compétitivité et esprit de groupe Pour cela, il est essentiel de maintenir une communication saine, un leadership juste et une gestion des conflits efficace. L’enjeu est de taille : un collectif soudé ne se construit pas uniquement sur la victoire, mais aussi sur la capacité à faire face ensemble aux défis Car si le handball est un sport d’équipe, c’est surtout un sport où le lien humain est au cœur de la réussite


L’équipe nationale cadette tunisienne de handball
Dans l’univers exigeant du sport de haut niveau, la performance collective ne se résume pas à l’addition de talents individuels. Elle repose avant tout sur des liens humains profonds, patiemment tissés à travers l’entraînement, les épreuves et la vie de groupe. Au sein de l’équipe nationale tunisienne de handball, ces liens sont la clé de la réussite, transformant un groupe de joueuses en une véritable famille
Les relations entre les joueuses ne naissent pas uniquement des exploits réalisés sur le terrain Si les entraînements et les matchs jouent un rôle majeur, ce sont souvent les moments informels qui forgent l’unité du groupe Les repas partagés après l’effort, les discussions animées dans les vestiaires, les voyages vers les lieux de compétition ou les soirées passées ensemble renforcent la complicité À mesure que les semaines passent, les coéquipières apprennent à se connaître audelà du maillot, découvrant les personnalités, les forces, les faiblesses et les sensibilités de chacune
L’accueil des nouvelles joueuses est un aspect central de la dynamique d’équipe. Dès leur arrivée, un effort collectif est déployé pour qu’elles se sentent à l’aise et intégrées. Les plus anciennes prennent soin de les guider dans les routines, de les inclure dans les discussions et de les inviter aux moments informels qui tissent les premiers liens. Cette bienveillance facilite l’adaptation des nouvelles recrues, leur permet de trouver rapidement leur place et contribue à maintenir un climat serein.

Comme dans toute grande équipe, les rituels jouent un rôle essentiel dans la construction de l’identité collective. À la veille des matchs, les joueuses entonnent une chanson commune dans le vestiaire, symbole d’unité et d’énergie partagée. Après les victoires, un cri collectif ou des gestes spécifiques viennent sceller la célébration. Ces traditions, simples en apparence, nourrissent le sentiment d’appartenance et rappellent à chacune qu’elle fait partie d’un groupe soudé.

Sur le terrain, la communication entre les joueuses est indispensable Elle permet de coordonner les efforts, de signaler les changements tactiques, de motiver après une erreur ou de maintenir la cohésion en situation difficile. Lors d’un des match disputé contre le Kosovo dans le cadre des jeux méditerranéens 2025, c’est justement en augmentant la communication défensive que notre équipe tunisienne a pu renverser la situation et remporter la victoire. Mais cette communication ne s’arrête pas aux frontières du terrain. En dehors des matchs, elle permet de désamorcer les tensions, de partager les ressentis et d’éviter que de petits malentendus ne se transforment en conflits durables.
Ce qui distingue l’équipe nationale tunisienne de handball d’un simple partenariat sportif, c’est l’intensité des émotions partagées. Ensemble, les joueuses traversent des moments de joie, de frustration, de doute, de dépassement de soi. Elles affrontent les blessures, les échecs, les victoires, et apprennent à se relever côte à côte. Avec le temps, cette accumulation d’expériences forge une confiance mutuelle rare, une amitié qui dépasse le cadre strict du sport.
Certains comportements peuvent menacer l’équilibre du groupe. Le manque de communication, l’individualisme, les jalousies autour des sélections ou des responsabilités, ou encore les critiques excessives peuvent éroder la confiance collective. Il est donc fondamental de cultiver l’écoute, la solidarité et le respect mutuel pour préserver la force de l’équipe.
La présence d’une compétition interne est inévitable à ce niveau d’excellence. Chacune souhaite gagner sa place, prouver sa valeur, être titularisée. Cependant, au sein de l’équipe nationale tunisienne, cette rivalité reste saine : elle pousse à l’amélioration individuelle tout en restant au service du collectif. L’objectif ultime reste toujours commun : faire briller l’équipe et non simplement briller pour soi.
La vie collective, même dans un cadre professionnel, n’est pas exempte de tensions Les principales sources de conflit résident dans la répartition du temps de jeu, les incompréhensions tactiques ou les différences de caractère. Lorsque ces tensions apparaissent, l’essentiel est de les désamorcer rapidement. Les joueuses expérimentées, tout comme le staff, ont un rôle clé pour apaiser les conflits, favoriser le dialogue et maintenir la cohésion.


La Tunisie, pionnière dans le monde arabe en matière de droits des femmes, a instauré un cadre juridique relativement progressiste pour le divorce, notamment grâce au Code du statut personnel.
Cependant, la réalité sociale reste complexe. Selon l'Institut national de la statistique (INS), le nombre de divorces a connu une augmentation significative ces dernières années, passant de 13 867 en 2013 à 17 306 en 2019.
Cette hausse s'explique en partie par l'évolution des mentalités et l'émancipation des femmes, qui n'hésitent plus à recourir au divorce en cas de difficultés conjugales. Toutefois, des disparités persistent, notamment en milieu rural, où les traditions patriarcales peuvent entraver l'accès des femmes à leurs droits. Par ailleurs, les procédures de divorce peuvent être longues et coûteuses, ce qui constitue un obstacle pour les femmes les plus vulnérables. Des associations comme l'Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) œuvrent pour sensibiliser les femmes à leurs droits et leur offrir un soutien juridique et psychologique.

Le divorce, loin d'être un simple acte juridique, est un processus complexe qui bouleverse l'équilibre familial. Ses effets ont un impact sur tous les membres de la famille, en particulier les enfants, qui peuvent être confrontés à des troubles émotionnels et comportementaux. Les conflits entre les parents, souvent aggravés par la séparation, peuvent créer un climat d'instabilité et d'insécurité pour les enfants En Tunisie, des études ont montré que les enfants de parents divorcés peuvent présenter un risque accru de difficultés scolaires et d'adaptation sociale

Le regard porté sur les femmes divorcées est souvent empreint de préjugés. Elles peuvent être perçues comme des femmes "brisées", "responsables" de l'échec de leur mariage, ou même comme des "proies faciles". Souvent, le divorce féminin est encore tabou et peut entraîner l'isolement social, le rejet familial et des difficultés économiques accrues. Cependant, les mentalités évoluent lentement et de plus en plus de voix s'élèvent pour défendre les droits et la dignité des femmes divorcées, reconnaissant que le divorce est une réalité complexe qui ne saurait être réduite à un jugement moral.
Sarah BENNEJI
Le divorce en Tunisie connaît une hausse inquiétante, bouleversant non seulement la structure familiale mais aussi l'équilibre social. Une augmentation qui soulève des interrogations sur les causes profondes de cette tendance et ses effets dévastateurs, en particulier sur les enfants.

Les répercussions du divorce ne s'arrêtent pas aux époux. Selon des études récentes, le nombre d'enfants touchés par la séparation parentale a atteint 600.000 en Tunisie entre janvier 2023 et décembre 2024. Plus alarmant encore, 104 d'entre eux se sont suicidés, victimes du mal-être engendré par la désunion familiale.
« Beaucoup de pères abandonnent ou négligent leurs enfants après le divorce, ce qui constitue une catastrophe pour leur santé mentale » , alerte Rawene Ben Regaya, juge chercheuse au Centre d'études juridiques et judiciaires du ministère de la Justice.
Les conséquences se manifestent dès l'enfance : anxiété, stress, sentiment d'abandon et troubles comportementaux.
Les recherches montrent également une baisse du rendement scolaire et des difficultés d'adaptation psychologique et sociale. À long terme ces enfants risquent un bien-être altéré, un statut socioéconomique plus faible et des relations distendues avec leurs parents, notamment avec leur père.
de plus en plus précipités ?

Face à cette crise du couple et de la parentalité, plusieurs structures tentent de limiter les dégâts. L'hôpital Razi et les centres de soutien psychologique accompagnent les enfants et les adultes en détresse. Des associations comme Amal pour la famille et l'enfant et l'Association Tunisienne de Défense des Droits de l'Enfant (ATDDE) œuvrent pour protéger les enfants abandonnés ou en rupture familiale Les experts plaident pour un encadrement plus strict du mariage et du divorce, ainsi qu'une sensibilisation accrue aux conséquences de la séparation sur les enfants Car au-delà de la sphère privée, c'est toute la société qui subit les répercussions de cette fragilisation du noyau familial.
Qu'est-ce qui pousse de plus en plus de couples tunisiens à se séparer ? Pour Slaheddine Ben Fradi, professeur en sociologie, la réponse réside en partie dans un manque de préparation à la vie conjugale. «Beaucoup de jeunes se marient sans être prêts aux réalités de la vie de couple. Très vite, ils sont rattrapés par des désillusions liées aux comportements du partenaire ou de sa famille», explique-t-il.
D'autres facteurs aggravent cette situation : difficultés économiques, changements de mentalité, poids des réseaux sociaux et montée de l'individualisme. Autant de raisons qui font vaciller le modèle familial traditionnel.
Le divorce est parfois une solution nécessaire pour éviter des situations de violence conjugale ou de maltraitance. Mais son augmentation rapide et ses conséquences sur les générations futures inquiètent les spécialistes.
« Faut-il renforcer l'éducation au mariage, multiplier les aides psychologiques, encourager le dialogue avant la séparation ? »
Autant de questions qui méritent des réponses urgentes, car l'avenir de milliers d'enfants est en jeu.
Syrine KHEMIR
Le divorce n’est plus un tabou en Tunisie, mais il reste un bouleversement qui demande du soutien. Le défi aujourd’hui n’est pas tant d’empêcher les séparations, mais d’assurer que celles-ci se déroulent dans les meilleures conditions possibles, pour les parents comme pour les enfants.
Face aux défis sociaux et économiques causé par le divorce, la société civile s'avère être un pilier de soutien Des associations comme l'Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD) mènent des actions concrètes à travers leurs quatre centres de conseils juridiques et d'écoute. En 2023, l'ATFD a rapporté avoir traité plus de 1200 cas liés au divorce, précisément une assistance juridique à environ 800 femmes pour la défense de leurs droits en matière de pension alimentaire et de garde d'enfants.
L'Union Nationale des Femmes Tunisiennes (UNFT), organise également des sessions de formation pour les femmes divorcées, afin de faciliter leur autonomie économique.

Bien que les chiffres d'impact de ces initiatives locales soient souvent imprécis, leur rôle dans la création de liens sociaux et la réduction de l'isolement est indéniable.
Toutefois, la recomposition familiale peut représenter une opportunité d’épanouissement. En reconstruisant de nouvelles dynamiques familiales, les enfants peuvent bénéficier d’un cadre stable. Les parents, quant à eux, trouvent parfois un nouvel équilibre dans ces structures recomposées, leur permettant de mieux exercer leur rôle éducatif et affectif. Cependant, la recomposition familiale peut aussi être source de conflits. L’acceptation d’un nouveau beauparent, la gestion des relations avec l’autre parent biologique et l’adaptation à une nouvelle organisation du quotidien ne sont pas toujours faciles. L’important reste la mise en place d’un environnement bienveillant et d’un dialogue constant entre les différentes parties impliquées.
Eya RMILI & Emna KAMOUN
Alors que l’autisme en Tunisie continue d'être un défi majeur, la place donnée aux centres spécialisés interroge : facilitent-ils l’intégration sociale et professionnelle des personnes autistes, ou sont-ils insuffisants considérant le manque de considération de l'État ? Ainsi, il est légitime de se demander si ces institutions permettent réellement de consolider les liens sociaux, trop souvent brisés par la singularité de ce handicap.
d’une marginalisation sociale profonde
L’autisme, ou TSA (Troubles du Spectre de l’Autisme), est un handicap mental qui touche plus de 6 personnes sur 100 en Tunisie. D'origine neurologique, l’autisme se caractérise par une altération de la communication socio-émotionnelle, une sensibilité sensorielle accrue et des difficultés à s’exprimer.

Ces symptômes entraînent souvent la marginalisation des personnes atteintes qui rencontrent en effet beaucoup de difficultés pour communiquer avec le monde extérieur. Isolées et exclues de la société, ces personnes se trouvent donc dans l’incapacité d’exercer un métier stable comme le reste de la société. D'où l'importance de fournir à ces personnes des opportunités professionnelles adaptées afin qu’elles puissent à leur tour se sentir acceptées comme partie intégrante de la société.

D’après l’article 48 de la constitution tunisienne : il incombe à l'Etat de prendre les mesures nécessaires pour garantir à tout individu handicapé une pleine intégration dans la société. De plus, l'enseignement est un droit fondamental garanti par la constitution tunisienne. Toutefois, malgré la présence de tels principes, certains enfants en sont toujours exclus : ce sont les enfants touchés par le trouble de l’autisme. Ainsi, malgré la prévalence d’un tel handicap, ceux-ci n’ont toujours pas accès à l’éducation publique et donc à l’emploi. Par conséquent, afin de pallier au manque d’engagement étatique, de nombreuses initiatives privées ont vu le jour : centres spécialisés, associations, et école privées adaptées n’en sont que des exemples. Bien qu’étant un premier pas nécessaire vers l’intégration de ces enfants, l’efficacité de ces centres spécialisés privés reste modérée En outre, leur coût très élevé les rend accessible à une minorité infime de la population Il en résulte donc une forte marginalisation des personnes atteintes d’autisme, surtout dans les classes sociales les moins favorisées de la société tunisienne.



LE CENTRE HALIM PRO les centres spécialisés garantissent-ils une intégration durable ?
Créé dans l’objectif d’intégrer les personnes atteintes de TSA dans le marché du travail, le Centre Halim Pro possède une approche innovante basée sur des “mini-projets” Les membres du Centre peuvent ainsi se spécialiser dans des domaines comme la restauration ou la décoration. Bien que le centre présente une approche individualisée visant à répondre aux besoins de chaque élève, la réussite d’une telle initiative reste à nuancer. Ainsi, de nombreux obstacles enracinés dans la société tunisienne subsistent. En outre, la bonne volonté d’une telle initiative doit nécessairement se heurter au marché du travail et au secteur privé luimême. La volonté d’accueillir des personnes atteintes d’autisme manque en effet chez la plupart des entreprises privées. Par conséquent, il est nécessaire de coordonner l’action de tels centres avec celle d’entreprises privées afin de pouvoir fournir un emploi extérieur au centre une fois la formation terminée.
Sarah LAYOUNI & Yasmin CHAOUCH
« Je pense que tout parent espère avoir une certaine garantie sur l’avenir de son enfant. »
Mère de trois enfants, dont un adolescent atteint de troubles du spectre de l’autisme (TSA), elle nous livre un témoignage sincère sur les difficultés qu’elle rencontre au quotidien, ainsi que sur les obstacles liés à la prise en charge de son fils en Tunisie.
Pouvez-vous nous parler un peu de votre enfant et de votre parcours depuis le diagnostic ?
“Je suis mère de deux enfants Mon fils aîné a 15 ans. Il est autiste, diagnostiqué tout petit à l'âge de 3 ans Pendant longtemps j’ai pensé que sa situation allait s’améliorer comme avec certains enfants qui avec le temps apprennent à s’exprimer et trouvent un certain équilibre social. Mais aujourd’hui c’est vrai que notre quotidien n’est pas facile. Mon fils a toujours beaucoup de mal à parler et sa situation ne s’est pas forcément améliorée. Il s’exprime certes et j’arrive à le comprendre vu que je suis sa mère mais c'est vrai que c’est très difficile pour quelqu'un qui ne le connaît pas de le comprendre.”
Quel a été l’impact du diagnostic sur votre quotidien ?
“Mon fils a été diagnostiqué très jeune donc je ne peux pas vraiment mesurer l’impact de ce diagnostic sur mon quotidien. C’est lui mon quotidien. Il est mon fils aîné, et cela, qu'il soit autiste ou pas. Mais il est vrai que notre vie, en la comparant à celle d’autres familles, est assez différente. Quand j’ai appris que mon fils était autiste, j’ai dû petit à petit abandonner ma carrière professionnelle pour pouvoir m’occuper de lui. Aujourd’hui, je me consacre beaucoup à lui parce que, contrairement aux autres enfants, il est très dépendant de moi.”

Et concernant l'insertion sociale ou scolaire ?
“J’imagine que tout parent ayant un enfant a envie d’avoir une certaine garantie par rapport à l’avenir de son fils : savoir que celui-ci pourra un jour voler de ses propres ailes, fonder une famille ou juste parfois avoir un travail qui lui permet de vivre par ses propres moyens. C’est là ou j’ai dû petit à petit me résigner à l’idée que ca ne sera probablement pas le cas de mon fils. Aujourd'hui on est chanceux. J’aime mon fils et j'ai ma famille pour me soutenir. Mais c'est vrai que sans ce soutien je sais que mon fils aura beaucoup de mal à s'intégrer dans la société ”

Le complexe psycho-éducatif et social de Sidi Hassine (Tunisie) qui a ouvert ses portes en 2022
Quelle a été votre expérience avec les centres spécialisés ?
“Notre expérience avec les centres spécialisés a été assez mitigée. Au départ, quand mon fils était jeune, on l’avait inscrit dans un centre privé, un peu comme une école, où il pouvait faire plusieurs activités comme la natation. Mais on a vite remarqué que quelque chose clochait et que ce centre ne l’aidait pas à se sentir mieux. C’est pourquoi on a dû changer plusieurs fois de centre avant de pouvoir trouver son centre actuel.
Aujourd’hui, notre fils est dans un nouveau centre où les enfants, comme les jeunes adultes, peuvent réaliser de petites tâches comme la pâtisserie, la boulangerie ou même la création de bijoux Pour l’instant, nous sommes assez satisfaits Mais nous savons qu’une intégration totale dans le domaine du travail reste difficile. C’est pourquoi ce centre reste un bon investissement pour le moment, car il permet à notre fils de réaliser des activités et d’avoir un certain équilibre ”

Dans le cadre d’un projet en éducation morale et civique, les élèves de la SELO en 1e4 et 5 encadrés par les enseignantes Mmes Driss et Ben Rhouma ont fait la visite de GAIA, une ferme thérapeutique pour handicapés située à Sidi Thabet
Gaïa, Ferme Thérapeutique de jour, est une association créée en 2007 dont la mission est l’insertion socioprofessionnelle de Personnes en Situation de Handicap (PSH), issues pour la majorité de familles nécessiteuses
C’est dans cette perspective que les élèves de notre établissement ont passé la journée du 11 février à leurs côtés.

Plaque à l’entrée du centre présentant les partenaires dans la création de ce projet
La ferme accueille des PSH de divers âges (de 3 ans jusqu’à 30 ans). Ils se réunirent dans une grande salle pour avec nos élèves, pour partager un petit déjeuner collectif Par la suite, vint l’heure des activités : peinture, football, équitation et jardinage Par groupes de six, nos élèves y participèrent tour à tour grâce à un système de rotation À chaque activité, ils étaient accompagnés des PSH, qui s’y épanouissaient particulièrement ainsi que des éducateurs.
Visite des lieux après le déjeuner
Après le déjeuner, les PSH, filles et garçons de différents niveaux, se réunirent pour présenter à nos élèves des chansons et des danses qu’ils avaient préparées avec leur professeur de musique. Et c’est sur cette belle note que la journée toucha à sa fin. Une journée remplie d’émotion, tant pour nos élèves que pour les enfants de GAIA !
Sarah BENNEJI


Malgré la ratification de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées, la Tunisie peine à garantir une inclusion réelle. Sur environ 240 000 personnes en situation de handicap, beaucoup restent exclues de l’école, de l’emploi et de la vie sociale, faute d’adaptations et de reconnaissance, notamment pour les handicaps mentaux. L’inégalité est encore plus marquée dans les régions rurales, où l’accès aux structures adaptées est quasi inexistant. Cette exclusion fragilise également les liens sociaux, en empêchant les personnes handicapées de participer pleinement à la vie collective et de créer des relations durables au sein de leur communauté.
C’est dans ce contexte que la ferme Gaia se distingue comme un projet d’inclusion exemplaire. Au sein de ce centre de formation atypique, 70 personnes en situation de handicap (dont 3 physiques et 67 mentales) bénéficient d’un accompagnement personnalisé en vue d’une insertion professionnelle durable.
L’accompagnement se fait dans un cadre éducatif non traditionnel, où on se base sur l’interaction et l’expérience avec l’environnement. Il s’agit d'une question de pratique plutôt que de passivité
Pour optimiser leurs perspectives d'insertion professionnelle, les handicapés ont accès à diverses formations ajustées à leurs compétences et aspirations :
Horticulture : acquérir des compétences en culture de plantes, en entretien de jardin et en production de récoltes.
Élevage : apprendre à prendre soin des animaux et à gérer un troupeau.
Mise en valeur des produits régionaux : convertir des matières premières locales en produits commercialisables.
Ces formations permettent aux participants de développer des aptitudes techniques et pratiques les rendant aptes à travailler dans différents domaines.

En complément de leur formation, les apprenants participent à des activités pédagogiques et ludiques, conçues pour favoriser leur bien-être et renforcer leurs capacités.

Atelier hydroponie
L’écriture et la lecture, pour améliorer la communication et l’expression.
L’art plastique, un moyen d’exprimer la créativité et de développer la motricité.
Le théâtre, qui aide à prendre confiance en soi et à mieux interagir avec les autres.
Le sport, essentiel pour la santé physique et mentale.
Ces activités ne sont pas de simples loisirs. Elles visent à renforcer leur indépendance, à rehausser leur confiance en eux et à optimiser leur interaction avec l'environnement.
À l'issue de leur formation, ils auront la chance d'intégrer diverses entreprises partenaires.

peinture
Mais l’intégration au monde du travail représenter un véritable challenge. Les peuvent être confrontées à plusieurs obsta auxquels elles doivent faire face.
Tout d’abord, le manque d’acceptation du handicap par certains employeurs et collègues, qui peuvent avoir des préjugés.
Trouver un emploi ne signifie pas seulement gagner un salaire. Pour ces personnes, c’est l’opportunité d’avoir une vraie vie sociale En quittant le centre de formation et en entrant dans la vie active, elles accèdent à une nouvelle indépendance qui peut mener à des amitiés, des relations amoureuses, voire au mariage.

L’intégration sociale au travail peut alors s’avérer plus difficile, en particulier pour celles et ceux qui trouvent l’environnement du travail intimidant. Le manque de confiance en leurs capacités peut également être un frein pour elles, notamment quant à la prise d’initiative ainsi qu’à l’adaptation

équitation
Pour assurer leur réussite, un suivi postformation est mis en place. Ce suivi comprend alors un accompagnement personnalisé pour aider à la transition, tout comme un soutien en entreprise pour sensibiliser les employeurs et favoriser une intégration en douceur.
Ce genre d'action démontre qu'avec un soutien approprié, il est envisageable d'accorder à chacun un rôle dans la société, indépendamment de son handicap.
Modifier les perceptions, éduquer les employeurs et proposer un soutien pérenne sont les éléments essentiels pour construire un futur plus inclusif.
Beaucoup de PSH arrivent à la ferme après avoir vécu l’isolement, parfois même le rejet, de leur famille ou de la société. Le handicap a souvent fragilisé leurs liens sociaux. À Gaia, ils ont pu trouver un espace où ils sont enfin reconnus et inclut dans leur entourage.
Sarah MEGDICHE & Inès TRIKI

En Tunisie, l'inclusion des personnes handicapées physiques demeure un enjeu majeur. Bien que des progrès aient été réalisés, beaucoup reste à faire pour offrir à ces individus les mêmes opportunités que les autres citoyens. C’est dans ce contexte qu’émerge le projet innovant de la ferme thérapeutique GAIA, un lieu unique qui mêle réhabilitation physique, bien-être psychologique et insertion sociale.
L’un des aspects les plus remarquables de la ferme GAIA est sa capacité à allier rééducation physique et thérapie par l’agriculture.
Grâce à des installations adaptées (pistes d’accès, espaces de travail modulables), la ferme permet aux personnes handicapées physiques de s’adonner à des activités agricoles variées, telles que le jardinage thérapeutique, la culture de plantes médicinales ou encore l’élevage d’animaux. Ces activités, en plus de favoriser le bien-être physique, apportent une véritable valeur thérapeutique, car elles permettent de renforcer la motricité, de lutter contre l'isolement et d'améliorer l'estime de soi.
C’est avec l’aide d’ateliers éducatifs, de visites guidées et de rencontres avec des experts en santé et en rééducation, que les jeunes citoyens ont la possibilité de se former tout en contribuant à des projets de société porteurs de sens. Au-delà de la rééducation, l’objectif est d’éveiller une conscience collective sur les défis que rencontrent les personnes handicapées dans leur vie quotidienne. Ce programme permet ainsi de renforcer les liens sociaux et de sensibiliser à l’importance de l’intégration des personnes handicapées dans la société tunisienne.
Témoignage d’un membre de l’équipe encadrante au sein de la Ferme GAIA.

Pourquoi ces formations sont-elles si importantes ?
“Parce qu’elles redonnent une place à chacun. Nos résidents peuvent choisir parmi plusieurs domaines : l’horticulture, l’élevage, le métier de palefrenier ou encore la valorisation des produits du terroir. Ce sont des filières concrètes, utiles, et qui leur permettent d’avoir des perspectives professionnelles réelles.”
Comment se déroule l’enseignement concrètement ?
“Ce n’est pas un enseignement classique. Il n’y a pas de salle de classe ni de leçon au tableau. Tout se fait par l’expérience. Ils apprennent en faisant : on les met directement en situation. Et pour les accompagner, on propose aussi de nombreuses activités : écriture, lecture, art plastique, théâtre, sport. C’est complet et surtout, ça leur plaît.
Quel est le rôle du contact avec les animaux dans ce parcours ?
“Il est central. Le lien avec les animaux apaise, responsabilise et motive. Beaucoup ont des difficultés à s’exprimer ou à faire confiance aux humains. Avec les animaux, il n’y a pas de jugement. Ils reprennent confiance, et ça les aide à progresser dans tous les domaines.”
Est-ce que cette formation mène réellement à une insertion professionnelle ?
“Oui, 29 personnes ont intégré le monde du travail à l’issue de leur parcours Ce sont de vraies embauches, pas des stages. Mais il y a encore certains freins ”
Quels sont les principaux obstacles ?
“D’abord, il y a le regard de la société. Certains employeurs ou collègues n’acceptent pas facilement le handicap Surtout qu’après avoir été dans un environnement sécurisé comme le nôtre, le monde extérieur peut faire peur Il manque aussi de confiance en eux.”
Un accompagnement est-il prévu après la sortie du centre ?
“Bien sûr. Le suivi ne s’arrête pas à la porte. On reste en lien avec eux pour les soutenir dans l’emploi, les aider à s’adapter, à répondre aux difficultés. Et on sensibilise aussi les entreprises.”

Qu’est-ce que cela change pour ces jeunes, humainement ?
“Tout. Ici, ils se sentent enfin valorisés. Ils découvrent qu’ils sont capables. Pour certains, c’est la première fois qu’ils ont une vraie vie sociale. Ils créent des amitiés, parfois même des couples. C’est bien plus qu’une formation : c’est une reconstruction.”

Combien de temps dure la formation ?
“Cela dépend. Il n’y a pas de durée fixe. Certains restent quelques mois, d’autres plusieurs années. On s’adapte à leur rythme, à leur évolution. Le but, ce n’est pas de faire vite, mais de faire bien.”
Et du côté des familles ?
“Parfois, c’est difficile. Certaines familles ne veulent pas reconnaître le handicap Il arrive que des parents renient leur enfant, ou que des frères et sœurs coupent les liens C’est terrible à voir, parce que ça les décourage profondément Heureusement, ici, ils trouvent une forme de famille.”
Et finalement, en un mot, que diriez-vous à quelqu’un qui doute de la capacité d’une personne en situation de handicap à travailler ?
“Je lui dirais de venir passer une journée ici Il changerait d’avis. Ce qu’on apprend ici, on ne l’apprend pas ailleurs À la ferme Gaia, chacun trouve plus qu’une formation : un soutien, des repères, et surtout, des liens. Ici, on leur donne la chance de croire en eux, d’être entourés, et de se sentir enfin à leur place.”
Inès Celia MEZIOU & Ikram BCHATNIA
Témoignage d’un résident en situation d’handicap physique de la Ferme GAIA.
Nous rencontrons R. lors d’une journée passée à la ferme thérapeutique GAIA. Avec une difficulté à se déplacer depuis l’enfance à cause d’une maladie génétique, il travaille ici depuis presque deux ans.
"Quand je suis arrivé ici, je ne savais pas planter une graine.Je venais surtout pour respirer. Aucune entreprise ne voulait de moi, même pour un poste de bureau."
C’est à GAÏA, qu'il a appris à jardiner, nourrir les animaux, organiser les cultures. Mais plus encore, c’est là qu’ il a retrouvé un lien social

personnes concernées comme “L’association Tunisienne Des Handicapés”(ATH).
s s s
Le témoignage de R. nous rappelle que l’exclusion n’est pas une fatalité. Là où on fait une place à la différence, c’est toute une société qui grandit. Ce qu’il manque à la Tunisie, ce ne sont pas des lois, mais bien de la volonté.
Ghalia SAIGHI & Nour REJEB

Les tirailleurs tunisiens ont longtemps servi au sein des armées françaises, souvent au prix d’immenses sacrifices. Pourtant, leur histoire et leur réintégration après la guerre restent largement méconnues.
À leur retour, ces soldats ont dû affronter de nombreuses difficultés : la réinsertion professionnelle, la quête d’une reconnaissance officielle et la reconstruction d’une identité dans une société qui ne leur offrait pas toujours la place qu’ils méritaient. Beaucoup ont été marqués par leur expérience militaire et ont dû naviguer entre leur passé de combattants et leur statut d’anciens soldats dans une Tunisie en mutation.
Pour mieux comprendre cette réalité, nous avons eu l’opportunité d’échanger avec le Colonel Vouilloux, attaché de défense et commandant du premier régiment de tirailleurs. Cet entretien a mis en lumière les défis auxquels les tirailleurs ont été confrontés après leur engagement : certains ont trouvé une nouvelle place dans les corps militaires ou la fonction publique, tandis que d'autres ont dû se réinsérer dans une société civile parfois indifférente à leur passé.
Le Colonel Vouilloux nous a également recommandé plusieurs ouvrages, tels que Sidi Brahim des Neiges, retraçant l’histoire des tirailleurs tunisiens, ainsi que Tirailleurs, un livre exclusivement édité pour les membres du régiment, offrant des portraits de soldats maghrébins à travers les époques Ces témoignages permettent de mieux saisir la complexité de leur réintégration et la transmission de leur mémoire à travers les générations

Par ailleurs, nous avons identifié plusieurs pistes pour approfondir cette mémoire collective. La cérémonie du 8 mai au cimetière militaire de Gammarth constituera un moment fort de commémoration, réunissant vétérans, officiels et historiens, dont le professeur Raphaël Simon (enseignant d’histoire à PMF). La chance d’avoir un professeur historien investi dans la cause des tirailleurs nous a aussi permis de trouver quelques livres, qu’il a coécrit, abordant la vie des tirailleurs et des soldats tunisiens.
Cet événement sera l’occasion de rappeler que la reconnaissance des tirailleurs ne doit pas se limiter à leur engagement militaire, mais aussi inclure leur rôle dans la société après leur retour.

La Tunisie peut s'enorgueillir d’avoir pris glorieusement part aux combats contre le nazisme lors de la seconde guerre mondiale.
Toutefois, la situation des tirailleurs est très complexe. En effet, le quatrième régiment tirailleur tunisien (régiment d’élite) est le drapeau régimentaire le plus décoré de l’armée française pour ses hauts faits de guerre.
Mais alors où sont ces combattants, leurs fils, leurs héritages, comment ont-ils vécu la guerre et la transition ?

Drapeau du 4 RTT en 1917 e
Nous nous sommes donc entretenus avec le citoyen Sami Trimeche, trouvé sur un groupe virtuel d’anciens combattants de la première et seconde guerre mondiale.
Il nous renseigna sur la carrière de son père, son lien avec lui, ses opinions sur l’intégration et la mémoire des tirailleurs, dont faisait partie le défunt Abdelmejid Trimèche. Il nous fournit photos et documents qui font valoir des combats menés en Tunisie, en Italie, en France, et en Allemagne, contre le nazisme, là où deux visions du monde s’opposèrent.
Le 4ème RTT dont faisait partie Abdelmejid, fut le premier régiment allié à pénétrer sur le territoire allemand, après la reconquête de la France, et l’offensive des Ardennes. Mais pourquoi ses hommes qui ont aidé la France à renouer avec la grandeur considèrent parfois qu’ils sont oubliés ?
En effet, Sami témoigne que son père, démobilisé en 1948, rejoint la réserve de l’armée beylicale tunisienne, comme la plupart des tirailleurs, et poursuit un tout autre combat : celui d’un blessé de guerre, payé 35 dinars par trimestre par la France. Il réussi toutefois à se reconvertir en tant que président d’associations et possesseur agricole. La réintégration sociale se heurte à d’autres quiproquos également.
Si les tirailleurs ont très majoritairement insisté pour rejoindre les rangs de l’armée tunisienne dès sa création, (traité du 20 mars 1956, Pierre Mendès France) ils subissent le regard des “moins documentés” qui les méprennent avec des soldats “étrangers” à la Tunisie. Il nous transmet plusieurs anecdotes très personnelles qui révèlent la dure réintégration dans le civil. Les réveils hurlant d’un père sujet à de forts cauchemars de guerre, une éducation très stricte et plusieurs séquelles

Cérémonie du 8 mai au cimetière militaire de Gammarth en commémoration des tirailleurs

Abdelmejid Trimèche, ancien tirailleur tunisien
Aujourd’hui, les faits des tirailleurs relèvent de l’histoire plus que de l’actualité.
Malgré tout, Abdelmejid se vit honoré du titre de chevalier de la légion d’honneur, et détenteur de la croix militaire.
ThomasRoman:«TennisetdistinctionsocialeenFrance:élitismeetdémocratisationd’un sport»
Sociologiedutennis:étudesurlasocialisationdesjoueursdetennis,leurengagementdansle sportetleurretraitesportive.ITFCoachingandSportScienceReview,2015 Zhai,Yulin TennisandSocioeconomicClass:TheChangeinPerceptionoftheSport In AdvancesinAppliedSociology,2022 Bourban,Nadine.Lesportcréateurdeliensocial?TravaildeBachelorpourl’obtentiondu diplômeBachelorofArtsHES·SOentravailsocial,sousladirectiondeChantalBournissen, Macolin,23août2016
Interviewdel'équipefémininedehandballd’ElMenzah LaPressedeTunisie-Hand–Equipenationale:DamesIlnousfautdesobjectifs
InstitutNationaldelaStatistique(INS) Marzouk,H (2024,13décembre) Ledivorceetsesconséquences:600000enfants impactés.LeconomisteMaghrebin.
ATFDTunisie–Associationtunisiennedesfemmesdémocrates.(s.d.).https://atfd-tunisie.org/ FéministesenAction (2023,21février) Associationtunisiennedesfemmesdémocratesféministesenaction! FéministesEnAction!https://feminaction.fr/osc/atfd-tunisie/
L’AUTISME
La Presse de Tunisie - Intégration des enfants autistes : Un guide parental voit enfin le jour ﻦﺴﻟارﺎﺒﻛوﺔﻟﻮﻔﻄﻟاوةأﺮﻤﻟاوةﺮﺳﻷاةرازو - Guide de l'éducateur : Vers l'inclusion des enfants atteints de troubles du comportement
La Presse de Tunisie - Isolés, mal compris 77% des enfants autistes victimes d'harcèlement
Parul Bakhshi, Fiona Gall, Dominique Lopez, Jean-Francois Trani: “Le handicap dans les politiques publiques tunisiennes face au creusement des inégalités et à l’appauvrissement des famillesavecdesayantsdroitensituationdehandicap”Firah InterviewsdanslafermeGAIA
DATAFORTUNISIA:”Statistiquesduhandicap:l’aberrationtunisienne”
Leila GASMI (2020, 21 septembre) - Gaïa : Ferme Thérapeutique pour Handicapés de Sidi Thabet,Jamaity.org
InterviewsauseindelafermeGAIA
Siteofficieldelafermethérapeutiquepourhandicapés,GAIA-fth-gaia.org
SidiBrahimdesneiges,(2008),PaulNicolas InterviewavecunfilsdetirailleurSamiTrimech Abdallah,(2019),RaphaëlSimon LaTunisiedanslagrandeguerre,(2019),deRaphaëlSimon


Première SELO 4/5