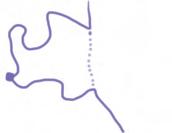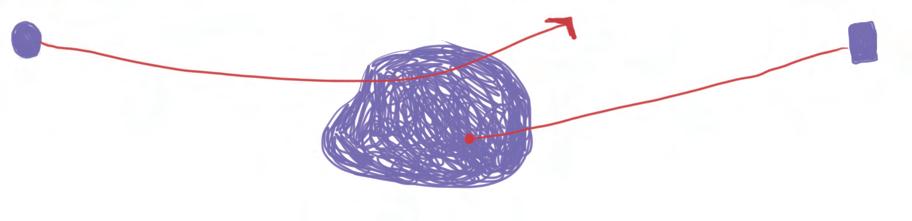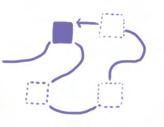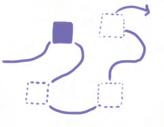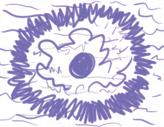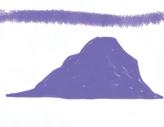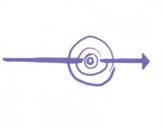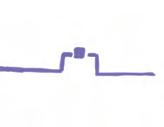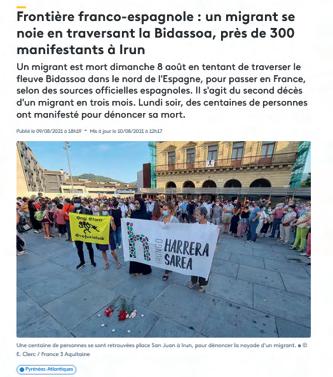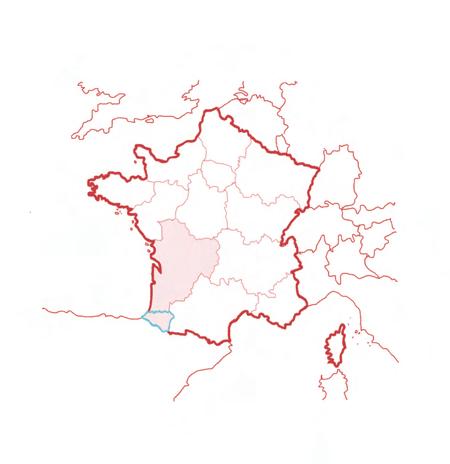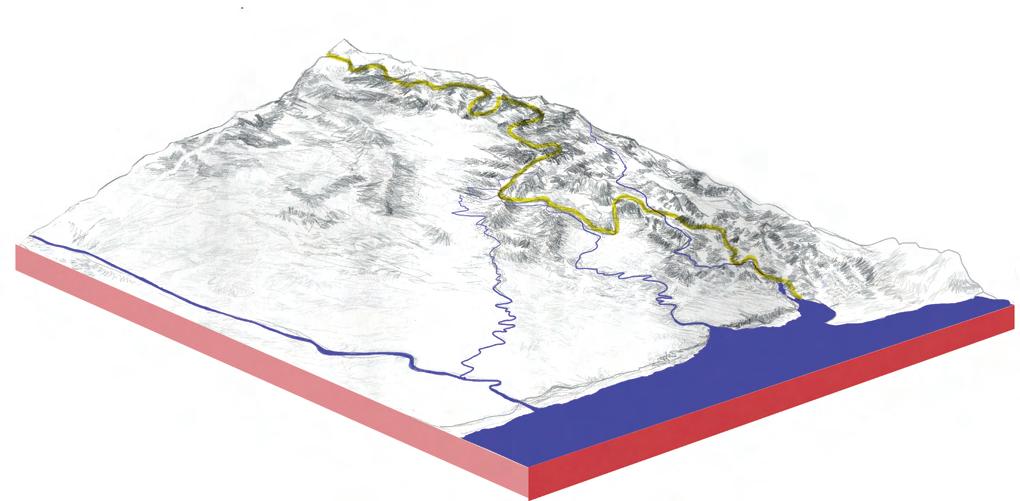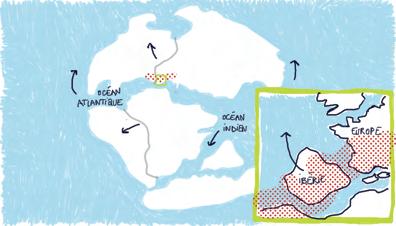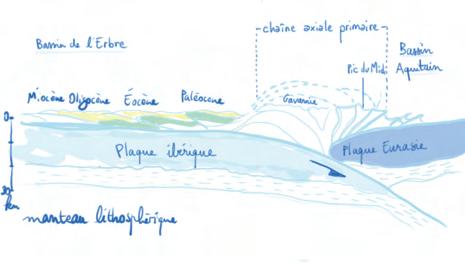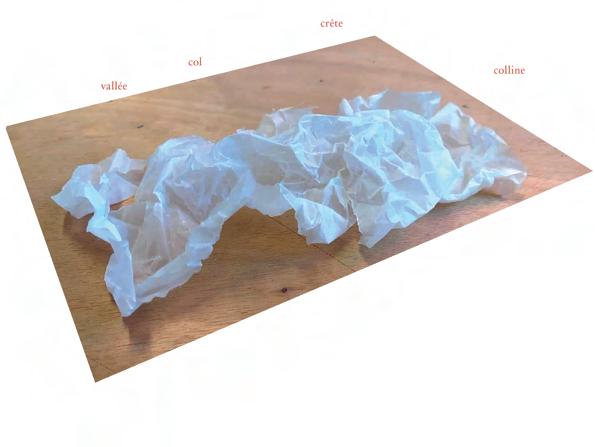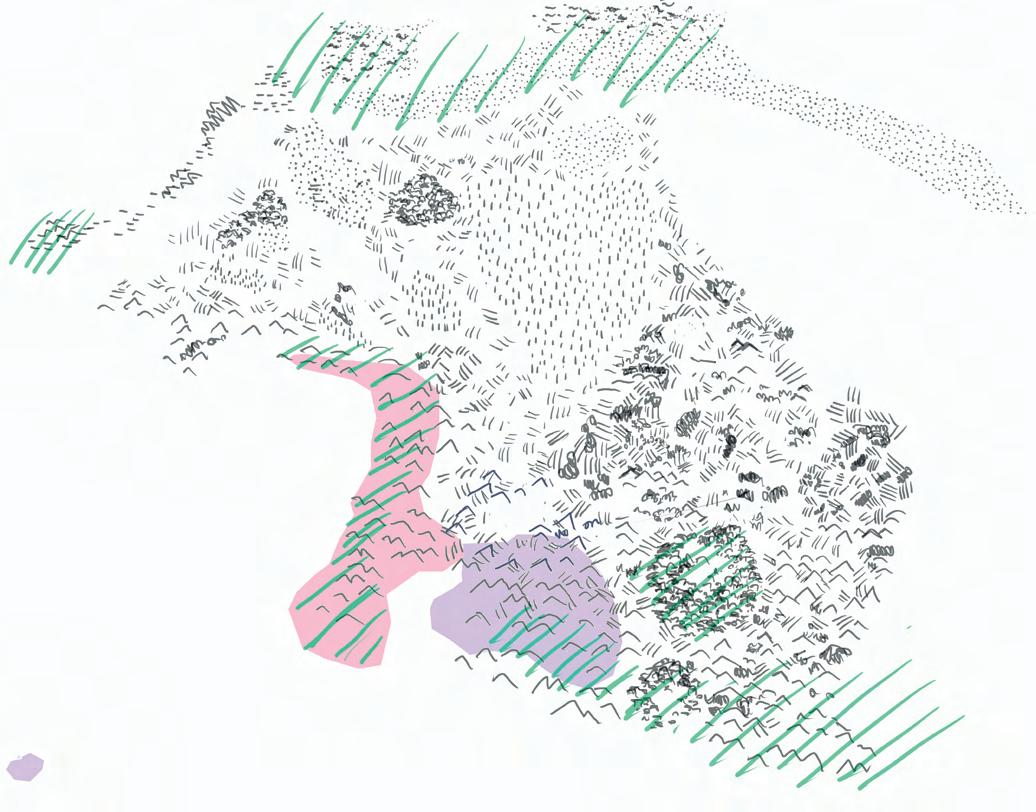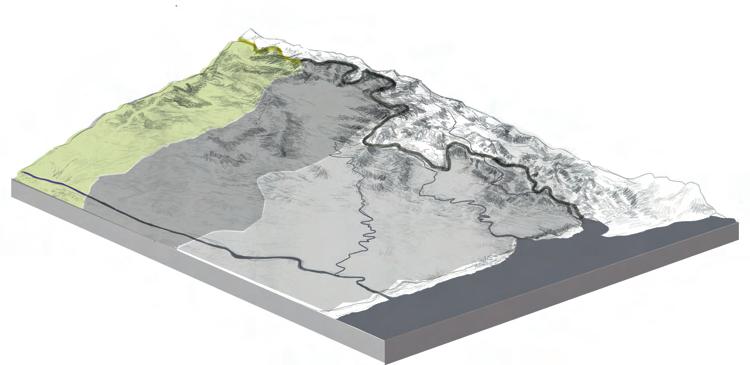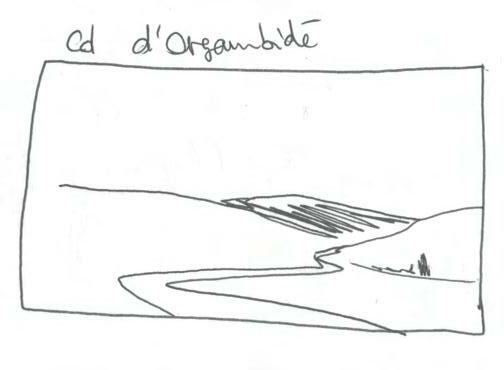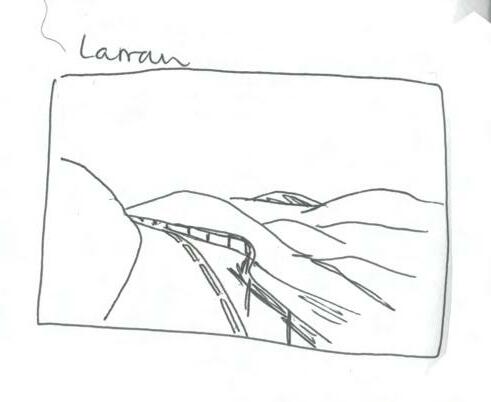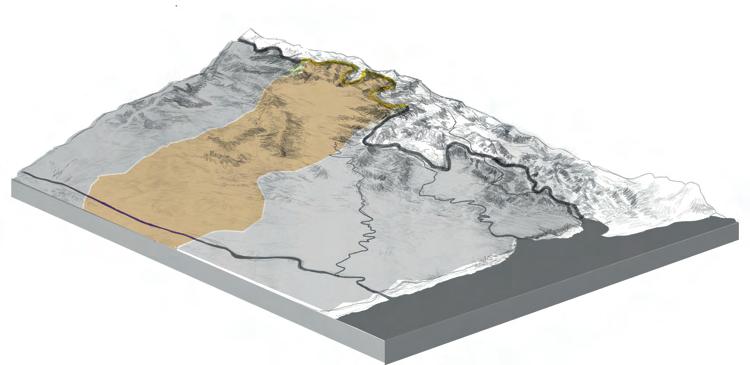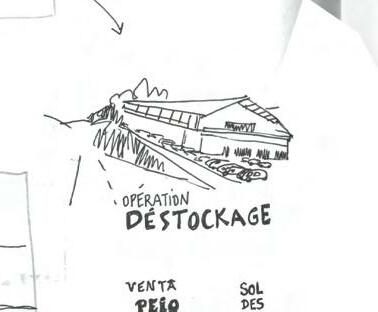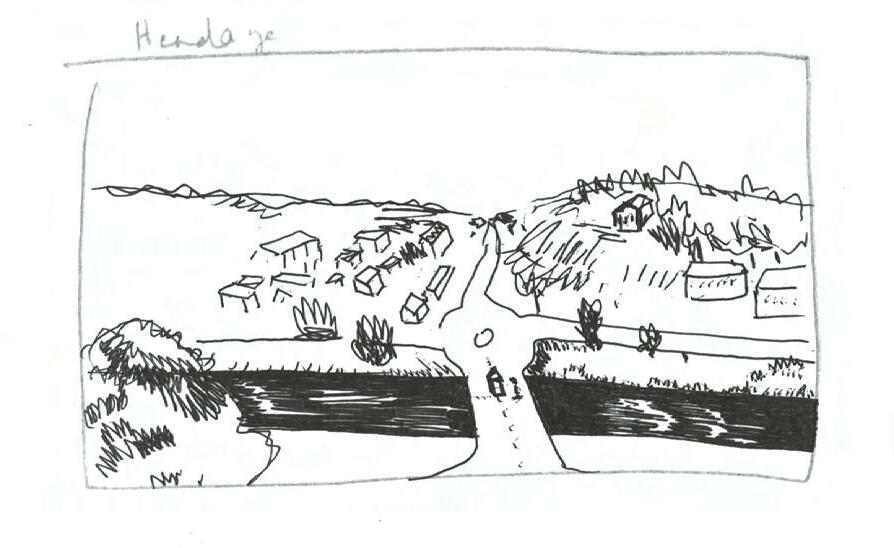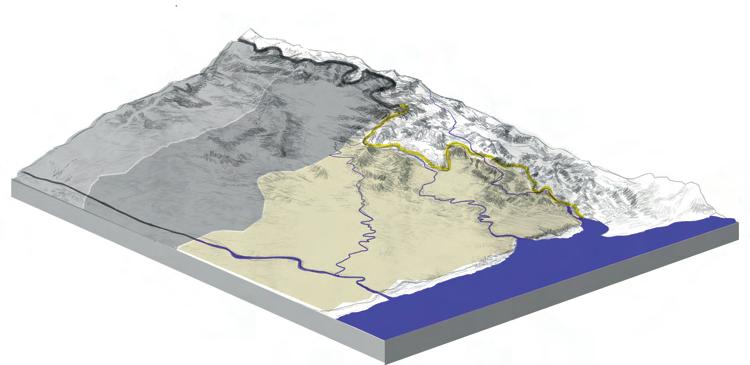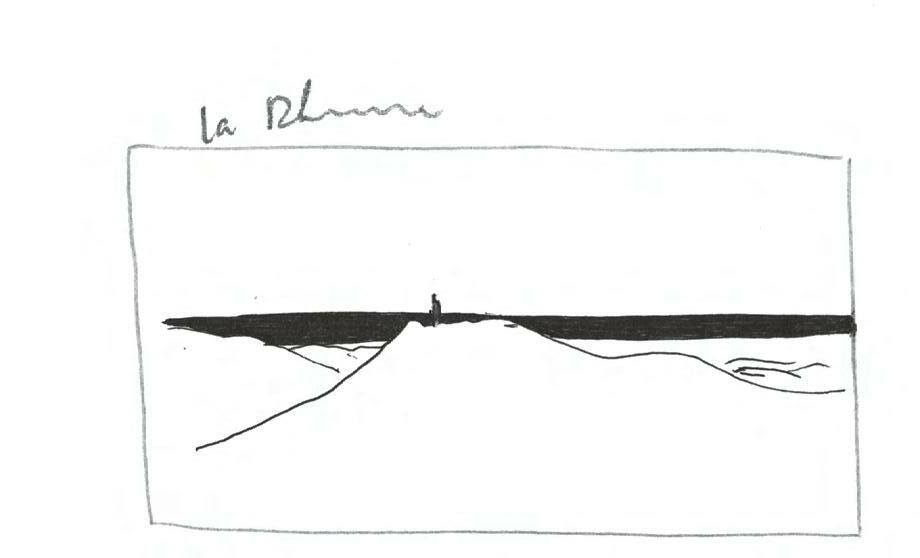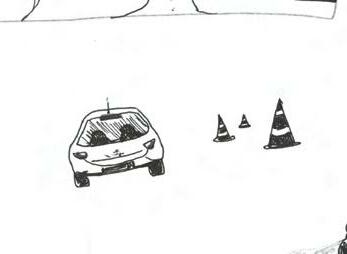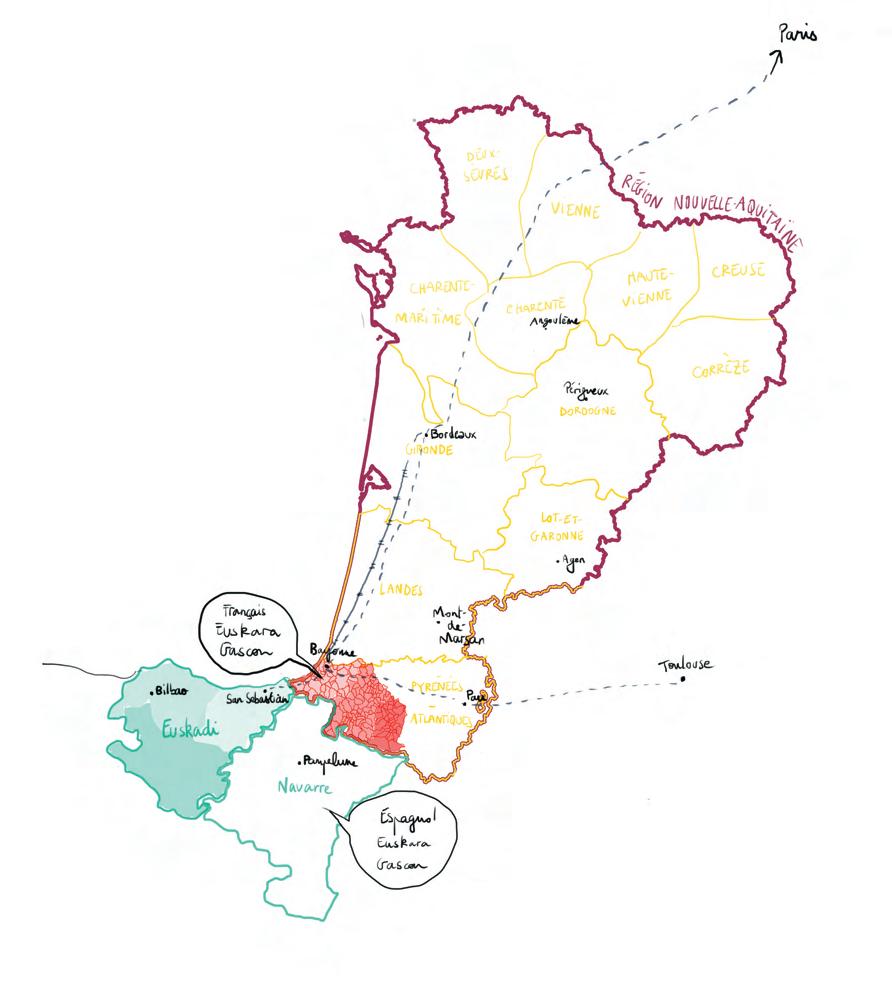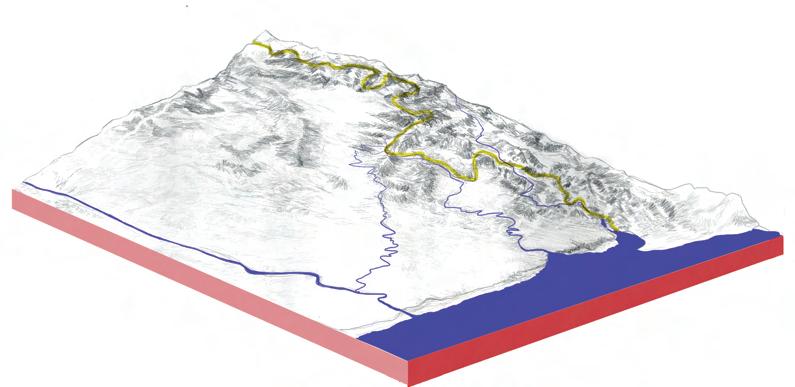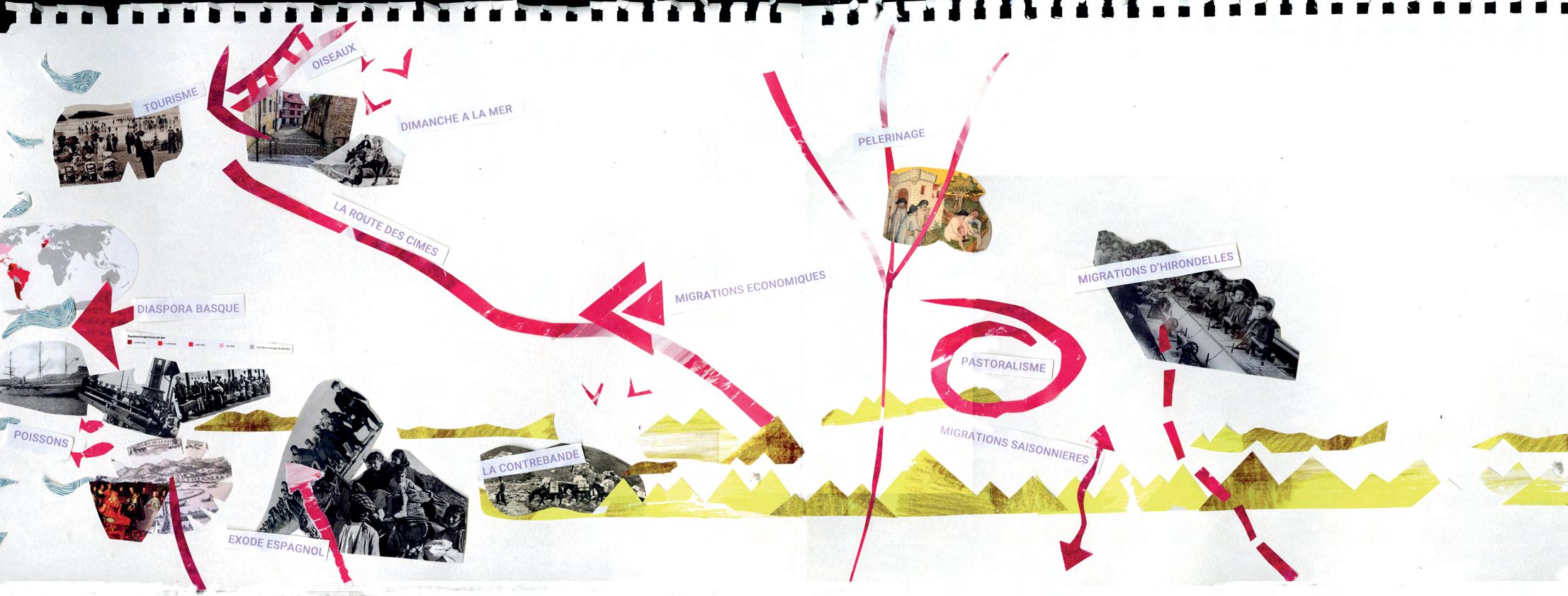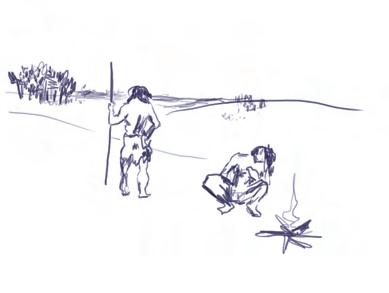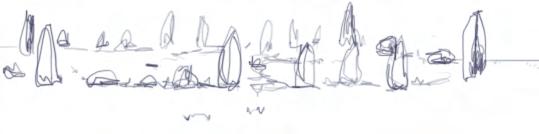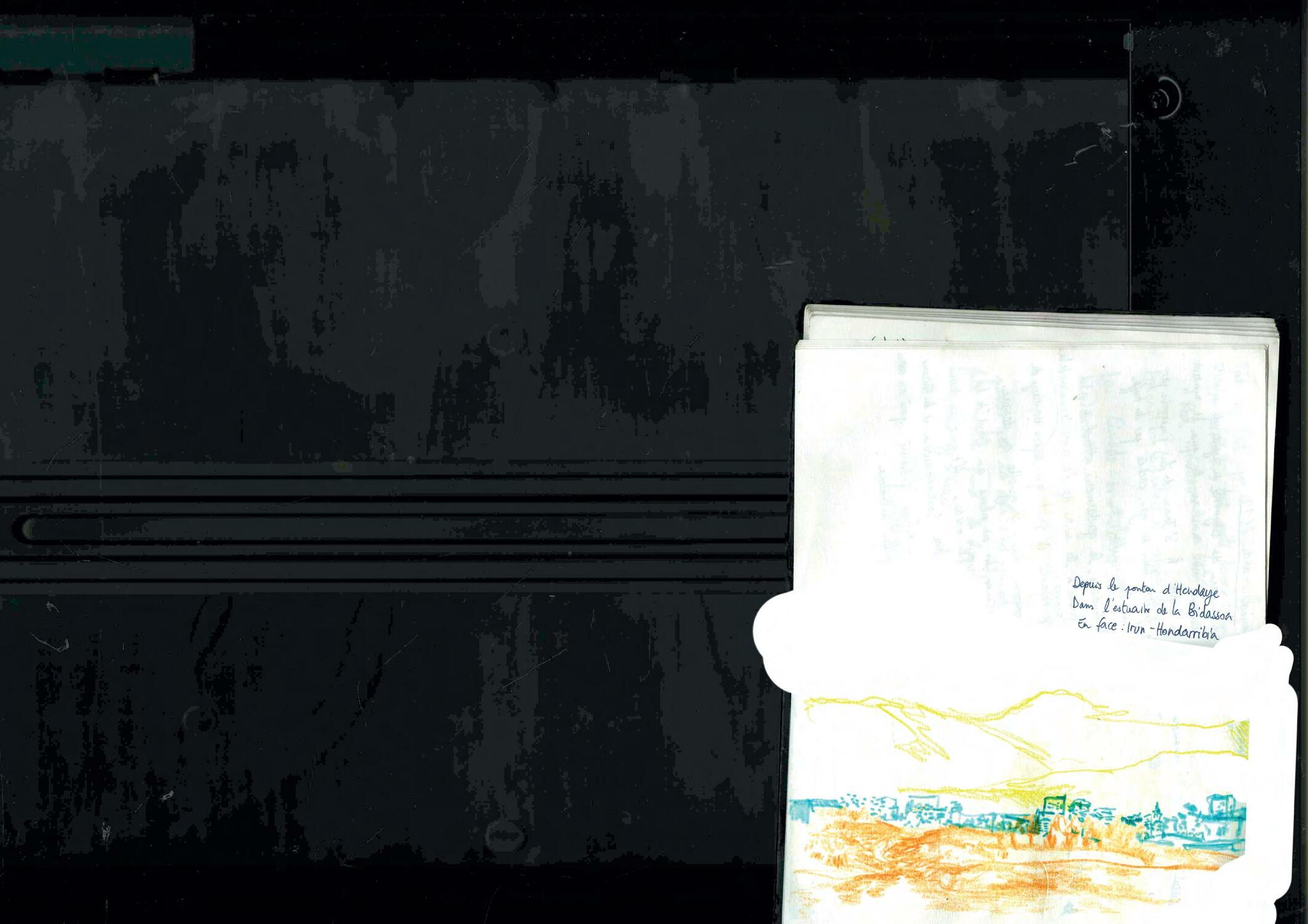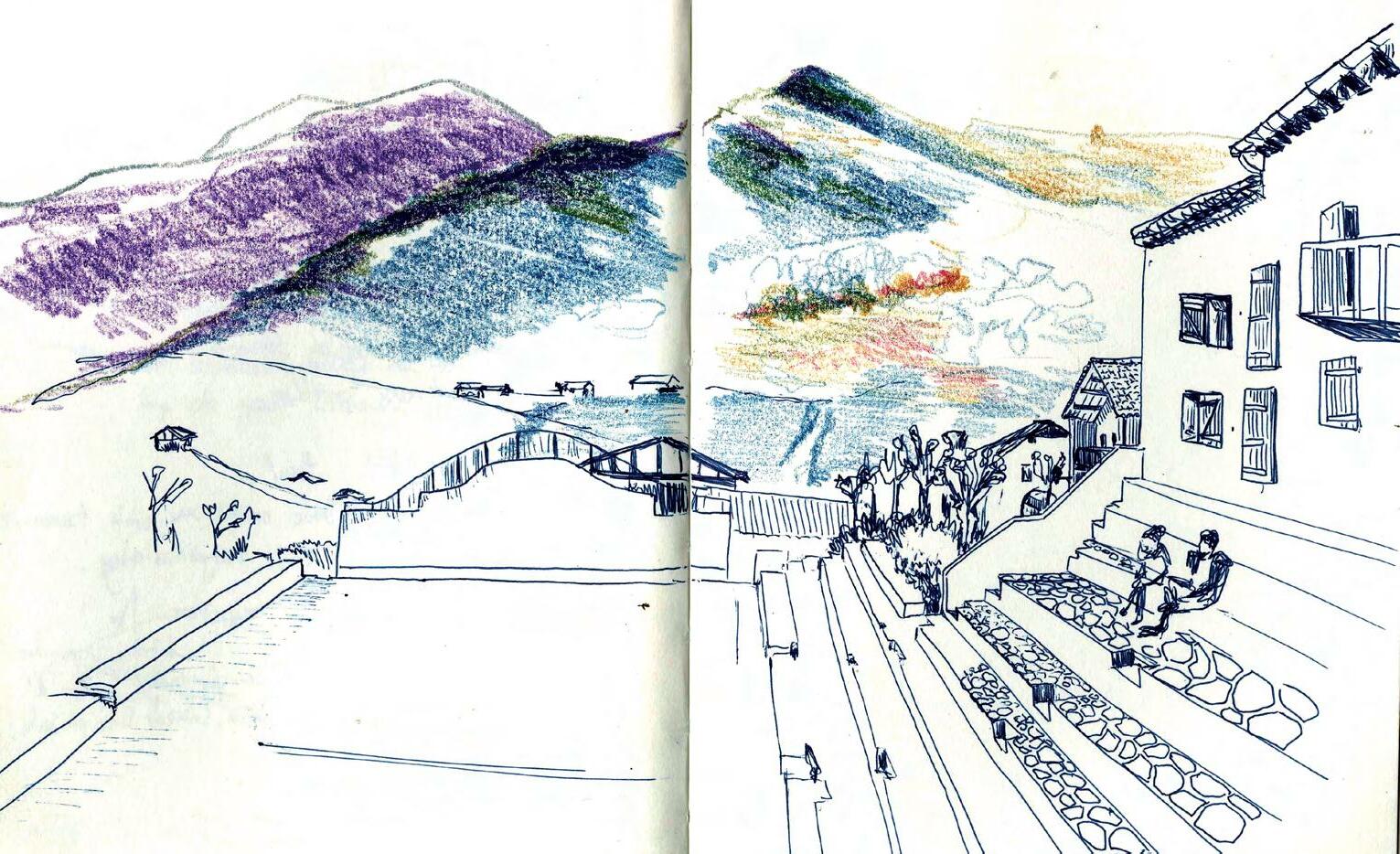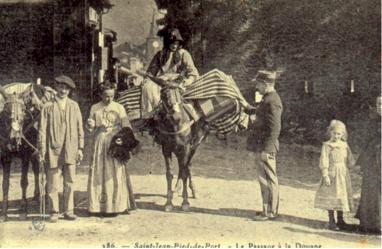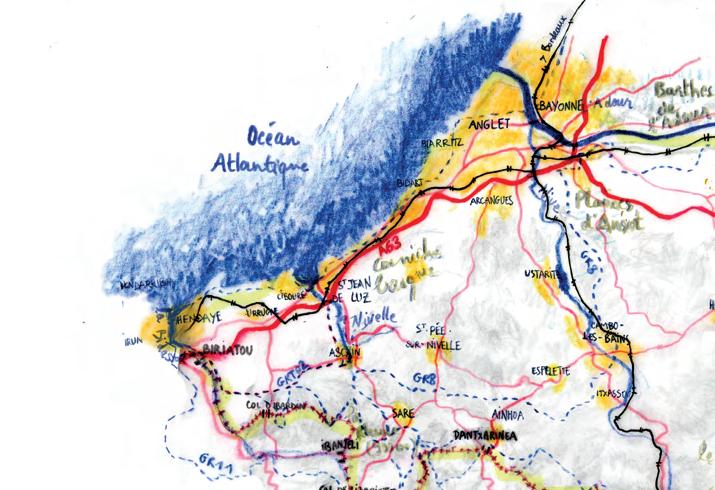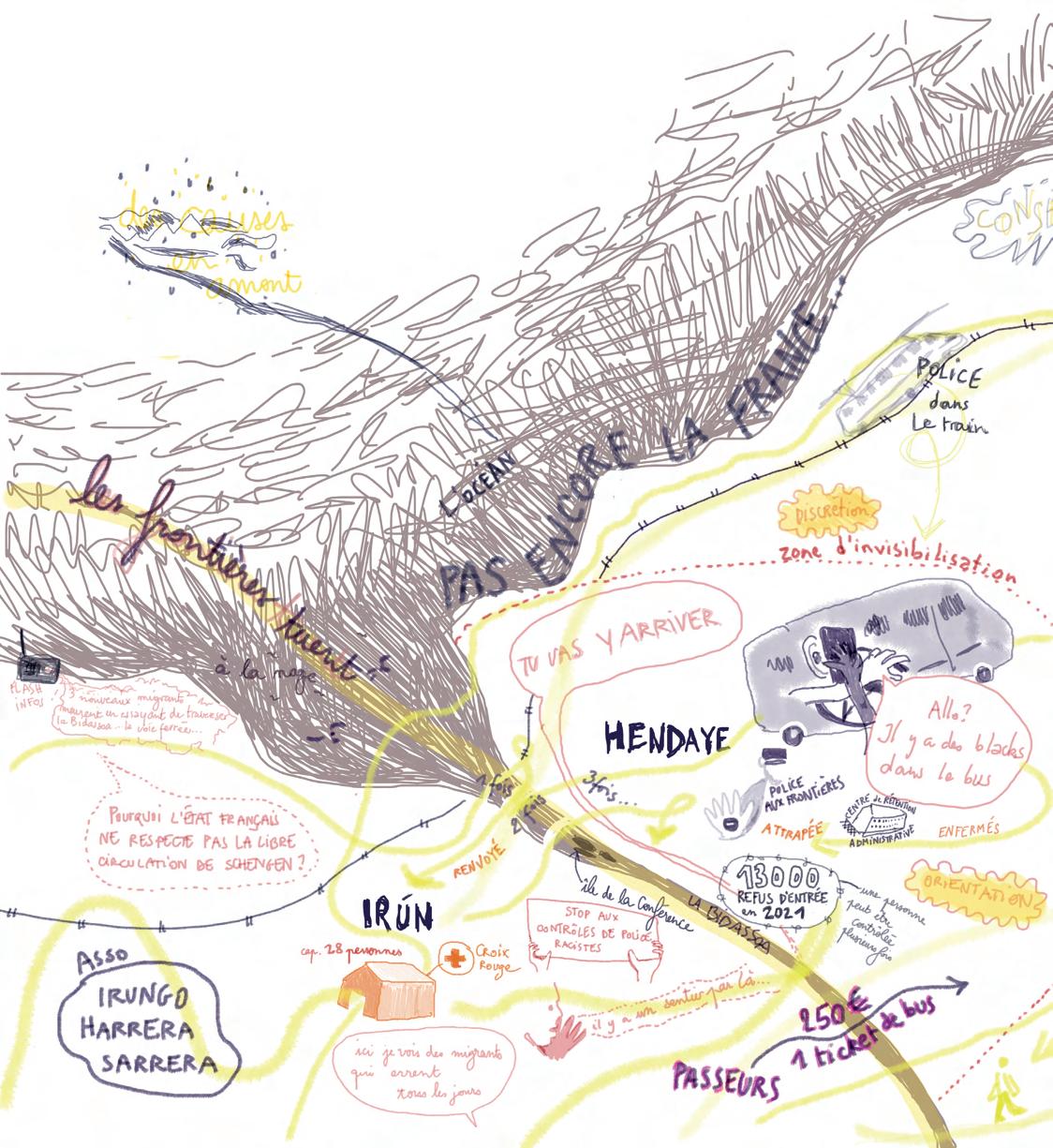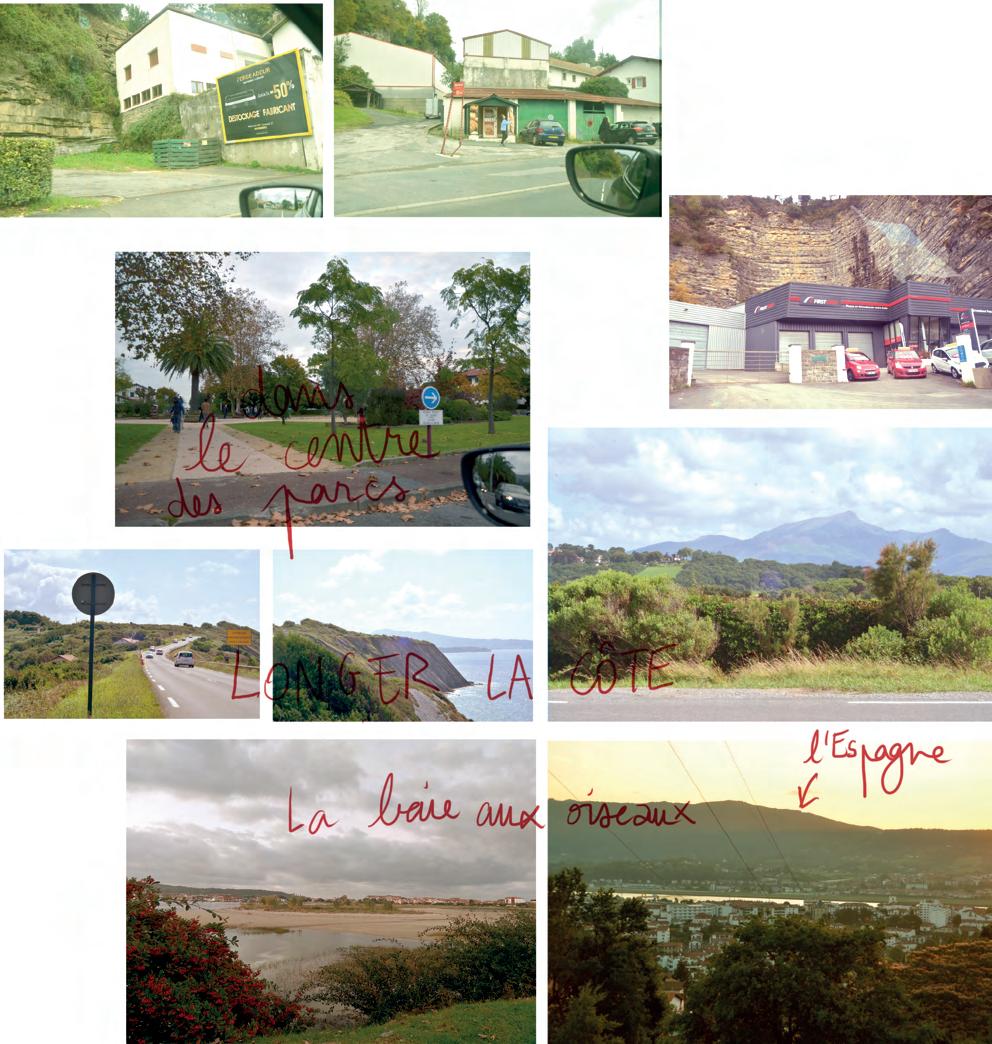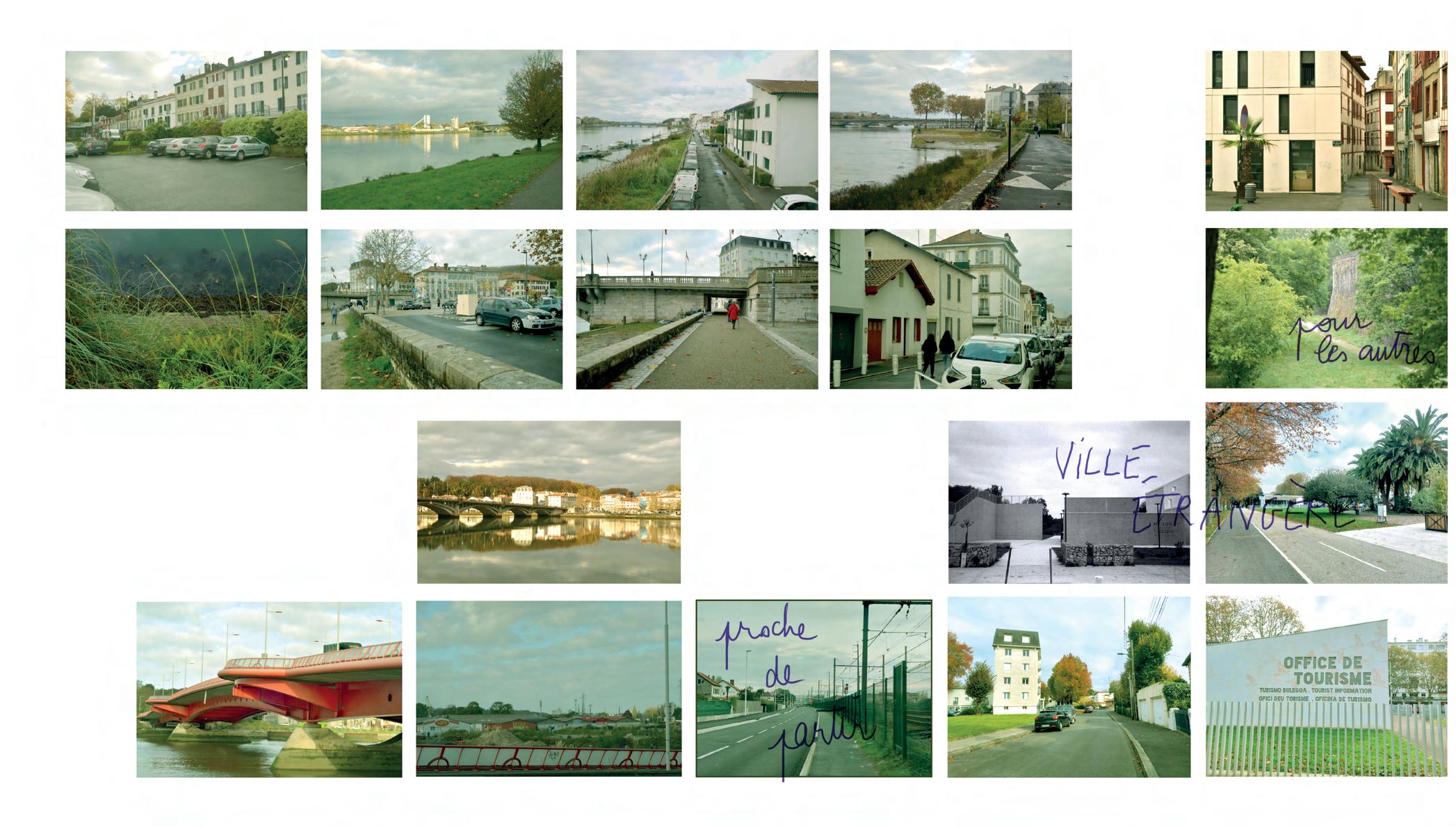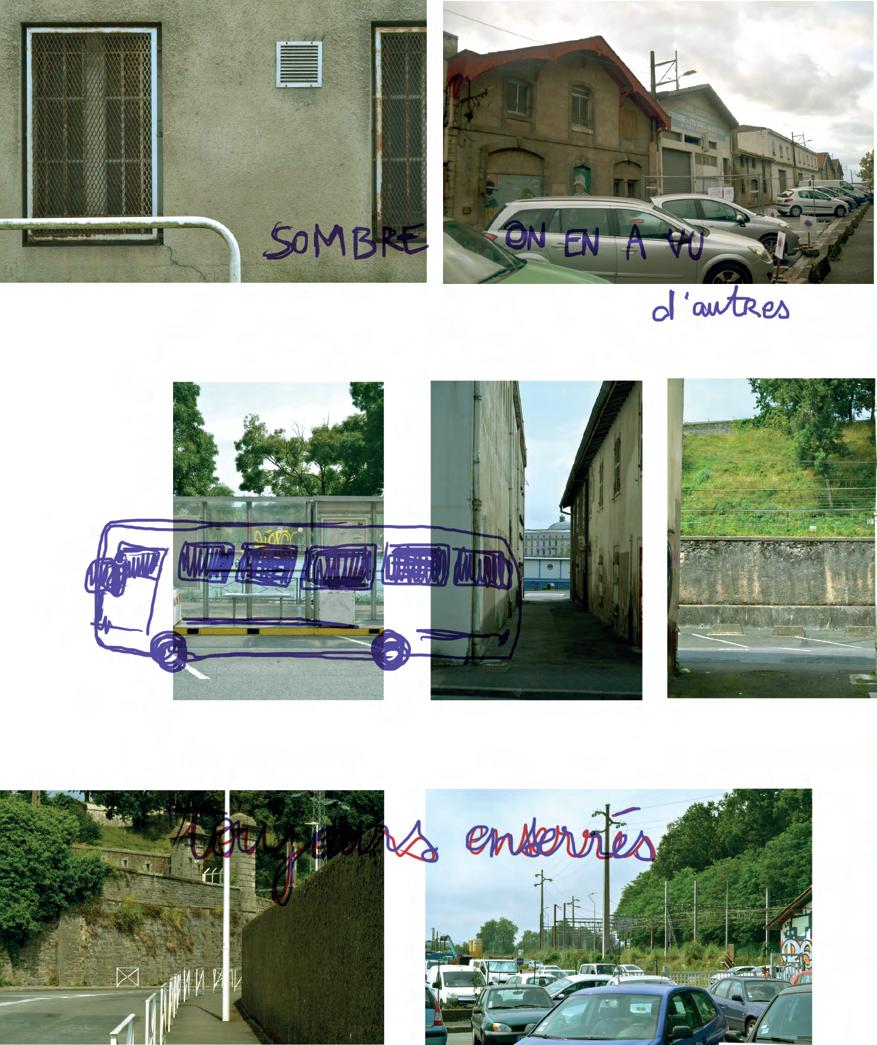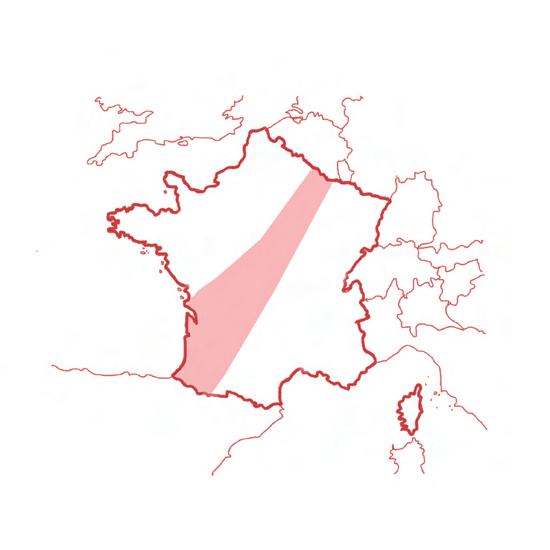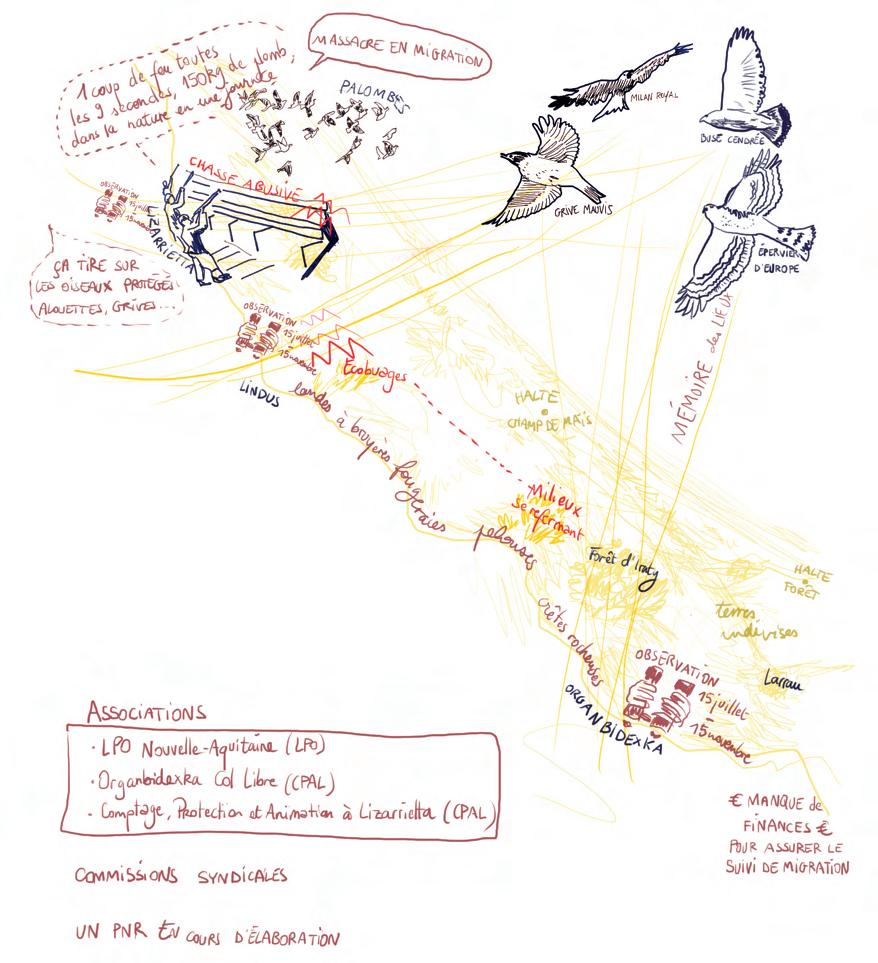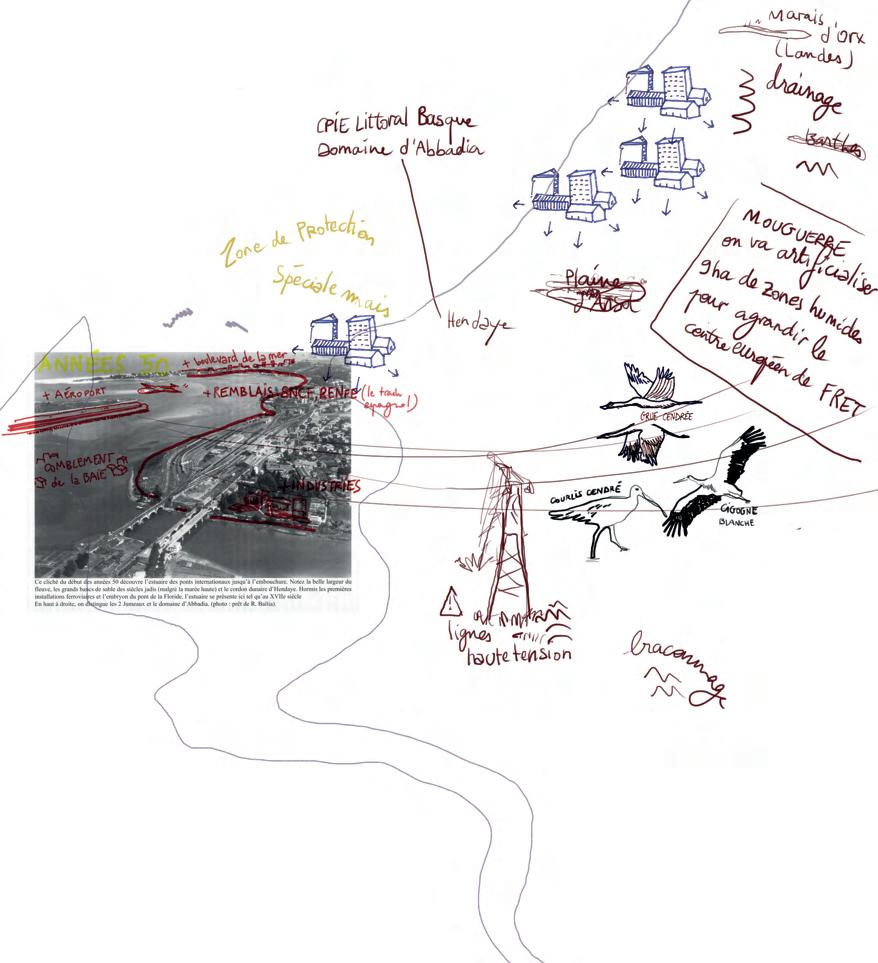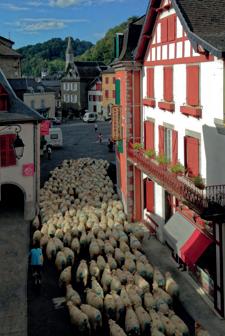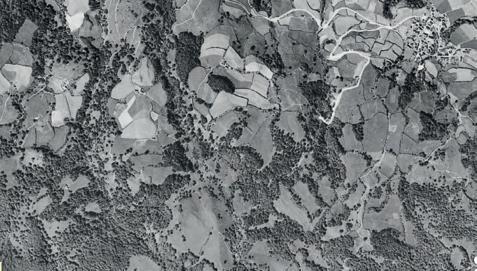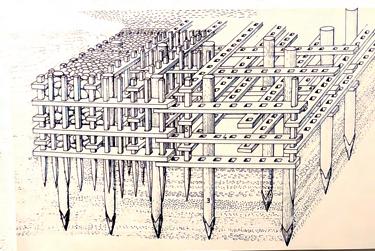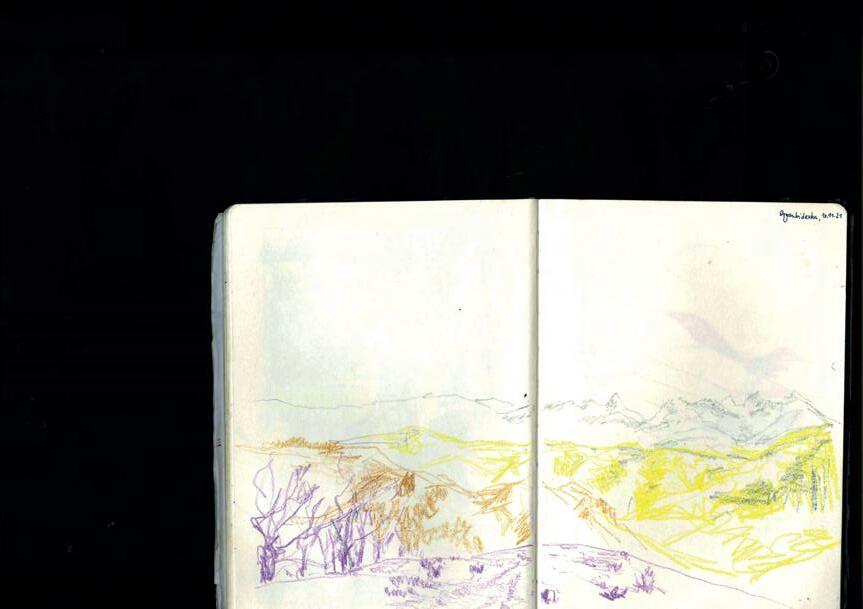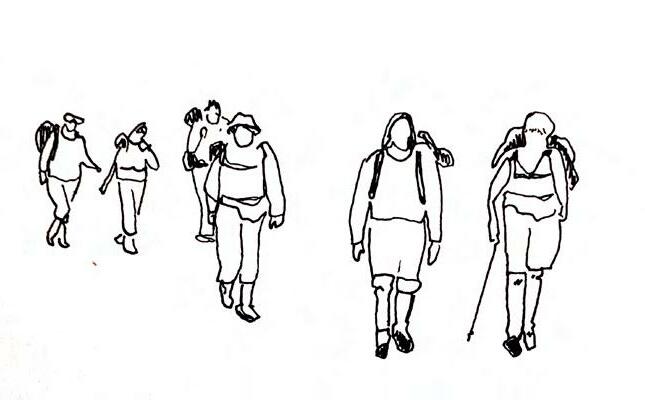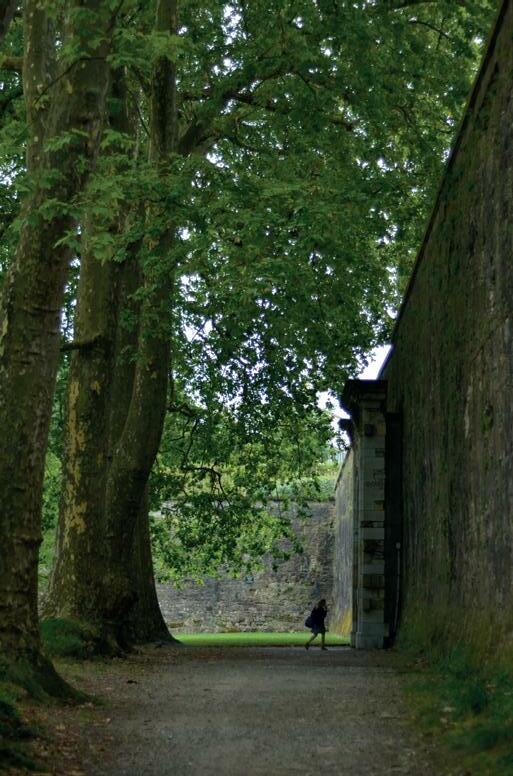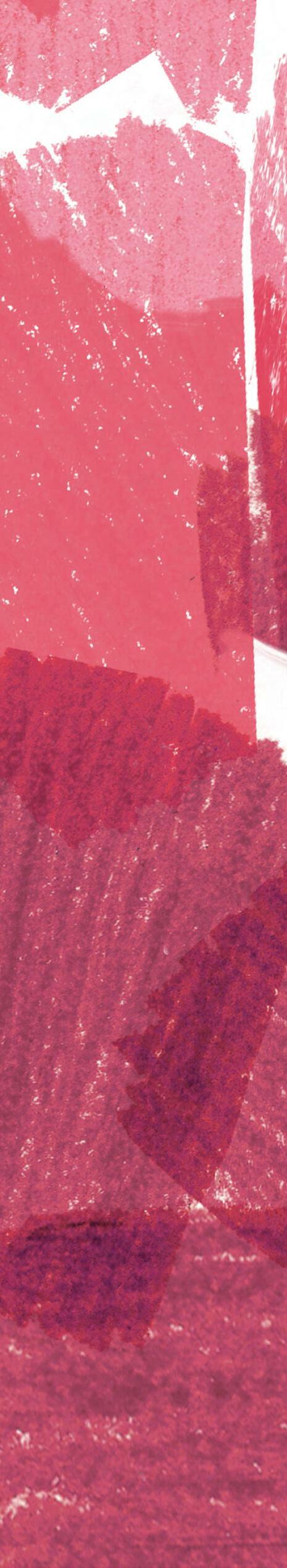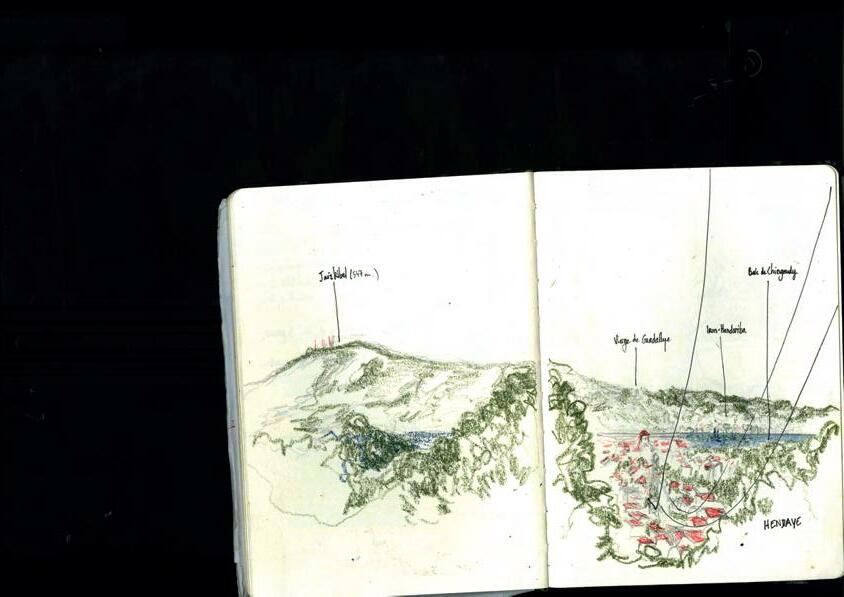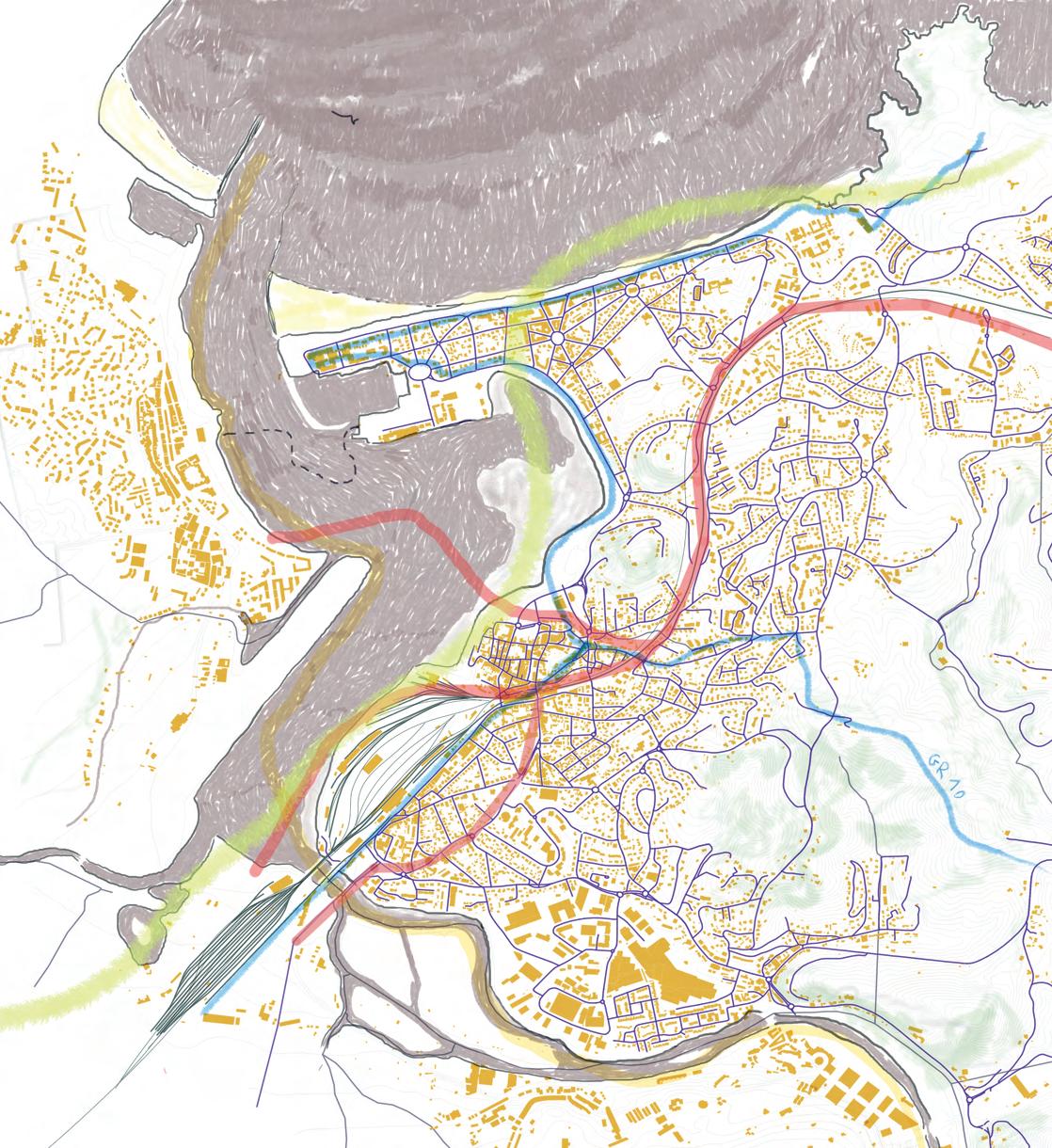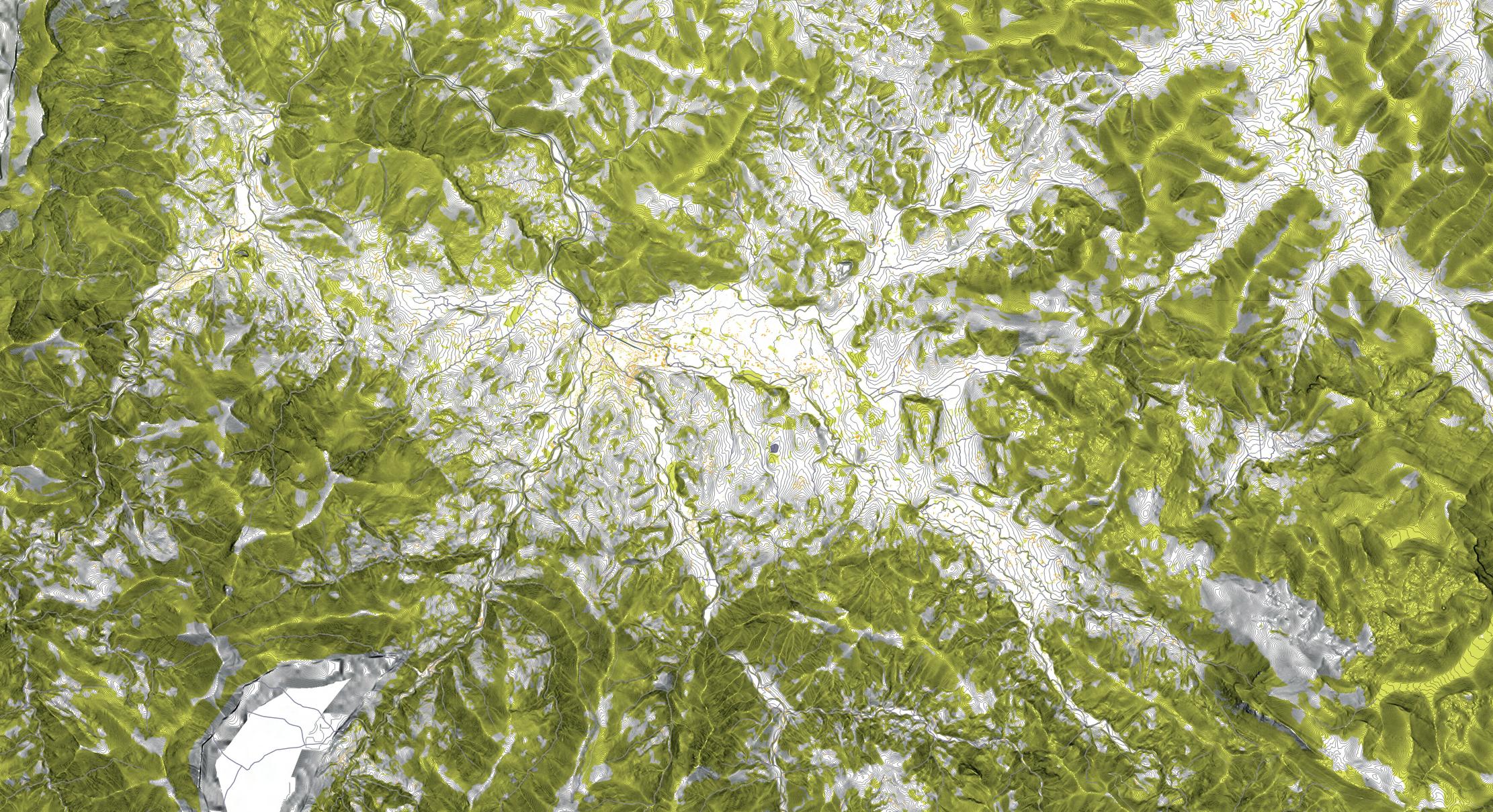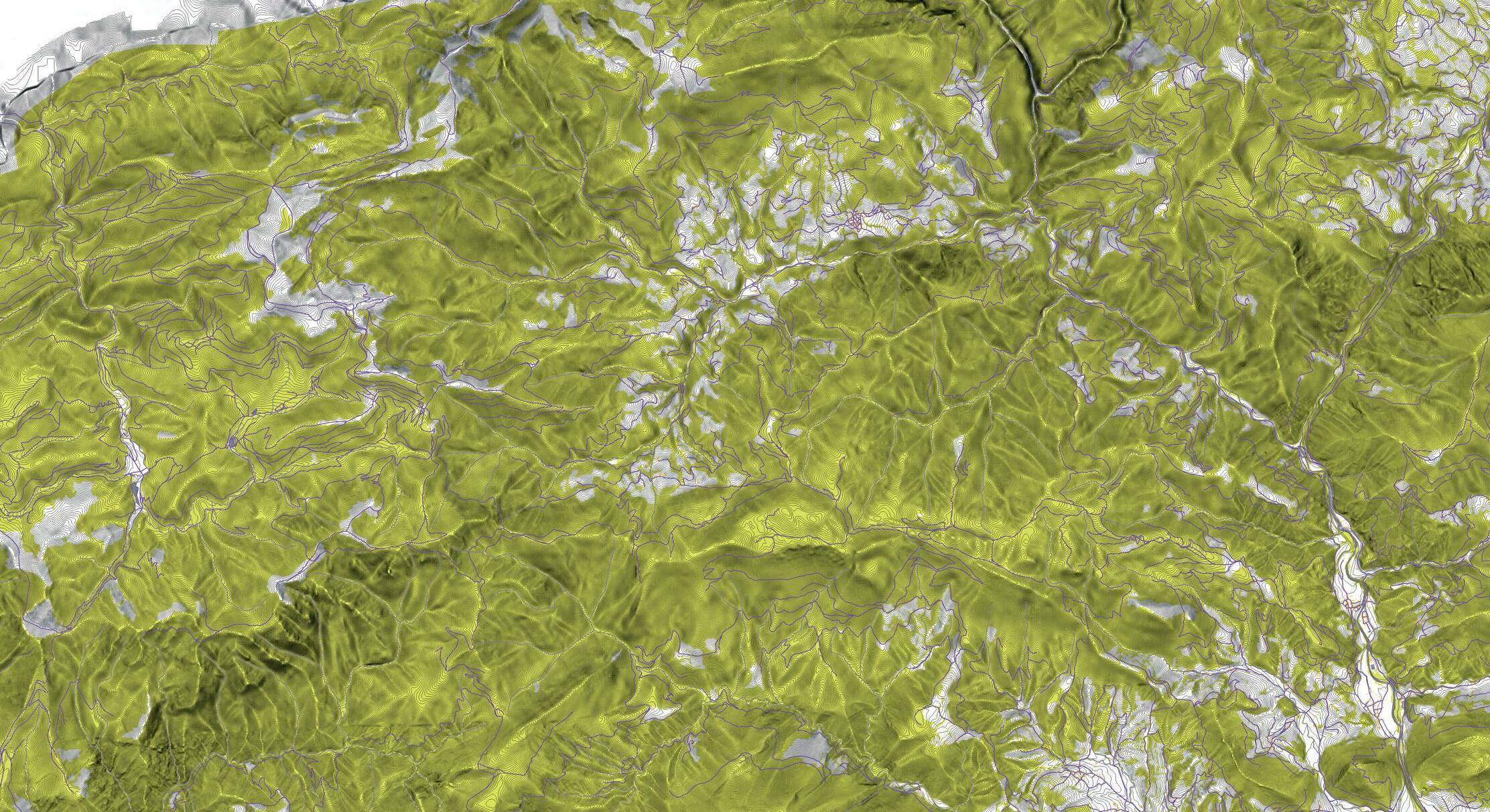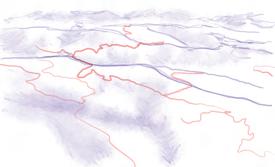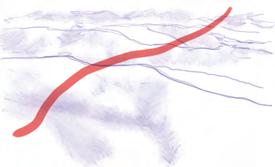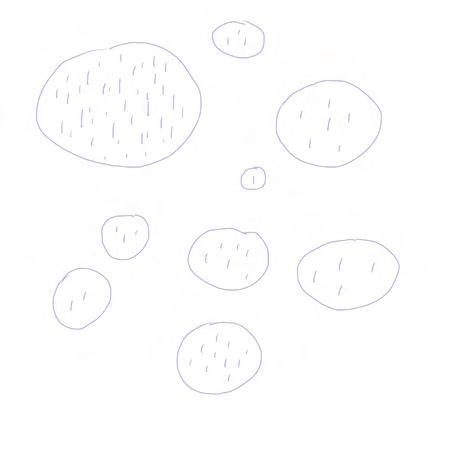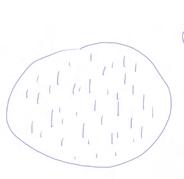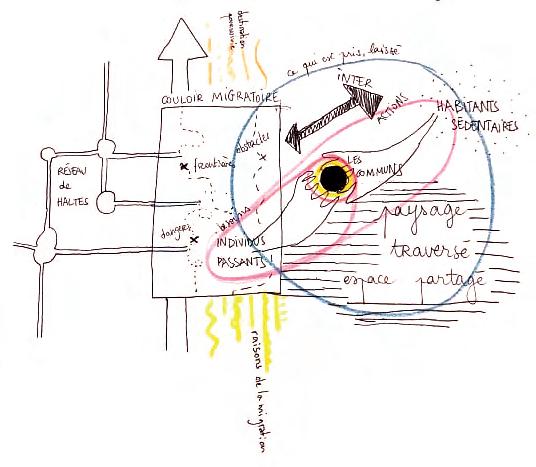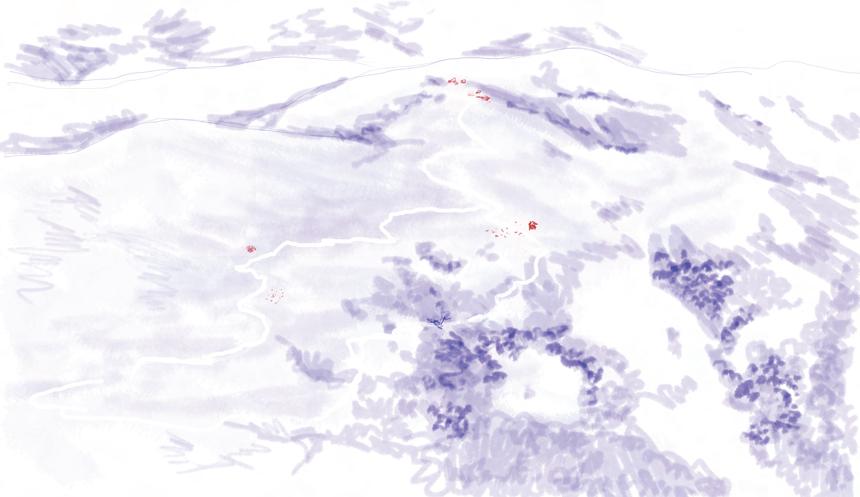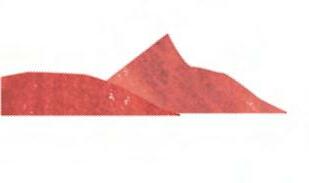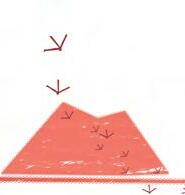Les paysages du passage dans le Pays

basque français
Affirmer l’identité accueillante d’une terre de migrations comment la cohabitation entre sédentaires et passants peut-elle participer à la fabrique d’un territoire en mouvement ?
 Louise Pinsard Mémoire de fin d’études 2021-2022
Louise Pinsard Mémoire de fin d’études 2021-2022

Ce qui motive les déplacements du passant n’a aucune importance, il suffit qu’il soit là et qu’il n’y demeure point.
Denis Delbaere, La fabrique de l’espace public

Le jury
encadrantes président
1. introduction
p. 8 passer p. 10 dans le pays basque p. 12 aujourd’hui
2. caractériser le territoire
Léa Hommage Bénédicte Flatet Olivier Gaudin Kantuta Schneider Marin Schaffner
Architecte paysagiste DPLG Enseignante de projet de paysage (3ème année à l’ENP Blois)
Formatrice de la voix Enseignante en communication orale (4ème et 5ème années à l’ENP Blois) Docteur en philosophie des sciences sociales Enseignant en histoire de la formation des paysages (3ème et 4ème années à l’ENP Blois) Maître de conférence à l’ENP Blois
invité.e.s
Ingénieure paysagiste DPLG Ancienne élève de l’ENP (promo 2015)
Auteur et traducteur Co-directeur des éditions WildProject Ethnologue
Sources et crédits
Ce document est un travail étudiant. En l’absence d’indication, les illustrations, cartographies et photographies sont des documents personnels. Toute reproduction totale ou partielle de l’un de ces documents est soumise à l’accord de son auteure.

Pour toutes informations : louise.pinsard@orange.fr
p. 14 où est-on ? p. 16 socle et paysages p. 30 territoire en mouvement
3. regarder en arrière
p. 38 traversées historiques p. 48 un terreau d’accueil
démêler les fils 4.
p. 50 les migrants p. 68 les oiseaux migrateurs p. 74 les transhumants p. 82 les marcheurs-pélerins p. 90 le territoire sillonné : de l’espace au lieu
5. les paysages du passage
des paysages accueillants ? p. 92 Bayonne p. 98 Hendaye p. 104 St-Jean-Pied-de-Port p. 110 Organbidexka
vers le projet 6.
p. 116 que peut faire le paysagiste ? p. 120 aiguillage et horizons p. 122 intentions p. 128 fin de l’étape
p. 132 bibliographie, références p. 136 remerciements
4
1. introduction

La porte de la voiture claque. Dans son gaz échappé s’éloigne avec elle une silhouette vers ailleurs. Autour de moi des langues incomprises et des pas qui se pressent, viennent pour aller.
Où donc ? Qu’est-ce qu’il reste de leur passage ici ? Et qu’ont-ils emporté avec eux ?
Ils foulent ce même sol sur lequel je suis et je questionne la manière dont chacun de nous vit. J’ai la sensation que nous sommes capables de créer des nids un peu partout. L’hyper-mobilité à laquelle nous avons accès aujourd’hui réduit l’espace mondial dans notre poche. Quand on a les pieds ancrés quelque part, on fait nôtre l’espace que l’on fréquente au quotidien ; l’apprivoise, le transforme, le politise. Dans notre sédentarité établie, des formes de passage teintent toujours les espaces de leur trace, et mettent souvent mal à l’aise les décideurs de la ville, les habitants ; comment appréhender une population de gens du voyage ? Comment est-ce possible de vivre ensemble sans créer d’attache spatiale ? L’espace public demeure pour tous.
Les itinérances me fascinent et me vertigent. J’aimerais qu’elles m’accompagnent pour ce voyage inconnu vers le diplôme de paysagiste.
6
7
Passant.e

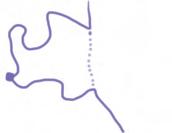


l’individu qui passe l’étranger personne qui ne séjourne que très peu de temps quelque part


Sédentaire




l’individu qui reste qui vit à un endroit fixe
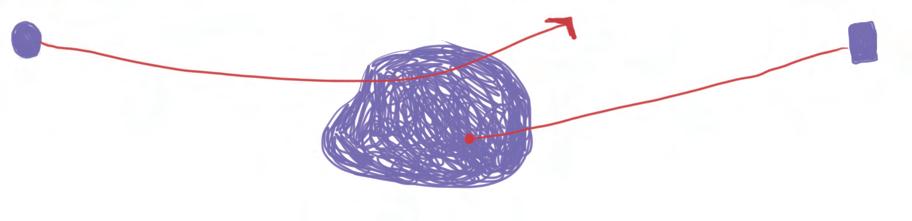

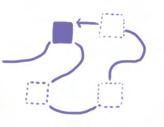

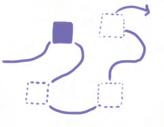

se déplacer déambuler se rendre progresser
monter
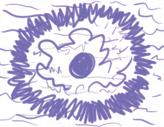
découvrir

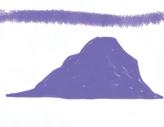
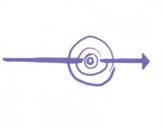

avoir un mouvement de déplacement franchir une limite traverser un espace en parlant d'un artiste, donner une représentation disparaître, s'estomper, cesser d'être

passer
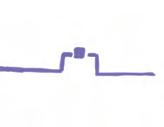
Passage
ENDROIT par où l’on passe - ACTION de passer quelque part pour un temps assez bref grande CIRCULATION de personnes en un lieu donné - ACTION des animaux migrateurs, et notamment des oiseaux, traversant une région pour se rendre dans une autre.
SERVITUDE DE PASSAGE : droit de passer sur la propriété d’autrui, servitude légale si le propriétaire d’un fonds n’a pas d’autre issue pour accéder à la voie publique.
passage piétons : ZONE BALISÉE que les piétons doivent emprunter pour traverser une rue.
PETITE RUE passant sous le premier étage des maisons, sur une partie au moins de son parcours, voie qui sert de passage entre deux rues ou bâtiments.
descendre sauter se faufiler traverser franchir entrer faire halte animer laisser faire un détour s ’ adapter éviter fuir emmener

stationner observer emprunter quitter

8
9
Dans les journaux on parle d’itinérance. De ses effets aujourd’hui, problématiques ou simplement factuels. Une nouvelle route migratoire arrivant par l’Espagne transforme le Pays basque en terre d’accueil pour des centaines de migrants venus d’Afrique subsaharienne. Dans le sens inverse, les oiseaux migrateurs débutent leur vol pour aller hiverner. Lisant cela, je suis moimême en vadrouille à pied et à vélo et je croise des dizaines de gens en shorts et chaussures de rando qui suivent les petits coquillages cloués aux poteaux de bois. On m’invite à venir à la fête de la transhumance qui verra les troupeaux redescendre des estives à l’automne. Je me rends compte que ces bêtes que j’avais l’habitude de voir en hauteur quand je randonnais petite ne sont pas d’étranges habitants de ces sommets mais qu’ils n’y passent qu’une partie de l’année.



Tous ces passants sont représentatifs de dynamiques à différentes échelles, par exemple internationale pour les migrants et les oiseaux, ultralocales pour les bergers transhumants pour qui le lien et le soin du paysage sont indissociables.

Alors je voudrais rassembler tous ces individus sous leur grande catégorie d’êtres itinérants et observer comment les accueille cette portion de territoire qu’ils traversent tous. Un sujet pétri de questions politiques, sociologiques, économiques que je décide de regarder sous l’angle de l’espace.
À l’aune d’une ère où les mouvements de population sont plus que jamais en ébullition, la multi-frontalité du Pays basque l’expose à ces divers flux dont la géographie facilite l’apparition.
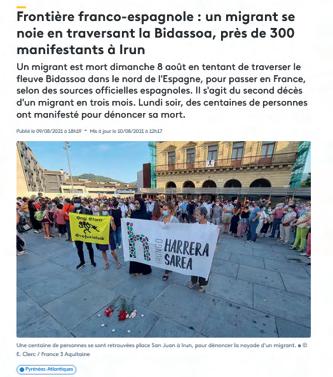
Il me semble que le point de vue d’un paysagiste, de plus en plus important dans le débat public, doit intégrer et valoriser cette caractéristique particulière du territoire dans une réflexion globale d’aménagement.
dans le pays basque

10 11
1. introduction
1. introduction
aujourd’hui
Pas si loin le temps où le gouvernement fichait toutes les personnes en mouvement1. Dans le pays où l’on vit, on peut normalement circuler comme bon nous semble. Ici, grande terre de tourisme dédiée depuis que les vacances existent, on le voit bien à l’été. Des centaines de milliers de personnes viennent temporairement découvrir la douce dynamique de la côte basque, apprendre à surfer, randonner sur ses versants, et goûter au mélange des climats gorgés de soleil et de pluies intenses.
Il y a aussi l’installation sérieuse du télétravail dans la vie qui pousse les gens à aller vivre dans des endroits plaisants. Je vois un bout de territoire dynamique, fonctionnant à la fois selon des logiques traditionnelles très ancrées et un développement international. Dans ce contexte, des flux plus ou moins vitaux, plus ou moins subis, sont moins reluisants pour le territoire car ne participent pas - ou moins visiblement - à sa stature économique. Je pressens que c’est ici un cadrage idéal pour étudier l’impact du passage dans le développement d’un territoire et une manière d’envisager l’installation d’un projet pilote autour de l’accueil dans l’espace public.

Partant de l’existant, du contexte actuel, m’intéressant au passé historique valant au pays basque sa qualité de «terre d’accueil», je vais dans ce mémoire démêler les fils des quatre passages énoncés : leur route, les gens et structures impliquées dans celle-ci, les conflits rencontrés et leurs besoins. Alors je déterminerai des cadrages où viennent à se croiser ces quatre figures. J’analyserai comment l’arpentage transforme un espace en lieu, et déterminerai alors des enjeux localisés selon l’étude faite au préalable. J’essaierai de déterminer ce qu’est un paysage du passage, et ce que le paysage peut apporter aux migrations. Enfin, je vous emmènerai dans quatre grands lieux de croisement puis commencerai à imaginer un projet d’aménagement ayant la migration comme cœur de pensée.
1 : Le livret de circulation était un document requis et obligatoire en France pour toutes les personnes, enfants compris, françaises ou étrangères, n’ayant pas de domicile fixe ni de résidence fixe depuis plus de six mois, et âgées de plus de 16 ans. Il a été supprimé par la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté, publiée au Journal officiel et entrée en vigueur le 29 janvier 2017. (source : www.wikipedia.fr)

12
Affirmer l’identité AccueillAnte d’une terre de migrAtions commentlacohabitation entresédentairesetpassants peut-elleparticiperàlafabrique d’unterritoireenmouvement?
2. caractériser le territoire où est-on ?
Blois > St-Pierre-des-Corps : première étape sur mon plongeon vers le sud-ouest. La couleur du train floqué d’un département lointain m’annonce que les paysages qui m’attendent sont encore à plusieurs heures de trajet. À Bordeaux déjà, l’air est différent, plus chaud, les Landes toutes proches pointent leurs millions de pins bien rangés. Je ne les vois même pas tant ils strient électriquement le paysage. Deux heures enfin et le train ralentit. J’ai traversé la France en diagonale, c’était simple, en fait. Je de scends mon vélo, mon sac, et pose le pied à Bayonne. La lumière n’est pas celle de l’été où je viens régulièrement passer des vacances. Elle est blanche et diffuse, continue. Je suis dans la vie réelle des gens, en novembre, loin des relâches estivales ; téléphone, travail, transports. J’ai toujours aimé cet endroit pour ce qu’il me renvoyait d’énergie, de puissance rurale, de musique et de noirceur dans les yeux des gens. Rondes montagnes à l’horizon, vertes mais noires, dont l’eau se joue. Immense dans l’océan bordé de falaises. Minuscule dans les ruisseaux qui suivent les courbes. Des animaux dans la montagne et des etxe, maisons traditionnelles blanches rouges et vertes. Un pays entier dans le pays. Ça doit être ça, une « région naturelle ». Derrière ces images bucoliques, je suis venue chercher une autre réalité qui existe chaque jour.
Le Pays basque est donc une entité très ancienne, à cheval sur la France et l’Espagne et découpée maintes fois au gré des histoires de pouvoir. La force de l’identité territoriale suffit à fixer mon cadrage, quoique très grand : j’observerai des fourmilières sur ces 3000 km² français.

Je me trouve là à de multiples frontières, celles de la terre et de l’Océan, de la plaine et de la montagne, de deux entités nationales distinctes. Le contexte géographique me laisse déjà penser que c’est ici une porte d’entrée, de sortie, un lieu de croisements et de sillonnements.

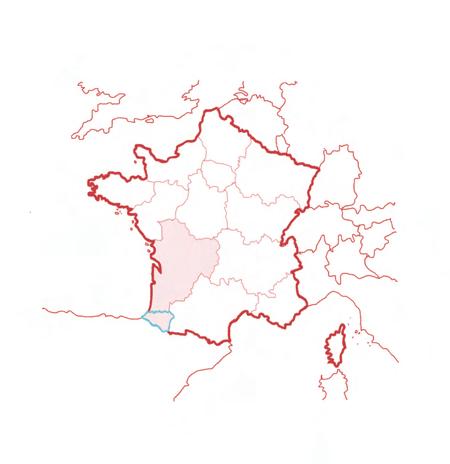
40 60 km 20
à l’extrémité sud-ouest de la France, il y a la région Nouvelle-Aquitaine
Le Pays basque Le Béarn
on y trouve le département des
Biscaye le Labourd la BasseNavarre
Guipozca Alava
la Soule Navarre

le Pays Basque, Euskal herria en langue basque, est une entité transnationale, qui s’étend sur la France et l’Espagne. Il est découpé en sept provinces, établies dans les esprits des basques et fondées sur des paysages propres.
Ipparalde Pays basque nord
Hegoalde Pays basque sud
Frontière franco-espagnole
14
Pamplona Vitoria
San Sebastian
Bilbao
Bayonne Hendaye Mauléon St Jean-Pied de-Port
2. socle et paysages
caractériser le territoire
D’abord une approche statique du territoire pour l’appréhender par ses formes.
Le chaîne pyrénéenne qui naît dans le Pays Basque se forme il y a environ 50 millions d’années à la suite de multiples collisions et subduction de la plaque eurasique et ibérique. Ici, les plus hauts monts excèdent à peine 2000 mètres ; les paysages de piémont glissent doucement de collines en plaine littorale. Nous sommes à la croisée de plusieurs milieux spécifiques influencés notamment par la diversité des climats : les airs océanique et montagnard se mêlent et créent un régime de pluies soutenues. On dit qu’avec le réchauffement climatique, le climat sera subtropical d’ici quelques années seulement.


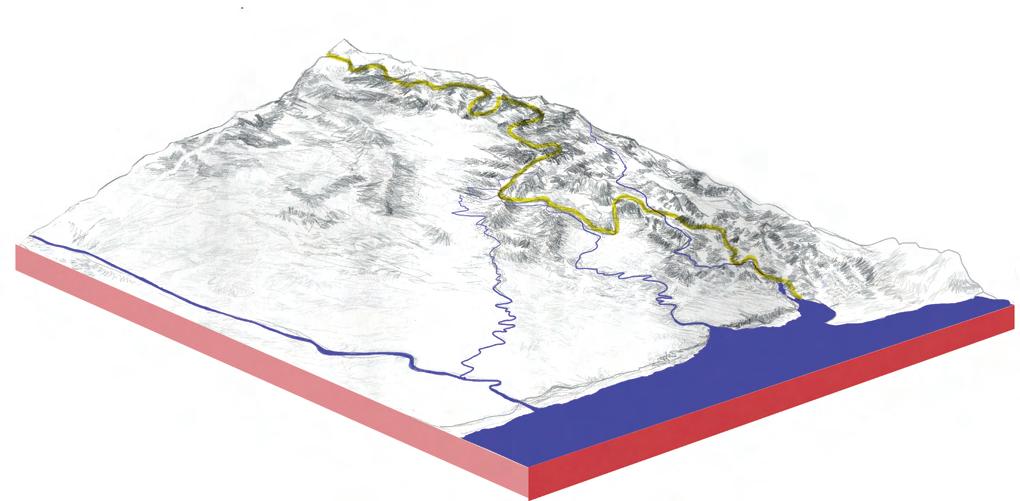
Le sol, de nature acide, accueille une végétation luxuriante faites de fougères, de hêtraies mixtes, et d’herbes grasses sur les versants. Les dunes littorales accueillent une végétation très spécifique (pelouses littorales, prés-salés, landes maritimes).
Des formes géologiques très particulières, appelées flyschs, ponctuent la côte au niveau d’Hendaye particulièrement; ce sont des dépôts sédimentaires de grès et de marnes, accumulés puis redressés à 45° lors de l’orogénèse.
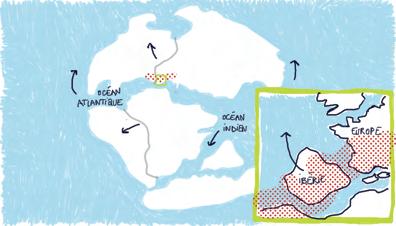
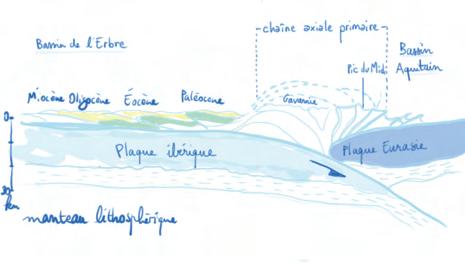
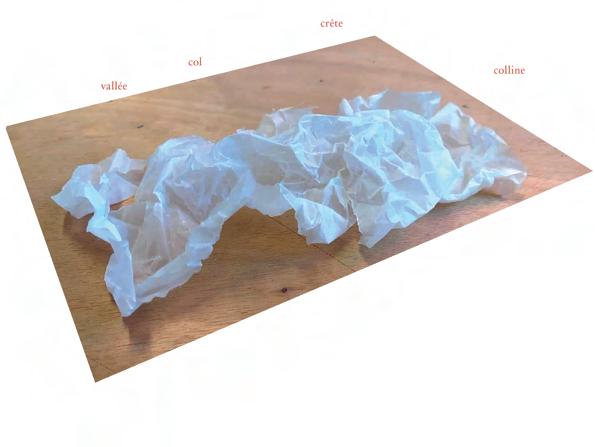

La diversité des milieux invite l’Homme à s’adapter à son milieu de vie. Ainsi, la ville vient se loger au creux des vallées où passe les rivières (l’Adour, la Nive, la Nivelle, la
L’orogenèse Hercynienne (- 360 à - 290 MA)
Dislocation de la Pangée (ère Mésozoïque -250 à -65 MA)
L’orogenèse Pyrénéenne ( - 53 à -33 MA)
Bidassoa et la Bidouze) et leurs multiples cheveux. Des zones humides, dans la continuité des Landes, bordent ces rivières et constituent des milieux diversifiés, entre marais et tourbières. Elles furent un support de pâture pour les bêtes. L’agriculture, tournée vers l’élevage et la polyculture (maïs notamment), se base essentiellement sur le pastoralisme qui permet d’exploiter les terrains de montagne peu cultivables. Les chemins de montagne qui mènent aux cols pyrénéens, routiers ou pédestres, ne sont que la reprise des anciens chemins pastoraux, qui ont eu tôt fait de sillonner la montagne pour passer d’un versant à l’autre. En effet, la frontière entre France et Allemagne créé une fausse séparation entre des versants qui forment un tout. La montagne, qui paraît sauvage, est en fait entretenue par les bergers et leurs bêtes qui vont et viennent de haut en bas des vallées pour pâturer sur les hauteurs.
Aujourd’hui
16 17
St-Etiennede-Baïgorry
St-JeanPied-de-Port St-Palais
MauléonLi charre
Bayonne Anglet Biarritz
Hendaye Ascain
Sare St-Jeande-Luz
Irùn Hondarribia Espelette
0 5 10 km N
Contour de l’agglomération CAPB Zone urbanisée
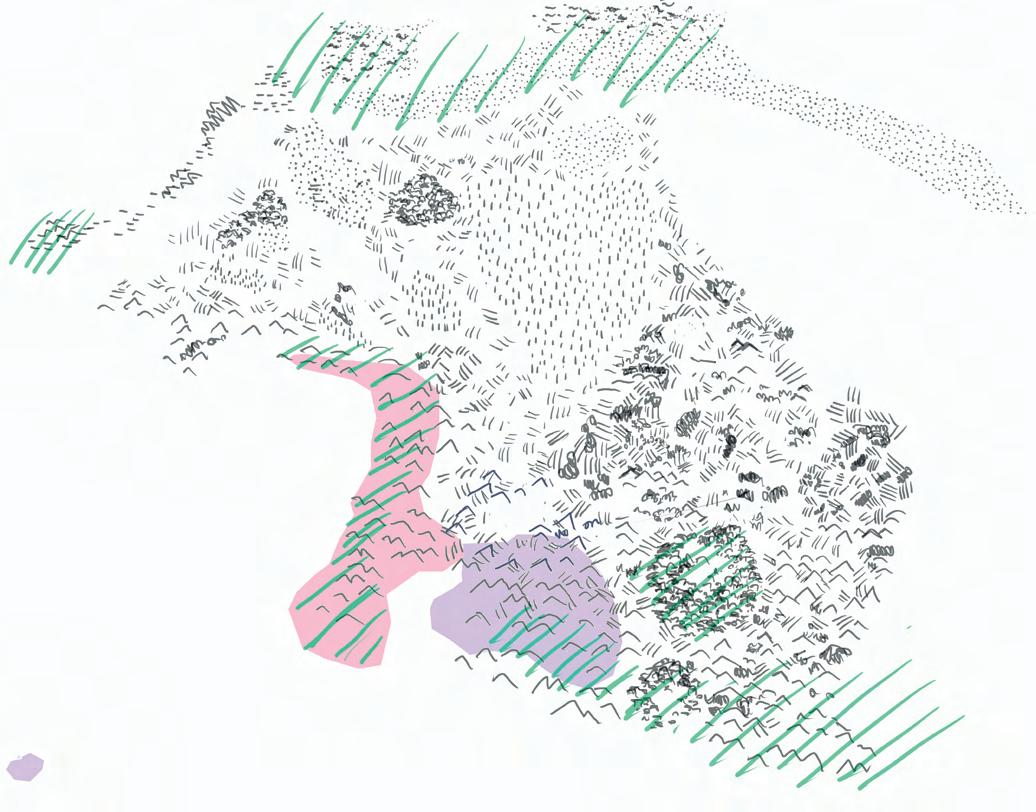
Mobilités Route départementale Autoroute Voie ferrée Chemin de Grande Randonnée
Milieux
Littoral rocheux, falaises, flyschs
Littoral sableux, estuaire, dunes
Zones humides
Barthes, plaines alluviales

Forêt, boisements Landes
Agriculture (polyculture-élevage) Montagne Basque
Périmètres Natura 2000
Zone de Protection Spéciale (oiseaux)





Site d’Intérêt Communautaire Montagne de St Jean-Pied-de-Port
Site d’Intérêt Communautaire Montagne des Aldudes
Une image de territoire idéal subvient aussi bien pour les touristes que pour les locaux : succession de panoramas idylliques, proximité de l’océan et des embruns, contact des montagnes très vertes, d’une nature enveloppante, riche de couleurs et de vie. L’abondance de paysages vivants permet de penser que la question du bienêtre et du bien-vivre est au cœur de la vie des gens.
Terre de montagnes et d’océans, l’ensemble du Pays basque est vraisemblablement découpé en deux parties, d’abord par leur socle puis par les dynamiques humaines qui viennent influer sur ses paysages.
La partie littorale est caractéristique des paysages du bassin aquitain, où se sont installées les 15 plus grosses communes du Pays basque.
La partie rurale est une mosaïque composée de prairies, champs et habitats dispersés où les distances s’allongent et où l’usage de la voiture devient indispensable pour parcourir un bout de chemin. Les zones transfrontalières diluent lentement les codes de l’un et de l’autre des côtés en passant une tête dans le Béarn je vois que les maisons changent immédiatement de cachet ; en grimpant à la frontière je n’entends presque plus que parler espagnol ou basque. À Irùn, sur le versant espagnol de l’Atlantique, la différence urbaine est nette bâtiments plus resserrés, plus hauts, matériaux différents, plus de monde dans les rues, plus de vastes places.
Les villes du littoral ressemblent peu ou prou à d’autres grandes villes; Bayonne et Biarritz imposent de hautes et grandes maisons bourgeoises, Anglet semble
compléter l’ensemble par de vastes zones pavillonnaires et commerciales. D’autres communes côtières comme St-Jean-de-Luz se sont construites autour d’une dynamique portuaire. L’eau occupe une importance sinon économique, toujours visuelle : calme dans les lacs collinaires, bienfaitrice dans les villes thermales (Cambo-les-bains), puissante dans l’Océan et lointaine dans les neiges d’horizons hivernaux .
Les grandes voies de communication sillonnent le littoral; le train longe la côte et fait une percée jusqu’à St-Jean-Pied-de-Port; l’autoroute A63 longe Bayonne et le réseau routier maille le territoire, s’étiolant en routes sinueuses puis chemins pastoraux à mesure que les dénivelés progressent.



La question de la traversée et du franchissement imprègnent ce territoire; mais un obstacle pour l’un est un abri pour l’autre. Une halte en fera fuir d’autres; chaque passant utilise le territoire selon ses besoins, et recherche la continuité et la diversité des couloirs.
Aucun de ces espaces n’est cloisonné. Ce qui vaut pour un ensemble administratif perdure dans l’identité bâtie, morphologique, linguistique, traditionnelle. Si le Pays basque s’étend jusqu’en Espagne, il est en France traditionnellement divisé en trois provinces assimilables à des paysages et activités particulières.
19
Constitué de vallées enclavées, c’est l’endroit le plus montagnard et rural.
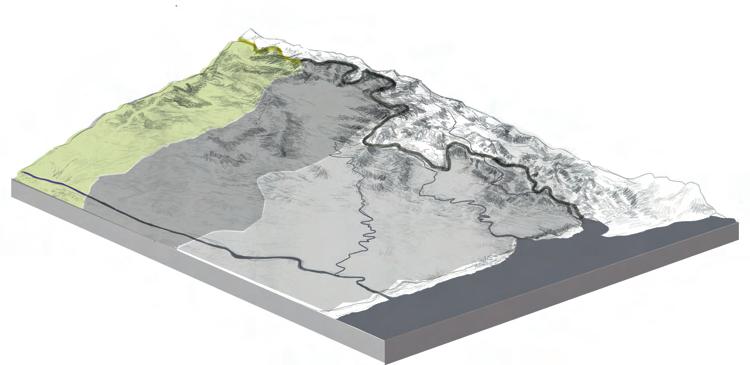
On dit que c’est la province la plus préservée du Pays basque. Ici, on trouve les pics et gouffres les plus hauts de l’Iparralde, des montagnes rocheuses coiffées de forêts de feuillus comme la forêt d’Iraty - plus grande hêtraie d’Europe. Le Pic d’Orhy culmine à 2017 m. Le col de la Pierre St-Martin collecte les exploits cyclistes. Le col d’Organbidexka voit passer les oiseaux migrateurs. Aux horizons lointains, d’autres Pyrénées immenses nous encerclent.
Un peu partout, on voit des brebis et des chevaux, traces des anciens chemins pastoraux qui passent d’un côté et de l’autre des montagnes.

L’habitat est dispersé dans les étendues gigantesques; l’économie est rurale, autrefois tournée vers l’industrie de l’espadrille à Mauléon.
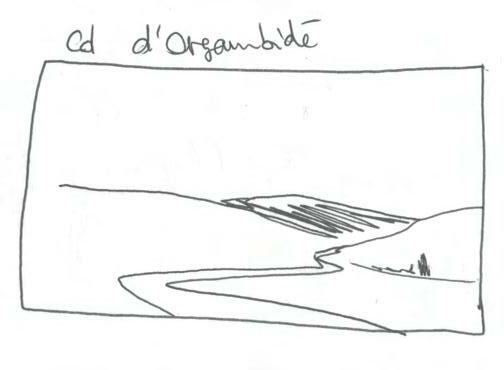
Les pâturages s’étendent largement et déjà les terres basco-béarnaises se mêlent par leurs traditions pastoralistes.
La Soule
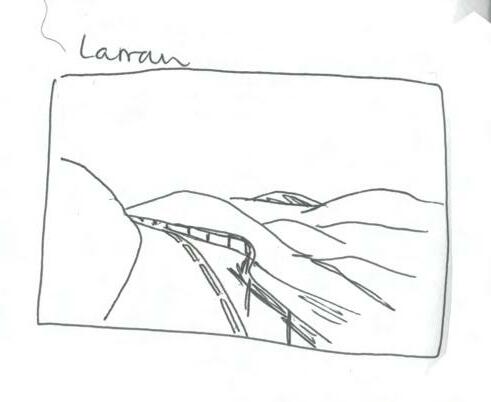
montagne pâturages habitat dispersé
Des cols creusés que suivent la frontière. Lieux reculés, convoités des cyclistes et des randonneurs, ils sont aménagés par des routes en serpent et accueillent parfois un village au creux, comme Larrau.
20 21


22 23
Sur la route d’Organbidexka
photo Michel Carlue
La
Basse-Navarre vallonné agricole cheminer

La Basse-Navarre était appelée le territoire d’outre-port, «par delà des montagnes».
Au fond des vallées, la ville de St-Jean Pied-de-Port, grande figure du passage (pèlerinages, route commerciale menant à Pampelune) en garde la trace dans son toponyme.
C’est une province très agricole avec un mélange de cultures de plaines, de landes à genêts vallonnées, de collines profondes et de pastoralisme sur les versants. Les randonneurs y trouvent leur compte.



C’est là où se trouve le carrefour européen des chemins de Compostelle à St Palais qui deviennent un seul fil pour rejoindre Compostelle ; cela laisse des traces dans l’organisation spatiale avec des prieuréshôpitaux, des auberges pour accueillir. Dans les creux on retrouve les traces de passages de marchandises illégales des contrebandes avec les ventas, ces maisons où l’on peut aujourd’hui se restaurer et acheter quelques bricoles à coût modique.
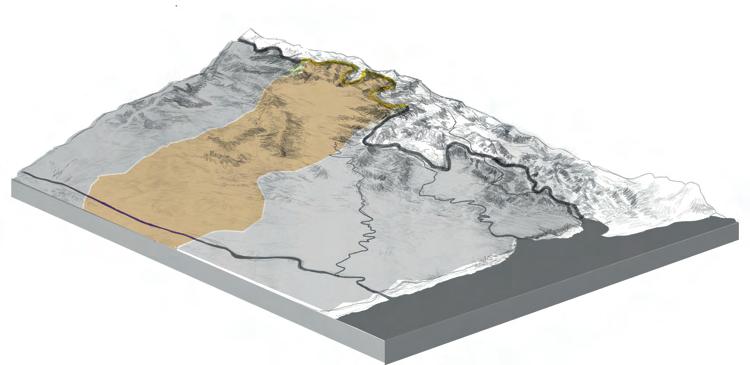
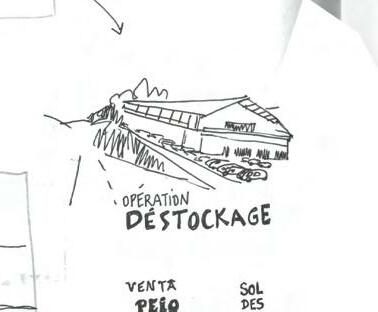

24 25
En arrivant à St-Jean-Pied-de-Port
Le Labourd interface littoral urbain


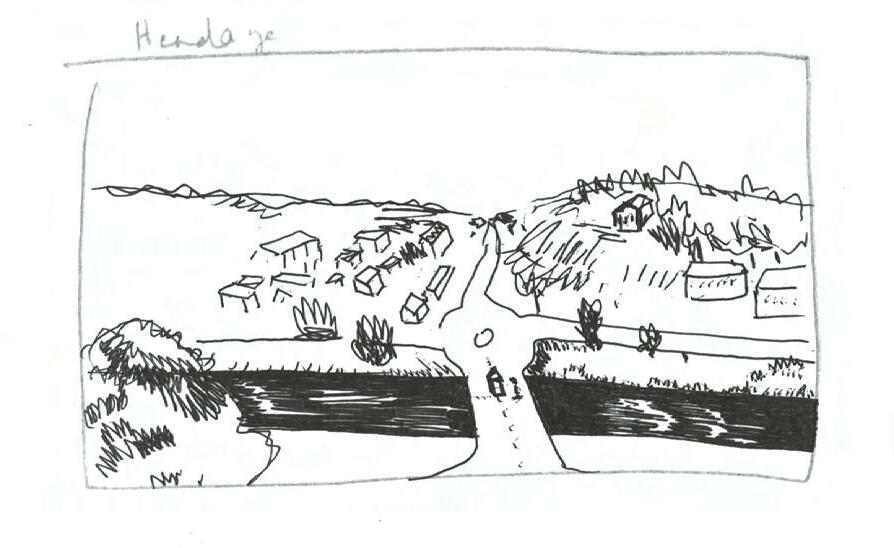
Le Labourd se situe à l’extrémité septentrionale de la côté atlantique. Il est à l’interface océane et s’organise en plaines et en pôles urbains ; l’axe BAB, pour BayonneAnglet-Biarritz, y est désormais bien connu. Son littoral rocheux et dunaire, très remanié pour y accueillir un tourisme balnéaire, déroule des paysages de carte postale.
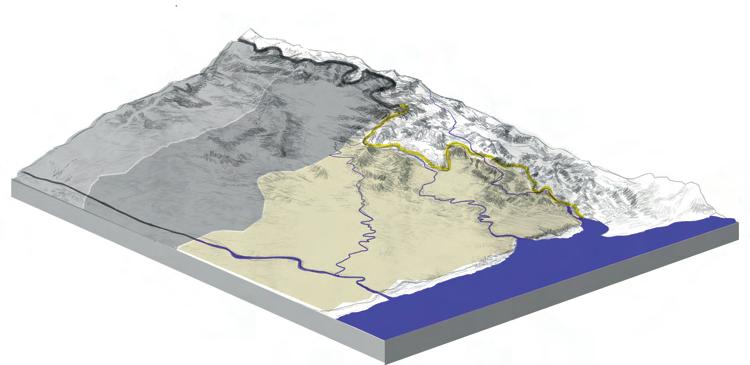
En allant vers les Landes au nord, on trouve les barthes et zones humides autour de l’Adour, ces immenses marais mouillés peignant la rivière jusque dans le coeur. Dans la plaine, on est à plat. Sur la Rhune, on voit la mer, l’Espagne, on voit tout. La plupart des flux transfrontaliers transite par le Labourd aujourd’hui, notamment car l’autoroute y passe. C’est ici qu’on vient prendre le train, l’avion, le bus. Historiquement, c’est un pays de passage transversal, car ouvert sur le monde commercial (Fort de Socoa à St Jean de Luz, citadelle Vauban, chantiers navals et port industriel à Bayonne,…)
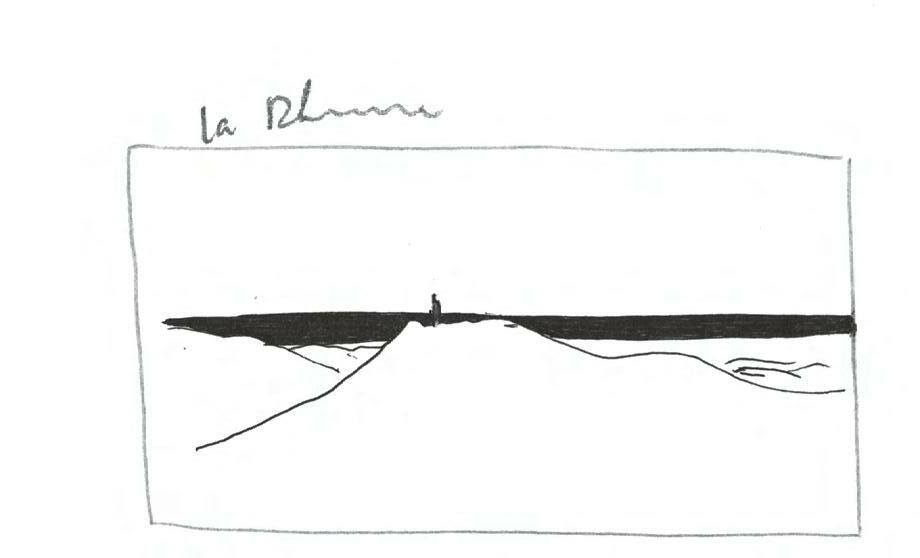
et aussi verticalement avec les réfugiés espagnols qui affluèrent par ici. Aujourd’hui, l’attraction urbaine y fabrique de nombreux flux complexes et croisés.
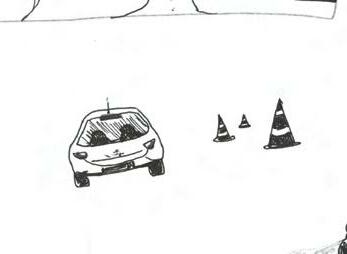
26 27
Sur le domaine protégé d’Abbadia, aux abords d’Hendaye



En quittant St-Pée-sur-Nivelle
Le Pont Grenet enjambe l’Adour à Bayonne, quelques centaines de mètres avant l’estuaire

28 29
caractériser le territoire

territoire en mouvement
L’Eurorégion


Région Nouvelle Aquitaine
Les Pyrénées bougent ! Mais les dynamiques plus perceptibles à notre échelle viennent des flux humains, économiques et des politiques à l’oeuvre sur le territoire.
En 2017, les dix intercommunalités qui composent ce que l’on appelle le «Pays basque» - et qui ne correspond alors à aucun découpage administratif, fusionnent au sein de la naissante Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB). Une nouvelle institution qui permet de canaliser des voix indépendantistes insatisfaites de n’avoir aucune structure de gouvernance indépendante de l’Etat. La création d’un pôle métropolitain «Pays de Béarn» en réaction, constitué autour de Pau, achève le processus de séparation des Basques et Béarnais au sein du département des Pyrénées-Atlantiques. Dans les faits, deux têtes pour la préfecture du département donc ; à Pau officiellement, et à Bayonne pour déléguer. La plupart des bâtiments administratifs sont dupliqués afin que la nouvelle collectivité de 158 communes (le plus grand nombre de France) puisse exercer ses compétences.
Dirigée par Jean-René Etchegaray, maire UDI de Bayonne depuis 2014, elle regroupe 312 000 habitants. La communauté d’agglomération est un outil pour agir : la double casquette permet de gouverner de manière volontariste sur le territoire et d’avoir de potentiels impacts à des échelles nationale et internationale. Différents pôles territoriaux disposent de services répartis grâce à l’installation de « maisons de communauté » dans le territoire, afin de favoriser le développement des zones reculées et de conduire des projets en adéquation avec le contexte ultralocal ; les problématiques de territoire sont en effet très disparates entre le littoral soumis à une pression urbanistique débridée et un arrière-pays encore affecté par l’exode rural.
La Communauté d’Agglomération travaille aussi en collaboration avec les autres entités basques frontalières via différentes instances et conseils.
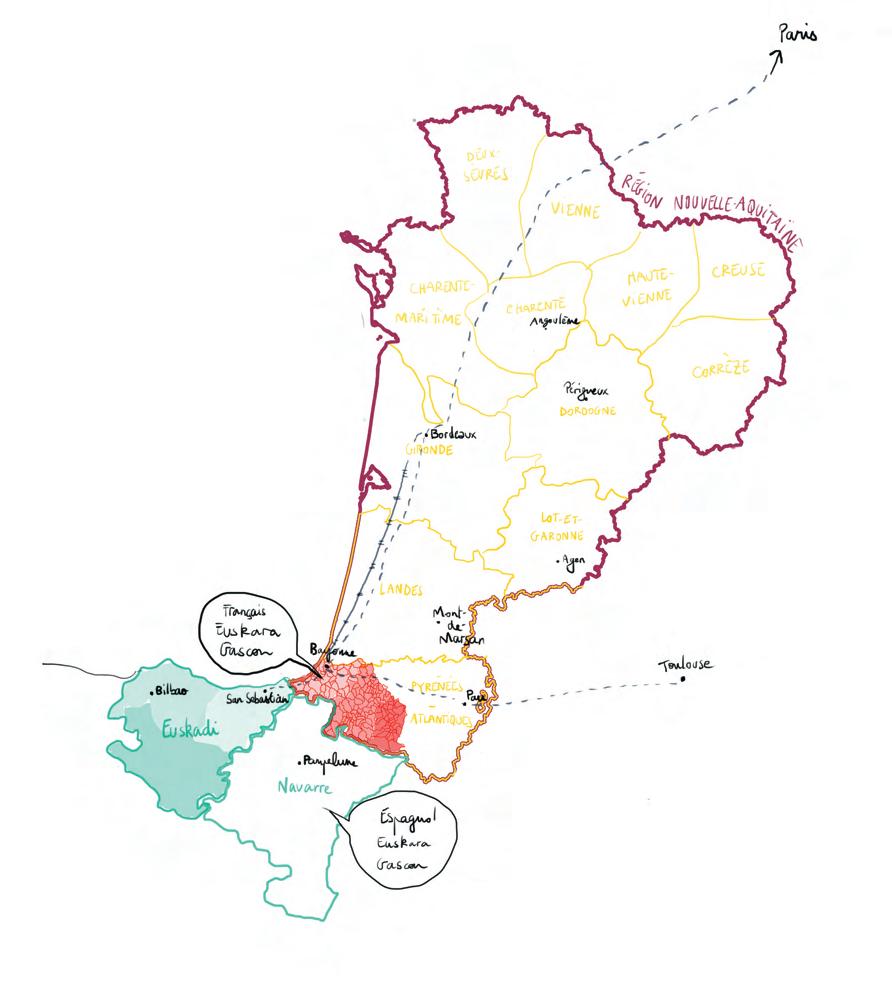
Communauté Navarre (650 000 hab.)
Communauté Euskadi (2 200 000 hab.)
8h en voiture 2hen train 1h45 en bus 56 h à pied 0 25 50 km 100

30 31 2.
Les champs d’action de la CAPB
• Définit le contenu et les conditions de mise en oeuvre d’une vision stratégique pour le territoire
• Rédige les PLU, PLUI, PLH
• Soutient la production de logements locatifs sociaux et la réhabilitation du parc privé
tranSition écologique et énergétique
• Rédige le Plan Climat Pays Basque et le Projet
Alimentaire de Territoire pour décliner sa politique Climat-Air-Énergie et Alimentation
•Concertation à travers le territoire
mobilitéS
• Structure les réseaux de bus (transports en commun et scolaires), les pistes cyclables, les modes de transports alternatifs à la voiture.
• Objectifs de continuités transfrontalières et de transports plus propres
Enseignement supérieur, recherche et formation
cohéSion Sociale
• Intervient en complément des communes et d’autres aceurs privés/publics sur les thèmes de l’autonomie, la précarité, la santé, l’enfance, la jeunesse, l’accessibilité des services public (Projet de Cohésion Sociale)
• Mobilise les fonds européens pour le développement (FESI)
• Porte 7 projets de coopération POCTEFA (programme européen de coopération transfrontalière entre la France, l’Espagne et l’Andorre pour les acteurs situés des deux côtés des Pyrénées)
• Mise en place d’une stratégie de coopération transfrontalière (SCT) à horizon 2030 (COPIL, ateliers d’acteurs, institutions espagne/france)
• Assure l’ensemble des missions du service d’eau potable et d’assainissement des eaux usées, ainsi que la gestion des eaux pluviales
• Exerce les compétences GEMAPI sur ses bassins versants
• Exerce des compétences facultatives relatives aux milieux littoraux, à la gestion des risques côtiers, à la lutte contre la pollution et à la gestion des zones de baignade
• Oeuvre au développement durable du territoire de montagne (projets LEADER)
• Accompagnement des instances de décision locales et des acteurs locaux (élus, éleveurs, habitants, associatiojns)
Développement économique
4 grands axes
Tourisme Agriculture, pêche et agroalimentaire
• Partenariats culturels, soutiens aux créateurs et à la multiculturalité, à l’apprentissage et à la découverte des arts
• De la collecte au traitement, vers une économie circulaire
bon mais, je suis un peu à la croisée de tout ça moi en fait...
32 33
Stratégie territoriale, aménagement et habitat
europe et coopération tranSfrontalière
Ingéniérie communautaire aux territoires et développement urbain et rural
Planification urbaine et patrimoniale
Habitat et gens du voyage
Foncier Réalisation d’opérations publiques d’aménagement (revitalisation centre-villes/ centre-bourgs)
economie
politiqueS linguiStique et culturelle
eau, littoral et milieux naturelS montagne baSque
prévention, collecte et valoriSation deS déchetS
Urbanisation et développement intense de la côte


L’engouement de plus en plus intense des touristes pour le Pays basque propulse le territoire dans des transformations profondes liées à la hausse démographique, la mobilité, l’économie. En moyenne, le tourisme représente 40 000 nuitées par jour sur l’année. Forte de cette attractivité, l’agglomération réoriente cependant sa stratégie pour calmer le tourisme de masse, par exemple en supprimant les campagnes de communication sur les lieux les plus touristiques : Bayonne, Anglet, Biarritz, la montagne de la Rhune à Sare. En été, 250 000 touristes quotidiens s’ajoutent à la population locale, alors que les villes côtières ne comptent pas plus de 48 000 habitants à l’année.

1950
Hendaye 2020
La côte s’urbanise, se mondialise, se construit à toute vitesse. Une surexposition qui fait débat entre une grande ouverture aux territoires extérieurs et des volontés de conservation de l’identité territoriale très ancrée. La crise du logement, latente depuis plusieurs années, explose avec la pandémie. De nombreux mouvements et manifestations dénoncent l’augmentation exponentielle du prix de l’immobilier et l’incapacité pour les basques de se loger, le foncier étant devenu inaccessible ; les villas se vendent à prix d’or, les résidences secondaires prolifèrent et la dynamique des logements type Airbnb pour les touristes affectent les locaux. On parle de logements vides et on regarde sa ville changer de visage au gré des constructions et des batailles foncières.

L’accueil au quotidien est une question récurrente.
Solde migratoire positif : +1.1 % chaque année à Bayonne + 2800 personnes par an au Pays Basque
« ...Biarritz, une cité où il y a plus de logements que d’habitants, et où pourtant se loger à l’année est devenu impossible » un militant du mouvement Alda 1 1 : Mobilisation au Pays Basque contre la hausse du prix du logement (Le Monde, nov. 2021)
Repli dans les communes rétrolittorales
Terre de passage économique

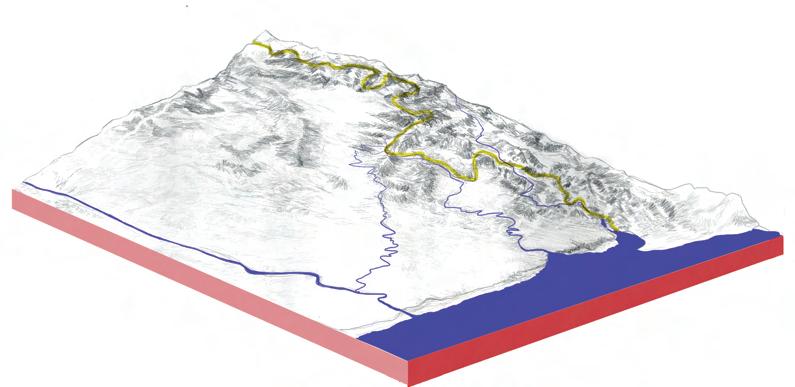
Aéroport de Biarritz

34 35
6700 1850 3000 200 1580 670 1530 700 48 000 38 700 26 000 6250 2600 2100 2000 62 000 17 000 16 800 14 100 4200 1200 3 millions de camions par an au péage de Biriatou (Hendaye) + 3 millions au col du Perthus = c’est 2x plus de passage que dans les Alpes Centre Européen de Fret à Mouguerre (Bayonne) pôle de transport et de logistique multimodal 100 000 m² d’entrepôts, 70 entreprises Un fret ferroviaire sous utilisé à la frontière Hendaye-Irùn Port de Bayonne 3ème port de commerce de Nouvelle-Aquitaine 3 millions de tonnes de marchandises par an 56 entreprises sur site Accessible toute l’année grâce à une activité constante de dragage à l’embouchure de l’Adour
Liaison avec Paris Orly, Paris CDG, Lyon, Nice, Bruxelles-Charleroi et Londres-Stansted plusieurs destinations françaises et européennes desservies de mars à octobre 15 ème aéroport métropolitain par son trafic voyageurs
Aujourd’hui alors, un exode urbain touche la population littorale. La dynamique urbaine de la côte s’étend vers Cambo, Hasparren, Bidache. Les enjeux immobiliers autour des aires urbaines empiètent alors sur la survie des milieux agricoles et naturels. Nombre d’habitants par communes et dynamiques de l’habitat
Bassin de vie transfrontalier
Milieux mouvants
623 km de frontière entre Espagne et France. Elle est traversée aujourd’hui par des voies internationales, essentiellement à ses extrémités. Ces voies sont des routes, des chemins de fer et chemins pastoraux. Qui passe la frontière ? La circulation est constante. Beaucoup habitent à Hendaye, mais travaillent à Irùn ou y font leurs courses, tandis que les touristes vont et viennent. Sur la route urbaine le rythme est tranquille. À Biriatou un peu plus à l’ouest passe l’autoroute. Le passage est très contrôlé dans les espaces urbanisés; dans les zones rurales, ça fonctionne autrement. Seules quelques sentinelles se postent à la frontière et pas en permanence. Ce sont les dynamiques de vallées qui façonnent la traversée.

Nombre de transfrontaliers par commune

70 30
Flux transfrontaliers
500 Travailleurs quotidiens Touristes annuels
La mer gagne du terrain sur les terres : entre 20 et 80 cm par an. L’érosion du littoral grignote la corniche basque et provoque des effondrements de pans de falaises. En novembre 2021, le préfet ordonne la fermeture du sentier littoral entre Ciboure et Hendaye, devenu trop dangereux. La route de la Corniche basque, fameuse pour ses panoramas et son tracés sinuant sur les courbes de la côte mais malheureusement bien trop proche d’elle, est donc remise en cause, tout comme les constructions trop proches du secteur; les communes, en accord avec le SCOT, se saisissent progressivement de cette donnée dans l’aménagement de leur territoire; une équation quand on sait l’attraction que représente la côte.













L’urbanisation et la pression touristique, très prononcées sur la côte avec aujourd’hui plus de 70% du littoral urbanisé, ont fortement impacté les milieux naturels originels1. Ces dégradations, généralement anciennes, ont entraîné une forte régression voire la disparition des végétations littorales par endroits, ne laissant parfois aucun vestige des anciens milieux naturels (plage d’Hendaye, baie de Saint-Jean-de-Luz, plage de Biarritz, les Sables d’Or à Anglet, etc.). La même constatation est faite dans les milieux rétrolittoraux où la biodiversité souffre de l’extension de l’urbanisation dans les périphéries urbaines.
L’érosion marine, couplée au phénomène de mouvement d’érosion des falaises
La
boues
côte
éboulements s’observent
les plus
que la
progressivement les pieds de falaises des formations plus Ainsi, d’importantes portions du littoral sont en régression Le recul des falaises ou des dunes perchées peut se faire mais aussi brutalement lors de tempêtes et de grandes marées plusieurs mètres peuvent s’effondrer en une seule fois. On observe donc une menace à deux échelles de temps différents surface stationnelles ou une perte brutale (ou quasi-totale) des est accentuée par sa corrélation avec d’autres menaces comme la progression des espèces xotiques envahissantes dans les zones érodées

36 37
Urrugne Ciboure
St Jean de Luz Hendaye
Biriatou
Sare
St Pée sur Nivelle
Ascain Ainhoa
Bayonne Biarritz Bidart
Anglet Cambo-les-bains
Données INSEE 2018
Entre Ciboure et Hendaye, le sentier littoral et la route de la Corniche surplombent les falaises de flyschs Sur la plage du Pavillon Royal à Bidart photo : Sud Ouest Figure 4 (Haut) Comparaison entre la carte de l’état-major 1820 – 1866) et la carte IGN actuelle sur la Baie de Saint-Jean-de-Luz (Bas) Comparaison des photographies aériennes
1965
royal
1 : Observatoire de la biodiversité végétale du littoral des Pyrénées-Atlantiques, Jean Denand, 2017
de 1950 –
avec celles d’aujourd’hui de la plage du Pavillon
maritimes
majorité de la
basque est soumise cette pression naturell des coulé
et des
dans les formations
meubles, tan
mer
Observatoire de la biodiversité végétale du littoral des Pyrénées-Atlantiques Bilan des travaux menés en 2017 v1.0
Figure 4 (Haut) Comparaison entre la carte de l’état-major 1820 – 1866) et la carte IGN actuelle de Saint-Jean-de-Luz (Bas) Comparaison des photographies aériennes de 1950 – 1965 avec celles d’aujourd’hui de la plage du Pavillon royal (source Géoportail)
L’érosion marine, couplée au phénomène de mouvements de terrain, entraîne un processus naturel de falaise maritimes La majorité de la côte basque est soumise à cette pression naturelle boues et des éboulements s’observent dans les formations les plus meubles, tandis que progressivement les pieds de falaises des formations plus ou moins dures Ainsi, d’importantes portions sont en régression Le recul des falaises ou des dunes perchées peut se faire régulièrement brutalement lors de tempêtes et de grandes marées où plusieurs mètres peuvent s’effondrer en On observe donc une menace à deux échelles de temps différents une régression progressive stationnelles ou une perte brutale (ou quasi-totale) des végétations La problématique de l’érosion par sa corrélation avec d’autres menaces comme la progression des espèces exotiques envahissantes zones érodées
Figure 5 Érosion progressive de la dune perchée du Pavillon royal à Bidart (à gauche), érosion brutale falaises du domaine d’Abbadia à Hendaye (à droite) (photo N. Meslage – CBNSA)
traversées historiques regarder en arrière
Ah ici, vous savez, on sait accueillir !
Et c’est parce qu’on le fait pour tous ceux qui passent par là. Quand cela commence-t-il ?
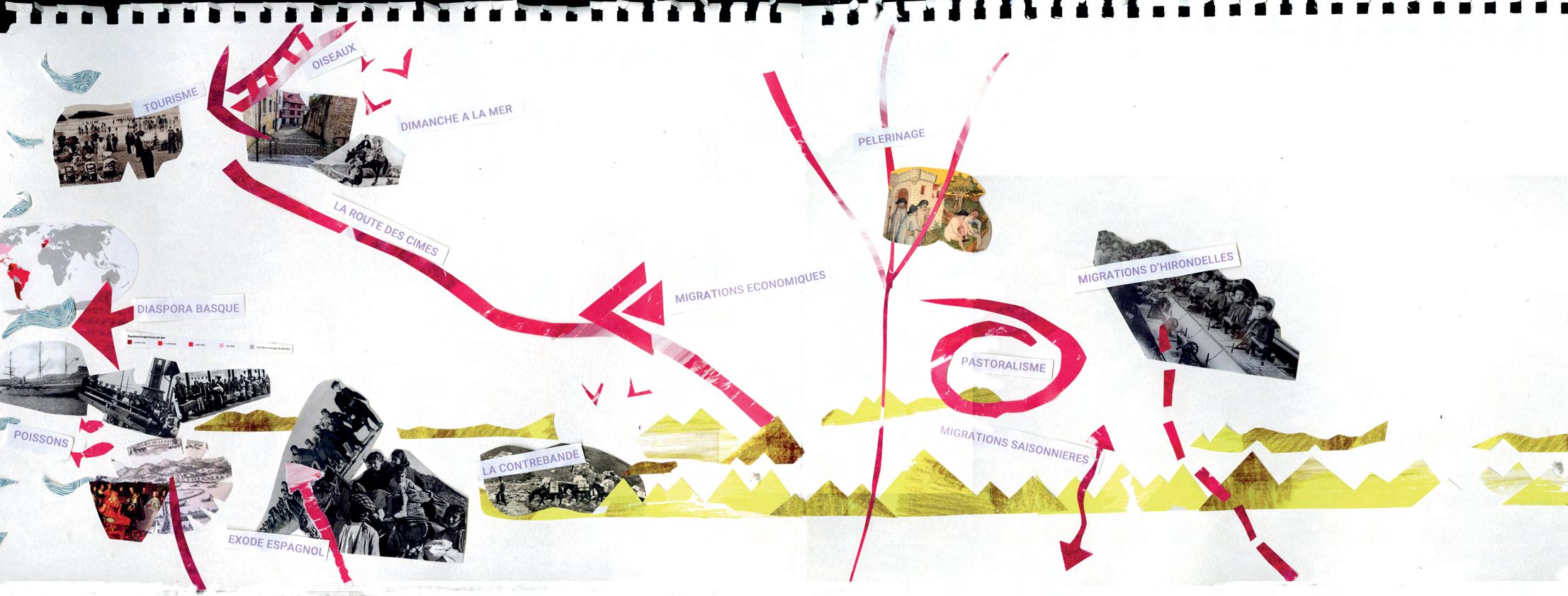
Mauléon-Licharre
St Palais
St JeanPied-de-Port
3.
L’Homo Sapiens, colonisant l’Europe, arrive en terre aujourd’hui basque.
- 40 000 ans - 5 000 ans - 3 000 ans le saumon atlantique la grande alose la lamproie marine la truite de mer

A l’ère néolitihque, la civilisation est nomade. Les individus se déplacent par petits groupes au grès des saisons.
Les migrations indo-européennes apportent avec elles la domestication des animaux sauvages : c’est le début de l’élevage et du pastoralisme sur les monts pyrénéens.

- 1000 ans An 1
Les migrants celtiques, des peuples venus d’Europe centrale, se déplacent jusqu’en terre basque. Les interactions entre passants et sédentaires font évoluer les techniques, les rites, les connaissances.
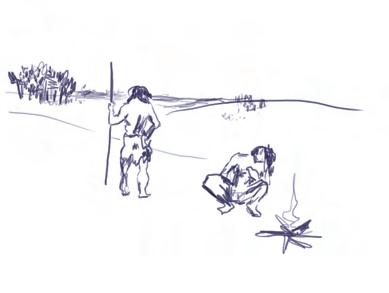
Conquête des romains. Le latin vient se mêler à l’euskara. Certains vascons et aquitains obtiennent la citoyenneté romaine, mais l’Empire n’arrivera pas à conquérir les terres basques; qu’ils occuperont pendant 3 à 4 siècles.
Pendant plusieurs siècles, la terre des vascons devient une terre de grand passage : Germaniques, Wisigoths, Suèves, Vandales, Alains, foulent les sols pyrénéens du nord au sud.
VIIIème siècle
Les Berbères remontent au Nord. A Pampelune, terre d’islam, les tombes se tournent vers la Mecque. Les jeux de royaumes et de pouvoir ne cessent de redistribuer les terres de peuple en peuple.
« Les Basques sont un peuple migrateur et le pays Basque est une terre où l’on immigre, quelle que soit la période. »
Antton Curutcharry, maire adjoint de St-Etienne de Baïgorry
l ’ anguille
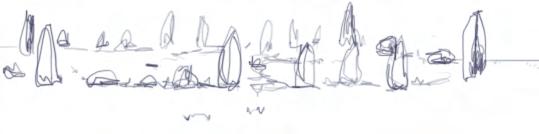
Xème au XVème siècle
Les chrétiens du Béarn, de Toulouse, de Gascogne, de Normandie entreprennent la reconquête des terres musulmanes. L’émergence des chemins de Compostelle contribuent au brassage culturel qui s’opère en ces temps ci.
40 41
Les premiers villages apparaissent ; l’ère de l’Homme sédentaire s’installe. Pendant ce temps, les poissons aiment déjà remonter la Nive, l’Adour ou la Bidouze et les oiseaux traverser les cols pyrénéens pour chercher un refuge agréable. dessins https://www.seinormigr.fr/
barricades et des empierrements, l’île des Faisans (ou île de la Conférence) fut le théâtre de nombreux échanges de mariages, terres et accords royaux.
aujourd’hui inaccessible au public
XVIIIème - XIXème siècle
Les basques se font colons, conquérants ; ils partent pêcher les baleines sur les rivages de Terre Neuve.
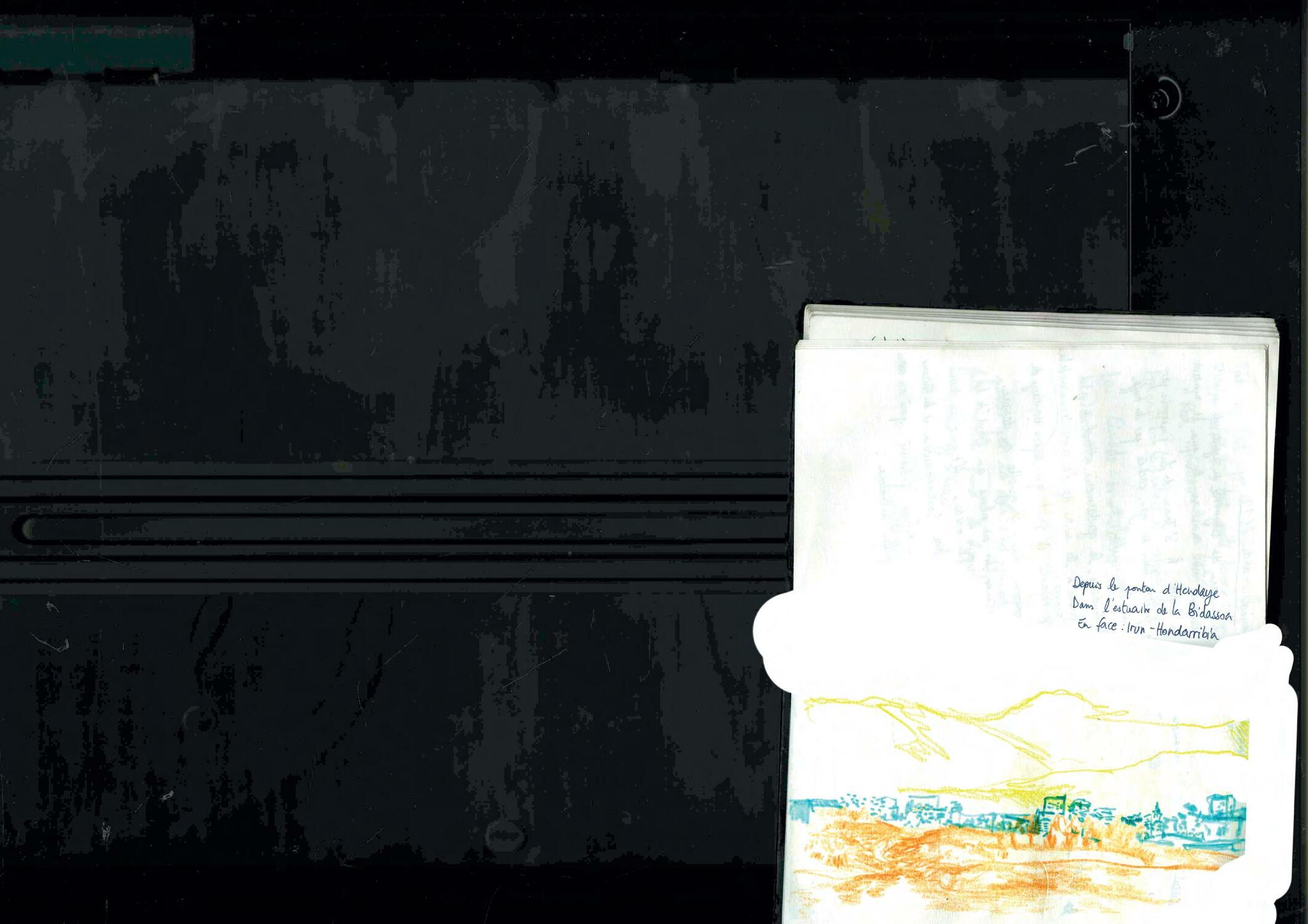
Les Amériques regorgent de trésors à conquérir et leur émigration prend une dimension toute particulière lors de la diaspora qui s’étend de 1830 aux Trente Glorieuses : des milliers de jeunes, contraints par le droit d’aînesse qui octroyait tout l’héritage aux aînés, quittent leur ferme familiale appauvrie par les temps qui courent. Dans une société endogame, faites de déplacements internes ruraux au gré des contrats de métayage et de mariages, les choix migratoires s’élargissent ; leur route mène aux villes côtières, à l’Espagne et surtout à l’Amérique du Sud. Attirés par la promesse de fortune outre-atlantique, notamment en Argentine, les émigrés basques affluent et s’installent. Beaucoup deviennent bergers et développent le modèle de la transhumance. Aujourd’hui, plus de 4 500 000 sudaméricains sont d’origine basque, quand le pays basque français compte moins de 500 000 personnes.
La route des cimes a été construite pour lier St-Jean-Pied de Port à Bayonne au début du XIXe siècle.
Elle fut un chemin stratégique pour les troupes de Napoléon qui l’empruntèrent pendant la guerre d’indépendance espagnole pour rejoindre Saint-Jean-Pied-de-Port. Sèche, carrossable même en hiver, et aisée de par son profil qui suit le sommet des collines, elle était utilisée par les grands personnages et les convois qui traversaient le Pays basque. Elle fut le théâtre de batailles, vols et combats cavaliers.
Aujourd’hui, RD 22, à peine visible sur le plan ; route touristique jalonnée d’objets patrimoniaux à découvrir.
Les échanges pastoraux et actes de contrebande ont longtemps caractérisé de nombreux cols frontaliers dans les Pyrénées, jusqu’à l’apparition de l’espace Schengen. La fraude permet d’éviter les contrôles de douane. Les patrons, grossistes, profitent du décalage évident entre les économies françaises et espagnoles ; un même colis n’est pas considéré de la même façon dans un pays et dans un autre.
Au Pays Basque, la terre n’est pas riche, les parcelles sont petites et les familles, grandes ; les contrebandiers empruntent à pied, à cheval, en caravane, des chemins de traverse tout au long de la frontière pour transporter des marchandises de part et d’autre et éviter les taxes. L’acte de passer prend un sens particulièrement stratégique ici, incarné dans le franchissement d’une ligne à partir de laquelle les règles changent. Alors le paysage devient le terrain de jeux qui permet de se cacher, de détourner, de tromper.
43
Années 50, un douanier guette les contrebandiers à Dantxaria

Au XVIIIe un courant de migrations saisonnières et temporaires connaît son apogée. Tuiliers et charbonniers basques quittent chaque année le village pour s’embaucher quelques mois en Espagne ou dans les Landes, tandis que les tanneurs de Hélette descendent en Galice. Les migrations économiques tirent les gens hors des campagnes. Au terme de parcours souvent complexes, une partie de ces migrants finit par s’établir à Bayonne et Bordeaux, centres de départ vers les Antilles, ou dans les villes espagnoles. Mais cette tradition ancienne de mobilité et de pluriactivité, au caractère transfrontalier ou transocéanique, balise les chemins des migrations massives du XIXe siècle. Elle perdurera jusque dans les années 1960. Durant ce même siècle, les hirondelles migraient vers Mauléon : c’était le nom donné aux jeunes femmes qui venaient tisser l’espadrille dans les industries de Soule. Elles empruntaient les chemins montagneux et chaotiques pendant des jours avant d’arriver dans les usines.
Le tourisme au Pays basque fabrique de nouveaux flux migratoires à travers tout le territoire. Il s’y développe dès la fin du XVIIIe siècle au diapason des autres futures destinations touristiques européennes comme la Côte d’Azur ou la Normandie. Les différentes révolutions industrielles d’alors suscitent un enrichissement des communes côtières ; les classes aisées et possédantes viennent y chercher les bienfaits des bains et de l’air marin, d’abord essentiellement à Biarritz.
Jusqu’aux années 1830, le tourisme est le fait d’une clientèle locale, essentiellement bayonnaise, qui fréquente les bords de l’océan le dimanche ou lors des villégiatures; le transport sur la côte est assuré par des cacolets, ou des omnibus attelés jusqu’au petit port.

Dès 1854, le couple impérial Napoléon III et Eugénie de Montijo choisissent Biarritz comme résidence d’été ; la Cour s’y déplace de 1854 à 1868 et de nombreuses figures de pouvoir international s’y rendent. Hôtels, villas, casinos, établissements de bains, poussent dans une frénésie de construction.

Le tourisme prend rapidement pied au Pays basque, associant son nom au luxe, aux loisirs et au cosmopolitisme. La pêche et l’agriculture se font oublier, les tamaris fleurissent sur les avenues. La côte littorale se mue en un espace de villégiature.
Les cacolets étaient des paniers d’osiers que l’on installait sur des ânes ou des mulets afin d'y transporter des voyageurs à l’époque où les routes n’étaient pas carossables. A Bayonne, le passage des Cacolets est aujourd’hui une ruelle pavée à escaliers dans le centre ancien.
C’est aussi l’arrivée du train dès 1855 à Bayonne qui propulse le Pays Basque dans une nouvelle ère de mobilité. Bordeaux, Hendaye, Toulouse, Paris, ne sont plus qu’à quelques heures de transport.
À Cambo-les-Bains, un peu en retrait du littoral, les sources thermales attirent un public régulier tout le long du siècle et tissent un attrait touristique dans un territoire rural. L’amélioration des liaisons ferroviaires avec Bayonne conforte un flux dans cette direction. Les paysages de landes à l’habitat dispersé, aux murs chaulés et aux volets verts, laissent place à une petite ville aux villas de pierre aux styles divers.
L’urbanisation du littoral s’accroît jusqu’à aujourd’hui, bâtissant un territoire d’accueil rentable, rythmé du passage d’individus en villégiature qui contribuent à construire des clichés et images pittoresques du territoire.
1855 : le train fait étape au Pays Basque


44 45
photo : Musée National des Douanes
Femmes basques après le bain Huile sur toile, Jules-Jacques Veyrassat, 1870.
Dès 1936 et le début de la guerre civile espagnole, des exilés républicains fuyant le conflit affluaient à la frontière française. En 1939, c’est la Retirada : 450 000 républicains, fuyant Franco, sa victoire et sa répression, se réfugient hors du pays et franchissent les Pyrénées. Au plus près, à la frontière basque, ils cherchent la solidarité et l’accueil. Les solidarités transpyrénéennes existent, facilitées par une langue et une histoire commune ; mais rien n’est prévu pour les accueillir. Les soldats sont désarmés et internés dans des camps. Les femmes sont mises à la hâte dans des centres d’hébergement improvisés. Dans le sens inverse, les basques français qui ne voulaient pas s’engager lors de la Première Guerre Mondiale se sont réfugiés du côté espagnol.



La France et l’Espagne adhèrent à l’union douanière de l’Union européenne, entrée en vigueur le 1er janvier 1968, et sont toutes deux membres de l’espace Schengen depuis le 26 mars 1995. Depuis lors, les postes-frontière ont été fermés ; le Code frontières Schengen stipule que les États participants doivent supprimer tous les obstacles à la libre circulation dans les frontières internes de l’espace. Dès lors, la circulation n’est plus soumise au contrôle systématique.

Une ancienne borne frontière en haut des chemins basques

46 47
1939
En 1936, des milliers d’Irundars fuyaient la guerre espagnole en traversant le pont de l’Avenida, propriété d’Irùn, pour rejoindre Hendaye. La France se trouvait alors en zone occupée sous le régime de Vichy et les passages de douane étaient strictement contrôlés. Aujourd’hui, le poste de douane a disparu mais le pont est fermé (voir p.54)
La Retirada, photographiée par Robert Capa (1939)
photo Gilles Athier
regarder en arrière
un terreau d’accueil
«L’histoire du Pays basque a créé des réseaux qui se sont remis à fonctionner dans l’entraide autour des migrants, c’est une sorte de tissu social préexistant, avec un fort ancrage militant historique»

Maite Etcheverry, de l’association la Cimade
Les formes du passage dans le passé illustrent nécessités et motifs pour lesquels le mouvement s’opère dans un territoire.
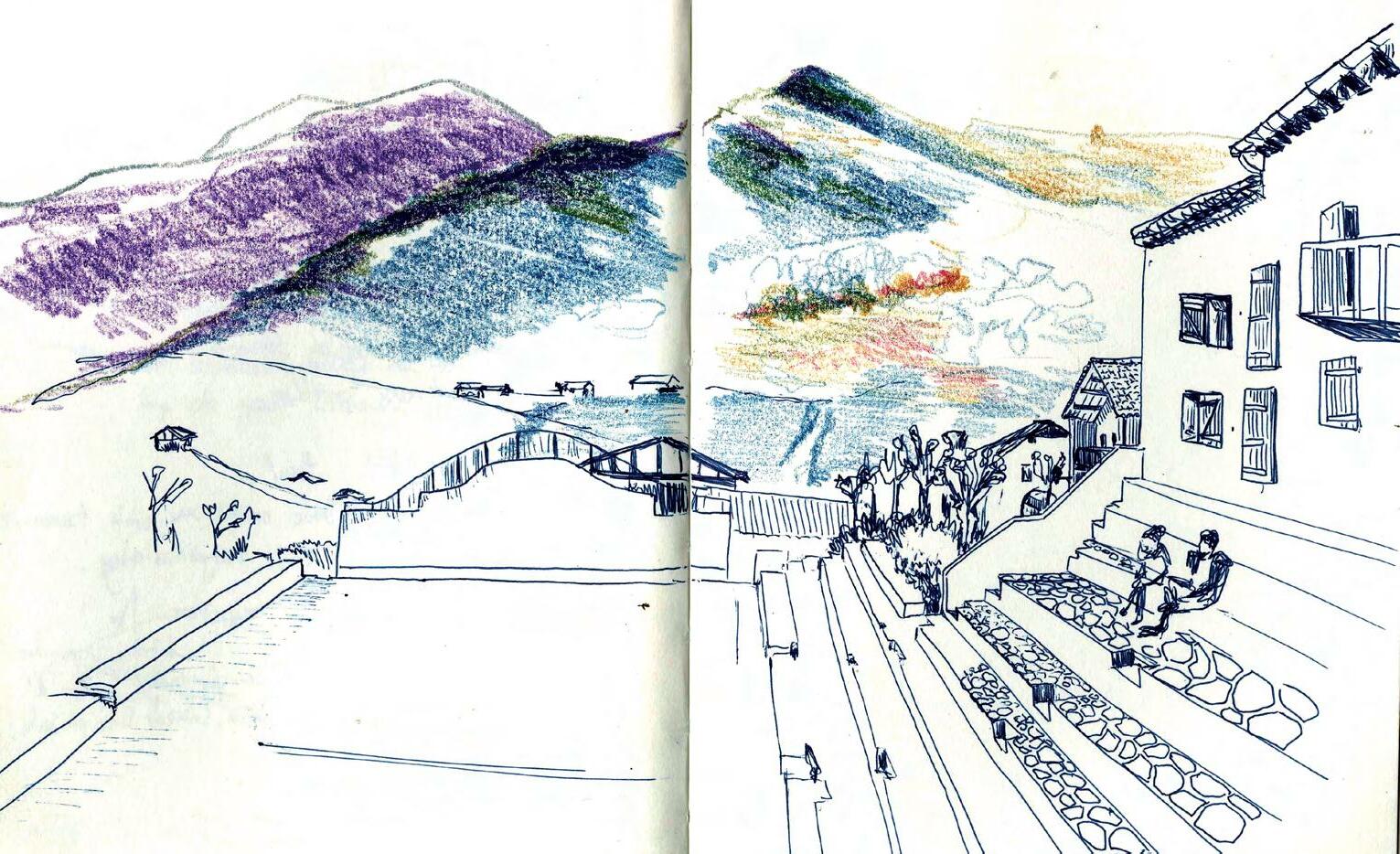
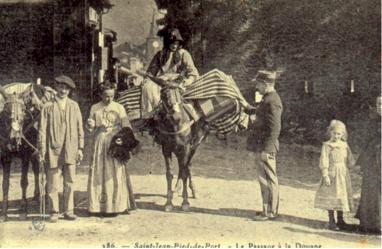
Se mettre en quête, émigrer pour augmenter son niveau de vie, pour faire fortune, s’adapter à ses besoins vitaux, fuir des conditions inacceptables, ou encore se délasser de sa vie quotidienne en découvrant de nouveaux horizons.
Ce brassage contribue à construire des identités. La notion d’accueil semble marquer un début dans la relation entre individus; le seuil d’un territoire; rassembler ce qu’on y trouve et le mettre sur le pas de la porte pour inviter à progresser. L’espace qui en résulte est nécessairement marqué des passages mais l’accueil est une affaire souvent privée, relevant de la solidarité ancrée dans les traditions.
La mise en partage des espaces s’illustre avec le système des lies et faceries. Ces conventions, dont les premières datent du XIIe siècle, sont la conséquence du relief montagneux et de la configuration des vallées. Les populations pyrénéennes rencontrent des problèmes de voisinage souvent liés à l’utilisation des pâturages. Elles ont alors développé des systèmes juridiques et économiques propres, insensibles aux changements politiques qui ont marqué l’histoire des deux versants du massif. Dans l’économie traditionnelle pastorale, les faceries établissent les limites des pacages communs ou respectifs, leur bornages et les sanctions à l’encontre des auteurs d’infractions. Alors que les États se constituent et que la frontière acquiert sa notion de limite militaire, politique, puis douanière, les faceries perdurent comme outil de gouvernance à l’échelle
d’une vallée. Elles intègrent des dimensions nouvelles à partir du XVe siècle, qui consistent en la protection de l’économie locale et la liberté des transactions, indépendamment des conflits nationaux et des règles fiscales propres à chaque royaume. Dans le prolongement de cette évolution se développe un concept politique de « petites républiques », basé sur la neutralité ou la surséance à la guerre. Aujourd’hui, certaines conventions existent toujours, entre Vera de Bidassoa et Sare, au col de Lizarietta. Ce sont désormais les Commissions Syndicales, structures propres au territoire basco-béarnais, qui poursuit cette tradition d’indivision des terres basé sur la notion de communs. Cette constituante de l’histoire basque infuse une éthique entre les vivants et leur territoire. À l’aune de nouveaux enjeux actuels, où transfrontalité et multiexposition sont à la table politique, comment ce terreau d’accueil se comporte face à l’arrivée de nouveaux flux ?
Sare, la place du fronton
48 49 3.
St Jean Pied de Port, le passage de la douane 1900 - Reproduction de carte postale, Macondo
L’île des Faisans ou de la Conférence, condominium
4. démêler les fils
Aujourd’hui mille et mille gens foulent le sol basque, passent par Hendaye, longent la côte, transpercent les montagnes. Pour des motivations diverses, avec des buts différents, et plus ou moins d’urgence. Les oiseaux eux survolent ce paysage en vue aérienne. Tous ces parcours forment et tissent des routes dans le territoire. Pour comprendre leur relation aux lieux il nous faut d’abord démêler les parcours.

50
4. les migrants démêler les fils
Lignes, sas, cheville, articulation. Petit bout de pays, rideau du territoire français. Par le Pays basque, on arrive en terre inconnue depuis le Mali, la Mauritanie, la Guinée, le Niger, le Sénégal, la Côte d’Ivoire.
L’histoire des migrations humaines est une encyclopédie. Elle se perpétue se déplace se transforme. Sur cette route on quitte on fuit on cherche où vivre sans subir.
En 2015, devant un nombre manifestement croissant de personnes migrant vers l’Europe par la Méditerrannée, les contrôles d’accès en Italie sont rétablies ; en 2018, le gouvernement de Matteo Salvini ferme franchement ses ports aux migrants et ONG. Il faut passer autre part ; de l’autre côté. L’exil défit l’infranchissable.
Le contexte politique de l’accueil migratoire est un dédale aussi bien national qu’européen. Sans réelle volonté de protéger, l’Etat français n’orchestre qu’une série de multiples, complexes et violentes procédures qui séparent le migrant de la jouissance des droits de l’Homme en terre française.
se jeter à l’océan
se frayer un chemin

La surveillance et la répression, militarisées, se matérialisent alors dans le paysage frontalier, linéaire et rendu épais par ces obstacles policiers. Captés du côté français de la ligne, les individus sans papiers sont reconduits en Espagne par les escadrons de la Police Aux Frontières. Plus de 600 agents, gonflés en 2018 par le gouvernement Macron, permettent une surveillance quasi continue de ces seuils. En train, en bus, en voiture ou à pieds ; qu’importe le véhicule, quand on a la peau noire, on incarne celui ou celle pour qui l’espace Schengen comporte des exceptions.
Ce jeu de ping-pong avec des humains a un nom : le pushback Lorsque le corps parvient à échapper au tamis, débute un long parcours administratif pour tenter d’accéder à une situation régularisée. Dans l’espace public, il faut fuir, se cacher ; se rendre transparent, le temps que cela passe. Compter sur les précieuses initiatives citoyennes et municipales qui permettent de contourner le mot d’ordre national.
Urgence et transit dessinent un passage bref dans cette terre d’accueil historique.
traverser l’Afrique
de la population mondiale est déplacé-forcé c’est deux fois plus qu’en 2011
espace Schengen
La route atlantique permet de rejoindre l’Europe depuis les pays d’Afrique subsaharienne. Le Pays Basque est une des principales portes d’entrées sur le territoire français.

l’espace schengen



Espace de libre circulation des personnes, qui implique le libre franchissement des frontières par tout individu entré sur le territoire d’un des 26 États membres de l’espace Schengen1.
Les règles en matière d’entrée sur l’espace Schengen sont à l’origine d’un parcours migratoire européen chaotique. Aux frontières de l’UE, Frontex, une agence créée en 2004 (devenue Agence européenne de gardefrontières et de garde-côtes en 2016) gère la coopération opérationnelle; elle mobilise 1500 gardes.
d’arrivées par mois à Hendaye centaines
tués
sur le transit au Pays Basque durant l’été 2021
Une personne qui a quitté son pays pour travailler, faire des études, rejoindre des membres de sa famille, ou bien pour fuir pauvreté, violences, situations politiques, catastrophes naturelles,.. Ce terme ne correspond à aucun statut juridique particulier.
un réfugié
«Une personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, et ne peut ou ne veut y retourner.»
- Convention de Genève du 28 juillet 1951
Ce statut est reconnu par l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) à la suite d’une demande d’asile validée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du Conseil d’État. Le réfugié obtient alors une carte de résident valable 10 ans.
un migrant un demandeur d’asile
Une personne qui a quitté son pays et demande aux autorités compétentes l’asile, soit l’autorisation d’entrer sur le territoire français pour être protégée, mais qui n’a pas encore été reconnue légalement comme «réfugiée». Le droit d’asile est un droit humain.
« Ces termes affectés de manière temporaire, ne reflètent pas, dans toute sa complexité, l’identité de l’individu. Lorsque nous les utilisons, nous devons nous rappeler que ce ne sont que des étiquettes qui ne font référence qu’à une expérience en particulier, celle de quitter son pays. »
Amnesty International
passages recensés depuis 2018 au centre Pausa (Bayonne)
52 53
source : rapport HCR Agence des Nations
%
Unies pour les Réfugiés, 2020
25 000
1 : https://www.vie-publique.fr
«Une Ville peut-elle se distinguer d’un Etat, prendre de sa propre initiative un statut original qui [...] l’autoriserait à échapper aux règles usuelles de la souveraineté nationale ?» (Jacques Derrida, 1995)
A l’échelle européenne, la question migratoire n’est réglée qu’au travers d’une approche de contrôle. Depuis vingt ans, les mouvements populistes européens construisent une politique presque unilatérale. Il est hors de question de bâtir une politique commune, inexistante. L’état tend à déléguer la gestion des besoins primaires et urgents de ces passants aux citoyens, à la société civile locale. Quand pour les dynamiques climatiques ou économiques, de nombreux travaux scientifiques produisent des projections et scénarii sur lesquels s’appuient des politiques, la question migratoire ne donne lieu à aucun modèle d’évolution probable. Ancrés dans un système de défense, nous sommes incapables de penser à l’échelle de la mobilité humaine.
Le tableau géopolitique actuel dresse pourtant des tensions entre Angleterre et France, Pologne et Biélorussie, des conflits de la Syrie à l’Ukraine en passant par l’Afghanistan, des murs entre les états, des régimes politiques qui forcent à fuir et des pressions climatiques qui vont ne faire que se dégrader sérieusement.
Une politique migratoire européenne devrait non seulement avoir une portée intérieure (franchissement des frontières, questions sociales (accès à l’éducation, à la santé, au regroupement familial) mais aussi extérieure, puisque l’État et l’Europe sont aussi impliqués bien en amont dans les conflits qui poussent des gens à fuir.
Chaque fois qu’un point de passage est fermé (détroit de Gibraltar, îles Canaries, Lampedusa, etc.), les flux migratoires sont déviés mais non stoppés. Pour avoir une chance de passer, il faut emprunter des routes toujours plus dangereuses et mettre sa vie entre les mains de mafias peu scrupuleuses.
Les effets qui se produisent, nous les retrouvons cachés, feutrés, dans notre paysage urbain et confortable. Le motif de l’urgence justifie une gestion autorisée des populations migrantes par le biais de la détention ou de la mise à l’écart systématique des migrants. Les procédures administratives affaiblissent leurs droits et confortent le désengagement progressif des Etats en matière d’accueil.
Dans les faits, ce sont donc les membres de la société civile qui comblent les tristes vides laissés par le gouvernement.
Certaines villes, comme c’est le cas pour Bayonne, décident de transgresser les interdits fixés par le gouvernement, comme celui de loger des personnes sans papier.



La question migratoire est alors abordée par les façons d’organiser un accueil digne de ce nom et non à celles de «tarir le flux».
^ Une attitude répressive (Coupe le long de la frontière franco-espagnole)
Les murs du quai de Lesseps, Bayonne
Entre une politique nationale de l’accueil inexistante, la gestion panique de la pandémie de Covid-19 et les craintes d’actes terroristes sur le territoire : depuis janvier 2021, 9 points de passage sur 17 entre les pays basques français et espagnol sont fermés. C’est la première fois depuis 1985, date de création de l’espace Schengen.

54 55
Les murs du centre Pausa, à Bayonne
Hendaye Navette maritime Hendaye Pont de l’Avenida 1 : 50 000 500 m 20 km 1 : 2 000 000
Union Européenne
réseau consulaire européen
Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) institué en 2004, régulièrement mis à jour
europe et affaires étrangères justice solidarités et santé
autres ministères
travail cohésion des territoires
France
structures interministérielles travaille avec travaille avec
Délégation Interministérielle à l’Accueil et à l’Intégration des Réfugiés (DIAIR)
Ministère de l’Intérieur
Délégation Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au Logement (DIHAL)
office français de protection des réfugiés et apatrides (ofpra) fontenay-sous-bois > applique les textes français et conventions européennes et internationales relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié, d’apatride et à l’admission à la protection subsidiaire > attribue ou non le statut de réfugié opérateurs publics
Asile, immigration, intégration sécurité intérieure BUDGETS rôled’autoritédegestionenFrance des mois se passent
s’appuie sur
direction générale des etrangers en france 7 services, 600 agents à Paris et en Loire Atlantique > chargée de la politique d’immigration, d’asile, d’intégration et d’accès à la nationalité française > met en oeuvre les orientations fixées par le Ministère > élabore les textes réglementaires autres directions générales sécurité civile, police, sécurité intérieure, gendarmerie nationale, collectivités locales,...
pilote • ... • Immigration, asile et intégration

Missions ministérielles
programme 104 programme 303
Immigration et asile Intégration et accès à la nationalité française
56 57 office français de l ’ immigration et de l’intégration (offii)
> accueille et accompagne les ressortissants étrangers autorisés à séjourner en France durablement
Préfecture
Pau ou Bordeaux
fuite pour échapper à la pression de la frontière
prise d’empreintes
Police aux Frontières
Début de la procédure de demande d’asile accords de Dublin
procédures interprète PADA et GUDA (plateforme et guichet d’accueil pour les demandeurs d’asile)
demande de visa de régulation (8 jours)
Zone d’Attente (une gare, un port,...) acceptée refusée
Obligation de Quitter le Territoire Français
territoire internation
nation
Destination villes, villes puissantes
La page précédente propose une vision du paysage administratif de l’exil en France : une longue suite de procédures, relevant de règles nationales en concertation avec des normes européennes ; les procédures sont partiellement délocalisées dans les préfectures mais Paris reste une ville centre pour obtenir des papiers français. Ici, c’est à Pau ou à Bordeaux que les procédures commencent. Depuis Hendaye, Bayonne est l’unique première destination : là où se concentrent les bus et les trains pour d’autres ailleurs.
Dans de plus en plus nombreuses villes européennes, une volonté de détachement de l’Etat quant à la question de l’accueil migratoire grandit. Dans les années 80, des «villes sanctuaires» aux Etats Unis refusent d’appliquer les lois fédérales répressives de contrôle migratoire1
En 1997, Jacques Derrida utilise le terme de «villes-refuge»2. Reposant sur « un droit des villes, une nouvelle souveraineté des villes », les villes refuges seraient une alternative à l’absence de politique de l’hospitalité portée par les États et dominée par la souveraineté étatique.
Aujourd’hui, en Allemagne, au Dannemark, en Espagne, des villes font le choix de l’accueil et mettent en place des moyens et mesures locales pour héberger et inclure l’étranger à la porte3. En France, des réseaux d’associations locales et nationales se superposent et se surajoutent : à l’échelle européenne et même mondiale, des
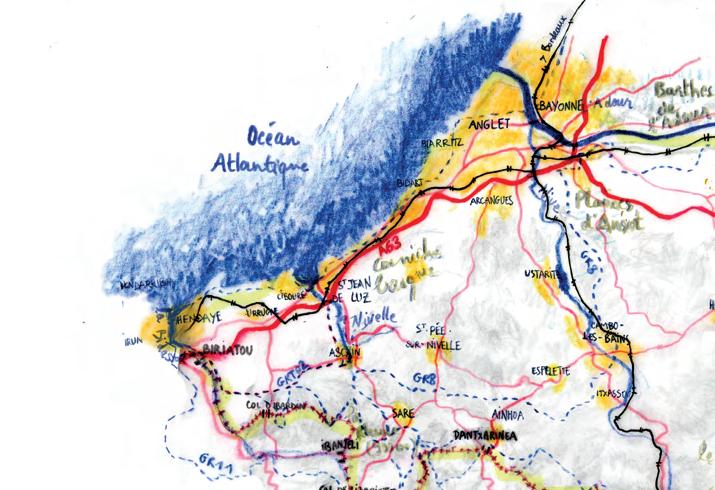
villes se structurent en « réseau de villes accueillantes»4, adhérant à une série de principes et de valeurs pour orienter leur politique.
Les villes concernées par le passage sont Hendaye et Bayonne. Cette dernière a mis en place des mesures pour l’accueil dès 2018 (voir p.100). À Hendaye, la police rôde partout et aucune structure ne prend en charge cette zone sous-tension; c’est l’endroit à fuir. Pour rejoindre la terre on peut passer par l’eau ou avoir de la chance par la route; pour rejoindre Bayonne, on passe sur les rails du train. Le chemin est semé d’embûches.
Dans ce contexte l’urbanisme peut se poser en garant pour éviter des situations d’enfermement à ses portes. Il faut rechercher des «exceptions contemporaines en urbanisme»5 : dérogations, compromis, arrêtés.
«Si l’on prend la ville comme échelle d’action, une politique d’accueil à hauteur de mégalopoles ou de villes moyennes et petites réinscrit les parcours migratoires dans des enjeux de socialisation, de voisinage, d’inclusion, et d’exclusion spatiale. Ces processus nous éloignent des enjeux de frontières, de camps, de dispositifs de gestion.»3
1 : Aux Etats Unis, des villes sanctuaires - Mireille Paquet, 2017
2 : Cosmopolites de tous les pays, encore un effort ! - Jacques Derrida, 1997
3 : Entre accueil et rejet, ce que les villes font aux migrants. Babels, 2018.
4 : Notamment l’Association Nationale des Villes et Territoires Accueillants

5 : Urbanisme temporaire / Informalité, migrations et « urbanisme temporaire», S. Jacquot, M. Morelle
passeurs
le bus
58 59
de
4
HENDAYE à BAYONNE
km 1 : 200 000 le train la fuite à pied les
« La Communauté d’Agglo finance à 100 % le centre Pausa (1 million d’euros par an). L’Etat ne participe en rien ; ce n’est pas une situation juste. » un élu de la CAPB

« Depuis Cédric Herrou, le délit de solidarité n’existe pas : c’est dans la loi » une bénévole de l’association Diakité
61
«Chez nous, on emprisonne les errants, les chercheurs de place, chez nous, au pays du refuge, il n’y a pas de refuge ? [...] Qui est venu ici parce que c’est ici ? [...] Accueillir ou être accueilli, c’est un projet. [...] On ne peut pas non plus être ici de passage : il faudrait qu’il y ait un passage.»

Des îles, Marie Cosnay. Retranscriptions d’échanges avec des migrants


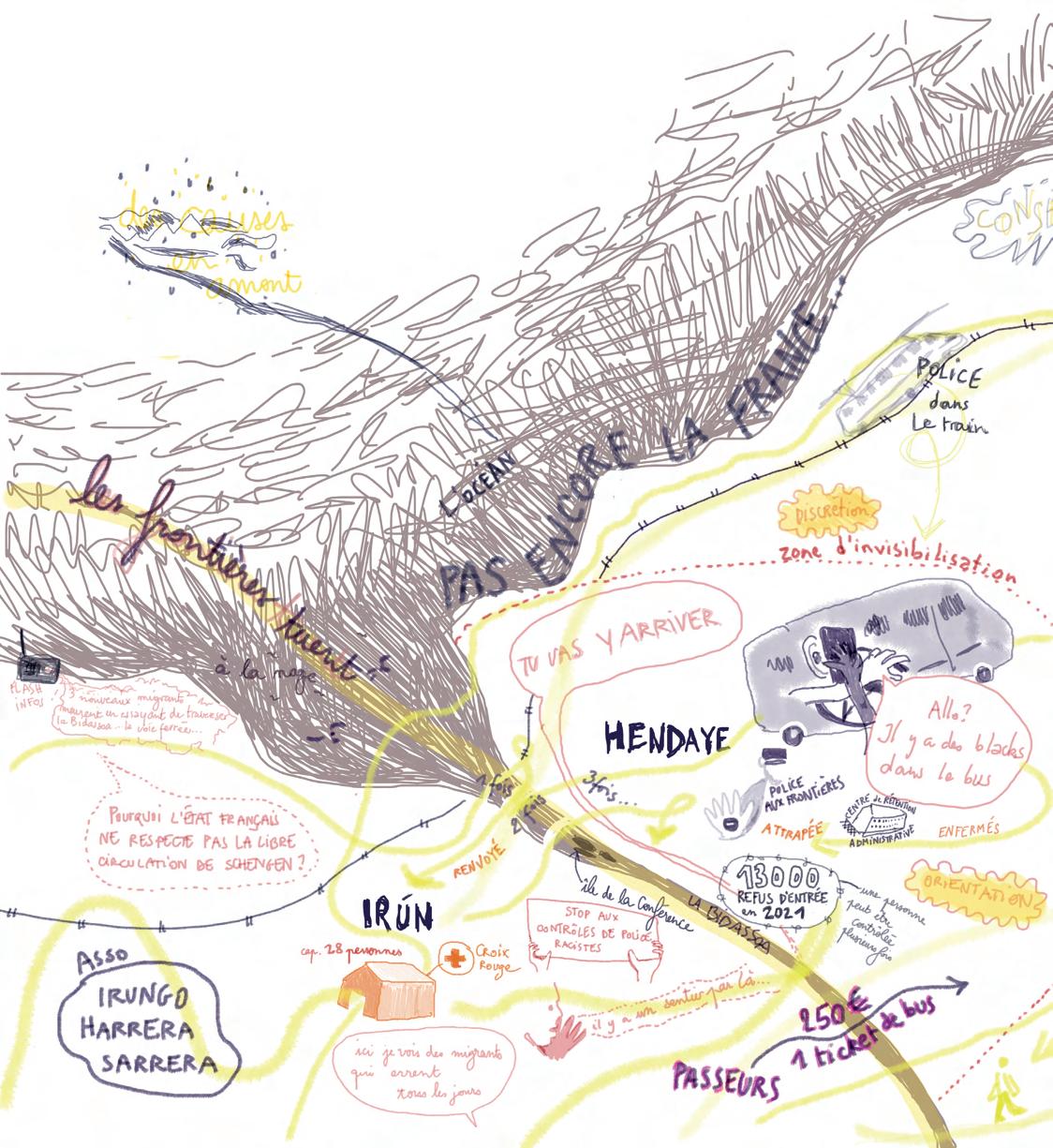
60
1000 m 250 gare d’Hendaye gare d’Irùn laBidassoa HENDAYE IRÙN BÉHOBIE Isla Galera Isla Iru Kanale Isla Santiagoaurra ZI Les Joncaux Centre de Rétention Administrative Hendaye Baie de Chingoudy Zone protégée gare Les 2 Jumeaux Abbadie Site protégé Parc écologique de Plaiaundi Aéroport de San Sebastian Baie du Figuier 1 9 10 16 17 20 18 11 15 19 14 13 12 3 4 6 5 2 7 8

1 7 10 11 12 8 6 9 2 3 4 12 13 15 14 5 6


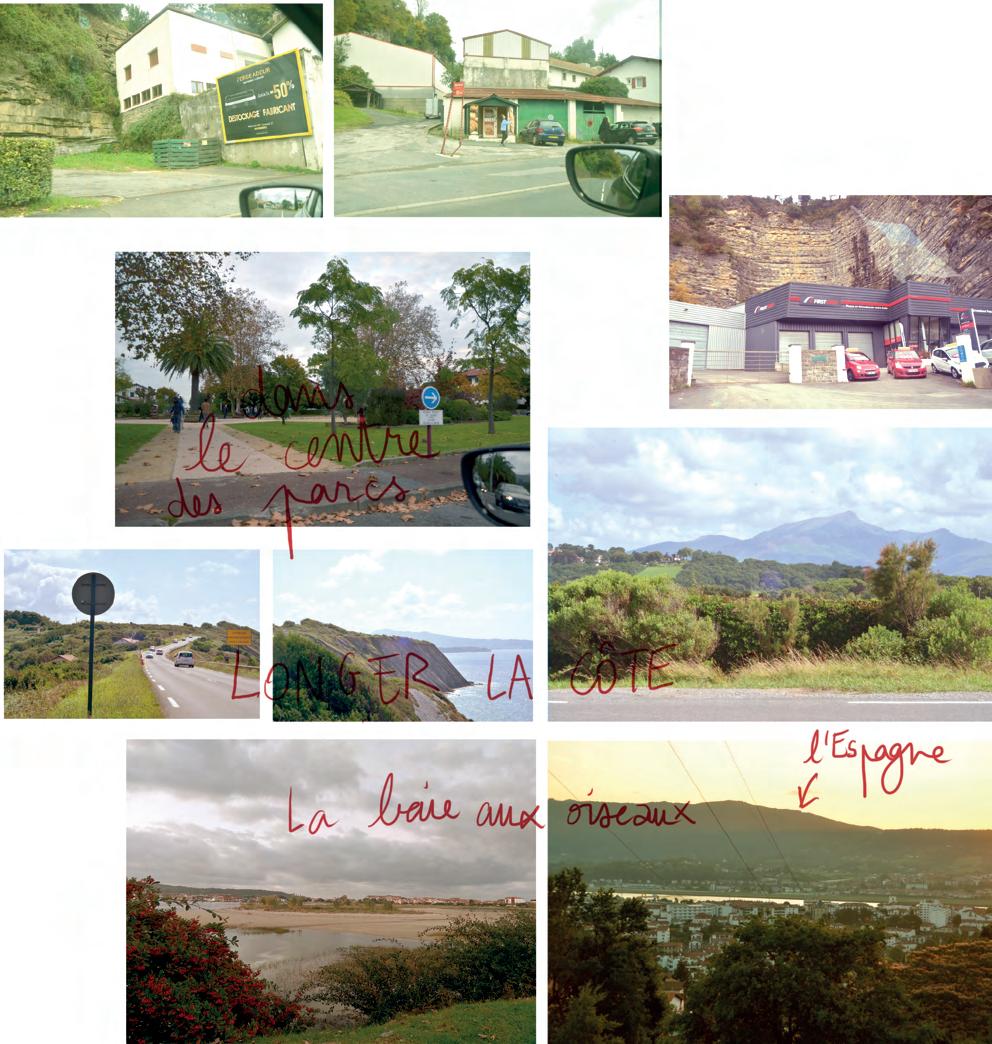
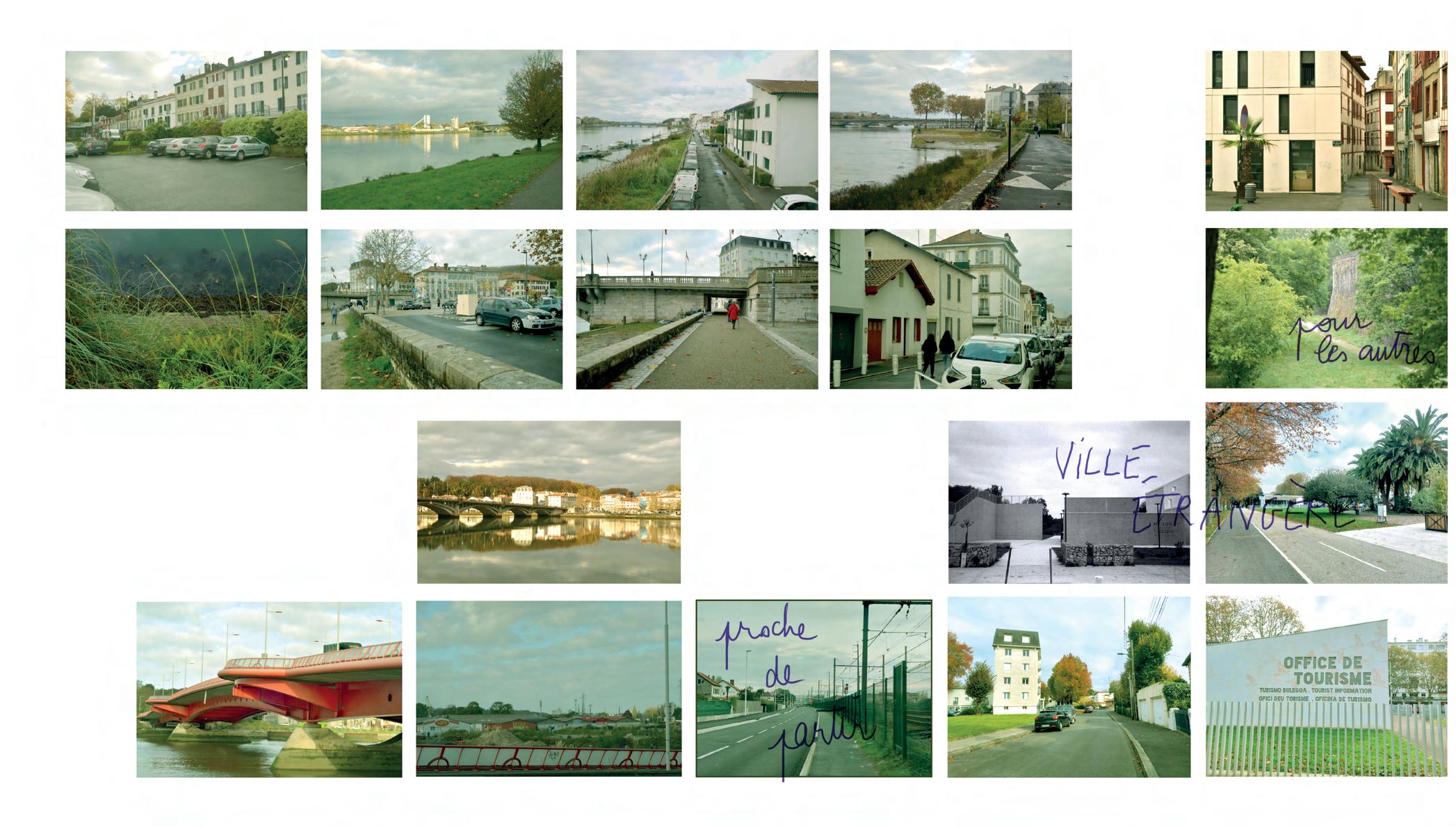
Bayonne Zone industrialo-portuaire Camp militaire st-esprit petitbayonne Gare Pausa et gare routière Mairie Place des Basques anglet la Nive ladour 1000 m 250 16 17 16 18 19 20 64 4 4 6 7 7 8 4 9 9 10 14 13 1 1 12 11 8 7 1 2 3 10 9 4 11 12 6 7 14 13 8 5
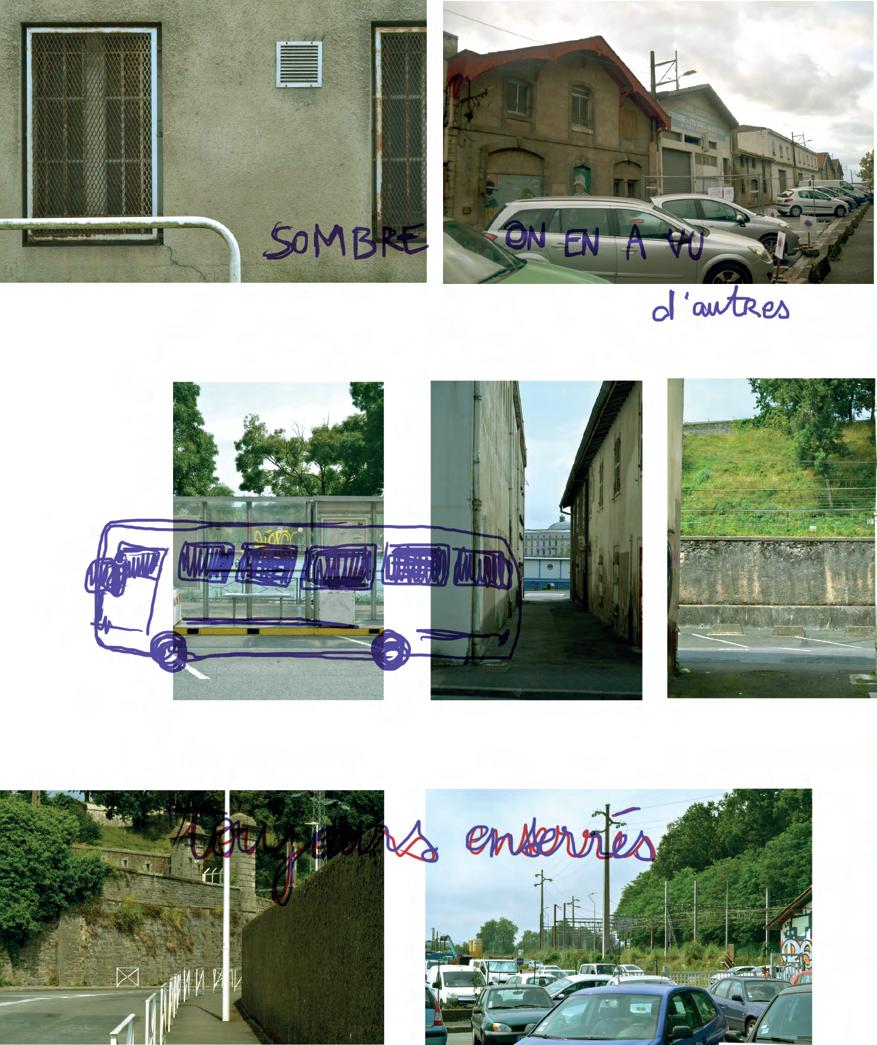

1 2 3 3 2 4 5
4. les oiseaux migrateurs démêler les fils
C’est l’automne et la nuit va tomber. Dans le ciel de Bayonne, une nuée de grues envahit l’air. Elles crient et leur organisation en groupe rend le paysage aérien tout à coup si vaste. Son échelle me paraît brusquement réelle.
Chaque année, des dizaines de milliers d’oiseaux quittent leur lieu de reproduction, au nord, pour rejoindre des contrées méridionales plus chaudes où elles pourront nidifier. C’est la migration postnuptiale, au contraire de la migration printanière qui s’effectue dans le sens inverse, dès la fin de notre hiver.
Se nourrir, avoir suffisamment chaud, suffisamment d’eau, suffisamment de vent… les oiseaux migrateurs flairent leur environnement au bec. Ils entreprennent la migration lorsque les conditions les y poussent. L’adaptation, l’art de la fuite : une quête inlassable pour une satisfaction éphémère. C’est ainsi que se tissent des itinéraires invisibles entre les écosystèmes les plus disparates sur Terre.
Aristote en son temps déjà, remarquait le passage d’oiseaux d’ailleurs. Il en alla de son interprétation, ainsi que ses successeurs,
qui ajoutèrent leur pierre à l’observation de la migration. À partir du XIXe siècle, des naturalistes comme Linné entament une étude plus poussée.
Il existe aujourd’hui des suivis et comptages réalisés à des endroits stratégiques (couloirs, entonnoirs) qui produisent une base de données d’observation des populations migrantes. Bien sûr, il n’y a rien d’absolu : l’observation se fait sur le temps très long et dépend de critères variables (météo, vents, compétences des observateurs,…). Aujourd’hui, la disparition des arthropodes, en particulier des insectes, contraint la majorité des espèces européennes d’oiseaux insectivores comme l’hirondelle à migrer. D’autres facteurs climatiques peuvent impacter les mouvements, ou encore la mémoire collective des routes empruntées: un évènement traumatisant sur le chemin entraînera un détour l’année suivante.
Chaque espèce possède ses propres calendriers, itinéraires, besoins. Certains migrent de jour, suivant le mouvement du soleil; d’autres préfèrent la nuit et le mouvement des étoiles. Ils suivent des couloirs aériens où les conditions
des 450 espèces d’oiseaux européennes effectuent une migration chaque année.
Le grand couloir de la migration postnuptiale des oiseaux migrateurs européens emprunte la France. Les flux convergent au gré des haltes et des conditions météorologiques.
Col de Lizarietta
Principal chemin migratoire
Autre chemin migratoire

Station de comptage
Organbidexka



Col de Lindus Plateau de Beille
Eyne Forge del Mitge
Les points de passage des Pyrénées.
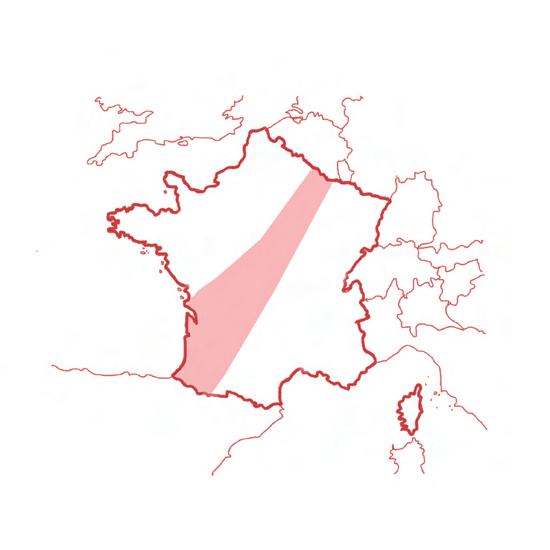
La faible altitude des cols basques et l’orientation des vallées attirent la route des oiseaux migrateurs, qui évitent la haute chaîne.
atmosphériques sont agréables, et où les lieux de halte sont accueillants ; un champ de maïs, une forêt, une zone humide,...
Pour des dizaines d’espèces de rapaces, de passereaux et d’oiseaux d’eau, les reliefs et creux du Pays basque sont une merveille. Faisant fi des lignes de frontières que l’on trace, ils survolent les cols basques où les Pyrénées se lovent. Terre d’accueil historique, il semble que son ciel le soit aussi.
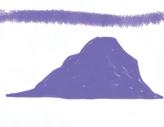
d’oiseaux européens nichent au sud du Sahara.

milliers
de km parcourus entre le site de reproduction au Nord et le lieu d’hivernage au Sud.
1 million
d’oiseaux observés aux 3 sites pyrénéens basques sur les périodes de migration (juillet/ octobre)
68 69
5 milliards
%
Le col d’Organbidexka est l’un des trois plus importants sites européens de migration d’oiseaux terrestres. Dans les années 80, l’association Organbidexka Col Libre y implante un site d’observation de la migration. Les cols se louent alors des fortunes par les chasseurs de palombe, qui viennent de toute la France tirer le fameux pigeon ramier. Les conflits entre naturalistes, chasseurs et bergers excitent les tours. L’installation des Châlets d’Iraty dans les années 70, village vacances au sein de la Forêt d’Iraty, viendra mettre du baume sur ce paysage en construisant un écotourisme basé sur les acteurs de la montagne, l’observation de la migration et la sensibilisation des publics aux activités rurales. Aujourd’hui, le multi-usages de la montagne demeure problématique.

Les barthes de l’Adour sont des terres régulièrement inondées de la vallée de l’Adour, des portes de Bayonne jusqu’à la confluence Adour-Midouze dans les Landes. Littéralement «taillis», «marécage buissonnant» en langue gasconne, ce sont des zomes humides précieuses pour une faune et une flore spécifique. Il en existe autour de l’Adour mais aussi au sud de Bayonne, au bord de la Nive et de la Nivelle. Les grues, courlis cendrés, cigognes blanches, spatules et autres oiseaux d’eau affectionnent ces milieux nécessaires à leur restauration sur la route. Inclus dans des Zones de Conservation Spéciale de Natura 2000, leur équilibre est menacé par la pression immobilière qui vient grignoter et drainer les zones humides et par la modification du contexte agricole et hydraulique (canaux, ouvrages de gestion,..)
La baie de Chingoudy (ou Txingudi) s’ouvre lorsque le fleuve Bidassoa verse dans l’océan Atlantique. Lac tranquille à marée haute, où se jette le mont espagnol Jaizkibel, il devient estuaire envasé lorsque l’eau se retire. Ses lagunes et marais humides sont fréquentés par plus de 300 espèces d’oiseaux migrateurs évitant la mer Cantabrique et la cordillière pyrénéenne.

Le développement du complexe touristique et industriel d’Hendaye-Hondarribia-Irùn ne cesse de dégrader cette zone depuis cent ans. À son contact en Espagne, le parc ornithologique de Plaiaundi-Jaizubia a permis de restaurer les marécages détruits ; mais à Hendaye, la baie ne cesse de se faire grignoter par les aménagements.



70 20 km 5
Col d’Organbidexka alt.1283 m
Col du Lindus alt. 1221 m
Col de Lizarietta alt. 441 m
Baie de Chingoudy
LARRAU
BANCA
SARE
BAYONNE UREPEL
HENDAYE Hondarribia Irùn
Zone de passage Point d’observation Zone humide - halte
Barthes de l’Adour Barthes de la Nive m er Cantabrique
Réserve de Lesgau, barthes de l’Adour
Baie de Chingoudy sur la Bidassoa
Col d’Organbidexka
oiseaux aquatiques

On cohabite encore moins avec les oiseaux migrateurs qu’avec l’avifaune qu’on perçoit dans notre paysage du quotidien. En se donnant pour but d’observer et de cumuler des données numériques, l’Homme se place en acteur du spectacle de la migration qui apparaît.
Ce sont le temps long et les attaches des gens au territoire qui permettent de faire des liens entre les modifications du paysage et les routes aériennes plus ou moins fréquentées. Sur ces sites, on n’observe pas de baisse de fréquentation générales des oiseaux. Ainsi, l’observation du passage des oiseaux est une veille de territoire, levier dans la réflexion sur la santé des écosystèmes du territoire et sur l’impact des activités humaines sur ceux-ci.

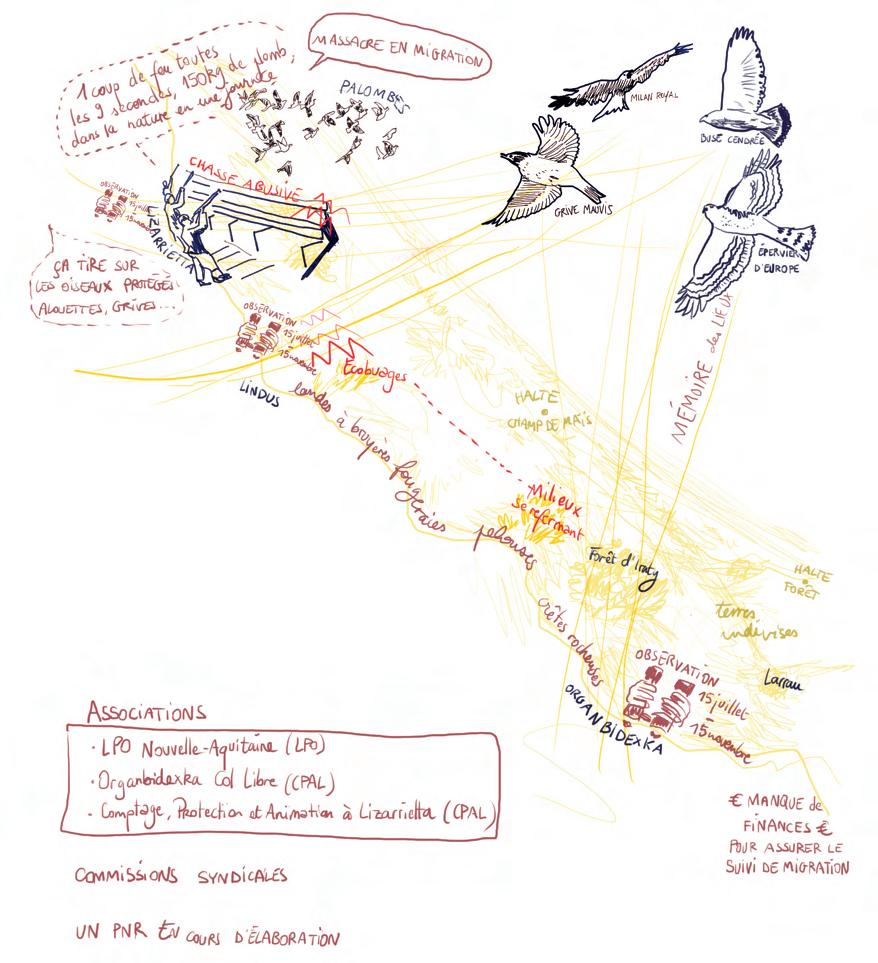
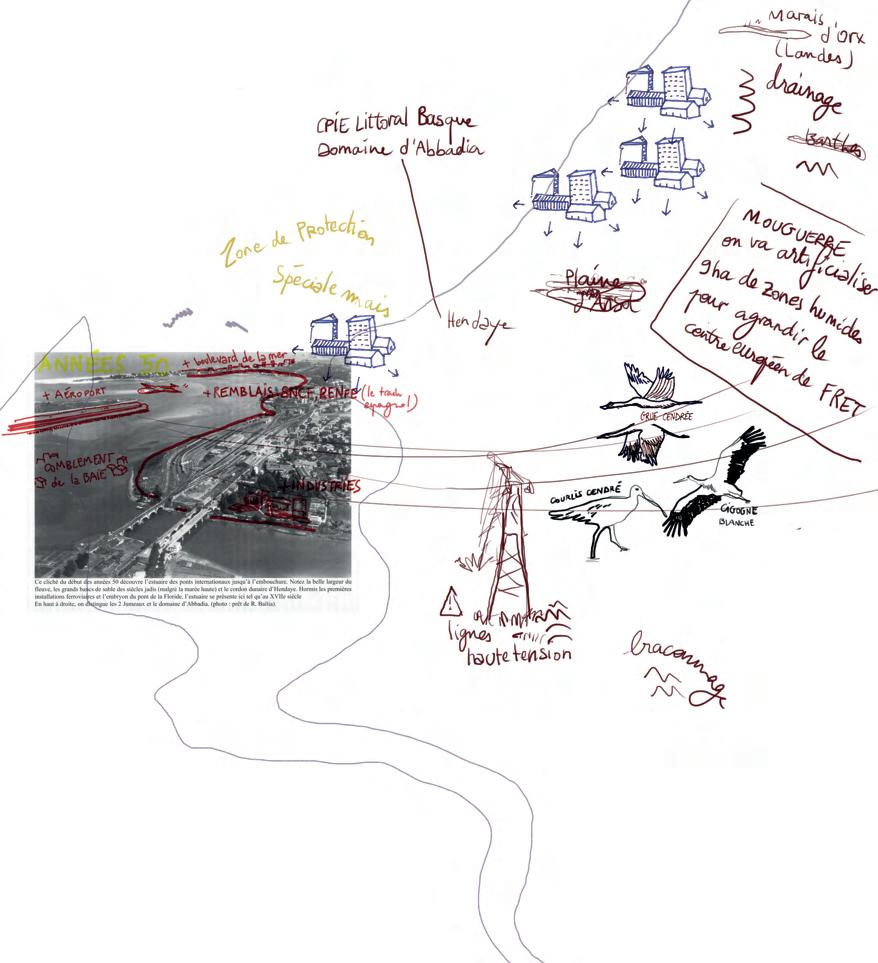
72 73
La réserve du Marais d’Orx à la lisière des PyrénéesAtlantiques
4. les transhumants démêler les fils


Je sillonne le Pays basque en voiture pendant des heures. L’été comme l’hiver, les reliefs m’entourent de leurs puissants rythmes. Je crois que jamais ça ne se finit ; un mont m’entraîne toujours vers de nouvelles et différentes configurations. Je suis ses pentes, et je tourne autour du Soleil. Quand je lis des paroles de vieux paysans, chacun semblait connaître ses terres si bien. L’échelle de la vie, c’est la vallée : qu’une ligne imaginaire y passe au creux ne fait aucun sens. Dans la vallée frontalière des Aldudes par exemple, les chemins pastoraux incarnent la notion de commun ; passer la frontière ne s’incarne pas, et les terres gérées par les bergers s’étendent comme un tout continu. Ici en effet, on s’occupe du sol et du vivant en étant mobile. Les vallons n’étant pas propices à une agriculture céréalière ou maraîchère, les bergers ont eu tôt fait d’installer le pastoralisme comme activité vivrière et prenant soin des paysages. Une de ses pratiques, la transhumance, désigne la migration saisonnière des troupeaux depuis les terres de vallée vers les terres d’estives, situées dans les hauteurs. En libérant les terres de la ferme, les brebis basques permettent à ces sols de fournir d’autres cultures, d’y faire du foin pour l’hiver. Pendant le printemps et l’été, brebis, vaches et chevaux déambulent dans les pâturages montagnards aux vastes espaces, nourris à son herbe. Ces pratiques permettent d’entretenir les milieux haut perchés en évitant que les broussailles puis la forêt ne viennent avaler les versants. C’est une valorisation de la ressource fourragère trouvée directement sur place, indirectement vertueuse pour les sols de l’exploitation qui peuvent se régénérer.

L’histoire de la transhumance imprègne le Pays basque intérieur, le rural, où l’Atlantique n’infuse pas tout à fait. L’économie rurale pastorale a façonné ses forêts, ses pelouses et ses landes. Dès le XIIe siècle, le système des faceries (voir p. 44-45) s’applique aux pâturages d’altitude et permettent leur utilisation consensuelle par les usagers dans une vision globale. Ainsi, de nombreux espaces sont indivis : ils appartiennent à un groupe qui peut bénéficier de droits sur les ressources naturelles. Par exemple, faire pâturer ses bêtes dans des terres en hauteur et bénéficier du cayolar, une maison d’altitude pour le berger qui comporte des espaces et outils pour parquer les brebis, les soigner, les traire. Les cayolars peuvent être privés ou propriété des commissions syndicales; ils sont ainsi à la disposition de n’importe quel éleveur transhumant, qui peut parfois l’utiliser en même temps qu’un autre éleveur. Ils peuvent alors partager les tâches et continuer de s’occuper de leur ferme dans la vallée.
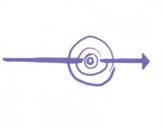
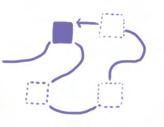

hade territoires indivis dont 27 200 ha d’estives et 14 800 ha de forêt.

éleveurs
répartis sur les terres des 4 commissions syndicales.
20 000 m 5000
CAPB

CS Vallée d’Ostabarret
CS Vallée de Baïgorry CS Pays de Soule
CS Bois de Mixe CS Pays de Cize
Les commissions syndicales prennent le relais des structures intercommunales créées au XIXème siècle. Basées sur le principe des territoires indivis, ces entités regroupent les communes de montagne et ont en charge la gestion et l’animation des terres indivises.
Elles travaillent auprès des éleveurs avec des associations foncières pastorales (AFP), groupements pastoraux (GP) ou syndicats agricoles (EHLG,..). Elles perpétuent un état d’esprit et d’appréhension de la terre par l’humain en cultivant la notion de commun, d’emprunt temporaire, de partage de l’esapce pour différentes activités.
cayolars ovins bovins équins ha
de Surface Agricole Utile disparaissent chaque année.
75
Latranshumanceestreconnuepatrimoinemondialimmatérieldel’UNESCOdepuis2020
Le secteur Montagne Basque divisé en cinq commissions syndicales





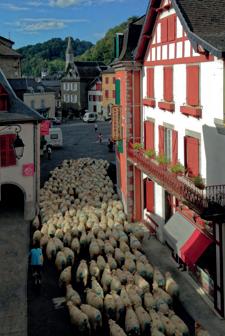


76 77 JANVIER agnelage traite à la ferme de Tardets-Sorholus aux estives à Larrau 300 brebis 20 km une demi journée de marche MAI transhumance SEPTEMBRE AOÛT JUILLET reproduction retour d’estive arrêt de traite traite en estive OCTOBRE NOVEMBRE Tardets-Sorholus Indivisions publiques sur 7 communes gérées par la Comission Syndicale Commission Syndicale du Pays de Soule (43 communes) Larrau
refermement des milieux

montagne en partage
1950 aujourd’hui

Depuis les années 50, on observe que les milieux de moyenne montagne se referment progressivement ; les broussailles et ajoncs gagnent les fonds de vallée, les forêts recouvrent les milieux sommitaux. Les espaces de pacage se réduisent alors, les milieux sont moins composés. Cela modifie l’équilibre des écosystèmes, cloisonne le paysage qui est aujourd’hui fréquenté par des usagers plus nombreux et divers. C’est aussi le risque grandissant de favoriser les incendies. L’embroussaillement des zones intermédiaires nécessite alors des interventions humaines pour entretenir les terres déclarées à la PAC (écobuage, gyrobroyage - pratiques qui, mal encadrées, peuvent avoir des effets nocifs sur l’environnement et les usagers).

chute des transhumances
Le refermement des milieux correspond à la désertion progressive des montagnes par les éleveurs. À l’instar de la tendance nationale, le Pays basque se vide toujours de ses agriculteurs malgré la vitalité des traditions pastoralistes : les effectifs de troupeaux et d’éleveurs font état d’une baisse moyenne de 15 à 30 % par an depuis 10 ans. Il manque 10 000 éleveurs d’ici 10 ans pour combler les départs à la retraite.
À l’institution de la PAC dans les années 60, les éleveurs sont incités à produire plus de lait, notamment par l’allongement de la période de collecte. Or, cette nouveauté est peu compatible avec les pratiques de transhumance qui ne permettent de traire en estive qu’une fois par jour et de récolter des volumes de lait moindres. Avec le développement des techniques agricoles, de plus en plus d’éleveurs laissent leurs brebis à la ferme toute l’année et ont suffisamment de prairies pour subvenir à leurs besoins. Parallèlement, le succès du roquefort du Massif Central provoque l’installation dans les montagnes de fromageries de Roquefort, pour drainer le lait pyrénéen des brebis qui ne transhument pas. De plus, l’arrivée en France de viandes d’agneaux d’origine étrangère dans les années 90 a fait chuter les prix, orientant les éleveurs vers l’élevage ovin ou dans les grandes cultures. Enfin, la mise en place d’aides pour l’élevage en montagne de poneys de race basque pottok a poussé de nombreux éleveurs à se tourner vers l’élevage équin.
On entre dans un cercle vicieux; les troupeaux sont moins nombreux et moins suivis qu’avant, certaines parcelles sont pleines de ronces et abandonnées. Les obstacles à la transhumance se multiplient.


La montagne attire de plus en plus : le «multiusages» est aujourd’hui la grande tendance. C’est une préoccupation majeure des commissions syndicales qui mettent en place des outils pour améliorer la cohabitation en montagne : charte des bonnes pratiques, aménagement de voiries, ... La montagne est en effet de plus en plus fréquentée par de nombreux usagers de loisirs (randonnée, VTT, parapente,..). Une surfréquentation de certains espaces ou une méconnaissance des attitudes à adopter stresse les troupeaux et conduit de nombreuses brebis à avorter. Cela ne concerne pas uniquement les touristes : certains locaux promenant leur chien sans laisse en montagne ont un sentiment d’appartenance et de légitimité à agir comme il leur semble.
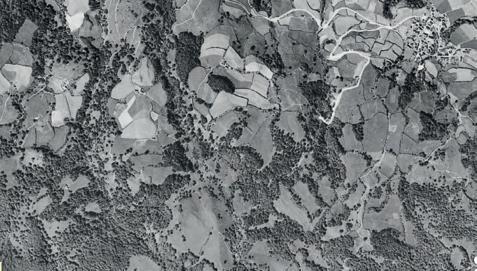
La chasse, à la palombe notamment, est un cas d’études ; ses pratiques peuvent nuire au multi-usages mais la location des cols permet cependant de financer une grande partie des projets d’entretien des zones de montagnes engagés par les commissions syndicales (rénovation de routes, adductions d’eau, fromagerie mobile…). Le partage des montagnes est un équilibre à construire dont la transhumance souffre pour l’instant des tranformations rapides et récentes. Un projet de Parc Naturel Régional Montagne Basque est en cours depuis quelques années. Cette structure pourrait permettre de fédérer les acteurs de la montagne autour d’aménagements de zones et de politiques communes.
En Soule, les cayolars sont privés. Cette tendance à la privatisation nuit à la vocation pastorale des abris de montagne et à la notion d’indivision des zones de montagne. >
«On voit qu’il y a beaucoup moins d’éleveurs qui circulent en montagne. D’autres gens utilisent la montagne mais ceux qui l’entretiennent et la font vivre sont moins nombreux » un éleveur à Sauguis
« On passe d’un côté et de l’autre pour faire transhumer nos bêtes. On appartient à sa vallée plus qu’à son pays.»
78 79
ha
Larrau Larrau
source : remonterletemps.ign.fr./
entretenir le passage
Les usagers
chasseurs touristes usagers de loisirs
occasionnel périodique
quotidien
LES COMMISSIONS SYNDICALES
ADAPTATION
entretien du paysage historique
habitants éleveurs agriculteurs
réinvention des espaces de vie
PARTAGER NOS FORCES ET NOS FAIBLESSES
• Un pâturage organisé et réparti dans le temps et l’espace : éviter le refermement des milieux et à l’opposé le surpâturage des sommets
Les structures impliquées
Commissions syndicales (CS) EHMEB (association des CS) Associations Foncières Pastorales Groupements Pastoraux Syndicats d’éleveurs (EHLG,..) Communauté d’Agglomération Pays Basque



transfrontalité
Programmes européens LEADERs de coopération
Projets artistiques transfrontaliers
Fonctionnement historique des vallées
APPRENDRE À SE CONNAÎTRE POUR MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE PRENDRE CONSCIENCE DE LA FORCE DU COLLECTIF
• Nouveaux troupeaux de Sasi Ardi, race locale et rustique pour continuer d’utiliser la montagne. Race qui s’adapte et valorise les broussailles, sous bois,.. assurer l’équilibre économique multi-usages
tendances bénéfices mutuels dommages et risques
Baisse du nombre d’éleveurs Tensions pastorales Refermement des milieux Recherche de développement et de pérennisation du secteur Montagne Basque

Montagne vivante Entretien des chemins Croisement des savoirs, outils, locaux... Valorisation touristique
Pratiques d’écobuage, gyrobroyage Conflits pour la gestion des espaces et des ressources Menaces pour les troupeaux (stress, avortement)
Les animaux Des grands lieux de transhumance Les paysages
Brebis Vaches
Chevaux
Oiseaux + migrateurs Faune sauvage
Landres, pelouses, sols acides, pelés Fougeraies, broussailles Hêtraies, chênaies
Formes rondes, sombres, horizons lointains
Col de Lizarietta Col d’Organbidexka Vallée des Aldudes Mont Baïgura La Rhune
Les outils existants
Labellisation patrimoine immatériel de l’UNESCO (2020) Faceries anciennes (Lizarietta renouvelé en 1997)
PNR Montagne Basque en élaboration Label AOP Ossau Iraty (fromage d’estive)
FAIRE DE NOS DIFFÉRENCES UNE FORCE
80 81
fils
4. les marcheurs-pélerins démêler les

Le pèlerinage, comme forme spirituelle du déplacement, existe dans toutes les religions depuis des siècles. Dans la tradition chrétienne, le pélerinage régional de Compostelle débute en 800 puis outrepasse rapidement les frontières espagnoles. Véritable manne financière pour l’Église des siècles durant, les pélerinages constituent des lieux d’échanges culturels et des voies de communication sillonnant l’Europe entière. Les pélerins espérent une guérison ou un salut, la route de Compostelle devient un exercice spirituel et une manifestation de la foi. Ceux-ci se déplaçaient de sanctuaire en sanctuaire. Ils étaient attirés par la réputation des reliques et par les secours qu’ils trouveraient au long d’une route.

Restes d’un ancien quai de passeurs sur le gave d’Oloron à Andrein - Musée de Basse-Navarre, St-Palais
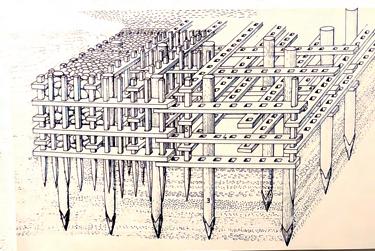
Les chemins de Compostelle
Mais le pèlerinage a aussi touché le monde profane en jouant un rôle décisif dans la naissance et la circulation des idées et des arts. S’il y a 4 « grandes voies », en réalité il
a pu y avoir autant d’itinéraires que de pèlerins. Au Pays basque ces 4 voies se rejoignent, à St-Palais puis à St Jean Pied de Port, grande figure du pèlerinage. En réalité d’autres chemins existent comme la voie littorale qui passe à Bayonne, qui avait son hôpital au XIIe siecle, et menait les pèlerins débarqués des ports sur la côte. An 0 30 44 800 Aujourd’hui
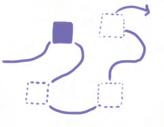

Crucifixion du Christ : St-Jacques le Majeur, apôtre, part évangéliser l’Espagne
St-Jacques le Majeur est décapité à Jérusalem
La découverte de son tombeau à Compostela déclenche un pélerinage européen autour de ses reliques pendant des siècles
Les pélerinages sont pratiqués par croyants et athées dans un but de loisir
jours pélerins
de marche de Bayonne à St-Jacques-de-Compostelle (878 km) à Compostelle en 2019
Peregrinus du latin per ager à travers champs per eger passage de frontières, où le voyageur devient un étranger

randonnées
82
GR
encadrées par la CAPB qui sillonnent le territoire
83
Aujourd’hui, de nombreux sentiers, courtes distances ou grandes randonnées, sillonnent le Pays basque en tous sens. Appui d’un tourisme de nature grandissant qui se tourne doucement vers les terres, les chemins s’insèrent directement dans le paysage du quotidien des locaux pour qui le rythme du touriste déstabilise le paysage connu : lenteur de la marche, fatigue du trajet, recherche de curiosités, d’émerveillement, de surpassement. On n’est plus à la recherche d’espaces pratiques et fonctionnalistes mais de lieux dont on se souviendra. Les chemins, vecteurs de pensée, et de rencontres, sont une zone de préhension du paysage par les yeux, par le corps, que seule l’expérience du marcheur peut révéler. Depuis 30 ans les routes de Compostelle ont perdu leur unique dimension religieuse et se posent comme une réaction aux dérives de notre société occidentale, individualiste, hyper-technologique et ultra-consumériste. La randonnée prend du sens en s’inscrivant dans une tradition, sur des itinéraires
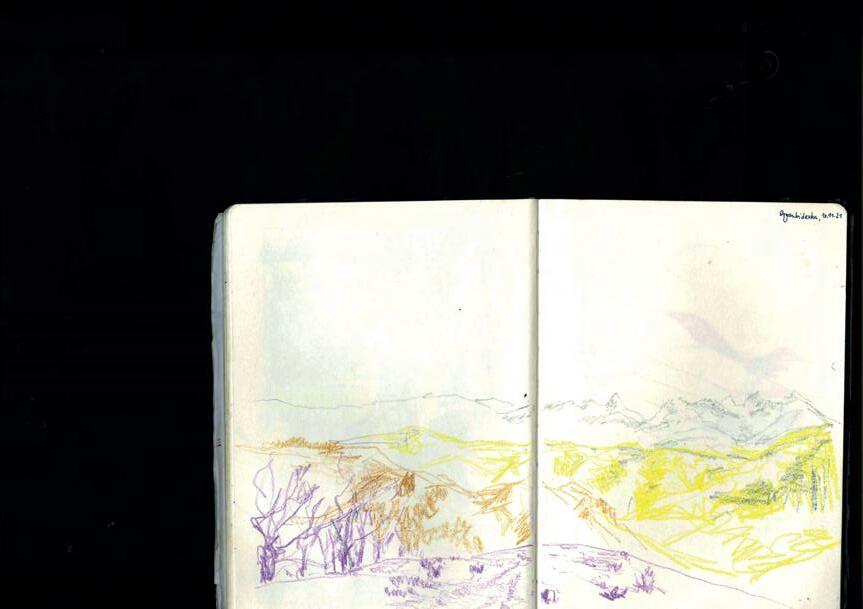

Un brin de sentiers du Pays basque chargés d’une mémoire collective, dans un esprit de rencontre des autres, un dépouillement de soi et une recherche de bien-être. Elle résiste au temps et se transmet malgré la transformation de nos villes, de nos espaces, de nos vies. On s’arrête en ville car elle nous dépasse; on traverse les villages pour se ravitailler. Cela m’interroge sur ce qu’il se passe aujourd’hui sur les chemins, à travers le paysage ; et non seulement par les symboles religieux égrainés tout le long des parcours. Dans une ville comme St-Jean-Pied-de-Port où l’entière toile de la ville semble oubliée pour s’être entièrement consacrée au passage des pélerins, comme éviter cette spécialisation des espaces et acueillir en partage ? Que retient-on de ces paysages ?
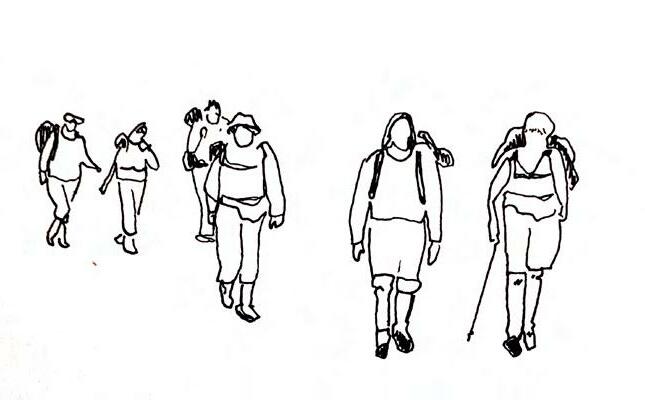




Les chemins mènent à des objets particuliers ; on grimpe pour voir la Rhune, plus haut mont du Labourd (900 m), on foule les pas des contrebandiers en longeant la frontière, on retrace le paysage des cerises d’Itxassou, l’histoire de Roland et de son cheval fendant la pierre, on guette les palombières sur des chemins mettant en scène la chasse de jadis. On se laisse porter de théâtre en théâtre. Quand je suis marcheuse, je me dis que beaucoup de mes haltes sont quand même un peu orchestrées pour moi. Les figures des frontons de pelote basque, dans chaque village, ont quelque chose de rassurant et de fédérateur; simple mur et vaste parvis clair bordé d’escaliers, un espace public en puissance.

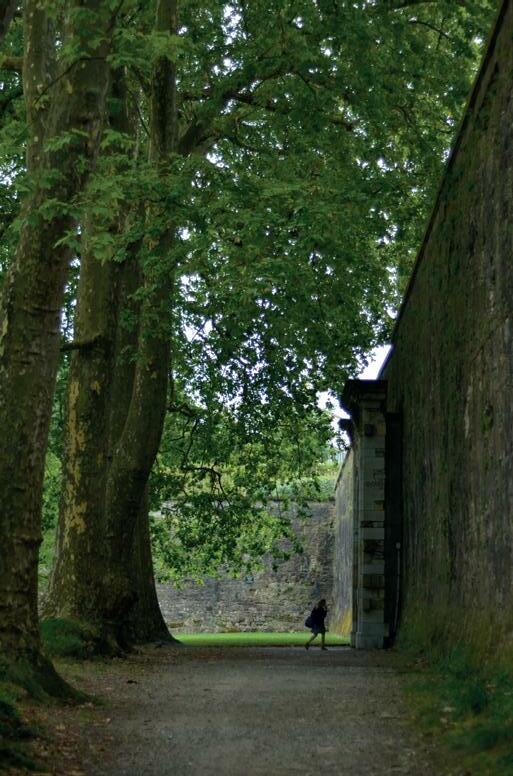




Sur les chemins, se regarder en se croisant c’est déjà prendre soin de l’autre; un sourire alors tout va bien. Bonne route et attention ça grimpe dans 300 mètres ! Le rythme rend plus disponible aux autres et plus attentif à ce qui nous entoure. Il arrive souvent qu’on croise des bêtes, chevaux, vaches, tranquilles ; pas plus effrayées par nos voitures que par notre bipédie. Objets dans le paysage à photographier. On s’arrête en haut pour boire une bière dans les fameuses ventas où des prémices d’exotisme excitent notre recherche de dépaysement. En marchant je suis presque une touriste comme un autre; je ne dévie pas, n’y fais rien qu’emprunter l’espace que je traverse.

86 87
j’ai rencontré
j’ai eu vent d’ailleurs
mon corps sur le chemin dans les confins
micro-halte se souvenir de la route
accueillirl’itinérance dans la ville
échelle vitesse fréquence durée
vie quotidienne plusieurs mois
Parcours sécurisé
Accueil besoins élémentaires
Informations sur le pays d’accueil Orientations dans la ville/le parcours
ÉVOLUTION DE LA DYNAMIQUE DU PASSAGE

Continue voire croissante
ENJEUX LIÉS AU
PASSAGE SUR LE TERRITOIRE
Contournement des politiques répressives
Continuité dans le réseau de haltes
Lien dans/avec la ville
échelle vitesse fréquence durée
saison biannuelle variable selon l’espèce
Lieux de haltes diversifiés milieux adéquats, nourriture, eau
Couloirs dégagés (obstacles) et tranquilles (chasse)




Conditions météorologiques favorables OISEAUX MIGRATEURS

Se déplace en fonction de facteurs météorologiques, qualité des habitats, etc.
Pressions d’artificialisation des milieux
Chasse abusive lors des phases de migration


Dérives de l’écobuage en montagne
Encadrer le multi-usages de la montagne
Alimentation en eau Chemins entretenus Organisation et sécurisation du multi-usages TRANSHUMANTS
échelle vitesse fréquence durée
année biannuelle quelques heures à une journée
moment de vie
PÉLERINS MARCHEURS
échelle vitesse fréquence durée
quotidienne quelques jours à plusieurs mois
Accueil quotidien, besoins primaires
Endroits de halte
Itinéraires, localisation


En diminution (-10 à 30% par an)



Continue
Freiner la spéculation foncière et immobilière sur les terres cultivables
Protéger les cayolars comme biens communs à vocation pastorale
Restaurer bordes de montagne (cabanes de bergers)
Cultiver la dimension spirituelle des chemins comme fenêtre sur le paysage
Sensibiliser, créer de l’échange à travers le paysage traversé
Des villages à l’identité diversifée et pas uniquement patrimonialisés par les chemins de Compostelle
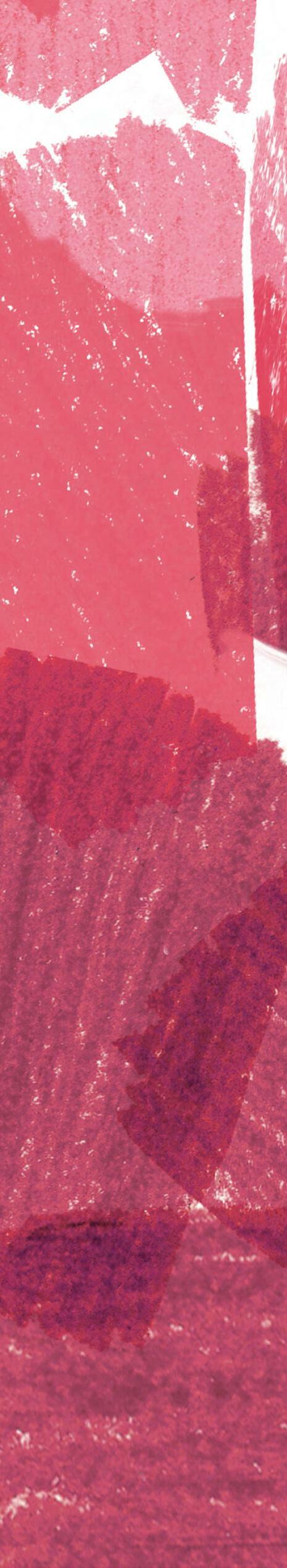
89
88
territoire sillonné : de l’espace au lieu démêler les fils
D’après la synthèse établie précédemment, je constate que les enjeux liés à ces différents passages n’ont rien à voir, sinon l’espace qu’ils traversent tous. L’espacement entre les vivants engendrent l’espace qu’ils habitent1. L’espace devient un lieu lorsqu’on le transforme par l’utilisation qu’on fait ; cela devient un objet d’intérêt, un but, une zone d’interactions. Le lieu désigne à la fois une donnée temporelle et spatiale.

L’espace collecte les passages des uns et des autres pour fabriquer l’histoire d’un lieu. Pourtant aujourd’hui, la migration fait partie d’une réalité étouffée du territoire et est accompagnée surtout par des faits privés, ou sous le motif de l’urgence. Habiter en mouvement pour un temps suggère de s’adapter à la forme des espaces. En retraçant les histoires égrainées sur la route, on arrive parfois à des chevilles où les histoires convergent. Cette carte des passages nous montre que les espaces de migration sillonnent le Pays basque sur de très vastes espaces. Les passages empruntent des formes diffuses : le couloir ou la voie relèvent d’un sentiment naturel de l’orientation, l’espace de migration semble délimité par raison et observation du terrain, la route et le chemin répondent à une nécessité de relier des points.
Sur cette carte sont synthétisés les déplacements des 4 individus étudiés. La cartographie du mouvement se heurte à l’impossible objectivité et exhaustivité du sujet étudié. Elle permet ici
d’imaginer des formes de paysage en fonction de la nature de la route empruntée et montre une forme d’occupation plus ou moins prégnante du mouvement dans le territoire.

L’appréhension des paysages du passage naît de cadrages plus localisés. J’en ai choisi quatre, où convergent des routes pour en parler à travers le même prisme.
Comment ces lieux de passage, caractérisés par leur arpentage et leurs haltes, produisent de l’accueil ?
1 : Terra forma, manuel de cartographies potentielles - Frédérique Aït Touati, Alexandra Arènes, Axelle Grégoire, éditions B42, 2019
91
4.
0 5 10 km 90 Frontière CAPB Tracé ferroviaire Espace migratoire des transhumants Couloir migratoire des oiseaux Chemins de Grande Randonnée Route des migrants


5. Des paysages accueillants ? Les paysages du passage Anglet Biarritz Bidart Arcangues 0 750 1500 m Forêt du Pignada Aéroport de BiarritzAnglet-Bayonne A63 - AutoroutedelaCôte Basque < Hendaye <
atlantique 92
Océan
la ville
Lieu de pause pour les migrants
Traversée par les oiseaux
Lieu d’intérêt pour les marcheurs

la rencontre du lieu le cas des migrants
pontGrenets


les routes
Bordeaux



QuaideLesseps
AlléesMarines
par le bus
par le train
Illégale, soumise aux contrôles policiers Survol, pas d’arrêt sur les berges Itinérance dans la ville au gré des activités touristiques
les abris
Pausa Auberges Réserve de Lesgau
fonctionnement assos + mairie


accueil 3 jours lits de camp ravitaillement capacité 120 personnes
nord ouest de Bayonne zone humide classée ZNIEFF à l’entrée des barthes
réseau d’hébergements pour pélerins dortoir ou chambre séparée service de repas
La rive droite de l’Adour est aujourd’hui la partie haute de Bayonne. Quelques centaines d’années auparavant, le fleuve faisait la séparation entre deux villes, même deux départements. De nombreux chantiers navals et, plus loin, le port de commerce, s’égrainaient en face de la vieille ville de Bayonne, construite en rues et ruelles autour de son château. Aujourd’hui, même si la gare y structure l’organisation et que de plus récents quartiers constituent une autre facette de la ville, plus résidentielle et mixte, on entend toujours qu’on « se rend à Bayonne lorsqu’on traverse le pont ».

En 2018, c’est à la place des Basques que des «bus Macron» chargés de migrants, hommes jeunes d’Afrique subsaharienne pour la plupart, font étape. Sur cette zone libre de la ville s’entassent les gens en pause sur leur parcours, avant de reprendre un bus vers Paris, vers l’Allemagne. C’est encore l’été ; les Bayonnais remarquent immédiatement tous ces gens qui dorment dehors. Après deux mois d’une aide auto-organisée par les habitants du quartier, les voix se structurent

94
95
0 100 200 m Citadelle militaire navette maritime centre de tri ^ vers l’estuaire Gare Pausa
Place des Basques Quartier administratif Château jardin botanique remparts Jardin Léon Bonnat Mairie Place du Réduit Parking Quartier St-Esprit ancien quartier des immigrés juifs PetitBayonne DIDAM art contemporain L’Atalante Cinéma pontSt-Esprit
entrepôt vide <
Gaztexte local Diakité
notamment autour des associations La Cimade et Etorkinekin pour demander expressément de l’aide à la mairie de Bayonne et à la communauté d’agglomération : les structures publiques doivent faire quelque chose. La mairie fournit d’abord un parking puis dédie un ancien local militaire du quai de Lesseps à l’accueil de ces personnes qui arrivent depuis la frontière. On le nomme Pausa ; la pause basque sur la route. C’est alors l’association Diakité et les financements de l’agglo qui font vivre et fonctionner le centre pourtant allégal au regard de la loi française; je n’ai connaissance d’aucun projet public similaire en France.
La règle d’accueil est un passage de 3 jours et 3 nuits par personne, pour permettre un renouvellement cadencé des places libres. On apporte à manger, de quoi se vêtir, les premiers soins. L’on ne fait que passer; l’important est de continuer sa route. Le travail mené par les associations de la Cimade, Bestearekin et Etorkinekin permet pour certains de se détourner de l’urgence en bénéficiant d’un logement dans des familles, réparties dans le Pays basque, notamment pour les mineurs isolés. La majorité pourtant viennent ici non par choix de territoire mais parce que la communication (téléphone, réseaux sociaux) oriente les parcours vers cette étape bayonnaise; une petite ville de bonne taille pour ne faire que transiter, ne pas faire des vagues, continuer le voyage entrepris. Le lien à la ville est donc inexistant car le temps manque et ça n’est pas l’objet du centre; le quartier inactif n’attire que les bénévoles et les visiteurs du centre d’art contemporain et du cinéma d’art et d’essai qui se sont installés à l’entrée du quai.
Désormais ce sont des salariés de la mairie
qui reprennent les rênes de l’organisation.
La mairie et l’agglomération financent le million d’euros par an qui permet au centre de fonctionner. L’arrêt de bus est déplacé devant lui pour en faciliter l’accès. Un arrêté municipal éloigne les voitures de police des abords du centre. Pourtant à deux pas de la gare, au bout du quai, Pausa ne se remarque pas ; le bâtiment lui-même semble vétuste et tous les bâtiments attenants, abandonnés. Des gens traînent devant, appuyés aux barrières du quai, circonscrits à sa longueur.
Le quai est un espace dilué de la ville, cloisonné, peu fréquenté ; de longues friches ferroviaires où voitures et objets de chantier s’entreposent, se délayent en 30 hectares vers un port en retrait de la ville. La promenade qui court le long est très fréquentée de passants au rythme lent de la balade; de fameux équipements sportifs s’y sont plantés.
Un peu plus loin, la navette maritime de la ville fait escale. Cela grouille tranquillement.
Pour saisir la dynamique longiligne de cet endroit, j’ai besoin d’y errer, d’y venir, d’y retourner longuement, et de voir les flux tendus s’égoutter entre l’arrivée des bus, les entrées sans bruit derrière l’opaque portail en ferraille de Pausa, et les permanences de Diakité au Gaztexte, le local associatif à quelques dizaines de mètres. Ce sont des allées et venues à l’échelle de la rue où se rangent les voitures.
Le coteau contre lequel s’adosse Pausa est souligné de hauts remparts. Il me frappe de sa hauteur qui surplombe la ville; c’est la citadelle Vauban qui accueille aujourd’hui le régiment des parachutistes. La colline est si haute et fermée que je ne l’avais pas vue cet été. L’arsenal de défense est entouré d’un
quand j’étais petit, c’était pas fermé ! On jouait au foot dans le parc des militaires

tant
ils parlent de refaire le quai, c’est sûr que le centre d’accueil ne va pas rester là
Situation illégale du site Pausa : refermement par nécessité et discrétion
Cloisonnement
Vacances des bâtiments du quartier
Quartier attenant enfriché et servant de parking; adossé à des zones closes et inaccessibles
Déconnexion des autres villles et du reste de Bayonne
Parcours jusqu’à Bayonne dangereux
Projet de réfaction du quai : avenir incertain de l’espace d’accueil Pausa
Foncier sous pression
Pressions d’urbanisation sur les milieux
vaste parc arboré que je ne pourrais que longer. Il encadre cette mystérieuse pièce de mon étude, jolie dans son coin, hostile à la fois. Dans un à-côté de la ville qui me semble clément de l’extérieur et malgré tout détaché du reste; à côté de ce majestueux pont qui fait flotter les couleurs de dizaines de drapeaux différents, comme une embrassade familière à une sorte d’interculturalité familière, récurrente, nécessaire. En dessous, le fleuve me paraît loin, coincé dans ses pierres ; il faut que je remonte l’Adour pour commencer à apercevoir quelques touffes d’herbes hautes où quelques canards barbotent; il faudra quitter la ville et s’enfoncer dans les barthes pour retrouver des milieux propices à la vie animale.
Lequel de ces passants ose traverser ce pont pour se rendre dans Bayonne, le «vrai», l’historique, le bien construit ? Et pour aller où ?
96 97
qu’il y aura du passage, cet endroit existera toujours

Irùn
0 750 1500 m Aéroport de San Sebastian Parc écologique Plaiaundi Baie
Mont
alt. 545 m Xoldokogaina alt. 486 m Mont du
alt. 277 m
98
Hendaye
Béhobie Biriatou Hondarribia FRANCE ESPAGNE
de Chingoudy
Jaizkibiel
Calvaire
Baie du Figuier Domaine d’Abbadie -CPIE Océan at lant ique LaBidassoa
la ville
Porte d’entrée pour les migrants
Lieu de halte pour les oiseaux Traversé par les marcheurs
les routes
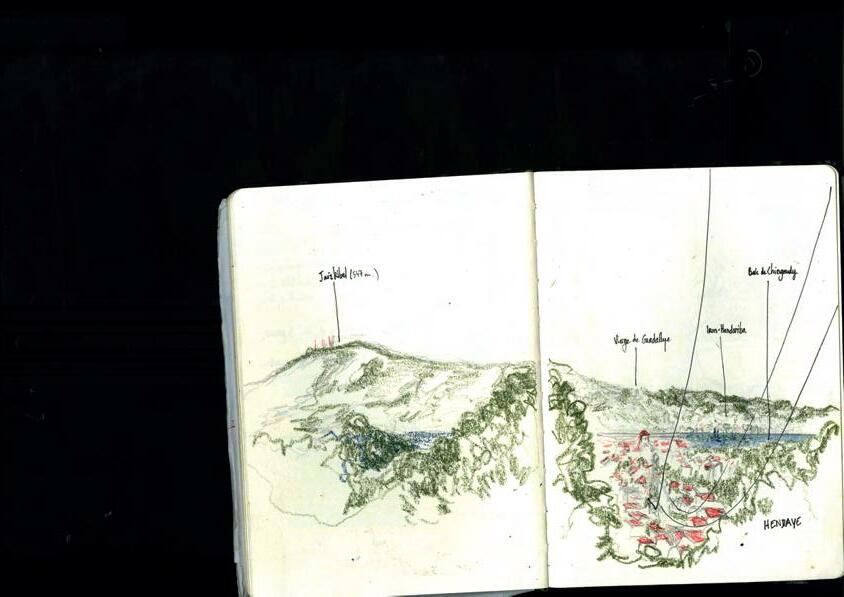
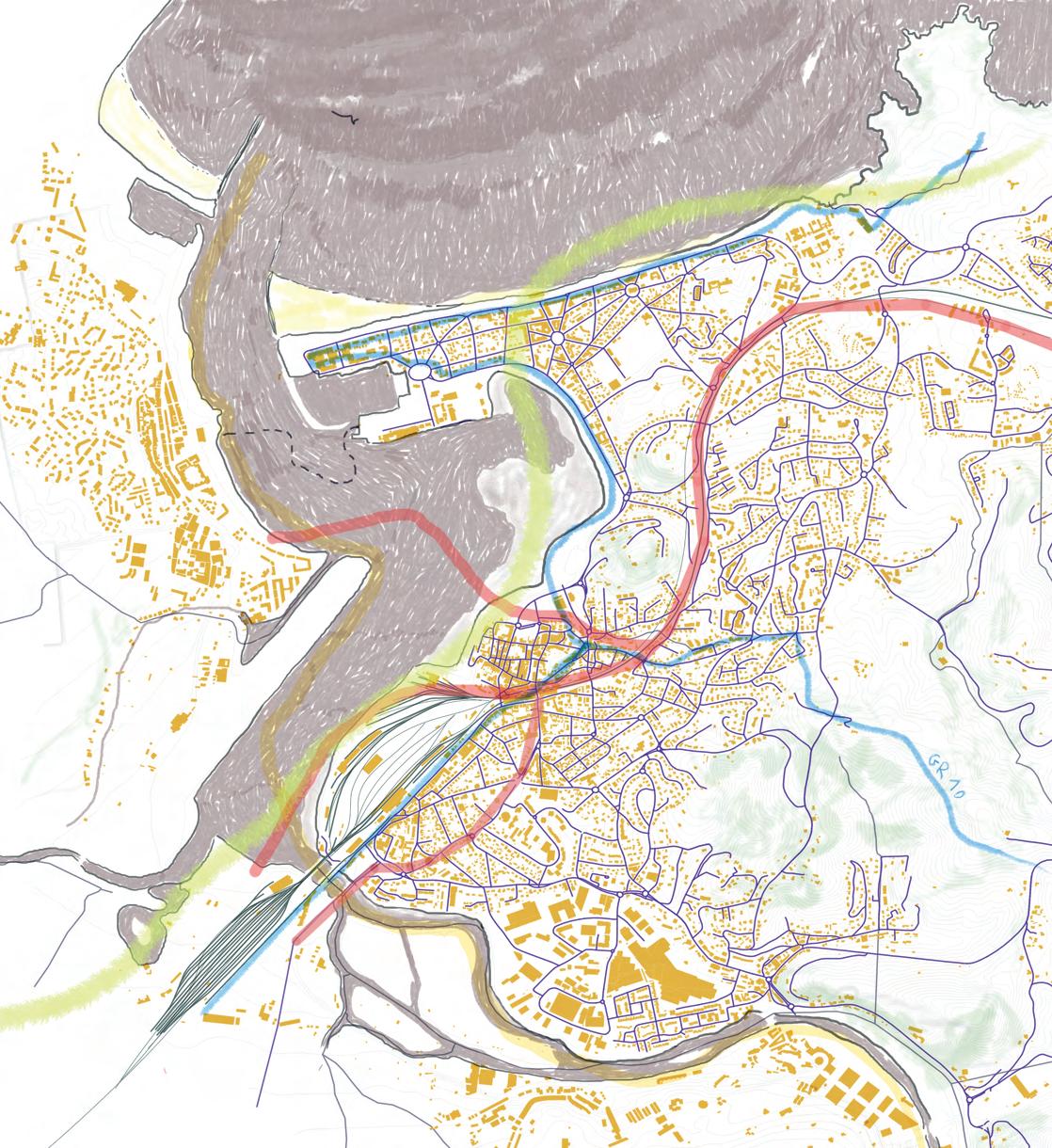
Hendaye-Plage
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Domaine d’Abbadia
Quartier Corniche
gare des Deux Jumeaux Bayonne à 35 min >

terres remblayées
EspagneFrance


Policée, tension Obstacles (pont fermé, rivière à franchir)
les abris
Espace public policé
Entravée par l’urbanisation Point de départ/d’arrivée du GR10 la baie de Chingoudy
campings, locations touristiques...


Pont ferroviaire Pont de l’Avenida
parc ornithologique Plaiaundi
100 Isla Galera
surveillance policière
eadenprom de la ba ie
port de plaisance navette maritime, 5 min vasières et îles centre de rétention administrative Pont International de St-Jacques
aéroport de San Sebastian gare principale SNCF gare RENFE
tiers-lieu artistique

Centre-Ville Zone Industrielle Les Joncaux
premières collines
101
Isla Iru Kanale
Isla Santiago aurra front résidentiel
falaises, entrepôts 0 250 500 m
Île des Faisans
Quartier gare Péage Autoroute A63
Hendaye est une petite ville à flanc de collines et d’océan. Dans les années 50, son pourtour est remanié par l’urbanisme balnéaire qui aménage tout un quartier pour les touristes estivaux : du casino aux établissements de bains en passant par le port de plaisance. J’essaie d’imaginer ce littoral avant que de nouvelles terres n’émergent de l’eau; une frange alors habitable pour plein de nonhumains.
Depuis, les infrastructures se sont multipliées, de vastes parkings en bâtiments liés au tourisme ou à l’industrie. Un quartier identifié par les loisirs d’eau et séparé de sa partie résidentielle, un peu plus en hauteur.
Longeant la frontière par la passerelle en bois qui serpente sur la baie, je suis entre deux mondes : une zone industrielle grillagée et une promenade aménagée pour profiter de la Bidassoa. Il fut un temps où cette zone limitrophe était cultivée pour nourrir la ville. Des îles me séparent de l’Espagne. Je les vois habitées par des oiseaux qui y règnent ; on dirait une terre bénie entre deux griffes urbaines. En face, de grands immeubles et la route qui passe très vite. Ça ne donne pas très envie de s’y jeter. Sous le pont de St Jacques, j’aperçois les tentes de la police aux frontières et les voitures qui roulent au pas. Certaines se font arrêter. Tout le monde sait qu’ici tentent de passer des dizaines de migrants par jour. Pourtant je n’en distingue aucun dans le paysage. La police est partout, jusque dans le train qui me remmène à Bayonne. C’est le paysage de l’invisibilisation. La gare, lieu cible, est constamment surveillée d’une voiture de police. Dans ses bâtiments il y a Borderline Fabrika, un tiers lieu culturel et artistique qui réinvestit d’anciens locaux de la SNCF.

À ses abords, caché derrière un groupe d’immeubles, le centre de rétention administrative s’occupe d’enfermer les migrants pris à la frontière en attente d’être renvoyés en Espagne; ils y restent quelques jours pendant laquelle l’administration remplit des papiers. À Hendaye, pas d’accueil ou de prise en charge particulière ; on veut fuir d’ici, partir à Bayonne par le train ou la marche en se cachant; c’est là bas que se trouvent les trains, l’accueil de Pausa, le réseau associatif qui aidera à remonter la France.
L’île des Faisans, micro symbole d’une terre en partage entre les deux pays, qui fut un lieu de réunion prisé par les commissionnés français et espagnols pour trouver des accords sur la gestion de la Bidassoa, m’est tout aussi inaccessible. Un petit parc planté y trône pourtant, de loin, je suis amusée. Ici, ville tranquille qui essaie de ne pas ébruiter les répressions policières quotidiennes, la tension risque de ne faire qu’augmenter, accélérant des fractures sociales, et la pression sur les associations qui, à Irùn ou à Bayonne, tentent d’apporter le secours aux migrants.
À l’entrée d’Hendaye, Abbadia, un site protégé sur la Corniche, abrite un CPIE, un château et de vastes prairies, vergers, promenades préservées de l’urbanisation. D’ici on domine toute la côte basque d’où se jettent les falaises dans l’océan. On n’y passe pas sans être vu; le sentier côtier est très fréquenté et d’autant plus dangereux que la Corniche perd ses falaises par pans.
Ici les randonneurs arrivent ou partent vers les horizons montagnards du GR10. Il quittent le monde urbain pour s’enfoncer dans le monde rural basque.
la rencontre du lieu
102 103
Contrôles de police systématiques
Pont piéton fermé
Espace public de l’invisibilisation Centre de Rétention Administrative à la frontière
Quartier transfrontalier du passage à l’accueil
Infrastructures côtières qui grignotent le littoral et les espaces naturels lié à l’étouffement des flux de migrants et d’oiseaux
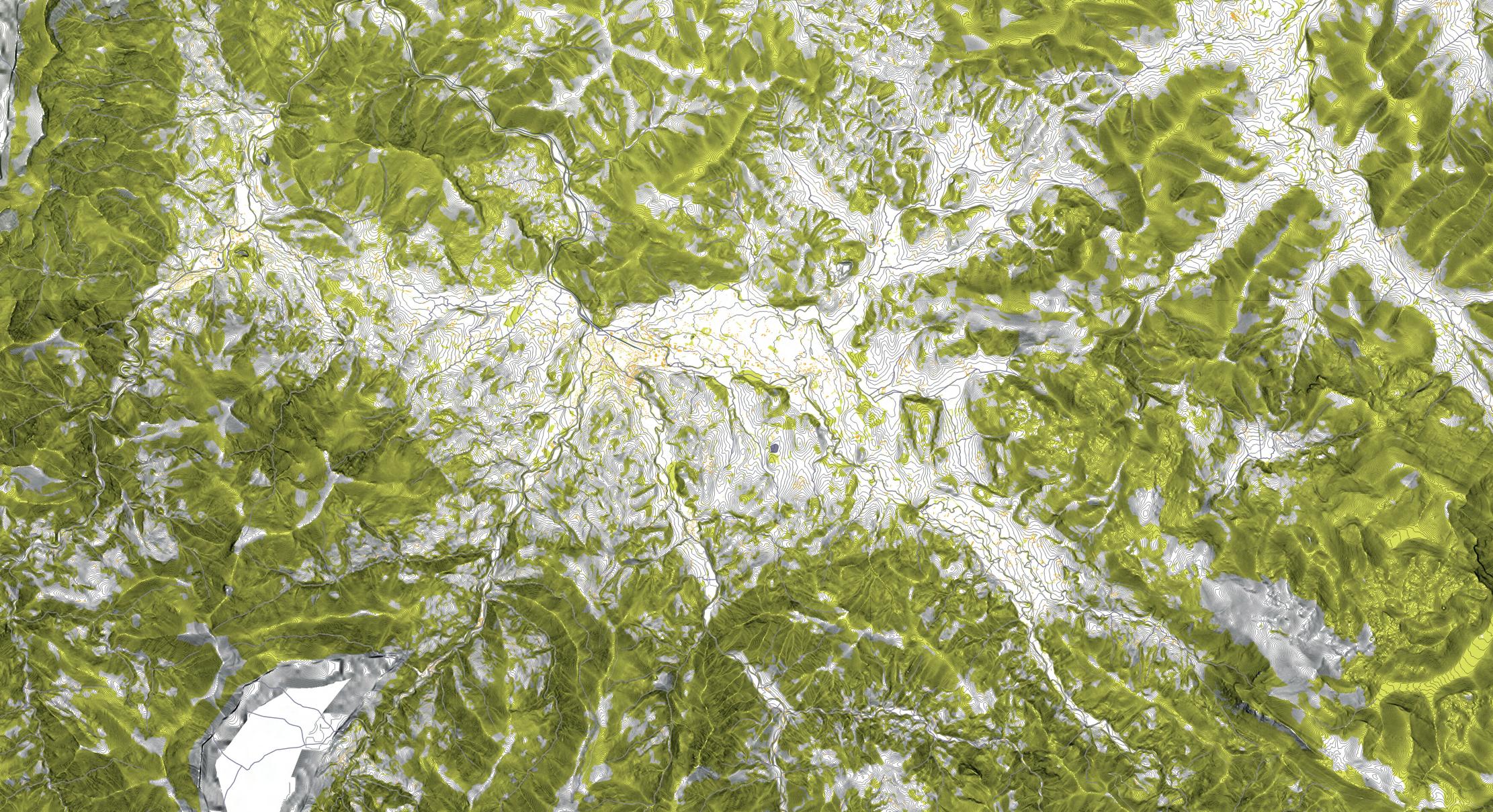
St-Jean-Piedde-Port Ispoure Ascarat Uhart-Cize St-Michel Lasse 0 750 1500 m la Nive l a Ni ve d e Béhé robie la N i v e d ’ Arnéguy Ihizgorri (alt. 555 m) Pic d’Arradoi (alt. 660 m) ESPAGNE FRANCE < Bayonne 104
la ville


la rencontre de la ville
les routes
les abris
Tous types d’auberges, campings, chambres d’hôte... pratique courante du donativo (je paye ce que je peux)





106 107
Gare Services Zone résidentielle Zone pavillonnaire Centre médiéval Auberges, campings Citadelle laNive<Bayonneà1h30 Pic d’Arradoi GR10 GR10 GR65 GR65 -Voie du Puy-en-Velay
Etape
Ralliement
Chemins
pour les marcheurs
des chemins de St Jacques
pastoraux 155 cayolars répartis sur le territoire de la commission syndicale de Cize
Zone
de transhumance
Dans une plaine reculée au creux des montagnes, alors que le train à flanc de falaise ralentit, St-Jean-Pied-de-Port se découvre. C’est ici la mecque des pélerins, une cité qui recueille depuis des siècles les passants au creux de la vallée ; la dernière étape avant de franchir les Pyrénées. Quatre voies se sont rassemblées en amont et forment deux brins à la sortie de la ville ; des milliers de personnes s’arrêtent chaque année par ici. Il faut y passer par le bureau des pélerins, petite pièce où l’on tamponne un carnet de pélerinage et où l’on peut trouver des auberges pour dormir. Puis visiter les remparts, passer sur les ponts de pierre et sous la porte St-Jacques, aller au supermarché se ravitailler.
Si de multiples auberges, restaurants, et magasins de souvenirs qui y sont liés s’égrainent dans toute la ville, une impression d’être passé à côté d’une vie de village flotte quand on s’en va.
Tout le bourg médiéval semble préparé pour l’accueil du pélerinage et l’expérience du passage s’en trouve altérée. Les espaces publics vides, n’appelant pas à un recueil religieux ou à une relation commerciale liée à la halte de la randonnée sont rares.

Le train s’arrêtant brusquement à St-Jean matérialise une césure entre zone résidentielle et zone touristique. Je me sens plus à l’aise en m’écartant de la ville, suivant les chemins qui m’emmènent voir les moutons. Le paysage est superbe et grimpe tout autour. Au milieu des terrasses, je ne le retrouve pas et je me demande si ce théâtre existe toute l’année.
Concentration de flux touristiques
Monopolisation du paysage de l’accueil par les chemins de Compostelle et ses symboles religieux
Étalement urbain
Déprise agricole, progression des milieux forestiers sur les vallons
Alternatives à la sacralisation de la ville
Nouvelles leviers économiques
Créer des vides fédérateurs
Lier des chemins d’itinérance par un espace commun
Une vallée résidentielle connectée aux chemins
La gare et le train comme leviers
108 109
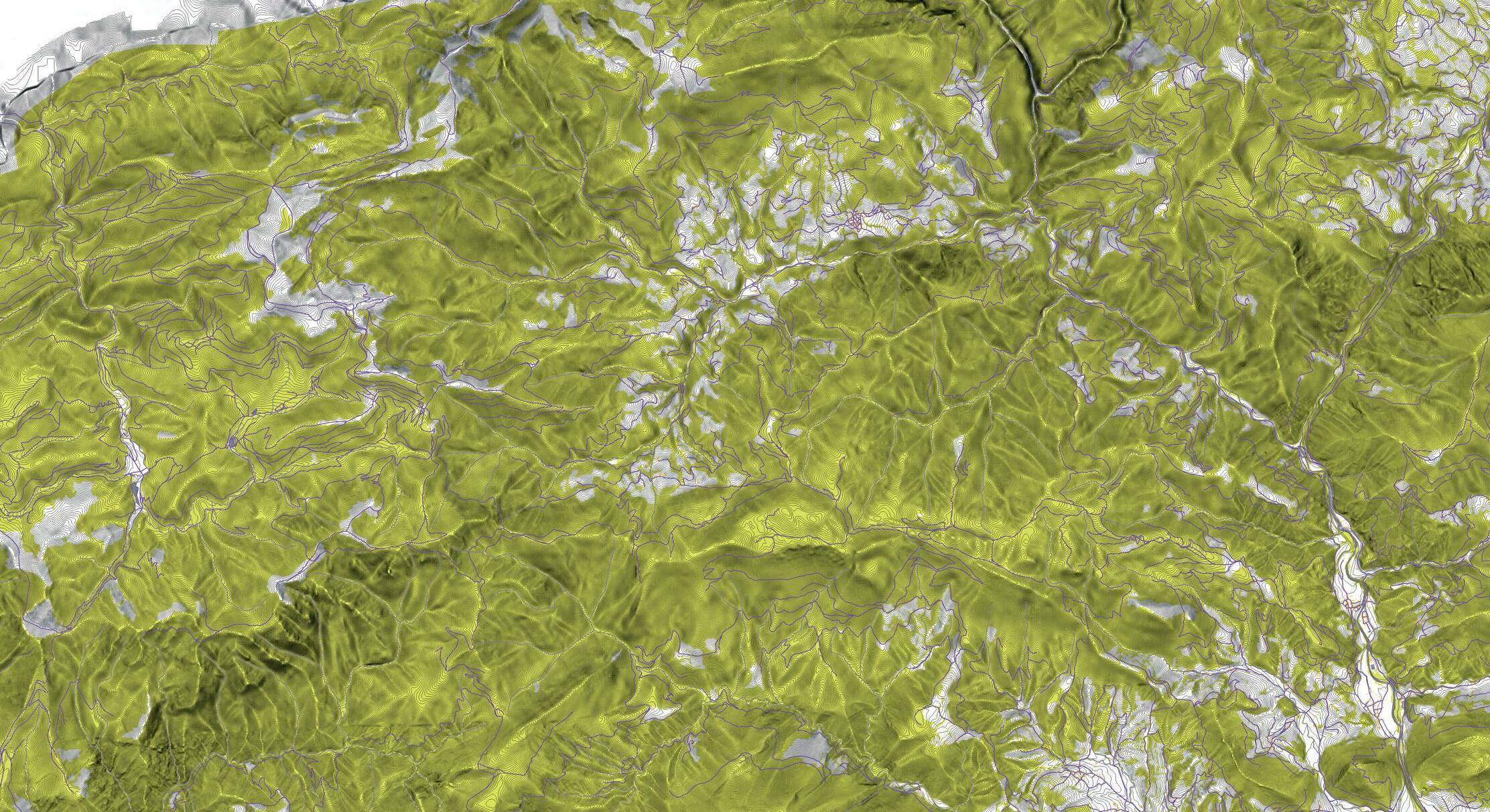
0 500 1000 m Col d’Organbidexka Pic des Escaliers (alt 1472 m) Pic Chardeca (alt 1440 m) Pic Mendibel (alt 1411 m) Bois de Gerrendoi Bois de Mayrule Forêt d’Iraty Châlets d’Iraty Cayolar têrC e deMillagate CrêtedeZazpigain detêrCkxedibmagrO’ a 110
le site

Convergence et franchissement pour les oiseaux
les routes

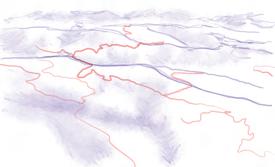
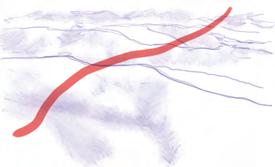
la rencontre du lieu
Survol du col
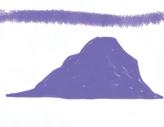
les abris
Lieu de transhumance pour les troupeaux Réseau de chemins pastoraux Libre cheminement en pâtures
Traversé par les marcheurs (GR10)
46 cayolars dans la commission syndicale de Soule
Chemins de randonnées balisés
Cayolar

la forêt d’Iraty les chalets d’Iraty
Spot d’observation des oiseaux
La Ruche, cabane d’observation


Chalets d’Iraty

112 113
Pour arriver tout en haut je passe par les routes étroites et serpentant sur les versants. C’est sublime et immense; en plein dedans, le paysage. En chemin je ne rencontre que quelques chevaux. Les routes semblent se rétrécir à mesure que la voiture s’élève; cela me paraît long, j’imagine le trajet que je parcours sur la carte. Le col d’Organbidexka est traversé par le GR10 ; c’est un des derniers cols avant le passage en Espagne et la liaison avec le GRT10 au niveau d’Holzarte.
La grande majorité des zones de montagne ici sont des terres indivises qui appartiennent à la commission syndicale de Soule.
L’ONF est également un gestionnaire présent sur le site et possède la maîtrise d’œuvre de la forêt d’Iraty, deuxième plus grande hêtraie sapinière d’Europe, trouée de poches d’eau et de tourbières.
À sa lisière, de vastes pelouses et pâturages herbeux, landes à bruyères. Des crêtes rocheuses assèchent ce paysage diversifié qui se referme par la montée d’une strate arborée sur d’anciennes pâtures.
À l’amont du col, les 35 châlets d’Iraty qui composent le village de tourisme installé dans les années 70, se posent autour d’un parking où se garent de nombreux véhicules pour y admirer le point de vue. Ici, le tourisme fonctionne bien : après les différents confinements, les chalets étaient pleins à craquer et les camping-car bien nombreux. Les pressions sur les milieux augmentent; dans ce cadre le tourisme mis en place par le village vacances se veut respectueux de l’environnement avec des pratiques tournées vers la découverte des milieux forestiers et montagnards, le respect des zones de montagne, la rencontre des acteurs d’Iraty :

bergers, forestiers, ...
Ici chaque année pendant 5 mois, des observateurs sont postés au milieu du col du lever du jour à la tombée de la nuit. Ils scrutent à la jumelle les oiseaux qui passent, les identifient et dénombrent chacun d’entre eux. À quelques mètres, une drôle de cabane nichée dans le sol, qui abritait les ornithologues autrefois : la Ruche. Derrière d’autres collines on me parle des palombières, ces cabanes en hauteur pour chasser la palombe. D’ici on les entend. Les conflits liés à la chasse restent latents sur le territoire et l’ébauche d’un Parc Naturel Régional est prometteuse d’échanges potentiels autour d’une structure fédératrice.
Toutes les données récoltées par les observateurs sont cumulées sur un site internet dédié et constituent une base pour mieux connaître qui passe par là.
L’observation des oiseaux migrateurs fait d’ailleurs chaque année l’objet d’animations au sein du centre proposées aux clients, en lien avec la LPO. Un vaste paysage suspendu à l’observation du passage.
La relation à la halte sur la route semble malgré tout vénale puisque le simple passant traverse comme un village les étranges châlets .
Les cayolars sont nombreux sur le site mais leur accès n’est pas forcément public ni dégagé ; dans un paysage si vaste, ils font un point d’accroche.
Chasse abusive
Dérives de l’écobuage
Conflits liés au multiusages
Déprise agricole Refermement de milieux
Accès à une halte commune
Fédérer autour d’un projet commun lié à l’itinérance
114 115
vers le projet
Que peut faire le paysagiste ?
Dans l’acte de passer il y a : un amont, un aval, un trajet entre les deux. Des routes empruntées, des obstacles rencontrés, des dynamiques humaines malaxant les passages. Le champ d’action du paysagiste se situe à la croisée de ces composantes.
Si je ne peux agir sur les causes bien souvent politiques, ou économiques, qui entravent le passage ou l’accueil, je peux dessiner des espaces publics qui soient voués à accueillir, dans l’articulation d’espaces privés où les fameux « sédentaires » mènent leur vie localement. Je peux imaginer des espaces qui incitent à des dynamiques plus justes pour les vivants, et pas uniquement pour les humains ; le Pays basque est d’autant plus un territoire d’accueil du vivant en puissance qu’il est traversé par de nombreux individus de formes, couleurs, véhicules différentes ; et donc de tout autant de besoins spécifiques liés à leur route. La condition d’être vivant est ce qui fait essence commune sur la route : se nourrir, se reposer, être abrité, en sécurité, en contact avec son environnement et ses congénères. Prendre soin des lieux alors, c’est prendre soin des individus ; un territoire fertile et ouvert, capable de donner ce qu’il a à offrir et de laisser passer.
Ces belles paroles s’impulsent bien sûr surtout par la volonté de quelques personnes qui s’engagent et contribuent à faire
perdurer un équilibre ; des dynamiques que je ne peux gérer. Mon défi serait alors de provoquer et d’influencer la forme des espaces d’accueil où ce dénominateur commun faits de besoins rudimentaires s’exprimerait.
Partout où l’urgence et/ou le désintérêt prennent le dessus sur l’aménagement de l’espace, subviennent des formes non désirables de l’accueil : camps de réfugiés, internement, segmentation/spécialisation des espaces. Marc Augé les nommerait les nonlieux1, des effets directs dans le paysage de la mondialisation qui ruisselle jusque dans les pavés. Par une anticipation et une pensée de l’espace conjointement à des volontés politiques, il est possible de les éviter.
Le monde en mouvement perpétuel plutôt qu’en territoires compartimentés est échantillonné ici. Je souhaiterais tirer parti de cette confrontation spatiale à l’altérité2 en agissant sur ces paysages de passage pour les lier par un projet de réseau d’accueil. Dans un territoire en mouvement, qui fourmille de vie et se réveille chaque jour influencé par de nouveaux jeunes projets et arrivants, il me paraît intéressant de détourner le regard d’un développement uniquement économique en invitant ses aménageurs et décideurs à prendre en compte ses passants comme apparaissant pleinement à l’agenda politique ; comme une grille de lecture récurrente, systématique, à
adopter dans les couloirs décideurs et dans les rues, sans pour autant aller à l’encontre des objectifs fixés par la collectivité d’agglomération.
Une base très intéressante comme l’installation du centre Pausa, les projets d’aménagement des cols de Lizarietta, du Soulor dans le Béarn, me permet de me placer dans un faisceau déjà existant de projets d’accueil. Il semble que l’institution politique englobante et le réseau d’associations locales soient vivaces et favorables au développement d’un projet spatial tel que celui ci. Celui-ci pourrait naître aussi de l’anticipation des flux à venir : le territoire doit être prêt à accueillir des flux plus importants dans les années à venir, et donc modelé pour cela.

Si la migration est un phénomène multiscalaire, son traitement dans un espace défini par une maîtrise d’ouvrage et sa réponse par un.e paysagiste, peut participer à l’activation de liens entre individus passants et individus sédentaires, dans un espace-temps défini. Il contribue à prendre soin des espaces en définissant des orientations d’aménagement nourries de l’observation des populations qui utilisent les lieux, et essaye de proposer des aménagements au plus juste pour ces utilisateurs suivant un parti pris spécifique.
1 : Non-lieux, une anthropologie de la surmodernité , Marc Augé
2 : La fabrique de l’espace public. Ville paysage et démocratie, Denis Delbaere
1. 2. 3.
1. Confluences au col du Soulor, un projet de mobilités en montagne au Béarn par l’atelier Le2bis

2. L’espace Rapine aux Grands Voisins, Paris 14e un exemple d’urbanisme transitoire (photo Les Grands Voisins)
3. Le jardin des migrations du Fort St-Jean, Marseille un projet de l’agence Aps (photo Mucem)

116 117
6.
Étude préliminaire Conception

Récolte de la parole, analyse des dynamiques de l’échelle du site et à l’échelle loco-régionale
Consultation des partenaires de travail, spécialistes (bergers, ornithologues, botanistesbiologistes, urbanistes, ateliers d’aide à conception,..)
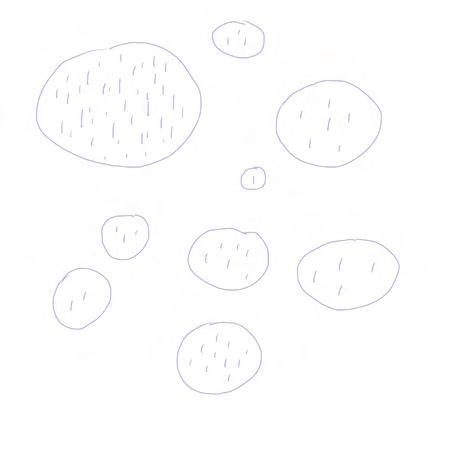

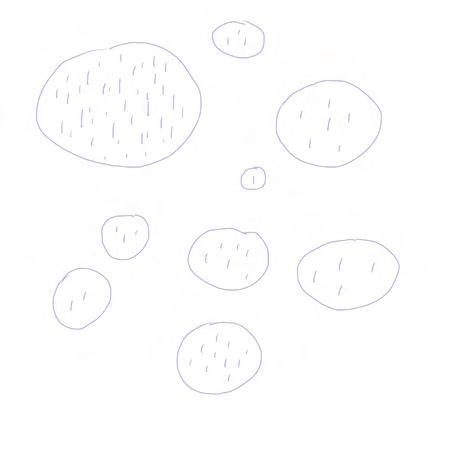
Veille scientifique (articles, observatoire des migrations, réflexions à l’échelle nationale, internationale)
Définition et discussion des cadrages d’intervention
Animer le site, faire participer les habitants à sa création (tables rondes, ateliers de co-montage de projet, chantiers collectifs)
Boussole pour un territoire accueillant
Espace public comme espace commun
Permettre le passage sans entraver l’ancrage
Recherche de diversité des formes et des usages
Du rythme dans l’espace
Soin au vivant - attention à l’humain, attention aux non-humains
Recherche de mixité sociale et d’inclusion
Gouvernance propre et partagée des espaces
Appui de partenaires techniques : Plateau urbain, Bellastock, agences de paysage transfrontalières, services techniques, ...
Soumettre des dessins, proposer des alternatives ; vision prospective positive du territoire
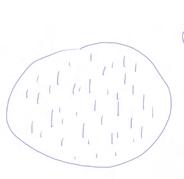





Réalisation de projets frugaux et faits avec les forces locales dans la mesure du possible

119
échelle d’intervention
Aiguillage et horizons vers le projet
Du passage à l’accueil
Une politique du passage et donc un aménagement du passage, ça n’existe pas en tant que tels; et faciliter la migration n’est pas une priorité du territoire en terme d’aménagement. Je prends le parti de mener un projet d’intérêt public ayant pour cœur les migrations dans ce territoire et leur accueil dans l’espace public.
Dans une étude de cette teneur, différents niveaux d’intervention vont me permettre de dessiner un projet cohérent, de l’échelle du territoire accueillant à celle du lieu de passage.
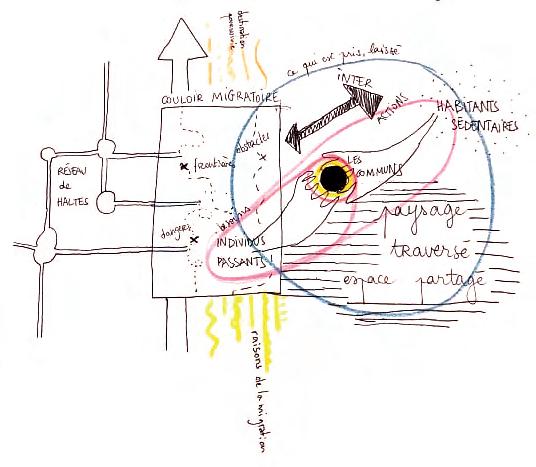



Je distingue une dynamique à deux facettes : celle du terreau d’accueil, fait d’une histoire traditionnellement basée sur la notion de communs et de cercle vertueux homme>animal élevé>environnement, et celle de l’urgence, d’une adaptation nécessaire à l’accueil de migrants et d’oiseaux qui relève de la survie.

Les cadrages choisis pour l’étude sont des haut lieux du passage dans le Pays basque mais sont évidemment dépourvus d’exhaustivité. J’en choisis deux pour traiter ces deux facettes, me permettant de considérer à la fois les quatre passages étudiés et pour commencer à tisser une histoire entre la route, le grand paysage, et la halte en ville.
La particularité de ce projet résidera dans sa vocation à être éphémère puisqu’à destination d’un public de passage.
Le temps passé sur le territoire par chacun d’entre eux constituera donc ma variable de projet : je dispose des jours que chacun passe sur place pour faire utiliser un espace à la fois aux passants et aux sédentaires. Pendant ce laps de temps, les besoins rudimentaires devront être pourvus par le lieu projeté, en lien avec le tissu social existant.
Un grand lot d’incertitudes demeure lié aux questions éminemment politiques et sociologiques qui se cachent derrière cette ébauche de transformation spatiale ; il me faudra naviguer entre des visions idéalistes et réalistes pour arriver au terme de ce voyage.
Grand territoire Bayonne Organbidexka «exception urbanistique» parcours sécurisé
haltes régulières,de qualité
espaces de multi-usages encadrés
route au contact de l’histoire des migrations
soin des espaces naturels sensibilisation à la migration
refuge pour passer entretien des chemins pastoraux refuge espace public accueillant sensibilisation à la migration
120 121
6.
6. Intentions vers le projet




Une première échelle de projet se consacrerait à la mise en récit d’une boucle de chemins se basant sur le tracé des GR existants et sur l’armature des voies ferrées, pour sillonner à travers le Pays basque en retraçant l’histoire de ses mobilités.
L’ensemble des communes traversées pourraient être mobilisées et liées par un projet commun de cette mise en récit ; haltes régulières, support pédagogiques, micro-musées de territoire à ciel ouvert. En détournant le regard vers un tourisme dans les terres, des portions de sentiers raconteraient les histoires des passages en s’appuyant sur mobilités douces pour permettre l’accès de zones reculées à tous les habitants et aller vers une reconnexion au territoire naturel.
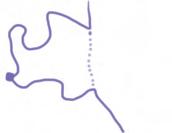



On s’attellerait à illustrer les formes spatiales du passage - franchissement, détours, progression vers les hauteurs pour donner à voir le territoire tel que ses passages l’ont modelé.
Les franchissements de frontière seraient
alors marqués par des structures-abris invitant au passage et les hauts lieux de passage tels que Bayonne, Organbidexka, ou Hendaye incarneraient des politiques d’accueil plus développées. L’entretien de sentiers pastoraux en montagne permettrait des services respectivement rendus entre différents passants (migrants, randonneurs, bergers) en rendant la montagne hospitalière.
Ce projet à grande échelle temporelle serait une colonne vertébrale pour aller vers une conservation appliquée des espaces naturels.
Partenaires du projet
Réseau de villes accueillantes
CAPB
Communes espagnoles frontalières Commissions syndicales PNR Montagne Basque

Mairies Habitants, voisins, bénévoles
CPIE - Seignanx et Adour - Corniche Basque
Les GR comme support du chemin des migrations


Des curiosités à découvrir pour tous Abris, micro-architectures, supports pédagogiques Encourager la multimodalité

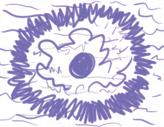
Des milieux naturels soignés Trames de refuges et ressources régulièrement entretenues
Des structures d’entraide Questionner le rapport au paysage commun : des zones partagées Le passant comme garant d’un entretien des chemins de montagne

122 123
53 km2 jour s 1 3 2
à l’échelle du territoire
2 Halte urbaine à Bayonne, une ville accueillante
Le chemin des migrations s’accrocherait sur la ville de Bayonne, figure du passage et de l’accueil grâce à des structures d’accueil étendues à l’échelle de la ville. Je souhaiterai étendre la dynamique lancée par l’initiative de centre d’accueil des migrants à un projet englobant des espaces communs liés à l’abri et à l’alimentation. Pour cela, la question du jardin se présente notamment sur les friches SNCF avec la figure de la cohabitation plante vagabonde-plante cultivée. Le récit des migrations pourrait s’étendre dans un espace qui récolterait les traces et les paysages du passage à la manière d’un musée de société.
Accueillir l’éphémère
Questionner la localité du centre d’accueil : quelle inclusion dans la ville ?
Questionner l’avenir de l’emprise militaire et de ses cloisons
Des vides publics symboliques non-définis pour permettre le passage Des espaces pour prendre, laisser, troquer, donner
Nourrir les individus
Questionner le centre de tri SNCF et ses possibilités en terme de fret Dessiner un jardin nourricier
Des ressources trophiques pour la faune aviaire : vers une renaturalisation des berges
Des communs
La gare comme assise de la mobilité pour habitants et passants Les quais comme espace d’accueil du vivant La figure de l’abri : édifice commun comme cheville du passage
Le projet de la mairie de réaménagement des quais Proposer une alternative à un ensemble de logements Activer le quartier en mobilisant une dynamique de village Penser à l’échelle de l’estuaire (port commercial, embouchure)

tourisme
tourisme résidentiel
port de commerce
extensionurbaine marges, accès à la halte
port de commerce haltesbiodiversité en ville fret passagers
fret marchandises 0 800 1600 m
équilibre tourisme - passage zones humides qualité ? entretien par le passage ? réouverture au pâturage ?
développer le détachement urbain - état compromis policiers
centre européen de fret ferroviaire
Cela suppose aussi de s’intéresser à la qualité des espaces naturels urbains (entretien, ressources fournies, marges) au niveau des berges du fleuve Adour et des différentes zones humides entourant la ville.

Bayonne devient une ville pilote d’accueil des brefs passages, grâce à la boussole citée plus haut.

Variable-temps
3 jours
zones humides qualité ? entretien par le passage ? réouverture au pâturage ?
impact sur les milieux ? connexion à la ville ?
Leviers de projet
_occupations éphémères - urbanisme transitoire _itinérances artistiques - art de rue _réseaux de villes accueillantes (ANVITA, Mission Opérationnelle Transfrontalières..)
_programmes POCTEFA transfrontaliers en cours (Traversia, de Mar a Mar, EderBidea...) _ structures d’éducation et de sensibilisation à l’environnement _ dynamiques politiques et associatives en place _ tradition des terrains indivis comme inspiration
Partenaires du projet
Réseau de villes accueillantes
SNCF
Asso dédiée - foncière portage de projetanimation gestion
CAPB Mairie de Bayonne
Habitants, voisins, bénévoles
CPIE - Seignanx et Adour - Corniche Basque Assos migrants
citadelle militaire (50 ha) friche ferroviaire, centre de tri (30 ha)
gare place de la mairie, place des basques
124 125 place du Réduit cheville entre deux quartier s
Musée basque lien à l’histoire traditionnelle
À Organbidexka, un refuge des migrations en montagne
Dans les confins de la route, le col d’Organbidexka accueillerait un site d’abri collectif pour les passants. Celui-ci retravaillerait l’espace aménagé par les chalets d’Iraty en créant des espaces communs propices à la halte piétonne. Ce point de rencontre au col accueillerait un édifice qui pourrait fonctionner comme un tiers-lieu où les passants peuvent contribuer à des chantiers, des aménagements, des animations. Une nouvelle structure adaptée au contexte de piémont veille à l’animation du site en lien avec les itinérances en montagne.
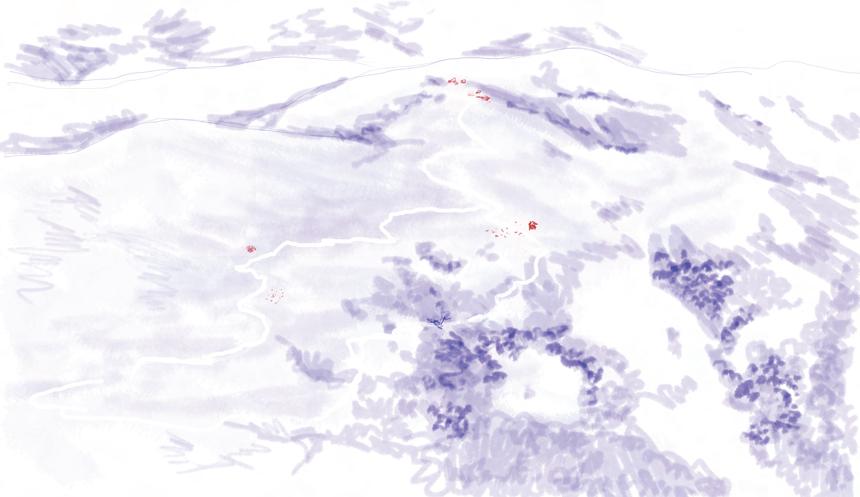

Sur la route du GRT10 mise en récit autour de la migration en montagne, de nouveaux chemins serpentent dans la vallée pour aller à la rencontre des cayolars disséminés dans le paysage et permettent d’entretenir les chemins pastoraux traditionnels.
Accueillir l’éphémère
Des aménagements pour un accueil temporaire
Construire ensemble : le passant comme pierre à l’édifice
Se nourrir sur la route
Questionner le paysage nourricier en montagne
Paysage comme support pédagogique pour comprendre la fabrication du fromage de brebis : étagement des zones pastorales, réouverture mécanique de milieux fermés
L’ensemble des châlets d’Iraty
Des espaces partagés avec les passants
Des communs
Le cayolar comme cellule partagée
Un multi usage encadré, une structure fixe centralisatrice
Des chemins entretenus garants du passage et de l’occupation pacifique de la montagne
Transfrontalité
Une approche des mosaïques de milieux par le jeu dans l’espace (microarchitectures, circuit,..)
Variable-temps
1 jour
Partenaires du projet
Leviers de projet
_itinérances artistiques - culture hors les murs (cf projet musée Basque)
_programmes POCTEFA transfrontaliers en cours (Traversia, de Mar a Mar, EderBidea...)
_ structures d’éducation et de sensibilisation à l’environnement
_ dynamiques politiques et associatives en place _ tradition des terrains indivis comme inspiration
EHMEB, groupements pastoraux, assos foncières pastorales
Châlets d’Iraty + Structure dédiée gestion-animation
PNR Pays Basque
CAPB Mairie de Larrau
Forêt d’Iraty
GRT10 GRT09
Col d’Organbidexka Village de Larrau Pic d’Orhy (2017 m)
Port de Larrau - frontière espagnole
Organbidexka
le chemin des cayolars jusqu’au Pic d’Orhy
Habitants, voisins, bénévoles
Assos naturalistes
Assos migrants
126
127
3
6. Fin de l’étape vers le projet
« Nous voici au terme du long voyage, au début du XXIe siècle. La grande émigration des Basques a cessé, et, sous l’effet progressif de la mondialisation, notre territoire se métropolise, se littoralise. Il attire de nouvelles populations, certaines fortunées, d’autres moins… L’arrivée massive de populations non bascophones inquiète… va-t-on perdre le trésor de notre histoire, celui qui, malgré tous les aléas, les va-et-vient, à travers les siècles, fut conservé précieusement par les Basques ? C’est une question, locale, qu’il nous faut concilier avec des questions globales. Car le Pays Basque et ses particularités est intégré dans le monde. Et les questions qui se posent au monde se posent donc aussi, aujourd’hui au Pays Basque. Quelle attitude avoir devant l’étranger qui arrive ? Il nous semble important, au-delà de toutes les lois, les réglementations, les procédures, dont la compréhension et la maîtrise sont primordiales, de penser aussi la migration comme un phénomène ancien et intrinsèquement lié à la condition humaine. Je migre, tu migres, elle migre. Ou alors, j’ai migré, tu as migré, il a migré. Ou bien je migrerai, tu migreras, il migrera… Le mouvement migratoire concerne l’ensemble des siècles, l’ensemble des peuples. Il nous faut, aujourd’hui, penser l’accueil du migrant. »
Antton Curutcharry, professeur d’Histoire et maire-adjoint de Saint-Etienne-de-Baïgorry Forum « Penser l’immigration autrement, agir localement » media Enbata, avril 2018
Partir d’intuitions
Tous les endroits du monde sont traversés, sillonnés par des passants ; tous sont des sites de projet en puissance. Il a fallu en choisir un.
Drôle d’idée que de rassembler tous ces individus dans une même étude, sur de mêmes cartes, dans un même projet de territoire ; car à priori, ils n’ont pas grand chose en commun.
Le Pays Basque m’a d’abord intriguée parce que l’arrivée récente de migrants en terre française par sa côte était une actualité brûlante. Par crainte de tomber dans le traitement nécessairement trop politique et sociologique de la question, j’ai pensé que ce qui les liait au paysage, c’était leur mobilité.
Ceci dit, c’est une caractéristique que de nombreux individus partagent.
Sur ce territoire alors, j’ai élargi la question du passage à des flux inhérents à cette portion de pays : je rassemblais des individus par leur caractère mobile. Ainsi, la question du passage devenait une question d’espace.
Des mouvements sur un socle
La plupart des passages qui sillonnent le territoire existent d’abord par les conditions géographiques, géomorphologiques, climatiques,...ce qui pourrait être appelé «socle», par opposition au mouvement des passants. Situé à de multiples frontières, à la fois physiques et immatérielles, le Pays
basque est naturellement un espace à franchir, à traverser. Il est notamment situé sur des couloirs de migration d’importance, à la fois pour la faune marine et aviaire. À ce titre, il dispose d’une responsabilité forte dans la conservation des espèces migratrices, et donc naturellement dans le soin des paysages qui les accueille. Si l’on transpose cette pensée aux migrations humaines, la théorie reste vraie - et réjouissante pour le paysagiste.
Ces migrations humaines sont complexes au sein du Pays basque, exposé à des mouvements de masse. Aujourd’hui en première place, le tourisme ne cesse d’aller tambour battant. Le contexte politicoéconomique lui confère du mouvement, le pousse à la réinvention pour faire cohabiter traditions agricoles, attractivité littorale, économie viable. Des activités toujours plus nombreuses et complexes au prisme d’enjeux contemporains mêlant économie, environnement, développement social et autres grandes réjouissances. De nombreuses visions de ce territoire se mêlent alors, et le développement du territoire aborde timidement l’angle de l’espace accueillant comme un potentiel levier de projet.
Des flux qui façonnent le paysage, des paysages qui façonnent les flux
Les sédentaires participent chaque jour à l’identité et à la forme des espaces, les entretenant, les construisant, les conduisant. Dans le Pays basque les formes de mobilité ont, à travers l’histoire, découlé de situations d’urgence et/ou du contexte géomorphologique. Elles ont elles aussi je crois
participé à ce qui pourrait être nommé identité et ce qui fait qu’on distingue ce territoire comme une « région naturelle» ; l’exemple des traités des lies et faceries autorisant le passage de la frontière, concept absurde dans une vallée pastorale, illustre cette appellation.
Parfois, ce sont donc les flux qui façonnent le paysage, et parfois c’est l’inverse.
Les flux de migrants, passages légalement inacceptés sont contraints par un paysage faits de structures (matérielles ou humaines) de répression et d’infra-expériences de la ville; fuite, dissimulation, attraction par les réseaux civils d’entraide. On le voit à Hendaye particulièrement, où le passage de la frontière demeure un paysage particulièrement délicat fait de successions de couches urbaines et naturelles mêlées.
Les routes des oiseaux sont à l’inverse plutôt façonnées par la morphologie perçue depuis le ciel, par la configuration de vallées, par la proximité de bois pour s’arrêter ou de zones humides pour se ravitailler. Là, c’est alors le passage qui influence le territoire, avec l’exemple des chalets d’Iraty qui ont trouvé de l’intérêt à se construire à proximité du site d’observation des migrations d’Organbidexka.
Il me semble que les paysages du passage peuvent être décrits comme des paysages relationnels, entre individus « sédentaires » et individus « nomades ». Aucun des individus concernés par mon écriture n’est fondamentalement de l’une ou de l’autre de ces catégories ; ils ne s’y assimilent que dans un espace-temps défini. Et dans cet espace-temps, le paysage de la traversée est personnel, recomposable ou interprétable mais simplement unique. Chacun transporte son pays mental dans le pays traversé, et je crois en
128 129
les espaces de halte pour permettre de les mêler. La question de la cohabitation entre sédentaires et passants se pense alors dans une relation spatiale, car le socle demeure et le paysage nous lie tous, que l’on y soit né ou que l’on y passe.
Un passant peut ne rien laisser dans le paysage : un simple randonneur sera simplement occupant de l’espace pendant un instant et ne fera que le traverser. Mais il suffit que cet individu soit multiplié et ce sont alors de véritables voies qui se définissent ; ainsi des chemins de Compostelle, des chemins pastoraux ou de ce qu’on peut appeler les routes migratoires - terme relativement englobant.
Les paysages du passage peuvent aussi être matériellement vécus ; franchir un col, une rivière, transhumer d’une vallée à l’autre, implique des mouvements spécifiques et créé des tableaux d’infrastructures dans le paysage : pont, gare, voie ferrée,...
Le passage pourrait être une succession de panoramas qui en appelle toujours de nouveaux. Les paysages du passage pourraient être des ensembles d’éléments à franchir, ou bien un plan séquence du déplacement ; alors chaque espace traversé, qu’il soit plus ou moins accueillant, plus ou moins complexe, n’a qu’une prise relative sur l’individu.
Dans le Pays basque, les multiples passages historiques sont singuliers et ont contribué à fabriquer un paysage immatériel, histoire qui perdure aujourd’hui. Que ce soit des ensembles de grand paysage traversés par les brebis ou des tracés de route irrigant les villes, les formes prises dans ce territoire

participent à une sorte de théâtre vivant.
Les partis pris du passage
Décortiquer ce territoire de passage ordonne une connexion au monde vivant. Première grande orientation du futur projet, une attention à tous les habitants, mobiles ou non, permettra d’amorcer un dessin spatial qui dessert le vaste terme de cohabitation. La mobilisation des « sédentaires » est pré-requise. Le Pays basque est en effet une terre de passage par la force des choses, et une terre d’accueil par les dispositions civiles qui y sont prises. Toutes les routes sont chargées de ressorts politiques. Cette facette du projet sera donc un grand déterminant de ce qui pourrait permettre aux passants de trouver des espaces fluides, accueillants et adaptés sur leur route.
Il est insensé de traiter tous les aspects du passage avec la même entrée, la même force. Un gradient d’urgence ou de nécessité existe dans les passages que j’ai présentés au long de ce mémoire. De même, le choix des thématiques à aborder peuvent être des sujets de territoire en eux-mêmes, comme le multi-usages en montagne.
Pour cela j’ai abouti au choix de trois cadrages au sein du territoire qui me permettront d’approfondir à plusieurs échelles les possibilités concrètes de formes d’accueil. La migration y sera érigée en symbole au sein du territoire.
Cela me permettrait de proposer une autre vision du territoire que ce que l’attractivité touristique engendre ; un Pays basque représenté par sa côte alors que 80 % de sa surface est un territoire de montagne.
Je profite donc de l’année de diplôme qui me permet de traiter une thématique relativement éthérée pour m’amener à la réflexion d’un projet pilote expérimental dans l’idée de célébrer les différentes formes de passage, du paysage rural au paysage urbain. De solides bases me le permettent (terreau accueillant, amorce de projet d’accueil par la ville de Bayonne,...).
Du passage dans l’espace au lieu accueillant
Le paysagiste en modelant avec plus ou moins de force les espaces peut contribuer au bien-être des êtres vivants dans des lieux précis.
En rassemblant les individus qui passent par le paysage et non plus par leur caractère mobile, je peux considérer que les espaces qu’ils partagent et traversent deviennent des lieux de vécu, et donc travailler à l’échelle de ces lieux. Séduite par les notions d’arpentage, d’itinérance et d’éphémère, je choisirais de m’intéresser au rayonnement du quartier de Lesseps à Bayonne, aux accès et à la figure du refuge au Col d’Organbidexka, et à un projet de cheminement à l’échelle du Pays basque pour raconter dans l’espace une histoire des migrations, à la manière d’un musée qui collecte l’histoire d’une civilisation.
J’espère alors continuer de chercher et révéler dans ce territoire ce que le paysage fait aux migrations et ce que les migrations font au paysage.
130 131
Bibliographie, références
À propos des migrants
_ Ouvrages
• Entre accueil et rejet : ce que les villes font aux migrants - co-dirigé par Michel Agier, éditions Le Passager Clandestin, collection Bibliothèque des frontières, 2018
• Des îles - Marie Cosnay, éditions de l’Ogre, 2021
• Campement urbain : du refuge naît le ghetto - Michel Agier, éditions Payot, 2013
• La ville accueillante, accueillir à Grande-Synthe - sous la direction de Cyrille Hanappe, collection Recherche PUCA (Plan Urbanisme Construction Architecture), 2018
• Atlas des migrants en Europe : approche critique des politiques migratoires - Migreurop, éditions Armand Colin, 2017
• Cosmopolites de tous les pays, encore un effort ! - Jacques Derrida, éditions Galilée, 1997 (cité p.58)
_ Revues, articles
• Migrants ; sommes-nous encore humains ? - Le 1, N°377, décembre 2021
• Ouvrir : l’accueil au Pays Basque - Marie Cosnay, Plein Droit, N°122, octobre 2019
• À Hendaye et Bayonne, le Pays basque et ses «accueillis» - Emmanuel Riondé, Mediapart, août 2021
• Urbanisme temporaire / Informalité, migrations et « urbanisme temporaire » - Sébastien Jacquot et Marie Morelle, Revues Urbanités, mars 2018
_ Articles scientifiques - plateforme Cairn
• Expériences d’ancrage dans les lieux de passage : le séjour de jeunes migrants dans le centre de transit Pausa à Bayonne - Lydie Déaux, Hommes & migrations, 2021
• Villes-refuges, villes rebelles et néomunicipalisme - Filippo Furri, GISTI Plein Droit, 2017
• L’accueil des exilés dans les espaces ruraux en France : orientations nationales et déclinaisons locales d’une politique de dispersion - William Berthomière, Julie Fromentin, David Lessault, Bénédicte Michalon, Sarah Przybyl, Revue européenne des migrations internationales, 2020
• Aux États-Unis, des villes sanctuaires - Mireille Paquet, GISTI « Plein droit » 2017/4 n° 115
_ Sites internet
• Ministère de l’Intérieur - https://www.interieur.gouv.fr/
• Office Français de l’Immigration et de l’Intégration - https://www.ofii.fr/
• Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides - https://www.ofpra.gouv.fr/
• MigrEurop http://migreurop.org/
• Infomigrants hhtp://infomigrants.net/
• Association Nationale des Villes et Territoires Accueillants - https://www.anvita.fr/
• Sites des associations locales et nationales : Diakité, Etorkinekin, La Cimade, Amnesty International..
• Vues d’Europe - Quel rôle pour les villes dans l’accueil et l’intégration des demandeurs d’asile et réfugiés ? https://www.vuesdeurope.eu/brief/quelles-competences-et-responsabilites-pour-les-villesdans-laccueil-et-lintegration-des-populations-migrantes-et-refugiees/
• Association Nationale des Villes et Territoires Accueillants https://www.anvita.fr/
_ Podcasts audio
• Nombreuses sources France Culture dont Des villes transformées par l’exil : mes voisins les migrants - La Série Documentaire, réalisée par Guillaume Baldy, juin 2020
_ Films, vidéos
• Grande-Synthe / La Ville où tout se joue - documentaire de Béatrice Camurat Jaud (2018)
• Un Paese di Calabria - film réalisé par Shu Aiello et Catherine Catella (2016)
• La ville accueillante - Conférence de Cyrille Hanappe, ENSA Strasbourg villes accueillantes
À propos des oiseaux migrateurs
_ Publications
• LPO Info Aquitaine, Spécial migration - mars 2021 n°83
• LPO Info Aquitaine, Spécial migration - 21 février 2022 (comme ce mémoire) n°86
• Le casseur d’os, revue du Groupe Ornithologique des Pyrénées et de l’Adour, Spécial milieux humides - octobre 2005 vol.5
_ Sites internet
• http://www.patrimoine-naturel-pays-basque.com/
• Trektellen, comptage et captures d’oiseaux migrateurs - https://www.trektellen.nl/?language=french
• Maintenir des sites de halte - Migraction - https://www.migraction.net/index.php?m_ id=22012&item=12
• Ligue pour la Protection des Oiseaux - https://www.lpo.fr/
_ Podcasts
• Quand les frontières deviennent un lieu pédagogique : Mugazabaldu - Radio Kultura, janvier 2020 - https://radiokultura.podbean.com/e/quand-les-frontieres-deviennent-un-lieu-pedagogique%e2%80%a6-%c2%ab-mugazabaldu-%c2%bb/
132 133
À propos des transhumances
• Documents de l’Euskal Herriko Mendielkargoen Batasuna (EHMEB), association des 4 commissions syndicales, 2020
• Portrait et évolution de l’agriculture du Pays Basque Nord, focus sur la montagne basque, Euskal Herriko Laborantza Ganbara, 2014
• La transhumance : vers une entrée au patrimoine immatériel de l’UNESCO - Alicia Munoz, 2020
• Berger basque sans prise de terre - article de La Ruche qui dit oui !, 2019
• Le pastoralisme au prisme des projets de territoires. Quels enjeux, quels acteurs, quelles échelles d’action? - Séminaire de l’Association française de pastoralisme , Lucie Lazaro, 2016
• L’usage des espaces agricoles de la montagne basque : l’exemple du Mont Baïgura - Constance Idiart, thèse d’exercice médecine vétérinaire, 2018
• Vers la réconciliation du pastoralisme et de la forêt en Pays Basque - Michel Pascouau, ONF, 1994
À propos des chemins de randonnée et de Compostelle
• Les sentiers contemporaines vers Compostelle - Association Française des Chemins de Compostelle
• Les chemins de St-Jacques en Béarn et Pays basque - Louis Laborde Balen et Jean Pierre Rousset, éditions Sud Ouest, 2004
• Graphies du déplacement, Mathias Poisson
• Errance transfrontalière : de Pau à Huesca - travail de l’atelier Bivouac, 2014
Références générales
• Paysages en migrations - Carnets du paysage de Versailles N°23
• La fabrique de l’espace public, ville, paysage et démocratie - Denis Delbaere, éditions Ellipses, 2010
• Du droit de déambuler : le paysage comme lieu de passage - Sarah Vanuxem, Les Cahiers de l’école de Blois, N°19 : Le droit au paysage, 2021
• Non-lieux, une anthropologie de la surmodernité - Marc Augé, éditions Seuil, 1992
• Terra Forma, manuel de cartographies potentielles - Frédérique Aït-Touati, Alexandre Arènes, Axelle Grégoire, éditions B42, 2019
• Arpenter le paysage ; poètes, géographes et montagnards - Martin de la Soudière, éditions Anamosa, 2019
• Villes nomades, histoires clandestines de la modernité - Stany Cambot, éditions Eterotopia, collection Rhizomes, 2016
• Mémoire de TFE dans la vallée de la Roya - Clément Rémy, ENP Blois, 2017
• L’étrange, BD de Jérôme Ruillier, éditions l’Agrume, 2016
• Atlas des paysages des Pyrénées Atlantiques - Morel Delaigue Paysagistes, 2003
• Nombreux articles des journaux locaux et nationaux : SudOuest, Mediabask, FranceBleu, Le Monde, Libération, Courrier Internationel, Mediapart - dont les visuels d’articles p.11
• Communauté d’Agglomération Pays Basque https://www.communaute-paysbasque.fr/
• Histoire locale des migrations, média Enbata https://www.enbata.info/
• Mintzoak, mémoire orale du pays basque nord - https://www.mintzoak.eus
• Musée Basque de Bayonne - 37 quai des Corsaires - 64100 BAYONNE http://www.musee-basque.com/
• BRGM, Géologie de la côte basque - https://sigesaqi.brgm.fr/-Geologie-de-la-Cote-Basque-.html
• Observatoire de la biodiversité végétale du littoral des Pyrénées-Atlantiques, Jean Denand, 2017 (cité p.37) https://professionnels.ofb.fr/sites/default/files/pdf/RevueFS/FauneSauvage311_2016_ complet.pdf
• A propos du livret de circulation (p.12) https://fr.wikipedia.org/wiki/Livret_de_circulation_(France)
• Mobilisation au Pays Basque contre la hausse du prix du logement - Le Monde, (nov. 2021) https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/11/20/mobilisation-au-pays-basque-contre-la-hausse-desprix-du-logement_6102969_3224.html
• À propos de la Retirada - http://www.histoire-immigration.fr/expositions-temporaires/frontieres/ focus-la-traversee-des-pyrenees-lors-de-l-exil-des-republicains et https://paysbasqueavant.blogspot.com/2017/08/le-refoulement-des-etrangers-au-pays.html
• Spectacle vivant à l’épreuve de l’itinérance ; magnétisme nomade et société de contrôle - Stéphane Labarrière, éditions L’harmattan (2016)
• Vers un après tourisme ? La figure de l’itinérance récréative pour repenser le tourisme de montagne : études des pratiques et de l’expérience de l’association Grande Traversée des Alpes - thèse de géographie de Libéra Berthelot (2012)
• Atelier Le2bis, Confluences au col du Soulor
• Agence Aps - le jardin des migrations - https://www.agenceaps.com/realisations-aps/creation-jardinfort-saint-jean-marseille/
• Atelier Bivouac - https://www.atelierbivouac.com
• Bellastock - https://www.bellastock.com/
• Plateau Urbain - https://www.plateau-urbain.com/
Cartes réalisées à partir des données SIG disponibles en libre service sur GéoServices et OpenStreetMap (https://geoservices.ign.fr/telechargement , https://www.openstreetmap.fr/)
134 135
Milesker ikus arte* !
à Bén édicte et Léa pour vos yeux, ainsi que Lolita et Olivier pour les conseils, sources, aux détours de l’école
aux personnes ressources rencontrées dans ce si grand site les passants, Nathalie Jaury de l’EHMEB, les bénévoles observateurs de la LPO, Christine de la Cimade, Lucie de Diakité, Marie-Hélène Hourquet du service Habitat, Francis Lartigau d’OCL, Christine Loquet et Philippe de Pausa, les salariés de l’Association Gadjé Voyageurs 64 même si finalement, les gens du voyage ont quitté le navire de ce diplôme ! Jean-Jacques Manterola du service Solidarités, le petit monsieur en bleu fervent habitant de Bayonne, ...
un merci particulier à Sabine Cazenave du musée Basque de Bayonne pour tout le partage, l’aile bienveillante, et un autre merci particulier à Steve de Landaco pour l’accueil estival sous les étoiles, dans ce pays basque si lointain, qui m’a menée sur de beaux chemins à ma famille et en particulier à mes parents pour l’accès à cette école merveille ! à ma famille de l’avenue de Châteaudun pour presque tous les jours à toutes les copaines, blésois.e.s d’adoption à ma Carobelle lointaine aux combattants de l’atelier tuné, de la trottinette aux perruques entre les gouttes de Covid à Théophile, et aux heureuses coïncidences basco-béarnaises à mes Justin un cœur singulier à chacun.e d’entre vous auprès de qui je grandis depuis 5 ans.
* merci au revoir !

136 137
Les paysages du passage
dans le Pays basque français
Des collines à n’en plus finir aux falaises qui plongent dans l’océan, des villes balnéaires aux villages rouges et blancs, je navigue d’un paysage à l’autre dans cette terre historique imprégnée de traditions. Un pays dans le pays. Territoire charnière, terre d’accueil et de passage.
Qu’est-ce que cela veut dire ? Qui traverse aujourd’hui ces paysages ?

Qu’est-ce qu’un paysage de passage ?
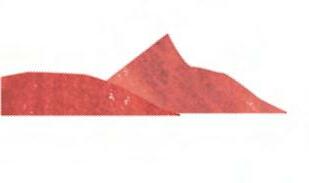

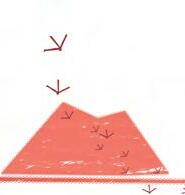
Bienvenue dans un voyage à travers une terre de migrations, à partir de l’étude des routes des migrants, des oiseaux migrateurs, des bergers transhumants et des randonneurs dans le Pays Basque français.




 Louise Pinsard Mémoire de fin d’études 2021-2022
Louise Pinsard Mémoire de fin d’études 2021-2022