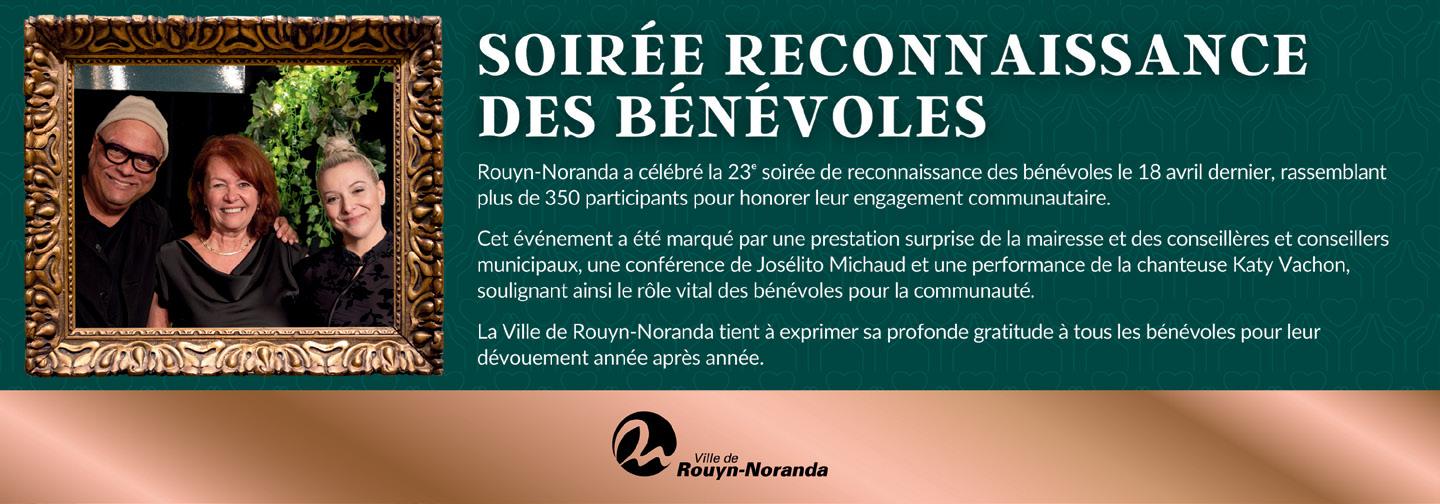GRATUIT JOURNAL CULTUREL DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE - JUIN 2024 - VOL 15 - NO 09 ARTS VISUELS UNE MURALE POUR ANGLIERS 14 PREMIÈRES NATIONS SERGE BORDELEAU ALIAS NAGADAM 21 LITTÉRATURE AMOS VOUS RACONTE LES TURCOTTE 11 ARTS VISUELS 40 E POUR LA GALERIE SANG-NEUF-ART 13 ART SONORE DÉAMBULATION SONORE AU C Œ UR DES CARAÏBES 09 CYNDY WYLDE SURREPRÉSENTATION CARCÉRALE DES FEMMES AUTOCHTONES + CAHIER PREMIÈRES NATIONS


EN COUVERTURE
Originaire de Pikogan, la professeure Cyndy Wylde a publié
Émergence insoumise aux Éditions Hannenorak en avril 2024.
Photo : Duclos photos
L’indice bohémien est un indice qui permet de mesurer la qualité de vie, la tolérance et la créativité culturelle d’une ville et d’une région.
150, avenue du Lac, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4N5
Téléphone : 819 763-2677 - Télécopieur : 819 764-6375 indicebohemien.org
ISSN 1920-6488 L’Indice bohémien
Publié 10 fois l’an et distribué gratuitement par la Coopérative de solidarité du journal culturel de l’Abitibi-Témiscamingue, fondée en novembre 2006, L’Indice bohémien est un journal socioculturel régional et indépendant qui a pour mission d’informer les gens sur la vie culturelle et les enjeux sociaux et politiques de l’Abitibi-Témiscamingue.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Marie-Déelle Séguin-Carrier, présidente et trésorière | Ville de Rouyn-Noranda
Pascal Lemercier, vice-président Ville de Rouyn-Noranda Dominique Roy, secrétaire | MRC de Témiscamingue
Chantale Girard Ville de Rouyn-Noranda
Lorrie Gagnon | MRC d’Abitibi-Ouest
DIRECTION GÉNÉRALE ET VENTES PUBLICITAIRES
Valérie Martinez
direction@indicebohemien.org
819 763-2677
RÉDACTION ET COMMUNICATIONS
Lise Millette, éditorialiste et rédactrice en chef invitée
Claudia Caron, adjointe à la direction et au contenu redaction@indicebohemien.org
819 277-8738
RÉDACTION DES ARTICLES ET DES CHRONIQUES
Bianca Bédard, Catherine Besson, Kathleen Bouchard, Claudia Caron, Stéphanie Fortin, Michel Gagnon, Francine Gauthier, Raymond Jean-Baptiste, Geneviève Lemire-Julien, Philippe Marquis, Lise Millette, Michaël PelletierLalonde, Kelly Poudrier, Dominique Roy, Élyse Tessier-Deslauriers
COORDINATION RÉGIONALE
Véronic Beaulé | MRC de Témiscamingue
Patricia Bédard, CCAT | Abitibi-Témiscamingue
Valérie Castonguay | Ville d’Amos
Fanny Hurtubise | Ville de Rouyn-Noranda
Sophie Ouellet | Ville de La Sarre
Stéphanie Poitras | Ville de Val-d’Or
DISTRIBUTION
Tous nos journaux se retrouvent dans la plupart des lieux culturels, les épiceries, les pharmacies et les centres commerciaux. Pour devenir un lieu de distribution, contactez : direction@indicebohemien.org
Merci à l’ensemble de nos collaboratrices et collaborateurs bénévoles pour leur soutien et leur engagement.
Pour ce numéro, nous tenons à remercier particulièrement les bénévoles qui suivent :
MRC D’ABITIBI
Jocelyne Bilodeau, Josée Bouchard, Valérie Castonguay, Jocelyne Cossette, France d’Aoust, Paul Gagné, Gaston Lacroix, Jocelyn Marcouiller, Monique Masse, Manon Viens et Sylvie Tremblay
MRC D’ABITIBI-OUEST
Maude Bergeron, Annick Dostaler, Lorrie Gagnon, Julie Mainville, Raphaël Morand, Sophie Ouellet, Julien Sévigny et Mario Tremblay
VILLE DE ROUYN-NORANDA
Claire Boudreau, Denis Cloutier, Anne-Marie Lemieux, Annette St-Onge et Denis Trudel
MRC DE TÉMISCAMINGUE
Émilie B. Côté, Véronic Beaulé, Daniel Lizotte, Dominique Roy et Idèle Tremblay
MRC DE LA VALLÉE-DE-L’OR
Claudia Alarie, Julie Allard, Nicole Garceau, Rachelle Gilbert, Nancy Poliquin et Ginette Vézina
CONCEPTION GRAPHIQUE
Feu follet, Dolorès Lemoyne
CORRECTION
Geneviève Blais
IMPRESSION
Imprimeries Transcontinental
TYPOGRAPHIE
Carouge et Migration par André Simard
2 JUIN 2024 L’INDICE BOHÉMIEN
À
UNE 4
ARTS VISUELS 12
ART SONORE 9 BALADOS
CALENDRIER CULTUREL
CHRONIQUE ENVIRONNEMENT
CHRONIQUE HISTOIRE
L’ANACHRONIQUE
CHRONIQUE
RÉGION,
MANGE 29 CULTURE 8 ÉDITORIAL 3 FESTIVAL 10 LITTÉRATURE 11 MUSIQUE 23 ET 27 PREMIÈRES NATIONS 16 À 22
SOMMAIRE
LA
ET 5
À 15
7
31
24
22 CHRONIQUE
6
MA
J’EN
PEFC/01-31-106 CertifiéPEFC Ceproduitestissude forêtsgérées durablementetde sourcescontrôlées www.pefc.org
BIENVENUE À CAP-DES-AURORES
LISE MILLETTE

Combien faut-il de temps pour réussir à invalider une impression négative devenue état de fait immuable dans l’opinion publique? Existe-t-il une masse critique de renseignements, de textes ou de manifestations pour inverser une tendance, une fois qu’elle s’est cristallisée dans l’imaginaire collectif? À quel moment un produit, une marque, un aliment ou une ville peuvent-ils espérer être réhabilités, et est-ce que la réhabilitation est toujours possible?
La question a été posée lors d’une soirée de discussion. La réflexion tournait autour de différents sujets récurrents : la pénurie de main-d’œuvre, la découverture estivale des services, les difficultés d’attractivité sur l’ensemble du territoire, la caricature voulant que la région ne soit que peuplade de mouches et de maringouins douze mois par année, que l’agriculture n’y ait point de salut, ou cette perception tenace que Rouyn-Noranda n’est qu’arsenic pour toute personne qui habite hors de l’Abitibi-Témiscamingue.
Au fil du temps, des œuvres – que l’on sait aujourd’hui erronées – ont contribué à cette mauvaise presse. Par exemple, le film Les brûlés produit par l’Office national du film (ONF) qui met en vedette Félix Leclerc dans le rôle d’un colon abitibien. À ses côtés, un autre frère de défrichement s’exclame devant un paysage ponctué de souches et d’une friche ingrate : « Y’a pas moyen de sortir d’un trou pour nous retourner dans un autre. Ça prend-tu des écœurants pour nous envoyer icitte? »
L’image se fige à l’écran, le champ ne présente aucune végétation, que d’immenses roches et cailloux au milieu d’une terre en apparence stérile. L’Abitibi-Témiscamingue, une terre de roches? C’est méconnaître l’enclave argileuse Barlow-Ojibway qui définit en partie notre agriculture régionale, c’est faire preuve de déni alors que la valeur des terres de l’AbitibiTémiscamingue a connu la plus forte hausse de la dernière année au Québec, c’est renier le potentiel agraire du Témiscamingue et de l’Abitibi-Ouest où jadis, de grandes et nombreuses terres n’avaient rien à envier en matière de rendement. Les freins à la prospérité ne tiennent pas à la qualité des sols, mais à une conjoncture économique complexe et sans doute à des choix de priorisation de développement, qu’ils soient économiques ou politiques.
Des stigmates, il y en a pour tout. Des individus dont les crimes ont tant choqué que tous les efforts de réhabilitation, ainsi que le temps purgé, n’y changent rien. Là encore toutefois, il n’y a pas forcément d’équité. Certains passeront le temps de l’oubli ou d’une forme de pardon collectif, d’autre pas. La voie vers la réhabilitation n’est pas pavée pour tout le monde.



UNE COMMUNAUTÉ MARQUÉE AU FER
L’ancienne ville d’Asbestos est aussi un cas d’espèce. L’or blanc – la fibre d’amiante – avait été décrié par 17 directeurs de la santé publique du Québec, qui s’étaient exprimés contre l’exploitation des résidus d’amiante.
En 2018, la ministre fédérale de l’Environnement, Catherine McKenna, lors du premier mandat de Justin Trudeau à Ottawa, a annoncé une interdiction de l’amiante au pays. « Des décennies d’extraction et d’utilisation de l’amiante ont entraîné un véritable désastre pour la santé de millions de travailleuses et de travailleurs à l’échelle planétaire et au Québec en particulier. Encore aujourd’hui, l’amiante est le premier tueur au travail dans le monde », mentionnait l’Union des travailleurs et travailleurs accidentés ou malades.
Ce n’était pas assez pour enlever à Asbestos sa charge minée. La connotation négative qui collait à Asbestos (qui signifie « amiante » en anglais) ne pouvait être éludée, même après l’adoption du règlement de la ministre McKenna, qui survenait déjà six ans après la fermeture de la mine Jeffrey en 2012.
Le nom… ce nom était lui aussi un frein à toute possibilité de passer à autre chose. En décembre 2020, la municipalité a changé de nom pour tenter de se détacher et faire table rase de son stigmate lié à l’amiante. Le maire Hugues Grimard a alors confié dans une entrevue dans Le Devoir : « On le fait pour les générations futures. » Parmi les noms possibles, Val-desSources a raflé la faveur populaire devant Trois-Lacs, Larochelle, Jeffrey-sur-le-Lac, L’Azur-desCantons et Phénix.
REPARTIR SOUS UN AUTRE NOM
Je n’ai pas su trouver la réponse au questionnement de départ : Que faut-il pour inverser une image profondément enracinée? Combien de bonnes choses faut-il pour éclipser le poids des côtés plus sombres de l’histoire?
Repartir sous un autre nom n’est pas forcément la solution à tous les maux. Peut-être suffit-il de s’affairer à d’abord croire nous-mêmes que nous ne sommes pas que mouches, maringouins, éloignement, rudesse et que nous épousons plus largement l’idée d’un pays neuf, ouvert aux possibles encore accessibles et à l’espace pour faire plutôt qu’à l’oppression d’une densité étouffante, à la débrouillardise ingénieuse plutôt qu’à la consommation de tous les services.
Et si on profitait du retour des beaux jours revenus pour se décomplexer le territoire et respirer à grandes bouffées ce bonheur d’être bien chez nous?
Parfaire ses connaissances sur les réalités et les enjeux autochtones
Programmes d’études o erts à l’École d’études autochtones de l’UQAT – sur campus et à distance
L’INDICE BOHÉMIEN JUIN 2024 3 – ÉDITORIAL –

4 JUIN 2024 L’INDICE BOHÉMIEN COURTOISIE ÉDITIONS HANNENORAK
SURREPRÉSENTATION CARCÉRALE DES FEMMES AUTOCHTONES :
CINQ QUESTIONS À CYNDY WYLDE
Dans son essai Émergence insoumise, paru en avril aux Éditions Hannenorak, l’auteure Cyndy Wylde navigue entre anecdotes poignantes et réflexions profondes, invitant le lectorat à une introspection sur les réalités autochtones contemporaines.
De l’anecdote initiale à l’Université du Québec en AbitibiTémiscamingue (UQAT) à la force inspirante de ses ancêtres, Cyndy Wylde explore les thèmes du racisme systémique et de la résilience avec une honnêteté brute et un humour subtil. Émergence insoumise est une invitation à la conversation, à l’éducation et à la compréhension mutuelle, ancrées dans la puissance de la parole… et de l’écrit. Entrevue.
Claudia Caron, de L’Indice bohémien (IB) : L’essai s’ouvre sur un de tes souvenirs, alors que tu attends un taxi à Val-d’Or, en soirée. Tu discutes avec le gardien de sécurité. Il t’encourage à aller attendre dehors, mais tu répliques : « Non, mais croyezvous vraiment que moi, une femme des Premières Nations, je vais aller attendre seule le soir, à Val-d’Or? » Pour toi, c’est une anecdote qui te parle particulièrement?
Cyndy Wylde (CW) : C’est vraiment ce qui a amorcé ma réflexion. Il a été très gentil, le monsieur. Il comprenait et m’a accompagnée dans mon attente… Mais le soir, quand je me suis couchée à l’hôtel, je me suis dit : « Ben voyons, qu’estce qui vient de se passer? Ce n’est pas normal que quelqu’un valide ces peurs-là, quelqu’un de non autochtone, en plus. » J’étais vraiment troublée, parce que ça veut dire qu’il y a plein de gens qui comprennent ma peur et qui valident ce qui est dénoncé [dans la Commission Viens, NDLR].
IB : Je perçois dans ton livre deux séries de thèmes. D’un côté : le racisme systémique, le trauma générationnel, les injustices; de l’autre, tu parles de résilience, de force, de fierté et de liens familiaux tissés serrés. Comment réussis-tu à équilibrer ces deux forces opposées?
CW : En fait, l’exercice que j’ai réalisé a été de m’informer quant à mon histoire familiale. Ce qui m’a sauté au visage, c’est la force des femmes qui m’ont précédée. Ma grandmère, par exemple […] Je sais qu’on lui a arraché ses enfants, je sais qu’elle a connu la colonisation, la sédentarisation, la destruction du territoire, je sais qu’elle a tout connu ça. Pour moi, c’était clair qu’elle, elle représentait la force. Et quand je suis revenue vers ma mère, je me suis dit : « My God, mais elle aussi! » Elle est une survivante de pensionnats… ce n’est
CLAUDIA CARON
pas quelque chose dont elle me parle. Ma mère a très peu de mots par rapport à ça, mais elle a toute mon admiration. Je sais qui elle est aujourd’hui. Je me dis qu’elle, personne n’a réussi à la détruire.
IB : Tu utilises un ton très doux tout au long de ton livre, avec un humour pince-sans-rire. Utilises-tu l’humour pour servir ton propos?
CW : Oui, mais c’est aussi une caractéristique des Premières Nations! Ma famille est très ricaneuse. Quand je pense à mes tantes, je pense aux fous rires en famille. Aujourd’hui, je sais que l’humour est une caractéristique d’un système de défense que mes tantes portaient, elles aussi. Je pense qu’avec l’humour, on peut faire des petits miracles! Les messages passent mieux, la communication est plus fluide. La création de liens devient possible. J’adore l’humour, j’adore rire, mais il y a aussi un sarcasme dans mon ton. Il est là pour illustrer ma colère… Ma colère envers le service correctionnel et la fonction publique. Plusieurs personnes ont essayé de rectifier ce que je dénonce, et ce qu’on est plusieurs à dénoncer. On n’a pas réussi, mais j’espère bien qu’on réussira avec les prochaines générations. C’est important pour moi de montrer que ce n’est pas parce que j’en ris que tout est beau. Il y a une réflexion à faire.
IB : J’ai appris dans Émergence insoumise qu’une femme sur deux incarcérée au Canada est autochtone.
CW : Oui. Ce matin, en m’en allant enseigner, je suis tombée sur un rattrapage de Radio-Canada avec Michèle Audette. Elle parlait du dépôt d’un rapport sur la justice au Manitoba pour les femmes. J’étais scandalisée : elle expliquait que 98 % des jeunes femmes qui sont incarcérées au juvénile sont autochtones. Ça m’a fait un coup de poignard, parce qu’au fédéral, on parle d’une femme sur deux. Dans des pénitenciers en Saskatchewan, on voit une représentativité des femmes autochtones de 70 à 80 % de la population carcérale féminine; et là, on m’amène ce chiffre-là. C’est une porte tournante, les services correctionnels. Quand on rentre, même si c’est au juvénile, il y a de bonnes chances qu’on continue d’emprunter sans cesse la même porte. Pour moi, tout ce qui touche à la surreprésentation carcérale des femmes autochtones, c’est une tragédie nationale. Je ne comprends pas pourquoi il n’y a pas plus de monde dehors en train de faire quelque chose.
IB : Comment expliquer cette surreprésentation?
CW : La toile de fond, ce sont les effets de la colonisation qui perdurent. Dans les pénitenciers et les prisons, on reproduit ce que la femme autochtone vit à l’extérieur. Tous les effets de la colonisation, le patriarcat, le racisme, la discrimination, ça revient en couche de fond, une fois dans le pénitencier. Comment ça se traduit? Par une surreprésentation dans les refus de libération conditionnelle, dans les cas d’automutilation… Une majorité des femmes autochtones au fédéral ont un diagnostic de santé mentale, ça me fait peur! Je pense qu’il manque vraiment de services en amont. Si on travaillait en logements, en emplois, en éducation, en aide en société – à faire une place aux femmes autochtones en société –, je pense que leur sort serait différent.
IB : Dans ton livre, tu mentionnes « l’importance du dialogue, de la transmission, et l’impératif de créer des tribunes adéquates ». Tu dis aussi que tu as « eu la chance extrême d’accéder à l’éducation et au pouvoir des mots ». Pour toi, le pouvoir des mots, quelle place a-t-il dans la libération de la parole autochtone?
CW : Je trouve ça extraordinaire. On a toujours été guidés par les transmissions orales, et maintenant, on se permet de laisser nos traces par écrit, et ça se fait de différentes façons. On écrit des chansons, des pièces de théâtre… Le pouvoir des mots est partout. En classe, aujourd’hui, j’ai parlé du génocide à mes étudiants. C’est sûr que comme professeure, j’ai appuyé mes propos avec la littérature, mais juste avant d’en arriver à une conclusion, j’ai fait passer la vidéo de Samian, Génocide Les étudiants ont réagi. Je voyais bien qu’ils étaient émus. Je me suis dit : « OK, j’ai atteint ce que je voulais. » Il faut y aller avec l’art, avec l’humour, avec la littérature.
Moi, je sais manier un texte. Humblement, je vais voir où ça me mène et j’espère pouvoir faire avancer des choses à ce niveaulà. Ce que je voudrais, c’est d’ouvrir le dialogue. Si les gens ont envie de me jaser, j’ai déjà gagné un point! Mon prochain ouvrage sera un roman, qui est déjà commencé. Je reste dans les thèmes connexes de la surreprésentation carcérale, c’est mon domaine, et je pense que ces réalités ne sont pas assez connues. Ce projet me tient à cœur et ça fait longtemps que ça cogite. Le personnage principal sera une femme!
L’INDICE BOHÉMIEN JUIN 2024 5 – À LA
UNE –
– L’ANACHRONIQUE –CUEILLIR
PHILIPPE MARQUIS

Je me suis fait souvent raconter par ma mère un souvenir dont les racines plongent dans le printemps de son existence.
Il s’agit du plaisir qu’elle avait, étant enfant, de croquer dans un sandwich aux radis. Deux tranches de pain de ménage, du beurre et des radis! Ces légumes, les premiers à être prêts à manger, lui annonçaient et lui annoncent toujours le véritable début de l’été. Elle en mange encore avec autant de plaisir lorsqu’on lui offre nos premières récoltes. Viennent ensuite toutes ces plantes potagères, à commencer par les épinards puis les salades, qui accompagnent, tout au long des mois chauds et bien après, nos repas. Il suffit de prendre soin du jardin, mais aussi, et c’est une évidence toute simple, que le climat estival s’y prête.
Quand j’étais enfant, mes tantes m’amenaient aux cueillettes dès que les fruits murissaient. C’est ainsi qu’à
genoux dans le foin, je tachais mes pantalons en écrasant les fraises des champs. Cela n’allait pas gâcher le goût des tartes de ma grand-mère Jeanne. Ça ne gâche jamais rien de se salir. Jamais.
Les framboises viennent après, puis les bleuets et les amélanches. Autant de cadeaux qu’il faut ramasser patiemment, en surveillant les guêpes, le soleil ou les orages. On les mêlera aux tartes, bien certainement, mais aussi aux pains, muffins, confitures, crêpes et tous ces desserts que je ne connais pas encore. Autant de mets qu’on préparera nous-mêmes avec cette manne qui pousse ici, plus nourrissante que l’or.
On pourra aussi les congeler parce qu’on peut s’offrir cela maintenant. Chez ma mère, à Val-Paradis, il n’y avait pas l’électricité à l’époque. Il m’arrive de me demander s’il n’y en a pas trop maintenant.
JE SOUTIENS L’INDICE BOHÉMIEN
FORMULAIRE
Pour contribuer au journal, libellez un chèque au nom de L’Indice bohémien et postez-le au 150, avenue du Lac, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4N5. Visitez notre site Web : indicebohemien.org — Onglet Journal, m’abonner ou m’impliquer.
FAIRE UN DON − REÇU D’IMPÔT (à partir de 20 $)
DEVENIR MEMBRE DE SOUTIEN (20 $, 1 fois à vie)
RECEVOIR LE JOURNAL PAR LA POSTE (45 $/an)
RECEVOIR LE JOURNAL PDF (20 $/an)
ÉCRIRE DANS LE JOURNAL (bénévole à la rédaction)
DISTRIBUER LE JOURNAL (bénévole à la distribution)
Prénom et nom :
Téléphone et courriel :
Adresse postale :
L’automne, saison des noisettes et des champignons, advient à la fin de ce cycle nourricier. C’est juste miraculeux, lorsqu’on s’arrête pour prendre le temps d’y songer, ce que la terre, l’eau, le soleil et l’air peuvent nous offrir. Les paroles des cueilleuses et cueilleurs, les cris des enfants se mêlent au geste méditatif, plusieurs fois millénaire, de cueillir. Puis, le souffle des oiseaux dans le chant du vent tombe dans mon panier percé de mémoire pour y semer je ne sais pas quoi encore.
Je ne connais pas, comme c’est là, tout ce qui pourrait être cultivé dans un petit potager ni les meilleures méthodes pour y parvenir. Il n’y a pas avec moi, le savoir des anciens capables de m’indiquer comment me nourrir, l’année durant à même notre jardin. Il est toutefois certain que nous en dépendons complètement.
En nous souhaitant le plus de temps possible pour se recueillir devant ces simples merveilles.
Dans le cadre de l’adoption de la Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels (loi 25), L’Indice bohémien souhaite vous informer de son obligation de collecter des renseignements personnels afin d’exécuter efficacement sa mission.
Je soussigné (e) consens librement à l’enregistrement de tous les renseignements que j’ai communiqués à L’Indice bohémien.
6 JUIN 2024 L’INDICE BOHÉMIEN
LES BALADOS QUI SE DÉMARQUENT
ELYSE TESSIER-DESLAURIERS, EN COLLABORATION AVEC LA RÉDACTION
Les balados, appréciés pour l’information, le divertissement ou l’exploration de récits inédits, gagnent en popularité. Découvrez quatre balados qui font sensation en ce moment.
AU PAYS DES CRATÈRES
Dans plusieurs régions, dont l’Abitibi-Témiscamingue, l’exploitation de mines à ciel ouvert pour extraire des minéraux critiques et stratégiques nécessaires à l’industrie des batteries est sur le point de commencer.
Dans le balado Au pays des cratères, Gaël Poirier et Elise EkkerLambert s’intéressent aux tensions grandissantes dans le village de La Motte. À travers leur documentaire sonore, le réalisateur et la réalisatrice nous emmènent sur le terrain, nous permettant de vivre leur expérience au plus près de la région. Au fil du récit, nous assistons à des témoignages poignants, notamment ceux de la famille de Gaël qui évoque son attachement à la région.
L’objectif de ce documentaire sonore est de fournir une information claire sur les multiples projets d’exploitation minière de lithium prévus dans la région. La réalisatrice et le réalisateur souhaitent sonder les opinions de la population locale, comprendre ses sentiments à ce sujet. En plus de sensibiliser le public, leur but était de susciter la réflexion chez l’auditoire, de l’encourager à repenser son lien avec la région et à envisager l’avenir de celle-ci de manière critique. Quels seront les impacts sur le territoire et ceux qui l’habitent? Est-ce le meilleur plan pour la transition? Des spécialistes ont été consultés dans ce documentaire, ce qui a considérablement enrichi sa portée et sa pertinence. Finalement, une voix est donnée aux communautés autochtones de Long Point First Nation et Pikogan, affectées par les projets miniers, offrant ainsi un éclairage essentiel sur leur réalité.
CAPTIVES : CRIMES RÉELS ET FAITS ÉTRANGES AU QUÉBEC
Beaucoup d’oreilles écoutent le balado Captives. Il s’agit d’une création originale d’Annie Lorrain et de Michèle Ouellet, deux passionnées de mystères et de faits divers criminels.
Dans chaque épisode, Annie présente une histoire résolue tandis que Michèle aborde celles qui restent non résolues. Les réalisatrices souhaitent mettre de l’avant les victimes. Michèle explique qu’ensemble, elles souhaitaient ramener les victimes du passé et des cas, au Québec, qui sont plongés depuis longtemps dans l’obscurité. Elles se concentrent exclusivement sur des crimes qui se sont déroulés au Québec, de l’affaire Corriveau en 1840 jusqu’à des événements récents survenus il y a à peine deux jours.
Captives se distingue par son approche immersive allant au-delà d’une simple narration. À travers leurs épisodes, les réalisatrices intègrent des effets sonores et des ambiances qui intensifient l’expérience auditive. Leur propos reste concis et concentré pour maintenir un effet narratif puissant, préservant ainsi l’immersion totale dans l’histoire. Elles réalisent ce balado avec cœur, passion et bienveillance. Il n’y a pas de stratégie marketing derrière leur démarche, insiste Michèle : « On a cette popularité-là à cause de victimes de crimes terribles. Ça, on ne l’oublie jamais. »
BON EN SALLE
Bon en Salle est un balado unique en son genre, enregistré à Amos en collaboration avec le Théâtre des Eskers.
Animé par Benoit St-Pierre et Pierre-Anthony Breton, le balado présente des discussions animées sur scène devant un public enthousiaste, dans une ambiance conviviale où les animateurs et leurs invités ont pour habitude de partager une bière.
Ce concept original déplace le format habituel des balados des studios vers les régions, attirant ainsi un public diversifié.
Mis en œuvre par le Théâtre des Eskers, ce rendez-vous sur scène invite les artistes de sa programmation à transmettre leurs réflexions et expériences avec l’auditoire.
Parmi les invités, on retrouve des personnalités comme Charles Beauchesne, également connu pour son propre balado Les pires moments de l’histoire, des humoristes comme Arnaud Soly, ainsi que des comédiennes et comédiens comme Sophie Cadieux.
LES PIRES MOMENTS DE L’HISTOIRE
Dans cette série audacieuse diffusée notamment sur OHDio, l’humoriste Charles Beauchesne adopte une perspective unique et humoristique pour explorer les aspects les plus sombres et les plus sinistres de l’histoire.
Avec un ton à la fois noir et captivant, il nous entraîne dans un voyage à travers des événements historiques qui ont laissé une empreinte indélébile sur notre passé.
Les épisodes récents de la série plongent l’auditoire dans des récits fascinants, comme le tragique naufrage du Titanic. Charles Beauchesne revisite également la vie de Thomas Edison, l’inventeur de l’ampoule électrique, dont les contributions à la science et à la technologie ont été aussi brillantes que controversées. En outre, la série explore les origines de la Nouvelle-France.
Charles Beauchesne, avec son style narratif distinctif, transforme ces histoires en aventures captivantes, pleines d’ironie et de sarcasme. Il anime les faits historiques avec un esprit vif et un regard critique. Comme l’indique le résumé de la série : « Ici, pas de place pour le “bon” vieux temps. Juste le mauvais. » C’est une invitation à redécouvrir notre histoire, non pas comme une série d’événements glorifiés, mais comme une suite de moments ironiques et complexes qui ont façonné le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui.

L’INDICE BOHÉMIEN JUIN 2024 7 – BALADOS –
NOS COUPS DE C ΠUR DE MAI
LA RÉDACTION
En mai, notre équipe éditoriale a sélectionné des événements qui ont marqué les esprits et réchauffé les cœurs de l’Abitibi-Témiscamingue.
LE FESTIVAL FIERTÉ VAL-D’OR RENAÎT DE SES CENDRES
Après une édition annulée par les feux de forêt, le Festival Fierté Val-d’Or nous revient, plus flamboyant que jamais. Du 6 au 9 juin à la place Agnico-Eagle, les membres de la communauté LGBTQ2+ de l’Abitibi-Témiscamingue pourront profiter d’un événement tout à fait gratuit. Le 6 juin, la soirée d’ouverture Wigobisan aura lieu, avec notamment une activité de danse autochtone à 20 h. Les années 1980 seront à l’honneur le 7 juin, avec le personnificateur de célébrités Jimmy Moore qui se transformera en Madonna. Le samedi 8 juin s’annonce prometteur : la production de Rita Baga Des drags en or sera à l’honneur pendant la soirée thématique bal en blanc. Une marche de la diversité ainsi qu’une représentation de The Karaokings clôtureront ce festival haut en couleur.

SKATE
FEST ET ŒUVRE COLLECTIVE AVEC LES CITOYENNES ET CITOYENS À LANDRIENNE
Lors du Skate Fest à Landrienne, une œuvre d’art collective émergera grâce à la participation de la population. Cette initiative sera le fruit de diverses interactions culturelles orchestrées par Geneviève Hardy, en collaboration avec la municipalité de Landrienne. « On est allés à la Maison des jeunes, on leur a expliqué le projet et ils nous ont fourni des idées, explique Geneviève Hardy. C’est super ludique! Ensuite, ils ont choisi les couleurs. C’est une œuvre peinte au sol, sur l’asphalte. Le public va même m’aider à la peindre! » La journée sera également marquée par une collecte de fonds destinée aux jeunes sous forme d’un dîner.

SEPT PODIUMS POUR LE STUDIO RYTHME ET DANSE
Le Studio Rythme et Danse a conclu sa saison compétitive à la compétition Hit The Floor Saint-Hyacinthe. Les 7 troupes, composées de 48 danseuses et danseurs de 6 à 19 ans, ont brillé en présentant 9 numéros variés. Leur préparation depuis août a porté ses fruits, avec quatre chorégraphies classées premières dans leurs catégories. Trois autres chorégraphies ont remporté les deuxième ou troisième places, confirmant le talent et le travail acharné des élèves et des six professeurs. – Geneviève Melançon pour Rythme et danse

Les Éditions Hannenorak annoncent la sortie, le 28 mai, d’une œuvre littéraire de Virginia Pesemapeo Bordeleau en l’honneur de l’événement Je lis autochtone. Ce récit inédit issu de la série Solstice se résume ainsi : « Dans ses affaires, une aînée retrouve un carnet où elle raconte les aventures amoureuses qu’elle a vécues lors de ses nombreux voyages. En plongeant dans ses mots et ses souvenirs, elle se redécouvre avec bonheur et trouve les réponses à de bien vieilles questions. Dans ce très beau récit de la vie d’une femme, Virginia Pesemapeo Bordeleau revisite l’image de la kokum et lui redonne toute sa dimension charnelle. – Sandra Blouin pour les Éditions Hannenorak

Vous avez de bonnes nouvelles à communiquer? Écrivez-nous à redaction@indicebohemien.org!
8 JUIN 2024 L’INDICE BOHÉMIEN – CULTURE –
UNE NOUVELLE DE VIRGINIA PESEMAPEO BORDELEAU POUR JE LIS AUTOCHTONE
FIERTÉ VAL-D’OR GENEVIÈVE HARDY STUDIO RYTHME ET DANSE COURTOISIE ÉDITIONS HANNENORAK
SONS M Ê L É S :
UNE D É AMBULATION SONORE AU CŒUR DES CARAÏBES
RAYMOND JEAN-BAPTISTE

Dans la sérénité et le calme de Rouyn-Noranda, Giscard Bouchotte, le commissaire haïtien, tout juste arrivé de la trépidante Port-au-Prince, prépare Sons mêlés, une exploration sonore dévoilant l’essence de la diversité musicale haïtienne.
Cette exposition se tiendra du 7 juin au 6 octobre au Musée d’art (MA) de Rouyn-Noranda. Elle propose d’emporter le public vers une expérience immersive par l’entremise d’un mélange de traditions et d’expressions contemporaines. Coup d’œil sur l’exposition.
UNE PROMENADE À PORT-AU-PRINCE, UNE VILLE BRUYANTE
Pour un voyage captivant, Sons mêlés retrace l’ambiance de chaos sonore qui règne à Port-au-Prince, la capitale d’Haïti. La cacophonie urbaine y prend tout son sens. Sirènes des officiels, sermons des églises du réveil, haut-parleurs des marchands de rues, klaxons des bagnoles génèrent une pollution sonore dingue. Dans ce tohu-bohu sonore, la moto remporte la palme. Certes, l’usage d’un deux-roues motorisé permet de gagner du temps en contournant les bouchons de circulation dans une ville où les règles de circulation n’existent que dans le Code de la route. Mais les oreilles doivent encaisser les 90 décibels du moteur et ceux de la radio à forte intensité sonore installée sur ce véhicule. On s’expose donc à plus de cent décibels, soit l’équivalent du bruit généré par un avion de ligne qui passe à 300 mètres au-dessus de notre tête.
LE RARA ET LE CARNAVAL, DES RYTHMES MUSICAUX
TRADITIONNELS REVISITÉS PAR LES ARTISTES
Au fil des siècles, les chants traditionnels dans les champs de canne ont inspiré les travailleurs et façonné l’identité musicale d’Haïti. Des rassemblements konbit aux cérémonies vaudou en passant par les festivités vibrantes du carnaval et du rara, la musique a toujours joué un rôle essentiel dans la culture et la vie quotidienne des Haïtiennes et des Haïtiens.
Le terme rara, qui signifie bruyamment, hautement, est un rythme musical qui se joue avec des instruments traditionnels produisant un effet lancinant. Du mercredi des Cendres jusqu’au dimanche de Pâques, cette musique folklorique sert de trame à une immense foule dansante et chantante, à travers les rues, au rythme du tambour. Elle suit la période carnavalesque qui prend fin le Mardi gras et dont les décibels équivalent à un concert de casseroles.
Aujourd’hui, le rara prend une extension irréversible. Il fait partie désormais de la scène musicale en République dominicaine sous le nom de gaga. Le groupe Arcade Fire s’en est même inspiré dans son album Reflektor, sorti en 2013.
Sons mêlés
Une exploration sonore au coeur d’HaÏti
7 juin au 6 octobre 2024
Commissaire : Giscard Bouchotte

Artisanat autochtone d’alexis weizineau – ART SONORE –
sous la lumière du nord
2 février 2024 - 2 février 2029
Impossible de trouver le sommeil dans ces conditions, sauf pour les Haïtiennes et Haïtiens déjà habitués au rara et au carnaval en début d’année.
Sons mêlés se distingue par sa vision novatrice de la musique, la considérant comme une source d’inspiration et un reflet de l’âme haïtienne. L’exposition propose de transcender les frontières de la musique conventionnelle pour explorer des territoires artistiques inexplorés avec une variété d’œuvres. Celles-ci regroupent vidéos, partitions musicales, mixtapes, archives sonores, instruments de musique traditionnels, péristyles, installations diverses, etc. Ces œuvres multidisciplinaires révèlent la profondeur et la puissance émotionnelle de la musique haïtienne.
Que l’on se passionne pour la musique ou que l’on souhaite simplement découvrir de nouvelles sonorités, l’exposition Sons mêlés promet une immersion inoubliable dans l’univers esthétique et musical d’Haïti. « Cette exposition, de l’avis de Giscard Bouchotte, s’intéresse dans le fond et dans la forme aux utilisations contemporaines du son par différents artistes qui s’emparent des traditions pour proposer de nouvelles expérimentations. » Elle combine donc le son et la cacophonie urbaine d’une manière agréable à l’oreille pour accompagner une déambulation dans les rues de Port-au-Prince.
la boutique du MA


museema.org 1 819-762-6600

L’INDICE BOHÉMIEN JUIN 2024 9
Photo : Josué Azor
JEAN-BAPTISTE
RAYMOND
EN PARTENARIAT AVEC
TOURISME
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
LE FESTIVAL D’HUMOUR ÉMERGENT EN ATTENDANT QUE LA PLANÈTE EXPLOSE
GENEVIÈVE LEMIRE-JULIEN
Le Festival d’humour émergent (FHE) est, malgré son jeune âge, un incontournable à Rouyn-Noranda. Depuis 2021, l’idée de Camille Dallaire a été propulsée vers un succès indiscutable auprès de la population : « Regardez dehors, écoutez les nouvelles » sont les mots qu’elle a utilisés pour entamer le lancement de la programmation. Camille m’a ensuite confié combien elle éprouve un certain malaise à créer un évènement culturel festif alors que des gens vivent dans des conditions de vie exécrables, que des guerres continuent de faire rage sur la planète et qu’il existe encore tant d’inégalités, d’injustices sociales, etc. Elle s’est dit qu’elle ne pouvait pas ne pas en parler. Son souhait est en fait que le Festival amène de la légèreté dans le cœur des gens, en parlant de ces défis planétaires avec humour. Il ne s’agit pas que de faire rire, mais aussi de sensibiliser, de conscientiser les gens et de générer de l’espoir dans la grande vibration du monde.
De plus, pour être en accord avec ses valeurs et celles du conseil d’administration, l’évènement doit être accessible au plus grand nombre de personnes possible. Les prix des billets ont été établis dans l’idée d’attirer une clientèle de tous types de revenus afin qu’un maximum de personnes désireuses de se changer les idées et rire un bon coup puisse se le permettre financièrement, en attendant que la planète explose!


Sur le plan des nouveautés, ce quatrième FHE saura surprendre son public loyal. Les soirées Gala se tiendront au Théâtre du cuivre, à l’abri des intempéries, et pourront accueillir un plus grand auditoire alors que la Guinguette chez Edmund sera réservée aux débuts de soirée. De plus, plusieurs spectacles seront présentés en simultané, forçant les gens à choisir, ce qui ne sera pas une tâche des plus faciles! L’Agora des arts accueillera certains spectacles de fin de soirée, appelés familièrement les late nights, alors que la scène Paramount présentera la soirée de clôture du 29 juin.
On innove aussi avec les ateliers d’improvisation donnés par Francis Sasseville avec des membres de la Ligue nationale d’improvisation (LNI), notamment Sylvie Moreau et Salomé Corbo. Deux types d’ateliers seront présentés l’un à la suite de l’autre; le premier pour les néophytes, et le second pour les téméraires, pour aller un peu plus loin dans leur expérience. Cette soirée se conclura par un match d’improvisation, la LNI contre les pros de la région, un match à voir absolument!
Sans aucune relâche, l’équipe 2024 a voulu étendre le territoire des spectacles et les festivités se rendront à Sainte-Germaine-Boulé ainsi que dans quatre autres quartiers ruraux, transportant cette grande fête de l’humour près des gens vivant loin du centre-ville. De plus, une alliance technologique s’est concrétisée pour offrir au public une application où tous les spectacles, l’horaire et des notifications pour les surprises seront affichés. Un incontournable pour être à l’affût des nouvelles.
La marchandise, créée par UTOPIQ Création a été fabriquée dans le plus grand souci environnemental. Certains articles sont carrément faits à partir des articles promotionnels des années précédentes. Le CA, conscient des impacts de la consommation excessive à laquelle le monde est exposé, a basé les choix en lien avec la protection de notre planète et la consommation éthique et écoresponsable, histoire de ne pas contribuer à la fin du monde.
J’ai demandé à Camille ses coups de cœur cette année et elle a été incapable de répondre! Tout est à voir et tous les passeports complets se sont écoulés en 24 heures. Il faudra faire vite pour se procurer les billets, l’évènement est populaire et apprécié par la communauté. Pour terminer, en bonne ambassadrice de la région, Camille invite les gens d’ailleurs, même jusqu’en Gaspésie, à venir en Abitibi-Témiscamingue parce que tout vaut le détour. Même quand on pense que c’est loin, ce n’est pas si loin. Il y a tant de choses à voir et à faire, en plus du Festival qui se tiendra du 26 au 30 juin.
10 | JUIN 2024 L’INDICE BOHÉMIEN – FESTIVAL –
Joëlle Prud’homme.
AUDRÉE GIROUX
AMOS VOUS RACONTE… LES TURCOTTE
DOMINIQUE ROY

Le lancement du huitième et avant-dernier tome de la collection « Amos vous raconte » est prévu dans la
se construit sera proche de la rivière Harricana, en Abitibi, il y a fort à parier que des gens s’y installeront et qu’une ville s’y développera. Ils veulent être les premiers sur place pour accueillir les nouveaux colons. « On ouvre un magasin, un hôtel, n’importe quoi, et quand le monde arrive, on est prêts! »
Ainsi, alors que les températures fraiches de l’automne se pointent, les Turcotte entament un long périple… Vingtdeux jours à traverser lacs et rivières, et à y faire du portage. Le clan se compose de Joseph Turcotte et de sa femme Bernadette; d’Ernest Turcotte, de sa femme Albertine ainsi que de leurs 4 enfants : Armand (5 ans), Rose (3 ans), Aline (2 ans) et Ivanhoé (9 mois). Les 4 adultes, les 4 enfants et 4 000 livres de marchandises sont répartis sur 2 canots. « La famille pagaye vers un monde nouveau avec l’espoir d’une vie meilleure. » L’expédition est rude, parsemée d’embûches et de difficultés. Leur arrivée marquera à tout jamais l’histoire de la colonisation de l’Abitibi.

Une fois de plus, Véronique Larouche-Filion signe cet album jeunesse. Pour ce tome, elle a travaillé en collaboration avec Geneviève Bigué, illustratrice professionnelle originaire d’Amos et arrière-arrière-petite-fille d’Ernest et Albertine Turcotte.
Le lancement, qui aura lieu en juillet, retiendra l’attention par son originalité. « Je voulais faire un événement qui allait attirer


du public au-delà de ceux qui achètent des livres ou qui sont déjà des fans des autres tomes », explique Mme LaroucheFilion. Ainsi, les spectateurs assisteront à des olympiades, mises en scène par des comédiens qui se livreront à des épreuves farfelues inspirées de la colonisation, par exemple, le roulage de balle de laine, le transport d’un canot, etc. Ce lancement divertissant, avec sa formule festive, fera partie des activités familiales à ne pas manquer lors du Festival H2O.


L’INDICE BOHÉMIEN JUIN 2024 | 11 –
LITTÉRATURE –
@AbitibiOuestQC Suivez-nous ! vivre.ao.ca Festival Équestre et Rodéo Professionnel de La Sarre 19 au 23
2024 VÉRONIQUE LAROUCHE-FILION VÉRONIQUE LAROUCHE-FILION
Crédit photo : © Festival équestre - Joanie Belzil
juin
EN PARTENARIAT AVEC
TOURISME
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
POUR LE PLAISIR DES SENS!
KATHLEEN BOUCHARD
31 mai 2024. Une date à retenir pour les adeptes d’art et de découvertes visuels puisque c’est ce jour qu’ont choisi les membres de l’Atelier Cent Pressions de Ville-Marie pour procéder à leur cinquième vernissage sous forme de 5 à 7. L’invitation est donc lancée.
Plus d’une trentaine d’exposantes et exposants auront la chance de présenter leurs œuvres au public. Sachez qu’il y en aura vraiment pour tous les goûts. Plusieurs types de techniques seront en vedette : aquarelle, peinture, encre, estampe, sculpture et relief.
MINIATURES, VOUS DITES?
Pour ce vernissage, vous découvrirez que les créations ont toutes un point en commun : leur taille. C’est d’ailleurs le regroupement d’artistes du Témiscamingue, l’Artouche, qui a lancé l’idée du thème « Les deux rives en miniature » à l’Atelier Cent Pressions. Rappelons que l’objectif de l’Artouche vise à promouvoir les artistes témiscamiens en formation, semiprofessionnels et professionnels. Les œuvres exposées ne dépassent pas le format de 4 x 6 pouces. Le thème de la miniature permettra au public de découvrir différentes visions et perspectives de la vie et de l’art à travers divers sujets : personnages, nature, monde animalier ou abstrait.

L’été, en Abitibi-Témiscamingue, c’est la poésie de la culture qui rime avec aventures et nature. Festivités avec originalité et diversité. Événements avec rassemblements et émerveillement.
Bon été culturel en Abitibi-Témiscamingue !


LES ARTISTES
L’idée de la miniature a fait son chemin jusqu’à plusieurs créatrices et créateurs de la région et de l’Ontario. Une bonne vingtaine de personnes ont répondu à l’appel. Vous pourrez, entre autres, découvrir (ou redécouvrir) les œuvres de Laura Landers, propriétaire d’une boutique à North Cobalt, et de son groupe d’artistes, ainsi que ceux appartenant au Bureau des regroupements des artistes visuels de l’Ontario (BRAVO-Nord), dont Francine Plante, une des propriétaires de l’Atelier Cent Pressions, fait partie. Les créations de cette dernière et de ses collègues pareront aussi les murs de l’atelier. Martine Savard, bien établie à Rouyn-Noranda, exposera également ses œuvres. Une chose demeure certaine, le mélange des styles rend ce vernissage plus qu’intéressant.
ENCOURAGER L’ART
C’est une réelle occasion pour se procurer des objets décoratifs inédits, faits par des gens d’ici et qui plairont tant aux collectionneurs qu’aux débutants en matière d’art visuel. C’est également un moment propice pour faire plaisir à quelqu’un puisque les œuvres se détaillent entre 30 $ et 150 $.
L’exposition se faisant directement dans les locaux de l’Atelier Cent Pressions, vous pourrez voir en direct, à l’occasion, le travail de certains artistes. En effet, l’espace sera ouvert tout l’été, du lundi au vendredi, à partir du vernissage, et ce, jusqu’en septembre. « Si vous vous trouvez à Ville-Marie à l’extérieur des plages annoncées, durant la fin de semaine par exemple, il vous sera possible de visiter la galerie en appelant au numéro qui apparait sur la porte du bâtiment », mentionne Francine Plante.
Alors, cet été, n’hésitez pas à prendre un peu de votre temps pour vous plonger dans cette forme de discipline tout en encourageant les artistes de la région. C’est un rendez-vous que vous proposent Francine Brouillard, Josée Lefèvre ainsi que Francine Plante Pokio à Ville-Marie, au 32, rue Notre-Dame Nord, du lundi au vendredi entre 11 h et 15 h, à partir du 31 mai.
Vos yeux n’en reviendront pas!
12 | JUIN 2024 L’INDICE BOHÉMIEN – ARTS VISUELS –
FRANCINE PLANTE POKIO
40 E ANNIVERSAIRE DE LA GALERIE SANG-NEUF-ART DE PALMAROLLE
Tout l’été, divers événements culturels, plus colorés les uns que les autres, se succéderont en Abitibi-Témiscamingue. Il y en a un que vous ne voulez pas manquer : le Déjeuner sur l’herbe, le dimanche 7 juillet, par lequel Louisa Nicol soulignera le 40e anniversaire de la Galerie Sang-Neuf-Art.

CONTEXTE D’ÉMERGENCE
En 1984, le désir légitime de voir émerger une Maison de la culture se fait sentir à La Sarre. Les élus municipaux tergiversent et, finalement, le projet échoue. Les artistes de La Sarre et des environs s’alarment face au refus de la Ville de La Sarre. Ils se mobilisent et font part de leur désarroi à Louisa Nicol, qui est sur le point d’ouvrir cette même année une nouvelle galerie d’art dans l’une des anciennes forges du village, sur la rue Principale. L’artiste de Palmarolle est reconnue pour n’avoir pas froid aux yeux. Elle prend la décision d’aviser Marcel Caron, maire de Palmarolle et alors préfet de la MRC, du refus de La Sarre de prendre les choses en main. À l’assemblée suivante du conseil des maires de l’Abitibi-Ouest, il déclare : « Si La Sarre renonce à doter sa ville d’une Maison de la culture, le village de Palmarolle veut bien, lui, relever ce défi. » Il n’en fallait pas plus pour que La Sarre réagisse et enclenche sur le champ le processus de construction de ladite maison, répondant ainsi deux ans plus tard au besoin d’une population assoiffée de culture. La Maison de la culture de La Sarre est inaugurée en 1986.
LE WESTMOUNT DE LA SARRE
En 1984, après l’inauguration de la Galerie Sang-Neuf-Art, le curé de Palmarolle, Arthur Drouin s’exclame en chaire
FRANCINE GAUTHIER
« Maintenant qu’une galerie d’art a pignon sur rue dans notre village, on peut dire que Palmarolle est le Westmount de La Sarre! » Trois ans plus tard, en 1987, Louisa Nicol récidive en ouvrant une école d’art : l’École des beaux-arts Rosa-Bonheur, au 382 du Rang 7.
Après l’inauguration de la première saison d’été 1984 avec le dévoilement de l’horloge publique intégrée au bâtiment, œuvre du sculpteur Jacques Baril, la Galerie Sang-NeufArt a accueilli nombre de visiteurs célèbres au cours de ses 40 ans d’existence. Citons par exemple Guylaine et Frédéric Back, artiste en animation ayant notamment réalisé L’homme qui plantait des arbres; Rogatien Vachon, hockeyeur originaire de Palmarolle qui a donné son nom à l’aréna du village; Lise Bissonnette, journaliste originaire de la région; Raoul Duguay, poète; Robert Bernier de la revue Parcours; Claude Jasmin, auteur entre autres du roman La petite patrie, devenu téléroman par la suite et sa compagne Raymonde Boucher, réalisatrice; Roger Paré, illustrateur; Louisette Dussault, actrice; Josée Rodriguez, la Botero française; Dany Turcotte et Mahée Paiement pour La Petite Séduction dont une partie du tournage a eu lieu à la galerie et à l’École des beaux-arts Rosa-Bonheur. Plusieurs visiteurs de marque se sont ajoutés au fil des ans. À deux reprises au cours de ces quarante ans d’existence, la Galerie Sang-Neuf-Art a tenu un kiosque aux expos des Salons des galeries d’art de Montréal.
DES EXPOSITIONS TOUT L’ÉTÉ
Au 109A, rue Principale à Palmarolle, lieu fréquenté par les artistes, les touristes et les amoureux des arts, des expositions sont au programme tout l’été, 7 jours sur 7, de midi à 18 heures :
• 13 juin : vernissage de l’exposition Le corps humain dans tous ses états de Louisa Nicol.
• 7 juillet : Déjeuner sur l’herbe à l’occasion du 40e anniversaire de la galerie.
• 14 au 25 juillet : maquettes de Raymond Marius Boucher et du groupe des maquettistes de théâtre du Québec.
• 28 juillet au 8 août : œuvres de Katia Martineau et des artistes du Groupe de la galerie.

• 11 au 23 août : œuvres de Jocelyne Caron, Jeannine Durocher, Jeannine Provost et Sophie Royer.
• 25 août au 2 septembre, le dernier jour d’ouverture de la Galerie Sang-Neuf-Art : les dessins réalisés d’après des modèles par les portraitistes des Beaux Mardis seront présentés à la population. Avis aux personnes qui auront posé pour eux.
En avant-midi, deux jours par semaine à des dates encore indéterminées, Louisa offrira des cours de technique de marouflage sur toile d’œuvres papier et des ateliers de modèle vivant. Les personnes intéressées peuvent contacter Louisa au 819 787-3047.
Le 7 juillet de midi à 18 heures, lors du 40e anniversaire de la galerie, des bouchées seront servies avec des vins d’accompagnement aux artistes et aux amateurs d’art invités. Nul doute que cet événement suscitera l’intérêt de toutes les personnes que la galerie a réunies en 40 ans pour l’amour de l’art.
Du 2 juin au 2 septembre, la Galerie Sang-Neuf-Art sera ouverte tous les jours de midi à 18 heures. Bienvenue à toutes et tous!
L’INDICE BOHÉMIEN JUIN 2024 | 13 – ARTS VISUELS –
Œuvre de Jacques Baril en façade de la galerie.
LOUISA NICOL
École des beaux-arts Rosa-bonheur.
LOUISA NICOL
ANGLIERS SE PARE D’UNE GRANDE MURALE!
Du 19 au 21 juillet, Angliers célèbrera son centième anniversaire. La programmation promet trois journées de rencontres, de retrouvailles, de divertissements et d’activités inoubliables. Pour souligner l’événement, et pour en garder une empreinte dans le temps, une œuvre artistique géante sera dévoilée au grand public à la fin de la matinée du 20 juillet. Cette dernière se veut un hommage, à l’histoire de ce village, et ce, depuis sa fondation en 1924.
L’idée de cette murale est celle de Cathy Fraser, présidente du Comité du centenaire du village d’Angliers. Elle avoue avoir été inspirée par celles de Laniel, bien en vue sur les murets qui longent la promenade, une ancienne voie ferrée qui traverse le village et qui est aménagée en sentier pédestre. « Je les trouve tellement belles et animées. »
UNE LIGNE DU TEMPS GÉANTE
Au départ, le tout devait orner trois murs de soutènement du barrage des Quinze, structure emblématique de cette localité, mais des enjeux de sécurité ont contraint le comité à choisir un autre emplacement. C’est donc sur le mur extérieur de l’aréna, le centre récréatif situé au cœur du village, bien visible à partir du chemin principal, que l’œuvre de 4,5 x 34,7 m (15 x 114 pieds) sera réalisée.
La murale représentera de nombreux pans de l’histoire de cette localité : artistiques, culturels, sociaux, familiaux,
DOMINIQUE ROY
économiques, patrimoniaux, etc. « On y retrouvera une ligne de temps qui présente le début d’Angliers, en 1924, avec la gare et le chemin de fer, le barrage, la drave avec le remorqueur de bois T.E. Draper, des billes de bois, des bûcherons, la présence des autochtones, l’École StViateur, l’oiseau cardinal qui représente l’unique grosse entreprise du village, le poisson lolotte pour le Festival du poisson, des enfants qui jouent au ballon, la chasse, la pêche, le lac et la forêt qui entourent notre village », explique Mme Fraser.
ARTISTES ET CITOYENS EN ACTION
Les Témiscamiennes Carol Kruger et Ginette Jubinville, artistes reconnues pour leur talent et leur expertise, sont déjà à l’œuvre. Elles créent d’abord la murale sur papier, dans leur local, avant de la peindre à l’extérieur. Et tout est réfléchi pour que les citoyennes et citoyens puissent y apporter leur coup de pinceau. Lors de la réalisation, les personnes intéressées pourront participer. Elles seront guidées et accompagnées par les artistes pour développer ou mettre en pratique les techniques de base typiques à ce genre de peinture. Une fois l’œuvre terminée, une séance d’évaluation est prévue « pour faire un retour et recueillir les commentaires des participants sur le processus de médiation culturelle. Nous allons réfléchir ensemble aux apprentissages et aux impacts de ce projet sur la communauté », termine l’instigatrice du projet.

et
La création de cette œuvre sera donc le résultat d’un travail collectif, pour que les gens d’Angliers puissent s’imprégner de leur histoire et se l’approprier de façon artistique.
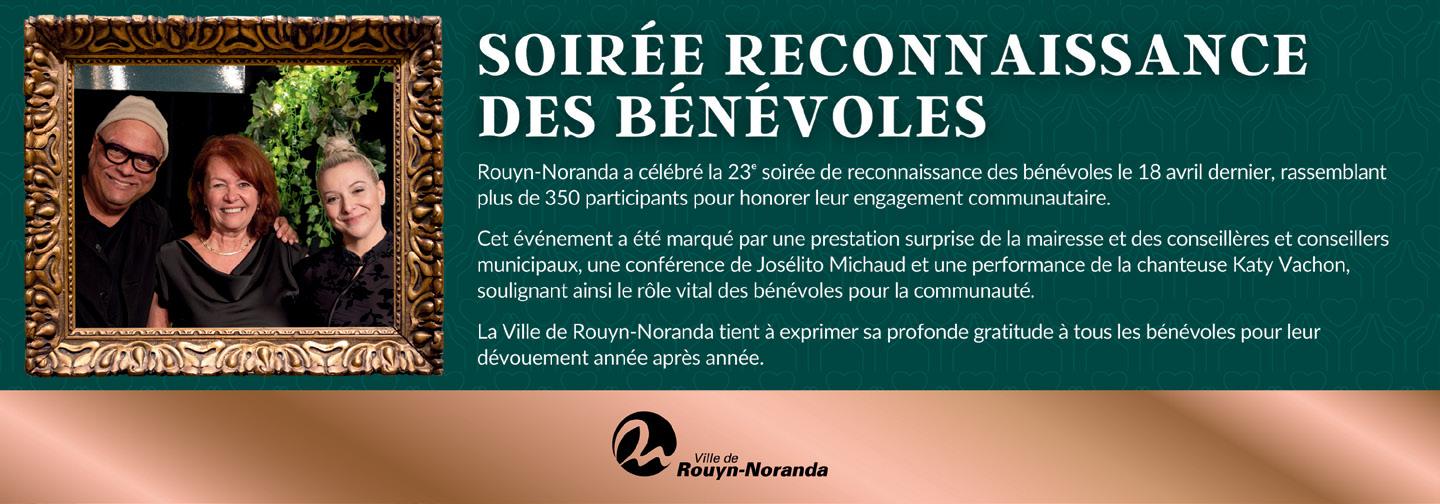
14 | JUIN 2024 L’INDICE BOHÉMIEN –
–
ARTS VISUELS
Ginette Jubinville
Carol Kruger.
JUBINVILLE
GINETTE
UNE MURALE VIBRANTE CÉLÉBRANT L’ATTACHEMENT AU TERRITOIRE
GENEVIÈVE LEMIRE-JULIEN
En Abitibi-Témiscamingue, nous pouvons admirer de nombreuses murales, en pleine ville, sur des murs qu’on a vus comme des canevas grandioses. La région est parsemée de ces œuvres inspirantes qui ajoutent de la couleur, de la vie et une touche créative dans les paysages urbains.
Une des artistes dont le nom revient souvent dans l’élaboration de ces projets depuis 2016, Valéry Hamelin, a pris en charge un projet de murale qui sera situé à Amos. C’est avec les yeux remplis de lumière que Valéry me mentionne combien les projets culturels vont de pair avec les démarches artistiques, et que le plaisir du processus vient de l’ouverture de la clientèle et de la liberté laissée aux artistes.
L’âme du projet est posée sur le territoire et le désir qu’on peut avoir d’y faire sa vie, d’y réaliser ses rêves et de s’enraciner dans son terreau fertile, un espace vaste, coloré, vivant. La murale proposera un diptyque aux thématiques universelles prenant tout son sens dans une lecture elliptique. Intéressée par l’interdépendance créée entre les polarités, Valéry a spontanément été inspirée par la boucle d’une ligne d’une vie. On y voit un enfant rêvant à l’avenir qu’il veut se bâtir, puis un vieil homme ému et heureux de cette vie qui a été fidèle à ses envies de jeune homme. Une histoire liée à l’attachement au territoire avec un ciel lumineux et coloré. Le loup fait figure d’intégrité, de courage et de fougue; il a transporté les pensées racines de l’enfant vers leur concrétisation dans l’œuvre d’une vie. L’ensemble de la démarche artistique de Valéry se chorégraphie autour d’une quête de l’essence de l’être humain à travers sa nature duelle intrinsèque, dans une perspective d’équilibre. La murale sera portée par deux murs distincts, comme la vie est, elle aussi, faite de dualités. Valéry a vu une grande occasion!
Ce projet est propulsé par des partenaires financiers indispensables rassemblés par Valéry : Réjean Carignan, Location Amos et Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Par ailleurs, Tourisme Abitibi-Témiscamingue collaborera davantage au projet en liant une capsule vidéo à un code QR qui permettra aux visiteurs de voir l’évolution de la mura;e. Aussi, des partenaires supplémentaires ont offert leur soutien : Suzanne Blais, députée d’Amos; Peinture John David et l’entente de développement culturel de la MRC d’Abitibi et de la Ville d’Amos. Valéry a pris la gestion complète du projet avec cœur et passion. Elle a conçu la maquette en étroite collaboration avec Stéphanie Dupré-Gilbert pour l’infographie et elle a monté une équipe d’artistes muralistes de talent : Andréane Boulanger, Ariane Ouellet et Stéphanie Dupré-Gilbert dont les forces se rassembleront pour concrétiser l’idée d’ici la fin juin.
Réjean Carignan, propriétaire de l’immeuble qui abrite La Résidence Les Sources, souhaite que le milieu de vie soit inspirant dans le quotidien des voisins et des passants et c’est par l’art public qu’il a choisi d’y parvenir. C’est avec des bâtisseurs comme M. Carignan que la vie culturelle prend vie dans des endroits parfois insolites, et comme citoyenne de l’Abitibi-Témiscamingue, je crois qu’on peut souhaiter que cette initiative sache en inspirer d’autres à participer à l’embellissement du territoire et partager cet amour de notre patrimoine.


L’INDICE BOHÉMIEN JUIN 2024 | 15 – ARTS VISUELS –
COURTOISIE

CAHIER PREMIÈRES NATIONS
16 | JUIN 2024 L’INDICE BOHÉMIEN
MARIE-FRÉDÉRIQUE FRIGON
Détail des regalia au Pow-Wow Abitibiwinni 2022.
NANIKANA , UN LIVRE PORTEUR DE LUMIÈRE
MICHAEL PELLETIER-LALONDE
Rivière Piché, un dimanche de mai. Le chant des merles, le fracas d’un pic-bois à l’œuvre enveloppent cette fin d’après-midi qui finit par s’ensoleiller. C’est ici, dans un des sentiers (issus d’une mobilisation citoyenne pour la sauvegarde de cette forêt, au début des années 1990) qui longent la rivière que j’ai donné rendez-vous à Rodrigue Turgeon pour causer de Nanikana, son premier livre, paru aux éditions l’Esprit libre, le 1er juin.
Dans cet ouvrage de quelque 300 pages, appuyé de cartes et d’illustrations réalisées par Geneviève Bigué, Rodrigue revient sur un voyage effectué sur le fleuve Nanikana en juillet 2021, avec ses acolytes : son frère Gabriel Turgeon et ses amis, Sébastien Brodeur-Girard et Gilles Gagnon. Un parcours d’environ 500 kilomètres, étalés sur 26 jours à travers les territoires Anicinape Aki et Eeyou Istchee, qui les a menés de Saint-Mathieu-d’Harricana à la baie James. Reprenant le fil des jours de ce périple, Rodrigue y revient sur ses émerveillements, ses craintes. Mais aussi sur notre rapport trouble au territoire et à Nanikana : un fleuve au cœur d’une certaine identité abitibienne, mais menacé par l’appétit sans fond des extractivistes, passés et à venir. Un fleuve méconnu aussi – jusqu’à la véritable signification de son nom, tel que le rappelle Isapen Mapitce dans sa préface – alors que « [l’on commence] à peine à tendre l’oreille aux récits autochtones qui fleurissent sur [ses] rives depuis des millénaires » (p. 26).
Partant de ce bilan, Rodrigue me nomme d’emblée le projet de Nanikana : « Ce que j’ai souhaité faire, à partir de ce constat-là de base, c’était de trouver une manière d’amener de la lumière làdedans, dans notre situation qui peut sembler désespérante à tellement d’égards […] De tout ce que je connais de la région, [Nanikana], c’est ce qui le plus porteur de lumière, de rassemblement, de force qui peut amener une cohésion, une inclusion, et un respect entre les gens. »
Parce que Nanikana, selon lui, est à l’image de portes ouvertes sur notre passé et notre avenir : « C’est un territoire qui se découpe en séquences d’occupation coloniale, et [on] peut très bien anticiper de ce qui adviendra de l’aval en évaluant ce qu’on a pu faire en 100 ans en amont. Le regard qu’on jette vers le futur, on peut le jeter vers l’aval de Nanikana, dans un territoire qui est encore relativement épargné, mais qui demande aussi à être restauré en grande partie… »
C’est d’ailleurs ce double regard qui donne son rythme aux dix chapitres de Naninaka, où le récit du voyage cède régulièrement le pas à l’essai, à mesure que le poids de l’histoire se révèle

aux canoteurs. Une démarche entièrement assumée par Rodrigue, d’autant qu’en plus des renseignements tirés de sources historiques ou contemporaines, on y retrouve de nombreux témoignages de personnes anicinapek, eeyouch et abitibiennes que Rodrigue a rencontrées dans le processus de rédaction du livre. Une démarche essentielle, indiscutable pour l’auteur, afin de jeter une diversité de regards sur Nanikana et son histoire : « Ça, ça a été le plus grand voyage dans le projet – quand j’ai fini d’écrire notre histoire, pis que je suis allé à la rencontre des gens ».
Et c’est ça, en fin de compte, Nanikana : le récit d’un voyage à la rencontre de l’autre et du territoire, et un vibrant appel à renouveler ce qui nous lie.
ERRATUM
Une erreur s’est malheureusement glissée dans l’article « Le FGMAT fête son 20e anniversaire avec une édition spéciale audacieuse » apparaissant en page 15 du dernier numéro de L’Indice bohémien (mai 2024). La légende de la dernière photo devrait faire mention d’Ivan Boivin-Flamand, et non de Scott-Pien Picard. L’artiste apparaissant sur la photo est en effet M. Boivin-Flamand.
Nous nous excusons auprès de M. Boivin-Flamand pour cette erreur.
L’INDICE BOHÉMIEN JUIN 2024 17 CAHIER PREMIÈRES NATIONS
DOMINIC LAFONTAINE, EN PLEINE CONSCIENCE DE SON ÉPOQUE
STÉPHANIE FORTIN
Si John Cage a dit « Everything we do is music » [« Tout ce que nous faisons est musique »], on pourrait le paraphraser pour Dominic Lafontaine de la façon suivante : « Everything he does is art » [« Tout ce qu’il fait est art »]. Inspiré et libre, il aime remettre en question l’art, déconstruire la création, faire fi des frontières entre les disciplines artistiques et voguer entre les genres. Il flirte avec l’intelligence artificielle, manie la caméra, le crayon et la souris, mélange héritage traditionnel et technologie. Il propose assurément un art autochtone en pleine conscience de son époque.
Selon ce qu’on en apprend sur le site Web de Minwashin, Dominic se décrit comme un « Frenglish, à moitié québécois, à moitié indien et franco-ontarien. Il y a tous ces mondes-là et je suis au milieu. Je cherche à voir l’humanité entre tous ces groupes culturels, identitaires et nationaux pour aller au-delà par l’humour ». L’humour est en effet un leitmotiv dans l’œuvre de Lafontaine. On sent qu’il s’amuse et joue en créant, à la jonction de l’ironie, de la réflexion et du plaisir.
Pour l’artiste multidisciplinaire, l’année 2023 a été bien remplie, avec plusieurs résidences artistiques, entre autres à Barcelone, et un calendrier d’expositions impressionnant. On peut notamment penser à La ville de Tolédère aime ses enfants, présentée à l’Écart de RouynNoranda et mettant en scène une ville fictive de l’Abitibi-Témiscamingue dans l’univers virtuel.

Suzanne BLAIS
DÉPUTÉE D’ABITIBI-OUEST

L’œuvre achetée par le Conseil des arts du Canada.
On ne peut passer sous silence Morrifaux, où Dominic Lafontaine a généré des œuvres, de connivence avec l’intelligence artificielle, librement inspirées de l’artiste anishinabe Norval Morriseau. L’exposition a d’abord été dévoilée au Centre d’exposition de Val-d’Or puis a voyagé jusqu’à Montréal, au Festival Art Souterrain, en mars dernier. L’œil attentif remarquera des créations de Lafontaine ici et là sur le territoire, par exemple au centre hospitalier de Témiscaming-Kipawa ou à l’aéroport de Val-d’Or. Même le Conseil des arts du Canada a fait l’acquisition de l’une de ses œuvres. En parallèle à la vie artistique, Dominic trouve le temps de s’impliquer. Il fait partie du jury de Conseil des arts du Canada et de celui du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) en plus de participer au comité de sélection de l’Écart et du Rift.
Pour le reste de l’année, Dominic Lafontaine réussira à être présent, autant du côté ontarien, à North Bay et Sudbury, qu’en Abitibi-Témiscamingue. En juin, Val-d’Or l’accueillera avec un autre artiste autochtone, Kevin Lee Burton. La masculinité autochtone, dans un angle humoristique, y sera explorée. À l’automne, c’est en résidence avec Marie-Hélène Massy Émond qu’il se retrouvera à Témiscaming pour explorer l’art sonore. « Je suis booké jusqu’en janvier 2025. On peut dire que je suis artiste à temps plein, avec toute la paperasse que ça implique! » / 819 444 5007 (bureau Amos) 819 339 7707 (bureau La Sarre) suzanne.blais.abou@assnat.qc.ca
Avec cette feuille de route, pas étonnant que le CALQ et le Conseil de la culture de l’AbitibiTémiscamingue lui aient octroyé le prix Artiste de l’année 2023 en Abitibi-Témiscamingue en janvier dernier. Le rythme déferlant se poursuit d’ailleurs en 2024. En janvier, le centre d’art autochtone Daphne à Montréal exposait Wanna Trade Belts? où le wampum s’entremêle à la technologie. « Qu’est-ce qui arrive quand l’ordinateur décide de créer le wampum? Finalement, c’est beau! Je vois ça comme un retour vers un formalisme à travers l’intelligence artificielle », explique Dominic. Son rapport avec l’intelligence artificielle, l’avenir de l’art et la culture autochtone éveille incontestablement la curiosité. À tel point que la Vie des arts lui a demandé un article sur le sujet dans son numéro de l’hiver 2024. « Ça m’a donné l’occasion d’être un essayiste émergent autochtone! », déclare-t-il, un sourire dans la voix.
18 | JUIN 2024 L’INDICE BOHÉMIEN CAHIER PREMIÈRES NATIONS
DOMINIC LAFONTAINE
Au Pow-Wow de Pikogan, qui se tiendra les 8 et 9 juin prochain, tout le monde est bienvenu. L’édition 2024 offrira une course tciman (canot), des danses et des vêtements traditionnels, des kiosques d’artisanat ainsi qu’un feu sacré.
Le grand rassemblement festif de la communauté de Pikogan permettra d’honorer le patrimoine culturel de ses membres, tout en favorisant l’échange et le rapprochement des communautés.

CE NE SONT PAS DES COSTUMES, MAIS DES REGALIA
Le coup d’envoi du Pow-Wow sera donné le vendredi 7 juin, avec une course tciman sur la rivière Harricana, en hommage à la tradition des ancêtres abitibiwinnik. Le samedi, plusieurs danses traditionnelles seront mises à l’honneur. Dans l’optique de favoriser la rencontre et le dialogue entre les communautés, les danseuses et danseurs seront présentés par un animateur. Les personnes non initiées pourront ainsi mieux comprendre les rituels, les significations et les messages transmis par les danseurs à travers leurs mouvements. Cette année, les head dancers (danseuse et danseur vedette) seront Stéphane Mapachee et Annick Wylde, tous deux de Pikogan qui porteront des regalia, des tenues de cérémonie colorées et éclatantes. Le regalia symbolise les identités individuelle et collective, la spiritualité et les convictions de la personne qui le porte. Celle-ci fabrique d’ailleurs sa propre tenue de A à Z.
OSER LA RENCONTRE AU POW-WOW ABITIBIWINNI
LA RÉDACTION
UNE ATMOSPHÈRE IMMERSIVE
Les drummers (joueurs de tambour) Bear Creek ainsi que Crazy Spirit seront mis à l’honneur, avec comme invités spéciaux Heart of the Land, un groupe de tambours de Chisasibi, ainsi que Moosetown. Les battements de tambour symbolisent les battements du cœur de la Terre-Mère. Ils résonneront tout au long des festivités.
Le public pourra également profiter des divers kiosques de nourriture et du grand shapitawan dressé sur le site pour découvrir les mets traditionnels comme le castor, l’outarde et la banick. Des kiosques d’artisanat permettront au public de découvrir des confections uniques et variées.
TOUS ENSEMBLE
Le thème de cette 9e édition, MAMA8i, est évocateur : il signifie « tous ensemble » en langue autochtone, alors qu’un pow-wow vise à rassembler les peuples autochtones et allochtones. L’événement est une main tendue pour cheminer ensemble vers un processus de guérison et de réconciliation.
« Nous souhaitons aussi rendre hommage aux enfants autochtones qui ont été envoyés dans les pensionnats, ainsi qu’aux enfants disparus ou assassinés, peut-on lire sur le site du Conseil de la Première Nation Abitibiwinni. Nos enfants sont le cœur de notre communauté. Ce sont eux qui, comme agents de changement, guideront nos familles, nos communautés et le Canada sur le chemin de la vérité et de la réconciliation. Nous vous invitons à porter un chandail orange lors de ce weekend afin d’exprimer votre soutien à la cause. »

Le Pow-Wow Abitibiwinni se veut un lieu de rencontre incarnant l’esprit communautaire dans sa forme la plus vivante. C’est un espace où la danse et la découverte se mêlent pour donner naissance à une véritable fête, un hymne à la joie et à l’unité qui résonne bien au-delà de ses frontières.


L’INDICE BOHÉMIEN JUIN 2024 | 19 CAHIER PREMIÈRES NATIONS
Carlos Kistabish.
Jeffrey Papatie.
MARIE-FRÉDÉRIQUE FRIGON MARIE-FRÉDÉRIQUE FRIGON MARIE-FRÉDÉRIQUE FRIGON
Patricia Rankin et sa fille Makhena.
En écorce, en perles, sculptés dans du bois ou des os ou encore en aiguille de porc-épic : l’exposition virtuelle Mikisikwaso –Elle coud des perles présente une incursion dans les motifs anicinabek.
Nul besoin de se déplacer pour parcourir ces motifs et les pistes d’interprétation qui ont fait de ceux-ci des œuvres qui se sont répétées et altérées au fil des années et des rencontres entre les différentes nations sur le territoire.
« L’art est imbriqué partout, dans les objets, les outils, les vêtements. On a effectivement constaté que des variations ont été faites au fil des époques et qu’il y a eu une évolution des motifs et des symboles », explique Justin Roy, responsable du projet de bibliothèque virtuelle Nipakanatik. Une partie du travail de M. Roy consiste à effectuer la numérisation des archives de Minwashin.
Le travail sur cette exposition s’est notamment amorcé avec la recherche Patrimoine graphique anicinabe dans les sources écrites anciennes de Guillaume Marcotte, réalisée avec la Corporation Dumulon. « Mais il ne s’agit que de la pointe de l’iceberg, insiste Justin Roy. Il nous manque des informations sur les archives, les dates exactes de ces créations et des artéfacts. Plusieurs outils ont été passés entre générations et les musées n’ont pas toujours les dates exactes de créations des pièces sur lesquelles se retrouvent les motifs. »
Pour le président de Minwashin, Richard Ejinagoji Kistabish, la forme virtuelle de l’exposition Mikisikwaso permet de faire un clin d’œil à l’aspect nomade des Anicinabek qui se
EXPOSITION VIRTUELLE SUR LES MOTIFS ANICINABEK
LISE MILLETTE
déplaçaient de lieu en lieu, comme ce que fait maintenant cette exposition en déplaçant des morceaux de culture.
L’exposition est découpée en quelques tableaux et par matière : motifs d’écorce qui servaient par exemple pour des jouets d’enfants ou comme pochoirs, motifs de piquants de porc-épic portés sur des robes ou des objets du quotidien, motifs perlés pour les mocassins et d’autres vêtements où les fleurs ont été largement répertoriées et finalement, motifs sculptés dans le bois ou les os pour diverses expressions graphiques.

Récipient fait d’écorce de bouleau, de racines d’épinettes et de piquants de porc-épic.


20 | JUIN 2024 L’INDICE BOHÉMIEN CAHIER PREMIÈRES NATIONS
Motif perlé.
MINWASHIN MINWASHIN
EN PARTENARIAT AVEC
TOURISME
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
SERGE BORDELEAU, ALIAS NADAGAM
« Le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue m’inspire énormément, pour toutes sortes de raisons. Il m’est impossible d’observer les cultures, les idéologies et les dynamiques de pouvoir qui se déploient sur ce territoire depuis à peine une centaine d’années, en faisant abstraction des cultures qui y ont fleuri pendant des millénaires. » – Serge Bordeleau
DE LA BIOLOGIE À L’EXPÉRIENCE AUDIOVISUELLE
Natif de Val-d’Or, Serge Bordeleau est biologiste de formation. Il a travaillé dans le domaine de l’environnement aux côtés de plusieurs communautés de la région. Au même moment, il a acquis un grand intérêt pour la production audiovisuelle et les courts métrages. Il a alors entrepris des études de scénarisation et de cinéma à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Son premier documentaire, né d’une collaboration avec la communauté anicinabe, Kitakinan - Notre territoire à tout le monde, a été récompensé à plusieurs reprises. Serge Bordeleau a ensuite fondé Nadagam films, une firme audiovisuelle spécialisée en réalité virtuelle, à l’occasion du projet Abitibi 360. À travers son regard et celui de ses équipes, plusieurs productions ont vu le jour depuis, toutes humaines, universelles et fidèles au territoire.
L’ORIGINE D’UN NOM
« Nadagam signifie au bord de l’eau en anicinabe. C’est le surnom qu’on m’avait donné alors que je travaillais comme biologiste avec la communauté de Kitcisakik. Je n’avais jamais
Au Centre d’exposition d’Amos…
ROSE-AIMÉE BÉLANGER
DU GRÈS AU BRONZE : 40 ANS DE SCULPTURE Musée d’art de Rouyn-Noranda, sous le commissariat de Natalia Zuazua Melón et Jean-Jacques Lachapelle

CATHERINE BESSON
pensé créer une entreprise de production, mais lorsque je me suis trouvé devant l’obligation d’incorporer mon projet de création cinématographique […], ce nom m’a paru naturel et riche de sens, et j’étais fier qu’on me l’ait attribué. »

DE COLLABORATIONS À COPRODUCTIONS
« Je recherche une forme d’authenticité qui esquive à la fois le misérabilisme et le romantisme. »
Il y a quinze ans, le regard médiatique se portait peu sur les Premières Nations; le racisme et l’incompréhension allaient bon train. Porté par l’envie de témoigner de l’expérience positive et enrichissante vécue aux côtés des communautés de Kitcisakik, Pikogan, Timiskaming First Nation et Long
MICRO-MACRO : IMPRESSIONS PHYTOLOGIQUES Marilyse Goulet

Point First Nation, Serge Bordeleau a souhaité répondre à l’ignorance ambiante de l’époque en tournant le documentaire Kitakinan. Plusieurs collaborations avec les premiers peuples, dont certaines avec le Wapikoni et l’Office national du film (ONF), ont suivi. « J’espère humblement avoir pu contribuer à bâtir des ponts entre les cultures, avoir apporté quelques clés pour une meilleure compréhension mutuelle », souligne-t-il. Aujourd’hui, chez Nadagam, deux projets numériques sont en cours impliquant deux porteurs culturels anicinabek. « Je les considère comme des coproducteurs », nous indique-t-il.
PROJET D’ACTUALITÉ
Accompagné d’une équipe chevronnée et d’artistes d’ici, Serge Bordeleau collabore présentement avec Minwashin et Grace Ratt, productrice et porteuse culturelle anicinabe, sur un nouveau projet de réalité augmentée. Cette nouvelle production reprendra les codes du jeu vidéo et permettra de s’initier aux savoir-faire traditionnels autochtones, et plus particulièrement à la transformation de l’orignal en objets d’artisanat. Serge précise à ce propos : « Jamais une application ne pourra remplacer une expérience tactile avec un vrai orignal et une vraie kokom [grand-mère] pour montrer les méthodes de travail. N’empêche, c’est quand même cool de voir des objets culturels anicinabek en 3D, ce qu’on ne verra jamais dans Grand Theft Auto. »
Pour en savoir plus sur Nadagam films, vous pouvez consulter leur site Web.
CIRCUIT PHOTOGRAPHIQUE EXTÉRIEUR
AU SENTIER FOREX
Le CEA se déplace hors de ses murs pour présenter 18 œuvres originales du photographe Del Totof. C’est en utilisant la technique insoupçonnée de micrographie de cristaux chimiques en double polarisation à l’aide du microscope qu’il nous invite à faire un saut dans l’imaginaire de l’infiniment petit.



L’INDICE BOHÉMIEN JUIN 2024 | 21
CAHIER PREMIÈRES NATIONS
© RÊVEUSE , 1999, MARILYSE GOULET © MICRO-MACRO MARILYSE GOULET © TYLENOL + FILTRE 2024, DEL TOTOF 21 JUIN AU 1ER SEPTEMBRE 2024 21 JUIN AU 1ER SEPTEMBRE 2024 FIN JUIN À FIN OCTOBRE 2024
Sans titre, Nagadam Films.
MARIE-RAPHAËLLE LEBLOND
CONNAISSEZ-VOUS
L’HISTOIRE DES VÉTÉRANS AUTOCHTONES?
KELLY POUDRIER, AGENTE DE SOUTIEN AUX UTILISATEURS À LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DU PATRIMOINE DE LA RÉGION DE LA SARRE

Comme la plupart le savent, la Grande Guerre, plus communément appelée la Première Guerre mondiale, a eu lieu de 1914 à 1918. Durant ce conflit, plus de 4 000 autochtones se sont joints à l’Armée canadienne au point où, dans certaines de leurs communautés, tous les hommes entre 20 et 35 ans ont décidé de rejoindre les Forces canadiennes.
LA GRANDE GUERRE
À l’aide de leurs nombreuses compétences acquises grâce à la chasse, soit la patience, la ruse, une visée précise et plus encore, de nombreux soldats autochtones sont devenus tireurs d’élite hors pair ou éclaireurs précieux. Une cinquantaine de ces courageux ont reçu des médailles de bravoure au cours du conflit.
LA DEUXIÈME
GUERRE MONDIALE
La Deuxième Guerre mondiale, quant à elle, s’est déroulée de 1939 à 1945. De nouveau, des milliers d’autochtones (plus de 3 000) ont répondu à l’appel de la patrie et se sont joints à l’Armée canadienne. En tant que soldats, ils ont repris leurs rôles de tireurs d’élite ou d’éclaireurs. Avec ce conflit est apparu un nouveau rôle d’une importance capitale qui a été attribué à des soldats autochtones : transmetteurs en code.
De valeureux autochtones ont traduit, en langue crie, des messages radio qui devaient à tout prix demeurer secrets. De cette façon, les ennemis, qui ne comprenaient pas le cri, ne pouvaient pas découvrir la signification des messages interceptés. Encore une fois, plusieurs soldats autochtones ont reçu des médailles de bravoure. En plus de leur précieuse aide militaire, ces soldats ont grandement participé à l’effort de guerre canadien, par exemple grâce à des dons financiers, en offrant des denrées alimentaires ou des vêtements, en accordant le droit d’utilisation d’une partie de leurs terres par l’Armée canadienne, etc.
LA GUERRE DE CORÉE
La guerre de Corée commença en 1950 pour se terminer en 1953. Encore une fois, de nombreux autochtones rejoignirent les Forces canadiennes. Plusieurs d’entre eux avaient déjà combattu auparavant, particulièrement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Beaucoup de courageux soldats autochtones reprirent leurs anciennes fonctions militaires. Un fait surprenant, surtout à cette époque : un régiment autochtone a reçu la décoration United States Presidential Unit Citation, un honneur généralement réservé aux Forces armées américaines! ET APRÈS…
Des milliers d’autochtones ont servi fidèlement leur pays au cours de ces trois grands conflits. Malheureusement, il n’y a pas eu que du positif pour ces vétérans de retour
LE CENTRE D’ART PRÉSENTE MICHEL SAULNIER
Du 18 avril au 16 juin 2024
CENTRE D’ART

La ruse et le courage du sergent Tommy Prince lui ont valu une douzaine de médailles.
(Musée et archives du PPCLI à Calgary)
chez eux après la guerre. En effet, en plus des nombreux traumatismes vécus pendant les batailles, le gouvernement canadien ne les a pas traités de la même façon que les vétérans non autochtones et ils n’ont pas eu droit à tous les avantages reçus par ceux-ci. Heureusement, ils ont tout de même été honorés de diverses façons : des cuirassés ont été nommés en leurs noms, un monument national a été érigé en leur honneur, des cérémonies du souvenir sont célébrées chaque année, etc.
Près de 12 000 autochtones ont servi au cours des guerres du 20e siècle et plus de 500 d’entre eux y ont perdu la vie. La contribution des autochtones aux grandes guerres est une histoire glorieuse, n’oublions pas de leur rendre hommage. Leur courage a sauvé des milliers de vies!
Pour en apprendre davantage sur le sujet, consultez la section Vétérans autochtones du site sur les vétérans du gouvernement du Canada.


22 | JUIN 2024 L’INDICE BOHÉMIEN
LIEU DE DIFFUSION SPÉCIALISÉ EN MÉTIERS D’ART DE LA SARRE
– HISTOIRE
–
SPÉCIAL PREMIÈRES NATIONS
ÉLISABETH BOUCHARD-BERNIER DANS SON RÔLE DE PASSEUSE CULTURELLE
ELYSE TESSIER-DESLAURIERS
En Abitibi-Témiscamingue, Élisabeth Bouchard-Bernier se distingue comme enseignante de musique à l’école des Explorateurs. Son influence culturelle dépasse même les limites de sa salle de classe pour rayonner au sein de la communauté de Malartic.
Élisabeth Bouchard-Bernier incarne la passion et l’engagement dans le domaine de l’éducation musicale. En tant qu’enseignante à l’école des Explorateurs, elle va au-delà des normes, intégrant la musicothérapie et utilisant la musique comme un outil puissant pour réguler les émotions de ses élèves.
Elle est également la fondatrice de l’Harmonie des Explorateurs, un projet consacré à l’épanouissement musical des jeunes. Son leadership s’étend jusqu’à son rôle de vice-présidente de la Fédération des associations de musiciens éducateurs du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Son dévouement a même été reconnu à l’échelle nationale lorsqu’elle a représenté l’AbitibiTémiscamingue au gala des prix Juno, en compétition pour le titre d’enseignante de musique de l’année au Canada.
LA CULTURE EN ACTION
En tant qu’ambassadrice culturelle au sein du Centre de services scolaire de l’Or-et-des-Bois, Élisabeth Bouchard-Bernier organise chaque année des activités enrichissantes pour les élèves de l’école des Explorateurs. Elle invite régulièrement des artistes, tant locaux que venant d’autres régions. Ces activités offrent aux élèves l’occasion de s’ouvrir sur le monde qui les entoure.
L’enseignante reconnaît que cette partie de son travail demande beaucoup d’organisation, mais elle souligne avec satisfaction que les élèves en retirent énormément de bonheur. « Les élèves sont tellement heureux après ça. Ça leur donne des rêves. Pour certains, ça allume des étincelles. » Cela contribue ainsi à nourrir l’imaginaire et les ambitions des jeunes.
L’ÉDUCATION PAR LA MUSIQUE
Dans son métier, Élisabeth trouve une grande satisfaction dans son rôle de passeuse culturelle. À travers la musique, elle saisit les nuances de la société et les communique à ses élèves, stimulant ainsi des discussions enrichissantes. Ainsi, au décès de Karl Trembley, le chanteur des Cowboys Fringants, elle a su utiliser cet événement pour ouvrir un dialogue sur le sujet, transformant presque toute une période en une exploration de son univers musical.
Les activités de groupe qu’elle organise permettent à certains de ses élèves de découvrir des émotions jamais ressenties auparavant à travers la musique. C’est un échange constant entre elle et ses élèves, où chacun apprend de l’autre. Selon l’enseignante, « c’est un partage, autant de moi vers eux que d’eux vers moi. Parce qu’ils m’apprennent des choses, eux aussi ».
L’HARMONIE COMMUNAUTAIRE CROISSANTE
Au cours de l’année à venir, Elisabeth aspire à intensifier son engagement communautaire à Malartic. Après avoir dirigé la chorale au sein du IGA et orchestré des concerts de Noël pendant les deux dernières saisons festives, elle envisage d’élargir ses collaborations, que ce soit avec l’harmonie, ou avec ses classes. Son objectif est de créer des liens plus étroits entre l’école et la communauté.


L’INDICE BOHÉMIEN JUIN 2024 | 23 – MUSIQUE –
ÉLISABETH BOUCHARD-BERNIER
LES BARRAGES HYDROÉLECTRIQUES : DES LEGS D’UNE AUTRE ÉPOQUE?
BIANCA BÉDARD, GÉOGRAPHE, DIRECTRICE GÉNÉRALE DU CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (CREAT)

Il y a 50 ans, des dizaines de milliers de Québécoises et Québécois étaient impliqués, directement ou indirectement, dans le « projet du siècle », la construction du complexe La Grande.
Il s’agissait d’une idée visionnaire de Robert Bourrassa, alors qu’on appréhendait une rupture de service en pointe hivernale dix ans plus tard, si aucun nouveau projet énergétique ne voyait le jour au Québec. C’est donc loin des regards, à plus d’un millier de kilomètres de Montréal que les travaux se sont amorcés pour harnacher la Grande Rivière, une majestueuse rivière sauvage, sans que les Premières Nations qui occupaient le territoire n’aient été dûment consultées… et sans non plus avoir préalablement réalisé des études d’impacts sur l’environnement.
Après près de quatre ans de démêlés juridiques, les Cris et les Inuits consentent à signer la Convention de la BaieJames et du Nord québécois. À la suite de la signature de l’entente, un vaste inventaire environnemental et social est entrepris afin d’acquérir des connaissances sur la faune, la flore, les écosystèmes et le mode de vie des personnes qui y vivent afin de limiter les impacts du projet.
Un demi-siècle plus tard, Hydro-Québec est chef de file mondial de l’hydroélectricité et des grands réseaux électriques, alors que 94 % de l’électricité au Québec provient de ressources hydroélectriques. Aujourd’hui, la société d’État fait face à un défi similaire à il y a 50 ans. Toutefois, la vision actuelle ne semble plus être tournée vers le développement de nouveaux barrages hydroélectriques. D’ailleurs, aucun des projets hydroélectriques énoncés n’a obtenu l’acceptabilité sociale du milieu. Cette tendance

s’observe aussi chez nos voisins de l’ouest et du sud. On dénonce les impacts des dizaines de milliers de barrages construits dans une certaine frénésie, qui bloquent la migration des poissons, nuisent au flux de sédimentation naturelle des rivières et modifient les écosystèmes.
Il y a un clin d’œil évidemment à faire ici avec le projet Onimiki. Récemment modifié, le projet dans sa forme actuelle comporte deux petites centrales hydroélectriques. La centrale Onimiki Nord, ressemblant fortement au projet Tabaret, menace directement l’intégrité écologique du parc national Opémican alors que le projet prévoit détourner les deux tiers du débit de la rivière Kipawa pour alimenter les turbines. Selon les débits projetés, le débit de la rivière Kipawa sera plus bas que son plus faible débit en saison estivale, et ce, près de la moitié de l’année. Quelles sont les répercussions appréhendées sur l’écosystème de la rivière

Kipawa? Aucune idée pour l’instant, selon les promoteurs. Bien que le projet soit petit, la puissance étant estimée à 70 MWH environ, ses impacts ne seraient pas négligeables.
Pourtant, il y a près de trente ans, Hydro-Québec abandonnait le projet Tabaret, faute d’acceptabilité sociale. Près d’une décennie plus tard, les municipalités de Kipawa, de Laniel et de Témiscamingue ainsi que les communautés autochtones vivant autour du lac Kipawa demandaient au gouvernement la nomination d’un médiateur dans le dossier Tabaret, considérant que le projet ne respectait pas l’environnement. Les préoccupations majeures ont mené à la création du parc national Opémican, dans l’optique de bloquer tout éventuel projet industriel dans ce secteur. Aujourd’hui, deux communautés autochtones s’étant jadis opposées au projet Tabaret font partie des promoteurs du projet Onimiki.
L’évolution de notre attitude nationale a changé depuis la fierté des grands barrages comme merveilles d’ingénierie. Aujourd’hui, il y a certainement une prise de conscience croissante que notre propre avenir est lié à la conservation des richesses humides et hydriques, à la vie et à la santé des rivières à l’état sauvage. Le développement énergétique du Québec doit se faire en harmonie avec la volonté des occupantes et occupants des territoires.
24 | JUIN 2024 L’INDICE BOHÉMIEN – ENVIRONNEMENT –
HUGO LACROIX
DES EXPÉRIENCES DE TOURISME AUTOCHTONE

Quand les Européens foulent la terre aujourd’hui connue sous le nom d’AbitibiTémiscamingue, le peuple anicinabe s’y trouve déjà depuis plus de 8 000 ans. À l’époque, les Timiskaming et les Abitibi se côtoient, partageant leurs techniques de chasse, leurs croyances, leurs connaissances des plantes médicinales et la dureté de l’hiver.
Les deux nations autochtones voient ensuite s’installer les Canadiens français et les aident à braver le froid ainsi que la maladie en plus de les guider dans les immenses forêts sauvages. Canadiens français et Anicinabek s’imprègnent les uns des autres, créant ainsi l’identité témiscabitibienne à travers une influence mutuelle. Pour en connaître plus sur les Premiers peuples de l’Abitibi-Témiscamingue, voici des expériences touristiques inspirantes.
Anisipi – à la découverte de l’eau
Anisipi, un grand spectacle lumineux et interactif, comporte trois différents arrêts principaux, dont le Tipi à Pikogan. Cette création est une collaboration entre Tourisme Amos-Harricana, la communauté Abitibiwinni de Pikogan et Moment Factory. Au Tipi, dans une expérience de projection vidéo, de son et de lumière, les Anicinapek racontent leur vision du monde. On y découvre un univers où les animaux sont

considérés comme des frères, où les humains occupent une place modeste et où l’équilibre fragile de la nature serait maintenu. Les visages de la communauté de Pikogan animent le Tipi. Pour vivre l’expérience, il suffit de s’asseoir dans le grand cercle. On y écoute les réflexions de ce peuple qui arpente ce territoire depuis des millénaires grâce à Nanika, aujourd’hui connue sous le nom d’Harricana.
Fort Obadjiwan-Témiscamingue
Il y a plus de trois siècles, soit en 1720, les autorités de la Nouvelle-France permettent l’établissement d’un premier poste de traite sur le site actuel du Fort Obadjiwan-Témiscamingue. Puis, 177 ans après la construction du fort, VilleMarie voit le jour. Au-delà du fort, on compte maintenant près de six millénaires de présence autochtone sur les lieux! Avec l’aide d’un guide, il est possible de faire un saut dans le temps pour connaître le théâtre de rivalités commerciales entre des marchands de fourrures pendant 200 ans. Karl Chevrier y passe également l’été pour y enseigner la construction du canot d’écorce, dans les règles ancestrales de l’art.
Abitibiwinni : l’expérience algonquine
Découvrez comment se conservent et se transmettent le savoir, les croyances et l’amour du territoire des communautés algonquines, dont celles de Pikogan. En ce sens, dans la communauté des Abitibiwinni, il est possible


de voir une exposition qui relate l’histoire de ce peuple. L’exposition présente une occupation millénaire qui a laissé des empreintes sur un vaste territoire. L’église de Pikogan, en forme de tipi, ainsi que la boutique d’artisanat sont deux incontournables de cette visite.
Skydreamer Studio – Le studio de création de Frank Polson
Frank Polson est un artiste multidisciplinaire originaire de la communauté de Long Point First Nation, à Winneway, dans le Témiscamingue. Ses œuvres sont vendues aux quatre coins du monde et sont exposées partout au Canada. Depuis les 25 dernières années, il peint dans le style Woodland, un style qu’il a développé afin que sa touche moderne respecte la tradition. Cet été, il sera possible de visiter son studio de création dans un contexte intime. Pour vivre cette immersion, il est important de téléphoner au studio afin de planifier votre visite. Pour réserver : 819 722-2054.
Pour en connaître plus sur les expériences touristiques de l’Abitibi-Témiscamingue, plusieurs outils sont à votre disposition. Le guide, avec la carte qu’il comprend, et le site Web sont des références comportant les renseignements essentiels. Avec ces outils, planifiez une aventure inoubliable dans notre région!

L’INDICE BOHÉMIEN JUIN 2024 | 25
VISITER NOTRE BLOGUE : ABITIBI-TEMISCAMINGUE.ORG
EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
TOURISME
PHOTOS MOMENT FACTORY, LOUIS JALBERT, NOMADEMARIE-PIER LEDUC, SKYDREAMER STUDIO ANISIPI – LE TIPI. UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE SIGNÉE MOMENT FACTORY ABITIBIWINNI : L’EXPÉRIENCE ALGONQUINE SKYDREAMER STUDIO LIEU HISTORIQUE NATIONAL D’OBADJIWAN–FORT-TÉMISCAMINGUE PUBLIREPORTAGE
PAR CLAUDINE GAGNÉ
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

26 | JUIN 2024 L’INDICE BOHÉMIEN
« CHÈRE EMAO, C’EST À TON TOUR… »
KATHLEEN BOUCHARD
L’automne prochain, l’École de musique d’Abitibi-Ouest (EMAO), située à La Sarre, soulignera en grand sa 40e année d’existence. Pour cet événement remarquable, plusieurs activités seront proposées aux étudiantes et étudiants, présents et anciens, ainsi qu’à toute la population des environs.

UN PEU D’HISTOIRE
C’est en 1984 que naissait l’EMAO. Il aura fallu la détermination d’une femme de cœur pour mener à terme ce long processus, soit la mise sur pied d’une école de musique reconnue par le ministère de l’Enseignement. L’instigatrice de ce projet est la regrettée Liliane Perreault que la Ville de La Sarre a décidé d’honorer, en 2018, en renommant sa salle de spectacle intimiste Théâtre Liliane-Perreault.
QUARANTE ANS PLUS TARD
Delphine Morissette est dorénavant à la barre de cet organisme et son mandat est de le faire grandir. Elle a succédé à Jacques Aumond qui a longtemps dirigé l’EMAO. Son rôle est de s’assurer que les locaux soient remplis de musiciennes et musiciens heureux et de dénicher du personnel enseignant compétent. Le but? Promouvoir la musique. Notons que l’EMAO compte une centaine d’élèves actifs qui apprennent le piano, le chant, la guitare, le violon et bien d’autres instruments. Les cours offerts dépendent vraiment des besoins des élèves. « Quand quelqu’un désire apprendre à jouer d’un instrument à vent, par exemple, je cogne aux bonnes portes afin d’offrir le service! » confie-t-elle avec le sourire. C’est également elle qui est responsable des activités visant à souligner cet heureux anniversaire.
LES ACTIVITÉS À VENIR
Le cadeau d’anniversaire sera offert les 18 et 19 octobre prochain. Notons que tout le monde aura l’occasion de profiter de cette fête puisque les événements seront gratuits pour les membres de l’école de musique et ouverts au public moyennant une faible contribution. Primeur : le tout commencera le vendredi 18 octobre par la présentation d’un concert mettant en vedette Lydie Moreau, une grande pianiste possédant un doctorat en interprétation du piano classique, et native de La Sarre. Le public aura l’occasion d’entendre celle qui a fréquenté l’EMAO à ses débuts. Vous découvrirez ainsi son album, Estampes boréales, qui regroupe ses compositions.
Le lendemain, les élèves auront la chance de pouvoir participer à des classes de maitres données par des artistes de la région et d’ailleurs. Côtoyer des professionnels fera grandir ces musiciennes et musiciens en apprentissage. Cette incroyable journée se terminera par une représentation où les maitres et d’autres invités partageront la scène.
UNE EXCLUSIVITÉ
Une place sera faite pour nos artistes locaux puisque vous aurez la chance d’écouter le groupe de style punk rock francophone abitibien, Maniaque, ainsi que Legion of Decadence, qui vient de lancer un album. Les élèves entendront donc d’anciens professeurs et verront des visages connus, dont celui de leur directrice, Mme Morissette, entre autres, et de l’enseignant de percussion (batterie) Michael Dupuis-Souligny.
L’EMAO a le vent dans les voiles. La période d’inscription étant ouverte, n’hésitez pas à vous joindre à cette grande famille. Vous rencontrerez des gens passionnés, vous ferez des apprentissages qui vous suivront dans toutes les sphères de votre vie et, surtout, vous créerez de solides amitiés!
« Chère EMAO, c’est à ton tour de te laisser parler d’amour! »

L’INDICE BOHÉMIEN JUIN 2024 27
– MUSIQUE –
JACQUES GAUMOND


28 | JUIN 2024 L’INDICE BOHÉMIEN PUBLIREPORTAGE
INGRÉDIENTS (POUR 4 PORTIONS)
4 unités
400 g (14 oz)
200 g (7 oz)
100 g (3,5 oz)
60 ml (2 c. à soupe)
– MA RÉGION, J’EN MANGE –
FEUILLETÉ DE BROCHET ET DORÉ, RAGOUT DE MORILLE ET TOPINAMBOURS
MICHEL GAGNON, CHEF ARTISAN (VAL-D’OR)
Feuilletés cuits
Filet de doré
Topinambours
Morilles fraîches
Vin blanc
1 Échalote française hachée
200 ml (3/4 de tasse et 2 c. à thé)
Quantité suffisante
QUENELLES DE BROCHET
350 g (12 oz)
30 g (2 c. à soupe)
Fumet de poisson
Huile d’olive

Brochet
Beurre salé ramolli
3 Œufs (2 blancs et 1 entier)
350 ml (1 tasse et ½ + 1 c. à soupe + 2 c. à thé) Crème 35 % Sel et Poivre
GARNITURE
Ciboulette fraîche et cerfeuil
MÉTHODE
1. Dans un robot culinaire, broyer la chair de brochet, ajouter 15 g (1 c. à soupe) de beurre. Broyer de nouveau la chair, puis ajouter les deux blancs d’œufs et finir avec le l’œuf entier. Ajouter 200 ml (¾ de tasse et 2 c. à thé) de crème 35 %. Saler et poivrer au goût. L’appareil de brochet doit être lisse et avoir l’apparence d’une mousse crémeuse. Garder au froid.
2. Blanchir les topinambours 4 à 5 minutes dans l’eau salée, puis les peler et les couper en quatre. Réserver.
3. Tremper les morilles fraîches dans le vin blanc. Réserver.
4. Façonner la mousse de brochet en forme de quenelles d’environ 85 g chacune. Les pocher dans le fumet de poisson de 5 à 8 minutes. Retirer les quenelles du fumet et les déposer sur un papier absorbant. Réserver.
5. Couper le filet de doré en quatre parties égales. Dans un poêlon, bien colorer les deux côtés du filet de doré dans l’huile d’olive. Retirer le doré du poêlon et réserver.
6. Dans le même poêlon, ajouter un peu d’huile d’olive et faire suer les échalotes françaises. Ajouter les topinambours et les morilles, puis déglacer avec le vin blanc du trempage des morilles. Ajouter le fumet de poisson puis 150 ml (1/2 tasse, 1 c. à soupe et 2 c. à thé) de crème 35 % et laisser réduire quelques minutes. Finir avec 15 g (1 c. à soupe) de beurre et bien fouetter.
7. Dresser l’assiette. Couper les feuilletés en deux, prendre la partie du dessous du feuilleté et le déposer dans le fond de l’assiette. Déposer une quenelle de brochet et napper de sauce morille et topinambour. Ajouter le filet de doré et finir avec la garniture pour servir.
Cette recette est inspirée du chef Marcel Kretz de l’hôtel La Sapinière de Val-David, grand amateur de pêche, de champignons sauvages, de légumes et de fines herbes qui lui rappelaient son enfance. M. Kretz a grandement contribué à former et à inspirer des cuisiniers de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et de tout le Québec.


L’INDICE BOHÉMIEN JUIN 2024 | 29
CHRISTIAN LEDUC
YVES MOREAU




30 | JUIN 2024 L’INDICE BOHÉMIEN
CINÉMA
Amos vous raconte : les coulisses
14 juin, Centre communautaire de Lebel-sur-Quévillon
DANSE
Minuit quelque part
4 juin, Théâtre Télébec (Val-d’Or)
La cité de la danse – TV SHOW 8 juin, Théâtre Télébec (Val-d’Or)
La cité de la danse – Spectacle de fin d’année 9 juin, Théâtre des Eskers (Amos)
EXPOSITIONS
Zeineb Siala – L’envers des jardins Jusqu’au 2 juin, L’Écart (Rouyn-Noranda)
Leyla Majeri – Fields of Iores Jusqu’au 2 juin, L’Écart (Rouyn-Noranda)
Ludovic Boney – NSPSLL!
Jusqu’au 2 juin, L’Écart (Rouyn-Noranda)
Sons mêlés : une exploration sonore au cœur d’Haïti 7 juin au 6 octobre, MA Musée d’art (Rouyn-Noranda)
IVANOVSTOEVA – Evolving Nature
Jusqu’au 9 juin, Centre d’exposition d’Amos
Société des arts Harricana – Passager
Jusqu’au 9 juin, Centre d’exposition d’Amos
Olivier Moisan Dufour – Construction multicolore
Jusqu’au 9 juin, VOART Centre d’exposition de Val-d’Or
Olivier Moisan Dufour – La démarche
Jusqu’au 9 juin, VOART Centre d’exposition de Val-d’Or
CALENDRIER CULTUREL
CONSEIL DE LA CULTURE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Quoi de neuf sous notre toit
Jusqu’au 30 août
Société d’histoire et du patrimoine de la région de La Sarre
Sous la lumière du Nord (exposition permanente)
Jusqu’au 2 février 2029, MA Musée d’art (Rouyn-Noranda)
HUMOUR
Christine Morency – Grâce 1er juin, Théâtre du Rift (Ville-Marie)
Emmanuel Bilodeau – Manu Bilodeau dans le pétrin
5 juin, Théâtre du cuivre (Rouyn-Noranda)
6 juin, Théâtre Télébec (Val-d’Or)
Festival d’humour émergent en Abitibi-Témiscamingue du 26 au 30 juin, Rouyn-Noranda
MUSIQUE
Festival des Guitares du Monde en Abitibi-Témiscamingue 25 mai au 1er juin, Rouyn-Noranda
Rafael Payare à la rencontre des conservatoires 2 juin, Théâtre Télébec (Val-d’Or)
Centre Musical en Sol Mineur – Concert de fin d’année 2 juin, Théâtre du cuivre (Rouyn-Noranda)
Harmonie Le Tremplin de Malartic – Mission Terre
7 juin, Théâtre Meglab (Malartic)
Orchestre de la Bande sonore de Rouyn-Noranda
BELLEZZE DELL’ITALIA
8 juin, Agora des Arts (Rouyn-Noranda)
Chorale En sol mineur – Du bonheur à emporter
13 juin, Théâtre du cuivre (Rouyn-Noranda)
Beatles Studio, revue musicale 14 juin, salle Dottori (Témiscaming)
Orchestre à vent de la Vallée-de-l’Or Rhapsodies américaines
14 juin, Théâtre Télébec (Val-d’Or)
Rock’N Bulls 2024
20 juin, Parc équestre Desjardins-Hecla Québec (La Sarre)
DIVERS
Samedis en folie
Fabrication d’objets décoratifs au crayon 3D
1er juin, Bibliothèque municipale d’Amos
Espace techno
4 et 11 juin, Bibliothèque municipale d’Amos
Les lunchs à gogo
6 juin, Agora des Arts (Rouyn-Noranda)
Vino pinceaux
7 juin, Centre d’exposition du Rift (Ville-Marie)
Pow-Wow Abitibiwinni
8 et 9 juin, Pikogan
Tous les géants sont petits!
9 juin, Théâtre du cuivre (Rouyn-Noranda)
Atelier de pyrogravure
15 juin, Centre d’exposition du Rift (Ville-Marie)
Fuel Junkie
15 juin, Bar Bistro L’Entracte (Val-d’Or)
Festival équestre et rodéo professionnel
19 au 23 juin, La Sarre
Pour qu’il soit fait mention de votre événement dans le prochain numéro de L’Indice bohémien, vous devez l’inscrire vous-même, avant le 20 du mois, à partir du site Web du CCAT au ccat.qc.ca/vitrine/calendrier-culturel. L’Indice bohémien n’est pas responsable des erreurs ou des omissions d’inscription.
L’INDICE BOHÉMIEN JUIN 2024 | 31
32 | JUIN 2024 L’INDICE BOHÉMIEN VENEZ CÉLÉBRER LE 15E ANNIVERSAIRE DE 19 SEPTEMBRE 2024 OUVERT À TOUTES ET À TOUS
dévoilés
de
Salle Paramount 15, rue Gamble Ouest, Rouyn-Noranda Les détails de la soirée seront
dans le numéro
juillet-août
Information : direction@indicebohemien.org