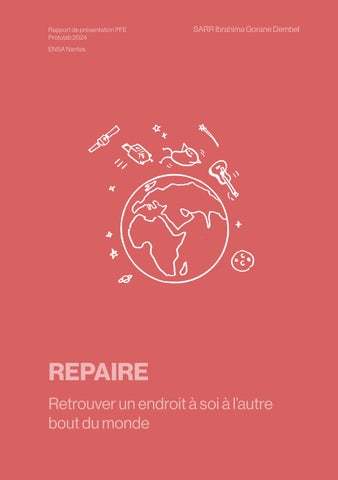Mon parcours et mes motivations
1.1. Une scolarité à l’international
Je suis né et j’ai grandi au Sénégal, où en 2018, après avoir obtenu mon baccalauréat scientifique, j’entame des études d’architecture au Collège Universitaire d’Architecture de Dakar (CUAD). C’est là le début d’une aventure qui m’a ensuite mené à Paris, à Maurice et enfin à Nantes.
Mes six années en tant qu’étudiant en architecture m’ont amené au studio Protolab, qui représente le point d’aboutissement de ce parcours, et quelque part, le début d’une nouvelle aventure. Je pense que cela fait beaucoup sens.
En effet, j’ai toujours eu une affection particulière pour la construction, le bricolage, et le détail. J’ai toujours eu un besoin viscéral de comprendre comment sont faites les choses. Petit, je m’amusais souvent à démonter et à remonter (parfois sans succès) mes jouets et autres objets qui me tombaient sous la main … Il me paraît donc logique de faire ce studio on ne peut plus pratique, dans lequel la construction est reine. Protolab me permet de nourrir ma curiosité, de réfléchir à des systèmes constructifs et à des assemblages, et de peaufiner le projet dans ses détails les plus infimes. Tout ce que j’aime, en somme.
Frise chronologique de mon parcours
Les endroits visités au cours de mes études: Sénégal, Paris, Nantes, Maurice, Seychelles
Mes études en architecture ont été ponctuées de passages plus ou moins longs dans le monde du travail, et lors de ces épisodes, j’ai eu la chance de me voir confier des projets bien réels, dont certains sont aujourd’hui construits. Protolab n’est donc pas la première fois que je dessine un projet voué à être réalisé. La différence est que dans ce studio, je suis à la fois concepteur et constructeur. Il n’y a donc aucun intermédiaire. Les projets REPERE, et plus tard REPAIRE, sur lesquels je travaille pendant ce studio représentent également pour moi une opportunité de réfléchir sur des problématiques qui me passionnent, et que j’ai eu à développer dans des studios précédents, notamment Muter Habiter Penser (MHP).
Mon parcours étudiant est sans nulle doute marqué par les différents voyages qu’il m’a été donné de faire. Lors de ceux-ci, j’ai vécu seul, et toujours dans des logements étudiants. Au fil des séjours, je me suis rendu compte que les choses n’étaient pas partout pareilles.
1.2. Paris 2020 : Découverte des logements étudiants
Au cours de ma deuxième année de licence à Dakar, j’apprends que le CUAD a été créé par 3 architectes sénégalais, sans concertation préalable avec l’Ordre des Architectes. Ainsi, la formation offerte par le CUAD, bien qu’ agréée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, n’est pas reconnue par l’Ordre des Architectes du Sénégal. Il me faut donc trouver un autre établissement où obtenir mon diplôme si je veux un jour exercer en tant qu’architecte dans mon pays.
En 2020, dans le cadre d’un workshop organisé entre le CUAD et l’ENSA Paris - La Villette (ENSAPLV), j’ai eu l’opportunité d’effectuer une mobilité au Semestre 4. Ainsi, en Février je fais mes bagages, je dis au revoir à tout le monde, et je m’envole pour Paris. C’est pour moi l’occasion de voir ce à quoi peut ressembler l’éducation à l’architecture en France.
C’est alors ma première fois aussi loin de ma famille et de mes amis. Je me souviens encore de mon arrivée dans un hôtel du XXe arrondissement, car mon studio au Crous n’était pas encore disponible. Je me rappelle que j’étais mort de froid, et complètement désorienté.
Deux jours après mon arrivée, j’ai rendez-vous avec le service international de l’ENSAPLV, et ils m’installent dans un studio de 20m², tout près de l’école, au 25 Rue de l’Argonne (dans le XIXe arrondissement de Paris). Je découvre une résidence assez neuve, de cinq étages. On m’indique la laverie, la salle commune, et les restaurants et services à proximité. Je suis maintenant chez moi pour les six mois à venir.
La salle commune est située au rez-de-chaussée, près de l’entrée. Elle donne sur la rue. Il y a des tables, des chaises, et un micro-ondes, mais je remarque qu’elle est presque tout le temps vide. Je pense que sur les six mois de mon séjour, je n’y ai rencontré qu’une ou deux personnes.
Je prends très vite mes marques et je note dans mon studio quelques détails qui attirent mon attention:
• La disposition : La kitchenette sépare la chambre de l’entrée, d’où on accède à la salle de bain. le bloc kitchenette est percé, mais j’ai l’impression que ma chambre est clairement délimitée. Cette kitchenette forme quasiment un îlot, et côté chambre, il y a un comptoir et un tabouret de bar, où je mangeais. J’ai trouvé cet arrangement très efficace.
• Les rangements : Il y en avait partout ! au-dessus de la kitchenette, sur toute la longueur du passage, sous le lit, au-dessus du lit. Même les tables d’appoint étaient des blocs évidés, dont le haut s’ouvrait et permettait de ranger des affaires.
La salle commune. Source : Agnès Cantin Architecture. ©Takuji Shimmura.
• La fenêtre : Il n’y avait pas de réel balcon, mais un garde corps fixé à la fenêtre permettait de profiter de l’épaisseur de la façade. La fenêtre était grande, et à deux vantaux, un grand et un petit. Le petit ouvrait sur un parallélépipède en métal perforé, qui permettait d’étendre du linge, sans qu’il soit visible de l’extérieur, ou tout simplement d’aérer la chambre sans avoir besoin d’ouvrir la fenêtre. Très ingénieux système, selon moi.
Je me plais dans ma chambre, ce n’est pas là le souci. J’ai tout ce qu’il me faut chez moi, et étant casanier, j’ai tendance à ne sortir qu’en cas de nécessité. Je ne croise quasiment personne dans les couloirs de la résidence, ou dans la salle commune, et je commence à me demander si j’ai réellement des voisins … Quelques jours après, je rencontre un étudiant en médecine qui m’explique que la résidence a un groupe Facebook et il m’envoie un lien pour le rejoindre. J’ai réussi à me faire quelques amis.
En Mars, arrive le confinement, et à certains moments, je me sens un peu isolé. Je n’ai plus la visite de mes amis. Ma chambre n’est pas très grande, pourtant j’y suis à l’aise, je trouve la surface confortable. La résidence, qui selon moi ne connaissait pas beaucoup de mouvements, s’est complètement éteinte. A la sortie du confinement, les choses n’ont pas vraiment changé. Je garde le souvenir d’une résidence très calme, à l’ambiance un peu stérile, et je suis rentré à Dakar un peu comme j’en étais parti, sans m’être fait beaucoup de nouveaux amis.
1.3. L’alternative SLR
Nous sommes en 2022, j’ai fini ma licence au CUAD, et je dois impérativement changer d’école pour le master. A cette période, je travaille à Art Ingénierie, une agence d’architecture sise au centre-ville de Dakar.
Dans mes recherches de l’établissement où terminer mes études, je fais le tour de mes contacts, et je parle notamment à Babacar NDIAYE, un ami, que j’ai côtoyé au CUAD. Il me parle de l’ENSA Nantes [Mauritius], et me la vend plutôt bien : l’établissement se trouve à l’ile Maurice, petit paradis de l’Océan Indien, pays rattaché au continent africain, et est un campus satellite de l’ENSA Nantes, école française. Babacar s’apprête alors à déménager de Maurice à Nantes, où il obtiendrait son diplôme.
Je me laisse convaincre, et m’embarque dans une nouvelle aventure. Comme dans ma première expérience parisienne, j’emménage dans
une résidence étudiante, du nom de Student Life Residences (SLR). La résidence est située sur la route de Flic en Flac, petite ville côtière de l’ouest de Maurice. Elle fait partie du projet immobilier Uniciti, à l’initiative de MEDINE, acteur très puissant de la région. Le projet comprend également un complexe sportif, le SPARC, le centre commercial Cascavelle, et le campus Uniciti, où se trouve l’ENSA Nantes [Mauritius] où j’étudiais.
Je découvre un grand campus, avec un total de 10 blocs de logement, un lounge pour les résidents, plusieurs cuisines partagées, une buanderie et des espaces extérieurs. La résidence est adjacente à un parc et des chemins piétons la relient au SPARC et au centre commercial Cascavelle. Son enceinte est délimitée par une clôture métallique, et l’accès est contrôlé, il y a un poste de garde à l’entrée.
Je suis accueilli par une équipe d’étudiants référents qui me font la visite guidée, et je commence tout de suite à faire des connaissances. Tous les étudiant.e.s rencontré.e.s dans les parties communes se présentent, et me souhaitent la bienvenue. Ils viennent de partout dans le monde, et sont pour la plupart étudiants à l’université de Middlesex qui fait face à SLR.
Ma chambre est au premier étage du bloc 8. J’ai 7 voisins de palier avec qui je partage deux salles de bain, et deux réfrigérateurs. Je m’attends à ce que la cohabitation soit tendue, mais à ma grande surprise, je m’entends très bien avec mes voisins de palier, ou “floormates” comme je les appelais, car nous n’avons pas du tout les mêmes horaires, et lorsque nous nous croisons, les rencontres sont assez sympathiques. Le nettoyage est assuré quotidiennement par les agents de la résidence, et cela contribue à rendre la cohabitation plus aisée. Je finis même par me lier d’amitié avec le personnel de service, que je vois souvent.
L’expérience est radicalement différente de mon séjour au Crous à Paris, en cela qu’elle a été d’emblée beaucoup plus sociale. Je pense que l’organisation même de la résidence contribue à faciliter les interactions. Je remarque plusieurs choix intéressants:
• Les passerelles reliant les blocs sont en béton, et le garde-corps est incrusté dans un élément moulé en forme de banc, qui file le long de la passerelle. Ainsi, un élément de distribution devient un espace social, et les vues à ces endroits sont agréables.
Passerelle reliant deux blocs. Photographie par Nauras AHMED
• Le choix de ne mettre que des cuisines partagées permet aux résidents de se retrouver au moment de la préparation, et du repas dans le lounge. Je me souviens de beaucoup de conversations, de partage de recettes et de rires aux éclats. Cependant, il faut reconnaître que les interactions étaient parfois subies, mais les cuisines étaient en nombre suffisant pour faire face à la demande. Dans les moments où je ne me sentais pas d’humeur, mon casque audio à réduction de bruit a été d’un grand secours.
ALLY
• La disposition des services à différents endroits du campus oblige à circuler dans la résidence, et quand bien même cela peut être contraignant, notamment en cas d’intempéries, cela contribue à créer du passage.
• Le fait que la résidence soit sécurisée inspire confiance, et donne aux résidents la possibilité d’évoluer dans un “extérieur” bien à eux, coupé du reste du monde et de ses potentielles nuisances, même si le coin était vraiment très calme. Ces extérieurs sont investis à toutes heures et grouillent de vie.
• Les services à proximité de la résidence (SPARC et Cascavelle) deviennent presque des extensions de la résidence, l’on y rencontre ses amis, et ils deviennent la destination du week-end et des jours fériés.
A la fin de mon séjour de près d’un an, je me suis réellement intégré au sein de la communauté SLR, et je me suis fait plein d’amis que je garde encore à ce jour. Vivre en communauté de la sorte m’a permis de m’épanouir, et je peux dire que cette année a été des plus sympathiques.
1.4. L’aventure nantaise
L’année d’après, c’est le départ pour Nantes, où s’achève mon cursus. Je quitte (non sans peine) l’île Maurice, pour m’installer sur l’île de Nantes. Ayant déjà séjourné en France, je sais à peu près à quoi m’attendre. Pourtant, ce fut quand même un choc pour moi. Je me suis habitué au calme et à l’omniprésence de la nature à Maurice, et à Nantes, j’ai l’impression de me retrouver dans une jungle de béton. Je retrouve mon ami Babacar, qui me fait visiter le centre, Bouffay et Commerce. Je dois avouer qu’à ce moment, ça va un peu trop vite pour moi.
Je réside à la résidence Ile de Nantes du Crous, non loin de l’école. Cette résidence me rappelle tout de suite celle que j’ai connu à Paris, sauf qu’elle est beaucoup moins récente. Une différence notable est que cette résidence n’a pas de salle commune. La disposition de la chambre est à peu près similaire à celle de Paris, mais je la trouve moins astucieuse et beaucoup plus conventionnelle. Pas de balconnet, mais une simple fenêtre, et un mobilier en bois rouge, que je trouve vieillissant. J’ai tout de même réussi à m’aménager un petit chez moi douillet!
Là aussi, en dehors d’un groupe WhatsApp, servant surtout aux résidents à râler à propos des sèche-linge qui ne fonctionnent jamais, il n’y a pas trop de mouvement. Je rencontre fortuitement quelques personnes dans l’ascenseur, ou dans la laverie, avec qui j’ai des passions en commun, et c’est de cette façon que j’arrive à me faire des amis.
Cependant, le Crous organise souvent des activités pour les 3 résidences de l’île de Nantes (O’slow, Corbilo et Île de Nantes). La résidence O’slow est dotée d’un foyer, où se tiennent les rencontres. Cela a été pour moi un moyen de décompresser, et surtout de rencontrer mes voisins.
Pour moi, le constat est sans appel, il est très important de prévoir des espaces de socialisation, et de créer une gradation de différents seuils d’intimité au sein des résidences étudiantes. Cela est à mon sens indispensable à l’épanouissement des jeunes.
Photographie de ma chambre
Au semestre d’automne, je choisis le studio Muter Habiter Penser, animé par Romain ROUSSEAU et Marie TESSON. Le studio nous invite à choisir librement une problématique à traiter, et le site de projet est le quartier de Nantes Sud. Le semestre démarre par une production de texte et des séances de brainstorming. Dès le début, je commence un peu instinctivement à m’orienter sur le thème du “commun”.
Ensuite, nous entreprenons un voyage, durant lequel nous commençons par nous rendre à Saint-Etienne, puis en région parisienne. Je suis à l’affût de tout ce qui contribuerait à resserrer les liens, et selon moi, le dîner, préparé avec nos camarades stéphanois, a participé à nous rassembler. Je prends la cuisine comme élément rassembleur, et je le justifie en convoquant mon expérience mauricienne. Je finis par faire un projet que j’ai appelé “ancre nous”, qui prend la forme d’une cuisine et d’une salle à manger, connectées par un préau.
Pendant ce studio, où le texte a pris beaucoup de place, je réalise que mes orientations ont en fait été données par mes expériences passées et présentes d’étudiant à l’étranger, à Paris, puis à Maurice, à Nantes et à Saint-Etienne. Ainsi, j’ai envie de continuer à travailler sur les façons dont l’architecture peut participer à créer du lien et à aider les étudiants étrangers à s’intégrer, notamment dans les résidences. C’est dans cette optique que je propose l’évolution de REPERE en REPAIRE.
6 ans, c’est long ...
2.1. En école, autour du monde
Je me rends compte que le fait d’avoir voyagé comme je l’ai fait pour mes études a été très enrichissant pour moi. En effet, j’ai pu en apprendre sur moi même, et sur les autres. Je pense que je suis aujourd’hui le produit de toutes ces expériences, et j’en suis très heureux.
Au Sénégal, j’ai acquis beaucoup de notions techniques, relevant parfois du BTP (plomberie, électricité etc…). J’ai aussi pris conscience d’enjeux patrimoniaux, et de mise en valeur de nos techniques constructives et de nos architectures traditionnels.
En France, j’ai découvert un autre côté, plus poétique, politique, artistique, et cela m’a donné envie dans une pratique future, de prendre des positions engagées et assumées. La diversité des enseignements et des méthodes m’a aidé à ouvrir mes horizons.
A Maurice, j’ai découvert les enjeux de résilience, et d’économie de ressources, propres à la condition insulaire, mais qui s’appliquent globalement dans le monde que nous avons aujourd’hui. Tout ceci constitue pour moi une richesse, et j’ai envie de continuer à découvrir le monde.
2.2. En agence
Mes passages en agence m’ont permis de me faire une idée de ce qui m’attend dans le monde professionnel. Lors du plus long, qui a duré neuf mois, à l’agence Art Ingénierie, à Dakar, j’ai été confronté pour la première fois au syndrome de l’imposteur.
En effet, à l’âge de 21 ans, je me suis très vite vu confier des responsabilités. Entouré de collègues plus âgés que moi, et au vu du sérieux et des enjeux réels des projets qui allaient être construits, je me sentais au début peu légitime à prendre des initiatives.
J’ai pu bénéficier d’un accompagnement bienveillant de la part de M. DIOP, architecte en chef, directeur de l’agence. Il a cru en moi et m’a donné l’opportunité de grandir au sein de sa structure. J’ai aussi pu profiter de la bonne compagnie de tous mes collègues. J’ai énormément appris en me confrontant aux défis réels de la vingtaine de projets sur lesquels j’ai eu à travailler, et j’ai pris confiance en mes capacités.
Le retour à l’école a été assez difficile pour moi, car je m’étais habitué à un autre rythme. A la fin de ma journée de travail, et le week-end, j’étais libre de faire ce qu’il me plaisait, et je n’avais pas la contrainte de rendre des devoirs. Le travail restait à l’agence.
Cette première expérience a beaucoup facilité la suivante, à Maurice cette fois-ci, à l’agence NK Architect Ltd. Je me savais déjà capable de mener à bien les missions qui me seraient confiées, et d’apporter une plus-value à l’agence.
Là aussi, j’ai eu la chance de côtoyer des personnes formidables. Voyant Kabir NURSOO, l’architecte en chef et directeur de l’agence, s’investir complètement pour faire décoller sa jeune structure, j’ai commencé à me poser des questions quant à l’avenir que je voulais pour moi même, notamment en rapport à l’équilibre entre la vie personnelle et professionnelle.
Kabir étant jeune (moins de 40 ans), il m’était assez facile de m’identifier à lui. Il a été présent lors de mon stage, et à la fin de celui-ci, nous avons eu un échange pendant lequel j’ai pu lui faire part de mes interrogations. Il m’a très bien conseillé, et m’a encouragé à poursuivre sur ma lancée, comme le ferait un grand frère.
2.3. Protolab
Faire mon PFE dans l’option Protolab me permet, quelque part, de faire la synthèse de mon parcours. C’est la dernière étape d’un long périple. Dessiner un projet, le transmettre à un bureau d’études, ensuite à une entreprise de construction, et le dessiner pour le construire soi-même, ce n’est pas du tout la même chose. Ici, en tant que groupe, nous avons pu nous occuper de tout, de A à Z. Nous sommes partis de quelques mots sur une feuille, et sommes arrivés à un objet bien réel, tangible.
En revanche, si j’ai une chose à déplorer, c’est la taille du groupe. Quand bien même j’ai eu la chance de travailler avec une équipe de personnes talentueuses, je pense qu’être à six, c’est peut être un peu trop. Je trouve qu’il devient difficile d’expédier les affaires de manière suffisamment efficace, et que les débats peuvent devenir vite longs et presque politiques.
Liste (non exhaustive) de ce qui ne devrait pas être volé aux usagers de REPERE.
De haut en bas: l’accès à l’information, l’accueil, l’intimité, faire signal, la qualité des espaces de travail.
L’expérience a d’ailleurs montré que nous étions plus efficaces en nous scindant en deux trinômes, et en nous affectant à des tâches différentes.
De plus, j’ai tendance à faire les choses à mon rythme, je sais que j’ai une certaine capacité à produire beaucoup en peu de temps, et je tiens les délais sans difficulté. Je suis conscient que mon rythme ne parle pas forcément à la majorité, mais j’ai besoin de gérer mon effort, car je suis rapidement saturé, voire surmené. La pression est certes inévitable, mais je préfère ne pas m’en rajouter inutilement.
Enfin, Je ne saurais parler au nom de tous, mais pour moi, le PFE revêt une dimension assez personnelle. Le partager avec d’autres étudiants également en PFE vient un peu diluer l’expérience. Il m’a fallu défendre mes idées, sans rentrer dans la confrontation, mais surtout rester flexible, et à l’écoute.
En fin de compte, je suis assez fier du travail que nous avons effectué ensemble, et chaque membre de l’équipe a pu contribuer à l’effort commun. Je me reconnais dans le travail final que nous présentons. La méthode de la liste désirante, que je ramène de MHP, nous a beaucoup servi, notamment dans les premières phases où elle nous a permis de nous accorder sur une série d’intentions à retranscrire dans le projet.
Je note également que mes camarades ont su s’approprier et améliorer mon idée de deux parois habitées. J’ai aussi, pendant mon temps libre, fait un peu de graphismes, et là également mes camarades ont réussi à sublimer les idées, et proposer une vraie identité visuelle à REPERE.
2.4. Et après ?
Mon projet professionnel a mûri, et sa forme s’est précisée au fil des années. Toutefois, au fond il reste le même. A court terme, je pense qu’il serait intéressant pour moi d’amasser un peu plus d’expérience et de capitaux. La HMONP ne me séduit pas réellement, car elle n’est pas réellement utile à mon projet professionnel. Je veux continuer d’apprendre, mais pas forcément à l’école d’architecture.
Mon souhait à long terme est de rentrer au Sénégal, et de monter une agence d’architecture. Au moment où j’écris ces lignes, je ne ressens pas le besoin de m’associer, ou du moins, pas initialement. Je pense que les projets sur lesquels je serai amené à travailler en tant que jeune architecte, à son compte, au Sénégal, seront relativement faciles à mener seul. Je n’exclus pas la collaboration avec d’autres architectes, mais je veux garder un maximum de liberté.
Je me vois bien aussi, faire de la sensibilisation, et peut être du projet caritatif. Je veux, en parallèle d’une pratique génératrice de revenus, assumer pleinement le rôle social de l’architecte, dans mon pays d’origine. Ceci peut prendre la forme d’un collectif, formé de quelques amis rencontrés au CUAD, et moi-même.
Je pense que la France est une étape, et que l’avenir est au Sénégal. Je suis reconnaissant de ce que j’ai pu apprendre ici, mais les problématiques auxquelles les architectes français doivent répondre sont assez différentes de celles que je pourrais retrouver au Sénégal. On ne construit pas en France comme à Dakar, ou à Maurice.
De plus, je dois reconnaître que j’ai quelques difficultés à m’intégrer, et que je vis assez mal la grisaille et le nombre incalculable de démarches administratives à faire en tant qu’étranger. J’ai du mal à trouver ma place (même si ce n’est pas faute d’avoir essayé) et je songe à faire mes valises.
REPAIRE : Le projet augmenté
3.1. Bienvenue chez moi !
La résidence Ile de Nantes, située au 23 Boulevard de la Prairie au Duc, consiste en un immeuble de cinq étages. Sa couleur rouge dénote avec l’environnement immédiat. Le rez-de-chaussée abrite des restaurants, à savoir Portavia Pizza, et le Zed. Il comprend également les services de la résidence. L’entrée se fait par le hall, entre les deux restaurants. Les étages supérieurs sont dédiés aux studios où résident les locataires.
Sur le boulevard, on a plusieurs restaurants et bars, une laverie, un Monop, et une salle d’escalade. L’ENSA Nantes se trouve à quelques mètres de là.
Le hall d’entrée comporte une façade vitrée, avec deux blocs de boîtes aux lettres disposées en diagonale dans l’espace. Depuis le hall, la laverie est accessible, et cette dernière a une petite fenêtre donnant sur le hall, et par extension, sur la rue. Le local poubelle, et un local entretien se trouvent également à ce niveau.
Je pense que l’espace le plus propice à l’implantation de REPAIRE est le hall d’entrée, car tous les résidents le traversent, et qu’il serait intéressant de travailler un certain rapport à la rue. Je trouve que la disposition actuelle des boîtes aux lettres n’est pas optimale, et que l’espace pourrait être mieux aménagé.
Entrée de la résidence
Façade Nord de la résidence
Intérieur du hall
3.2. Qu’est ce qu’on va bien pouvoir en faire ?
Le projet REPAIRE intégrerera les boîtes aux lettres, qui sont l’attraction principale du hall aujourd’hui. Elles doivent rester visibles et facilement accessibles, notamment pour les personnes à mobilité réduite.
Le projet comportera également des assises confortables. Le projet REPERE, qui est le point de départ de ce projet augmenté, sera la base dont je partirai pour redonner vie à notre hall d’entrée.
Cette notice rétrospective raconte mes 6 ans d’études, et comment une scolarité autour du monde m’a conduit à ce studio de PFE et a influencé mes envies de projet, et mes projections futures.