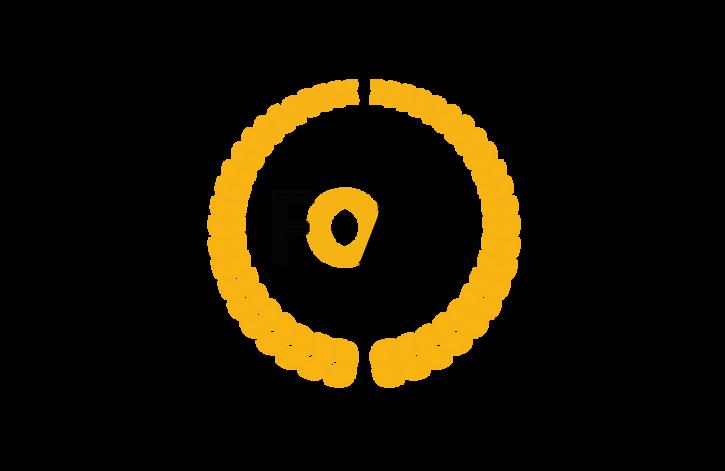

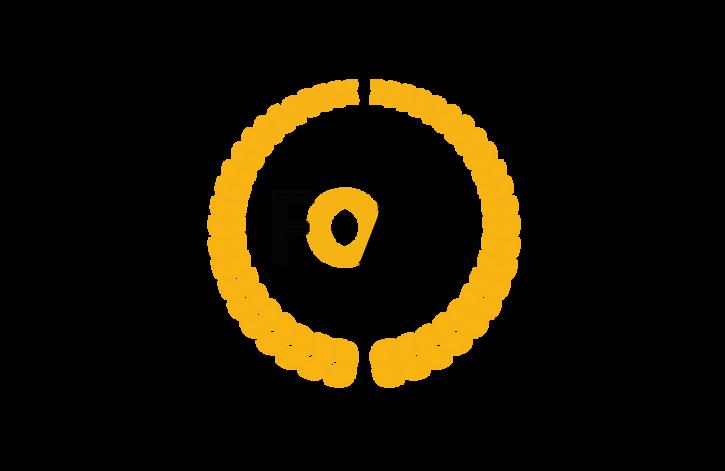

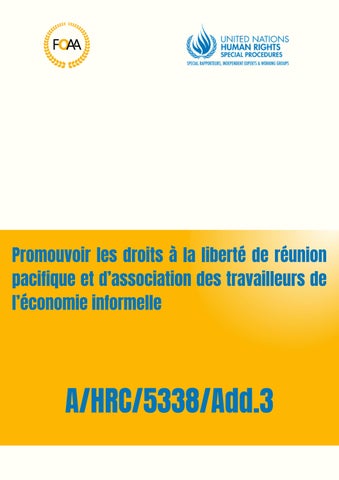
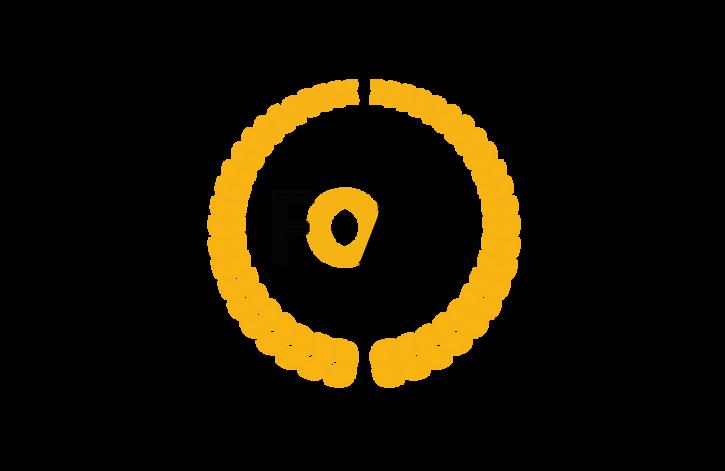

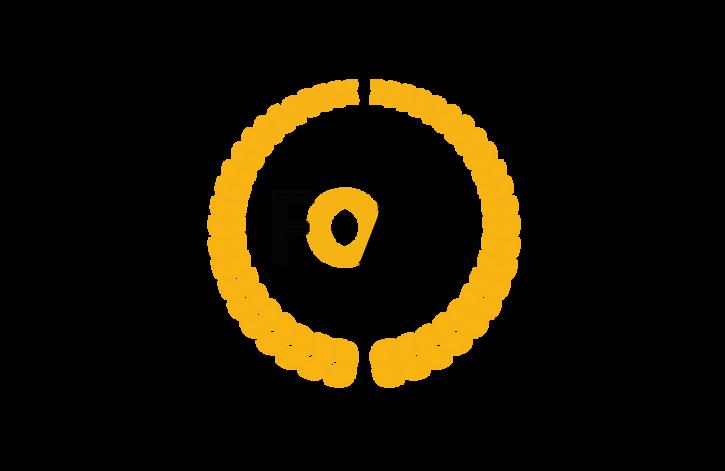

Conseil des droits de l’homme
Cinquante-troisième session
19 juin-14 juillet 2023
Point 3 de l’ordre du jour
Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement
Distr. générale
23 juin 2023
Français
Original : Anglais
Promouvoir les droits à la liberté de réunion pacifique et d’association des travailleurs de l’économie informelle
Rapport du Rapporteur spécial sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d’association, Clément Nyaletsossi Voule*
* Ce rapport est reproduit telle qu’il a été reçu, dans la langue originale seulement

1. Les droits des travailleurs à la liberté de réunion pacifique et d’association ne sont ni bien respectés, ni bien protégés, ni bien appliqués dans le monde d’aujourd’hui. Comme l’indique le rapport 2022 de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’indice mondial des droits, en 2020, « quatre-vingt-sept pour cent des pays violaient le droit de grève », « soixante-dix-neuf pour cent des pays violaient le droit à la négociation collective » et « soixante-quatorze pour cent des pays excluaient les travailleurs du droit de créer un syndicat et de s’y affilier ».”1
2. Ces chiffres sont alarmants, car ils indiquent à quel point les droits fondamentaux et essentiels à la liberté de réunion pacifique et d’association sont peu respectés lorsqu’il s’agit de les exercer dans le cadre du travail. La situation est encore pire pour les travailleurs de l’économie informelle. Comme l’a fait remarquer le précédent Rapporteur spécial, Maina Kiai, dans son rapport de 2016, Le travail informel se caractérise souvent par de mauvaises conditions d’emploi, de faibles salaires et l’absence de protection contre le non-paiement des salaires, les licenciements sans préavis ni compensation, les heures supplémentaires obligatoires, les conditions de travail dangereuses et insalubres, et l’absence d’avantages sociaux tels que l’assurancemaladie,les congésde maladie, lespensions oula sécuritésociale. Parce qu’ils échappent généralement à la protection du droit du travail, les travailleurs informels ont peu d’accès à la justice et moins de possibilités de se réunir, de former des syndicats ou d’y adhérer, ou encore de négocier des salaires plus élevés ou de meilleures conditions de travail. L’absence de droits fondamentaux les empêche de demander des comptes à leurs supérieurs et les prive de la possibilité de changer leurs conditions de travail. Les États, en collaboration avec les employeurs, choisissent qui est ou n’est pas couvert par les droits syndicaux 2
3. La pleine jouissance des droits à la liberté de réunion pacifique et d’association est toutefois essentielle pour les travailleurs de l’économie informelle. Comme l’a noté le Directeur général de l’Organisation internationale du travail (OIT) en 1991, La liberté d’association est particulièrement importante à cet égard, car ce n’est qu’en formant et en rejoignant des organisations de leur choix que les personnes travaillant dans le secteur informel pourront exercer une pression suffisante pour provoquer les changements nécessaires dans les politiques, les attitudes et les procédures qui entravent le développement du secteur et l’amélioration des conditions de travail dans celui-ci 3
4. Comme l’a observé la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) de l’OIT en 2012, les « travailleurs ont le droit de s’organiser et de négocier collectivement sans discrimination aucune, de constituer librement des organisations syndicales et s’y affilier et de représenter leurs membres devant les pouvoirs publics dans les structures instituées pour le dialogue social ».”4
5. Àbiendeségards,ilnesemblepas queleschosesaientévoluédanslabonnedirection. Celaestdûàlafoisauxrestrictionsdesdroitsàlalibertéderéunionpacifiqueetd’association en relation avec le travail, et aux mesures prises par plusieurs États qui augmentent le nombre de travailleurs dans l’économie informelle, au lieu de le diminuer. Cependant, au cours des dix dernières années, les organes et mécanismes des Nations Unies ont de plus en plus reconnu que les violations des droits des travailleurs, y compris les droits des travailleurs formels et informels de s’associer et de se réunir, constituaient des violations des droits de
1 CSI. Indice des droits dans le monde (2022).
2 Rapportdu Rapporteur spécialsur lesdroitsàla libertéderéunion pacifiqueet àlalibertéd’association, Maina Kiai, Doc ONU A/71/385 (14 septembre 2016), par. 21.
3 Rapport du Directeur général à la 78e session du CDI (1991), 39.
4 OIT. Donner un visage humain à la mondialisation (2012), par. 75.
l’homme. Les lois et les politiques qui nuisent aux individus et leur rendent la vie plus difficile en raison de leur pauvreté, de leur classe sociale et/ou de leur situation socioéconomique, ainsi que la nature discriminatoire de ces mesures, ont également été davantage reconnues.
6. L’augmentation du caractère informel du travail est notée dans l’Enquête générale de l’OIT de 2012, dans laquelle la Commission d’experts des conventions fondamentales sur les droits du travail se fait l’écho des préoccupations des syndicats concernant « l’impact négatif des formes précaires d’emploi sur les droits syndicaux et la protection des travailleurs, et notamment les contrats temporaires à court terme renouvelés à plusieurs reprises, la soustraitance, même de la part de certains gouvernements dans leur propre service public pour accomplir des tâches permanentes statutaires; et le non-renouvellement de contrats pour des motifs antisyndicaux »5. La Commission d’experts a souligné que, dans la pratique, « certaines de ces modalités de contrats privent souvent les travailleurs de l’accès aux droits en matièrede libertésyndicaleet de négociationcollective »,à la fois en raisonderestrictions légales et du fait que cela « peu[t] dissuader les travailleurs de s’affilier à un syndicat » 6
7. Plus récemment, la pandémie de COVID-19 a exacerbé et empiré la vulnérabilité des travailleurs au lieu de la réduire. Comme l’a observé la CEACR, « la crise de la COVID-19 a été particulièrement dévastatrice pour deux milliards de travailleurs dans l’économie informelle qui représentent plus de 60 pour cent de la main-d’œuvre mondiale et qui sont deux fois plus exposés au risque de vivre dans la pauvreté que les travailleurs occupant un emploi formel »7. La situation s’est aggravée par l’élargissement sous-jacent des inégalités et de l’exploitation au niveau mondial, ainsi que par les défis croissants posés par le changement climatique et la dégradation de l’environnement.
8. Encasdeconflit, commeparexempleenUkraineetau Soudan,l’économieinformelle connaît souvent une croissance rapide et spectaculaire, car les possibilités de travail régulier sont réduites. Par ailleurs, les conflits entraînent souvent des flux migratoires, ce qui souligne la nécessité de veiller à ce que les migrants jouissent pleinement de leurs droits à la liberté de réunion pacifique et d’association. Dans ce contexte, le Rapporteur spécial rappelle et souhaite souligner l’importance des points soulevés dans la Recommandation (no 205) de l’OIT sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience.
9. Ce rapport fait suite aux travaux antérieurs de l’OIT, de la CSI et du Rapporteur spécial, qui ont souligné l’importance de veiller à ce que les droits à la liberté de réunion pacifique et d’association des travailleurs de l’économie informelle soient pleinement respectés. L’OIT est un chef de file dans ce domaine depuis des décennies. Trop souvent, cependant, les droits des travailleurs et les droits de l’homme ont été considérés comme catégoriquement distincts. Dans le même temps, les organes des Nations Unies et d’autres organes liés aux droits de l’homme ont commencé à prendre des mesures plus énergiques pour combler ce fossé. Par exemple, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) a reconnu que le droit à des conditions de travail justes et favorables s’applique à tous, y compris aux travailleurs indépendants, aux travailleurs de l’économie informelle, aux travailleurs agricoles, aux travailleurs réfugiés et aux travailleurs non rémunérés8. Il a en outre reconnu que « les femmes sont souvent surreprésentées dans l’économie informelle » et a souligné que les lois et les politiques prévoyant des droits et des protections pour les travailleurs devraient s’étendre aux travailleurs de l’économie informelle9 . 10. De son côté, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (« Comité CEDAW ») a estimé que l’article 11 de la Convention sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes ne s’appliquait pas seulement aux salariés, mais aussi, entre autres, aux travailleurs indépendants. Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (« Comité CERD ») a quant à lui estimé que, lorsqu’une minorité raciale particulière ou un groupe victime de discrimination est surreprésenté dans l’économie informelle,
5 OIT. Donner un visage humain à la mondialisation (2012), par. 935.
6 Ibid.
7 Application des normes internationales du travail, 2023, Rapport de la CEACR, 111e session de la Conférence internationale du Travail, 2023, par. 56.
8 CESCR, Observation générale no 23, par. 4-5.
9 CESCR, Observation générale no 23 par. 47d).
l’exclusion des travailleurs de ce secteur particulier de la protection du droit du travail équivaut à une discrimination raciale au sens de la Convention sur l’élimination de la discrimination raciale.
11. Les organes nationaux et supranationaux africains ont également développé une jurisprudence importante dans des domaines connexes. En 2020, dans l’affaire Mahlangu and Another v. Minister of Labour and Others, la Cour constitutionnelle sud-africaine a estimé que l’exclusion des travailleurs domestiques du champ d’application de la loi sur l’indemnisation des maladies et des accidents professionnels constituait une discrimination directe et indirecte fondée sur la race, la classe sociale et le genre10. La même année, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ACtHPR) a estimé que les lois sur le vagabondage, y compris les mesures qui pénalisent l’« oisiveté », la participation à l’économie informelle en tant que telle, les activités jugées immorales et le simple fait d’éveiller les soupçons des autorités,11 violaient de nombreux droits de l’homme 12
12. Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté a quant à lui appelé les États à adopter et à renforcer les mesures qui reconnaissent la discrimination fondée sur la pauvreté, observant que « le renforcement de l’interdiction de la discrimination fondée sur la précarité socioéconomique est un outil essentiel pour l’élimination de la pauvreté »13
13. Le présent rapport vise à souligner davantage le lien entre les droits des travailleurs et les droits de l’homme. Trois faits essentiels doivent être gardés à l’esprit dans ce contexte. Premièrement, les droits des travailleurs sont des droits de l’homme. Deuxièmement, les droits des travailleurs à la liberté de réunion pacifique et d’association sont essentiels à la réalisation d’autres droits liés au travail, y compris les droits économiques et sociaux. Troisièmement, la pleine jouissance des droits des travailleurs est essentielle à la jouissance des droits de l’homme en général, car les syndicats et les grèves jouent un rôle clé dans la mise en place de sociétés fondées sur les droits humains. En d’autres termes, l’existence de lieux de travail démocratiques est essentielle à l’existence de sociétés démocratiques
14. L’étude de l’économie informelle est un défi pour plusieurs raisons, notamment parce que l’économie informelle couvre un large éventail de travailleurs dans des situations différentes, et parce que l’économie informelle peut être définie en référence à de multiples critères différents. Le terme « secteur informel » a été utilisé pour la première fois par l’OIT en 1972, dans le cadre d’une stratégie visant à accroître l’emploi productif au Kenya14. Les questions connexes ont été traitées plus en détail dans un rapport spécifique en 199115. Un autre rapport important a été publié en 2002, dans lequel l’expression « économie informelle » a été préférée,16 à la suite d’un travail important réalisé par le Groupe d’experts sur les statistiques du secteur informel, l’OIT et Femmes dans l’emploi informel :
10 Voir Mahlangu and Another v Minister of Labour and Others [2020] ZACC 24, disponible sur: http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/2020/24.html
11 Pour plus de détails sur ces lois, voir Christopher Roberts, Discretion and the Rule of Law: The Significance and Endurance of Vagrancy and Vagrancy-Type Laws in England, the British Empire and the British Colonial World, 33 Duke Journal of Comparative and International Law 181 (2023).
12 Voir ACtHPR, Avis consultatif nº 001/2018, disponible sur https://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.africancourt.org/cpmt/storage/app/uploads/public/5fd/0c6/53e/5fd0c653ec0e7417257939.pdf
13 Rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté, Doc. ONU A/77/157 (15 juillet 2022), disponible sur: https://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/file:///C:/Users/PC/Downloads/A_77_157-FR
14 Voir OIT, Emploi, revenus et égalité : stratégie pour accroître l’emploi productif au Kenya. (1972).
15 Voir Rapport du Directeur général, Le dilemme du secteur non structuré, 78e session de la Conférence internationale du Travail, (1991).
16 Voir OIT Travail décent et économie informelle, 90e session de la Conférence internationale du Travail, (2002).
Globalisation et organisation17. Depuis lors, l’économie informelle est généralement le terme préféré, comme le montre par exemple son utilisation dans la recommandation n° 204 de l’OIT de 2015, en raison de l’idée générale qu’il s’agit d’un terme plus englobant que celui de « secteur informel », qui a été compris comme ayant une couverture plus limitée.
15. L’économie informelle est définie dans la recommandation n° 204 de l’OIT comme « l’ensemble des activités économiques des travailleurs et des unités économiques qui, en droit ou dans la pratique, ne sont pas couverts par des dispositions formelles, ou sont insuffisamment protégés »18. Par nature, les caractères formel et informel constituent un spectre, comme le suggère la référence à une « protection insuffisante » dans la définition de l’OIT. En outre, la frontière entre les travailleurs de l’économie formelle et de l’économie informelle est souvent fragile, notamment en raison de l’insécurité de l’emploi et des politiques et pratiques commerciales de l’État qui favorisent le caractère informel
16. Le présent rapport ne porte pas essentiellement sur des questions de définition en tant que telles. Le Rapporteur spécial souligne plutôt que toutes les personnes, y compris tous les travailleurs, qu’ils soient dans l’économie formelle ou l’économie informelle, devraient jouir pleinement de leurs droits à la liberté de réunion pacifique et d’association, ainsi que de tous les autres droits civils, politiques, sociaux, économiques et autres. Le présent rapport ne se limite donc pas à ceux qui occupent une place centrale dans l’économie informelle, mais s’inscrit dans une perspective plus large. Dans le même temps, l’économie informelle est le principal sujet de préoccupation du rapport. Si d’autres domaines sont abordés, c’est parce que les travailleurs appartenant à ces catégories peuvent, en droit et/ou en pratique, être confrontés à des formes similaires de violation des droits des travailleurs de l’économie informelle, et parce qu’une couverture maximale des droits concernés dans l’ensemble des catégories couvertes est le meilleur moyen de garantir une protection et une réalisation maximales des droits pour tous, y compris tous ceux qui travaillent dans les économies formelle et informelle
17. La capacité de s’associer, y compris sous la forme de syndicats, est un droit civil et politique clé, essentiel à la participation des individus à leur société de manière plus générale, ainsi qu’à l’élaboration des structures qui affectent leur vie, et essentiel à l’établissement de sociétés démocratiques. Tous les individus jouissent de ce droit, qu’ils travaillent dans l’économie formelle ou informelle. Toutes les mesures qui restreignent ce droit sur la base du caractère formel du travail constituent donc des violations du droit des individus et des groupes à la liberté d’association
18. Alors que de nombreuses constitutions nationales reconnaissent le droit à la liberté d’association, et souvent le droit de former des syndicats, ces droits fondamentaux ne sont souvent pas reconnus dans le droit du travail. Dans de nombreux pays, les lois nationales sur le travail limitent le droit de former des syndicats aux « employés », un terme restrictif en soi et souvent défini de manière restrictive, en référence par exemple aux contrats de travail et aux superviseurs, ou à ceux qui ont un contrat de travail en tant que tel19. Toutes ces mesures
17 Pour en savoir plus, y compris un compte rendu plus détaillé de l’historique des termes en question, voirMarleseVonBroembsen&JeffreyVogt,WhytheStruggleofthe2BillionWorkersintheInformal Economy Matters to Us All, 2 ILAW 4 (2022).
18 L’économie informelle telle que définie dans la Recommandation (n° 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015, art. 2a) de l’OIT Ailleurs, le travail informel est défini comme “ emploi sans travail ni protection sociale.” Voir MA Chen, Rethinking the Informal Economy: Linkages with the Formal Economy and the Formal Regulatory Environment, Document de travail no 46, DESA (2007).
19 De telles dispositions sont manifestement en violation du droit à la liberté d’association en tant que tel. En outre, elles rappellent à tout le moins – et peuvent d’une certaine manière être considérées comme un héritage – d’anciennes façons profondément problématiques de concevoir les relations de travail, y
devraient être modifiées afin de garantir que l’engagement dans le travail en tant que tel est la seule condition nécessaire pour former un syndicat.
19. Afin d’exercer leur droit à la liberté d’association lorsque les lois empêchent les travailleurs de former un syndicat, ces derniers profitent souvent d’autres lois moins restrictives pour former différents types d’associations, y compris des partenariats à responsabilité limitée, des sociétés privées, des fiducies et des coopératives. Les travailleurs devraient généralement être libres de s’associer sous la forme de leur choix. Les États ne devraient en aucun cas limiter la capacité des individus à former de telles associations, car elles constituent souvent le seul moyen légal dont disposent certains travailleurs pour s’associer. En outre, les États devraient veiller à ce que les travailleurs ainsi organisés soient en mesure d’engager des négociations collectives. Dans le même temps, il convient de rappeler que les États doiventveiller à ce que ledroit deformer des syndicats ne soit en aucun cas limité, y compris pour les travailleurs de l’économie informelle
20. Dans ce contexte, le Rapporteur spécial souhaite souligner et faire écho au travail effectué par le Comité de la liberté syndicale (CFA) de l’OIT, qui a clairement indiqué que « Tous les travailleurs devraient pouvoir jouir du droit à la liberté syndicale, quel que soit le lien contractuel au moyen duquel s’est établie la relation de travail »20. La taille d’une entreprise ne devrait pas être déterminante à cet égard21. En outre, comme l’a fait remarquer le Comité de la liberté syndicale, la jouissance du droit à la liberté syndicale ne dépend pas de « la relation d’emploi avec un employeur »22. Parmi les travailleurs qui jouissent du droit à la liberté d’association figurent les travailleurs agricoles,23 les travailleurs des plantations,24 les travailleurs indépendants,25 les travailleurs temporaires,26 les travailleurs en période d’essai et sous contrat de formation,27 les chômeurs,28 les personnes participant à des programmescommunautairesdeluttecontrelechômage,29 lestravailleursdescoopératives,30 les travailleurs en sous-traitance,31 les travailleurs des zones franches d’exportation,32 les travailleurs domestiques,33 les travailleurs migrants, les travailleurs à domicile,34 les
compris, par exemple, le cadre « maître-serviteur » qui prévalait autrefois dans le droit coutumier. Pour en savoir plus sur cette dernière, voir Douglas Hay & Paul Craven, (sous la dir. de) MASTERS, SERVANTS, AND MAGISTRATES IN BRITAIN & THE EMPIRE (2005).
20 Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, OIT (6e éd., 2018), par. 327. Voir aussi par. 328-331.
21 Voir ibid , par. 415-416. Voir aussi 346e rapport du Comité de la liberté syndicale (2007), Cas no 2473, par. 1541 ; 371e rapport du Comité de la liberté syndicale (2014), Cas no 2988, par. 845.
22 Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, par. 387. Voir aussi 342e rapport du Comité de la liberté syndicale (2006), Cas no 2423, par. 479 ; 359e rapport du Comité de la liberté syndicale (2011), Cas no 2602, par. 365 ; 360e rapport du Comité de la liberté syndicale (2011), Cas no 2757, par. 990 ; 363e rapport du Comité de la liberté syndicale (2012), Cas no 2602, par. 461
23 363e rapport du Comité de la liberté syndicale (2012), Cas no 2868, par. 1005 ; 363e rapport du Comité de la liberté syndicale (2012), Cas no 2888, par. 1084 ; 376e rapport du Comité de la liberté syndicale (2015), Cas no 2786, par. 349 ; 376e rapport du Comité de la liberté syndicale (2015), Cas no 3042, par. 532.
Voir Compilation desdécisionsdu Comitédelalibertésyndicale, par. 374-375 ; OIT. Donner un visage humain à la mondialisation, 101e session de la Conférence internationale du Travail (2012), par. 71.
24 Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, par. 376.
25 Voir Compilation desdécisionsdu Comitédelalibertésyndicale, par. 387-389 ; OIT. Donner un visage humain à la mondialisation, 101e session de la Conférence internationale du Travail (2012), par. 71.
26 Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, par. 390.
27 Voir Compilation desdécisionsdu Comitédelaliberté syndicale, par. 391-394 ; OIT. Donner un visage humain à la mondialisation, 101e session de la Conférence internationale du Travail (2012), par. 71.
28 Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, par. 395.
29 Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, par. 396.
30 Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, par. 397-400.
31 Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, par. 401-402.
32 Voir Compilation desdécisionsdu Comitédelalibertésyndicale, par. 403-405 ; OIT. Donner un visage humain à la mondialisation, 101e session de la Conférence internationale du Travail (2012), par. 71.
33 Voir Compilation desdécisionsdu Comitédela libertésyndicale, par. 406-407 ; OIT. Donner un visage humain à la mondialisation, 101e session de la Conférence internationale du Travail (2012), par. 71.
34 Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, par. 408-409.
travailleurs licenciés,35 les travailleurs retraités,36 les travailleurs des petites entreprises37 et les mineurs38. Cela ne veut pas dire que tous ces travailleurs sont toujours dans l’économie informelle ; cela varie selon les catégories et les lois nationales en vigueur. Tous ont parfois vu leur droit à la liberté d’association limité de manière inappropriée, en violation de l’obligation des États de garantir le droit à la liberté d’association.
21. La CEACR a souligné à plusieurs reprises la nécessité de garantir la pleine jouissance du droit à la liberté d’association dans l’économie informelle en général. En 2022, par exemple, la CEACR a appelé le Pakistan à « prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des mesures législatives aux niveaux fédéral et provincial, en vue de garantir les droits des travailleurs de l’économie informelle au titre de la Convention [sur la liberté syndicaleetlaprotection dudroitsyndical] »39.LaCEACRaégalementinvitélesPhilippines à « veiller à ce que tous les travailleurs », y compris « les travailleurs indépendants et temporaires, les travailleurs sous-traitants ou sous contrat, les travailleurs non-résidents, les travailleurs à temps partiel, les travailleurs agricoles et les travailleurs domestiques et migrants », à « la seule exception possible des forces armées, de la police et des fonctionnaires engagés dans l’administration de l’État […] puissent effectivement bénéficier des droits consacrés par la Convention [sur le droit d’organisation et de négociation collective], y compris le droit à la négociation collective »40. La CEACR a souligné la même chose à l’Ouganda41 En 2022, en réponse à une communication concernant Cuba, le Comité de la liberté syndicale a souligné que « le critère à retenir pour définir les personnes couvertes par le droit syndical n’est pas la relation d’emploi avec un employeur » et que « les travailleurs qui ne sont pas liés par un contrat de travail doivent pouvoir, s’ils le souhaitent, constituer les organisations de leur choix ».42 22. Il est essentiel que la loi n’interdise pas aux travailleurs d’adhérer à un syndicat simplementparcequ’ilsontétélicenciés,carunetelledispositionpermettraitauxemployeurs de violer beaucoup plus facilement le droit des travailleurs à se syndiquer. Dans une décision de 1998 concernant Djibouti, le Comité de la liberté syndicale a souligné que « la perte du statut syndical d’une personne à la suite d’un licenciement pour faits de grève est contraire aux principes de la liberté d’association »43. Dans une communication de 2006, plusieurs syndicats coréens ont contesté divers aspects du droit du travail coréen. Entre autres conclusions, le Comité de la liberté syndicale a souligné que les lois « excluant l’appartenance syndicale des travailleurs licenciés [sont] incompatible[s] avec les principes de la liberté syndicale »44
23. Ilestégalementessentielquelestravailleurstemporairesjouissentpleinementdudroit à la liberté d’association, notamment pour garantir que les États et les employeurs ne puissent pas limiter ce droit en plaçant les travailleurs sous des contrats de plus courte durée. Le Comité de laliberté syndicale a déjà soulignécepoint dansdes affaires concernant le Canada,
35 Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, par. 410-411.
36 Voir Compilation desdécisionsdu Comitédelalibertésyndicale, par. 412-413 ; OIT. Donner un visage humain à la mondialisation, 101e session de la Conférence internationale du Travail (2012), par. 71.
37 Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, par. 415-416.
38 Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, par. 417.
39 Demande directe (CEACR) – adoptée 2022, publiée 111e session CIT (2023), Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 – Pakistan.
40 Observation (CEACR) – adoptée 2022, publiée 111e session CIT (2023), Convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 – Philippines.
41 Demande directe (CEACR) – adoptée 2022, publiée 111e session CIT (2023), Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 – Ouganda.
42 397e rapport du Comité de la liberté syndicale (2022), Cas no 3271, par. 350.
43 309e rapport du Comité de la liberté syndicale (1998), Cas no 1851 et 1922, par. 238.
44 346e rapport du Comité de la liberté syndicale (2007), Cas no 1865, par. 761 ; voir aussi 353e rapport du Comité de la liberté syndicale (2009), Cas nº 1865, par. 720 ; 365e rapport du Comité de la liberté syndicale (2012), Cas no 2829, par. 575.
l’Inde,ElSalvador,laColombie,laRépubliquedeCorée, lesÉtats-Unis,laMalaisie,lePérou et le Qatar.45
24. Les travailleurs indépendants, y compris, par exemple, de nombreux vendeurs de rue, jouissent également du droit à la liberté d’association. Malheureusement, ce droit n’est pas reconnupartousles États. Celaanotammentconduitàdescasoùdesemployeursontcherché à faire classer des travailleurs salariés dans la catégorie des travailleurs indépendants, afin de limiter les droits auxquels ces travailleurs peuvent avoir accès. Au Royaume-Uni, par exemple, les chauffeurs de Deliveroo se sont vu refuser le droit de former un syndicat au motif qu’ils étaient indépendants46. Il s’agit d’une erreur de classification. Même si certains travailleurs sont plus raisonnablement classés comme indépendants, cela ne devrait pas avoir d’impact sur la jouissance de leurs droits en tant que travailleurs, y compris leur droit à la liberté d’association.
25. L’OIT a précédemment constaté que les principes de la liberté d’association ne sont pas violés lorsqu’une loi accorde aux travailleurs retraités et aux chômeurs uniquement le droit d’adhérer à un syndicat et de participer à son fonctionnement sous réserve des règles de l’organisation concernée47. Le Rapporteur spécial souligne que le droit à la liberté d’association garantit aux chômeurs, tout comme aux salariés, la possibilité de former des associations pour représenter leurs intérêts, et que ces associations doivent avoir la pleine liberté de choisir et d’entreprendre les activités souhaitées par leurs membres
26. Il est important que les accords économiques spéciaux, quels qu’ils soient, ne soient pas considérés comme des motifs de restriction du droit des travailleurs à la liberté d’association. Ainsi, la création de zones économiques spéciales ne justifie en aucun cas la limitation de la pleine jouissance du droit à la liberté syndicale. Le Comité de la liberté syndicale a insisté sur ce point dans le cadre de communications concernant notamment les Philippines, Maurice, le Bangladesh et El Salvador48. La Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’OIT insiste sur le même point 49
27. En outre, les travailleurs des coopératives jouissent du droit à la liberté d’association et les coopératives ne devraient pas être utilisées comme un moyen d’empêcher les travailleurs de jouir et d’exercer leur capacité à former des syndicats et à y participer. Le Comité de la liberté syndicale a déjà souligné ce point en ce qui concerne, entre autres, l’Indonésie 50
28. La législation et la pratique doivent également garantir que les travailleurs agricoles et les travailleurs des plantations sont en mesure d’exercer pleinement leur droit à la liberté
45 Voir 324e rapport du Comité de la liberté syndicale (2001), Cas nº 2083, par. 253 ; 330e rapport du Comité de la liberté syndicale (2003), Cas no 2158, par. 846 ; 342e rapport du Comité de la liberté syndicale (2006), Cas nº 2423, par. 479 ; 343e rapport du Comité de la liberté syndicale (2006), Cas no 2430, par. 360 ; 349e rapport du Comité de la liberté syndicale (2008), Cas no 2556, par. 754 ; 350e rapport du Comité de la liberté syndicale (2008), Cas no 2602, par. 671 ; 350e rapport du Comité de la liberté syndicale (2008), Cas no 2547, par. 801 ; 351e rapport du Comité de la liberté syndicale (2008), Cas no 2556, par. 34 ; 351e rapport du Comité de la liberté syndicale (2008), Cas nº 600, par. 572 ; 353e rapport du Comité de la liberté syndicale (2009), Cas nº 2637, par. 1051 ; 355e rapport du Comité de la liberté syndicale (2009), Cas no 2600, par. 477 ; 355e apport du Comité de la liberté syndicale (2009), Cas no 2602, par. 654 ; 356e rapport du Comité de la liberté syndicale (2010), Cas no 2637, par. 84 ; 357e rapport du Comité de la liberté syndicale (2010), Cas no 2687, par. 891 ; 371e rapport du Comité de la liberté syndicale (2014), Cas no 2988, par. 841.
46 Voir UK Court of Appeals confirms Deliveroo riders are self-employed, Reuters (24 juin 2021).
47 Voir 363e rapport du Comité de la liberté syndicale (2012), Cas no 2888, par. 1085.
48 Voir 302e rapport du Comité de la liberté syndicale (1996), Cas no 1826, par. 411 ; 333e rapport du Comité de la liberté syndicale (2004), Cas no 2281, par. 636 ; 337e rapport du Comité de la liberté syndicale (2005), Cas no 2327, par. 195 ; 346e rapport du Comité de la liberté syndicale (2007), Cas no 2528, par. 1446 ; 360e rapport du Comité de la liberté syndicale (2011), Cas no 2745, par. 1056 ; 346e rapport du Comité de la liberté syndicale (2012), Cas no 2745, par. 995 ; 370e rapport du Comité de la liberté syndicale (2013), Cas no 2745, par. 675 ; 371e rapport du Comité de la liberté syndicale (2014), Cas no 2908, par. 290.
49 OIT. Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale, (6e éd., 2022). Voir aussi CEACR, Observation générale, Convention nº 87 (2009).
50 Voir 350e rapport du Comité de la liberté syndicale (2008), Cas no 2589, par. 948.
d’association. Le Comité de la liberté syndicale a souligné les droits de ces travailleurs dans le cadre de communications concernant le Sri Lanka (Ceylan), le Guatemala, le Costa Rica, la République démocratique du Congo (Congo Léopoldville), la République dominicaine, le Chili et le Qatar.51
29. Les travailleurs domestiques jouissent également du droit à la liberté d’association, comme le reconnaît notamment la Convention no 189 de l’OIT, à savoir la Convention sur les travailleuses et travailleurs domestiques Malheureusement, les travailleurs domestiques sont souvent exclus du droit du travail, notamment au Bangladesh, et empêchés de former des syndicats52. Dans une communication de 1996, le Congrès du travail du Canada a allégué des violations du droit à la liberté d’association au fait que la loi de l’Ontario ne reconnaissait pas les travailleurs domestiques, entre autres, parmi les catégories de travailleurs protégés par sa législation du travail. En réponse, le Comité de la liberté syndicale a demandé au gouvernement de veiller à ce que les travailleurs domestiques soient couverts par les protectionsjuridiquespertinentes53.En2013,unecommunicationdelaCSIamisen évidence des violations du droit à la liberté d’association au Cambodge, notamment en ce qui concerne les travailleurs domestiques. Dans ses observations finales, le Comité de la liberté syndicale a souligné que « tous les travailleurs, à la seule exception des membres des forces armées et de la police, devraient avoir le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’ y affilier » et a demandé au « gouvernement [de] pren[dre] toutes les mesures nécessaires » pour modifier sa législation conformément à cette obligation54 Heureusement, le droit des travailleurs domestiques à la liberté d’association a parfois été reconnu, notamment par la Loi sur les relations de travail de 1995 en Afrique du Sud. Le Comité de la liberté syndicale a demandé au gouvernement jordanien de « pren[dre] les mesures nécessaires pour que les travailleurs domestiques puissent librement constituer l’organisation de leur choix et y adhérer »55 . La CEACR a également souligné la nécessité de garantir le droit à la liberté d’association des travailleurs domestiques, notamment en ce qui concerne le Bangladesh,56 l’Italie57 et la Jordanie.58
30. Les travailleurs migrants sont souvent confrontés à des difficultés particulières pour s’organiser et pour jouir de leurs droits de l’homme en général. Le Comité de la liberté syndicale a déjà examiné diverses allégations concernant le droit des travailleurs migrants à s’organiser. En 2012, la CSI a soumis une communication concernant la violation des droits des travailleurs migrants au Qatar. Cette communication faisait état de diverses violations des droits des travailleurs migrants au Qatar, notamment la violation de leur droit à la liberté d’association imposée par les lois restrictives du Qatar dans ce domaine, et diverses autres violations des droits rendues possibles par cette limitation, notamment des conditions de travail si mauvaises quedenombreuses personnes en sontmortes, des conditionsdelogement sordides et la fréquente sous-rémunération des travailleurs. Dans ses observations finales, le Comité a appelé le Qatar à « prendre les mesures nécessaires pour que tous les travailleurs puissent jouir de la liberté d’association et des droits de négociation collective »59. Si les
51 Voir 4e rapport du Comité de la liberté syndicale (1953), Cas no 34, par. 168 ; 24e rapport du Comité de la liberté syndicale (1956), Cas no 144, par. 237 ; 52e rapport du Comité de la liberté syndicale (1961), Cas no 239, par. 180-181 ; 76e rapport du Comité de la liberté syndicale (1964), Cas no 327, par. 308309 ; 76e rapport du Comité de la liberté syndicale (1964), Cas no 379, par. 375 ; 89e rapport du Comité de la liberté syndicale (1966), Cas no 444, par. 95 ; 119e rapport du Comité de la liberté syndicale (1970), Cas no 611, par. 93 ; 211e apport du Comité de la liberté syndicale (1981), Cas no 1053, par. 163 ; 241e apport du Comité de la liberté syndicale (1985), Cas no 1285, par. 213 ; 241e rapport du Comité de la liberté syndicale (1985), Cas no 1293, par. 273 ; 371e rapport du Comité de la liberté syndicale (2014), Cas no 2988, par. 841.
52 Voir Soumission, Homenet South Asia.
53 Voir 308e rapport du Comité de la liberté syndicale (1997), Cas no 1900.
54 377e rapport du Comité de la liberté syndicale (2016), Cas no 3064, par. 210.
55 397e rapport du Comité de la liberté syndicale (2016), Cas no 3337, par. 479.
56 Voir Observation (CEACR) – adoptée 2022, publiée 111e session CIT (2023), Convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 – Bangladesh.
57 Voir Demandedirecte(CEACR)– adoptée2022,publiée111e session CIT(2023), Convention (n° 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011 – Italie.
58 Voir Observation (CEACR) – adoptée 2022, publiée 111e session CIT (2023), Convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 – Jordanie
59 371e rapport du Comité de la liberté syndicale (2014), Cas no 2988, par. 844.
efforts d’organisation des travailleurs migrants ont parfois abouti à des réformes palpables, il est souvent difficile de pérenniser les acquis.60
31. Les travailleurs domestiques migrants font partie des groupes les plus susceptibles d’être confrontés à des restrictions de leur droit à la liberté d’association, ainsi qu’à d’autres formes de conditions difficiles et de violations des droits sur leur lieu de travail. Le Comité de la liberté syndicale a déjà examiné diverses allégations concernant le droit des travailleurs domestiques à s’organiser. En 2008, le Congrès des syndicats de Malaisie a soumis une communication concernant la situation des travailleurs domestiques migrants en Malaisie. Cette communication faisait état des mauvaises conditions de travail, de l’isolement, de la vulnérabilité et des abus fréquents dont sont victimes les travailleurs domestiques migrants. La communication note que les travailleurs domestiques migrants ont tenté de former un syndicat, mais que celui-ci s’est vu refuser l’enregistrement par le gouvernement sans raison. En réponse, le Comité a recommandé à la Malaisie de « prendre les mesures nécessaires, y compris des mesures législatives si besoin est, afin que, tant dans la législation que dans la pratique, les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs employés en sous-traitance, nationaux ou étrangers, puissent tous jouir effectivement du droit de constituer les organisations de leur choix et d’y adhérer », et « [a demandé] en outre au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’enregistrement immédiat de l’association des travailleurs domestiques migrants afin que ceux-ci puissent pleinement exercer leurs droits syndicaux »61 Dans un suivi de 2022, le Comité de la liberté syndicale a de nouveau souligné que « les travailleurs domestiques, comme l’ensemble des autres travailleurs, devraient bénéficier du droit à la liberté syndicale » et a de nouveau demandé au gouvernement de « garantir que les travailleurs domestiques, qu’ils soient étrangers ou nationaux, y compris les travailleurs employés en sous-traitance, jouissent tous de façon effective du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, en droit et en pratique, afin d’être en mesure de défendre leurs intérêts professionnels »62 32. Non seulement les travailleurs domestiques, mais tous les travailleurs à domicile ont le droit de se syndiquer. Comme l’a souligné le Comité de la liberté syndicale en réponse à une communication concernant la Pologne, « les travailleurs à domicile ne sont pas exclus du champ d’application de la convention nº 87 et doivent donc tous bénéficier des garanties offertes par la convention et avoir le droit de constituer des organisations professionnelles et de s’y affilier »63. Ailleurs, dans une communication concernant le Canada, le Comité de la liberté syndicale a souligné que les personnes travaillant à domicile, y compris « dans les secteurs des services sociaux, de la santé et de la garde d’enfants », jouissent pleinement du droit à la liberté d’association, de sorte que toute restriction imposée par l’État à leur capacité de former des syndicats et de s’y affilier constitue une violation de ce droit64. Le Rapporteur spécial se réjouit des rapports indiquant que des progrès positifs ont été réalisés en termes de reconnaissance juridique de la capacité des travailleurs à domicile à former des syndicats et à s’engager dans des activités connexes, et à bénéficier de diverses formes de protection sociale et sur le lieu du travail, dans plusieurs États
33. Le Comité de la liberté syndicale a également souligné que le droit à la liberté d’association s’étend aux travailleurs mineurs comme aux autres65. Le Rapporteur spécial reprend ce point en ce qui concerne le droit couvert par son mandat également
60 Pouruneétudedecassurlesmanifestationsdes sans-papiersenFrance, voirNatashaIskander,Informal Work and Protest: Undocumented Immigrant Activism in France, 1996-2000, 45 British Journal of Industrial Relations 309 (2007).
61 353e rapport du Comité de la liberté syndicale (2009), Cas no 2637, par. 1053 ; voir aussi 356e rapport du Comité de la liberté syndicale (2010), Cas no 2637, par. 84 ; 362e rapport du Comité de la liberté syndicale (2011), Cas no 2637, par. 90.
62 397e rapport du Comité de la liberté syndicale (2022), Cas no 2637, par. 31.
63 363e rapport du Comité de la liberté syndicale (2012), Cas no 2888, par. 1085.
64 340e rapport du Comité de la liberté syndicale (2006), Cas no 2314 et 2333, par. 420-423.
65 Voir 342e rapport du Comité de la liberté syndicale (2006), Cas no 2448, par. 405.
B. La liberté de former des syndicats dans la pratique et d’entreprendre des activités syndicales
34. Pour qu’une association puisse se constituer dans la pratique, il est essentiel non seulement que le groupe d’individus en question ait le droit légal de former une organisation de ce type, mais aussi que leur capacité à le faire ne soit pas limitée par le pouvoir discrétionnaire de l’exécutif. Le Rapporteur spécial a déjà souligné à plusieurs reprises que le droit à la liberté d’association exige que les individus puissent former des associations librement, sans avoir besoin d’une autorisation de l’État ou être soumis à un processus discrétionnaire. Le Comité de la liberté syndicale a souligné un point similaire dans le contexte des syndicats et autres organisations de travailleurs, dans des affaires concernant l’Algérie, la Malaisie, le Cameroun, les Fidji, le Panama, le Liban et le Zimbabwe66 35. En outre, même lorsque les cadres juridiques permettent aux travailleurs de l’économie informelle de former des syndicats, ils sont souvent limités par des obstacles dans leur accès à l’information concernant les procédures par lesquelles ils peuvent former des syndicats, les coûts élevés liés à l’enregistrement, les complexités bureaucratiques des processus à suivre, et/ou les restrictions imposées par le fait que les législateurs et les fonctionnaires n’avaient pas à l’esprit les syndicats composés de travailleurs de l’économie informelle lorsque les lois et réglementations en question ont été initialement rédigées. Parmi les problèmes qui peuventse poser dans cedernier cas,par exemple, on peut citer l’obligation pour les travailleurs souhaitant créer un syndicat d’indiquer le nom et l’adresse de leur employeur, ce qui suppose une relation traditionnelle employeur-employé unique ; l’obligation pour les travailleurs d’indiquer l’adresse de leur syndicat, ce qui peut être impossible si les travailleurs n’ont pas les moyens d’obtenir une adresse ; l’obligation pour les travailleurs de joindre une copie de leur carte d’identité, ce qui peut être impossible pour certains travailleurs de l’économie informelle ; et/ou l’obligation d’être alphabétisé ou d’avoir un certain niveau d’éducation. En outre, les lois ou les règlements peuvent exiger que les personnes qui enregistrent une association n’aient pas de casier judiciaire. Cela aussi peut être difficile pour les travailleurs de l’économie informelle, car de nombreux États maintiennent des lois sur le vagabondage qui violent les droits et qui pénalisent pénalement les travailleurs de l’économie informelle. Les États devraient prendre des mesures pour s’assurer que les informations pertinentes soient largement diffusées et que les procédures soient accessibles, simples et rapides.
36. Dans la mesure où certaines formalités sont nécessaires pour établir un syndicat dans la pratique, le processus d’accomplissement de ces formalités devrait être aussi rapide que possible, et ces formalités ne devraient pas être appliquées d’une manière qui retarde ou empêche la création de syndicats. Le Comité de la liberté syndicale a souligné ce point en ce qui concerne le Cameroun, la Guinée équatoriale, l’Indonésie, la Tunisie, la Colombie, l’Algérie, le Panama, la Hongrie, la République de Corée et le Guatemala67. En outre, comme
66 Voir 357e rapport du Comité de la liberté syndicale (2010), Cas nº 2701, par. 137 ; 360e rapport du Comité de la liberté syndicale (2011), Cas no 2301, par. 70 ; 362e rapport du Comité de la liberté syndicale (2011), Cas no 2812, para 388 ; 362e rapport du Comité de la liberté syndicale (2011), Cas no 2723, para 842 ; 363e rapport du Comité de la liberté syndicale (2012), Cas no 2868, para 1005 ; 365e rapport du Comité de la liberté syndicale (2012), Cas no 2723, para 778 ; 367e rapport du Comité de la liberté syndicale (2013), Cas no 2944, para 138 ; 367e rapport du Comité de la liberté syndicale (2013), Cas no 2952, para 876 ; 370e rapport du Comité de la liberté syndicale (2013), Cas no 2961, par 489 ; 377e rapport du Comité de la liberté syndicale (2016), Cas no 3128, par. 466.
67 Voir 340e rapport du Comité de la liberté syndicale (2006), Cas no 2439, par. 360 ; 340e rapport du Comité de la liberté syndicale (2006), Cas no 2431, par. 923 ; 342e rapport du Comité de la liberté syndicale (2006), Cas no 2441, par. 624 ; 354e rapport du Comité de la liberté syndicale (2009), Cas no 2672, par. 1137 ; 356e rapport du Comité de la liberté syndicale (2010), Cas no 2672, par. 1275 ; 357e rapport du Comité de la liberté syndicale (2010), Cas no 2701, par. 137 ; 357e rapport (2010), Cas no 2677, par. 298 ; 359e rapport du Comité de la liberté syndicale (2011), Cas no 2751, par. 1043 ; 360e rapport du Comité de la liberté syndicale (2011), Cas no 2777, par. 779 ; 363e rapport du Comité de la liberté syndicale (2012), Cas no 1865, par. 125 ; 365e rapport du Comité de la liberté syndicale (2012), Cas no 2840, par. 1057 ; 367e rapport du Comité de la liberté syndicale (2013), Cas no 2944, par. 1057 ; 375e rapport du Comité de la liberté syndicale (2015), Cas no 2777, par. 39 ; 376e rapport du Comité de la liberté syndicale (2015), Cas no 3042, par. 535.
l’ont déjà souligné le Rapporteur spécial et le Comité de la liberté syndicale, il ne faut pas imposer des exigences minimales en matière d’affiliation qui auraient pour effet d’entraver indûment la capacité des travailleurs à former des syndicats dans la pratique68. Ceci est particulièrement important dans le contexte de l’économie informelle, où les lieux de travail individuels sont souvent très petits. Dans ce contexte, le Rapporteur spécial souhaite attirer l’attention sur lefait qu’un nombre minimumdeparticipants beaucoup plus faibleest souvent nécessaire pour former des syndicats d’employeurs, contrairement aux syndicats de travailleurs, ce qui suggère une approche discriminatoire et l’absence de motif légitime.
37. La capacité des travailleurs del’économie informelle à former librementdes syndicats peut également être entravée par le fait que l’espace est occupé par des organismes préexistants, qui peuvent ne pas être entièrement libres et indépendants, mais plutôt liés à des intérêts étatiques ou non étatiques particuliers, et qui n’accordent pas la priorité aux intérêts des travailleurs du secteur concerné dans son ensemble. Plus généralement, certains États occupent indûment l’espace de la société civile en créant des syndicats officiels ou en soutenant certains syndicats plutôt que d’autres, ce qui limite fortement la liberté d’association dans la pratique. Dans de tels contextes, il n’est pas rare que les syndicats perçuscommedesopposantsfassentl’objetd’attaques,depoursuitespénales,deprocès,d’un climat administratif hostile et de harcèlement de la part des autorités et d’acteurs non étatiques
38. Dans de nombreux contextes, même lorsque les lois régissant la formation des syndicats sont relativement peu restrictives, les employeurs, les autorités de l’État oud’autres acteurs peuvent intimider les travailleurs qui cherchent à former des syndicats indépendants et exercer des représailles à leur encontre, ce qui constitue un obstacle supplémentaire à la formation de syndicats dans la pratique. La situation est particulièrement difficile pour plusieurs des catégories de travailleurs mentionnées ci-dessus, notamment :
• les travailleurs qui se heurtent à des obstacles à la formation de communautés et à l’accès à l’information, par exemple parce qu’ils travaillent à domicile ;
• les travailleurs qui travaillent et/ou vivent sur la propriété d’autrui, y compris les travailleurs domestiques et de nombreux travailleurs agricoles, qui peuvent être expulsés de leur domicile et de leur emploi si leur employeur n’est pas favorable à leurs activités syndicales, qui peuvent être plus facilement et plus agressivement ciblés par les autorités chargées de l’application de la loi au motif qu’ils sont présents sur la propriété privée d’autrui, et qui sont souvent particulièrement vulnérables aux abus et à l’exploitation de la part des personnes pour lesquelles ils travaillent ;
• les travailleurs vulnérables ou appartenant à des groupes marginalisés ou victimes de discrimination, notamment les femmes, les mineurs, les personnes issues de races ou d’ethnies discriminées, etc.
39. La situation est particulièrement désastreuse pour les travailleurs dont le travail est criminalisé, notamment les travailleurs du sexe, car le cadre criminel dans lequel ces travailleurs opèrent rend particulièrement difficile pour ces derniers de s’associer ouvertement et de tenter d’obtenir de meilleurs droits. La vente ambulante, elle aussi, reste souvent criminalisée dans les lois nationales ; s’il est possible d’obtenir une licence, les procédures pour y accéder sont souvent difficiles d’accès et excessivement discrétionnaires.
40. L’isolement des travailleurs de l’économie informelle les plus marginalisés et les attaques dont ils font l’objet entraînent souvent un cycle négatif qui se renforce de lui-même, en aggravant l’état de vulnérabilité initial dans lequel se trouvent ces travailleurs.
41. Même lorsque des syndicats de travailleurs de l’économie informelle sont en mesure de se constituer, il se peut que la politique de l’État limite cette formation au niveau local, de la ville ou de l’État, empêchant ainsi la formation de syndicats plus universels. De tels obstaclesontétérencontrésparexempleparlesramasseursd’orduresduKarnataka,quin’ont pas pu enregistrer de syndicat au niveau de l’État69. Cela peut entraîner des coûts en termes de temps et de ressources pour les efforts d’organisation syndicale, et peut réduire le pouvoir
68 Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, OIT (6e éd., 2018), par. 435-447.
69 Voir Soumission, Homenet South Asia.
de négociation final des travailleurs du secteur en question. Pour ces raisons, de telles limitations ne devraient pas s’appliquer ; au contraire, les travailleurs devraient être libres de déterminer l’échelle à laquelle ils cherchent à s’organiser, y compris au niveau transnational, s’ils le souhaitent.
42. Parmi les évolutions positives, on peut citer le développement par les États de structures permettant aux syndicats de mieux faire entendre leur voix dans la politique nationale, y compris les forums tripartites et autres, ou d’autres institutions conçues pour promouvoir la négociation collective. Toutefois, les travailleurs de l’économie informelle sont souvent exclus de ces espaces, notamment parce que les cadres juridiques et institutionnels existants sont souvent mal adaptés aux contextes, besoins et défis spécifiques auxquels sont confrontés les différents types de travailleurs de l’économie informelle. Entre autres, la capacité des travailleurs de l’économie informelle à s’engager dans des négociations collectives efficaces est souvent limitée par le fait que ces travailleurs doivent négocier avec de multiples entités différentes afin d’obtenir de meilleures conditions de travail. Il est important que ces lacunes soient comblées dans la législation et la pratique 43. Les États devraient notamment prendre des mesures positives pour créer et soutenir des forums de négociation collective et d’autres mécanismes appropriés, indépendants et dotés de ressources suffisantes, qui permettent aux travailleurs de l’économie informelle de défendre efficacement leurs intérêts et leurs points de vue. Les travailleurs de l’économie informelle devraient être associés aux discussions conduisant à la création de tels organes. Il convient également de créer des mécanismes permettant aux travailleurs de l’économie informelle de participer régulièrement à l’élaboration des lois et des politiques qui les concernent. Au niveau local, les travailleurs de l’économie informelle, y compris les vendeurs de rue et les collecteurs de déchets, par exemple, devraient avoir un rôle et une voix significatifs dans la réglementation des espaces dans lesquels ils opèrent. Plus généralement, les travailleurs de l’économie informelle devraient être consultés de manière significative chaque fois que des projets d’infrastructure ou d’aménagement urbain susceptibles d’affecter leurs moyens de subsistance sont entrepris. Plus généralementencore, l’État devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour créer un environnement favorable à la société civile
C. Restrictions de grèves et attaques contre les grévistes
44. Le droit de grève est insuffisamment reconnu dans le monde entier pour les travailleurs de l’économie formelle et informelle. Même lorsqu’il existe une procédure légale permettant d’entamer une grève, les États restreignent souvent ce droit de manière inappropriée, en ne reconnaissant pas de nombreuses grèves légales. Dans d’autres cas, les États ne respectent pas leur obligation de protéger ce droit, notamment en permettant à des acteurs non étatiques d’attaquer et d’intimider des grévistes potentiels
45. Le Comité de la liberté syndicale a souligné l’importance fondamentale du droit de grève des travailleurs pour la défense de leurs intérêts économiques et sociaux70. Si, dans ce contexte, le Comité a souligné que les grèves « de nature purement politique ne bénéficient pas de la protection des conventions nos 87 et 98 », il convient de noter que cette limitation doit être interprétée de manière très restrictive, car les grèves peuvent avoir lieu dans le but de protester ou d’influer sur « les politiques économiques et sociales d’un gouvernement », ou dans le cadre d’une « protestation générale »71. Le Rapporteur spécial souligne en outre que ledroit àla libertéde réunion pacifique au sens large, telqu’il est couvertpar sonmandat, s’étend incontestablement à l’expression politique, qui devrait en fait bénéficier d’une protection particulière.
46. Dans de nombreux États du monde, les autorités chargées de l’application des lois et les acteurs non étatiques réagissent fréquemment aux grèves en les dispersant, en recourant à une force disproportionnée et en les criminalisant, ce qui constitue une violation du droit de grève. Les grévistes de l’économie informelle sont particulièrement vulnérables, dans la mesure où les organisations et le travail auxquels ils participent ne sont souvent pas reconnus
70 Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, OIT (6e éd., 2018), par. 751-782.
71 Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, OIT (6e éd., 2018), par. 761, 763, 782.
officiellement. En Inde, plusieurs personnes ont été portées disparues à la suite de grèves massives des agriculteurs en 2021.72
D. Attaques contre des organisateurs et des membres de syndicats
47. Les organisateurs et les membres des syndicats de travailleurs de l’économie informelle, comme les autres organisateurs syndicaux, ont souvent fait l’objet de diverses formes d’attaques. Le Rapporteur spécial a reçu des informations suggérant que dans de nombreuxÉtats, la situation s’est aggravéependant et après la COVID-19, en particulierpour les personnes dont le travail se déroule dans les espaces publics ou est lié à ceux-ci, notamment en raison du renforcement des approches restreignant la capacité des individus à s’associer dans les espaces publics qui s’est développé parallèlement à la propagation du virus. Cette situation est particulièrement préoccupante pour les vendeurs de rue, par exemple, qui jouent souvent un rôle essentiel dans la distribution de nourriture et dont les conditions de travail se sont souvent dégradées au cours de la pandémie de COVID-19 D’autre part, certains États ont pris des mesures positives pour reconnaître certains travailleurs de l’économie informelle comme des travailleurs de première ligne méritant un traitement positif pendant la pandémie de COVID-1973. Les avantages accordés étaient cependant souvent limités et l’inclusion ne s’est généralement pas traduite par une amélioration des droits et de la reconnaissance au cours de la période de rétablissement de la pandémie74 .
48. En juin 2019, le président du Syndicat des travailleurs ruraux de Rio Maria a été abattu. Les membres du Mouvement des travailleurs ruraux sans terre ont également été fréquemment attaqués par le passé, notamment lorsque Márcio Matos a été tué en janvier 2017. D’autres organisateurs ruraux, comme Francisca das Chagas Silva, qui militait également pour les droits des femmes, ont également été tués. En Colombie, les militants syndicaux de l’économie informelle, dont plusieurs représentent les travailleurs ruraux et agricoles, ont également fait l’objet d’attaques fréquentes au cours des dernières années, au cours desquelles de nombreux dirigeants syndicaux ont été tués. Le Rapporteur spécial est également très inquiet d’avoir reçu des informations selon lesquelles des organisateurs de travailleurs agricoles ont récemment été détenus au Cambodge 49. Dans une décision rendue en 2022, le Comité de la liberté syndicale a examiné la situation d’un groupe de dockers de Lima (Pérou), qui avait fait l’objet de représailles de la part d’une entreprise locale et dont les dirigeants avaient été arrêtés, inculpés au pénal et condamnés à des peines de prison. En réponse, le Comité de la liberté syndicale a souligné que « nul ne doit faire l’objet de mesures préjudiciables en raison de l’exercice d’activités syndicales légitimes et que les affaires de discrimination antisyndicale devraient être traitées de manière rapide et efficace par les institutions compétentes », a voulu « croire que le gouvernement s’est assuré qu’aucun membre du syndicat » ayant fait l’objet d’arrestations, d’inculpations et de détentions « n’a vu son accès à l’emploi entravé », et a demandé au gouvernement « d’accorder des indemnisations adéquates aux travailleurs qui ont été emprisonnés et qui ont été libérés à la suite des jugements de la Cour supérieure de justice de Lima et de la Cour suprême »75 50. Dans tous les secteurs de l’économie informelle, les travailleurs sont vulnérables et souvent confrontés à la violence et au harcèlement. Pour les travailleurs domestiques, ces actes sont souvent commis par les employeurs et les membres de leur famille directement dans leur domicile privé. Pour les travailleurs dans les lieux publics, le harcèlement peut être le fait d’intermédiaires ou d’agents des forces de l’ordre. Les États devraient signer et respecter la convention 190 de l’OIT sur la violence et le harcèlement et prendre des mesures immédiates et efficaces pour lutter contre toutes ces formes de violence et de harcèlement.
72 Voir Amnesty International, Inde: Le gouvernement doit cesser de réprimer la contestation paysanne et de diaboliser les dissidentes (9 février 2021).
73 Voir Soumission, Homenet South Asia.
74 Voir ibid
75 Voir 400e rapport du Comité de la liberté syndicale (2022), Cas no 3306, par. 621-622.
51. Comme l’ont montré les sections précédentes, les travailleurs devraient jouir pleinement de leurs droits à la liberté de réunion pacifique et d’association, quel que soit le niveau d’intégration de leur emploi dans le secteur formel.Dans le même temps, compte tenu des lois restrictives existantes, ainsi que des formes de discrimination qui se chevauchent et des défis socio-économiques auxquels sont confrontés les acteurs de l’économie informelle, les travailleurs jouissent souvent d’une protection d’autant plus grande que le secteur dans lequel ils travaillent est formel. Cependant, l’intégration dans le secteur formel peut signifier beaucoup de choses différentes – parfois, elle peut représenter un élargissement progressif des droits et des protections ; à d’autres moments, une main plus lourde de coercition et de contrôle. Il est important que des efforts soient faits pour étendre l’intégration progressive dans le secteur formel du premier type, conformément aux principes énoncés dans la recommandation n° 204 de l’OIT, et que les États prennent des mesures pour éviter que les travailleurs ne soient dépouillés des droits et protections dont ils bénéficient déjà par le biais d’une modalité ou d’une autre. En outre, il est essentiel que les processus en question constituent une intégration au secteur formel menée par les travailleurs, dans laquelle les travailleurs de l’économie informelle eux-mêmes jouent un rôle clé au sein des processus en question
52. En réalité, l’économie informelle s’est développée et englobe désormais la majorité des travailleurs dans de nombreux États. C’est le cas, par exemple, au Zimbabwe et au Nigéria, selon les rapports que le Rapporteur spécial a reçus. L’augmentation de la taille de l’économie informelle par rapport à l’économie formelle est due à de nombreux facteurs, notamment les politiques néolibérales mondiales, les réformes structurelles qui ne tiennent pas compte des besoins des travailleurs et la reconnaissance par certains acteurs de l’État et dusecteurprivéquelaforcedessyndicatspeutêtrediminuéepardespolitiquesquifavorisent l’intégration au secteur informel. La portéecroissante des sanctions a également eu unimpact négatif sur de nombreuses économies, contribuant souvent à réduire l’économie formelle et à développer l’économie informelle.
53. Il n’est d’ailleurs pas rare que des lois théoriquement conçues pour « régulariser l’économie informelle » laissent en fait les travailleurs dans des situations de plus en plus vulnérables. C’est le cas, par exemple, de la Loi no 13 467, adoptée au Brésil en juillet 2017. En Inde également, certaines réformes récentes du secteur du travail ont affaibli la capacité des travailleurs à bénéficier de contrats sûrs, assortis de l’ensemble des protections et avantages accordés aux travailleurs.
54. Souvent, les employeurs ont tenté d’échapper à la législation du travail et d’empêcher les travailleurs de bénéficier des protections et des avantages qu’ils exigent en recourant à diverses approches dans lesquelles la relation de travail est déguisée, y compris des relations informelles, limitées dans le temps ou de sous-traitance avec les travailleurs76. Cela a été le cas, par exemple, en Afrique du Sud77. Comme l’a souligné la CEACR, « le recours au travail occasionnel sur une base régulière, pour mener à bien des activités qui concernent l’activité principale de l’entreprise […] est une forme de relation de travail déguisée et contribue à la précarité naturelle de ce type de travail »78. De telles pratiques privent les travailleurs de leurs droits et doivent être évitées. Les États devraient prendre des mesures fermes pour combler les lacunes juridiques qui permettent à ces stratégies de réussir. Il convient notamment d’éviter les dispositions légales qui limitent la possibilité pour les travailleurs de porter plainte pour licenciement abusif à ceux qui ont été employés pendant une période donnée, ou qui restreignent d’une manière ou d’une autre la possibilité pour les travailleurs à plus court terme d’accéder aux prestations, car de telles mesures encouragent les employeurs à maintenir les travailleurs dans des emplois à court terme.
76 Voir CEACR, Promouvoir l’emploi et le travail décent dans un monde en mutation, Conférence internationale du Travail, 109e session, 2020 (ci-après dénommé « Rapport PEDWCL »), par. 191.
77 Voir Paul Benjamin, Informal Work and Labour Rights in South Africa, 29 Industrial Law Journal 1579, 1582 (2008).
78 Rapport PEDWCL, par. 287.
55. Bien qu’il soit souvent annoncé comme faisant partie d’un avenir meilleur, l’essor de l’économie « des petits boulots » a souvent été lié à des limitations de l’économie formelle, notamment par la classification erronée du statut d’emploi des travailleurs et le déplacement de ces derniers vers des postes de plus en plus précaires, avec moins d’avantages et de protections. Les initiatives devilles intelligentes ont elles aussi parfois été liées à des attaques contre les travailleurs de l’économie informelle, comme par exemple en Ouganda où, selon les informations que le Rapporteur spécial a reçues, les vendeurs ambulants ont été chassés des rues après le lancement de l’initiative « Kampala ville intelligente ».
56. À cet égard, des exemples positifs peuvent être trouvés dans la législation du travail de plusieurs États. En Australie, la législation du travail interdit de licencier des travailleurs et de les réembaucher en tant que vacataires79. En Argentine et au Gabon, la législation du travail prévoit que les contrats frauduleux sont nuls et non avenus80. En Algérie, en Arménie, en Belgique, en Colombie et à Malte, la législation rend les employeurs automatiquement responsables du paiement de l’intégralité des cotisations dues aux personnes employées dans le cadre de contrats frauduleux81. Au Chili, le code du travail interdit :
57. le recours à tout subterfuge, dissimulation, déguisement ou altération de l’identité ou de la propriété s’il a pour effet d’éviter le respect des obligations en matière de travail et de sécurité sociale établies par la loi ou la convention Est considérée comme subterfuge toute modification entreprise de mauvaise foi par l’établissement de dénominations sociales différentes, la création d’identités juridiques, la division de l’entreprise ou d’autres moyens qui entraînent pour le travailleur une réduction ou une perte des droits individuels ou collectifs du travail et, en particulier, en ce qui concerne les premiers, des primes ou indemnités pour années de service, et en ce qui concerne les seconds, du droit de s’organiser et de négocier collectivement82 .
58. La responsabilité de la reclassification des relations de travail désignées de manière inappropriée varie d’un pays à l’autre83. La recommandation no 198 de l’OIT (2006) sur la relation de travail suggère que les États « autorisent une grande variété de moyens pour déterminer l’existence d’une relation de travail » et qu’ils « établi[ssent] une présomption légale d’existence d’une relation de travail lorsqu’on est en présence d’un ou de plusieurs indices pertinents »84 .
F. Absence de législation et de pratique interdisant effectivement la discrimination à l’encontre des organisateurs et des membres de syndicats
59. De nombreux États ne disposent pas de lois strictes limitant la discrimination à l’encontre des organisateurs et des membres de syndicats. Les droits des travailleurs à la liberté de réunion pacifique et d’association sont généralement restreints chaque fois qu’ils ont des raisons de craindre que des activités pro-syndicales ou la participation à des grèves puissent entraîner leur licenciement, voire pire. Par conséquent, le respect de ces droits nécessite des mesures juridiques fortes limitant la capacité des employeurs à s’engager dans de telles activités, et les pénalisant s’ils le font
60. Le Comité de la liberté syndicale a déjà souligné l’importance de ces mesures et la nécessité de prendre des mesures rapides et efficaces pour garantir l’absence de discrimination à l’embauche, pendant l’emploi ou lors du licenciement de membres d’un syndicat ou de personnes potentiellement intéressées par l’adhésion à un syndicat, pour
79 Rapport PEDWCL, par. 287.
80 Voir Argentine (loi no 20744 sur les contrats de travail, art. 14) et Gabon (Code du travail, art. 3 à 5), cité dans Rapport PEDWCL, par. 196.
81 Voir Algérie, Arménie, Belgique (loi-programme (I) de 2006, art. 340), Colombie (Code du travail, art. 198) et Malte (ordonnance nationale sur la situation dans l’emploi (SL 452.108), cité dans Rapport PEDWCL, par. 196.
82 Chili (article 507 du Code du travail), cité dans Rapport PEDWCL, par. 196.
83 Voir Rapport PEDWCL, par. 198.
84 OIT, Recommandation (n° 198) sur la relation de travail, 2006, par. 11(a-b) ; voir aussi Rapport PEDWCL, par. 233-235.
rétablir dans leurs fonctions les syndicalistes licenciés à tort et pour leur offrir des voies de recours appropriées.85
61. Le Comité de la liberté syndicale a souvent demandé aux États de veiller à ce que les personnes ne puissent pas faire l’objet de discriminations dans le cadre de leur emploi en raison de leurs activités et de leur engagement en faveur des syndicats. En réponse à une communication concernant le Qatar, le Comité a demandé à ce pays d’« assurer la protection contre [le fait de ] subordonner l’emploi d’un travailleur à la condition qu’il ne s’affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d’un syndicat » et contre le fait de « congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tout autre moyen, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales»86. Ces dernières années, le Comité de la liberté syndicale a également insisté sur un point similaire en ce qui concerne des États comme le Salvador, la Turquie, la Colombie, le Guatemala, l’Argentine, le Mexique, la Pologne, le Paraguay, le Pérou, la Bolivie, les Comores, la Thaïlande, la Géorgie, le Brésil, le Monténégro, la Hongrie, la République dominicaine, le Honduras, Maurice, l’Algérie et le Myanmar87
62. Les États devraient ratifier la Convention (no 190) de l’OIT sur la violence et le harcèlement. L’article 5 de cette Convention stipule que les États doivent :
63. promouvoir et réaliser les principes et droits fondamentaux au travail, à savoir la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective, l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire, l’abolition effective du travail des enfants et l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession, et aussi promouvoir le travail décent.
64. Bien que réitérés par la Convention (no 190) de l’OIT, ces principes découlent également de nombreuses autres dispositions du droit international humanitaire et devraient être reconnus par tous les États
85 Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, OIT (6e éd., 2018), par. 1072-1186.
86 371e rapport du Comité de la liberté syndicale (2014), Cas no 2988, par. 858.
87 340e rapport du Comité de la liberté syndicale (2006), Cas no 2418, par. 811 ; 340e rapport du Comité de la liberté syndicale (2006), Cas no 2351, par. 1350 ; 342e rapport du Comité de la liberté syndicale (2006), Cas no 2356, par. 364 ; 342e rapport du Comité de la liberté syndicale (2006), Cas no 2390, par. 563 ; 344e rapport du Comité de la liberté syndicale (2007), Cas no 2456, par. 278 ; 344e rapport du Comité de la liberté syndicale (2007), Cas no 2479, par. 1051 ; 344e rapport du Comité de la liberté syndicale (2007), Cas no 2474, par. 1153 ; 346e rapport du Comité de la liberté syndicale (2007), Cas no2487, par. 928 ; 348e rapport du Comité de la liberté syndicale (2007), Cas no 2356, par. 372 ; 348e rapport du Comité de la liberté syndicale (2007), Cas no 2526, par. 1046 ; 349e rapport du Comité de la liberté syndicale (2008), Cas no 2498, par. 744 ; 350e rapport du Comité de la liberté syndicale (2008), Cas nº 2553, par. 1538 ; 351e rapport du Comité de la liberté syndicale (2008), Cas no 2582, par. 240 ; 351e rapport du Comité de la liberté syndicale (2008), Cas nº 2594, par. 1177 ; 353e apport du Comité de la liberté syndicale (2009), Cas nº 2619, par. 582 ; 353e rapport du Comité de la liberté syndicale (2009), Cas nº 2557, par. 840 ; 353e rapport du Comité de la liberté syndicale (2009), Cas nº 2634, par. 1303 ; 354e rapport du Comité de la liberté syndicale (2009), Cas nº 2594, par. 1080 ; 355e rapport du Comité de la liberté syndicale (2009), Cas no 2609, par. 864 ; 355e rapport du Comité de la liberté syndicale (2009), Cas nº 2648, par. 960 ; 356e rapport du Comité de la liberté syndicale (2010), Cas nº 2663, par. 761 ; 357e rapport du Comité de la liberté syndicale (2010), Cas nº 2676, par. 299 ; 359e rapport du Comité de la liberté syndicale (2011), Cas nº 2773, par. 301 ; 359e rapport du Comité de la liberté syndicale (2011), Cas no 2769, par. 483 ; 359e rapport du Comité de la liberté syndicale (2011), Cas no 2752, par. 918 ; 360e rapport du Comité de la liberté syndicale (2011), Cas nº 2775, par. 728 ; 363e rapport du Comité de la liberté syndicale (2012), Cas nº 2819, par. 537 ; 363e rapport du Comité de la liberté syndicale (2012), Cas no 2811, par. 658 ; 363e rapport du Comité de la liberté syndicale (2012), Cas no 2875, par. 693 ; 370e rapport du Comité de la liberté syndicale (2013), Cas no 2985, par. 423 ; 371e rapport du Comité de la liberté syndicale (2014), Cas no 3010, par. 666; 372e rapport du Comité de la liberté syndicale (2014), Cas no 2989, par. 316 ; 374e rapport du Comité de la liberté syndicale (2015), Cas no 3052, par. 584 ; 376e rapport du Comité de la liberté syndicale (2015), Cas no 3027, par. 297 ; 376e rapport du Comité de la liberté syndicale (2015), Cas no 3042, par. 546 ; 376e rapport du Comité de la liberté syndicale (2015), Cas no 3086, par. 783 ; 377e rapport du Comité de la liberté syndicale (2016), Cas no 3104, par. 110 ; 378e rapport du Comité de la liberté syndicale (2016), Cas no 3171, par. 488.
65. Certaines pratiques positives en matière de mesures non discriminatoires sont disponibles en Italie, où un tribunal de Bologne a jugé que Deliveroo avait indirectement discriminé les chauffeurs exerçant leur droit de grève, en raison de la manière dont l’algorithme de l’entreprise pénalisait ces chauffeurs en fonction de leur indisponibilité pendant la grève88
G. Lanécessitédeveillerà cequelesdroits dutravailetdeprotectionsociale soient étendus à tous
66. De nombreux travailleurs de l’économie informelle – qui sont souvent issus de groupes minoritaires, marginalisés et/ou victimes de discrimination – bénéficient presque inévitablement d’une protection du travail moindre que ceux de l’économie formelle. Les vulnérabilités cumulées de nombreux travailleurs de l’économie informelle les rendent particulièrement vulnérables aux formes d’exploitation du travail, y compris le travail forcé, la servitude et l’esclavage. Plus généralement, les travailleurs de l’économie informelle n’ont souvent pas accès aux soins de santé, aux congés de maladie, aux vacances, au salaire minimum, à la durée maximale du travail, aux normes de santé et de sécurité sur le lieu de travail, aux indemnités, aux allocations de chômage et aux prestations de vieillesse. Malheureusement,lestravailleurssevoientsouventrefusercesdroitssurlabase d’arguments non solides, par exemple parce qu’ils travaillent dans le cadre de contrats de service plutôt que de contrats de travail. Le fait que de nombreux États incluent ces travailleurs dans leurs statistiques du travail tout en ne veillant pas à ce qu’ils bénéficient de l’ensemble de leurs droits, ainsi que le fait que les travailleurs de l’économie informelle sont lourdement taxés par rapport aux prestations qu’ils reçoivent, payant souvent un pourcentage plus élevé de leurs revenus en impôts que ceux qui se situent plus haut dans l’échelle des revenus (notamment en raison des taxes sur la valeur ajoutée sur les biens et services essentiels en particulier), montrent clairement qu’il y a deux poids et deux mesures en l’occurrence.
L’extension des droits des travailleurs et des droits sociaux dans le cadre des systèmes existants devrait toujours être interprétée de la manière la plus large possible, et des réformes juridiques devraient être entreprises pour garantir que les droits en tant que tels s’étendent également de la manière la plus large possible
67. En outre, le Rapporteur spécial souligne qu’il est essentiel dans ce contexte que les droits sociaux et du travail en général soient aussi solides que possible, car l’extension de ces droits aux travailleurs de l’économie informelle apportera naturellement un avantage équivalent à la solidité des ordres juridiques en question. Dans le même temps, l’élargissement de la base des partisans de ces politiques a un rôle clé à jouer dans la création d’un soutien politique à ces mesures, ce qui peut contribuer à une évolution positive et à la pérennisation des acquis
68. La Convention (n° 187) sur lecadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail de l’OIT et la Recommandation (n° 197) qui l’accompagne s’appliquent toutes deux aux travailleurs du secteur informel et du secteur formel. La Recommandation no 197 invite notamment les programmes nationaux de santé et de sécurité à « prévoir des mesures appropriées pour la protection de tous les travailleurs », y compris en particulier « les travailleurs dans les secteurs à haut risque ainsi que les travailleurs vulnérables tels que ceux de l’économie informelle ». Les États devraient veiller à ce que toutes les mesures qu’ils prennent soient conformes à ces instruments. La Recommandation (no 204) de 2015 de l’OIT sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle invite les États à :
• prendre des mesures immédiates afin de remédier aux conditions de travail dangereuses et insalubres qui caractérisent souvent le travail dans l’économie informelle ; et
• promouvoir la protection de la sécurité et de la santé au travail et l’étendre aux employeurs et aux travailleurs de l’économie informelle89
88 Voir Business & Human Rights Resource Centre, “Italian court rules against ‘discriminatory’ riderranking algorithm” (5 janvier 2021).
89 OIT, La transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015 (no 204), par. 17.
69. Le Rapporteur spécial approuve ces recommandations et invite les États à étendre les protections du travail aux travailleurs occasionnels et aux travailleurs de l’économie informelle. Les normes de sécurité sur le lieu de travail devraient s’appliquer à tout type de travail et ne pas être limitées par son degré de formalité. Dans ce contexte, il est important que les États prennent pleinement en compte les différentes situations des différents travailleurs et élaborent les lois et politiques pertinentes de manière à garantir une protection maximale.Toutcommelestravailleursdel’économieformelle,lestravailleursdel’économie informelle devraient bénéficier d’une indemnisation lorsqu’ils sont blessés dans le cadre de leur travail. La loi sud-africaine récemment adoptée sur l’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles (Compensation for Occupational Injuries and Diseases Amendment Act) constitue un exemple positif à cet égard, dans la mesure où elle étend la couverture aux travailleurs domestiques en particulier90. Les lois sur le salaire minimum devraient couvrir tant les travailleurs de l’économie informelle que ceux de l’économie formelle. Les États devraient également veiller à ce que tous les travailleurs puissent avoir accès à de l’eau propre et à des services d’assainissement appropriés, ainsi qu’àunéclairageadéquat,cequinécessiteranotammentlamiseàdispositionparlespouvoirs publics de services auxquels les personnes travaillant dans des espaces publics peuvent avoir accès. Des transports publics sûrs, fiables et abordables sont aussi souvent particulièrement importants pour les travailleurs de l’économie informelle.
70. En outre, les États devraient mettre en place des systèmes d’inspection du travail solides et efficaces, couvrant les travailleurs de l’économie formelle et informelle91. Ces programmes doivent être dotés de ressources suffisantes et leur personnel doit être formé de manière appropriée, afin qu’il puisse jouer son rôle de manière efficace. Il est notamment essentiel de trouver des modes d’inspection dans lesquels les travailleurs de l’économie informelle n’ont pas à craindre de subir des représailles s’ils signalent honnêtement leurs conditions de travail. Pour sa part, la CEACR a appelé les gouvernements à « envisager l’extension progressive du système d’administration du travail de façon à y inclure les travailleursquinesontpas,endroit,destravailleurssalariés »92.Danscecontexte,laCEACR a félicité la Moldavie pour le fait que « les entreprises et les travailleurs opérant dans l’économie informelle entrent dans le champ d’application de la législation sur l’inspection du travail, l’emploi et la protection sociale des personnes à la recherche d’un emploi » 93. En outre, tous les travailleurs, y compris ceux de l’économie informelle, devraient avoir accès à des « des procédures efficaces et accessibles de plainte et de recours »94 .
71. Les États devraient également étendre les prestations sociales à tous les travailleurs. À cet égard, l’extension des programmes de protection sociale de toutes formes à l’économie informelle est extrêmement positive95. Le Rapporteur spécial est encouragé, par exemple, par les rapports indiquant que certains États ont ouvert les régimes de sécurité sociale aux travailleurs migrants. Les programmes publics de soins de santé et d’aide à la maternité devraient être accessibles gratuitement à toutes les personnes.
72. L’extension de ces avantages n’est pas seulement importanteen soi, mais aussi en tant que moyen de renforcer le pouvoir de négociation des travailleurs et, partant, leur capacité à exercer et à jouir de leurs droits à la liberté de réunion pacifique et d’association. Souvent, les travailleurs de l’économie informelle peuvent être dissuadés d’exercer leurs droits dans la pratique en raison de la précarité de leur emploi et de la conscience qu’ils ont des circonstances difficiles auxquelles ils seraient confrontés s’ils perdaient cet emploi. Les programmesdeprotectionsocialeetl’aidesocialepeuventatténuercescraintesen permettant aux travailleurs d’accéder plus facilement à leurs droits sociaux et économiques fondamentaux. En outre, ce type d’aide permet d’aborder et de limiter les formes de
90 Pour plus de détails, voir Socio-Economic Rights Institute of South Africa, COIDA Factsheet (4 juin 2021).
91 Voir OIT, La transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015 (nº204), par. 11q), 27.
92 Rapport PEDWCL, par. 429.
93 Demande directe (CEACR) – adoptée 2010, publiée 100e session CIT (2011), Convention (n° 150) sur l’administration du travail, 1978 – République de Moldavie
94 OIT, La transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015 (nº204), par. 29.
95 Pour discussion, voir Rapport PEDWCL, par. 466-467.
coercition indirecte auxquelles les travailleurs de l’économie informelle sont souvent confrontés.
V. L’importance de reconnaître les limitations des droits des travailleurs de l’économie informelle à la liberté de réunion pacifique et d’association comme une discrimination, et de prendre des mesures correctives appropriées pour remédier à cette discrimination
73. Les États devraientreconnaîtretous les impactsdiscriminatoires ducaractère informel du travail et y remédier. En plus de constituer une violation du droit à la liberté d’association, la limitation de la capacité des travailleurs de l’économie informelle à s’associer devrait être comprise comme une discrimination directe sur la base du statut socio-économique, ainsi qu’une discrimination indirecte partout où les groupes discriminés ou marginalisés sont plus susceptibles d’occuper un emploi informel, ce qui est actuellement le cas dans tous les États, comme détaillé ci-après.
74. Les organes et mécanismes conventionnels des Nations Unies, les mécanismes de contrôle de l’OIT et les tribunaux nationaux et régionaux reconnaissent de plus en plus que le refus de respecter et de protéger les droits des travailleurs de l’économie informelle consacre l’inégalité et peut constituer une discrimination directe et indirecte sur des bases multiples et souvent croisées. Dans le monde entier, les groupes historiquement défavorisés, notamment les femmes, les migrants, les personnes LGBTIQ+, les personnes handicapées, les jeunes, les membres de groupes raciaux minoritaires ou victimes de discrimination, les personnes vivant dans la pauvreté, les personnes vivant dans les zones rurales et les membres de groupes ethniques, religieux et sociaux marginalisés, sont plus susceptibles de travailler dans l’économie informelle. En tant que tels, ces groupes sont affectés de manière disproportionnéeparl’absencedemécanismespermettantderéaliserdemanièresignificative leurs droits à la liberté d’association et à la négociation collective. L’exclusion de leurs droits d’association et de négociation collective exacerbe en outre les désavantages sociaux et économiques auxquels ces groupes sont confrontés.
75. Dans de nombreux pays, la loi interdit aux travailleurs de l’économie informelle de former des syndicats ou d’y adhérer, ou les empêche de s’organiser sur une base équivalente à celle des travailleurs ayant une relation d’emploi reconnue. Les États parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ICESCR) ont l’obligation d’éliminer la discrimination formelle et substantielle fondée sur l’origine sociale, dont l’Observation générale n° 20 de l’ICESCR indique qu’elle inclut le « statut économique et social »96. Les États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ICCPR) doiventveiller àce que toutes les personnes soientégales devantla loi etbénéficient d’une égale protection de la loi sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, lafortune,lanaissanceoutouteautresituation97.Lestravailleursinformelssontgénéralement exclus sans fondement rationnel et ne sont manifestement pas égaux devant la loi 76. Dans une décision récente de la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud, Mahlangu and Another v Minister of Labour and Others,98 les travailleurs domestiques ont contesté avec succès leur exclusion de la législation garantissant une indemnisation pour les blessures, les maladies et les décès liés au travail. En considérant la discrimination directe, la Cour a estimé que l’exclusion des travailleurs domestiques des lois sur l’indemnisation des travailleurs ne répondait à aucun objectif rationnel du gouvernement et que « la différenciation entre les travailleurs domestiques et les autres catégories de travailleurs est arbitraire et incompatible avec le droit à l’égalité de protection et au bénéfice de la loi »99. En 2003, la Cour constitutionnelle de Colombie a reconnu que les ramasseurs de déchets
96 CESCR, Observation générale nº 20, Doc. ONU E/C.12/GC/20 (2009), par. 24.
97 Voir ICCPR, article 26.
98 Mahlangu and Another v Minister of Labour and Others
99 Ibid , par. 72.
informels constituaient un groupe social vulnérable confronté à la discrimination et à l’inégalité des chances,100 et a estimé que les réglementations empêchant les associations de ramasseurs de déchets de soumissionner pour des contrats publics violaient les obligations del’Étatd’adopterdesmesuresenfaveurdesgroupesmarginalisésetdepromouvoirl’égalité véritable
77. En2020,l’ACtHPRaémisunavisconsultatifestimantquelesloissurlevagabondage violaient plusieurs garanties de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, estimant notamment que ces lois constituaient une discrimination fondée sur le statut économique et qu’elles violaient les droits à l’égalité devant la loi et à l’égale protection de la loi101. En concluant que les lois sur le vagabondage sont discriminatoires, la Cour a fait observer que ces lois « répriment en réalité les pauvres et les personnes défavorisées, y compris, mais sans s’y limiter, […] les vendeurs ambulants et les personnes qui utilisent notamment les espaces publics pour subvenir à leurs besoins »102. La Cour a fait observer que les lois sur le vagabondage en Afrique « reflètent une perception dépassée et largement coloniale des individus sans aucun droit [qui] déshumanise etrabaisse ces personnes, quisont perçues comme ayant un statut inférieur »103
78. Le CESCR a souligné que la simple élimination de la discrimination directe par l’État ne suffit pas à garantir l’égalité réelle. Au contraire, les gouvernements doivent porter « une attention suffisante aux groupes de population qui sont en butte à des préjugés hérités de l’histoire ou tenaces » et « adopter immédiatement les mesures nécessaires afin de prévenir, de réduire et d’éliminer les situations et les comportements qui génèrent ou perpétuent une discrimination concrète ou de facto » 104. Le CESCR a également reconnu l’existence d’une « discrimination systémique » lorsque « de règles juridiques, de politiques, de pratiques ou d’attitudes culturelles prédominantes dans le secteur public ou le secteur privé [...] créent des désavantages relatifs pour certains groupes, et des privilèges pour d’autres groupes »105 .
79. Les États ont le devoir de modifier et de réviser régulièrement leur législation afin de s’assurer qu’elle n’est pas discriminatoire ou ne conduit pas à la discrimination, que ce soit directement ou indirectement, en ce qui concerne le droit à la liberté d’association ainsi que tous les autres droits106. Des restrictions juridiques claires sur la capacité des travailleurs de l’économie informelle à s’organiser, des restrictions de facto par le biais de procédures trop discrétionnaires ou bureaucratiquement impossibles d’accès, et le fait de ne pas prendre de mesures suffisantes pour soutenir la capacité des travailleurs de l’économie informelle à s’organiser peuvent tous être considérés comme une violation de l’obligation des États de garantir des systèmes égaux et non discriminatoires
80. Demanièreplusuniverselle,mêmelorsquelesloisen questionsontneutresàpremière vue, – comme c’est généralement le cas – l’exclusion des travailleurs informels des droits d’association est discriminatoire sur la base du genre, car de telles mesures ont un impact disproportionné sur les femmes, qui sont plus susceptibles de travailler dans l’économie informelle. En vertu de l’article 11 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), les États sont tenus de prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de l’emploi. Le Comité CEDAW a notamment estimé que l’article 11 devait porter « exclusivement sur la protection des employés ayant un contrat d’emploi et non sur la protection des travailleurs indépendants »107 .
100 Cour constitutionnelle de Colombie, Sentencia T-724/03 (20 août 2003).
101 Voir ACtHPR, La compatibilité des lois sur le vagabondage avec la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et avec les autres instruments des droits de l’homme applicables en Afrique, (4 décembre 2020), par. 64-75, disponible sur: https://www.africancourt.org/cpmt/storage/app/uploads/public/5fd/0c6/53e/5fd0c653ec0e7417257939.pdf
102 Ibid , par. 70.
103 Ibid , par. 79.
104 CESCR, Observation générale nº 20, par. 8.
105 CESCR, Observation générale nº 20, par. 12.
106 Voir CESCR, Observation générale nº 20, par. 37.
107 Comité CEDAW, Elisabeth de Blok et al. c les Pays-Bas, Comm. no 36/2012, Doc. ONU CEDAW/C/57/D/36/2012 (24 mars 2014).
81. Le CESCR, quant à lui, a reconnu à la fois le fait que le travail dans l’économie informelle est marqué par le genre et certains des impacts de cette répartition du travail basée sur le genre. Le CESCR a noté que « les femmes sont souvent surreprésentées dans l’économie informelle, où elles travaillent, par exemple, comme travailleuses occasionnelles, travailleuses à domicile ou travailleuses indépendantes, ce qui accentue les inégalités dans des domaines tels que la rémunération, la santé et la sécurité, le repos, les loisirs et les congés payés »108. L’impact discriminatoire de l’exclusion des travailleurs de l’économie informelle du droit d’organisation se fait donc sentir à de multiples reprises, car elle limite la capacité de ces travailleurs à accéder à leur droit à la liberté d’association en tant que tel, et les empêche d’utiliser ce droit pour défendre et donc améliorer leur accès à d’autres droits sociaux et économiques.
82. Pour sa part, l’ACtHPR a estimé que les États avaient l’obligation, en vertu du protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, de « créer un environnement dans lequel les femmes pauvres et marginalisées peuvent jouir pleinement de tous leurs droits fondamentaux » 109, et que les lois sur le vagabondage qui permettent « l’arrestation de femmes pauvres et marginalisées » portaient atteinte aux droits des femmes à une protection égale110 .
83. Partout dans le monde, les femmes sont confrontées à des discriminations dues à l’application de lois, de règlements et de pratiques discriminatoires à l’égard des travailleurs de l’économie informelle. Ces impacts discriminatoires sont aussi souvent intersectionnels. Le CESCR111, le Comité CERD,112 le Comité CEDAW et le CEACR113 ont tous approuvé une approche intersectionnelle. La Recommandation générale nº 25 du Comité CEDAW, par exemple, invite les États à accorder une attention particulière aux formes complexes de désavantage dans lesquelles la discrimination raciale est associée à d’autres formes de discrimination, telles que l’âge, le sexe, la religion, le handicap, le statut migratoire et la classe sociale114
84. Danssesobservationsfinales de2022 concernantleZimbabwe,leComité CERDs’est dit préoccupé par le fait que la législation visant à protéger les droits du travail et à prévenir la discrimination ne couvre pas explicitement les travailleurs de l’économie informelle et le travaildomestique115.LeComité aappelélegouvernementàmodifiersalégislationdutravail et à « prendre des mesures pour lutter contre la discrimination fondée sur la race, la classe et le sexe dans tous les domaines de l’emploi »116. Le Comité CERD a souligné que le secteur informel et le travail domestique sont « deux secteurs où les femmes noires sont majoritaires et font face à de faibles salaires, à de mauvaises conditions de travail et à un traitement raciste et déshumanisant de la part des employeurs et des clients de différentes identités raciales ou ethnolinguistiques, ce qui rappelle l’époque d’avant l’indépendance »117 85. La jurisprudence nationale va dans le même sens. La Cour constitutionnelle sudafricaine a estimé que le fait d’exclure les travailleurs domestiques de l’accès à
108 CESCR, Observation générale no 23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables, par. 47d), disponible sur: https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g16/087/52/pdf/g1608752.pdf?token=0K4HXKSSGtBUT7X dMU&fe=true
110 ACHPR, Avis consultatif 001/2018, par. 137.
111 Le CESCR a invité les États parties à reconnaître les cas où des individus ou des groupes sont victimes dediscriminationfondéesurplusd’unmotifinterdit,etasoulignéque« cettediscriminationcumulative a des conséquences bien spécifiques pour les personnes concernées et mérite une attention et des solutions particulières » CESCR, Observation générale nº 20.
112 ACHPR, Avis consultatif 001/2018, par. 137.
113 Voir OIT. Donner un visage humain à la mondialisation (2012), par. 960.
114 Comité CEDAW, Recommandation générale Nº 25 concernant le premier paragraphe de l’article 4 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, portant sur les mesures temporaires spéciales (2004), par. 12.
115 Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. Observations finales concernant le rapport du Zimbabwe valant cinquième à onzième rapports périodiques, Doc. ONU CERD/C/ZWE/CO/5-11 (16 septembre 2021), par. 31.
116 Ibid.
117 Ibid.
l’indemnisation des accidents du travail constituait une discrimination directe et une discrimination indirecte intersectionnelle sur les bases combinées de la classe, de la race et dugenre118.LaCourconstitutionnelleaspécifiquementconcluquel’exclusiondelacatégorie des « travailleurs domestiques », bien qu’ostensiblement neutre, avait un impact disproportionné sur les femmes noires qui sont représentées de manière disproportionnée dans ce type d’emploi. En outre, la Cour a reconnu que cette exclusion était un héritage du système colonial et de l’apartheid, et qu’il s’agissait d’une mauvaise reconnaissance du travail dans la sphère privée, traditionnellement effectué par les femmes, comme n’étant pas un travail approprié
86. Les États devraient également adopter et renforcer les mesures qui reconnaissent et cherchent à remédier à la discrimination fondée sur la pauvreté. Ce point a été souligné dans un rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme, qui a estimé que « le renforcement de l’interdiction de la discrimination fondée sur la précarité socioéconomique est un outil essentiel pour l’élimination de la pauvreté »119. Le caractère informel est en soi un facteur de pauvreté, et l’absence de droits d’association prive les travailleurs d’un mécanisme essentiel pour améliorer les salaires et les conditions de travail.
87. Les travailleurs issus de communautés discriminées ou marginalisées sont plus susceptibles d’être incapables de former et d’adhérer librement à des syndicats et de s’organiser pour exiger de meilleures conditions de travail, ce qui aggrave et renforce l’inégalité sociale et économique et ladiscrimination auxquelles ils sont confrontés. Les États ont le devoir de reconnaître et de remédier à l’impact discriminatoire des cadres juridiques exclusifs et inadéquats qui limitent la capacité de certains groupes à jouir pleinement de leur droit à la liberté d’association.
VI. Pratiques positives relatives à l’organisation de l’économie informelle
88. Comme l’ont montré les sections précédentes, les restrictions aux droits des travailleurs sont très répandues dans le monde contemporain. Ces restrictions sont souvent plus sévères dans l’économie informelle, où elles sont également ressenties de manière plus aiguë, compte tenu de la vulnérabilité supplémentaire fréquente, du manque d’accès aux ressources et d’autres défis auxquels sont confrontés les travailleurs de l’économie informelle
89. Malgré les difficultés, le travail inlassable d’organisateurs dévoués a permis d’obtenir de grands succès dans l’organisation de l’économie informelle dans de nombreux pays à travers le monde. Parmi les efforts d’organisation couronnés de succès, citons ceux qui ont conduit à la formation et/ou à l’expansion de l’Association des femmes exerçant une activité indépendante à Anukatham en Inde, de la Fédération des travailleuses à domicile au Pakistan et de Griha Shramik Mahila Samaj Nepal au Népal,120 ainsi que de la Centrale ouvrière d’Argentina-Autonoma, la Confédération des travailleurs de l’économie informelle en Argentine, l’Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin, le Congrès des syndicats de Fidji, le Congrès des syndicats du Ghana, CIVIDEP en Inde, les Syndicats du secteur informel du Malawi, la Fédération générale des syndicats népalais, le Syndicat des travailleurs de Pérou du Pérou central, le Congrès des syndicats des Philippines et l’Alliance des travailleurs de l’économie informelle, le Congrès sierra-léonais du travail, l’Union tanzanienne des travailleurs de l’industrie et du commerce, l’Organisation nationale des syndicats en Ouganda, le Congrès des syndicats de Zambie et le Congrès des syndicats du Zimbabwe,121 le Syndicat des travailleurs du transport et des services généraux) en Ouganda,
118 Mahlangu and Another v Minister of Labour and Others.
119 Rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté, Doc. ONU A/77/157 (2022), 5.
120 Voir Soumission, Homenet South Asia.
121 Pour plus de détails, voir OIT. Organiser les travailleurs de l’économie informelle en syndicats : Guide à l’intention des organisations syndicales (2019). Voir aussi Supriya RoyChowdhury, Labour Activism
la Confédération nationale des syndicats du transport aux Philippines, l’Association des travailleurs indépendants du transport au Népal, l’Union nationale des travailleurs de Rama, les Services de l’industrie du transport et de la logistique en Colombie et le Syndicat national des travailleurs autonomes de l’économie informelle au Niger.122 En Ukraine, un syndicat représentant les petits entrepreneurs a été créé et est actif depuis plusieurs années, et les efforts visant à créer une représentation organisée pour les travailleurs domestiques ont également été couronnés de succès
90. Les syndicats des travailleurs de l’économie formelle peuvent adopter, et ont adopté à différentes époques, des attitudes différentes à l’égard de la syndicalisation des travailleurs de l’économie informelle. Le soutien de ces syndicats, qu’il s’agisse de partager des compétences ou d’inclure des catégories plus larges de travailleurs sous leur égide, est extrêmement précieux pour élargir l’accès au droit à la liberté d’association pour les travailleurs de l’économie informelle. Le Rapporteur spécial encourage et salue donc les mesures positives qui ont été prises dans de nombreuses juridictions à travers le monde à cet égard
91. Il est important de souligner, en outre, que les initiatives en faveur des droits des travailleurs de l’économie informelle devraient être menées par ces travailleurs, à qui l’on donne la primauté pour élaborer et poursuivre leurs propres revendications. Plus généralement, les travailleurs de l’économie informelle devraient être inclus dans les discussions à différents niveaux visant à élaborer des politiques, y compris toutes les politiques visant à étendre la jouissance des droits des travailleurs et des droits à la liberté de réunion pacifique et d’association en particulier
92. La syndicalisation des travailleurs de l’économie informelle pose souvent le problème de savoir avec qui les travailleurs doivent négocier pour obtenir de meilleures conditions, étant donné que les circonstances et les conditions varient considérablement d’une forme de travail à l’autre dans l’économie informelle. Il n’existe pas de solution unique aux défis posés dans ce domaine ; les travailleurs devraient plutôt être libres d’élaborer leurs propres politiques et approches
93. Enfin, il est important de reconnaître que les travailleurs de l’économie informelle sont des travailleurs, que les travailleurs ont des droits et que les droits des travailleurs sont des droits de l’homme. Bien que la législation et la pratique puissent rester restrictives dans de nombreux contextes, le Rapporteur spécial est encouragé par les rapports indiquant qu’un nombre croissant de travailleurs reconnaissent leurs demandes pour de meilleures conditions et un meilleur traitement comme des revendications de droits en tant que telles, ainsi que par la solidarité au-delà des groupes et des frontières affichée par de nombreux individus et groupes en faveur d’un plus grand épanouissement des droits
VII. Recommandations
94. À la lumière des conclusions susmentionnées, le Rapporteur spécial recommande les actions suivantes afin de garantir le plein respect des droits à la liberté de réunion pacifique et d’association.
A. Recommandations à l’intention des États
95. Les États devraient :
• Veiller à ce que toutes les lois, y compris les lois sur le travail, ne limitent pas le droit d’association aux travailleurs de l’économie formelle, notamment en limitant le droit de former des syndicats aux « employés » ou aux personnes en possession de contrats de travail formels, ou en employant des définitions qui excluent directement ou indirectement tout travailleur.
and Women in the Unorganised Sector: Garment Export Industry in Bangalore, 40 Economic and Political Weekly 2250 (2005).
122 Voir Soumission, ITF Global.
• Veiller à ce que le droit à la liberté d’association soit pleinement exercé, non seulement en droit mais aussi dans la pratique, notamment en éliminant toute forme de pouvoir discrétionnaire excessif et d’obstacle bureaucratique.
• Veiller à ce que les travailleurs de l’économie informelle puissent prendre part aux institutions conçues pour promouvoir la participation des travailleurs, y compris les structures tripartites et les mécanismes conçus pour soutenir la négociation collective
• Prendre des mesures positives pour créer et soutenir des forums de négociation collective et d’autres mécanismes appropriés, indépendants et dotés de ressources suffisantes, spécifiquement conçus pour répondre aux besoins des différents groupes de travailleurs de l’économie informelle, et inclure les travailleurs de l’économie informelle dans les processus de conception et de révision de ces organes
• Veiller à ce que les travailleurs de l’économie informelle, comme tous les autres travailleurs, jouissent pleinement de leur droit de grève
• S’abstenir de commettre ou de soutenir des actes de violence ou de harcèlement à l’encontre de toute personne, y compris tous les travailleurs de l’économie formelle, de l’économie informelle et du monde du travail en général, et se conformer pleinement aux dispositions de la Convention no 190 et de la Recommandation no 206 de l’OIT
• Protéger toutes les personnes, y compris tous les travailleurs de l’économie formelle, de l’économie informelle et du monde du travail en général, contre toutes les formes de violence ou de harcèlement de la part d’acteurs non étatiques.
• Garantir des enquêtes approfondies, l’obligation de rendre des comptes et des voies de recours complètes en cas de violations des droits, y compris, en particulier, les violations impliquant une force illégale
• Assurer l’inclusion progressive dans l’économie formelle conformément à la recommandation no 204 de l’OIT, qui prend en compte « la diversité des caractéristiques, des situations et des besoins des travailleurs et des unités économiques dans l’économie informelle et la nécessité d’ y répondre par des approches spécifiques », par des mesures qui, entre autres, « étend[ent], dans la législation et la pratique, à tous les travailleurs de l’économie informelle, la sécurité sociale, la protection de la maternité, des conditions de travail décentes et un salaire minimum qui tienne compte des besoins des travailleurs et considère les facteurs pertinents, notamment le coût de la vie et le niveau général des salaires dans le pays»123 .
• Veiller à ce que les processus susmentionnés constituent une formalisation menée par les travailleurs, dans laquelle les travailleurs de l’économie informelle jouent un rôle clé et sont consultés de manière significative sur l’ensemble des processus, décisions politiques et pratiques ayant un impact sur leur travail
• Empêcher et supprimer toute limitation des droits des travailleurs imposée sous prétexte que ces travailleurs ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de ces droits, par exemple parce qu’ils font partie de l’économie des petits boulots, parce qu’ils travaillent dans le cadre de contrats à durée limitée ou de contrats temporaires,ouparcequ’ilssontindépendants,touten modifiantleslois sous-jacentes afin de garantir qu’elles couvrent tous les travailleurs
• Veiller, dans la législation et la pratique, à ce qu’aucun travailleur ne fasse l’objet d’une discrimination ou ne subisse des conséquences, en termes d’accès à l’emploi ou autre, en raison de l’exercice ou de la tentative d’exercice de ses droits à la liberté de réunion pacifique et d’association
• Mettre en place des mesures juridiques strictes sanctionnant les employeurs et/ou les acteurs étatiques qui exercent des représailles contre les travailleurs en raison de
123 Recommandation nº 204 de l’OIT, par. 7a), 18.
l’exercice de leurs droits à la liberté de réunion pacifique et d’association, notamment par le biais de licenciements et d’autres formes de représailles.
• Veiller à ce que les dispositions en matière de protection sociale ne soient pas limitées sur la base de la participation à l’économie formelle
• Reconnaître que les cadres juridiques exclusifs et inadéquats en ce qui concerne le droit d’association ont un impact discriminatoire sur les travailleurs issus de communautés marginalisées et victimes de discrimination, et prendre des mesures efficaces pour promouvoir l’égalité réelle, y compris des mesures positives pour garantir que tous les travailleurs de l’économie informelle jouissent pleinement de leurs droits à la liberté de réunion pacifique et d’association.
• Ratifier et respecter les traités pertinents en matière de droits de l’homme et les conventions de l’OIT, y compris toutes les conventions internationales en matière de droits de l’homme ainsi que les Conventions nos 87, 98, 111, 150, 155, 187, 189 et 190 de l’OIT, et respecter les dispositions des recommandations pertinentes, y compris les recommandations nos 197, 198, 204 et 205 de l’OIT.
B. Recommandations à l’intention de la communauté internationale
96. La communauté internationale devrait :
• Compiler des informations plus nombreuses et plus claires sur les restrictions imposéespar lesÉtatsàlacapacitédestravailleursdel’économieinformelled’exercer leurs droits à la liberté de réunion pacifique et d’association.
• Compiler des informationsplus nombreuses et plus claires sur les meilleures pratiques en matière d’association et de droits des travailleurs de l’économie informelle
• Surveiller et appeler systématiquement les États à prendre des mesures pour remédier aux limitations des droits des travailleurs dans l’économie informelle
• Veiller à ce que les travailleurs de l’économie informelle puissent participer aux processus internationaux.
• Inclure dans les accords commerciaux et d’investissement des dispositions garantissant que tous les droits des travailleurs, y compris les droits des travailleurs migrants, soient pleinement protégés
C. Recommandations à l’intention du secteur privé
97. Le secteur privé devrait :
• Respecter pleinement les droits des travailleurs à la liberté de réunion pacifique et d’association, y compris dans le cadre de la formation de syndicats, de la participation à des grèves et à des négociations collectives
• Veiller à ce que des mesures disciplinaires internes soient prises à l’encontre de tout employé qui exerce des représailles contre des travailleurs pour avoir exercé leurs droits à la liberté de réunion pacifique et d’association.
• Reconnaître les relations de dépendance avec les travailleurs tout au long des activités de l’entreprise et élaborer des accords qui maximisent la part de la main-d’œuvre employée dans le cadre d’accords formels
D. Recommandations à l’intention de la société civile
98. La société civile, y compris les syndicats du secteur formel, devrait :
• Soutenir les efforts d’organisation des travailleurs de l’économie informelle
• Travailler à renforcer les connaissances et les compétences des travailleurs de l’économie informelle, afin de leur permettre de mieux faire valoir pleinement et efficacement leurs droits à la liberté de réunion pacifique et d’association.