Caroline Britz

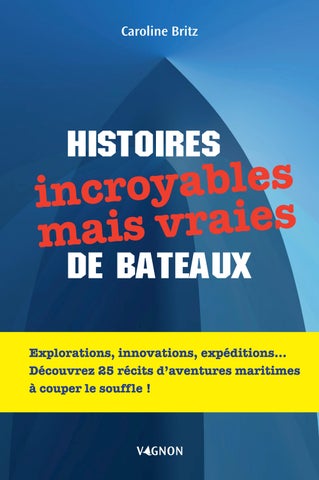
Caroline Britz

Explorations, innovations, expéditions…
Découvrez 25 récits d’aventures maritimes à couper le souffle !
C’est sans doute un des plus grands symboles navals de la Bretagne et une des épaves les plus recherchées par les archéologues. La Cordelière, navire amiral de la flotte bretonne du début du xvie siècle, a coulé dans une explosion qui a aussi emporté son adversaire, le navire britannique Regent. Dans la rade de Brest, on se souvient encore, cinq siècles plus tard, de l’héroïsme d’Hervé de Portzmoguer, dit « Primauguet », et de ses hommes.
À la fin du xve siècle, le duché de Bretagne est encore indépendant et tente de résister à l’expansion du royaume de France. Dotée d’une façade maritime stratégique et d’un réseau de ports actifs (Nantes, Brest, Morlaix, Saint-Malo), la Bretagne investit dans ses forces navales pour protéger ses côtes, défendre ses intérêts commerciaux et affirmer sa souveraineté sur mer. En 1487, le duc François II ordonne la construction d’un grand navire de guerre destiné à devenir le fleuron de sa flotte.
Le chantier débute à Morlaix, sur les rives du Dourduff, sous la direction du maître charpentier Nicolas Coetanlem. Le navire est initialement nommé La Nef de Morlaix, puis La Mareschalle et La Nef de la Royn avant d’être définitivement baptisé La Cordelière par Anne de Bretagne, fille de François II devenue duchesse souveraine, en référence à l’ordre des Cordeliers (franciscains), dont elle adopte la devise et l’emblème.
Le navire est conçu selon les standards des grands bâtiments de guerre de l’époque : une coque en chêne massif, une longueur d’environ 40 m, une capacité de six cents tonneaux, trois mâts, un gréement carré, et une voilure en toile de lin et chanvre. Le calfatage est réalisé à la poix et à la filasse. Le navire est fortement armé avec deux cents pièces d’artillerie, dont seize canons lourds et plusieurs bombardes à roues.
La Cordelière est lancée en 1498, peu après l’union dynastique entre la Bretagne et la France. Bien qu’intégrée à la flotte française, elle conserve une forte identité bretonne, est commandée par des officiers bretons et utilisée dans des missions combinant défense régionale et opérations de portée nationale.
Ses premières années sont consacrées à la surveillance du littoral breton entre Brest, Saint-Malo, Belle-Île et les abords du golfe de Gascogne. Elle escorte des convois marchands et assure la protection des ports contre les corsaires et les incursions anglaises. Elle participe aussi à des expéditions en Méditerranée, notamment dans le cadre des campagnes militaires menées par Louis XII en Italie. La Cordelière est intégrée à des flottilles franco-vénitiennes opérant autour du royaume de Naples. Elle est chargée du transport des troupes, de l’artillerie et des provisions. Sa capacité d’emport, sa robustesse et sa puissance de feu en font un navire apprécié dans les sièges côtiers.
La montée des tensions entre la France et l’Angleterre dans le contexte de la ligue de Cambrai conduit à un redéploiement des forces navales françaises dans la Manche et en mer Celtique. La Cordelière prend part à ces opérations.
Elle est principalement chargée de missions de patrouille et d’escorte entre la Bretagne et les ports normands, ainsi que du transport de troupes vers l’Écosse, alliée traditionnelle de la France. Elle croise régulièrement au large de Plymouth et des Scilly, où elle participe à des engagements ponctuels avec la flotte anglaise. Son apparence et son armement impressionnant sont mentionnés dans plusieurs rapports ennemis.
Le 10 août 1512, la mer d’Iroise devient le théâtre d’un affrontement majeur entre les flottes franco-bretonne et anglaise. La Cordelière est alors intégrée à la flotte française. Elle est placée sous le commandement du capitaine breton Hervé de Portzmoguer, officier expérimenté issu de la noblesse morlaisienne.
Le but de l’expédition est de briser le blocus que la flotte anglaise impose sur le port de Brest, et de permettre à plusieurs navires français de sortir en mer. La Cordelière prend la tête d’une formation d’une dizaine de navires et quitte la rade de Brest en direction du large, escortant notamment La Louise et d’autres unités de taille moyenne. En face, une escadre anglaise forte d’une vingtaine de navires croise au large, dirigée par le Regent, navire amiral du roi Henri VIII commandé par Sir Thomas Knyvett.
Les deux vaisseaux amiraux, La Cordelière et le Regent, se repèrent en fin de matinée, non loin de la pointe Saint-Mathieu. Portzmoguer, conscient de l’infériorité numérique de sa flotte, choisit l’engagement direct afin de couvrir la retraite des navires alliés. Il ordonne une manœuvre d’approche rapide et entame un duel d’artillerie avec le Regent. La Cordelière, avec ses canons, cause de lourds dégâts à l’avant du navire anglais, mais elle subit à son tour des tirs destructeurs au niveau de ses ponts supérieurs.
Vers midi, les deux navires s’abordent. Des grappins sont lancés, les coques se touchent et, sur les ponts encombrés, la mêlée fait rage. Archers anglais, arbalétriers bretons, piquiers, hommes d’armes et officiers combattent au corps-à-corps.
C’est alors qu’une énorme explosion secoue les deux navires. La soute remplie de poudre de La Cordelière explose. Le souffle détruit instantanément les deux vaisseaux, projetant des débris à des centaines de mètres et déclenchant un incendie qui se propage jusqu’aux navires alentour.
On ignore à ce jour si cette explosion fut déclenchée par un tir anglais, le résultat d’un accident ou une action délibérée de
Portzmoguer. La tradition bretonne privilégie l’acte volontaire, faisant du capitaine un martyr héroïque.
L’explosion cause la mort de la quasi-totalité des équipages des deux navires. On estime que près de mille cinq cents hommes – bretons, français et anglais – périrent dans les flammes et les flots.
L’affrontement de Saint-Mathieu est considéré comme la première bataille navale de l’histoire moderne à s’achever par la destruction simultanée des deux vaisseaux amiraux. Il marque la fin de la carrière de La Cordelière, et consacre l’image de Portzmoguer comme figure du sacrifice patriotique. En Bretagne, cette bataille devint rapidement un épisode fondateur de la mémoire navale.
Depuis les années 1980, des campagnes de recherches sousmarines sont menées pour localiser les restes de La Cordelière et du Regent au fond de la mer d’Iroise. Malgré les moyens modernes mis en œuvre – sonars multifaisceaux, ROV, plongées techniques –l’épave n’a pas encore été formellement identifiée à ce jour.
La mer est noire et furieuse, le 9 septembre 1813, au large d’Aurigny. Sur les flots, un petit cotre français fend les vagues à toute allure. Il s’appelle Le Renard, et ce nom n’est pas une vaine promesse : vif, rusé, mordant, il est fait pour la traque et la course. Cette dernière est une forme de guerre navale autorisée alors par l’État. Elle consiste à armer des bateaux civils, les corsaires, pour attaquer les navires marchands ennemis. Loin des affrontements entre grandes flottes, cette stratégie vise à affaiblir l’économie adverse en perturbant son commerce maritime.
À Saint-Malo, en ce début du xixe siècle, vit Robert Surcouf. Pendant les guerres de la Révolution et de l’Empire, il s’est enrichi en capturant des dizaines de navires marchands britanniques, parfois même sous le nez de la marine de guerre adverse. Cette embarcation au nom évocateur devient une légende vivante, au point de symboliser à lui seul l’esprit corsaire de la France. Mais en 1812, la situation change. L’Empire bat de l’aile, la campagne de Napoléon tourne au désavantage de celui-ci, et la guerre de course décline. Pourtant, Surcouf n’a pas dit son dernier mot : il décide de financer la construction d’un nouveau navire, un petit bijou parfaitement calibré pour la guerre de course. Celui-ci sortira de chantier en 1813 et sera baptisé Le Renard.
Conçu pour privilégier rapidité et manœuvrabilité, Le Renard est un cotre à hunier de soixante-dix tonneaux, mesurant environ 20 m de long pour une largeur de 5,60 m. Doté d’une voilure adaptée à la course, il peut remonter efficacement au vent et surprendre ses proies par sa vivacité. Son armement compte dix caronades, des canons courts à large calibre, redoutables à courte portée, ainsi que quatre canons plus légers, parfaits pour les engagements brefs. Son équipage composé de quarante-six hommes devait être à la fois expérimenté et discipliné, capable de manœuvrer dans des conditions extrêmes avec un effectif réduit. Le Renard est un véritable prédateur des mers.
À la tête du Renard, Surcouf place le capitaine Emmanuel Leroux-Desrochettes. Il le charge de harceler les navires anglais et de prendre ce qui peut l’être. Leroux-Desrochettes sait que la mission qu’on lui a confiée est périlleuse. Un soir de septembre, ce qu’il voit se dessiner dans l’ombre brumeuse n’est pas un simple navire marchand. C’est l’Alphea, une goélette britannique, un navire de guerre. Seize canons de douze livres, entre quatre-vingts et cent vingt hommes à bord : à côté, Le Renard paraît minuscule.
La rencontre avec la goélette anglaise est brutale. Pendant plus de deux heures, les deux équipages s’affrontent dans un duel féroce. Le bois fume, les voiles se déchirent, les hommes tombent. Et pourtant, contre toute attente, Le Renard résiste, manœuvrant rapidement, esquivant et ripostant. Puis vient le tir décisif : deux boulets français atteignent de plein fouet la soute à munitions de l’Alphea. En une seconde, la goélette est pulvérisée.
Le Renard est cependant sévèrement touché, et le capitaine Leroux-Desrochettes mortellement blessé. Seule une dizaine d’hommes valides peut encore tenir debout. Le cotre parvient ainsi à regagner le port de Diélette, puis à revenir à Saint-Malo, gravement endommagé. Son capitaine succombe à ses blessures. C’est le lieutenant Jean Herbert qui prend brièvement le commandement. L’histoire du Renard s’arrêta là. Avec la chute de Napoléon, plus
aucune lettre de course ne fut émise. L’ère des corsaires touchait à sa fin.
Le Renard ne fit pas d’autre prise, mais sa victoire contre l’Alphéa suffit à lui assurer une place dans la mémoire collective.
Un siècle et demi plus tard, en 1988, une poignée de passionnés décida de faire renaître ce pan oublié de l’histoire maritime. Une réplique fidèle du Renard fut construite à Saint-Malo. Lancée en 1991, elle navigue encore aujourd’hui, déployant fièrement ses voiles dans les rassemblements nautiques.
L’histoire du Vasa est à la fois triste et fascinante. Triste car il s’agit sans doute d’un des naufrages les plus rapides de l’histoire ; et fascinante car, trois siècles plus tard, il a été retrouvé dans un état de conservation exceptionnel grâce aux eaux froides et peu salées de l’archipel de Stockholm. Il est aujourd’hui exposé dans la capitale suédoise et offre un témoignage précieux de l’histoire navale.
Le Vasa porte le nom de la famille royale suédoise régnante en 1626. Gustave II Adolphe, le roi, est pris dans un contexte de rivalités militaires en mer Baltique, au beau milieu de la guerre de Trente Ans. Le Vasa devait symboliser la grandeur et l’ambition du royaume : il fut conçu pour être le plus puissant, le plus richement décoré et le plus lourdement armé des navires suédois, servant à la fois d’outil militaire et de démonstration de prestige. Il fut le premier d’une série de cinq grands vaisseaux destinés à constituer l’épine dorsale de la flotte suédoise et à impressionner alliés comme adversaires.
La construction du Vasa débute à la fin de l’hiver 1626 à Stockholm, dans le chantier naval qui est le principal centre de construction du pays à cette époque. La conception et la direction des travaux sont confiées à l’architecte naval néerlandais Henrik Hybertsson assisté de son associé Arendt de Groote et, après la mort de Hybertsson en 1627, à Henrik Jacobsson.
Les architectes dessinent un trois-mâts hybride entre galion et caraque, mesurant environ 69 m de long et plus de 50 m de haut, armé de soixante-quatre canons et orné de centaines de sculptures richement décorées. Plus de quatre cents artisans de diverses nationalités travaillent sur le chantier : charpentiers, menuisiers, sculpteurs, peintres… Les matières premières, notamment le bois de chêne, proviennent de toute l’Europe du Nord.
Le chantier de construction ne se passe pas bien. Pour commencer, l’architecte naval n’est pas un spécialiste des bateaux de guerre. Le Vasa est le premier qu’il dessine, ce qui n’est pas anodin : au xviie siècle, il n’existe pas de théories mathématiques ni de méthodes fiables pour évaluer la stabilité d’un navire. Les constructeurs se fient à leur expérience. Et ici, comme Henrik Hybertsson n’en a pas, il ne peut anticiper les problèmes liés au centre de gravité et à la répartition des masses qui vont se révéler cruciaux plus tard.
Les plans d’armement sont modifiés à plusieurs reprises, passant des trente-six canons prévus initialement à soixante-quatre canons, dont beaucoup étaient installés sur les ponts supérieurs. Cette surcharge élève considérablement le centre de gravité du navire et accroît son instabilité.
Il apparaît aussi rapidement que la coque du Vasa est trop étroite par rapport à sa hauteur et au poids des superstructures, ce qui limite aussi sa stabilité transversale. Les ponts de batterie sont trop massifs, et les plafonds trop hauts. Tout ceci accroît le déséquilibre du bâtiment. Enfin, il y a un problème de ballast : les 120 t de pierre embarquées dans le fond du bateau ne sont pas suffisantes pour compenser le poids excessif des hauts.
Pour aggraver le tout, la pression politique et royale est forte. Trop forte, sans doute. Le roi impose ses exigences tout au long de la construction : c’est lui qui demande à plusieurs reprises des modifications des plans, notamment en ce qui concerne les dimen-
sions et l’armement du navire. Gustave II Adolphe exerce aussi une pression constante pour accélérer les travaux, exigeant que le navire soit lancé au plus vite. Les responsables du chantier et les officiers, de crainte de déplaire au roi en retardant la mise à l’eau, préfèrent ignorer ou minimiser les risques, alors même qu’ils ont constaté des problèmes de stabilité lors des essais.
Le 10 août 1628, à Stockholm, le lancement du Vasa se déroule dans une ambiance festive et enthousiaste. Bien que le roi Gustave II Adolphe soit en campagne militaire, il a ordonné que le navire soit mis à l’eau sans attendre. Des milliers de curieux, des dignitaires étrangers et les familles des marins se rassemblent sur les quais pour assister au départ de ce fleuron de la marine suédoise.
Le Vasa s’éloigne lentement du quai, saluant la foule d’une salve de canon. Seules trois de ses dix voiles sont déployées. Une fois hors du port, il entame sa route vers l’île de Vaxholm avec, à son bord, des femmes et des enfants de marins qui doivent débarquer plus loin. L’atmosphère est joyeuse : un orchestre joue et le navire glisse majestueusement sur les eaux calmes.
Mais à peine franchie la zone abritée, une première rafale de vent fait dangereusement gîter le Vasa sur bâbord. Il se redresse, mais une seconde rafale, plus violente, le déséquilibre à nouveau. L’eau s’engouffre alors par les sabords du pont inférieur, restés ouverts. En moins de vingt minutes, le Vasa chavire et sombre à quelques centaines de mètres du rivage, sous les regards horrifiés de la foule. Trente à quarante personnes périssent dans le naufrage, tandis que d’autres sont sauvées de justesse.
Le roi Gustave II Adolphe, alors à l’étranger, est informé rapidement du drame. Il ordonne une enquête pour déterminer les responsabilités. Le commandant, les officiers, les constructeurs et d’autres témoins sont interrogés. Chacun rejette la faute sur l’autre : l’équipage affirme avoir suivi les procédures, les constructeurs assurent avoir respecté les ordres. Finalement, l’enquête ne désigne aucun coupable : la catastrophe est attribuée à une combinaison de défauts de conception et de pressions pour lancer le
navire rapidement, et aucune sanction n’est appliquée. Le naufrage est attribué à la « volonté de Dieu ».
Peu après, des opérations sont menées pour récupérer les canons et d’autres objets de valeur du Vasa. Ces interventions endommagent partiellement la structure du navire. Puis le bateau est oublié… pendant trois cents ans.
Dans les années 1950, l’épave est découverte par Anders Franzén, un archéologue naval amateur. Il parvient à mobiliser autour de lui, et une opération de relevage est planifiée avec minutie. Six tunnels sont creusés sous la coque du Vasa par des plongeurs équipés de lances à haute pression pour dégager la vase. Ces tunnels permettent de passer de solides câbles d’acier sous le navire.
Ces câbles sont ensuite reliés à deux grands pontons de levage positionnés de part et d’autre de l’épave. En remplissant puis en vidant les pontons d’eau, on parvient à soulever progressivement le Vasa, étape par étape, jusqu’à ce qu’il soit remonté à une profondeur intermédiaire plus accessible. Cette méthode permit de déplacer le navire sans le briser, malgré sa fragilité après plus de trois siècles sous l’eau.
Après avoir été partiellement dégagée et allégée de la vase et des débris, la coque est rendue aussi étanche que possible (fermeture des sabords, obturation des trous). Le 24 avril 1961, le Vasa refait surface pour la première fois depuis trois cent ans, devant un large public et la presse internationale. Il est ensuite remorqué sur un ponton flottant jusqu’à une cale sèche permettant des fouilles archéologiques et la conservation du navire.
Une fois l’épave sortie de l’eau, elle fut aspergée pendant près de dix-sept ans avec une solution de polyéthylène glycol, un produit chimique utilisé pour remplacer l’eau dans le bois et éviter qu’il ne se fissure. Ensuite, l’épave sécha lentement à l’air pendant plusieurs années, un processus délicat destiné à éviter toute déformation. Certaines parties manquantes furent comblées avec du bois moderne pour stabiliser la structure.
Dans ce livre écrit par une passionnée de la mer, vous trouverez des histoires de bateaux, si étonnantes qu’on pourrait les croire inventées.
Et pourtant tout est vrai : des pirogues à balancier sur lesquelles les navigateurs austronésiens ont traversé des océans sans boussole et sans carte il y a des milliers d’années, au prototype militaire américain Sea Shadow conçu dans le plus grand secret au moment de la guerre froide puis devenu bateau fantôme, en passant par le Gros Ventre, le bateau sorti des chantiers navals de Bayonne qui a bien failli rendre l’Australie française au xviiie siècle…
Les histoires que vous allez lire vous étonneront autant qu’un roman d’aventures ou un film de science-fiction !
Une lecture fascinante qui ravira tous les amoureux de mer et d’aventure.
Caroline Britz est journaliste maritime, et elle a navigué sur la plupart des mers du monde. Elle aime raconter ses embarquements sur des navires de toutes les tailles, et partager sa passion de la mer, de l’histoire et des marins.
VA09142
www.vagnon.fr