TOUTES LESPOURTECHNIQUES DÉBUTER
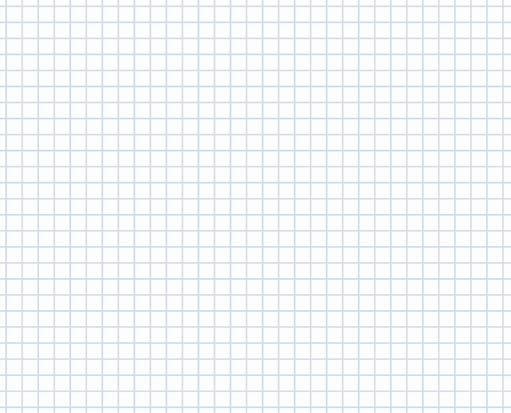
ROBERT ELGER
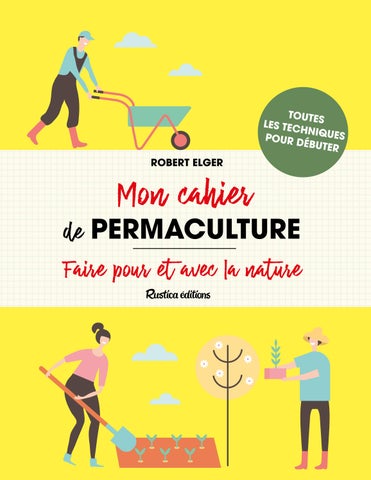
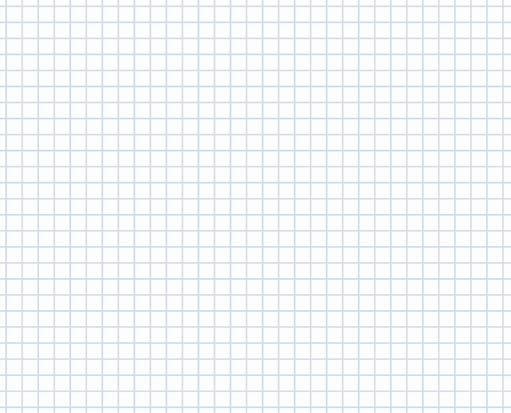
ROBERT ELGER
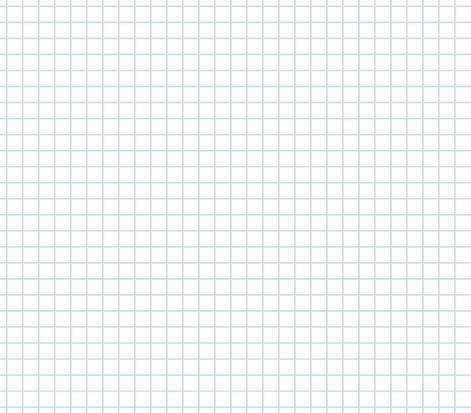
Débuter
Concevoir Implanter
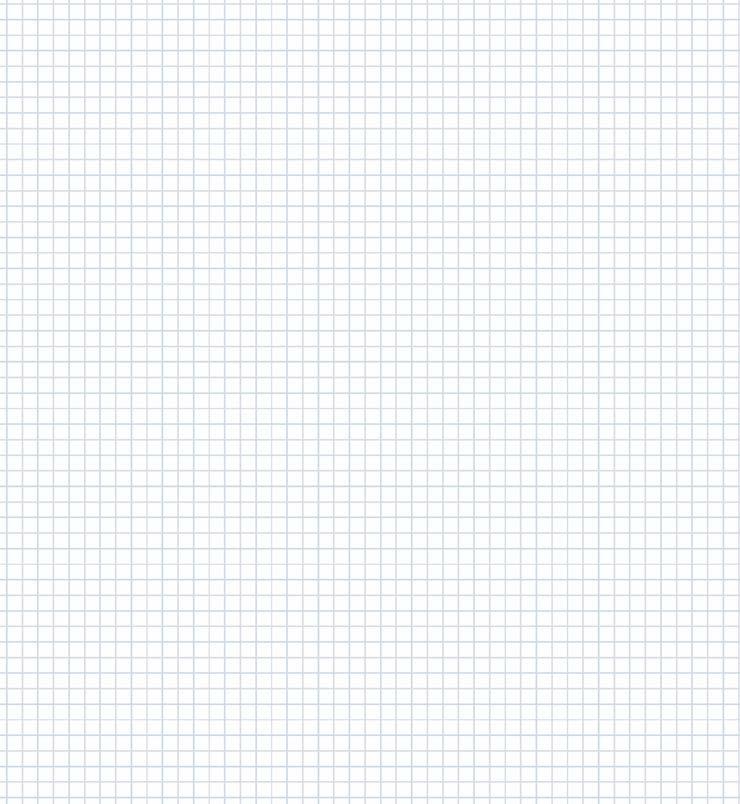
L’objectif de la permaculture est de permettre à chacun d’autoproduire ses légumes, ses plantes condimentaires et ses fruits, voire ses œufs, son miel et ses céréales. Et cela dans le respect de ce qui existe, à moindre coût énergétique, sans apports extérieurs – les fameux intrants ! – et sans traitements hasardeux.
Son modèle ? La nature en général et la forêt en particulier. Observez la façon dont cette dernière se renouvelle d’une année sur l’autre ! Au printemps apparaissent les feuilles, en été s’épanouissent les fruits, en automne elle fait peau neuve en abandonnant au sol son feuillage et, en hiver, rassemble son énergie pour un nouveau départ printanier. Elle produit chaque année une énorme masse végétale, sans travail du sol, sans engrais et sans traitements. Comment ? En limitant les déchets et en recyclant une grosse partie de sa biomasse – les feuilles qu’elle abandonne en automne – pour les réinjecter dans une nouvelle croissance saisonnière.
Conduit en permaculture, un jardin obéit aux mêmes injonctions naturelles et, de fait, fonctionne de la même façon. Il s’épanouit lui aussi dans une rotation saisonnière et réutilise chaque année la matière organique produite par les diverses mises en culture pour alimenter un nouveau cycle de production : mises en culture, suivis et récoltes, avec nouvelles mises en culture, nouveaux suivis et nouvelles récoltes, et ainsi ad infinitum. L’étonnant, c’est que cette dynamique naturelle optimise les récoltes en cours et en même temps améliore d’une année sur l’autre le potentiel de production de votre jardin.
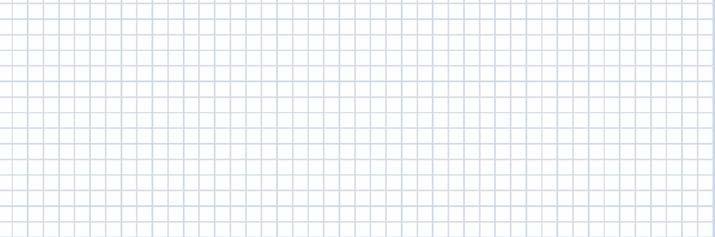
Un simple coup de fourche-bêche dans un coin ombragé et riche en matières organiques permet de mettre à jour quantité de vers de terre et, en allant voir de plus près encore, d’observer une faune et une flore très diversifiées. Couplée à la pose d’une couverture organique permanente, une simple aération du sol sans retournement compose le b.a.-ba de la permaculture.
Les clés du succès
Tenez compte simultanément des caractéristiques physiques et biologiques du sol.
Tous les sols sont constitués des mêmes matériaux de départ : argile, sable et calcaire. Les proportions respectives de ces éléments définissent leurs caractéristiques physiques. Quand l’un d’eux domine – ce qui complique en général les mises en culture –, la terre est définie comme argileuse, sableuse ou calcaire. Souvent, aucun des éléments ne l’emporte vraiment et la terre se fait alors
argilo-calcaire, argilo-siliceuse ou silico-argileuse. C’est le cas de la majorité des terres cultivées.
À cette texture minérale s’ajoute une composante organique essentiellement d’origine végétale qui est à la fois support de vie et nourriture pour de nombreux organismes animaux. Certains, les vers de terre par exemple, sont bien visibles à l’œil nu, d’autres, comme les cloportes, les myriapodes, les diverses larves de coléoptères et de diptères, les acariens et les collemboles, sont beaucoup
plus discrets. L’immense majorité enfin, comme les bactéries et les champignons microscopiques – se comptant par milliards – sont totalement invisibles.
Sympathiques vers de terre
Les vers de terre sont loin d’être les seuls animaux présents dans le sol. Comme l’importance de leur population est reliée à celle de l’ensemble du monde vivant, ce sont d’excellents thermomètres de la qualité biologique d’un sol.
La composition minérale de votre terre entraîne des effets sur son degré d’acidité ou de basicité. Une terre riche en sable est habituellement acide ; un sol bien pourvu en calcaire est basique. Induit essentiellement par la configuration géologique, le degré d’acidité ou de basicité de votre terre est le même chez votre voisin et, par ailleurs, évolue peu et très lentement. Il existe de nombreux tests colorimétriques faciles d’emploi permettant de savoir si votre terre est acide ou basique.
Le degré d’acidité ou de basicité d’un sol est défini par la valeur de son pH. Le pH d’un sol acide se situe entre 4,5 et 6,5, celui d’un sol basique entre 7,5 et 8,5. Entre les deux – de 6,5 à 7,5 – le sol est dit « neutre ». Comme souvent au jardin, seules les valeurs extrêmes (pH < 5,5 et pH > 8) causent de réelles difficultés en culture. Les habitudes culturales préconisées en permaculture – en particulier le recours à de forts volumes de matières organiques – permettent une mise en culture sans précaution particulière des terres dont le pH se situe entre ces valeurs extrêmes.
z À NOTER : Un simple coup d’œil sur votre facture d’eau vous renseignera sur le pH de votre terre. Les pH de l’une et de l’autre coïncident en effet… pour peu que le pompage de votre eau soit fait à proximité de votre maison d’habitation.
Les clés du succès
Testez les préconisations proposées par les ouvrages horticoles mais n’ayez foi qu’en vos propres observations.

Remplacez le retournement du sol à la bêche ou à la fourche-bêche par une aération à l’aérabêche.

Chaque strate de votre sol abrite des organismes aux besoins spécifiques en oxygène, en eau et en lumière. En retournant le sol – et donc en mélangeant la strate organique de surface et les horizons minéraux de profondeur –, ils ne peuvent se développer normalement, compromettant l’évolution naturelle de la matière organique. Pénible et lent, le bêchage ramène par ailleurs à la surface les graines enfouies de mauvaises herbes.
Pour préparer le sol aux mises en culture, contentez-vous de l’aérer à l’aérabêche. Incurvées sur leur longueur et biseautées à leurs extrémités, les dents s’enfoncent dans le sol en appuyant avec le pied, comme avec une fourche-bêche. Ramenées vers l’arrière, elles provoquent un simple soulèvement du sol, sans retournement, facilitant ainsi la circulation de l’air et l’intégration progressive de la matière organique.
bon outil
Munie généralement de deux manches montés sur une barre transversale portant selon les modèles 3, 4 ou 5 dents, l’aérabêche est l’outil idéal pour ameublir le sol sans le retourner. Cet outil ergonomique – contrairement à la bêche ou à la fourche-bêche – vous évitera en outre bien des tiraillements lombaires.
Comme souvent en permaculture, une intervention unique présente des conséquences multiples. En recouvrant votre sol, vous pondérez les effets négatifs du climat lors des grandes chaleurs estivales ou des fortes gelées hivernales. En été, un épais paillis économise l’eau présente dans le sol en réduisant la diffusion dans l’atmosphère de la vapeur d’eau et limite l’apparition des herbes indésirables. Cette couverture organique améliore à terme la structure et la richesse de votre sol et donc sa capacité à porter des récoltes abondantes.
bon geste
Outre ses avantages agronomiques, la couverture permanente vous évitera le retournement du sol par bêchage lors des mises en culture et, par la suite, de longues heures de binage et de sarclage.
Toutes les matières d’origine végétale conviennent. Il faudra néanmoins privilégier les matériaux organiques issus de l’entretien même du jardin, comme les tontes de gazon, les feuilles mortes et les divers broyats de branches et de rameaux de taille. Les composts et les fumiers compostés sont parmi les meilleurs matériaux de couverture. Mais de simples cartons de récupération débarrassés des adhésifs qui recouvrent leurs rabats constituent, faute de mieux, une bonne couverture organique. La paille quant à elle, de blé, d’orge, d’avoine ou de seigle, est aisée à manipuler.
Précieux humus !
L’humus est le résultat ultime du processus de dégradation de la matière organique. Son importance agronomique est telle qu’il n’est pas exagéré d’affirmer qu’un sol « riche » est avant tout un sol bien pourvu en humus.
Les clés du succès
Maintenez en permanence un paillis de couverture, la dynamique agronomique d’un sol y est largement corrélée.
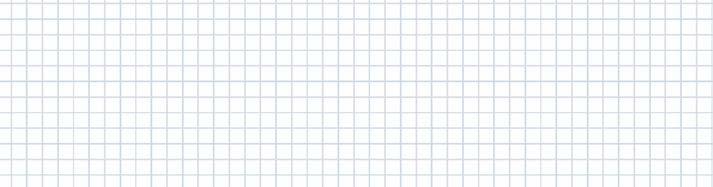
Préalablement compostés ou déposés directement en surface, les déchets verts issus de la cuisine ou de l’entretien courant du jardin stimuleront l’activité biologique de votre sol tout en augmentant sa teneur en humus et le volume des récoltes futures.
clés du succès
Tous les déchets organiques disponibles doivent impérativement retourner au jardin !
Faites feu de tout bois ! Recyclez tous les matériaux d’origine végétale dont vous disposez pour viser le « zéro déchet » organique et minimiser ainsi la fameuse « empreinte écologique ».
Un composteur est un grand bac en bois ou en plastique recyclé. Discret, il permet d’obtenir un compost de qualité comparable à celui obtenu par un compostage en tas.
Le compostage en tas consiste à récupérer les matériaux organiques pour leur faire subir une première décomposition avant utilisation définitive au jardin. Entassés dans un endroit discret, de préférence à miombre, les déchets organiques produisent en 3 à 6 mois un compost jeune, en 6 à 9 mois un compost intermédiaire, en 9 à 12 mois un compost mûr.
Aérez le sol à l’aérabêche à l’endroit du futur tas de compost avant d’entasser en les mélangeant les matières organiques dont vous disposez. Au fur et à mesure que le tas s’élève, jetez-y régulièrement quelques pelletées d’ancien compost afin d’« ensemencer » le nouveau compost et de hâter sa décomposition. Au besoin, arrosez-les.
Monté au printemps, le tas devra être retourné à 2 ou 3 reprises en cours d’été afin de permettre une décomposition régulière et homogène.
Le compostage en surface facilite tout au long de l’année l’intégration naturelle et
DÉCHETS ISSUS DE LA CUISINE ET DE LA MAISON
DÉCHETS ISSUS DU JARDIN
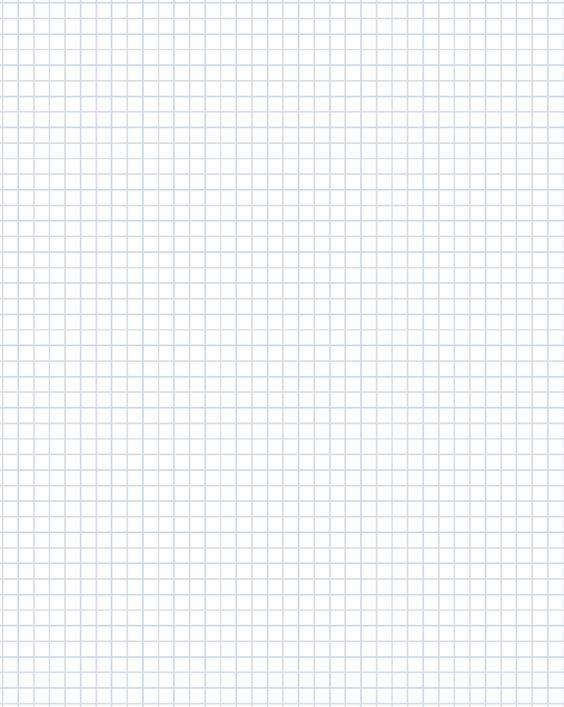
EXCRÉMENTS DES PETITS ÉLEVAGES DOMESTIQUES
RÉCUPÉRATIONS EXTÉRIEURES
Mes remarques...
Épluchures diverses, cosses de petits pois, fanes diverses, marc de café, thé et sachets de thé, coquille d’œufs, essuie-tout et serviettes en papier, papier journal, cendre de bois
Tontes diverses, feuilles mortes, jeunes branches taillées, broyats divers, déchets de légumes gâtés ou non récoltés, déchets de fruits gâtés ou non récoltés, fleurs fanées, mottes de plantes cultivées parvenues en fin de culture, vieux terreaux, anciens composts, mauvaises herbes (de préférence non montées à graines)
Diverses litières, crottes de lapins, fientes de poules, poils, plumes, laine
Cartons, fumier d’écurie, fumier d’étable, pailles diverses, vieux foins, sciures de bois, résidus de champignonnières
progressive de la matière végétale fraîche. Posés sur la terre après aération à l’aérabêche ou non, les divers matériaux organiques entraînent une importante prolifération microbienne qui assure une décomposition rapide.
z À NOTER : Moins populaire que le compostage en tas, le compostage en surface produit à moindre coût un humus de qualité et doit être préféré chaque fois que c’est possible.
Pour composter en surface, déposez les matériaux organiques aux pieds des plantes en croissance, en évitant les amoncellements trop importants. Les tontes de gazon – et plus généralement tous les végétaux frais à forte teneur en humidité –devront être étalées en couches ne dépassant pas 2 cm d’épaisseur. La décomposition totale peut prendre plusieurs mois en hiver, mais ne dépasse pas quelques semaines en été.
Pour obtenir un compost de qualité…
Veillez à mélanger les couches de matières organiques riches en carbone (paille, feuilles mortes, branches fines ou broyées…) et celles bien pourvues en azote (tontes, fanes et déchets de cuisine, fumier non pailleux…).

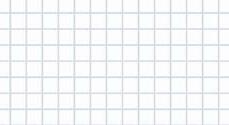
Faire pour et avec la nature, voici l’essence de la permaculture.
Vous rêvez de produire vos fruits et légumes, vos œufs, votre miel, dans le respect de votre environnement et avec un investissement minimal…
Lancez-vous ! Ce cahier ludique et pratique est le guide qu’il vous faut pour réussir en toute simplicité vos premiers pas en permaculture.
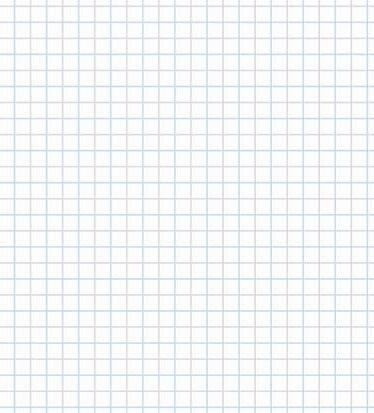
Débuter et mettre en place les bases pour partir du bon pied
z Connaître son sol et en prendre soin
z Recycler les ressources naturelles
z Favoriser la biodiversité
Concevoir et implanter son jardin en permaculture
z Observer et structurer son jardin
z Faire les bons choix : forme, culture, entretien
z Semer, planter, récolter et recommencer !
Aller plus loin et adopter la permaculture humaine au quotidien
z Définir ses limites et son implication
z Essayer la permaculture dans la maison
z Partager les ressources et savoir-faire
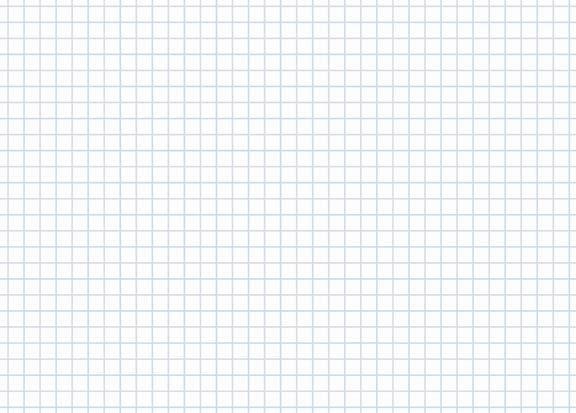
Pépiniériste et jardinier, Robert Elger collabore régulièrement à la revue Rustica. Il a déjà publié plusieurs livres aux Éditions Rustica dont Découvrir la permaculture, La permaculture en pas à pas, Mon premier jardin en permaculture ou encore le Calendrier de la permaculture
