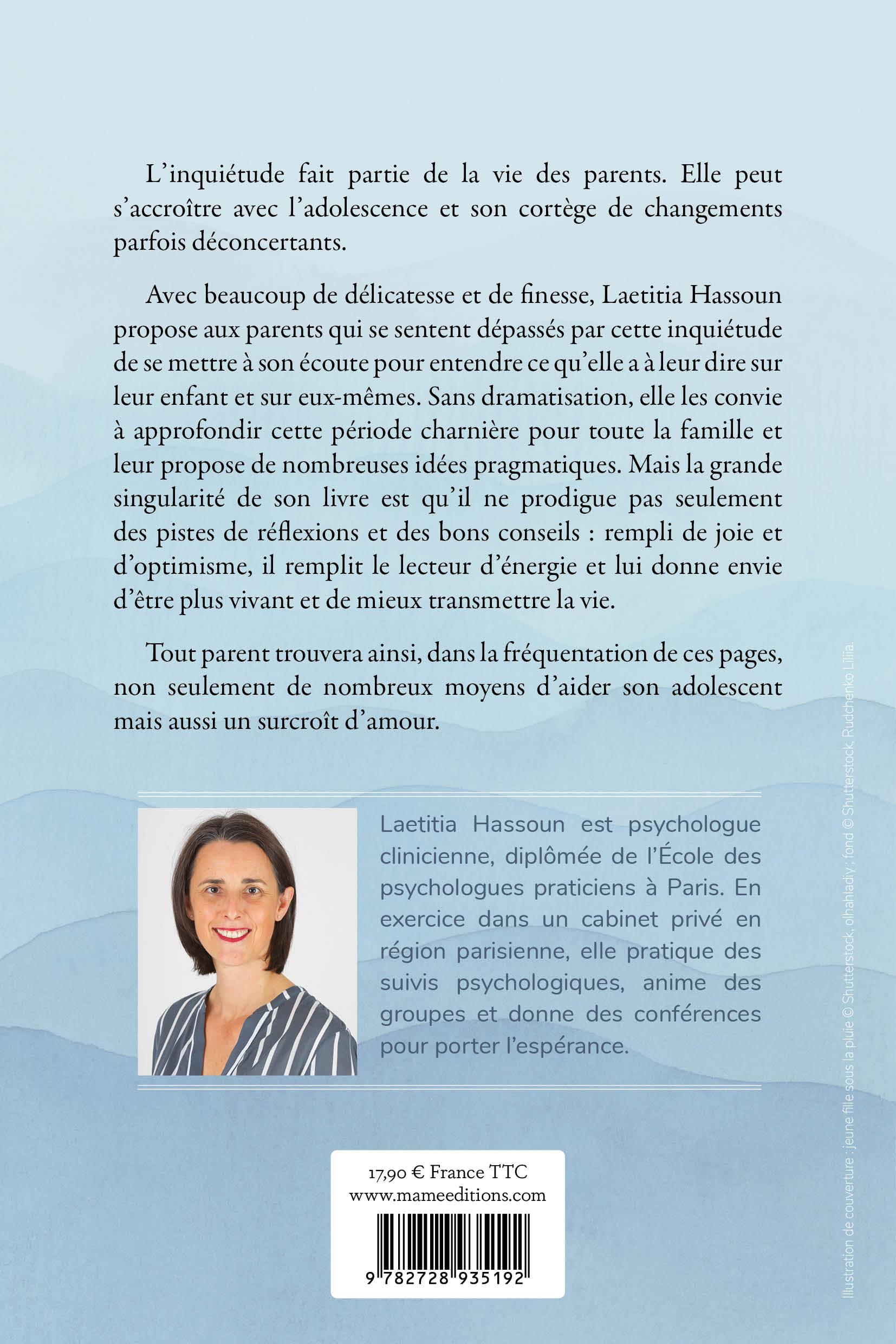Laetitia Hassoun


Laetitia Hassoun
P RÉFACE DU DOCTEUR C AMILLE B ENOÎT
P SYCHIATRE
P RATICIEN ATTACHÉ À L A P ITIÉ -S ALPÊTRIÈRE
Direction : Guillaume Arnaud
Direction éditoriale : Sophie Cluzel
Édition : Vincent Morch
Direction artistique : Thérèse Jauze
Direction de fabrication : Thierry Dubus
Fabrication : Julia Miranda
Mise en pages : Pixellence
© Mame, Paris, 2024 www.mameeditions.com
ISBN : 978-2-7289-3519-2
MDS : MM35192
Ce livre s’adresse aux parents d’adolescents, mais plus largement à tous les parents, tant il pose les fondamentaux d’une éducation visant à l’épanouissement et à l’autonomie des enfants.
Cet ouvrage, empli d’humanité et d’humilité, n’est ni un manuel ni une compilation de leçons pour une parentalité « réussie ». Il insiste sur l’importance de rencontrer continuellement son enfant, dont le devenir est protéiforme, particulièrement à l’adolescence.
Laetitia Hassoun nomme, avec douceur, la palette particulièrement bariolée des émotions à l’adolescence.
La joie et la sérénité qui nous reposent, nous, parents, tant elles sont confortables, mais aussi la peur, la colère, la tristesse, la jalousie, la culpabilité… qui sont les ingrédients nécessaires à l’émancipation de l’adolescent et à son devenir et qui font partie de la vie, de la leur, de la nôtre. « Faut que ça sorte ! » – au risque, si cela ne se fait pas, que cela se retourne contre lui, le ronge de l’intérieur et le fragilise durablement. Laetitia Hassoun nous permet donc de poser un regard calme sur ces émotions, de les accueillir en nous sans effusion, tout simplement, pour permettre à notre adolescent de les vivre au mieux maintenant et, plus tard, dans sa vie d’adulte. D’un chapitre à l’autre, elle nous permet d’être plus solides et de nouer un lien indéfectible avec notre adolescent.
Tout en finesse, elle nous invite à nous interroger sur ce que nous transmettons à nos enfants, volontairement et parfois involontairement, lorsque notre propre histoire, notre enfance, mais aussi la vie de nos aïeux, viennent influencer nos réponses, nos attentes et nos réactions vis-à-vis d’eux. Elle nous pousse à chercher au fond de nous ce que nous devons leur donner en écoutant notre cœur et le leur, et en acceptant de faire le deuil de certains rêves que notre ego aurait échafaudés pour eux.
Ce livre nous rappelle, sans détour, à quel point notre responsabilité est grande à leur égard, à quel point nous devons leur consacrer du temps, être disponibles moralement, physiquement et mentalement pour eux, toujours. Car les états d’âme, la détresse des adolescents, leurs réussites mais aussi leurs déconvenues, peuvent se présenter à tout moment, sans crier gare. Être là, constamment, dans le cœur et dans l’esprit de l’adolescent, tel un port fiable, accessible, dans lequel il trouvera toujours refuge. Être là, sans condition, sans contrepartie, même lorsque l’adolescent rejette, bouscule, dénigre… Tout cela est nécessaire pour mettre en marche sa révolution intérieure, qui lui permettra in fine de désidéaliser ses parents, pour le meilleur – car, en faisant cela, il développera son esprit critique, son autonomie, ainsi que ses propres ambitions. Après ces temps tumultueux et « révolutionnaires », une nouvelle rencontre pourra se faire, entre les parents perçus tels qu’ils sont réellement par l’adolescent, et l’adolescent tel qu’il devient.
Cet ouvrage nous rappelle que beaucoup de combats peuvent être adoucis pour ceux qui savent lâcher prise sur le non-essentiel et résister à la tentation du bras de fer ou de l’emprise. D’autres combats seront à mener, sans
relâche, pour permettre à l’adolescent de s’émanciper en toute sécurité. Le cadre, les repères, les interdits servent à cela : quoi qu’il fasse, certains piliers sont indestructibles et inaliénables. Ce livre invite chaque famille à ériger les siens, selon ses valeurs et son histoire.
Il nous rappelle également, fort heureusement, avec délicatesse et sincérité, nos propres limites, notre essoufflement légitime et la nécessité d’être entourés, d’accepter notre propre fragilité face à l’adversité, et le besoin de s’appuyer sur l’Autre (qu’il s’agisse de la famille, des amis, des professionnels, de la foi pour certains…).
Laetitia Hassoun nous invite à faire un pas de côté, à prendre quelques instants, au jour le jour, pour penser à son adolescent et pour se penser soi-même en tant que parent. Prendre un temps, dans un quotidien qui, pour la plupart des parents, est mouvementé, pour se questionner, sonder ses convictions, en conserver certaines et en moduler d’autres.
La densité de cet ouvrage est à l’image de la densité de l’adolescence. Il se lira dans le « temps long », mot à mot, sans précipitation, avec des allers-retours. Il est à considérer comme un livre de chevet, un compagnon, à retrouver jour après jour, et particulièrement les jours les plus tumultueux, pour retrouver un cap, tourné vers l’essentiel. Il rappelle à quel point être parent est une aventure riche, semée d’embûches, de doutes et d’imprévus, parfois d’épuisement mais, surtout, je le souhaite, d’émerveillement et de bonheur.
Docteur Camille Benoît.
Tout serait simple si nous pouvions constamment garder à l’esprit que, si chaotique et désarçonnante que l’adolescence puisse parfois être pour notre enfant et pour nous, cette période a pour horizon l’épanouissement des potentialités et l’entrée dans la vie adulte. L’« adolescence », qui provient du latin adulescens, signifie bien en effet « en train de grandir ». Mais notre cœur de parent est ainsi fait qu’il ne peut s’empêcher de s’inquiéter devant les difficultés que rencontre notre enfant. Il en va bien ainsi. Il est d’ailleurs probable que, si nous ne nous faisions pas du tout de souci pour lui, cela créerait un vide qui pourrait l’apeurer davantage. Si nous banalisions nos inquiétudes ou les camouflions, nous aurions davantage de mal à tenir notre promesse de nous engager de toutes nos forces pour l’accompagner.
« Mon ado m’inquiète » est donc le début d’une quête… pour entendre ce que votre inquiétude vient vous dire.
Mon ambition est de vous aider à vous mettre à son écoute pour non seulement créer un surgissement de remises en question fécondes mais aussi pour en faire votre alliée dans la recherche de la justesse de vos comportements et de vos décisions.
Certes, depuis quelques années, on note que davantage d’adolescents – dont fait peut-être partie le vôtre –, traversent des difficultés plus précoces et plus fortes que leurs devanciers, et on se sent démuni. Les familles sont
ainsi davantage secouées, tant du point de vue de la conjugalité que de celui de la parentalité, avec un soutien souvent trop défaillant. Or l’adolescent nous recentre sur ce qu’est la famille et sur le sens profond du combat que nous menons pour elle. Selon la Déclaration universelle des droits de l’homme, « la famille est l’élément naturel et fondamental de la société ». Elle est un lieu qui transmet des valeurs et des savoirs, là où se forge une identité.
Au cœur de cette famille, nous, parents, devons prendre notre part de responsabilité, d’affection et d’autorité, en cherchant à être fiables et constructifs. Sans faire de nos enfants des êtres anxieux, inconscients ou fragiles, nous devons prendre soin d’eux – ils sont précieux !
Nous sommes là pour leur procurer l’élan qui les fera explorer le monde, leur donner la capacité de faire face aux inévitables épreuves et leur donner l’envie de prolonger la merveilleuse aventure de l’humanité.
Pour cela, l’un des meilleurs moyens est d’habiter nous-mêmes la confiance, de témoigner d’une force de vie et de donner de l’amour.
Dans ce livre nourri de nombreux entretiens avec des confrères et des professionnels de santé, ainsi que de mes échanges avec mes patients, je souhaite vous inviter à oser plonger, à votre rythme, dans ces pages pour gagner en confiance et en joie.
Vous n’y trouverez pas de descriptions exhaustives de tous les maux des adolescents car il existe déjà des ouvrages qui les abordent de façon précise et qui proposent des pistes d’aide spécifiques. Il ne s’agira pas non plus de « moi devant mon adolescent en crise », mais bien de « moi avec mon
adolescent qui grandit », intégrés dans un système ouvert et dynamique nourri d’une vision intégrale de la personne, et orienté vers la Vie.
Dans une première partie, vous pourrez identifier le terrain sur lequel s’enracinent vos inquiétudes : notre époque, notre société et ses évolutions, votre famille et son histoire, votre vie. Dans une deuxième partie, je vous propose de mieux comprendre ce qu’est l’adolescence en général et d’appréhender les défis particuliers des adolescents d’aujourd’hui, d’apprendre à relire leurs comportements pour décrypter leur monde et leurs demandes subtiles en matière de santé affective, sociale, cognitive, spirituelle. Enfin, dans une troisième partie, vous trouverez des repères ou des pistes concrètes pour prendre soin de lui et pour l’aider à grandir.
J’ai à cœur que, au fil des chapitres, vous soyez renforcés dans cette croyance que vous êtes capables d’accompagner votre adolescent, dotés de connaissances et d’outils pour vivre avec lui ce moment clé de sa vie. Je crois en la capacité de chacun à trouver sa note personnelle, à trouver son style d’éducation et à accorder sa relation avec son adolescent. Les encadrés « Questions pour avancer » qui jalonnent le livre sont justement là pour guider une réflexion ou provoquer un dialogue et être à l’origine d’une action.
J’espère que vous pourrez trouver quelque chose qui parle de vous, qui vous dit quelque chose de vous, qui vous interpelle. Les petites « Vignettes cliniques » visent ainsi à donner de la chair à ce que j’aborde, à vous ouvrir au vécu d’autrui et à vous conduire au vôtre.
Je vous encourage, si ces lignes vous en font ressentir le besoin, si vous vous sentez trop seul ou que les difficultés
sont trop lourdes à porter, à trouver des personnes pour vous écouter et pour vous soutenir.
Pour tous, parents ou enfants, il s’agit de découvrir le trésor que l’adolescent vient éclairer, révéler, faire briller en soi, et que vous trouviez votre propre chemin pour le mener vers le monde. Il nous faut suivre le désir de devenir des êtres toujours plus vivants, fortifiés par les crises surmontées, heureux de progresser d’un âge à l’autre, et audacieux dans ses projets.
Quel est le contexte sociétal ?
La rapidité
Nous faisons quotidiennement l’expérience d’un rythme de société accéléré : le riz se cuit toujours plus vite, les livraisons se font en un jour, les informations partent en un clic. La notion même d’immédiateté, soutenue par l’arrivée de nouvelles technologies, nous pousse à faire tout, tout de suite, à tout âge.
Julie1 -
Les transitions se réduisent et les pauses sont inexistantes. Parfois, nous accélérons et faisons tout rapidement, parfois nous nous arrêtons, souvent malgré nous et hors d’haleine,
1. Les prénoms, dans ces vignettes, ont été modifiés.
sans trouver le sens de notre course. Nous pouvons comparer la société à une personne en état d’arythmie qui recherche anarchiquement la bonne cadence.
Pour l’enfant, il est difficile de grandir dans un monde plein de gens toujours occupés, pressés et sans patience. Tout est calculé, montre à la main, avec souvent l’injonction : « Dépêche-toi ! » Le temps lui manque pour exercer sa spontanéité, sa créativité, sa capacité d’improvisation. Pour l’adolescent ensuite, le rythme imposé le met à rude épreuve. Même si sa temporalité n’est plus la même que pendant l’enfance, ce n’est pas encore la nôtre. Il ralentit ou accélère en lien avec ce qu’il vit corporellement ou relationnellement, sans encore avoir trouvé son tempo.
Le temps est un grand cadeau universel donné de façon identique à chacun d’entre nous, petit ou grand, pauvre ou riche : vingt-quatre heures dans une journée. Il est composé de différents moments : de jeu, de partage, d’activité physique, d’intériorité, de travail, de sommeil, etc. Ainsi peut-on concevoir la réalisation de multiples objectifs, mais pas simultanément, donc en priorisant !
Parce que nous sommes parents, il est donc nécessaire de prendre du temps avec et pour notre adolescent. Nous
sommes invités à choisir ce que nous voulons faire de notre temps disponible, à nous interroger sur la connaissance de nos tempos : « À quoi est-ce que je consacre mon temps ?
Comment est-ce que je le mets en rapport avec mes objectifs de vie ? Comment est-ce que je programme mes journées ? Qu’est-ce que j’accorde à mes enfants ? Comment puis-je me caler sur le rythme de mon adolescent ? »
Conjointement, nous sommes invités à prendre conscience des modulations du temps. Ainsi que le propose la matrice du général Eisenhower, nous devons prioriser nos actions selon les critères urgent/important pour ne pas nous détourner de l’essentiel. L’appréhension que tout est urgent et que tout doit être réalisé rapidement peut laisser sa place au discernement et à une temporalité plus lente avant d’agir – ressource ô combien précieuse pendant l’adolescence d’un enfant.
L’enjeu n’est peut-être pas tant la régularité de nos journées – bien qu’il en faille aussi – que de laisser entrer une plus belle alternance de temps long et de temps court, de rapidité et de lenteur, dans les activités et dans les relations avec les personnes. Un peu de recul peut nous permettre de repérer nos prédispositions neuronales à agir vite ou lentement, d’écouter les signes qui nous permettent de comprendre que nous avons de l’énergie ou que nous sommes fatigués, de discerner la possibilité de ralentir ou la nécessité d’accélérer.
Dans la course des jours, nous sommes invités à prévoir mais aussi à rester souples et réceptifs pour accueillir ce qui arrive de façon inattendue et changeante.
Dans nos vies quotidiennes, recherchons cette allure qui permet de réussir les aventures demandant de l’endurance, comme faire un marathon ou élever un enfant. Pour notre
adolescent comme pour nous, cette période est une invitation à donner une valeur au temps et une épaisseur à ce que nous vivons dans l’instant présent.
Notre perception du monde est profondément façonnée par les progrès de la technique. On nous demande d’être compétitifs, productifs, d’évaluer les coûts, les risques et les bénéfices. La performance est au premier plan et toute action est ramenée à la rentabilité, à son résultat. La technologisation du monde a participé à sa désincarnation et à sa désacralisation. En renforçant le pouvoir des machines, elle a tout enfermé dans des chiffres et des équations. L’évacuation de l’émotion fait reculer l’imprévu, l’inconnu, la sensibilité et l’imaginaire, si précieux pour l’humain. La négligence du sacré fait perdre les notions de sens et de symbole et plonge le monde dans le matérialisme.
La pression se faisant plus forte au sujet de l’impératif de la perfection, les idéaux normatifs n’ont jamais été aussi puissants. Le monde doit être vidé de la souffrance et de l’échec. Tant dans le domaine esthétique (corps, visages) que dans celui de la taille des fruits, tout doit être « calibré » – et tout ce qui « dépasse » est impitoyablement rejeté.
Les adolescents sont donc confrontés à une exigence de tous les instants. À l’école, par exemple, par des notes qui sont immédiatement relayées sur les serveurs des établissements et qui poussent à la comparaison avec le reste de la classe. Dans leur groupe de pairs, leurs comportements et leurs projets sont épiés – phénomène renforcé par les réseaux sociaux.
On en convient : cette logique « perfectionniste » aide à voir plus haut et pousse en avant… mais elle malmène souvent les enfants en leur faisant subir une pression excessive et intransigeante vers une réussite presque dictée. Les aléas, les erreurs et les échecs n’ont pas leur place. Ainsi pensée, la vie devra être une accumulation linéaire de succès pour mener au bonheur présenté par cette publicité : une famille souriante dès le matin, savourant un petit-déjeuner ensoleillé.
L’idéal de perfection nous porte ; il peut dessiner un projet de vie et des changements à opérer dans nos vies. Bien choisi, il peut être motivant ! Idéalement… mais souvent, l’idéal ment ! Mal ajusté à notre vie, il génère des tensions. Alors, il nous faut nous remettre devant ce qui est juste pour nous, devant ce que nous, ou notre adolescent, sommes capables d’entreprendre. Comme un capitaine de voilier déterminé à atteindre une destination et qui a connaissance de ses forces et de ses fragilités, nous sommes à la recherche du bon réglage des voiles mais aussi prêts à changer celui-ci en fonction des éléments (vents, courants, récifs, état du bateau, etc.).
Face à l’injonction de la performance et de la perfection, il nous faut effectuer un pas de côté pour nous interroger sur l’élan ou le poids qu’elles représentent, nous mettre à la recherche de notre propre niveau d’exigence (parfois bien loin des normes de la société), lâcher le « tout-parfait » et reconnaître avec humilité ce qui est là devant nous, simplement. Face à notre adolescent, redéfinissons un cap juste et poursuivons la traversée de la vie, à son écoute et à la nôtre.
Notre société est porteuse de jugements et juge en permanence. Ce besoin de juger ou de solliciter le jugement est légitime et louable. Il procède de l’intention juste de résoudre une situation problématique ou de venir en aide à quelqu’un d’autre. Mais, bien souvent, le jugement émane de peurs et de blessures.
Revenons ensemble, comme le propose Lytta Basset1, sur les trois sens du mot « jugement ».
Juger signifie d’abord « discerner et évaluer une situation ou un acte ». Ainsi, les jugements sur les parents portés par leurs proches, leurs voisins ou les institutions sont autant de façons de veiller sur eux. Parfois, c’est nous-mêmes qui sommes en quête d’un avis, comme lorsque nous sollicitons des conseils auprès de nos proches ou de professionnels pour savoir s’il est juste ou non de nous faire du souci.
Le jugement part d’une bonne intention : chercher ou projeter ce qu’on souhaiterait pour l’autre, répondre au besoin de changement, rassurer. Évaluer permet donc de
1. Lytta Basset, Moi, je ne juge personne. L’Évangile au-delà de la morale, Paris, Albin Michel, 2003.
poser des choix, pour autant que l’on distingue toujours bien la personne de l’acte ou de la situation. Tout cela est bon à la condition que le regard demeure ouvert et cherche à être juste.
Mais nos jugements sont-ils toujours objectifs et sans ambiguïté ? Très souvent dépendants des normes de la société et empreints de notre vécu et de notre subjectivité, respectent-ils la personne que nous évaluons ? Quelles sont vraiment les normes dont nous usons quand nous jugeons notre adolescent ou dont usent les autres lorsque nous sommes jugés comme parents ?
Juger renvoie aussi à « catégoriser » et procède d’une démarche qui cherche à mettre dans des cases. Classer dans une catégorie explique et éclaire. Mais c’est aussi une façon de mettre l’autre à distance et de le limiter. Les étiquettes collées sur les parents, sur les enfants des autres, sur nos adolescents répondent à ce besoin. Les très nombreuses demandes de bilan psychologique ou de consultation de professionnels témoignent de cette recherche de catégoriser les maux, voire les personnes. Cette démarche est louable mais à la condition d’être accompagnée d’un regard respectueux sur l’être humain et sur ses possibilités d’évolution. Les catégories doivent être des cases ouvertes à actualiser sans cesse.
C’est là qu’intervient la dernière dimension du jugement : celle qui condamne et porte une appréciation définitive sur une situation ou sur une personne. Nos vies fourmillent d’exemples de jugements lapidaires qui nous clouent au pilori, ou de jugements que nous-mêmes, ou d’autres, portons sur notre adolescent. Or, nous recherchons
un regard non pas qui enferme mais qui nous perçoit tels que nous sommes et, qui ensuite, peut nous aider à changer. Nous pourrions ici nous interroger sur ce que nous laissons voir de nous à l’extérieur. Le jugement va d’autant plus aisément s’immiscer dans notre vie qu’elle est ouverte et transparente aux regards des autres. Mais si nous évitons de publier certaines photos de nos enfants, si nous nous empêchons de parler de notre vie au téléphone dans les espaces publics, si nous gardons pour nous les dernières informations sur la vie privée de notre adolescent, c’est que nous avons réfléchi à notre rapport à l’intimité et à la confidentialité, et cela nous protégera davantage. Alors, veillons aussi à sauvegarder une intimité pour notre adolescent et pour nous-mêmes et à nous ouvrir consciemment aux regards bienveillants.
Si nous écoutons avec un peu de recul les jugements formulés sur nous ou sur notre adolescent, nous y entendrons
les inquiétudes ou les blessures de ceux qui les portent – nous y compris. Nous allons ainsi nous dégager des jugements durs que nous portons sur nous-mêmes ou que portent sur nous nos proches ou la société. Nous pourrons nous libérer de la peur de la norme et de la condamnation et avoir la force de faire face aux préjugés du monde et d’oser être différent. Nous pourrons croire que juger la réalité peut être fait de façon bienveillante et ainsi nous interroger sur ce que le jugement porte de vrai et de lumineux.
• À quel nouveau rapport aux exigences de la société suis-je invité ?
• Quel regard est-ce que je pose sur la gestion de mon temps et l’acceptation des rythmes variés et changeants ?
• Est-ce que j’arrive à me dégager des préjugés et à porter un jugement juste sur ce que nous vivons ?
Notre autorité parentale doit pouvoir s’exercer au moment où notre adolescent a besoin d’être guidé et protégé. Nous sommes invités à sortir des postures de peur et de victime et à endosser pleinement notre autorité pour permettre à notre enfant de tenir debout. L’enjeu de notre rôle d’éducateur est de lui apporter un soutien fiable. Devant certaines inquiétudes, nous ne devons ni mollir ni encore moins déléguer entièrement notre autorité parentale. Au contraire, nous devons persister pour prodiguer de l’amour et des
interdits, des savoirs et des connaissances. Pour élever un adolescent, il faut de la verticalité et de l’ordre.
Revenons sur la notion d’autorité et sur son évolution.
Le Code civil, à l’article 371-1, l’évoque ainsi : « L’autorité parentale appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. » L’autorité, pour être légitime, doit respecter les besoins de celui sur qui elle s’exerce. Elle se met au service d’un apprentissage de la tolérance aux frustrations et aux contraintes que connaît tout citoyen et d’un apprentissage des limites légitimes qui marquent la construction d’une personne.
Classiquement, l’enfant est considéré comme un sujet (du latin subjicere, « être placé dessous », ici, en l’occurrence, sous l’autorité du chef de famille). En vertu du Code civil tel que conçu à l’ère napoléonienne, le père exerce l’autorité directement sur ses enfants, ou par sa femme par délégation auprès d’eux, et il n’y a qu’un seul chef. Il fait partie de ces figures qui permettent à l’enfant de se redresser, de regarder loin et droit devant lui, pour devenir un être de projet et d’avenir, ouvert sur le monde, prêt à transmettre la vie qu’il a reçue. La mère, de son côté, engendre la vie, apporte les soins à l’enfant et préserve joie et chaleur dans le foyer. On considère l’enfant comme un sujet pour le conduire peu à peu à l’individu « qui peut agir comme son propre chef ». Grandir représente alors une promesse, une conquête, un but.
Malheureusement, force et autorité ont pu être confondues, l’asymétrie entre l’adulte et l’enfant, transformée en
pouvoir. Néanmoins, depuis la fin du xxe siècle, un large mouvement social travaille pour préserver les droits de l’enfant, pour prévenir et condamner l’usage de la violence.
Par la suite, avec la montée du nombre des divorces, le pater familias, en tant que source unique d’autorité, a été rejeté. Cela ne dissout pas celle-ci mais la modifie en faisant qu’elle peut aussi être endossée par la mère. Le terme « parentalité » est apparu. Les hommes, sous l’influence des mouvements féministes, ont vu évoluer leur image et leur rôle d’homme et de père, les faisant entrer dans une véritable crise de l’identité masculine. La religion a subi des remises en question radicales par la disqualification de Dieu. L’État, au lieu de poursuivre son rôle de soutien et de protecteur de la famille, première communauté naturelle, a conduit une politique visant à la fragiliser. Enfin, dans les relations familiales, l’usage de l’affectif et l’exercice de la séduction ont remplacé la peur mais sont tout aussi critiquables : l’absence d’interdit et la crainte d’imposer des choix à nos enfants témoignent de notre désir de leur plaire, mais à leur détriment.
Ainsi, notre rôle très concret de parents n’est pas sans lien avec la question de l’autorité et de ses évolutions.
L’autorité parentale passe par l’énoncé des interdits qui permettent de différencier les choses, de sortir de la fusion ou de la confusion. L’interdit est ce qui inter-dit, ce qui « dit entre » des personnes et ouvre des échanges. L’accepter, c’est accepter l’existence de soi, d’un autre, dans une différence irréductible. Cela fonde le refus de trois types de comportement : se supprimer, supprimer l’autre, et aller vers la régression fusionnelle en niant toute différence. La religion chrétienne les exprime comme des grands commandements :
respecter sa vie, respecter la vie de l’autre, s’interdire la fusion. C’est ainsi que l’autorité passe par la privation, la reconnaissance d’une limite, face à quelque chose qu’on ne peut pas avoir, pas tout de suite.
Les parents doivent pouvoir incarner, dans leurs comportements et dans l’éducation qu’ils donnent au quotidien, les justes limites. Ils donnent de la force en nommant les grands interdits liés à la structuration de la société mais aussi aux lois du pays, de la religion, de la famille. Ils accompagnent l’adolescent dans la connaissance et l’intégration des interdits et des limites par les règles de l’école, du club de loisirs ou de sport et des autres lieux qu’il fréquente. Il faut ajouter que les interdits et les règles doivent être dits, ou même écrits, de façon claire, compréhensible et adaptée à l’âge ou à la situation particulière de l’enfant si nécessaire (maladie chronique, situation de handicap, etc.). Ils doivent faire l’objet d’un échange pour expliciter leur sens et énoncer la sanction ou la réparation qui s’appliquera en cas de non-respect. En effet, être clair quant aux conséquences reste un outil indispensable pour tous. L’adolescent ayant un fort besoin de prévisibilité, cette explicitation sans ambiguïté y participe. Les exigences des enfants s’exprimant souvent de manière croissante, des « non » leur sont opposés clairement tout au long de leur vie et ne doivent pas diminuer à l’adolescence – car il en va de leur sécurité –, dans un échange constant et avec une nécessaire cohérence parentale. Bien que la société soit imprégnée par les notions de plaisir et d’épanouissement de l’individu, il demeure préjudiciable de considérer les limites uniquement comme blessantes, abusives et arbitraires, de n’y voir qu’un carcan pour des désirs qui devraient nécessairement être satisfaits.
Parce qu’il n’est pas facile d’être parent aujourd’hui, il est important de dissocier autorité et infaillibilité car les parents ne savent pas tout et, parfois, sont démunis. Entre autorité en déroute et autorité vide de sens, nous devons reconnaître le dur exercice de celle-ci. Tout en restant fermes, les parents peuvent donner à leur autorité la forme et le fond les plus adaptés à la situation et peuvent faire preuve de souplesse et d’adaptation sur certaines règles. L’autorité passe donc par le fait d’autoriser, de permettre, de dire « oui » à une expérience ou un à choix qui favorisent un espace de liberté. On peut faire acte d’autorité par la réceptivité et la flexibilité, par exemple en autorisant l’enfant ou l’adolescent à se procurer un objet auquel il tient, à disposer d’un espace à lui, ou encore à entreprendre un projet. Osons même dire « oui » à quelque chose qui peut nous faire peur mais qui fera grandir notre adolescent : il nous appartient de lui témoigner de la confiance et de faire preuve d’audace.
Il nous incombe de tenir bon, et fermement. Nous devons être à la fois sûrs de nos positions éducatives et conscients que d’autres sont possibles. Par cette expression : « Cela, j’y tiens », nous allons exprimer la fermeté de nos décisions, de nos promesses, de nos engagements, de nos paroles. Précisément parce que notre adolescent a du prix à nos yeux. Nous devons lui faire savoir que nous sommes prêts à faire le nécessaire pour le protéger et le faire grandir, à trouver le bon dosage entre interdire et autoriser.
Nous sommes invités à comprendre en finesse les changements de notre société dans ce rapport à l’autre et à l’enfant ; à définir les espaces où se joue l’acte d’autorité ; à nous remettre en question sur les moyens utilisés pour dire oui ou non ; à identifier les ressources manquantes pour tenir et tenir bon, encore et encore.
Il nous faudra parfois nous conformer, parfois nous opposer, inspirés par des sages, pour bien discerner ; devenir plus alignés, cohérents et forts. Nous pouvons nous appuyer sur notre légitimité de parents et faire acte d’autorité. Pour, un jour, espérer nous passer de ce pouvoir que nous avons sur notre adolescent parce qu’il sera devenu un adulte qui aura intégré en lui ce qui est interdit et ce qui est possible. Questions pour avancer
• Comment est-ce que j’exerce mon autorité ?
• Quels sont les interdits ou privations que je déploie ?
• Comment favoriser davantage les moments pour pouvoir dire « oui » ?
Un remaniement inédit
Le 16 mars 2020 a marqué une mise à l’arrêt de notre pays, dans un réel état de sidération collectif. Nous avons tous dû réorganiser notre vie et « sortir des rails » pour réinventer le moindre détail de notre quotidien. Comme les guerres ou les catastrophes naturelles passées ou présentes dans le monde, le Covid-19 a fait surgir, comme le décrit bien Marie-Estelle Dupont, une « réorganisation désorganisante1 » de tous les repères spatiaux, temporaux et relationnels qui a particulièrement impacté la jeunesse, interrompue dans le rythme naturel de sa construction identitaire et sociale. Pendant deux ans, nous avons vécu un bouleversement non dénué de conséquences. Fondamentalement, si cette période a été source de découvertes, elle a aussi généré fatigue ou usure à cause de la nécessité de s’adapter sans cesse. Chacun de nous a dû mettre en place des choses nouvelles, puiser dans ses ressources, chercher à surmonter ces moments inédits, et à en apprendre.
Nous avons vécu sans pouvoir nous projeter dans l’avenir, dans un fort sentiment d’insécurité. Les places étaient plus confuses, les repères, moins stables, l’environnement, moins lisible, et donc les angoisses, plus fortes. Sortir représentait le risque de s’exposer à une menace invisible ; faire entrer quelqu’un chez soi était source de méfiance.
Pour tous, les peurs archaïques se sont réactivées, comme celle de la mort, de la guerre, du manque, de la souffrance,
1. Marie-Estelle Dupond, Être parents en temps de crise. Comment restaurer l’équilibre psychique de nos enfants, Paris, Trédaniel, 2023.
de l’isolement. Ce qui fonde notre équilibre relationnel, c’est-à-dire la certitude de pouvoir se retrouver après s’être quitté, a été fragilisé.
Pour les personnes plus fragiles psychiquement, financièrement, matériellement, socialement, ce fut une période très éprouvante, avec des aides peu ou pas suffisantes, qui les a fait parfois basculer dans la pathologie ou la pauvreté. Pour ceux qui avaient déjà vécu des situations d’enfermement, de guerre, d’injustice grave, elle a pu réactiver les traumatismes anciens.
Chaque confinement comportait des modalités nouvelles et chaque déconfinement apportait le risque d’un déséquilibre. Nous, parents, pouvions avoir l’envie de tout lâcher, de craquer face à l’épuisement parental ou professionnel, l’inquiétude économique, le poids de la maladie d’un proche ou le fardeau d’un deuil. Quant aux enfants, ils ont pu subir, lors de leur retour dans le monde « normal », la pression de ne pas être au niveau à l’école, la difficulté de se séparer de leur cercle familial, le stress de reprendre un rythme plus rapide, l’angoisse du monde extérieur.
Le rôle de tout parent est de défendre son enfant du danger et de faire barrage à ce qui l’agresse. Or, il ne fut pas simple de savoir ce qui mènerait à la survie. Sur le moment, la santé physique a été privilégiée au détriment de la santé mentale et, malheureusement, les dégâts sont apparus a posteriori. Il n’a pas été simple pour chacun d’avoir une juste attitude entre adaptation et rébellion, avec des conflits de loyauté, des contradictions entre ses pratiques et ses principes éducatifs et les injonctions du gouvernement. Cela a pu rendre plus ardues certaines décisions et renvoyer à nos enfants une impression de manque de cohérence et de justesse.
Les enfants et adolescents ayant été désireux d’épargner à leurs parents des difficultés supplémentaires, ils ont beaucoup pris sur eux pour s’adapter de leur mieux. Ainsi, pendant cette période, pris dans une contradiction très forte entre leurs besoins et les consignes des adultes, et dépourvus de mots ou d’arguments pour s’opposer à la contrainte, ils ont dû se soumettre. On a alors observé le passage dans un mode d’hypoactivation avec repli sur soi, désinvestissement des apprentissages et/ou des relations, perte d’énergie, ralentissement de la pensée et de l’action, difficultés de concentration, troubles du comportement alimentaire, scarifications, cauchemars, etc. D’autres, au contraire, se sont agités dans un mode d’hyperactivation. Ils ont tenté de manifester la puissance de la vie qu’on ne peut pas éteindre, de lutter contre les angoisses et de chercher à bouger des limites qu’il était difficile de supporter par une colère mal exprimée. D’autres enfin, disposant d’une sécurité interne plus solide ou de parents plus régulés, sont restés sereins et ont développé de nouvelles compétences, ont appris à travailler autrement, et ont renforcé leurs liens avec leurs proches.
Les traces de cette période
Nous avons profité de cette période pour redécouvrir nos enfants, apprendre et travailler autrement, optimiser nos lieux de vie et notre organisation matérielle. Nous avons pu, peut-être, concrétiser un projet, profiter de la nature, ou encore développer notre créativité. Nous avons essayé de ménager nos forces et de revoir nos objectifs, de mettre l’accent sur la communication et l’entraide. Nous avons resserré nos liens avec notre famille proche et nos voisins.
Nous nous sommes tournés vers des relations anciennes ou des personnes qui nous tenaient à cœur pour prendre soin d’elles. Nous nous sommes retrouvés face à nous-mêmes pour vivre une leçon de vie.
Mais nous ne pouvons pas nier que, depuis cette pandémie, les retards de langage, les troubles de la communication, les difficultés dans les interactions sociales, les dépressions, les troubles des comportements alimentaires, les troubles de l’apprentissage (entre autres) ont été et sont encore en très nette augmentation. À cela s’ajoutent la modification du rapport aux écrans, une image du corps altérée, des projections négatives sur l’avenir et une perte de confiance en l’adulte.
S’il était tout petit au moment de cette pandémie, notre enfant a peut-être encore des difficultés à se séparer de nous ou à explorer le monde de façon sereine. S’il avait entre 3 et 10 ans, il a eu moins d’occasions de se faire des amis, d’apprendre, et peut rencontrer une difficulté de socialisation. S’il était jeune adolescent, il peut éprouver le sentiment que son élan d’exploration du monde est cassé, ou vivre une adolescence difficile.
La menace liée au Covid-19 s’étant maintenant estompée, il est possible d’ouvrir un espace d’échanges sur cette période. Il s’agit de faire émerger les mots pour que la mémoire traumatique soit transformée en mémoire autobiographique, de constituer un film dynamique du passé grâce à l’expression de sensations, d’émotions et d’idées. Pour reprendre l’analyse d’Alain Berthoz, « la mémoire du passé n’est pas faite pour se souvenir du passé, elle est faite pour prévenir le futur ». Un tel retour sur son histoire permet de ne pas rester figé dans le passé, d’intégrer une réalité difficile et de se rendre disponible à l’instant présent.
Nous pourrions revisiter cette période en pensant à ce que nous y avons vécu et à ce que nous pourrions en dire aujourd’hui. En calculant l’âge qu’avait notre enfant lors de ces deux années marquées par le Covid-19, nous pouvons essayer d’en saisir l’influence sur lui. Il peut être aussi intéressant de nommer les ressources dont nous avons bénéficié ou celles qui nous ont manqué. Cette évocation peut aussi donner lieu à des moments de rire : nous avons tous des souvenirs drôles à raconter de ces instants, et l’humour permet de mettre à distance les choses difficiles et de les intégrer plus doucement.
Nous pouvons aussi réconforter notre adolescent, le remercier pour son attitude, ses efforts pendant ces années-là. Et lui faire part de notre vécu, de notre analyse, avec sincérité, dans la limite de ce qu’il peut entendre et comprendre.
Nous avons traversé cette tempête ensemble et ce fut une aventure collective. Nous pouvons remettre en place des attitudes ou des habitudes qui nous ont fait du bien car
rien ne nous empêche de maintenir certaines belles choses de ce temps-là ou de revenir à elles.
Par nos échanges, nous pouvons essayer de trouver les actions à mettre en place pour nous défaire du sentiment de danger qui peut être encore actif.
Cette crise nous oblige à repenser notre éducation, à reposer notre liberté de parents et, comme toute crise, doit nous amener à de beaux et fructueux changements.
Questions pour avancer
• Que puis-je raconter du bien que je retire de cette crise ?
• Quelles traces douloureuses ai-je gardées de cette période ?
• Qu’en ressort-il comme leçons de vie pour moi, pour mon adolescent ?
Chapitre premier. Quel regard sur l’adolescence ? ..........90
De nombreux changements
Sur le plan du temps
Sur le plan
Sur le plan cognitif..............................................................93
Sur le plan affectif
Sur le plan
Sur le plan
Sur
La crise d’adolescence ...................................................98
Le passage vers l’âge
Les besoins spécifiques à l’adolescent
L’adolescence en crise
Chapitre 2. Quelle est sa quête de limites ? .................112
L’enjeu du choix ..........................................................112 L’éducation au choix ..........................................................112
Les comportements des adolescents face aux choix .........115
La nécessaire confrontation ..............................................122
L’apprentissage du discernement .......................................124 Acquérir une méthode de discernement..............................
Réfléchir aux valeurs qui motivent et transcendent les actions
Apprendre à nager à contre-courant .................................
S’informer et échanger sur l’état du monde
à communiquer ...............................................
L’aider à évaluer les fruits issus de son choix ....................
L’importance de se sentir « contenu » ...........................129
La fonction de porter et supporter ...................................129
La force d’être plusieurs ....................................................130
La mise en place des limites .............................................132
La régulation des émotions et des pensées .......................135
L’intérêt d’une juste résistance ....................................137
La reconquête des capacités de concentration ..................137
La capacité de contrôle .....................................................139
La place de la patience et de la persévérance ...................142
Le bon combat ..................................................................144
Chapitre 3. Comment l’encourager à grandir ? .............149
L’écoute des ruptures ..................................................149
Les décalages du développement corporel ........................149
Les fluctuations de l’appétit ..............................................151
Les addictions ...................................................................153
Les fugues .........................................................................154
L’apprivoisement de la perte .......................................157
L’acceptation de l’échec .....................................................157
Le chemin du deuil ...........................................................160
Les élans parentaux ....................................................165
La reconnaissance qu’il grandit .........................................165
La place à partager ............................................................167
Le consentement à vieillir .................................................169
Chapitre premier. Sur qui veiller ? ...............................174
S’accorder au sein du couple parental ..........................174
Être au clair sur notre couple conjugal .............................174
Partager en tant que parents .............................................177
Continuer à accompagner son éducation ..........................179
Mobiliser des ressources ....................................................181
Entrer dans une dynamique personnelle ......................184
Faire le point sur son équilibre de vie ..............................184
Acquérir des connaissances ...............................................186
Relire la vie de notre adolescent .......................................187
Travailler sur son propre passé ..........................................188
Prendre en compte la fratrie ........................................192
Considérer la fratrie ..........................................................192
Aimer ses enfants de façon unique ...................................192
Veiller au rôle et à la place de chacun ..............................193
Prendre soin de tous .........................................................195
Être tous des vigies .....................................................196
Connaître ses pairs ............................................................196
Veiller et surveiller ensemble.............................................197
Ne pas peser ......................................................................197
Chapitre 2. Quelle juste place auprès de lui ? ...............200
Adopter les bonnes attitudes .......................................200
Prendre du temps ..............................................................200
Nous faire confiance et être humbles ................................201
Agir en fonction du « style d’attachement » construit ......202
Échanger avec lui .......................................................203
Devenir un artiste du dialogue .........................................203
Mettre les bonnes conditions à la communication ...........205
Oser la confrontation ........................................................207
Développer une juste connexion-déconnexion aux écrans...................................................................208
Dompter les écrans ...........................................................208
Quelques règles .................................................................210
Quel écran ? Pour quoi faire ? Pour combien de temps ? ... 210
Priorité à la santé, à la sécurité et à ceux qui sont là ........ 211
Instituer des garde-fous .................................................... 211
Ne pas tout dire, réfléchir avant de publier....................... 211
Lui faire prendre conscience de sa responsabilité................ 212
Le protéger des contenus violents et des manipulations...... 212
Guider son parcours scolaire .......................................213
Être un partenaire de l’école .............................................213
Le soutenir dans ses apprentissages ..................................215
Accompagner son orientation ...........................................217